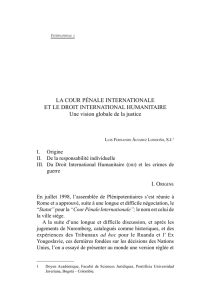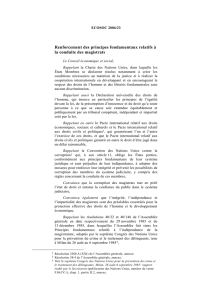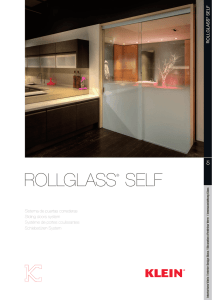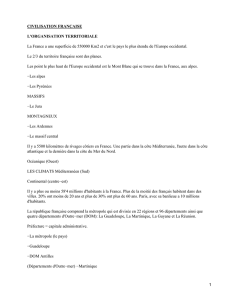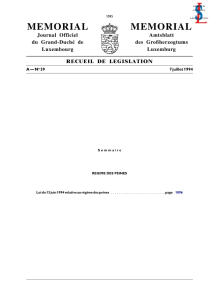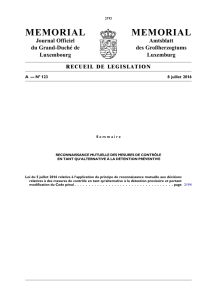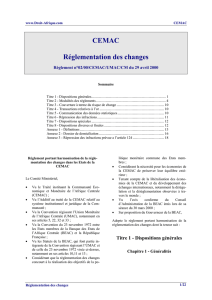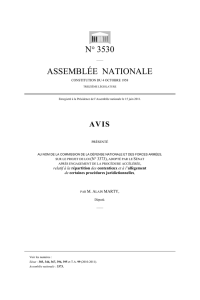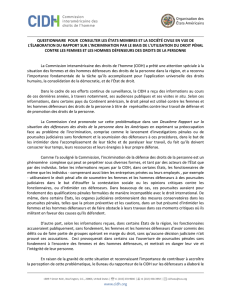Droit pénal général et procédures pénales by Bernard Bouloc Haritini Matsopoulou (z-lib.org)
Anuncio

international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889512693:88866209:196.200.176.177:1593004351 0$18(/ ,17e*5$/ FRQFRXUV 'URLWSpQDOJpQpUDO HWSURFpGXUHSpQDOH HpGLWLRQ À jour ns des dispositio i lo de et oj du pr ion at m m ra og de pr 2018-2022 e et de réform e ic st ju la pour %HUQDUG%RXORF+DULWLQL0DWVRSRXORX 5HVSRQVDELOLWpSpQDOH (QTXrWHVHWSURFqV ([pFXWLRQGHVVDQFWLRQV international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889512693:88866209:196.200.176.177:1593004364 Avertissement Cet ouvrage a été rédigé, en premier lieu, par Georges Levasseur (Professeur honoraire à l’Université Panthéon-Assas/Paris II) et Albert Chavanne (Professeur émérite à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin/Lyon III). Ils se sont adjoints, ultérieurement, Jean Montreuil (Commissaire divisionnaire). Depuis la 14e édition, il est l’œuvre de Bernard Bouloc et de Haritini Matsopoulou. Madame Haritini Matsopoulou a rédigé le chapitre préliminaire, la première partie (Droit pénal général), le chapitre 4 de la deuxième partie (La recherche des infractions), ainsi que les développements consacrés à la prescription de l’action publique et au principe de la loyauté dans la recherche des preuves. Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d’alerter le lecteur sur la menace que représente pour l’avenir de l’écrit, particulièrement dans le domaine de l’édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage. Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s’est généralisée dans les établissements d’enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l’auteur, de son éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC, 20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris). Éditions DALLOZ 31-35 rue Froidevaux, 75685 Paris cedex 14 Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5, 2° et 3° a), d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. © Éditions DALLOZ – 2018 ISBN 978-2-247-17847-6 978-2-247-18120-9 Chez le même éditeur Dans la même collection international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889512693:88866209:196.200.176.177:1593004373 Administrations et fonctions publiques en France, S. Salon et J.-C. Savignac, 2002. Droit européen et droit de l’Union européenne, P. Dollat, 3e éd., 2010. Droit public, G. Siat et P. Georges, 16e éd., 2011. Leçons d’économie contemporaine, sous la dir. de I. Samson, 2e éd., 2009. Finances publiques, R. Muzellec, M. Conan, 16e éd., 2013. Institutions françaises et européennes : bilan et perspectives, P. Gévart, 2003. Leçons de droit social et de droit de la santé, R. Pellet et A. Skzryerbak, 2e éd., 2008. Collection Spécial concours Attaché territorial, E. Ambacher, F. Bouvrain, M. Boyer, H. Duranton, M. Frangi, D. Miranda, 6e éd., 2018. Commissaire de police. Officier de police. Officier de gendarmerie, sous la dir. de F. Debove, 7e éd., 2017. Inspecteur des finances publiques et des douanes, sous la dir. de G. Siat, 4e éd., 2016. IRA Instituts régionaux d’administration, J.-C. Savignac, 3e éd., 2010. Magistrat, sous la dir. de F. Debove, 8e éd., 2018. Contrôleur des finances publiques et Contrôleur des douanes, sous la dir. de J. Serba, 3e éd., 2014. Rédacteur territorial, sous la dir. d’A.-S. Hardy-Dournes, 5e éd., 2013. Secrétaire administratif/SASU, sous la dir. de V. Cattoir-Jonville, 2005. Collection M&thod Les épreuves de culture générale. Compositions et oraux, S. Salon et J.-C. Savignac, 8e éd., 2006. La note de synthèse, S. Salon et J.-C. Savignac, 8e éd., 2008. Techniques de l’expression écrite et orale, D. Baril, 11e éd., 2008. Collection Dictionnaires Sirey Dictionnaire de droit administratif, A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, 7e éd., 2015. Dictionnaire du droit constitutionnel, M. de Villiers, A. Le Divellec, 11e éd., 2017. Dictionnaire d’économie, sous la dir. de F. Renversez, 2e éd., 2002. Dictionnaire de sciences politiques, D. Alcaud, L. Bouvet, J.-G. Contamin, X. Crettiez, S. Morel, 2e éd., 2010. Dictionnaire thématique histoire géographie, D. Brand et M. Durousset, 8e éd., 2007. Petit dictionnaire de culture générale, D. Baril, 2e éd., 2006. Collection QCM 100 QRC en droit public. 100 Questions en culture générale. 100 Questions en droit civil et procédure civile. 100 Questions en droit pénal et procédure pénale. 100 Questions en droit public. 100 Questions en droit social. 100 Questions en droits et libertés fondamentaux. 100 Questions en économie. 100 Questions en finances publiques. 100 Questions en introduction au droit. 100 Questions sur les collectivités territoriales. 100 Questions sur les conflits mondiaux. 100 Questions sur le président de la République. 100 Questions sur l’Union européenne. IV Liste des abréviations international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889512693:88866209:196.200.176.177:1593004379 Sommaire ........................................................................ Chapitre préliminaire VII Prolégomènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Première partie 1 L’infraction Chapitre 1 Les classifications des infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Chapitre 2 La légalité criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Chapitre 3 L’élément matériel de l’infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Chapitre 4 L’élément moral de l’infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Chapitre 5 Les causes de non-responsabilité 149 ....................................................... Chapitre 6 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices Deuxième partie ................. 195 2 Le procès pénal, étude de la procédure pénale Chapitre 1 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal .......................... 239 Chapitre 2 Les juridictions répressives et leur compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Chapitre 3 La preuve dans le procès pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Chapitre 4 La recherche des infractions .............................................................. 335 Chapitre 5 La poursuite des infractions ............................................................... 485 Chapitre 6 L’instruction préparatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 V ...................................................................................... Chapitre 8 Les voies de recours .......................................................................... Chapitre 9 L’autorité de la chose jugée Troisième partie La peine international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889512693:88866209:196.200.176.177:1593004384 Chapitre 7 Le jugement ................................................................ 563 593 619 3 Chapitre 1 Les diverses classifications des peines et mesures de sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 Chapitre 2 La fixation de la sanction .................................................................... 659 Chapitre 3 L’exécution des peines et mesures de sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 Chapitre 4 L’extinction de la peine ou de la mesure de sûreté – L’effacement de la condamnation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 Index alphabétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889512693:88866209:196.200.176.177:1593004389 Liste des abréviations AJ pénal APJ APJA Art. Ass. plén. Actualité juridique pénal Agent de police judiciaire Agent de police judiciaire adjoint Article Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation Bull. crim. Bull. Joly Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation Bulletin mensuel Joly d’information sur les sociétés C. civ. C. com. C. consom. C. douanes CE CEDH C. envir. CESEDA CGI Chron. Circ. Civ. CJM C. mon. et fin. Comm. Cons. const. COJ Cour EDH C. pr. pén. CSI CSP CSS C. trav. Crim. C. route D. DC Code civil Code de commerce Code de la consommation Code des douanes Conseil d’État Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme Code de l’environnement Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Code général des impôts Chronique Circulaire Arrêt d’une chambre civile de la Cour de cassation Code de justice militaire Code monétaire et financier Commentaire Conseil constitutionnel Code de l’organisation judiciaire Cour européenne des droits de l’Homme Code de procédure pénale Code de la sécurité intérieure Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code du travail Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation Code de la route Décr. Décr.-L. Dr. pénal Recueil Dalloz Recueil critique de jurisprudence et de législation Dalloz (années 1941 à 1944) Recueil périodique et critique mensuel Dalloz (années antérieures à 1941) Décret Décret-Loi Droit pénal Gaz. Pal. Gazette du Palais DP IR JAP JCP J.-Cl. Pén. JDI Informations rapides du Recueil Dalloz Juge de l’application des peines Juris-Classeur périodique (Semaine juridique) Juris-Classeur pénal Journal de droit international Clunet VII OIPC ONU OPJ Ord. PV QPC Rec. CE Rev. crit. DIP Rev. pol. nat. Rev. sociétés RI crim. et pol. tech. RJ com. RSC S. T. corr. TGI TPI T. pol. Petites Affiches Organisation internationale de la police criminelle Organisation des Nations unies Officier de police judiciaire Ordonnance Procès-verbal international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889512693:88866209:196.200.176.177:1593004394 LPA Question prioritaire de constitutionnalité Recueil des arrêts du Conseil d’État (Lebon) Sirey Revue critique de droit international privé Revue de la police nationale Revue des sociétés Revue internationale de criminologie et de police technique Revue de jurisprudence commerciale Revue de sciences criminelles Recueil Sirey Tribunal correctionnel Tribunal de grande instance Tribunal pénal international Tribunal de police international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 Chapitre préliminaire Prolégomènes 1 Les règles adoptées par les pouvoirs publics, afin de maintenir une certaine harmonie dans le corps social, ne sont jamais intégralement respectées. En quelque groupe humain, en quelque temps que ce soit, nombreux sont les individus qui, mus par divers instincts (celui d’appropriation ou l’instinct sexuel, par exemple) ou animés de pulsions irrationnelles (telles que l’agressivité des vandales contemporains prenant plaisir, semble-t-il, à détruire le bien d’autrui), transgressent les normes édictées par l’autorité, en vue de préserver ou de rétablir l’ordre public, c’est-à-dire, essentiellement, la tranquillité publique, la sécurité des personnes, des biens, la défense des institutions auxquelles la société a confié la gestion de la chose publique, enfin le respect des libertés publiques reconnues et garanties aux citoyens de tout État de droit. Certains de ces comportements antisociaux – ceux qui causent à l’ordre public un trouble d’une certaine gravité (V. infra, no 6) – constituent le phénomène criminel que le droit pénal décrit et sanctionne. Il convient ici : de définir le droit pénal et son fondement • § 1 – de rappeler son évolution en insistant, d’une part, sur la publication du nouveau Code pénal, d’autre part, sur les importantes modifications apportées au Code de procédure pénale • § 2 – d’évoquer ses fonctions et ses moyens • § 3 – enfin de décrire son contenu • § 4. 1 § 2 1 Définition et fondement du droit pénal L’expression « droit pénal », entendue dans son acception la plus large, désigne la branche du droit positif ayant pour objet l’étude de la répression par l’État des comportements de nature à créer un trouble intolérable pour l’ordre social. 2 A. Le droit pénal est une branche du droit positif 3 Il ne s’agit pas d’un droit idéal ou d’un droit naturel, mais d’un ensemble de règles de droit positif, de normes écrites, auxquelles sont attachées des sanctions particulièrement 3 1 4>4 Chapitre préliminaire – 4 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 énergiques, les peines, d’où le nom de droit pénal, l’appellation « droit criminel » découlant du fait que les agissements les plus graves ainsi réprimés sont aussi appelés crimes. Le droit pénal ne saurait être confondu avec la morale. Les rapports entre celle-ci et le droit pénal sont évidents en ce qui concerne un certain nombre de dispositions répressives : tuer son prochain, c’est transgresser une règle fondamentale et ancestrale de la vie en société – ainsi qu’en porte témoignage le décalogue – qui ressortit tout à la fois au droit naturel, à la morale communément admise et au droit pénal, mais on peut multiplier les exemples de comportements appelant une sanction pénale – parce que troublant l’ordre public – sans constituer une faute morale : l’inattention dont procède une blessure infligée à autrui, l’inobservation d’un arrêté de police en matière de stationnement des véhicules ressortissent au droit pénal, sans être ressenties moralement comme blâmables. À l’opposé, innombrables sont les comportements que condamne peu ou prou une certaine morale sans pour autant être réprimés pénalement : ainsi en est-il de l’adultère (sanctionné pénalement en France, dans certaines hypothèses, jusqu’en 1975), du suicide (réprimé dans le droit de l’Ancien Régime); ainsi en est-il encore de la réception consciente d’une somme indue et du non-paiement d’une dette (qui peuvent donner lieu à une instance civile), ou encore du mensonge (sous réserve que celui-ci ne revête pas l’une des formes réprimées par le Code pénal, telles que l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité sanctionné au titre du délit d’escroquerie). Le droit pénal, qui procède pour une bonne part de la morale au sens large (et ne saurait sans péril entrer en conflit avec celle qui est communément admise dans une société et à un moment déterminé), ne cherche pas à perfectionner moralement l’individu; il se préoccupe, plus prosaïquement, de faire régner un certain ordre dans la société, même de façon purement extérieure. Le droit pénal et la morale sont deux cercles concentriques, le rayon de la morale étant plus grand que celui de la législation pénale (B. Bouloc, Droit pénal général, 25e éd., Dalloz, 2017, no 24). À cet égard, E. Garçon écrivait que le droit et la morale peuvent être comparés à deux cercles qui, se chevauchant, ont à la fois une aire commune et des surfaces propres (E. Garçon, Le droit pénal; origine, évolution, état actuel, Payot, 1922, p. 131). En réalité, le droit pénal peut paraître avoir un champ d’application plus vaste que la morale, dans la mesure où il sanctionne certains agissements indifférents à celle-ci, en raison du trouble qu’ils provoquent à l’ordre public (par exemple, le cas des délits prévus par le Code de l’environnement ou certaines contraventions au Code de la route). Les lois étant « les rapports qui découlent de la nature des choses » (Montesquieu), on ne saurait s’étonner du caractère éminemment évolutif de la loi pénale. La morale contemporaine présente de grandes différences avec celle qui était communément admise sous le premier Empire, et le monde qui nous entoure a considérablement évolué depuis la publication du Code pénal de 1810. Songeons, à titre d’exemple, aux effets de la révolution industrielle engagée au XIXe siècle et poursuivie à un rythme accéléré depuis quelques décennies. Dans le même trait de temps, les exigences du respect des droits de l’Homme (proclamés en 1789 mais souvent bafoués…) s’affermissaient, tandis que la criminalité revêtait des formes nouvelles particulièrement dangereuses pour l’ordre public et requérant, corrélativement, l’adoption de dispositions répressives nouvelles et la création de nouveaux services de police lato sensu. Ainsi, la constitution de bandes de malfaiteurs, usant de toutes les ressources de l’essor technique au début du XXe siècle, a conduit à la formation des « brigades mobiles » (V. infra, no 593); ainsi le caractère international de certaines formes de criminalité (procédant, en particulier, de la possibilité 4 2 Prolégomènes international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 pour les malfaiteurs de se déplacer avec une extrême rapidité) a provoqué la création de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL), (V. infra, no 144), et a suscité l’adoption de la Convention contre la criminalité transnationale organisée par les Nations unies (la Convention de Palerme, ratifiée par la France le 24 juillet 2002), ainsi que la réaction du législateur français qui en a tiré les conséquences avec les lois no 2004204 du 9 mars 2004 (JO 10 mars 2004, p. 4567) ayant pour objectif de lutter contre la criminalité organisée et no 2016-731 du 3 juin 2016 tendant à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement; ainsi la crainte légitime d’un « déficit de sécurité », procédant de l’ouverture des frontières intérieures de l’Europe, a déterminé les États concernés à souscrire l’Accord de Schengen et sa Convention d’application, et à adopter, le 13 juin 2002, la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen, qui apportent des accommodements au principe de la souveraineté nationale des signataires (V. infra, no 153). En France, ces profondes modifications, les « valeurs de notre temps », le souci de mieux respecter les droits de l’Homme et la nécessité de combattre plus efficacement la criminalité contemporaine ont amené le législateur à abroger le Code pénal de 1810, lui substituant un nouveau Code pénal, et à modifier sensiblement de très nombreuses dispositions du Code de procédure pénale (V. infra, nos 20 et s.). Le droit pénal est le plus positif des droits, écrit-on, ajoutant que, droit sanctionnateur par excellence, il intervient, en quelque sorte, au second degré. Le droit civil, le droit commercial, le droit disciplinaire, le droit administratif, etc., ont, en effet, leurs sanctions propres, et on peut considérer que le législateur pénal intervient alors pour ériger en infraction tel ou tel manquement particulièrement grave aux règles du droit civil ou commercial ou disciplinaire, etc. C’est ainsi que dans un contrat civil (une vente, par exemple), le dol du contractant, qui ressortit le plus souvent au droit civil, appelle une sanction pénale, lorsqu’il revêt le caractère intolérable pour l’ordre public des manœuvres frauduleuses prévues et réprimées par les articles 313-1 et suivants du Code pénal. À côté du dol civil, existe un dol criminel inacceptable pour l’ordre public et appelant donc une sanction pénale. 5 5 – S’il est vrai, comme l’écrivait Lesage, que « Tous les hommes aiment s’approprier le bien d’autrui, les manières seules de le faire étant différentes », on peut écrire que le droit pénal sanctionne en l’occurrence les « manières » les plus mauvaises, les plus dangereuses pour l’ordre public. En d’autres termes, l’ordre public, dont le droit pénal assume la défense, ne se confond pas avec « l’ordre juridique privé » (B. Bouloc, Droit pénal général, op. cit., no 6). – La thèse, selon laquelle le droit pénal serait un droit sanctionnateur au second degré (Portalis allait même jusqu’à écrire que les lois criminelles sont « moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres »), peut induire en erreur, en ce sens qu’elle risque d’estomper le principe selon lequel le fondement du droit pénal est sui generis. On ne saurait voir entre cette discipline juridique et les autres branches du droit une simple différence de degré; aussi bien, peut-on observer que certains comportements sanctionnés pénalement sont pratiquement indifférents au droit civil (ainsi en est-il des atteintes à la sûreté de l’État ou du blanchiment de l’argent ayant une provenance illicite). 6 Il importe donc de souligner que le droit pénal a pour fondement la défense de l’ordre public – notion éminemment évolutive – contre les comportements estimés incompatibles avec celui-ci. Il s’agit là d’une notion spécifique, la « frontière » entre les comporte6 3 7>9 Chapitre préliminaire ments requérant une sanction pénale, d’une part, et ceux qui échappent à toute critique ou ne relèvent que d’autres sanctions (civiles, disciplinaires, par exemple), d’autre part, étant d’un tracé aussi délicat que fluctuant. Il importe, tant pour le maintien de l’ordre public (sans lequel aucune vie en société n’est concevable) que dans l’intérêt des citoyens (qui doivent savoir ce qu’il leur est interdit de faire sous peine de sanction pénale), que le seuil de réprobation pénale soit fixé aussi clairement et précisément que possible par des textes. Tel est l’un des fondements essentiels du droit pénal. Les textes répressifs constituent le meilleur rempart contre l’arbitraire des juges et les abus d’autorité des autres représentants de la puissance publique (comme en témoignent les tribulations des textes et de la jurisprudence relatifs aux contrôles et vérifications d’identité ou à la visite des véhicules ou des locaux), tant il est vrai que « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser », ainsi que l’écrivait Montesquieu. 7 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 7 B. Le droit pénal organise la répression par l’État de certains comportements 8 Le droit pénal ne s’occupe que de la répression par l’État. Il se distingue d’autres branches du droit offrant quelque analogie, tel le droit disciplinaire. Celui-ci établit des règles qui s’imposent aux membres de certains groupements (groupement professionnel, fonctionnaires, association, etc.); ce droit – qui a ses sanctions propres – se développe selon une technique différente de celle du droit pénal. À noter qu’un fait peut constituer tout à la fois une infraction pénale et une faute disciplinaire (par exemple violences illégitimes commises par un policier) et donc donner lieu à sanction sur les deux plans, tandis qu’un autre fait (désobéissance du fonctionnaire au supérieur hiérarchique, par exemple) ne peut donner lieu qu’à sanction disciplinaire (à moins qu’en agissant comme il l’a fait, le fonctionnaire ait enfreint la loi pénale). 9 Du fait que le droit pénal organise « la répression par l’État », il ressort que nous sommes en présence d’une branche du droit public; en effet, il met en cause les rapports des individus avec l’État et avec certains services de l’État (Justice, Police, Administration pénitentiaire, etc.). 8 9 – Pourtant, le droit pénal, quoiqu’appartenant incontestablement au droit public par sa nature, est traditionnellement rapproché du droit privé. Il en est ainsi parce que souvent l’infraction (c’est-à-dire le fait d’avoir enfreint une prescription de la loi pénale) cause non seulement un trouble social mais aussi un préjudice individuel, et que sa victime va demander la réparation du dommage subi. Au problème de droit public se superpose alors un règlement entre particuliers, qui se déroule sur le terrain du droit privé. Or, le droit français permet à la victime d’une infraction de porter son action civile en réparation contre l’auteur du dommage devant le tribunal répressif, en même temps que l’action publique exercée par le ministère public au nom de la société contre le délinquant (V. infra, nos 322 et s.). En outre, certaines notions sont communes au droit privé et au droit pénal; ainsi en est-il de la notion de faute, base de la responsabilité pénale comme de la responsabilité civile (V. toutefois les réserves formulées, infra, no 19 et spéc. nos 185 et s.). Enfin, on rapproche le droit pénal du droit privé à raison du fait que les juridictions, qui sont appelées à appliquer le droit pénal, sont des juridictions judiciaires et non pas les juridictions administratives qui connaissent habituellement des procès de droit public (il en est ainsi parce que l’on pense réaliser de cette façon une meilleure protection 4 Prolégomènes de la liberté individuelle, l’article 66 de la Constitution indiquant que l’autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle »). Le droit pénal sanctionne des « comportements » déterminés. Ce terme vague doit être employé parce que l’inobservation de la loi pénale peut se présenter sous des formes diverses : tantôt – le plus souvent – il s’agira d’agissements positifs consistant à accomplir un acte interdit (exemple : meurtre, vol), tantôt il s’agira de comportements négatifs (omissions ou abstentions), consistant à ne pas accomplir un acte imposé (exemple : défaut de secours à personne en péril, art. 223-6 C. pén.). 10 § 2 Évolution du droit pénal Le droit pénal paraît la plus ancienne des branches du droit; les dispositions des lois antiques ou barbares parvenues jusqu’à nous sont presque toutes d’ordre répressif. On peut écrire qu’il est contemporain de l’établissement des premières autorités sociales dans la tribu ou dans la cité. Aux temps les plus anciens, la victime d’un dommage infligé par autrui assouvissait elle-même et librement sa vengeance; plus tard elle n’a pu satisfaire celle-ci que sous le contrôle des pouvoirs publics (période de la justice privée), mais depuis bien longtemps la justice pénale est une justice publique, rendue au nom du corps social, sans qu’il soit nécessaire, sauf exception, que la victime intervienne, et destinée à réparer le trouble social causé par l’infraction. 11 1 – 12 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 10 Les droits anciens se montrent rigoureux, tant quant aux peines appliquées que dans la procédure suivie. Ainsi, le droit au Moyen Âge était cruel, inégal selon la condition sociale, et laissait un assez large arbitraire au roi et aux juges. La procédure, dite inquisitoire, était alors secrète, écrite, non contradictoire; fort dangereuse pour la liberté individuelle, elle comportait l’usage de la « question », c’est-à-dire de la torture, pour obtenir l’aveu des personnes poursuivies. Le système tendant à l’imputabilité des infractions (lesquelles ne comportaient pas toujours – il s’en faut – de définition) était dit des preuves légales, formule derrière laquelle on trouvait – outre la question et son corollaire, l’aveu (« reine des preuves »), – une arithmétique compliquée de fractions de preuve relevant de la casuistique. Au XVIIIe siècle, l’œuvre du milanais Beccaria, qui connut un grand retentissement dans toute l’Europe et notamment en France auprès des philosophes et des encyclopédistes, attira l’attention sur la nécessité d’établir une répression plus modérée, plus respectueuse de la dignité humaine et aussi plus efficace, parce que plus rationnelle dans la recherche des preuves. Ces idées, ainsi que les campagnes célèbres de Voltaire en faveur d’une justice moins archaïque, trouvèrent un aboutissement législatif provisoire en France à l’époque révolutionnaire. Elles inspirèrent largement les deux codes promulgués sous l’Empire (encore que ceux-ci demeurèrent – la dureté des temps le requérant et l’autoritarisme de l’Empereur y incitant – d’une grande rigueur) : le Code pénal (1810), demeuré en vigueur jusqu’en 1994, consacré au droit pénal général et au droit pénal spécial (V. infra, nos 38 et s.) – le Code d’instruction criminelle (1808), qui traitait de la procédure pénale. Le Code d’instruction criminelle de 1808 laissait la place, en 1959, au Code de procédure pénale, modifié à de très nombreuses reprises (V. infra, no 20), tandis que le nouveau Code pénal était substitué en 1992 au code de 1810. 12 5 13 > 14 Chapitre préliminaire 13 Il convient d’observer ici, avant d’évoquer les dispositions du nouveau Code pénal : 1° que le législateur était fréquemment intervenu depuis 1810 afin d’adoucir considérablement les pénalités prévues par le Code pénal, les mettant en harmonie avec l’évolution des mœurs (suppression des travaux forcés exécutés outre-mer – abolition de la peine de mort – création de peines de substitution tendant à éviter au condamné la promiscuité criminogène des prisons – contraventionnalisation de certains délits – suppression de diverses incriminations, ainsi l’adultère); 2° que nombreux furent les articles du Code pénal créés ou modifiés afin d’adapter la répression à l’évolution des techniques lato sensu ou pour assurer la défense de nouvelles « valeurs » sociales, tandis que de nombreuses dispositions de lois spéciales (non intégrées au Code pénal) poursuivaient le même objectif (ainsi en est-il du Code de la route, du Code de l’urbanisme, du Code de la santé publique, etc.). Ainsi, la loi du 17 juillet 1970 a prévu des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui fracturent la vie privée de leurs concitoyens à l’aide d’appareils acoustiques ou optiques. Par ailleurs, certaines formes de délinquance, ayant causé une émotion particulière dans le public, ont fait l’objet d’incriminations nouvelles (ainsi en est-il des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données); 3° que très importantes furent les modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle (depuis 1959 au Code de procédure pénale qui a succédé à celuici) afin de libéraliser le droit pénal : en permettant au juge, en particulier par le jeu des circonstances atténuantes (institution aujourd’hui disparue), de descendre bien au-dessous du minimum de la peine prévue par la loi – en reconnaissant à la personne poursuivie des « droits de la défense » toujours plus étendus et mieux garantis – en réglementant plus étroitement la mise en détention provisoire avant jugement, etc.; 4° que la pratique de la correctionnalisation judiciaire (V. infra, no 437) permettait au juge de tempérer les rigueurs excessives qui subsistaient dans le Code pénal, les peines prononcées depuis plusieurs décennies n’ayant parfois qu’un lointain rapport avec les sanctions prévues par la loi; 5° que l’évolution des mœurs avait de surcroît déterminé le juge à abandonner progressivement, en fait, l’application de certaines dispositions de la loi pénale; ainsi les textes relatifs à l’outrage public à la pudeur n’étaient-ils plus, depuis bien longtemps, interprétés comme ils le furent il y a un siècle; de même, les délits de mendicité et de vagabondage étaient-ils, depuis des dizaines d’années, tenus pour obsolètes; 6° que l’autorité judiciaire est, depuis plusieurs décennies, associée étroitement à l’exécution des peines, pratiquant en l’occurrence une politique libérale qui n’emporte pas toujours l’adhésion de l’opinion publique (l’usage extensif par le juge de l’application des peines des « permissions de sortir » a été l’objet de critiques, dont la Chancellerie avait contesté le bien-fondé). 14 La genèse du nouveau Code pénal, fort longue et marquée de péripéties, ne saurait être évoquée ici que succinctement (V. pour plus de détails : Badinter, Projet de nouveau Code pénal, Dalloz, 1988. – Circ. G. des s., Crim. 92-12/F. 1, 24 juill. 1992. – Pradel, Le nouveau Code pénal, Dalloz, 1993. – Vermelle, Le nouveau droit pénal, Coll. « Connaissance du droit », Dalloz, 1994). 14 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 13 En 1974, a été instituée une Commission chargée de « réviser le Code napoléonien », qui a publié en 1976 un projet de « partie générale » suscitant nombre de critiques (V., sur ce point, G. Levasseur, 6 Prolégomènes international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 « Le problème de la codification en matière pénale en droit français », in Mélanges offerts à Robert Legros, Éd. Univ. Bruxelles 1985, p. 399 et s.). – À la suite de ces observations, la Commission a présenté, en 1978, le texte d’un projet dit définitif, ce projet, revu par le groupe dirigé par le garde des Sceaux, M. Badinter, a été déposé en février 1986, juste avant une nouvelle alternance politique. À la question : « Pourquoi un nouveau Code pénal ? », M. Badinter répondait qu’en dépit des modifications apportées au code de 1810, celui-ci apparaissait archaïque, inadapté, contradictoire, incomplet. Il considérait que le nouveau code devait : « exprimer les valeurs de notre temps », être « inspiré par les droits de l’Homme », « protéger les plus faibles », etc., enfin être conçu selon une « méthodologie » le rendant « accessible à tous » et permettant ainsi à l’axiome « Nul n’est censé ignorer la loi » de retrouver sa portée (op. cit.). – En 1989, le président de la République annonçait son intention de faire voter un « nouveau code ». Les travaux parlementaires étaient alors engagés et en juillet 1992, le Parlement votait, au cours d’une session extraordinaire, les quatre lois (L. no 92-683 à no 92-686, 22 juill. 1992) qui constituent le « nouveau Code pénal ». 15 On a pu écrire que le nouveau code, « fait de nombreux compromis, a perdu les aspérités qui caractérisaient le projet de 1976-1979, sauf la responsabilité pénale des personnes morales », et que « des sujets graves, comme le sort des malades mentaux acquittés et celui des mineurs délinquants ont été renvoyés à des lois séparées » (op. cit.). En tout cas, le nouveau Code pénal « ne vient pas révolutionner notre droit positif […]; il s’inscrit autant dans une logique de continuité que dans une logique d’évolution ». 16 Il convient de souligner toutefois l’importance : 1° de la reconnaissance dans le nouveau code de la contrainte (V. infra, no 254), de la légitime défense des biens (V. infra, nos 207 et s.) et de l’erreur inévitable sur le droit (V. infra, no 259) comme causes d’irresponsabilité pénale; 2° de la consécration, par le nouveau code, de la responsabilité pénale des personnes morales (V. infra, no 277); 3° des modifications apportées au système des peines; pour chaque infraction n’est fixé que le maximum de la peine encourue, les circonstances atténuantes étant supprimées; l’emprisonnement disparaît en matière contraventionnelle (il n’était qu’exceptionnellement prononcé même pour les contraventions de 5e classe); 4° des incriminations nouvelles et des circonstances aggravantes nouvelles ou aménagées, tendant en particulier à assurer une meilleure protection des personnes particulièrement vulnérables ou à sanctionner plus fermement certaines manifestations de la criminalité contemporaine (actes de barbarie, proxénétisme en bande organisée, terrorisme, trafic de stupéfiants, etc.), les nouveaux textes modifiant souvent des textes antérieurs; 5° des modifications apportées à la définition même de certaines infractions (par exemple s’agissant du délit d’abus de confiance, le législateur a élargi le champ d’application de l’incrimination par suppression de l’énumération des contrats en vertu desquels la chose détournée doit avoir été confiée au prévenu); 6° de la création des incriminations de mise en danger délibérée d’autrui. 17 15 16 La loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, « relative à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur » (JO 23 déc. 1992), dite loi d’adaptation, com- 17 7 18 > 19 Chapitre préliminaire international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 porte d’importantes dispositions (outre les modifications de terminologie indispensables : ainsi aux expressions « excuses absolutoires » et « excuses atténuantes » est substituée la dénomination de « causes légales d’exemption ou de diminution de la peine »). On notera : 1° que l’ancien Code pénal est abrogé en totalité (et que le nouveau code ne reprend pas toutes les incriminations de l’ancien); 2° que certaines dispositions sont transférées, soit du Code pénal dans le Code de procédure pénale (ainsi en est-il des textes relatifs au calcul des peines privatives de liberté, aux déchéances et incapacités), soit de diverses lois spéciales (ou de codes spéciaux) dans le nouveau Code pénal (ainsi en est-il des textes sur le sursis et le sursis avec mise à l’épreuve, autrefois dans le Code de procédure pénale, et de ceux réprimant le trafic de stupéfiants, qui figuraient jusqu’alors dans le Code de la santé publique); 3° que la même loi d’adaptation : réaménage les dispositions relatives à l’échelle des peines, précise les règles particulières applicables aux personnes morales dont la responsabilité pénale est engagée et procède à la réforme de certaines procédures ainsi qu’à la modification de divers codes spéciaux. 18 Le décret no 93-726 du 29 mars 1993, « portant réforme du Code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale » (JO 30 mars 1993, p. 5559 et s.), complète la réforme qui procède des lois du 22 juillet 1992 instituant le nouveau Code pénal. Sont reprises et aménagées les dispositions de l’ancien Code relatives aux contraventions. Les dispositions font désormais l’objet des articles R. 610-1 à R. 655-1 du Code pénal. On observera, par ailleurs, que le nouveau Code conserve la répartition des contraventions en cinq classes. 19 Depuis la mise en vigueur du nouveau Code pénal, d’autres textes ont été adoptés. À cet égard, il est utile de citer, tout d’abord, la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (JO 11 juill. 2000, p. 10484. V. sur cette loi : F. Le Gunehec, « La loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », JCP G 2000, no 36, act. p. 1587; JCP G 2000. III. 20330). Cette loi : – exige que la faute pénale d’imprudence ne soit retenue que s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (art. 121-3, al. 3, C. pén.); – dissocie la faute pénale d’imprudence de la faute civile, notamment lorsque les personnes physiques n’ont pas causé directement le dommage; dans cette hypothèse, leur responsabilité pénale ne pourra être engagée qu’en cas d’une faute particulièrement grave (faute délibérée ou faute caractérisée; v. art. 121-3, al. 4, C. pén.); – affirme que l’absence de faute pénale ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant un juge civil (art. 4-1 C. pr. pén.). Par ailleurs, la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (JO 10 sept. 2002, p. 14934; v. J.-F. Seuvic, Chron. législ., RSC 2002, p. 867) a apporté un certain nombre de modifications en matière de responsabilité 18 19 8 Prolégomènes international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 pénale des mineurs, en procédant à la réécriture de l’article 122-8 du Code pénal (V. infra, no 268). Le législateur est intervenu ensuite avec la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (JO 19 mars 2003, p. 4761; v. H. Matsopoulou, Chron. législ., Revue pénitentiaire et de droit pénal 2003, no 4, p. 834 et s.). Ce texte a, d’une part, institué de nouvelles incriminations (telles que la demande de fonds sous contrainte [art. 312-12-1 C. pén.] ou l’exploitation de la mendicité [art. 225-12-5 C. pén.]) et, d’autre part, a créé de nombreuses circonstances aggravantes (V. par ex. : l’art. 47-II à IX de la loi qui fournit la liste des infractions entraînant une aggravation de la peine, lorsqu’elles sont commises « à raison de l’orientation sexuelle de la victime »). En outre, la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (JO 10 mars 2004, p. 4567; J. Pradel, « Vers un aggiornamento des réponses de la procédure pénale à la criminalité. Apports de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II », JCP 2004, G, I, nos 132 et 134) a institué, sur la base de l’article 13278 du Code pénal, de nombreuses causes d’exemption ou de réduction de peines en faveur des personnes ayant permis d’éviter la réalisation de certaines infractions limitativement énumérées par ce texte (sont notamment concernées la plupart des infractions relevant de la criminalité organisée [les crimes d’assassinat et d’empoisonnement, les actes de torture et de barbarie, le trafic de stupéfiants, etc.], le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, la fabrication ou la détention illégales d’armes), de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par celles-ci ou d’identifier les éventuels auteurs ou complices (V. par ex. : art. 221-5-3, al. 1er, C. pén. énonçant que « toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices »), tandis qu’elle a aggravé les sanctions pour un certain nombre d’infractions commises en bande organisée telle l’escroquerie (cf. art. 313-2, dernier al., C. pén. qui prévoit une peine d’emprisonnement de 10 ans et une amende de 1 000 000 euros). La loi précitée comporte, par ailleurs, un bloc de dispositions consacrées à la lutte contre les discriminations et elle refond le dispositif relatif à l’exécution des peines. Enfin, elle a généralisé la responsabilité pénale des personnes morales, à compter du 31 décembre 2005. La loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, apporte un certain nombre de modifications au Code pénal qui consistent dans l’extension du domaine d’application de la récidive; l’aggravation des peines prononcées à l’encontre des « violeurs en série »; la création de nouvelles « mesures de sûreté », telles que la surveillance judiciaire des personnes dangereuses et le placement sous surveillance électronique mobile. La loi no 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, renforce la répression en matière de terrorisme et institue un délit général de non-justification de ressources correspondant au train de vie (art. 321-6 C. pén.); elle a toutefois laissé subsister l’infraction spécifique visée à l’article 421-2-3 du Code pénal, qui relève des actes de terrorisme, afin de permettre que les règles de procédure dérogatoires à celles de droit commun lui soient applicables. La loi no 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance (V. sur cette loi le commentaire de M. Ph. Conte, Dr. pénal 2007, étude no 7) établit toute une série de 9 19 > 19 Chapitre préliminaire 10 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 nouvelles incriminations, comme celles tendant à la protection des mineurs et le délit d’embuscade (art. 222-15-1 C. pén.). De plus, elle introduit une nouvelle peine, la sanction-réparation, qui peut être soit principale, soit alternative, ainsi que trois peines complémentaires (l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, celle d’accomplir un stage de responsabilité parentale et l’interdiction de détenir un animal). On pourra encore ajouter la loi no 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui avait institué des peines minimales, dites « peines plancher », applicables aux récidivistes majeurs, en dessous desquelles les condamnations dont étaient frappés ces derniers ne devaient pas tomber (V. le commentaire de M. J.-H. Robert, « Le plancher et le thérapeute », Dr. pénal 2007, étude no 20). Le même texte définit le nouveau régime de la récidive des mineurs, ceux âgés de 16 ans à 18 ans encourant le risque d’être traités comme les majeurs. Par ailleurs, il généralise le recours à l’injonction de soins qui peut désormais être mise en œuvre dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve. La loi no 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption (complétée de trois décrets no 2008-671, 2008-672 et 2008-673 du 4 juill. 2008), ayant pour objectif de mettre le droit français en conformité avec les exigences du droit européen (v. art. 29 du Traité de Maastricht sur l’Union européenne) ou international. Ce dispositif a été par la suite renforcé par les lois no 2011-525 du 17 mai 2011, no 2013-1117 du 6 décembre 2013, no 2016-1691 du 9 décembre 2016 et no 2017-1339 du 15 septembre 2017. La loi no 2008-174 du 25 février 2008 vint enrichir la liste des mesures de sûreté, en en instituant deux nouvelles, la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté, qui peuvent entraîner l’enfermement, peut-être perpétuel, d’une personne, après qu’elle a purgé sa peine (V. sur cette loi, le commentaire de H. Matsopoulou, Dr. pénal 2008, étude no 5). En outre, ce texte prévoit l’application de certaines mesures de sûreté aux auteurs d’infractions atteints de troubles mentaux. La loi no 2010-242 du 10 mars 2010, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, a, par la suite, modifié les conditions du prononcé de la rétention de sûreté et des surveillances judiciaire et de sûreté, ainsi que la durée et le contenu de ces surveillances (V. le commentaire de M. J.-H. Robert, « Récidive législative », Dr. pénal 2010, étude no 8). De plus, elle a habilité les juridictions de l’application des peines à soumettre les condamnés sous-main de justice à différentes mesures restrictives de liberté, dans l’intérêt des victimes (telle l’interdiction d’entrer en rapport avec la victime ou la partie civile; v. aussi : Loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge). La loi no 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines ayant également pour objectif de prévenir la récidive par une meilleure évaluation du profil des condamnés et par le renforcement de leur prise en charge. D’autres dispositions de cette loi ont eu, en outre, pour objectif de « garantir la célérité et l’effectivité de l’exécution des peines prononcées, notamment des peines d’emprisonnement ferme », ainsi que d’« améliorer la prise en charge des mineurs délinquants ». Récemment, l’arsenal répressif a été considérablement renforcé par de nouveaux textes. Prolégomènes international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 Il s’agit de la loi no 2013-711 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, qui a transposé en matière pénale trois directives européennes, deux décisions-cadres et la décision renforçant Eurojust. En particulier, afin de mettre la législation française en conformité avec les définitions de la traite des êtres humains données dans les différents instruments internationaux, le législateur a élargi le champ d’application de cette infraction en introduisant une référence à la « soumission à du travail ou à des services forcés » et à la « réduction en esclavage ou en servitude » (art. 225-4-1 C. pén.). Il a également introduit un nouveau moyen pour caractériser l’infraction de traite des êtres humains : l’« abus d’une situation de vulnérabilité ». La même loi a, par ailleurs, transposé la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que de la pédopornographie. Enfin, elle a institué de nouvelles infractions, telles que « la réduction en esclavage et l’exploitation de personnes réduites en esclavage » (art. 224-1 A et s. C. pén.), les « atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées » (art. 221-12 et s. C. pén.) ou les incriminations tendant à réprimer la tentative d’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée (art. 223-11 C. pén.) ou le fait de tromper autrui dans le but de le forcer à conclure un mariage (art. 222-14-4 C. pén.). La loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, a apporté certaines modifications en matière de blanchiment et sensiblement renforcé les peines d’amende applicables aux atteintes au devoir de probité (corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts…). La loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines a institué une nouvelle peine, celle de « contrainte pénale » (v. infra, no 54), et supprimé les peines plancher qui revêtaient le caractère d’une sanction automatique, ce qui n’était pas conforme au principe à valeur constitutionnelle d’individualisation des peines. En outre, elle a mis fin aux « sorties sèches », non accompagnées d’un suivi et des mesures de contrôle, afin d’éviter le mécanisme de libération conditionnelle automatique qui est souvent facteur de récidive. La loi no 2014-1353 du 13 novembre 2014, tendant à renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, a notamment institué une nouvelle incrimination ayant pour objet de sanctionner « l’entreprise terroriste individuelle » (art. 421-2-6 C. pén.); en outre, elle a prévu la mise en place de certaines mesures administratives destinées à faciliter la prévention des actes de terrorisme, telles que l’interdiction de sortie du territoire (art. L. 224-1 CSI) ou l’assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée (v. art. L. 563-1 et L. 624-4, dernier al., CESEDA). La loi no 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, qui a, notamment, sanctionné « le recours à la prostitution » (« interdiction de l’achat d’un acte sexuel ») en instituant une contravention de la cinquième classe (art. R. 611-1 C. pén.; ce fait constitue un délit, s’il est commis en récidive ou si la victime est mineure ou une personne vulnérable). La loi no 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, a créé de nouvelles incriminations, telles que le délit de trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes (art. 322-3-2 11 20 > 20 Chapitre préliminaire 20 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 C. pén.) ou le délit d’entrave intentionnelle au blocage des services de communication en ligne faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant à la commission de tels actes (art. 421-2-5-1 C. pén.); par ailleurs, elle a introduit, dans le Code pénal, un bloc d’incriminations tendant à sanctionner le « trafic d’armes » (art. 222-52 et s.). La loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a renforcé le dispositif tendant à lutter contre les discriminations et l’insécurité routière (création d’un délit de conduite sous couvert d’un faux permis) et a, par ailleurs, apporté des modifications au droit pénal des mineurs. La loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a incriminé le trafic d’influence d’un agent public au sein d’un État étranger, a étendu le champ d’application du délit de favoritisme à l’ensemble des marchés publics et a institué la nouvelle peine de mise en conformité (art. 131-39-2 C. pén.). La loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, qui a fixé le cadre juridique de l’usage des armes, commun à l’ensemble des forces de l’ordre, et a renforcé le dispositif tendant à lutter contre le terrorisme. La loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui a rendu obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité pour toute une série d’infractions, telles que celles portant atteinte au devoir de probité. Actuellement, le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice propose la création de la « peine unique de stage » et de la nouvelle peine de « détention à domicile sous surveillance électronique ». Par ailleurs, il est suggéré d’étendre les possibilités de prononcer le travail d’intérêt général et de revoir les conditions du prononcé des peines d’emprisonnement. Enfin, le projet précité vise à modifier les dispositions relatives au sursis avec mise à l’épreuve, qui serait désormais dénommé « sursis probatoire », afin d’y intégrer la contrainte pénale et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Dans le domaine de la procédure pénale, la matière est régie par le Code de procédure pénale (promulgué par la loi no 57-1426 du 31 décembre 1957, complété par l’ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958 et entré en application le 2 mars 1959). Au cours des soixante années qui ont suivi l’entrée en vigueur de ce Code (succédant au Code d’instruction criminelle de 1808), de nombreuses réformes sont intervenues. Il est utile de citer certains textes importants ayant été adoptés en la matière. Il s’agit de la loi no 93-22 du 4 janvier 1993, « portant réforme de la procédure pénale », qui a donné lieu à de vives controverses et dont certaines dispositions ont été abrogées ou modifiées par la loi no 93-1013 du 24 août 1993 « portant réforme »… de la réforme. Signalons ici : 1° que ces lois renforcent le rôle de l’autorité judiciaire pendant le déroulement des enquêtes et étendent le contrôle de la mission de police judiciaire par la chambre de l’instruction aux agents de police judiciaire adjoints agissant ès qualités (V. infra, no 753); 2° que les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont profondément modifiées, afin de renforcer les droits de la défense de la personne gardée à vue; 20 12 Prolégomènes international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 3° que les dispositions du Code de procédure pénale traitant de la mise en examen (vocable substitué à celui d’« inculpation ») sont modifiées, de même que les textes relatifs à la mise en détention provisoire et au maintien de cette mesure; 4° que le régime des « nullités » est sensiblement réformé; 5° que certaines dispositions modifient les règles de procédure applicables aux mineurs; ainsi le mineur de 13 ans « ne peut être placé en garde à vue » (la loi no 94-89 du 1er février 1994 ayant, par la suite, institué à son endroit une mesure de « retenue » exceptionnelle et spécifique), tandis que la même mesure prise à l’encontre d’un mineur de plus de 13 ans est entourée de formalités tendant à assurer une meilleure protection de ses intérêts; 6° que l’article 30 du Code de procédure pénale, qui conférait aux préfets des pouvoirs de police judiciaire en matière de crimes et délits contre la sûreté de l’État, est abrogé. La loi no 93-992 du 10 août 1993 a modifié les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux contrôles et vérifications d’identité, déjà « aménagés » par les lois du 10 juin 1983 et du 3 septembre 1986 (art. 78-1 et s. C. pr. pén. V. sur cette loi la décision no 93-323 DC du 5 août 1993 du Conseil constitutionnel : JO 7 août 1993), (V. infra, nos 568 et s.). 21 21 Par ailleurs, la loi constitutionnelle no 93-592 du 27 juillet 1993 (JO 28 juill. 1993) a réformé le Conseil supérieur de la magistrature : deux formations sont créées, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’endroit des magistrats du parquet, les magistrats étant désormais en majorité dans le Conseil. 22 2 – Enfin, il convient de noter qu’une loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 (JO 24 nov. 1993), portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958, a créé, au titre X nouveau de la Constitution, qui traite « De la responsabilité pénale des membres du gouvernement », une « Cour de justice de la République » (V. infra, no 485). 23 On a pu écrire que : « Notre législation pénale vient de traverser une zone de turbulence due à une succession quasi ininterrompue de textes portant réformes, contre-réformes ou atermoiements à laisser pantois usagers et praticiens… » (M. Angevin, « La cour d’assises et les lois nouvelles », JCP G 1994. I. 3730). Néanmoins, plusieurs textes importants ont vu le jour depuis lors : ainsi la loi du 8 février 1995 élargissant les possibilités pour le tribunal correctionnel de siéger à juge unique [V. infra, nos 411 et s.] – ainsi la loi du 1er juillet 1996 mettant en place des procédures accélérées à l’encontre des mineurs commettant des infractions réitérées (V. infra, nos 909 et s.), ainsi la loi du 19 décembre 1997 instituant la possibilité du placement du condamné à certaines peines d’emprisonnement sous surveillance électronique par port d’un bracelet (V. infra, no 1280), ou la loi du 17 juin 1998, tendant à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs, qui a porté création du suivi socio-judiciaire, de l’injonction de soins, du fichier national automatisé des traces et empreintes génétiques (V. infra, nos 1216 et s.). 24 La loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (JO 16 juin 2000, p. 9038, et rectificatif au JO 8 juillet 2000, p. 10323. V. sur cette loi : les actes du colloque du 22 novembre 2000 ayant pour thème, « Une nouvelle procédure pénale ? Étude de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protec- 23 24 13 25 > 25 Chapitre préliminaire 25 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 tion de la présomption d’innocence et les droits des victimes », RSC 2001, p. 3 et s.), modifiée par celle no 2002-304 du 4 mars 2002, a encore rénové notre procédure pénale. Pour l’essentiel, cette loi : 1° confie à un juge des libertés et de la détention le placement ou le maintien en détention provisoire; 2° rénove le statut du témoin assisté, lequel devrait être octroyé le plus souvent possible en l’absence de charges graves ou concordantes de participation aux faits délictueux; 3° renforce les droits des parties au cours de l’instruction préparatoire; 4° permet à la personne gardée à vue d’avoir un entretien avec un avocat dès le début de la mesure et à la vingtième heure, ainsi qu’à la trente-sixième heure en cas de prolongation; 5° crée un double degré de juridiction en matière criminelle; 6° institue un réexamen des décisions définitives, suite à une condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’Homme; 7° s’efforce de limiter la durée des procédures, et notamment la durée de la détention avant jugement; 8° judiciarise certaines modalités d’exécution des peines; 9° révise le dispositif destiné à protéger les personnes faisant l’objet de procédures pénales. Le législateur est, par la suite, intervenu, à plusieurs reprises, en procédant à des réformes importantes dans le domaine de la procédure pénale. Trois textes méritent une attention particulière. Il s’agit, tout d’abord, de la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. Cette loi : 1° institue une procédure de jugement à délai rapproché pour les mineurs; 2° étend légèrement la composition pénale; 3° simplifie la détention provisoire et crée une procédure de référé-détention; 4° élargit le domaine de la procédure de comparution immédiate; 5° instaure une procédure simplifiée en matière correctionnelle; 6° renforce les droits des victimes pendant le cours de la procédure. Ensuite, la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a apporté de nombreuses innovations en la matière. Plus précisément, ce texte : 1° procède à certaines modifications aux règles de compétence territoriale des membres de la police judiciaire; 2° étend le contenu du fichier national automatisé des empreintes génétiques; 3° réglemente certains prélèvements pouvant être effectués sur des personnes concernées par une procédure; 4° autorise l’accès à un système informatique lors d’une perquisition; 5° renforce les pouvoirs des officiers de police judiciaire quant aux visites des véhicules; 6° aménage la procédure de l’amende forfaitaire. 25 14 Prolégomènes international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 Enfin, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : 1° crée un ensemble de règles de procédure particulières en matière de criminalité organisée; 2° simplifie l’entraide judiciaire et la procédure d’extradition; 3° institue le mandat d’arrêt européen; 4° aménage l’instruction des infractions en matière économique, financière, douanière, de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime; 5° complète le dispositif applicable au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles; 6° apporte certaines modifications à la composition pénale et aux autres procédures alternatives aux poursuites; 7° instaure une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plea bargaining, ce qu’on appelle « le plaider-coupable »). Depuis lors, d’autres textes vinrent encore modifier la procédure pénale. Il s’agit de : – la loi no 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité; – la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive, qui a apporté certaines modifications en matière de détention provisoire et au régime applicable au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Elle a, par ailleurs, aggravé le régime d’exécution de certaines peines (telles que le sursis avec mise à l’épreuve et le suivi socio-judiciaire), tandis qu’elle a procédé à des aménagements de peine; – la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a apporté certaines modifications dans le domaine des contrôles d’identité et de la garde à vue, celle-ci pouvant désormais atteindre le délai de 6 jours en matière de terrorisme; – la loi no 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale (V. sur cette loi, le commentaire de H. Matsopoulou, Dr. pénal 2007, études nos 4 et 5), qui a étendu le système de la cosaisine des juges, avant la mise en place de la collégialité de l’instruction, qui, reportée à de multiples reprises, était prévue pour le 1er janvier 2017 (toutefois, la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle [art. 25] a renoncé à la collégialité de l’instruction). Le même texte a renforcé le principe du contradictoire dans la phase préalable au jugement et limité les plaintes avec constitution de partie civile abusives ou dilatoires; enfin, il a renforcé les droits des mineurs au cours du procès pénal; – la loi no 2008-174 du 25 février 2008 qui, ayant institué une nouvelle procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, permet désormais à la juridiction constatant une telle irresponsabilité de se prononcer sur la réalité des faits délictueux commis par la personne mise en cause et sur les mesures de sûreté nécessitées par son état de santé; – la loi no 2008-174 du 1er juillet 2008, ayant créé de nouveaux droits pour les victimes et amélioré l’exécution des peines; – la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 ayant redéfini les conditions du placement en garde à vue et renforcé les droits de la personne en faisant l’objet, l’essentiel de ces droits étant celui d’être assisté par un avocat pendant les auditions et confrontations; 15 26 > 26 Chapitre préliminaire 26 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 – la loi no 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, qui a prévu la participation des citoyens au jugement de certains délits qui étaient essentiellement ceux portant atteinte à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 5 ans. Le tribunal correctionnel en formation citoyenne devait être composé, outre des trois magistrats, de deux citoyens assesseurs. L’arrêté du 18 mars 2013 a cependant mis fin à l’expérimentation de ces dispositions dont l’application avait pour conséquence d’augmenter le coût de la justice et d’allonger les délais d’audiencement « sans que l’image de la justice ne s’en trouve améliorée ». La loi du 10 août 2011 a, par ailleurs, modifié la procédure devant la Cour d’assises et, notamment, introduit la motivation des décisions de celle-ci. Enfin, elle a prévu la création d’un tribunal correctionnel des mineurs pour juger ceux âgés de plus de 16 ans, auteurs d’un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans et commis en état de récidive légale (toutefois, la loi no 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle [art. 29] a supprimé cette juridiction). Récemment, la loi no 2013-669 du 25 juillet 2013, relative aux attributions du garde de Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, a eu pour objectif d’empêcher toute ingérence du pouvoir exécutif « dans le déroulement des procédures pénales, afin de ne pas laisser la place au soupçon qui mine la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire ». Cette loi interdit au ministre de la Justice d’adresser aux magistrats du parquet des instructions dans des affaires individuelles. Elle confie, par ailleurs, au garde des Sceaux la responsabilité de conduire la politique pénale déterminée par le Gouvernement et d’en préciser, par instructions générales, les grandes orientations pour assurer sa cohérence et son efficacité. – La loi no 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation a réglementé cette pratique qui « englobe toutes les techniques permettant de localiser en continu un téléphone portable ou un objet, comme un véhicule, sur lequel une balise a préalablement été posée ». L’adoption de cette loi, intervenue à la suite des arrêts de la chambre criminelle du 22 octobre 2013, était nécessaire afin de mettre le droit français en conformité avec les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne dans son arrêt Uzun c/ Allemagne du 2 septembre 2010 (v. infra, no 669). – La loi no 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales tend à améliorer, aux différents stades de la procédure, les droits des personnes suspectées ou poursuivies. En particulier, cette loi prévoit un statut au profit des personnes suspectées lors d’une enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue. Elle renforce également les droits des personnes gardées à vue et de celles poursuivies. – La loi no 2014-640 du 20 juin 2014, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, a institué une juridiction unique de révision et de réexamen (art. 623 et s. C. pr. pén.), et déterminé les conditions matérielles d’exercice du recours en révision ainsi que la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen. 26 16 Prolégomènes international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 – La loi no 2015-993 du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, a transposé des décisions-cadres et des directives européennes afin d’assurer une meilleure administration de la justice entre les États de l’Union, en faisant obstacle aux doubles poursuites et en permettant l’exécution de décisions prises par un État membre sur le territoire d’un autre État (V. C. Ribeyre, « Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne : tout ça pour ça ? », Dr. pénal 2015, chron. 21; O. Cahn, « Nouvelle étape dans l’adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne », JCP G 2015, no 1018, p. 1715). Le même texte a, par ailleurs, transposé la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne, et la directive 2012/29/UE du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes. – La loi no 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, a apporté de nombreuses modifications au Code de procédure pénale. Cette loi : 1° renforce considérablement les pouvoirs d’investigation (perquisitions nocturnes dans des locaux d’habitation en matière d’enquête préliminaire, saisies des correspondances stockées par la voie des communications électroniques, utilisation de l’IMSI-catcher, opérations de sonorisation ou de captation d’images, captation des données informatiques…), dans le domaine des enquêtes de police, afin de lutter contre la criminalité organisée; 2° prévoit la possibilité d’auditionner un témoin « à huis clos » en cas de risques de représailles, dès lors qu’il s’agit de certaines infractions limitativement énumérées (crimes contre l’humanité, crime de disparition forcée, crimes de tortures ou d’actes de barbarie…); elle crée, par ailleurs, une procédure de témoignage sous numéro; enfin, elle étend aux témoins le dispositif de protection réservé aux repentis; 3° étend le champ d’application des visites des véhicules et autorise l’inspection visuelle des bagages et leur fouille, aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions (actes de terrorisme, infractions en matière d’armes et d’explosifs, trafic de stupéfiants…); 4° introduit une certaine contradiction dans le cadre de l’enquête préliminaire; 5° transpose la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (dite « directive C »); 6° simplifie le déroulement des procédures pénales en allégeant un certain nombre de formalités complexifiant le travail des enquêteurs (simplification de l’extension de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire, dématérialisation des actes de procédure effectués au cours d’une enquête, simplification des modalités du jugement…). – La loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a étendu la procédure de l’amende forfaitaire à certains délits, a renoncé à l’instauration du collège de l’instruction, a supprimé les tribunaux correctionnels pour mineurs, a rendu obligatoire l’assistance d’un avocat pour le mineur gardé à 17 Chapitre préliminaire – – – – – vue et a apporté des modifications au jugement des contraventions (remplacement des juges de proximité par des magistrats exerçant à titre temporaire, rattachement du tribunal de police, à compter du 1er juillet 2017, au TGI). La loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a assoupli les conditions dans lesquelles les faits de corruption et de trafic d’influence commis à l’étranger par des Français, des entreprises françaises ou des personnes résidant habituellement en France peuvent être poursuivis sur le territoire national. Le même texte a, en outre, institué la procédure de « convention judiciaire d’intérêt public » au profit des entreprises mises en cause pour un ou plusieurs délits de corruption et de trafic d’influence actifs (les conditions de mise en œuvre de ce dispositif transactionnel sont prévues par l’article 41-1-2 C. pr. pén.). La loi no 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, qui a apporté des innovations importantes dans ce domaine. Celles-ci résident pour l’essentiel dans l’allongement des délais de prescription en matière criminelle et délictuelle, ainsi que dans l’inscription, au sein de la loi, des principales règles jurisprudentielles régissant le point de départ du délai de prescription de l’action publique (s’agissant d’infractions « occultes » ou « dissimulées ») et l’interruption ou la suspension de ce délai. La loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, qui a étendu l’application du dispositif d’anonymisation des procédures judiciaires, a élargi la liste des agents pouvant effectuer des contrôles d’identité, des palpations de sécurité, des visites des véhicules et des fouilles des bagages, et a modifié la composition de la cour d’assises spéciale chargée de juger certains crimes, notamment ceux relevant du terrorisme (le nombre d’assesseurs, qui sont tous magistrats professionnels, est réduit de six à quatre en premier ressort et de huit à six en appel; art. 698-6 C. pr. pén.). La loi no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a transposé dans le droit permanent les principales mesures de l’état d’urgence (institué par la loi no 2015-1501 du 20 novembre 2015 et prolongé à plusieurs reprises), en autorisant de nombreuses restrictions de liberté (« mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ») et les perquisitions administratives (« visites et saisies »). Actuellement, le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice propose : d’étendre le champ d’application des pouvoirs particuliers d’investigation destinés à lutter contre la délinquance et la criminalité organisées aux crimes; d’étendre les mesures de géolocalisation et d’interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques aux enquêtes portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement; d’harmoniser les régimes juridiques applicables à certaines techniques spéciales d’enquête; de modifier les dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers et agents de police judiciaire; de réformer les dispositions relatives à l’ouverture et au déroulement de l’information judiciaire (extension du recours à la visioconférence, simplification du déroulement de l’instruction en matière de délits de presse); d’étendre la procédure de l’amende forfaitaire à certains délits; de modifier les dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale (exten18 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 26 > 26 Prolégomènes international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 sion de son domaine d’application) et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité; de modifier les dispositions relatives au jugement (institution de la « procédure de comparution différée », extension de la compétence du juge unique, expérimentation du « tribunal criminel départemental », etc.); de créer un parquet national antiterroriste. La multiplication des textes répressifs conduit au phénomène dit de l’« inflation pénale » qui rend très difficile pour le citoyen la connaissance des interdits. C’est ainsi que le législateur a été amené à consacrer l’erreur inévitable sur le droit comme cause d’irresponsabilité pénale. Il conviendrait donc que les pouvoirs publics choisissent avec mesure, parmi les règles de la vie sociale, celles dont la violation doit entraîner l’application du droit pénal. 27 27 – Selon un courant important de la doctrine contemporaine, il y aurait lieu de « décriminaliser » certains secteurs du droit pénal traditionnel (ainsi la loi du 11 juillet 1975 a supprimé les incriminations d’adultère de la femme et d’entretien de concubine au domicile conjugal); d’autres spécialistes estiment qu’il y aurait lieu de déplacer les « frontières de la répression ». – Un exemple de « dépénalisation » est offert par les modifications apportées à la législation en matière de chèques (Décr.-L. 30 oct. 1935, modif. L. 3 janv. 1975 et 30 déc. 1991. – V. aussi : art. 13119 C. pén. au sujet de l’interdiction d’émettre des chèques et art. 131-20, au sujet de l’interdiction d’user des cartes de crédit) : les auteurs de chèques sans provision, n’ayant pas agi « avec l’intention de porter atteinte aux intérêts d’autrui », ne sont frappés aujourd’hui que de « sanctions bancaires » : restitution du ou des chéquiers, interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans, sauf régularisation (art. L. 131-73 à L. 131-78 C. mon. et fin.) – Le Rapport sur la mise en état des affaires pénales préconisait une « large dépénalisation », certaines infractions de peu de gravité pouvant être traitées par le « jeu de sanctions administratives ou disciplinaires ». D’autres proposent la création d’un vaste secteur donnant lieu à une répression administrative (sans peines privatives de liberté) et avec un recours possible devant l’autorité judiciaire (à l’imitation de la législation allemande). La loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (JO 16 mai, p. 7776) a procédé à une dépénalisation de certains délits du droit des sociétés en y substituant des injonctions judiciaires (V. les actes du Colloque de la Baule du 16 au 17 juin 2001 sur La dépénalisation dans la vie des affaires, RJ com. nov. 2001). Ce mouvement s’est, d’ailleurs, poursuivi avec les deux lois du 1er août 2003 de sécurité financière et pour l’initiative économique (J.-H. Robert et H. Matsopoulou, Traité de droit pénal des affaires, PUF, Coll. Droit fondamental, 2004, no 1). Ainsi, le premier texte (loi de sécurité financière) a aboli les délits consistant dans le fait, pour le liquidateur, de ne pas réunir l’assemblée des associés après chaque exercice et de se maintenir en fonction après l’expiration de son mandat (ancien art. L. 247-7, 4° et 5° C. com.), tandis que le second texte (loi pour l’initiative économique) a abrogé, pour les SARL et les sociétés par actions (de toutes formes), l’incrimination liée à l’omission, sur tous les actes et documents destinés aux tiers, de l’indication de leur dénomination (suivie de la nature de la société) et de l’énonciation du capital social (V. B. Bouloc, « La dépénalisation dans le droit des affaires », D. 2003, Cahier Droit des Affaires, p. 2492; J.-H. Robert, « Dépénalisation saupoudrée », Dr. pénal 2003, comm. no 114). Il est à noter que, dans cette dernière hypothèse, la loi (art. L. 238-3 C. com.) prévoit, à la place d’une sanction, une injonction de faire, le cas échéant sous astreinte, déclenchée à l’initiative du ministère public ou de tout intéressé. – En outre, les ordonnances no 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises et no 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ont procédé à certaines dépénalisations. La plupart des dispositions concerne essentiellement les règles relatives au fonctionnement des organes de gestion des sociétés par actions et à la représentation des obligataires et actionnaires sans droit de vote (V. J.-H. Robert, « Tableau récapitulatif des dépénalisations opérées depuis 2003 dans le droit des 19 28 > 29 Chapitre préliminaire – On pourra faire observer que la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a instauré des sanctions administratives comme alternatives aux sanctions pénales et civiles en cas de non-respect de certaines dispositions du Code de la consommation (concernant notamment les obligations d’informations précontractuelles sur les biens et les services, les règles de publicité des prix, les publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées), en cas de violation de certaines dispositions des règlements communautaires assurant l’information et protégeant les droits des passagers dans le secteur des transports, ainsi qu’en matière de relations commerciales. Ce dispositif a été maintenu par l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation. Les conceptions positivistes, corrigées par celles de la « Défense sociale nouvelle » (V. infra, no 35), ont infléchi la législation pénale et son application dans une optique selon laquelle le délinquant – ce « protagoniste de la justice pénale » (Enrico Ferri) – doit faire l’objet : d’une étude individuelle tendant à établir les causes (tant endogènes qu’exogènes) de son comportement criminel et d’un « traitement » plus que d’une peine. 28 28 – Poussé par certains à l’extrême – ou déformé – ce raisonnement mène au postulat du déterminisme absolu, et tend corrélativement à faire disparaître les notions de peine et de responsabilité, ce qui est pour le moins excessif et incompatible avec le libre arbitre de l’homme, principe même de la dignité humaine dont se réclament d’ailleurs les promoteurs de telles doctrines. Que la société soit parfois « criminogène », nul ne le conteste et nul ne met en doute la nécessité d’adopter les mesures concrètes de nature à modifier cet état de fait, mais il n’en demeure pas moins que le comportement incompatible avec l’ordre public demeure le fait d’un homme responsable – au moins en partie – de ses actes, non pas d’un robot. Alors que certaines manifestations de la grande criminalité (terrorisme et banditisme, par exemple) se montrent particulièrement inquiétantes, que la délinquance moyenne (cambriolages, par exemple) demeure menaçante, il est inutile d’insister sur le péril qui découlerait pour l’ordre public de l’abandon des notions traditionnelles de responsabilité et de sanction (pour un historique plus complet, v. B. Bouloc, op. cit., nos 67 et s.). § 29 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 sociétés par actions », Dr. pénal 2005, chron. no 3; W. Jeandidier, « L’art de dépénaliser : L’exemple du droit des sociétés », Mélanges offerts à J.-L. Aubert, Dalloz 2005, p. 449 et s.). En réalité, ce ne sont que les branches mortes du droit pénal des sociétés qui ont été élaguées. – Un groupe de travail sur « la dépénalisation de la vie des affaires » a été institué en octobre 2007; il a été notamment chargé de formuler « des propositions afin de limiter le risque pénal des entreprises et d’envisager des modes de régulation plus adaptés à la vie économique ». Ce groupe a suggéré la dépénalisation de certaines infractions relevant du domaine du droit des sociétés, du droit de la consommation et du droit de la concurrence (V. sur la question, H. Matsopoulou, « Les propositions sur la dépénalisation de la vie des affaires », Rev. sociétés 2008, no 1, p. 1 et s.). 3 Fonctions et moyens du droit pénal Les pouvoirs publics, en recherchant les moyens les plus efficaces pour supprimer (ou tout au moins pour limiter autant que possible) la criminalité, poursuivent une politique criminelle, comme ils poursuivent une politique étrangère, une politique économique, etc. La politique criminelle d’un État est l’ensemble des mesures à l’aide desquelles les pouvoirs publics s’efforcent d’obtenir l’observation aussi complète que possible des règles de la vie sociale, dont la violation met en péril la société et appelle une sanction pénale. Il existe deux grandes séries de moyens auxquels la politique criminelle peut recourir : les moyens préventifs et les moyens répressifs. 29 20 Prolégomènes A. Moyens préventifs 30 Du seul fait qu’elle existe, qu’elle énumère les infractions et prévoit les peines qui frapperont ceux qui les commettront, la loi pénale joue un rôle préventif. En effet, elle informe les individus sur ce qui est défendu sous peine de sanction pénale, ainsi que sur la gravité respective des agissements incriminés. Elle menace de façon précise, et influe par-là sur le comportement de ceux que l’infraction pourrait tenter, car elle s’adresse anonymement à l’ensemble du public. La loi pénale bien faite, bien dosée et correctement diffusée, remplit donc un rôle préventif. De même, l’application de la loi pénale réalise un but de prévention générale : quand l’auteur d’une infraction se voit appliquer effectivement telle ou telle peine prévue par la loi, cela produit un effet d’intimidation chez les autres; ce qui renforce l’effet préventif de la loi pénale. 31 L’existence de services ou d’appareils de surveillance suffisamment nombreux et actifs (systèmes de « vidéo-protection », radars) est également indispensable, non seulement pour déceler les infractions commises mais aussi pour prévenir les infractions. La crainte du gendarme est, dit-on, le commencement de la sagesse, et les services de police remplissent donc un important rôle préventif, tant par leur existence même que par leurs interventions et, au besoin, leurs injonctions au moment opportun. 31 – 32 Agissant de la sorte, ils assument, dit-on, une mission de police administrative. Mais cette forme de prévention débouche fréquemment sur la constatation d’infractions, cette contiguïté des deux missions (police administrative et police judiciaire) apparaissant clairement dans certains textes : ainsi, l’article L. 234-9 C. route permet aux officiers de police judiciaire, sur instructions du procureur ou à leur initiative, de procéder à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident; de même, l’article 78-2 du Code de procédure pénale autorise des contrôles d’identité, afin de prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens (V. H. Matsopoulou, Les enquêtes de police, LGDJ 1996, no 450). À côté de lois pénales et de services de police suffisants, les pouvoirs publics doivent promouvoir des mesures dites de prophylaxie sociale qui, dans de nombreux cas, sont aussi efficaces qu’une répression rigoureuse pour prévenir la criminalité. De telles mesures peuvent être prises utilement pour lutter contre divers fléaux sociaux qui sont indiscutablement des facteurs de criminalité (alcoolisme, dissociation familiale, chômage, déficiences physiques et mentales); le développement des mesures de prophylaxie sociale peut éviter, sans nul doute, la commission de nombreuses infractions, aussi certains ontils qualifié ces mesures de « substitutifs pénaux » (Enrico Ferri). 32 B. Moyens répressifs 33 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 30 Ces moyens sont mis en œuvre à la suite d’une violation de la loi pénale. Ils ont alors un caractère individuel et s’adressent à la personne qui s’est ainsi rendue coupable d’une infraction. Il existe deux grandes catégories de moyens de ce genre : les peines et les mesures de sûreté. 3 21 34 > 35 Chapitre préliminaire La peine, le plus ancien des moyens répressifs de politique criminelle et le plus couramment employé, poursuit des buts divers. Autrefois, on insistait surtout sur son effet d’intimidation. Cette intimidation s’adresse non seulement au public (effet d’exemplarité, qui a été noté ci-dessus à propos de l’effet préventif de l’application de la loi pénale), mais aussi à l’intéressé lui-même; elle est choisie de telle sorte que celui qu’elle frappe hésitera à l’avenir (du moins peut-on l’espérer) à transgresser la loi et à encourir ainsi une nouvelle sanction. Depuis longtemps, ce but d’intimidation, s’il n’a pas disparu, n’est plus au premier plan. On doit également faire une place au but de rétribution : la peine apparaît, selon la conception traditionnelle, comme un châtiment destiné à punir l’individu pour la faute qu’il a commise. C’est en raison de cette faute (en latin culpa) qu’on le dit coupable, et la peine est généralement proportionnée à la gravité de la faute commise. 34 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 34 La loi proportionne parfois la peine à la gravité du dommage causé par l’infraction; il en est ainsi en matière de violences volontaires. Les auteurs du Code pénal considéraient que la faute, la perversité de l’individu, était proportionnelle au dommage qu’il avait causé ou voulait occasionner. Dans d’autres cas, c’est la manière d’opérer de l’agent qui est retenue par le législateur pour doser la peine, par exemple par le jeu de circonstances aggravantes (telles que l’usage de violences ou d’arme, l’effraction, etc.), ce qui est beaucoup plus rationnel; ainsi en est-il en matière de vol. À raison de son but rétributif, la peine a un caractère afflictif; elle doit infliger une certaine souffrance, ou tout au moins une certaine gêne, en compensation, en quelque sorte, du mal social qui a été causé. Mais cette souffrance ne doit pas être exagérée, car la peine poursuit également un but de réadaptation ou de resocialisation; ce but a toujours existé, mais la politique criminelle actuelle tend à lui donner de plus en plus d’importance, estompant ainsi le caractère afflictif de la sanction pénale. C’est, en effet, par la réadaptation des délinquants que les doctrines contemporaines pensent pouvoir réaliser la plus efficace défense de la société (d’où le nom de « Défense sociale nouvelle » de l’une de ces doctrines). Les peines le plus fréquemment appliquées sont appelées par le Code pénal « correctionnelles », et ce terme est bien choisi puisque, dans la langue courante, « corriger » veut dire à la fois « punir » et « améliorer ». Par le fait que la peine poursuit un but de « réadaptation », elle est orientée non seulement vers le passé mais aussi vers l’avenir; elle tend, par la transformation qu’elle aura réalisée chez l’individu, à éviter que celui-ci ne commette à l’avenir de nouvelles infractions. Ainsi, quoique mesures répressives, les peines doivent assurer également une action préventive, notamment de prévention de la récidive. Ces différentes fonctions de la peine sont clairement rappelées par l’article 130-1 du Code pénal (créé par la loi no 2014-896 du 15 août 2014, art. 1er). Ce texte dispose qu’« Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. » 35 35 – Exceptionnellement, dans les cas désespérés, la peine avait, dans le passé, une fonction éliminatrice; c’était le cas de la peine de mort, abolie par la loi du 9 octobre 1981, et – à un degré moindre – de la peine de relégation, supprimée par la loi du 17 juillet 1970. 22 Prolégomènes Les fonctions de prévention sociale et de réadaptation du délinquant sont encore plus nettement marquées dans les mesures dénommées « de sûreté », dont la reconnaissance formelle est récente (V. notamment infra, nos 1137 et s.). Il s’agit de mesures qui poursuivent un but essentiellement préventif lato sensu : tenter de remédier à l’état dangereux pour l’ordre public que présente un individu, sans avoir à rechercher si cet état est dû ou non à sa faute (et sans lui infliger pour autant un blâme social de ce chef). Peu importe que cet état procède du déséquilibre mental du sujet ou de l’alcoolisme ou de l’usage de stupéfiants, etc. On s’efforce, par ces mesures de sûreté, de protéger tout à la fois la société (contre les risques de réitération d’infractions) et l’individu qui en fait l’objet, soit en le soignant, soit en lui ôtant les moyens ou en lui évitant les occasions de commettre de nouvelles infractions. Il convient de souligner que la Cour de cassation dénomme parfois les mesures de sûreté de « mesures de police et de sécurité publique ». Ces mesures comportent, dans certains cas, une neutralisation provisoire du sujet : c’est particulièrement le cas du délinquant malade mental qui, s’il est dangereux, est interné dans un établissement psychiatrique jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un meilleur équilibre mental grâce aux soins qui lui sont administrés. Plus souvent, la mesure de sûreté est orientée vers la réadaptation sociale : c’est le cas pour les mineurs délinquants, à l’endroit desquels l’ordonnance du 2 février 1945, modifiée, dispose que « le tribunal pour enfants, et la cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées » (art. 2); ces juridictions pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l’exiger, « soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans […] soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de 13 à 18 ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9 ». La technique des mesures de sûreté, les caractères qu’elles présentent et la procédure à suivre pour les prononcer ou pour les exécuter, sont tout à fait différents de ce qui se passe en matière de peines. Sous l’empire de l’ancien Code pénal, la différence entre les peines stricto sensu, les mesures de sûreté et les « substituts » à la peine d’emprisonnement était d’autant plus délicate : que la loi du 11 juillet 1975 avait prévu comme « substituts » aux peines d’emprisonnement des mesures qui étaient auparavant considérées comme des « mesures de sûreté »… et qui, dès lors, jouaient le rôle de véritables peines (suppression du permis de conduire, du permis de chasser, etc.) – que la loi du 10 juin 1983 avait créé deux nouveaux « substituts » à l’emprisonnement : le travail d’intérêt général et le jour-amende. Le nouveau code a mis fin à ces ambiguïtés : les sanctions prononcées par les juridictions pénales sont toutes des « peines » aux yeux de la loi, quoique le régime de fonctionnement des diverses formes de sanctions ne soit pas identique (sursis à l’exécution, révisibilité de la mesure, etc.). 36 § 37 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 36 4 Contenu du droit pénal Le droit pénal, entendu au sens large, comprend plusieurs branches : le droit pénal général (A) – le droit pénal spécial (B) – la procédure pénale (C) – la science pénitentiaire (D) – les autres « sciences criminelles » : criminalistique et criminologie (E). 37 23 38 > 41 Chapitre préliminaire A. Droit pénal général Le droit pénal général consiste dans l’étude de la structure de l’infraction et des conditions générales de la responsabilité pénale. Il comporte également l’étude des diverses peines et mesures de sûreté encourues, et énonce les principes selon lesquels elles sont prononcées et appliquées. 38 B. Droit pénal spécial 39 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 38 Il réside dans l’examen détaillé non plus de l’infraction en général, mais de chacune des infractions que connaît le droit français, prise individuellement (vol, abus de confiance, meurtre, corruption, etc.). C’est, en quelque sorte, le catalogue descriptif des infractions (crimes, délits, contraventions) avec, pour chacune de celles-ci, ses divers éléments constitutifs et les sanctions applicables (avec ou sans circonstances aggravantes). 39 C. Procédure pénale 40 Elle a pour objet l’examen des règles techniques de la mise en œuvre de la répression et des différents rouages, amenés à intervenir dans cette mise en œuvre. Sont étudiées dans cette branche du droit pénal : les conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées, découvertes, constatées, poursuivies et prouvées; les autorités compétentes pour agir en l’occurrence (magistrats, officiers de police judiciaire, etc.) et leurs attributions précises; les juridictions qui ont à connaître des procès répressifs; les règles relatives au déroulement de ces procès jusqu’à la décision définitive, après épuisement des voies de recours éventuelles. En résumé, la procédure pénale détermine donc les règles qui président à l’organisation et à la compétence des différentes juridictions répressives, à la recherche et à la constatation des infractions, ainsi qu’à l’administration de la preuve. 41 On doit souligner l’importance considérable de cette discipline. Ainsi que l’écrivait Henri Levy-Bruhl : « La preuve est inséparable de la décision judiciaire : c’en est l’âme, et la sentence n’est qu’une ratification ». Or, il est difficile de « proposer une chose au jugement d’autrui sans corrompre son jugement, ne serait-ce que par la manière de la lui proposer » (Pascal). Par ailleurs, la procédure pénale accorde à certains magistrats, aux officiers et aux agents de police judiciaire lato sensu des attributions leur permettant – dans certaines hypothèses et en respectant le formalisme prévu par la loi – de porter atteinte aux libertés fondamentales du citoyen. Appréhensions coercitives, gardes à vue, contrôles d’identité, perquisitions, etc. sont autant de « points d’équilibre » entre les libertés publiques, d’une part, et les nécessités du bon accomplissement de la mission de police judiciaire, cette « fonction auxiliaire de la justice répressive » (Besson, Vouin, Arpaillange, Code de procédure pénale commenté, Litec, Paris 1959), d’autre part. Assurer tout à la fois l’ordre public, la sécurité et l’exercice des libertés publiques, telle est l’une des difficultés – non des moindres – que doit surmonter une réelle démocratie. 40 41 24 Prolégomènes D. Science pénitentiaire La science pénitentiaire est l’étude de l’exécution des peines, et particulièrement des peines privatives de liberté, que celles-ci soient exécutées en milieu fermé (incarcération) ou en milieu libre (probation, libération conditionnelle). Il ne s’agit pas de l’examen de l’échelle des peines, mais de l’efficacité comparée de celles-ci, et surtout de leur régime d’exécution, lequel doit être organisé de façon à ce qu’elles produisent tous les effets qu’on en attend. Certains principes élémentaires de cette matière seront signalés dans l’avant-dernier chapitre du présent ouvrage. 42 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 42 E. Autres sciences criminelles 43 À côté du droit pénal proprement dit, il existe d’autres sciences criminelles qui le complètent : la criminalistique et la criminologie. La criminalistique a pour objet la mise en œuvre des sciences et des techniques susceptibles de concourir à la lutte contre le phénomène criminel, en permettant ou en facilitant soit la découverte et la constatation des infractions, soit l’identification de leurs auteurs et l’administration de la preuve de leur culpabilité. Elle comporte deux volets : l’Identité judiciaire (photographie et anthropométrie criminelles – dactylotechnie) – la police scientifique (médecine légale, toxicologie, biologie, balistique, etc.). Les techniques de l’Identité judiciaire sont mises en œuvre dans les services de police lato sensu; celles qui constituent la police scientifique relèvent de la compétence des laboratoires de police scientifique et des experts (qu’ils appartiennent ou non aux laboratoires de police scientifique). La criminologie a pour but l’étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale (sociologie criminelle) et dans sa réalité individuelle (anthropologie criminelle, biologie criminelle, psychiatrie criminelle). Ses recherches sont utiles, tant au législateur qui doit formuler des normes pénales adéquates, qu’au juge qui doit appliquer celles-ci à des cas concrets. 43 Tableau no I A. La criminalité constatée ou dénoncée : criminalité apparente 2000 Total constaté Dont : Homicides volontaires ................................... Violences volontaires ..................................... Viols ............................................................ Atteintes aux mœurs ..................................... Vols à main armée ......................................... Vols avec violences ....................................... Cambriolages ................................................ Vols d’automobiles et de deux roues ................ Escroqueries Faux .......................................... Stupéfiants (trafic et consommation) .............. 2009 2012 2014 2016 3 771 849 5 030 578 4 981 005 4 621 486 4 992 686 2 166 106 484 8 458 33 538 8 613 101 223 370 993 399 970 317 044 103 731 25 2 097 175 886 10 506 32 247 6 521 113 120 377 381 293 489 320 417 146 424 1 863 193 200 10 885 15 848 5 321 118 493 352 626 545 955 274 157 187 761 2 085 208 125 27 786 12 773 5 234 115 612 372 687 544 082 298 762 197 651 1 784 214 800 14 130 21 770 8 800 92 100 489 000 496 900 420 000 196 962 43 > 43 Chapitre préliminaire B. La criminalité légale 1° Condamnations pour crimes (prononcées par les cours d’assises de majeurs) a) Nature de la condamnation Ensemble ..................................................... international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 1998 2001 2006 2009 2012 2014 2016 3 386 3 262 2 921 2 659 2 393 2 297 2 432 Réclusion à perpétuité ................................... 34 37 20 15 16 15 11 Réclusion à temps ......................................... 1 333 1 311 1 317 1 061 1 187 952 1 102 Emprisonnement ........................................... 1 850 1 887 1 584 1 583 2 367 1 330 1 319 Meurtres et assassinats .................................. 593 520 471 428 437 660 443 Attentats aux mœurs ..................................... 1 636 1 718 1 810 1 105 1 357 864 819 Infractions contre la propriété ........................ 736 663 670 494 455 605 616 b) Nature des infractions 2° Condamnations pour délits (tribunaux correctionnels et cours d’appel) 1998 2006 2009 2012 2014 2016 449 330 500 351 579 264 647 000 543 432 561 417 Ensemble a) Nature des infractions Vols ........................................................... Escroquerie Abus de confiance ...................... 124 769 112 984 13 989 14 631 94 491 97 048 92 562 76 289 14 631 16 428 10 411 11 876 Abandons de famille .................................... 7 941 5 728 5 562 5 501 6 050 5 912 Atteintes aux mœurs ................................... 9 318 10 735 10 193 9 523 9 320 12 200 b) Nature des peines prononcées Emprisonnement ferme ou avec sursis partiel ................................... 99 326 129 070 131 647 122 160 122 805 131 342 Emprisonnement avec sursis total ................. 194 605 203 942 179 441 181 812 169 282 155 067 Amende ..................................................... 80 581 157 787 219 779 183 898 211 807 203 300 Peines de substitution ................................. 49 436 66 072 64 038 64 885 63 577 63 362 Dispenses de peine (1) .................................. 8 014 8 323 8 216 6 631 5 392 4 436 (1) Loi du 11 juillet 1975 instituant les articles 469-1 et 469-2 C. pr. pén.; art. 132-58 C. pén. 26 Chapitre préliminaire international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 L’essentiel Le droit pénal est une branche du droit positif qui organise la répression par l’État de certains comportements de nature à causer un trouble intolérable à l’ordre public. En particulier, il prend soin, d’une part, de définir ces comportements antisociaux et, d’autre part, de déterminer les sanctions qui leur sont applicables. Le droit pénal joue à la fois un rôle préventif et répressif. Enfin, il comporte plusieurs branches, chacune de celles-ci ayant fait l’objet d’importantes réformes législatives. 1. Les caractères du droit pénal Le droit pénal est un ensemble de règles de droit positif, de normes écrites, auxquelles sont attachées des sanctions particulièrement énergiques, les peines. Il ne saurait être confondu avec la morale. C’est qu’en effet, tous les comportements immoraux ne sont pas pénalement sanctionnés. Ainsi, le blasphème ou le suicide ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de la loi pénale. C’est ce qui explique que l’on dise que le droit pénal et la morale sont deux cercles concentriques, le rayon de la morale étant plus grand que celui de la législation pénale. À cet égard, E. Garçon écrivait que le droit et la morale peuvent être comparés à deux cercles qui, se chevauchant, ont à la fois une aire commune et des surfaces propres. Cependant, dans certaines hypothèses, le droit pénal peut paraître avoir un champ d’application plus vaste que la morale, dans la mesure où il sanctionne des agissements indifférents à celle-ci, en raison du trouble qu’ils provoquent à l’ordre public (par exemple, le cas des délits prévus par le Code de l’environnement ou certaines contraventions au Code de la route). Le droit pénal est un droit sanctionnateur qui doit, en principe, intervenir au second degré. Le droit civil, le droit commercial, le droit administratif, etc. ayant leurs propres sanctions, le législateur intervient pour ériger en infraction tel ou tel manquement particulièrement grave aux règles de chacune de ces disciplines du droit. Du fait que le droit pénal organise « la répression par l’État », il résulte qu’il s’agit d’une matière relevant du droit public. C’est qu’en effet, il met en cause les rapports des individus avec l’État et avec certains services de l’État (police, administration pénitentiaire, etc.). À vrai dire, même si le droit pénal appartient, par sa nature, au droit public, il est traditionnellement rattaché au droit privé. Il en est ainsi parce que l’infraction cause souvent non seulement un trouble social mais aussi un préjudice individuel, et que sa victime va demander la réparation du 27 2. Les moyens du droit pénal international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 dommage subi. Au problème de droit public se superpose donc un règlement entre particuliers, qui se déroule sur le terrain du droit privé. En outre, on rapproche le droit pénal du droit privé en raison du fait que les juridictions, qui sont appelées à appliquer les normes pénales, sont des juridictions de l’ordre judiciaire et non pas les juridictions administratives qui connaissent habituellement des procès de droit public. Mais il convient de se demander quels sont les fonctions et les moyens du droit pénal. Les pouvoirs publics, en recherchant les moyens les plus efficaces pour supprimer ou limiter la criminalité, poursuivent une politique criminelle. Celle-ci peut être définie comme l’ensemble des mesures à l’aide desquelles les pouvoirs publics s’efforcent d’obtenir l’observation aussi complète que possible des règles de la vie sociale, dont la violation met en péril la société et appelle une sanction pénale. Aussi bien, afin d’atteindre cet objectif, la politique criminelle peut avoir recours, d’une part, à des moyens préventifs et, d’autre part, à des moyens répressifs. S’agissant des moyens préventifs, on pourra faire observer que du fait que le droit pénal définit les infractions et prévoit les peines qui frapperont ceux qui les commettront, il joue un rôle préventif. En effet, il informe les individus sur ce qui est défendu sous peine de sanction pénale, ainsi que sur la gravité respective des agissements incriminés. Il menace de façon précise, et influe par-là sur le comportement de ceux que l’infraction pourrait tenter, car il s’adresse anonymement à l’ensemble du public. Par ailleurs, l’application concrète de la loi pénale à tel ou tel cas déterminé réalise un but de prévention générale, dans la mesure où elle produit chez les citoyens une certaine intimidation, ce qui renforce l’effet préventif de la loi pénale. Quant aux moyens répressifs, ils sont mis en œuvre à la suite de la violation de la loi pénale. Ils ont alors un caractère individuel et s’adressent à la personne qui s’est rendue coupable d’une infraction. Entrent dans la catégorie des moyens répressifs les peines et les mesures de sûreté. En ce qui concerne les peines, elles poursuivent différents buts. Alors qu’autrefois, on insistait sur leur but d’intimidation (effet d’exemplarité) et de rétribution (caractère afflictif), on insiste actuellement sur celui de réadaptation ou de resocialisation. Par le fait que la peine poursuit un but de « réadaptation », elle est orientée non seulement vers le passé, mais aussi vers l’avenir ; elle tend, par la transformation qu’elle aura réalisée chez l’individu, à éviter que celui-ci ne commette à l’avenir de nouvelles infractions. Les fonctions de prévention sociale et de réadaptation du délinquant sont encore plus nettement marquées dans les mesures dénommées « de sûreté ». Celles-ci poursuivent un but essentiellement préventif. Elles tendent à remédier à l’état dangereux que présente un individu pour l’ordre public, sans avoir à rechercher si cet état est dû ou non à sa faute. Peu importe que ce dernier procède du déséquilibre mental du sujet ou de l’alcoolisme ou de l’usage de stupéfiants, etc. On s’efforce, par ces mesures de sûreté, de protéger tout à la fois la société (contre les risques de réitération d’infractions) et l’individu qui en fait l’objet, soit en le soi28 3. Le contenu du droit pénal international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 gnant, soit en lui ôtant les moyens ou en lui évitant les occasions de commettre de nouveaux faits délictueux. Enfin, la question qui se pose est celle de savoir quel est le contenu exact du droit pénal. Le droit pénal au sens large du terme comprend, tout d’abord, le droit pénal général qui étudie les différents éléments constitutifs de l’infraction, les conditions générales de la responsabilité pénale, les différentes catégories de peines susceptibles d’être prononcées, ainsi que les principes devant guider le juge répressif dans la détermination de celles-ci. Fait également partie de cette matière le droit pénal spécial, qui constitue un catalogue descriptif des incriminations avec, pour chacune de celles-ci, ses divers éléments constitutifs et les sanctions applicables. En outre, on pourra y faire entrer la procédure pénale. En particulier, cette discipline détermine les règles régissant l’organisation et la compétence des différentes juridictions répressives, la recherche et la constatation des infractions, ainsi que l’administration des preuves. On y trouve aussi toutes les règles relatives au déroulement du procès pénal jusqu’à la décision définitive, après épuisement des voies de recours éventuelles. Aux matières précédentes, on pourra aussi ajouter la science pénitentiaire qui étudie l’exécution des peines, et notamment de celles privatives de liberté, que cellesci soient exécutées en milieu fermé (incarcération) ou en milieu libre (libération conditionnelle, probation). Enfin, à côté du droit pénal proprement dit, il existe d’autres sciences criminelles qui le complètent. Il s’agit de la criminalistique (qui a pour objet la mise en œuvre des sciences et des techniques pouvant permettre ou faciliter soit la découverte et la constatation des infractions, soit l’identification de leurs auteurs) et de la criminologie (qui étudie le phénomène criminel dans sa réalité sociale et dans sa réalité individuelle). 29 44 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 Plan du cours Afin de présenter les éléments de droit pénal général et de procédure pénale figurant habituellement dans les programmes des concours administratifs, le présent ouvrage suivra le plan ci-dessous, inspiré de l’ordre chronologique d’intervention des différents rouages de la justice pénale. 4 Première partie : L’infraction Cette partie traitera des divers éléments de l’infraction, des conditions de la responsabilité pénale (tant des personnes physiques – majeures ou mineures – que des personnes morales) et de la répression de la complicité (conditions et sanctions). Deuxième partie : La procédure pénale Celle-ci sera consacrée à l’étude de la mise en œuvre de la répression depuis la recherche de l’infraction jusqu’à la condamnation définitive du coupable. Troisième partie : La peine Cette partie examinera le catalogue des peines en vigueur, les conditions de fixation des peines, les modalités d’exécution des diverses catégories de peines ou de mesures de sûreté et les principales causes de non-exécution ou d’extinction des peines. 30 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 Première partie L’infraction 45 L’infraction est le fait d’enfreindre la loi pénale. Pour qu’il y ait infraction, il faut qu’une prohibition ou une injonction de la loi pénale n’ait pas été respectée. Cette inobservation doit se manifester par un signe extérieur du comportement; tantôt positif (une action), tantôt négatif (une omission). Il faut également que celui qui a agi, ou qui a négligé d’agir, ait été conscient de ce qu’il faisait, c’est-à-dire qu’il n’ait pas été en état de démence ou de contrainte. On ne doit pas, toutefois, confondre cette exigence avec la conscience que peut avoir la personne en cause de transgresser la loi pénale (on sait que « nul n’est censé ignorer la loi »), (V. infra, no 260). Il faut enfin que le comportement reproché comme faisant l’objet d’une incrimination n’ait pas été exceptionnellement ordonné ou autorisé ou toléré par la loi. En conséquence, on peut définir l’infraction de la façon suivante : il s’agit d’une action ou d’une omission définie et punie par la loi pénale, imputable à son auteur, et ne se justifiant pas par l’exercice d’un droit. Cette définition a l’avantage de faire ressortir les éléments constitutifs nécessaires à l’existence d’une infraction quelconque et qui seront étudiés ici : élément légal, élément matériel, élément moral. L’élément légal réside dans le fait que le comportement en question était prévu et puni par la loi pénale. L’élément matériel est constitué par l’action ou l’omission incriminée par la loi. L’élément moral est constitué si le comportement est imputable à son auteur. Enfin, il ne peut y avoir culpabilité que si l’auteur ne peut se prévaloir d’une cause d’irresponsabilité déterminée par la loi. Dès lors, il est nécessaire d’étudier les différentes causes d’irresponsabilité pénale. 46 Plus précisément, nous examinerons, dans cette partie de l’ouvrage, les divers éléments communs à toutes les infractions quelles qu’elles soient (chap. 2, 3, 4, 5; voir la comparaison des diverses causes d’impunité, Tableau no II, p. 188). Mais, avant de procéder à une telle étude, il conviendra d’exposer les différentes classifications des infractions, et surtout la classification fondamentale en crimes, délits, et contraventions (chap. 1). Par ailleurs, une infraction peut être imputée soit à des personnes physiques, soit, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, à des personnes morales; le cumul 45 46 46 > 46 L’infraction 32 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 des responsabilités étant possible. Dès lors, des personnes physiques et des personnes morales peuvent être poursuivies en qualité d’auteurs de l’infraction. Mais les poursuites judiciaires peuvent viser non seulement les auteurs, mais également tous ceux qui ont aidé à réaliser l’acte matériel constitutif de l’infraction, ceux que le droit pénal appelle les complices. Quand peut-on dire qu’une personne s’est rendue complice d’une infraction, et comment doit-elle alors être punie ? C’est ce qui sera examiné dans le dernier chapitre (chap. 6) de cette première partie. 1 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 chapitre Les classifications des infractions 47 Pour classer les diverses infractions, on peut se placer sur le plan de l’un ou de l’autre de leurs éléments constitutifs : légal, matériel ou moral. 47 section 1 Classifications fondées sur l’élément légal 48 On distingue, selon ce critère : 1° la division tripartite des infractions, « suivant leur gravité », qui est la classification fondamentale; 2° la division en infractions de droit commun, d’une part, et en infractions politiques, infractions militaires et infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées, d’autre part. 48 § 49 1 Division tripartite des infractions suivant leur gravité L’article 111-1 du Code pénal énonce : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article 111-2 du Code pénal, qui dispose que « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ». 49 33 50 > 52 L’infraction A. Principes 50 Le principe qui découle de ces textes, connu sous le nom de division tripartite des infractions, peut être résumé comme suit : le crime est l’infraction que la loi « détermine » et punit d’une peine criminelle – le délit est l’infraction que la loi « détermine » et punit d’une peine correctionnelle – la contravention est l’infraction que le règlement « détermine » et punit de peines contraventionnelles. La classification tripartite des infractions pénales procède donc, comme par le passé (V. art. 1er, ancien C. pén.), de la nature (criminelle, correctionnelle, contraventionnelle) des peines « encourues » par leurs auteurs, en vertu de la loi ou du « règlement », malgré la formule de l’article 111-1 du Code pénal donnant pour critère de la classification des infractions leur « gravité ». C’est qu’en effet, le nouveau Code pénal distingue, comme son prédécesseur, les peines criminelles, des peines correctionnelles et des peines contraventionnelles. 51 Peines criminelles. S’agissant des peines criminelles, l’article 131-1 du Code pénal énonce que les peines encourues par les personnes physiques sont : « 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de 30 ans au plus; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de 20 ans au plus; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de 15 ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de 10 ans au moins ». 51 – 52 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 50 En outre, l’article 131-2 du Code pénal dispose que ces peines ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et « d’une ou de plusieurs peines complémentaires prévues à l’article 131-10 ». Ce dernier texte énonce que, lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou plusieurs peines complémentaires qui emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, etc. Peines correctionnelles. En ce qui concerne les peines correctionnelles, l’article 131-3 du Code pénal prévoit que les peines encourues par les personnes physiques sont : 1° l’emprisonnement; 2° la contrainte pénale instituée par la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales; 3° l’amende; 4° le jour-amende; 5° le stage de citoyenneté institué par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (ce stage, pouvant être prononcé par une juridiction à la place d’une peine d’emprisonnement, a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines et les devoirs du citoyen; il ne peut être prononcé contre le prévenu qui refuse cette peine ou n’est pas présent à l’audience, sauf s’il a fait connaître par écrit son accord et s’il est représenté par son avocat [art. 131-5-1 C. pén.]; la juridiction doit préciser si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué au frais du condamné); 6° le travail d’intérêt général; 7° les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6; 8° les peines complémentaires prévues à l’article 131-10; 9° la sanction-réparation (celle-ci consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime; il peut s’agir de la remise en état d’un bien endommagé à 52 34 Les classifications des infractions 53 54 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 l’occasion de la commission de l’infraction, à condition que la victime et le prévenu y consentent). L’article 381 du Code de procédure pénale (mod. L. no 92-1336, 16 déc. 1992) dispose que « sont des délits, les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 € ». L’article 131-4 du Code pénal est relatif à la durée des peines d’emprisonnement; sept échelons sont constitués; de « 10 ans au plus » à « 2 mois au plus » (la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure avait prévu une peine d’emprisonnement de 2 mois pour le délit de racolage [ancien art. 225-10-1 C. pén., abrogé par la loi no 2016444 du 13 avr. 2016, art. 15]). Les articles 131-5 à 131-9 du même code concernent les jours-amende (131-5) – le stage de citoyenneté (art. 131-5-1) – les peines privatives ou restrictives de droits (131-6 et 131-7) – le travail d’intérêt général (131-8) – la peine de sanction-réparation (131-8-1) et les cumuls prohibés ou possibles entre ces peines (131-9), (V. sur ces questions infra, nos 1096 et s.). Par ailleurs, lorsque la loi le prévoit, un délit peut être sanctionné d’une ou plusieurs peines complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 131-10 du Code pénal. 53 S’agissant de la peine de contrainte pénale (art. 131-4-1 C. pén.; v. aussi art. 713-42 et s. C. pr. pén.), elle peut être prononcée par la juridiction de jugement « lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socioéducatif individualisé et soutenu ». Cette peine, qui est exécutée en milieu ouvert, peut donc être retenue au lieu et place des courtes peines d’emprisonnement. En particulier, elle consiste dans l’obligation pour la personne condamnée de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre 6 mois et 5 ans (cette durée est fixée par la juridiction), à des mesures de contrôle et d’assistance, ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de l’intéressé au sein de la société. Plus précisément, il peut s’agir : des obligations et interdictions prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve (telles que l’obligation de réparer le préjudice causé à la victime, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, d’accomplir un stage de citoyenneté, etc.); de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général (au profit d’un établissement public, d’une collectivité territoriale ou d’une association); de l’injonction de soins (si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement). Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d’aide ayant pour objectif de faciliter son reclassement social (art. 132-46 C. pén.). Ces mesures, obligations et interdictions sont déterminées, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, par le juge de l’application des peines, dans des conditions et selon des modalités précisées par le Code de procédure pénale. Elles peuvent être modifiées, supprimées ou complétées, au cours de l’exécution de la peine, au regard de l’évolution du condamné. La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. 54 35 55 > 55 L’infraction 55 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 La juridiction de jugement fixe également la durée maximale de la peine d’emprisonnement encourue par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cette peine ne pourra excéder 2 ans d’emprisonnement, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. À vrai dire, telle que définie par la loi, la contrainte pénale se distingue difficilement, par son contenu, du sursis avec mise à l’épreuve, puisque le condamné à une telle peine pourra se voir appliquer des interdictions et obligations prévues en matière dudit sursis. Les mesures imposées sont destinées, dans les deux hypothèses, à l’« insertion » ou au « reclassement social » de la personne condamnée. En outre, en cas d’inobservation, par cette dernière, des obligations prononcées dans le cadre de l’exécution de la contrainte pénale, la peine d’emprisonnement pourra être ordonnée, comme en cas de révocation du sursis avec mise à l’épreuve. Dans ces conditions, on a du mal à voir comment cette nouvelle peine peut trouver ses marques par rapport au sursis avec mise à l’épreuve. Enfin, la mise en œuvre de la contrainte pénale nécessite une augmentation très significative du nombre des postes de travailleurs sociaux figurant dans les SPIP, afin que les objectifs poursuivis par le législateur puissent réellement aboutir. Modifications apportées par le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce projet procède à la réécriture de l’échelle des peines correctionnelles, en prévoyant la création de la « peine unique de stage » et de la nouvelle peine de « détention à domicile sous surveillance électronique ». La peine de contrainte pénale serait intégrée dans le « sursis probatoire » (cette dénomination remplacerait celle de sursis avec mise à l’épreuve). En particulier, il est proposé : a) de compléter le 1° de l’article 131-3 du Code pénal relatif à la peine d’emprisonnement, afin de préciser que ce dernier pourrait faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions prévues par le Code pénal; b) de créer la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique, qui pourrait être prononcée, lorsqu’un délit serait puni d’une peine d’emprisonnement, « à la place de l’emprisonnement », pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru (art. 131-4-1 C. pén. modifié). Comme c’est actuellement le cas pour la mesure d’aménagement de peine consistant dans le placement sous surveillance électronique, cette peine emporterait pour le condamné l’obligation de demeurer dans son domicile ou dans tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines et de porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation. Le condamné ne serait autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines pourrait, selon des modalités précisées par le Code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter; c) de créer « une peine unique de stage » et d’instituer un régime commun applicable à tous les stages (art. 131-5-1 C. pén. modifié). Cette peine se substituerait ainsi à 5 36 Les classifications des infractions 56 57 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 l’ensemble des peines de stage existant actuellement, à savoir le stage de citoyenneté, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels et le stage de responsabilité parentale (à cette liste, il serait encore ajouté le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes). Selon le dispositif proposé, lorsqu’un délit serait puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction pourrait, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devrait accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle préciserait la nature. Les différents stages visés constitueraient donc des modalités différentes d’une même peine, que la juridiction devrait préciser dans sa décision de condamnation. Le stage, dont le coût ne pourrait excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, serait effectué aux frais du condamné (sauf décision contraire de la juridiction). Cette peine serait exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation serait devenue définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. La création de la « peine unique de stage » permettrait de supprimer plus d’une trentaine d’articles ou d’alinéas dans le Code pénal. Peines contraventionnelles. L’article 131-12 du Code pénal énonce que les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° l’amende; 2° les peines privatives ou restrictives de droits visées à l’article 131-14; la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-15-1. Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. L’article 131-13 fixe le montant de l’amende contraventionnelle en constituant cinq échelons, qui déterminent (comme dans l’ancien code) cinq classes de contraventions. Les contraventions de la 1re classe, les moins graves, sont punies d’une amende de 38 € au plus, tandis que pour celles de la 5e classe, les plus graves, l’amende encourue est de 1 500 € au plus. Ce montant peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les hypothèses où la loi indique que la récidive de la contravention constitue un délit. Les articles 131-14 à 131-18 organisent des peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-14), le cumul possible des sanctions (art. 131-15), la peine de sanction-réparation pour les contraventions de 5e classe, des peines complémentaires qui peuvent être prévues par le règlement (art. 131-16 et art. 131-17; il peut, par exemple, s’agir de la suspension du permis de conduire, de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou du travail d’intérêt général contraventionnel [art. 131-17, al. 2]). 56 Peines applicables aux personnes morales. Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales ayant été expressément consacré par le nouveau Code pénal et généralisé par la loi du 9 mars 2004 (à compter du 31 décembre 2005; v. infra, nos 277 et s.), les articles 131-37 à 131-49 traitent des peines applicables en l’occurrence, celles-ci offrant une spécificité, compte tenu de la « qualité » des auteurs. Aux termes de l’article 131-37, les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : 1° l’amende; 2° dans les cas prévus par la loi, les peines 57 37 57 > 57 L’infraction 38 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 énumérées à l’article 131-39 (telles que la dissolution de la personne morale, l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles, la fermeture de l’établissement, l’exclusion des marchés publics, etc.) et 131-39-2 (la peine de « mise en conformité »); 3° en matière correctionnelle, la juridiction peut aussi prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-39-1. L’article 131-38 détermine le taux maximum de l’amende applicable, qui est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction (V. Crim. 19 avr. 2017, no 17-90.004, Dr. pénal 2017, comm. no 138, note V. Peltier : la chambre criminelle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester la conformité des dispositions de l’article 131-38, al. 1er, du Code pénal au principe d’égalité devant la loi pénale et à ceux de nécessité et d’individualisation des peines. Pour ce faire, elle a, d’une part, estimé que « la différence de situation existant entre les personnes morales et les personnes physiques justifie que le législateur ait institué à leur encontre des peines différentes et la différence de traitement qui résulte de la disposition contestée, en permettant d’assurer, par le prononcé d’une amende significative, une répression effective des infractions, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit; d’autre part, la disposition ne porte pas atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines, dès lors que le montant maximum de l’amende encourue par les personnes morales varie, comme pour les personnes physiques, selon l’infraction reprochée et que le juge qui prononce une telle peine doit l’individualiser », conformément aux critères fixés par la loi). Aussi bien, appartientil au juge pénal, qui prononce une peine d’amende, de motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges de la personne morale (Crim. 9 janv. 2018, no 1780.200). Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, les personnes morales pourront s’exposer à une amende de 1 000 000 € (art. 131-38, al. 2, C. pén. inséré par l’article 55 de la loi du 9 mars 2004). L’article 131-39 dispose, par ailleurs, que « lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou plusieurs des peines » spécifiées (dissolution de la personne morale, interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles, fermeture de l’établissement, exclusion des marchés publics, confiscation, etc.). Il est évident que lorsque les textes d’incrimination n’édictent pas expressément l’une des peines spécifiques, seule l’amende peut être prononcée à l’encontre des personnes morales. En réalité, la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, opérée par la loi du 9 mars 2004, n’emporte que la généralisation de la peine d’amende (V. art. 131-38, al. 2, C. pén., préc.), en excluant les autres peines visées à l’article 131-39 C. pén. pouvant être adaptées à la nature et à la gravité des infractions retenues; ce qui est peu conforme au principe de l’individualisation des peines. Toutefois, la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 relative à la simplification du droit a comblé la lacune dans de nombreux domaines (par exemple, en matière d’assurances, de consommation, d’environnement, douanière… etc. V. notamment art. 125 de la loi précitée). S’agissant de la nouvelle peine de mise en conformité, visée à l’article 131-39-2 du Code pénal, elle a été créée par la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La finalité de cette peine, dont la durée maximale est de cinq ans, est d’obliger une entreprise condamnée pour des faits de corruption ou de trafic d’influence à mettre en œuvre, en Les classifications des infractions B. Commentaires 58 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 son sein, toute une série de mesures et procédures définies par ce texte (code de conduite pour les salariés, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, procédures d’évaluation de la situation des clients et fournisseurs, procédures de contrôles comptables, dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence, régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale). Pour assurer le suivi de cette peine, le procureur de la République peut solliciter le concours de l’Agence française anticorruption (organe chargé de la prévention de la corruption) qui peut avoir recours à des experts, personnes ou autorités qualifiées pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. En cas de non-respect de cette peine, les dirigeants de la personne morale peuvent être condamnés à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 50 000 euros (art. 43443-1 C. pén.). Quant aux personnes morales, elles encourent la peine d’amende et l’ensemble des peines prévues au titre du délit pour lequel elles auront été condamnées et qui aura donné lieu au prononcé de la peine de mise en conformité. Par ailleurs, les peines d’affichage et de diffusion de la décision de condamnation peuvent recevoir application. Quant aux articles 131-40 à 131-44 du Code pénal, ils traitent des peines contraventionnelles encourues par les personnes morales (amendes, peines privatives ou restrictives de droits, la peine de sanction-réparation prévue par l’article 131-44-1). On remarquera que le législateur, tout en créant un système autonome de peines pour les personnes morales, a maintenu les dénominations traditionnelles de la classification tripartite des infractions. Le Code pénal facilite l’application du principe de la division tripartite des infractions. Dans l’ancien code, la peine encourue par l’auteur d’une infraction comportait presque toujours un maximum et un minimum, ces jalons de la répression se situant parfois l’un dans l’échelle des peines correctionnelles, l’autre dans celle des peines contraventionnelles (on prenait alors en considération le maximum de la peine comminée par la loi pour opérer le classement de l’infraction considérée dans l’une ou l’autre des catégories de la division tripartite). Dans le nouveau code, pour chaque infraction, la loi (ou le règlement en matière de contraventions) prévoit la peine maximale encourue. Ainsi, « l’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende » (art. 313-1); ainsi « le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » (art. 311-3). Si le nouveau Code pénal ne prévoit plus que la peine puisse être choisie par le juge entre un maximum et un minimum, ce serait faire erreur que de considérer qu’il consacre le système dit des « peines fixes » (exceptionnelles dans l’ancien code); c’est le maximum de la peine encourue qui est fixé par la loi (ou le règlement) pour chaque infraction, étant entendu que respecté ce maximum (indispensable eu égard au principe de la légalité des peines : v. infra, no 88 et spéc. nos 98 et s.), le juge garde, en application de l’article 132-24 du Code pénal, un large choix quant à la peine qu’il prononce dans chaque cas soumis à 58 39 59 > 62 L’infraction – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 son examen (toutefois, l’article 132-18 du Code pénal dispose que lorsqu’une infraction est punie par la loi de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à 2 ans d’emprisonnement; et dans l’hypothèse où la loi prévoit une peine de réclusion ou de détention criminelle à temps, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à un an). Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 du Code pénal, ainsi que les peines de contrainte pénale et de travail d’intérêt général, ne peuvent être prononcées cumulativement avec l’emprisonnement (art. 131-9 C. pén.). Un délit, qui expose son auteur à une peine d’emprisonnement, peut donc entraîner l’application d’une peine privative ou restrictive de droits, prononcée à titre de « peine principale » (« à la place de l’emprisonnement »; v. art. 131-6 C. pén.). Cette peine pourra alors être affectée du sursis, ce qui n’est pas le cas des peines complémentaires. 59 Dans le nouveau Code pénal, l’emprisonnement a disparu des peines contraventionnelles. Une loi du 7 août 1985 et un décret du 11 septembre 1985 avaient déjà abrogé toutes les dispositions édictant des peines d’emprisonnement en première infraction ou en cas de récidive pour les contraventions des 1re, 2e et 3e classes, l’emprisonnement demeurant prévu facultativement pour les contraventions des 4e et 5e classes, ainsi qu’en cas de récidive de ces mêmes contraventions. Pouvant alors atteindre 2 mois en cas de récidive, la peine d’emprisonnement n’était en l’occurrence que rarement prononcée. Le nouveau Code pénal ne fait ici qu’entériner une pratique constante et se conformer à une remarque précise exprimée par le Conseil constitutionnel (Cons. const, no 73-80 L. 28 nov. 1973; v. infra, no 1103). 60 Par ailleurs, le nouveau code maintient la traditionnelle distinction entre les peines criminelles de droit commun et les peines criminelles politiques : à côté de la réclusion criminelle, figure, comme dans l’ancien code, la détention criminelle, peine politique. Comme dans l’ancien code, le législateur n’a pas organisé un système spécifique de peines applicables aux délits politiques. 61 Certains critiquent la division tripartite en observant que les crimes et les délits traduisent chez leur auteur un caractère nettement antisocial, tandis que les contraventions sont en général beaucoup moins graves. Ils proposent donc une division bipartite qui correspondrait à peu près aux infractions intentionnelles et aux infractions non intentionnelles (parmi les délits, on trouve des délits non intentionnels, comme l’homicide par imprudence; art. 221-6 C. pén.). 59 60 61 – Les dispositions du Code pénal étant incompatibles avec leur thèse, ces auteurs ont souvent tenté d’aboutir au même résultat en prétendant soumettre les délits non intentionnels à un régime hybride, à mi-chemin entre celui des contraventions et celui des délits, les délits-contraventions. Cette conception, que le législateur avait parfois adoptée, n’a pas été retenue par le nouveau Code pénal. – Une autre critique faite à la division tripartite des infractions est qu’il n’est peut-être pas prudent de classer les infractions en raison de leur gravité, car l’opinion que l’on se fait de la gravité des faits a tendance à varier avec le temps et les contingences économiques et sociales. 62 Normalement, en cas d’évolution des mœurs, le législateur intervient pour modifier la catégorie légale à laquelle appartient l’infraction. Souvent, cette intervention se fait dans le sens de la diminution de la gravité de l’infraction et l’on assiste à un phénomène, 62 40 Les classifications des infractions – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 appelé la correctionnalisation ou la contraventionnalisation légale. Cela consiste pour le législateur à qualifier délit un fait qui était jusqu’alors un crime, ou contravention un fait qui était jadis un délit (L. du 17 févr. 1933, correctionnalisant la bigamie; Ord. du 23 déc. 1958 correctionnalisant le faux en écriture privée ou de commerce; Ord. no 58-1297 du 23 déc. 1958 contraventionnalisant divers délits par la création de contraventions de 5e classe). Il arrive aussi que le législateur ne soit pas intervenu pour modifier la qualification légale d’une infraction et que pourtant celle-ci n’apparaisse plus être en harmonie avec les mœurs. Par exemple, il semble que tel fait qualifié de crime par la loi ne mérite pas d’être jugé avec l’appareil solennel de la cour d’assises mais corresponde davantage à la gravité des simples délits. Dans ce cas, les parquets n’hésitent pas à poursuivre ce crime en le qualifiant à tort de délit. Pour cela, ils négligent volontairement de considérer tel élément constitutif ou telle circonstance aggravante qui faisait entrer l’acte dans la catégorie des crimes. Ils « fermeront les yeux », par exemple, sur le fait que le vol a été commis avec menace d’une arme, pour ne retenir que le vol simple puni de 3 ans d’emprisonnement (art. 311-3 C. pén.). Une telle pratique, qu’on appelle la correctionnalisation judiciaire, conduit à condamner sous des qualifications fallacieuses. Ainsi, s’agissant du crime de viol, qui relève normalement de la compétence de la cour d’assises, le magistrat du parquet ou le juge d’instruction peut faire abstraction de la nature sexuelle de l’agression et la considérer comme des violences sur la personne, pouvant être jugées par le tribunal correctionnel. Néanmoins, on est amené à reconnaître que cette façon de procéder est parfois utile pour éviter l’engorgement des cours d’assises par des infractions que le législateur a qualifiées de crimes, alors que, dans la pratique, elles offrent une gravité moyenne. On pourra faire observer que cette pratique trouve désormais un fondement législatif, à savoir l’article 469, al. 4, du Code de procédure pénale (dans l’hypothèse où le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, ledit tribunal peut statuer sur ce fait, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque le renvoi de l’affaire devant cette juridiction a été ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction; v. Crim. 4 avr. 2013, QPC, no 12-85.185). C. Intérêts pratiques de la division tripartite Quels que soient les défauts présentés par la division tripartite des infractions, c’est elle qui commande la plupart des institutions de notre droit pénal. 1° Un premier intérêt est relatif aux sources du droit : seule « la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs » (art. 111-2 C. pén.), tandis que « le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants » (ibid.). 63 63 – Il est arrivé que la loi détermine et réprime une contravention; c’était le cas de la loi du 9 juillet 1970 modifiant l’article L. 1er du Code de la route afin de réprimer de peines contraventionnelles la conduite de véhicule avec un taux d’alcoolémie dans le sang entre 0,8 et 1,2 gramme par litre (le texte prévoyant des peines correctionnelles lorsque le taux était égal ou supérieur à 1,2 gramme); la loi du 8 décembre 1983 a abrogé cette disposition en correctionnalisant la conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre (art. L. 234-1 C. route). Depuis un décret no 2004-1138 du 25 octobre 2004 41 63 > 63 L’infraction (modifié par le décret no 2015-743 du 24 juin 2015), est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre (art. R. 234-1 C. route). 42 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 2° En ce qui concerne la compétence, sauf exceptions légales, les crimes relèvent de la compétence de la cour d’assises, les délits de celle des tribunaux correctionnels, tandis que les contraventions sont soumises à la connaissance des tribunaux de police (art. 521 C. pr. pén.). Il est à noter que la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a supprimé les juridictions de proximité (art. 15, IV), qui avaient compétence pour juger les contraventions des quatre premières classes (le tribunal de police ayant exclusivement compétence pour les contraventions de la cinquième classe), à compter du 1er juillet 2017 (cette suppression a été initialement prévue par la loi no 2011-1862 du 13 déc. 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, mais repoussée à plusieurs reprises). Toutefois, pour le jugement des contraventions des quatre premières classes (sauf exception) et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police (qui, à compter du 1er juill. 2017, est rattaché au TGI; art. L. 211-9-1 COJ) peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire (ces magistrats, créés par la loi organique no 2016-1090 du 8 août 2016, ont remplacé les juges de proximité). 3° La procédure suivie devant chacune de ces juridictions est différente. La phase de l’instruction préparatoire est obligatoire pour les crimes, menée par le juge d’instruction, dont les ordonnances sont susceptibles d’appel devant la chambre de l’instruction. Cette phase est, sauf exceptions, facultative pour les délits et exceptionnelle en matière de contraventions. La citation directe, c’est-à-dire la possibilité offerte à la victime ou au parquet d’attraire directement l’auteur de l’infraction devant la juridiction de jugement, existe pour les délits et les contraventions. Elle est impossible pour les crimes (V. infra, no 776). La loi du 10 juin 1983 a institué une procédure de comparution immédiate (substituée, en quelque sorte, à l’ancienne procédure de flagrant délit), qui n’est applicable qu’en matière correctionnelle (V. infra, no 779). Par ailleurs, la loi du 9 mars 2004 a mis en place une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, applicable à tout délit punissable d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, à l’exception des délits d’atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles visées aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal, ainsi que de ceux mentionnés par l’article 495-16 du Code de procédure pénale (art. 495-7 C. pr. pén., v. infra, no 786). 4° Les délais de prescription de droit commun de l’action publique, c’est-à-dire les délais au-delà desquels on ne peut plus poursuivre une infraction, sont de 20 ans pour les crimes, de 6 ans pour les délits et de 1 an pour les contraventions. On remarquera que la loi no 2017-247 du 27 février 2017 a considérablement allongé ces délais en matière criminelle et correctionnelle par rapport au droit antérieur (qui prévoyait un délai de prescription de dix ans pour les crimes et de trois ans pour les délits), car ils apparaissaient « très courts » et étaient, dans l’ensemble, plus brefs que ceux retenus par la plupart des législations européennes (V. pour une étude détaillée, infra, nos 330 et s.). Les classifications des infractions 5° Les délais de prescription de droit commun des peines, c’est-à-dire les délais audelà desquels on ne peut faire subir à un condamné une peine prononcée contre lui, sont de 20 ans pour les peines criminelles, de 6 ans pour les peines correctionnelles et de 3 ans pour les peines de police. La loi du 27 février 2017 a donc harmonisé les délais de droit commun de prescription de l’action publique des crimes et des délits avec ceux de prescription des peines criminelles et correctionnelles. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 – 6° La tentative des crimes est toujours punissable, celle des délits ne l’est que si la loi le décide expressément; la tentative des contraventions n’est pas punissable (V. infra, no 173). 7° Le principe du non-cumul des peines joue pour les crimes et les délits. Il ne joue pas, sauf exception, pour les contraventions. 8° La récidive et le sursis ne s’appliquent pas de la même manière aux crimes, aux délits et aux contraventions (V. infra, nos 1151 et s., et nos 1193 et s.). 9° L’extradition est possible pour les crimes et certains délits. Elle est exclue pour les contraventions (V. infra, no 151). Il est à noter que, contrairement à la situation résultant de l’ancien Code pénal, la complicité de contravention, par provocation, peut être punissable, dans les hypothèses où le règlement le prévoit expressément (V. en cas de provocation ou d’instructions données : art. R. 610-2 C. pén.; cf. aussi art. R. 624-1, dernier al., C. pén., sanctionnant la complicité par aide ou assistance en matière de violences légères). § 64 2 Infractions de droit commun, infractions politiques, infractions militaires, infractions relevant de la criminalité organisée Le législateur a prévu, pour certaines catégories d’infractions, un régime juridique dérogatoire adapté à la nature particulière de celles-ci. Ainsi, à côté des infractions de droit commun, il existe les infractions politiques, les infractions militaires et celles relevant de la criminalité ou délinquance organisées. 64 A. Infractions politiques 65 Les infractions politiques sont celles qui ont pour objet de porter atteinte à l’ordre politique de l’État. Elles traduisent souvent chez celui qui les commet une moralité moins perverse que chez le délinquant de droit commun, car le premier s’attaque davantage au régime qu’à l’ordre social général (cependant, certaines formes de délinquance contemporaine d’inspiration terroriste ou anarchiste relèvent davantage d’une agression contre l’ordre social en général que contre le régime politique du moment; aussi ne sont-elles pas considérées comme des infractions politiques). De plus, ces infractions font courir à la société un risque particulier, puisqu’elles s’attaquent à la source même de l’ordre établi. 65 43 66 > 67 L’infraction 1° Régime international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 Ces deux caractères appellent des réactions sociales contradictoires : sévères en raison du danger présenté par les infractions, indulgentes en raison de la moralité du délinquant politique. Selon qu’on se trouve en présence d’un régime libéral ou d’un régime autoritaire, selon aussi qu’on se trouve dans une période de calme ou une période d’agitation politique ou sociale, c’est l’une ou l’autre de ces tendances qui l’emporte. En France, selon les époques, la tendance libérale ou la tendance autoritaire a prédominé, ce qui a pour conséquence que le régime des infractions politiques est un régime complexe où coexistent des mesures d’indulgence et des mesures de rigueur. Dans le sens de la tendance libérale, on peut citer la création, en 1832, d’une échelle spécifique de peines politiques criminelles, aujourd’hui fixée par l’article 131-1 du Code pénal. Les jalons de la répression vont, en l’occurrence, de la détention criminelle à perpétuité à la détention criminelle à temps de 10 ans au moins. Sous l’empire de l’ancien code existaient, de surcroît, les peines de bannissement et de dégradation civique. 66 6 – La peine de mort, supprimée en matière politique en 1848, avait été pratiquement rétablie par des textes permettant de l’appliquer en matière d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État (1939) et d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État (Ord. du 4 juin 1960, supprimant d’ailleurs la distinction entre ces crimes). La loi du 9 octobre 1981 a abrogé l’article 13 du Code pénal, prévoyant, en cas de crime contre la sûreté de l’État, l’exécution de la peine de mort par fusillade. On peut également rattacher à la tendance libérale : l’exclusion, à l’endroit des auteurs d’infractions politiques, de la procédure de flagrant délit, de la procédure de la comparution immédiate ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le bénéfice du sursis possible malgré l’existence de condamnations prononcées pour infractions politiques, l’exclusion de l’extradition (art. 696-4-2° C. pr. pén.) et de la contrainte judiciaire (art. 749 C. pr. pén.). Dans le même esprit, la loi du 11 juillet 1975 (art. 131-6, 10 et 11° C. pén.) a interdit de choisir comme substitut à la peine d’emprisonnement une interdiction professionnelle ou une confiscation, lorsque l’infraction commise est un délit de presse (considéré comme une infraction politique). En matière correctionnelle, il n’existe pas d’échelle de peines politiques, mais le régime d’exécution de ces peines est généralement moins rigoureux que celui de « droit commun ». En ce qui concerne la compétence, les infractions politiques ont fréquemment relevé de juridictions d’exception, en général fort critiquées : Cour de Riom, Cours martiales, tribunal d’État et tribunaux du maintien de l’ordre sous le régime de Vichy; Haute Cour de justice, Cours de justice et chambres civiques à la Libération; Haut tribunal militaire, Cours martiales, tribunal de l’ordre public, Cour militaire de justice (déclarée illégale par l’arrêt Canal, CE 19 oct. 1962, D. 1962. 687) sous la Ve République. – 67 Deux lois du 15 janvier 1963 avaient créé la Cour de sûreté de l’État, juridiction permanente d’exception, compétente pour connaître non seulement des crimes et délits contre la sûreté de l’État, mais aussi de diverses infractions de droit commun par nature (telles que les vols, escroqueries, violences, etc.), dès lors qu’elles étaient « en relation avec une entreprise individuelle ou collective consistant ou tendant à substituer une autorité illégale à l’autorité de l’État » (ancien art. 698 C. pr. pén.). La loi du 4 août 1981 a supprimé cette juridiction d’exception. Aujourd’hui, en temps de paix, les crimes et délits « contre les intérêts fondamentaux de la nation » (punis de peines politiques) sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun (art. 702 C. pr. pén.). Lorsque les faits constituent un crime ou un délit prévu 67 44 Les classifications des infractions 2° Critère 68 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-14 du Code pénal (il s’agit de la trahison, de l’espionnage et des autres atteintes à la défense nationale), l’instruction et le jugement font l’objet des dispositions dérogatoires au droit commun (art. 697 et 698-6 C. pr. pén.). Ainsi, la cour d’assises qui en connaît n’est composée que de cinq magistrats professionnels, lorsqu’elle statue en premier ressort, et de sept en cas d’appel. Dans ces hypothèses, elle siège sans jury. Lorsqu’il s’agit de savoir à quels faits il faut appliquer le régime particulier des infractions politiques, on se heurte au problème difficile du choix d’un critère approprié. D’une part, tout acte peut prendre une signification politique en raison de l’objectif poursuivi par son auteur (déposer des fleurs, par exemple, devant la maison d’un condamné). D’autre part, des actes constituant des infractions de droit commun peuvent avoir des mobiles politiques (assassinat d’un ministre ou d’un chef d’État, par exemple). Mais il existe aussi des infractions qui sont certainement politiques. Il s’agit de celles qui portent atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, sans constituer aucune autre infraction de droit commun. On leur assimile les infractions en matière de presse, qui touchent à des libertés constitutionnelles fondamentales. De même, il n’y a pas de difficulté si la peine prévue par le législateur figure dans l’échelle des peines criminelles politiques. Lorsqu’on se trouve, au contraire, en présence d’actes qui objectivement sont des infractions de droit commun (vol, meurtre), mais qui ont été accomplis en raison d’un mobile politique, on peut hésiter sur le point de savoir si on est en présence ou non d’infractions politiques. D’après une théorie subjective, seul le mobile importe et lorsqu’il est politique, on est en présence d’une infraction politique, (ainsi les Italiens ont refusé à la France l’extradition des assassins du roi Alexandre de Yougoslavie, estimant qu’il s’agissait d’un crime politique). L’ancien article 698 du Code de procédure pénale, qui définissait la compétence matérielle de la Cour de sûreté de l’État (créée en 1963 et supprimée en 1981), tenait largement compte du but poursuivi par l’agent. En revanche, selon une théorie objective, adoptée en France, la nature de l’objet de l’infraction doit l’emporter sur le mobile (le droit français ne se préoccupe en général pas des mobiles). Le vol d’armes pour soutenir une insurrection reste un vol de droit commun; les assassins respectifs du président Carnot et du président Doumer ont été condamnés à mort et exécutés, quoique la peine de mort fût abolie en matière politique. De même, la rébellion (c’est-à-dire la résistance avec violence ou voies de fait aux agents agissant pour l’exécution des lois) n’est pas une infraction politique, bien que son auteur ait agi à l’occasion d’une manifestation politique (V. en ce sens, pour des assassinats perpétrés par un séparatiste basque espagnol, CE 25 sept. 1984, Rec. CE 1984, 307). Toutefois, la Cour de cassation a estimé que l’infraction de participation sans arme à un attroupement, organisé par un parti politique, après sommation de se disperser (art. 431-4, al. 1er, C. pén.) constitue un délit politique (Crim. 28 mars 2017, no 15-84.940). Enfin, une théorie mixte, adoptée notamment par la Suisse, cherche à dégager ce qui prédomine dans l’acte, du caractère politique ou du caractère de droit commun. C’est un critère très souple qui permet de faire face à toutes les situations. Lorsque le procédé de réalisation de l’infraction est particulièrement horrible (massacre d’ennemis politiques 68 45 69 > 69 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 sans défense, terrorisme aveugle contre des innocents), il y aura là un élément de nature à ramener l’infraction au régime de droit commun. On suit aujourd’hui un tel raisonnement, en matière d’extradition, à l’égard des terroristes internationaux (V. Levasseur, « Le problème de l’infraction politique dans le droit de l’extradition », JDI 1990, p. 557; cf. art. 696-4, 2° C. pr. pén.). Le Secrétariat général de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPCINTERPOL) – dont les statuts interdisent toute intervention dans les affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial – saisi d’une demande de collaboration relative à une infraction susceptible de revêtir, peu ou prou, un caractère politique (ainsi en est-il souvent des affaires de terrorisme), procède à l’examen du « caractère prédominant » des faits, une fin de non-recevoir étant opposée si ce caractère est politique. On peut faire observer qu’INTERPOL considère aujourd’hui que les terroristes coupables de crimes de sang doivent être traités comme des criminels de droit commun, quelle que soit leur motivation, conformément à la Convention européenne sur le terrorisme conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 (ratifiée par la loi no 87-542 du 16 juill. 1987). La loi du 9 septembre 1986 afférente aux infractions « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur », relative à la répression du terrorisme, a aménagé un régime spécifique comportant des dispositions de procédure dérogatoires au droit commun applicables aux infractions relevant de ce domaine (V. art. 706-16 C. pr. pén.) – encore qu’offrant certaines analogies avec le crime politique, le terrorisme ne saurait être assimilé à celui-ci. Ce régime a été davantage accentué, notamment, par les lois no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, no 2012-1432 du 21 décembre 2012 (adoptée suite à la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 nov. 2008), no 2014-1353 du 13 novembre 2014 tendant à renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, no 2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. La France a ratifié (L. no 87-542 16 juill. 1987) et publié (Décr. 21 déc. 1987) la Convention européenne pour la répression du terrorisme, aux termes de laquelle certaines infractions graves ne peuvent être considérées comme des infractions politiques du point de vue de l’extradition. En outre, la loi no 2008-134 du 13 février 2008 a autorisé la ratification d’une Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005, qui prend soin de préciser les infractions que les États s’engagent à ne pas traiter comme des infractions politiques. 69 69 – Il est à noter que la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires (au plus tard le 8 sept. 2018) pour que soient érigés en infractions terroristes les actes intentionnels, dont la liste figure à l’article 3 (tels que les atteintes contre la vie d’une personne pouvant entraîner la mort, les atteintes graves à l’intégrité physique, l’enlèvement ou la prise d’otage, la capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises, etc.) qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale. Selon la directive, l’auteur doit 46 Les classifications des infractions B. Infractions militaires international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 commettre ces actes dans le but de : gravement intimider une population; contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque; gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou d’une organisation internationale. À la liste de ces infractions, il faut aussi ajouter l’incrimination de direction d’un groupe terroriste ou de participation aux activités d’un tel groupe (art. 4), ainsi que toutes les infractions liées à des activités terroristes visées aux articles 5 à 12 de ladite directive (par ex. le recrutement pour le terrorisme, dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, voyager à des fins de terrorisme, financement du terrorisme). Une infraction peut être subjectivement militaire parce qu’elle a été commise par un militaire, ou objectivement militaire lorsqu’elle constitue la violation d’un devoir militaire (désertion, refus d’obéissance). Ces infractions étaient justiciables précédemment des tribunaux permanents des forces armées, qui obéissaient à des règles de procédure particulières définies par le Code de justice militaire. Toutefois, les infractions subjectivement militaires, mais de droit commun par nature, n’étaient déférées à ces juridictions qu’autant qu’elles avaient été commises dans le service ou dans un établissement militaire. 70 70 – La loi du 21 juillet 1982, relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire, a supprimé les tribunaux permanents des forces armées (en temps de paix) et modifié, par voie de conséquence, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de justice militaire. Actuellement, dans le ressort de chaque cour d’appel, une formation spécialisée d’un tribunal de grande instance est chargée d’instruire et de juger les délits, et une cour d’assises les crimes, qui étaient de la compétence des tribunaux militaires, ainsi que les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation (trahison, espionnage, etc.) commis en temps de paix (art. 697-1 C. pr. pén.). La cour d’assises, compétente pour juger les crimes en la matière, est composée de cinq magistrats professionnels, lorsqu’elle statue en premier ressort, et de sept en cas d’appel. Dans ces hypothèses, le jury n’entre pas dans sa composition (art. 698-6 C. pr. pén.). Il en est autrement, lorsqu’il s’agit d’un crime de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, dont l’évocation ne présente pas de risque de divulgation d’un secret de la défense nationale (art. 698-7 C. pr. pén.). Les infractions objectivement militaires (ou purement militaires) ne comptent pas pour la récidive. Elles ne mettent pas obstacle à l’octroi d’un sursis et leurs auteurs ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’extradition (art. 696-4, 8° C. pr. pén.). C. Infractions relevant de la criminalité organisée 71 La loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité institue un régime procédural dérogatoire, lorsqu’il s’agit de l’une des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Le législateur n’a pas donné une définition générale de ces infractions, mais a préféré fournir une liste limitative des crimes et délits relevant de ce domaine aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale. En particulier, l’article 706-73 vise un certain nombre de cri71 47 71 > 71 L’infraction 48 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 mes et délits commis en bande organisée : le crime de meurtre, le crime de tortures et d’actes de barbarie, le crime de vol, le crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien, les crimes et délits d’enlèvement et de séquestration, les délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France, le crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (art. 224-6-1 C. pén.), le délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement (art. L. 512-2 C. minier) lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions visées aux 1° à 17° de cet article. La même disposition fait, par ailleurs, entrer dans le domaine de la criminalité organisée les crimes et délits de trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-40 C. pén.), les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains (art. 225-4-2 à 225-4-7 C. pén.), les crimes et délits aggravés de proxénétisme (art. 225-7 à 225-12 C. pén.), les crimes aggravés d’extorsion (art. 312-6 et 312-7 C. pén.), les crimes en matière de fausse monnaie (art. 442-1 et 442-2 C. pén.), les crimes et délits constituant des actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-6 C. pén.), les crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du Code pénal, un certain nombre de délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par le Code pénal, le Code de la défense et le Code de la sécurité intérieure, les crimes et délits punis de 10 ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167, les délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus ou des choses provenant de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 13°, les délits d’association de malfaiteurs (art. 450-1 C. pén.) ayant pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° s ainsi que le délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie (prévu par l’art. 321-6-1 C. pén.), lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17°. On pourra faire observer que les infractions définies à l’article 706-73 du Code de procédure pénale justifient l’application de l’ensemble du régime procédural dérogatoire. Par ailleurs, l’article 706-73-1 du Code de procédure pénale, introduit par la loi no 2015-993 du 17 août 2015 et modifié par celles no 2016-731 du 3 juin 2016, no 2017257 du 28 février 2017 et no 2017-1510 du 30 octobre 2017, fait entrer dans la catégorie des infractions relatives à la délinquance et à la criminalité organisées : le délit d’escroquerie en bande organisée (art. 313-2, dernier al., C. pén.); le délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre par l’État, commis en bande organisée (art. 323-4-1 C. pén.) et le délit d’évasion commis en bande organisée (art. 434-30, al. 2, C. pén.); les délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée; les délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus ou des choses provenant de l’une des infractions précédemment mentionnées; les délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du Code pénal (blanchiment commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle et blanchiment commis en bande organisée), à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706-73 du Code de procédure pénale; les délits d’association de malfaiteurs, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° de cet article; le délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie (art. 321-6-1 C. pén.), lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions indiquées ci- Les classifications des infractions – 72 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 dessus; les délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel (art. 322-3-2 C. pén.); les délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée (art. 415-6 C. envir.); les délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée (art. L. 253-17-1, 3°, L. 253-15, II, L. 253-16, II, et L. 254-12, III, C. rur.); les délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du Code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article; le délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard commis en bande organisée (art. L. 324-1, al. 1er, CSI) et les délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux de hasard ou d’adresse commis en bande organisée (art. L. 324-2, al. 1er, CSI); les délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5, 411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l’article 412-2, à l’article 413-1 et au troisième alinéa de l’article 413-13 du Code pénal. Dans les hypothèses visées à l’article 706-73-1 du Code de procédure pénale, le régime procédural dérogatoire s’applique également, à l’exception des dispositions autorisant la prolongation de la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours et de celles permettant l’intervention différée de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure. Quant à l’article 706-74 du Code de procédure pénale, il étend le régime dérogatoire, lorsque la loi le prévoit, aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1, ainsi qu’aux délits d’association de malfaiteurs tendant à la préparation des crimes ou des délits punis de 10 ans d’emprisonnement (art. 450-1, al. 2, C. pén.), autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 ou du 4° de l’article 706-73-1 du Code de procédure pénale. Ces précisions données, les différentes infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées se caractérisent, d’une part, par leur gravité et, d’autre part, par la pluralité d’auteurs. Aussi bien, la plupart de ces infractions doivent être commises en bande organisée. Saisi par les parlementaires, qui soutenaient que la notion de « bande organisée » serait floue et imprécise, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision no 2004-492 DC du 2 mars 2004 (JO 10 mars 2004, p. 4637 et s.), que cette expression n’est ni obscure, ni ambiguë, dans la mesure où elle est définie par l’article 132-71 du Code pénal comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions », et se distingue ainsi de la notion de réunion ou de coaction. En outre, les juges constitutionnels ont indiqué que « la jurisprudence dégagée par les juridictions pénales a apporté les précisions complémentaires utiles pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs » (V. E. Vergès, « La notion de criminalité organisée après la loi du 9 mars 2004 », AJ Pénal Dalloz, mai 2004, p. 181, et spéc. p. 183; selon cet auteur, les indices jurisprudentiels peuvent être regroupés autour de trois critères : un réseau relationnel, des actes préparatoires et une organisation structurée). Ce faisant, le Conseil constitutionnel s’est prononcé pour les caractères clair et précis de la définition des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, dont la commission entraîne l’application des règles procédurales dérogatoires. On peut faire observer que la chambre criminelle a affirmé, par un arrêt du 8 juillet 2015 (Dr. pénal 2015, comm. no 120, note Ph. Conte), que « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres » (v. aussi : Crim. 22 juin 2016, no 16-81.834). S’agissant, en particulier, de ces règles, on peut notamment faire observer qu’afin de faciliter la découverte des infractions relatives à la criminalité organisée, des pouvoirs 72 49 73 > 73 L’infraction section 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442897966:88866209:196.200.176.177:1592997733 d’investigation étendus ont été conférés aux officiers et agents de police judiciaire, tels que la surveillance de personnes suspectées, ainsi que celle de l’acheminement et du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une de ces infractions (V. art. 706-80 C. pr. pén.; v. infra, no 728), la participation à des opérations d’« infiltration » (art. 706-81 et s. C. pr. pén.; v. infra, no 729), la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé (ces opérations doivent être effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction; cf. art. 706-96 et 706-96-1. C. pr. pén.; infra, no 731), la saisie des correspondances stockées par la voie des communications électroniques (ces opérations doivent être effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction; cf. art. 706-95-1 à 706-95-3 C. pr. pén.; v. infra, no 732), l’utilisation de l’IMS-catcher (art. 706-95-4 à 706-95-10 C. pr. pén.; v. infra, no 736) ou la captation des données informatiques (art. 706-102-1 et 706-102-2 C. pr. pén.; ces opérations doivent être effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction; v. infra, no 741). Par ailleurs, le législateur a prévu des règles dérogatoires en matière de garde à vue (706-88 C. pr. pén.; v. infra, no 682), de perquisitions (art. 706-89 et s. C. pr. pén.; v. infra, no 658) ou d’interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (art. 706-95 C. pr. pén.; v. infra, no 731), tandis qu’il a créé des juridictions spécialisées pour la poursuite, l’instruction et le jugement de l’une des infractions relevant de la criminalité organisée (art. 706-75 et s. C. pr. pén.). Enfin, afin de faciliter l’appréhension des délinquants, la loi a institué de nombreuses causes d’exemption ou de réduction de peines. Classifications fondées sur l’élément matériel § 1 Infractions de commission et infractions d’omission L’élément matériel d’une infraction peut être un acte positif (une commission) ou un comportement négatif (une abstention ou une omission). À ce titre, on distingue les infractions d’omission (non-déclaration de la naissance, non-paiement de la pension alimentaire allouée au conjoint ou aux enfants, délit de fuite, défaut de secours à personne en péril, par exemple) et les infractions de commission (vol, meurtre, par exemple). 73 73 – Dans les infractions d’omission, on ne conçoit pas la répression de la tentative. Dans les délits d’action qui comportent l’accomplissement de divers actes, il peut être difficile de déterminer avec précision la date de commission de l’infraction (question importante pour l’application des règles de la non-rétroactivité des lois pénales, de l’amnistie et de la prescription). 50 Les classifications des infractions La distinction entre l’infraction d’omission et celle de commission est parfois délicate; ainsi, en estil en matière de délit de non-assistance à personne en danger. Selon l’article 223-6, alinéa 2, du Code pénal, l’infraction consiste dans le fait pour un individu de s’abstenir « volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Il s’agit donc d’une infraction d’abstention. Cependant, la jurisprudence n’a pas hésité à sanctionner, sur le fondement de ce texte, le pilote d’un avion militaire qui, ayant provoqué la chute d’un hélicoptère, a évoqué l’accident, à son retour à la base, d’une façon vague et hypothétique que les secours ont été organisés avec plusieurs heures de retard et l’une des victimes, décédée peu avant l’arrivée des sauveteurs, a ainsi perdu une chance de survie (Crim. 4 mars 1998, Dr. pénal 1998, comm. no 97, obs. M. Véron). Il est clair que pour la jurisprudence, une action dilatoire peut être équivalente à une omission ou à une abstention et peut, par conséquent, justifier l’application de l’article 223-6, alinéa 2, du Code pénal. § 2 Infractions instantanées et infractions continues L’infraction instantanée est celle qui se réalise en une période de temps pratiquement négligeable : vol, meurtre. Cela ne veut pas dire qu’une telle infraction n’exige pas parfois une longue préparation; elle se trouve néanmoins consommée en un instant. 74 74 – 75 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 – Le cambriolage d’une villa aura pu, par exemple, être préparé de longue date : le vol est consommé par l’appréhension de la chose d’autrui (des difficultés sont rencontrées en matière de vol dans les self-services, la préhension de l’objet demeurant parfois équivoque). De même, les effets de l’infraction pourront se prolonger dans le temps, elle n’en sera pas moins une infraction instantanée si on se trouve en présence d’un seul acte de volonté. Celui qui, par exemple, colle une affiche à un endroit interdit commet à ce moment un délit instantané, même si son affiche reste collée plusieurs mois à l’endroit interdit. Certains auteurs appellent ces infractions, dont les effets se prolongent dans l’avenir, des infractions permanentes. C’est, en réalité, une catégorie inutile, dans la mesure où elle se ramène à celle des infractions instantanées. Les infractions continues (que l’on appelle encore successives) sont celles qui se prolongent dans le temps par une réitération constante de la volonté du coupable après l’acte volontaire initial. Ce sera, par exemple, le cas de la non-représentation d’enfant, de l’abandon de famille, du port illégal de décoration qui exige une nouvelle intention coupable à chaque nouvelle sortie du délinquant, du recel de choses volées, qui exige que le receleur conserve volontairement la chose reçue en connaissant sa provenance frauduleuse, ou de la séquestration arbitraire (Crim. 8 nov. 1979, Bull. crim. no 311, JCP G 1980. II. 19337, note J. Davia). 75 76 L’infraction continuée constituerait une catégorie intermédiaire. C’est la réitération d’une série d’infractions instantanées de même nature, liées entre elles par une intention unique : le vol de gaz ou d’électricité par branchement clandestin, le déménagement d’une villa où le voleur est obligé de faire plusieurs voyages. En raison de l’unité d’intention, la jurisprudence soumet ces infractions continuées au régime des infractions continues. 77 La distinction entre infractions instantanées et infractions continues présente différents intérêts. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de l’action publique, il se situe, pour l’infraction instantanée, au jour où celle-ci a été accomplie, alors que, pour l’infraction continue, le point est fixé au jour où l’état délictueux a cessé. 76 7 51 78 > 79 L’infraction § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 S’agissant du choix de l’enquête de police pouvant être mise en œuvre, la distinction revêt un intérêt particulier, car, pour une infraction continue, l’enquête de flagrance reste possible pendant toute la durée de la commission de l’infraction, à condition que celle-ci soit révélée par des indices apparents (V. infra, nos 651 et s.). Pour les conflits d’application de lois dans le temps, l’infraction continue est soumise à la loi en vigueur au moment où l’acte incriminé a cessé, même si cette loi est plus sévère que celle qui était applicable lors du début de l’action (V. infra, no 114). L’amnistie des infractions continues n’est accordée qu’autant que l’état délictueux n’a pas persisté après la date fixée par la loi d’amnistie. Il y a autant de tribunaux compétents pour connaître des infractions continues que de lieux où les éléments constitutifs de l’infraction ont été réalisés. Si, après une première condamnation définitive, l’infraction continue se poursuit, une seconde condamnation peut être prononcée, bien qu’il s’agisse d’une seule entreprise criminelle, puisque la volonté coupable persiste même sans nouvel acte matériel (cf. Crim. 30 déc. 1952, Gaz. Pal. 1953. 1, somm. p. 3). 3 Infractions isolées et infractions d’habitude L’infraction isolée est consommée par un seul acte délictueux, qu’il soit instantané ou continu. L’infraction d’habitude, au contraire, n’est incriminée qu’à raison du danger social que représente la réitération de certains agissements qui, isolés, n’appelleraient pas de sanction pénale. 78 78 – Il n’y a alors infraction que si le comportement est habituel, c’est-à-dire s’il est renouvelé un certain nombre de fois (par ex. : l’exercice illégal de la médecine). À vrai dire, la jurisprudence se contente de deux faits pour décider qu’il y a habitude et que la répression est possible. La prescription de l’action publique a pour point de départ, pour les infractions d’habitude, le jour du dernier acte accompli, la date de commission des actes antérieurs ne devant pas être prise en considération. § 4 Infractions simples et infractions complexes L’infraction simple est composée d’un seul élément matériel qui donne à l’acte sa qualification pénale : le meurtre résulte de l’acte qui entraîne volontairement la mort de la victime. D’autres infractions sont dites complexes parce que leur élément matériel est composé de plusieurs actes; ainsi l’escroquerie (art. 313-1 C. pén.) est complexe en ce sens que les manœuvres frauduleuses (fréquemment constituées de plusieurs actes étalés dans le temps) provoquent une remise de valeurs par la victime (acte distinct du ou des précédents). 79 79 – L’intérêt de la distinction concerne surtout le point de départ du délai de prescription de l’action publique qui, pour les infractions complexes, est fixé au jour du dernier acte constitutif de l’infraction. Un autre intérêt concerne la compétence territoriale et résulte du fait que, s’agissant des infractions complexes, leurs actes constitutifs peuvent avoir été accomplis dans des endroits différents et justifier, dès lors, plusieurs compétences territoriales. 52 Les classifications des infractions § Il y a infraction matérielle lorsque le résultat dommageable figure parmi les éléments constitutifs de l’infraction, de sorte que celle-ci n’est consommée qu’autant qu’un tel résultat a été obtenu. Il n’y a meurtre, par exemple, que si la victime est décédée (si elle ne l’est pas en dépit du but recherché, il y a simplement tentative de meurtre). Une infraction est dite formelle, lorsqu’elle est considérée comme consommée indépendamment du résultat dommageable voulu par son auteur. Il y a, par exemple, empoisonnement (art. 221-5 C. pén.) dès l’administration de substances de nature à entraîner la mort, indépendamment des suites pour la victime. 80 § 81 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 80 5 Infractions matérielles et infractions formelles 6 Infractions flagrantes et infractions non flagrantes L’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a également infraction flagrante, lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit (art. 53 C. pr. pén.). La plus grande facilité d’administration de la preuve à l’endroit du délinquant arrêté en flagrant délit (« la main dans le sac ») a, de tout temps, entraîné des assouplissements aux règles qui président tant à l’enquête qu’à la poursuite et au jugement. Ainsi, la situation de fait de flagrance autorise les officiers de police judiciaire à mettre en œuvre motu proprio l’enquête de flagrant délit qui se caractérise par l’étendue et le caractère coercitif des investigations (V. infra, nos 655 et s.). L’individu déféré au procureur de la République à l’issue de cette enquête pouvait, jusqu’en 1981, être jugé « en flagrant délit »; il peut aujourd’hui faire l’objet – dans certaines hypothèses – de la procédure dite de comparution immédiate qui offre davantage de garanties au prévenu (V. infra, nos 779 et s.). Notons que l’immunité parlementaire ne joue pas en cas de flagrant délit. 81 section 3 Classifications fondées sur l’élément moral 82 Indépendamment de la distinction entre infractions politiques et infractions de droit commun, qui présente un certain intérêt en fonction du mobile et que nous avons déjà étudiée, la principale distinction des infractions fondée sur l’élément moral est celle des infractions intentionnelles et des infractions non intentionnelles. Selon l’article 121-3 82 53 83 > 83 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 du Code pénal : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». Les infractions intentionnelles ne peuvent être poursuivies que si la preuve d’une intention coupable est établie à l’encontre de l’agent. Cette intention, distincte du mobile, se ramène du reste, en droit français, en raison du principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, à la conscience de l’illicéité de l’acte accompli (V. infra, nos 181 et s.). Le vol, le recel, les violences volontaires, etc. sont des infractions intentionnelles. Le principe, selon lequel le mobile est juridiquement indifférent (V. infra, no 183), est exceptionnellement écarté, lorsque le législateur requiert, pour la constitution d’une infraction, un « dol spécial » qui prend en considération le but poursuivi par le délinquant; ainsi en est-il du délit de destruction de traces et indices sur les lieux d’une infraction, « en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité » (art. 434-4 C. pén.). Les infractions non intentionnelles sont punies à raison de la seule violation de la règle légale, sans qu’on ait à s’inquiéter de la volonté de l’agent, à condition qu’il y ait eu une faute dans son comportement (V. infra, nos 185 et s.). Cette dernière s’entend souvent d’une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Depuis la loi du 10 juillet 2000, modifiant l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal, une telle faute ne peut être retenue que s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans certains cas, la faute peut résulter du seul fait de la violation de la prescription légale ou réglementaire (et on est en présence des infractions dites souvent purement matérielles, ce qui n’est pas exact, car ces infractions comportent un élément moral, si ténu soit-il). La distinction entre infractions intentionnelles et infractions non intentionnelles est utile en ce qui concerne la tentative; celle-ci n’existe que pour les infractions intentionnelles et elle est exclue en matière d’infractions non intentionnelles; par ailleurs, une infraction non intentionnelle ne peut pas être justifiée par la légitime défense, qui implique une riposte volontaire (V. infra, no 210); enfin, si l’infraction est intentionnelle, une condamnation ne pourra intervenir qu’autant que la preuve de cette intention aura été apportée par le ministère public. 83 83 – Entre les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles, on place souvent les infractions dites praeterintentionnelles. Il s’agit de l’hypothèse où l’acte de l’agent a été voulu et conscient, mais dont le résultat a de beaucoup dépassé le but qu’il se proposait d’obtenir. Ce sera le cas, par exemple, des coups et blessures volontaires portés à un hémophile et qui entraîneront sa mort. Le Code pénal a visé cette situation à l’article 222-7, qui réprime les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 54 Chapitre 1 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 L’essentiel Pour classer les différentes infractions, il faut se fonder sur leurs éléments constitutifs : légal, matériel ou moral. 1. Classifications fondées sur l’élément légal Si l’on se fonde sur ce critère, on distingue, en premier lieu, la division tripartite des infractions « suivant leur gravité ». À cet égard, l’article 111-1 du Code pénal indique que les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Cette classification procède, en réalité, de la nature (criminelle, correctionnelle, contraventionnelle) des peines encourues par leurs auteurs, en vertu de la loi ou du règlement, malgré la formule de l’article 111-1 du Code pénal retenant comme critère de la classification des infractions leur « gravité ». S’agissant des peines criminelles, elles sont fixées par l’article 131-1 du Code pénal. Il s’agit de la réclusion (ou de la détention) criminelle à perpétuité et de la réclusion (ou de la détention) criminelle à temps (qui est de 10 ans au moins). En ce qui concerne les peines correctionnelles visées à l’article 131-3 du Code pénal, elles sont l’emprisonnement (dont la durée ne peut excéder 10 ans), la contrainte pénale, l’amende (dont le montant peut être supérieur ou égal à 3 750 €), le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits prévues par l’article 131-6 du Code pénal, les peines complémentaires prévues par l’article 131-10, la sanction-réparation. On peut faire observer que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice procède à la réécriture de l’échelle des peines correctionnelles, en prévoyant la création de la « peine unique de stage » et de la nouvelle peine de « détention à domicile sous surveillance électronique ». La peine de contrainte pénale serait intégrée dans le « sursis probatoire » (cette dénomination remplacerait celle de sursis avec mise à l’épreuve). Quant aux peines contraventionnelles, définies à l’article 131-12 du Code pénal, elles sont l’amende (dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € pour les contraventions de cinquième classe, porté à 3 000 € en cas de récidive), les peines privatives ou restrictives de droits visées à l’article 131-14, la peine de sanction-réparation. Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues par les articles 131-16 et 131-17 du Code pénal (telles que la suspension du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, le travail d’intérêt général contraventionnel). 55 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 La division tripartite des infractions présente certains intérêts pratiques. Un premier intérêt est relatif aux sources du droit : les crimes et les délits relèvent du domaine législatif (art. 111-2 C. pén.), alors que les contraventions relèvent de la matière réglementaire. En ce qui concerne les juridictions compétentes pour juger ces trois catégories d’infractions, les crimes sont soumis à la connaissance de la cour d’assises, les délits le sont à celle des tribunaux correctionnels, tandis que les contraventions relèvent de la compétence des tribunaux de police. En outre, la prescription de l’action publique, c’est-à-dire le délai au-delà duquel on ne peut plus poursuivre l’infraction, est en principe de 20 ans pour les crimes, de 6 ans pour les délits et de 1 an pour les contraventions. Quant aux délais de prescription de la peine (c’est-à-dire le délai au-delà duquel on ne peut faire subir à un condamné une peine prononcée contre lui), ils sont : 20 ans pour les peines criminelles, 6 ans pour les peines correctionnelles et 3 ans pour les peines contraventionnelles. Par ailleurs, la tentative des crimes est toujours punissable, celle des délits ne l’est que si la loi le décide expressément, alors que la tentative des contraventions n’est pas punissable. Enfin, la règle du non-cumul des peines ne joue, en principe, que pour les crimes et les délits. En second lieu, on peut distinguer, selon le critère légal, la division en infractions de droit commun, d’une part, et en infractions politiques, infractions militaires et infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées, d’autre part. Les infractions politiques sont, tout d’abord, celles qui ont pour objet de porter atteinte à l’ordre politique de l’État. Elles entraînent l’application de la peine de détention criminelle à perpétuité ou de celle de détention criminelle à temps de 10 ans au moins (dès lors qu’il s’agit d’un crime politique). Les infractions militaires sont, ensuite, celles qui ont été commises par un militaire (critère subjectif) ou qui constituent la violation d’un devoir militaire (critère objectif), telles que la désertion ou le refus d’obéissance. Les infractions objectivement militaires relèvent de la compétence des juridictions spécialisées; elles ne comptent pas pour la récidive et leurs auteurs ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’extradition. Quant aux infractions relatives à la criminalité organisée, elles sont définies aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale. Elles se caractérisent, d’une part, par leur gravité et, d’autre part, par la pluralité d’auteurs (la plupart de ces infractions doivent être commises en bande organisée). Enfin, elles justifient l’application des règles de procédure dérogatoires à celles du droit commun (perquisitions, garde à vue, écoutes téléphoniques, etc.). Mais il convient aussi de préciser les classifications des infractions fondées sur l’élément matériel. 2. Classifications fondées sur l’élément matériel L’élément matériel d’une infraction pouvant être un acte positif ou un comportement négatif, il est permis de distinguer les infractions de commission (vol, meurtre, par exemple) et celles d’omission ou d’abstention (non-assistance à personne en péril, délit de fuite, par exemple). En outre, certaines infractions peuvent se réaliser en une période de temps très courte, alors que d’autres se prolongent dans le temps par une réitération constante de la volonté du coupable après l’acte volontaire initial. Dans la première hypothèse, on parle des infractions instantanées, alors que dans la seconde, des 56 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 infractions continues. De plus, il existe une catégorie intermédiaire, celle des infractions continuées. Il s’agit de la réitération d’une série d’infractions instantanées de même nature, liées entre elles par une intention unique (le vol de gaz ou d’électricité par branchement clandestin, par exemple). En raison de l’unité d’intention, la jurisprudence soumet ces infractions au régime des infractions continues. On pourra, par ailleurs, distinguer entre les infractions simples et les infractions complexes. Les premières comportent un seul élément matériel donnant à l’acte sa qualification pénale (par exemple, le meurtre), tandis que dans les secondes, l’élément matériel est composé de plusieurs actes (par exemple, l’escroquerie). Aux distinctions précédentes, on pourra encore ajouter celle opposant les infractions matérielles et les infractions formelles. Il y a infraction matérielle, lorsque le résultat dommageable figure parmi les éléments constitutifs de l’infraction (par exemple, le meurtre); en revanche, une infraction est formelle, lorsqu’elle est considérée comme consommée indépendamment du résultat dommageable voulu par son auteur (par exemple, l’empoisonnement). Ensuite, il existe la distinction entre les infractions isolées et les infractions d’habitude. Les premières sont réalisées par un seul acte délictueux, qu’il soit instantané ou continu, tandis que les infractions d’habitude ne sont incriminées qu’en raison du danger social que représente la réitération de certains agissements qui, isolés, n’appelleraient pas de sanction pénale (par exemple, l’exercice illégal de la médecine). La jurisprudence se contente de deux faits délictueux pour décider qu’il y a habitude, auquel cas la répression est possible. Enfin, la dernière classification des infractions est fondée sur l’élément moral. 3. Classifications fondées sur l’élément moral La principale distinction des infractions fondées sur l’élément moral est celle des infractions intentionnelles et des infractions non intentionnelles. Tous les crimes et la plupart des délits sont des infractions intentionnelles. Quant aux infractions non intentionnelles, elles exigent qu’il y ait eu une faute dans le comportement de l’agent. Celle-ci s’entend souvent d’une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cependant, dans certains cas, la faute peut résulter du seul fait de la violation de la prescription légale ou réglementaire (par exemple, délits de nature technique). 57 Greffier en chef, 2012 La classification des infractions Magistrat, concours externe, 2014 L’appréhension pénale du terrorisme Magistrat, concours externe, 2006 La dangerosité Magistrat, concours externe, 2004 Les contraventions Officier de gendarmerie, 2005 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 Sujets de concours Chapitre 1 Quels sont les moyens du droit pénal et de la procédure pénale dans la lutte contre la criminalité organisée ? Officier de police, 2014 Les infractions non intentionnelles Sous-directeur de l’Administration pénitentiaire, externe et interne, 2002 La lutte contre le terrorisme : les principales incriminations et les particularités procédurales 58 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 chapitre La légalité criminelle 84 L’article 111-3 du Code pénal énonce, sous une forme nouvelle, le principe de la légalité de la répression, qui est une base fondamentale du droit pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ». L’article 111-4 dispose, en outre, que « la loi pénale est d’interprétation stricte », ce qui contribue à déterminer la portée exacte du principe de la légalité. De son côté, l’article 112-1 est ainsi conçu : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». Il consacre par là le principe de la non-rétroactivité de la répression, corollaire du principe de la légalité. Enfin, la loi pénale étant une manifestation de l’autorité de l’État et organisant le fonctionnement du service public de la justice répressive, son emprise ne s’étend en général que sur le territoire national : c’est ce qu’on appelle le principe de la territorialité du droit pénal. Nous étudierons ces trois aspects de l’élément légal de l’infraction dans les trois sections de ce chapitre : Section 1 – Le principe de la légalité des délits et des peines Section 2 – L’application de la loi pénale dans le temps Section 3 – L’application de la loi pénale dans l’espace 84 section 1 Le principe de la légalité des délits et des peines 85 C’est le principe selon lequel aucune incrimination ni aucune peine ne peuvent être retenues, sans avoir été prévues par un texte émanant des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire sous peine d’encourir une sanction pénale. 85 59 86 > 88 L’infraction Nous allons étudier le fondement de ce principe et son évolution, d’une part • § 1 – Nous examinerons ses conséquences, d’autre part • § 2. 1 Fondement et évolution du principe international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 § 86 La liberté des citoyens serait gravement menacée, si les pouvoirs publics pouvaient les poursuivre pour des faits qui n’auraient pas été incriminés par un texte préexistant porté à leur connaissance. Il y a là une règle fondamentale de justice tendant à empêcher toute arrestation ou toute poursuite arbitraire. Il y a là aussi, corrélativement, un principe délimitant la zone de libre activité des honnêtes gens. À ce double titre, le principe de la légalité des délits et des peines est apparu comme tellement important qu’il fut inscrit dans de nombreuses Constitutions et dans certaines Déclarations des droits de l’Homme et du citoyen (art. 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789; art. 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ratifiée par la France en 1974; art. 11-2° et 22-2° de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’ONU en 1948; Préambule et art. 34 de la Constitution du 4 oct. 1958; art. 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). 87 Le principe de la légalité des délits et des peines fait cependant l’objet de certaines critiques, sous prétexte qu’il serait difficilement compatible avec certaines données de la science criminologique moderne. Certaines personnes présentent en effet un état dangereux avant même d’avoir commis une infraction, et il peut sembler opportun de prendre tout de suite à leur égard une mesure tendant à défendre la société contre le danger qu’elles présentent, cette mesure revêtant d’ailleurs le caractère de mesure de sûreté plutôt que de peine (sur le problème de l’influence de la criminologie sur la manière d’envisager le principe de la légalité, cf. Pinatel, « L’élément légal de l’infraction devant la criminologie et les sciences de l’homme », RSC 1967, p. 683). 86 87 – 88 On pourra faire observer que la loi no 2008-174 du 25 février 2008 a institué la rétention de sûreté, qualifiée par le législateur de mesure de sûreté, qui consiste dans le placement d’une personne, après qu’elle a purgé sa peine, en un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, dans lequel l’intéressé bénéficiera, de façon permanente, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique, dispensée par une équipe pluridisciplinaire (art. 706-53-13, dernier al., C. pr. pén.). La rétention de sûreté répond à la notion de mesure de sûreté, car son principe dépend de l’état dangereux de l’individu, c’est-à-dire de la grande probabilité de le voir à nouveau violer la loi pénale, et de la possibilité d’un traitement visant à éliminer cet état dangereux et à empêcher ainsi la récidive. En matière de peines, le principe de la légalité a reçu certains tempéraments. Si la peine avait jadis pour principal but d’intimider les délinquants, ce but d’intimidation a, sans disparaître entièrement, perdu beaucoup de son importance, et les peines sont aujourd’hui organisées également en vue de permettre la réinsertion sociale du délinquant. Il est nécessaire, dès lors, pour que les peines puissent remplir un tel rôle, qu’une certaine souplesse préside à leur exécution. Si le condamné s’amende, la durée du traite- 8 60 La légalité criminelle – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 ment pourra être abrégée. Si, au contraire, la peine prononcée prend fin sans avoir amené l’amélioration attendue, il serait utile de pouvoir prolonger le traitement. Actuellement, une peine apparaît beaucoup moins comme le salaire objectif et tarifé, si l’on peut dire, d’une infraction, que comme une mesure adaptée à la personnalité d’un délinquant en vue de l’amender, de le « resocialiser ». Pour toutes ces raisons, en matière de peines, le principe de la légalité a fait l’objet en droit français de certains assouplissements. L’autorité judiciaire a reçu du législateur des pouvoirs étendus pour modérer la peine prévue ou pour en adoucir l’exécution. Certaines législations vont même jusqu’à permettre que le juge prononce des sentences de durée indéterminée, mais ceci n’est pas admis en droit français où le législateur fixe toujours un maximum que le juge ne peut pas dépasser, de même que l’Administration ne peut prolonger l’exécution de la peine au-delà de la date fixée par le juge. Les pouvoirs publics ont cependant, tout en respectant en apparence ce principe fondamental, un moyen de le tourner qui aboutirait à le vider de toute substance; c’est d’édicter des textes créant des incriminations tellement larges ou tellement vagues que le juge garderait une grande possibilité d’arbitraire. C’est ce qu’on appelle des « délits ouverts ». Ainsi l’article 82 de l’ancien Code pénal punissait quiconque, en temps de guerre, accomplissait « sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte ». Sous l’empire du nouveau Code pénal, on peut relever certaines incriminations dont l’élément matériel n’était pas précisé par le législateur. Ainsi, l’article 222-33 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, définissait le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle… », sans donner la moindre précision sur les modalités d’accomplissement de l’acte délictueux. La doctrine a pu se demander si le texte d’incrimination satisfaisait aux exigences posées par le principe de légalité. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester la conformité de ce texte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’aux principes de clarté et de précision de la loi, le Conseil constitutionnel l’a déclaré non conforme à la Constitution en raison de son imprécision (Cons. const., QPC, déc. no 2012-240 QPC du 4 mai 2012, D. 2012, p. 1372, note S. Detraz). Le législateur a donc été amené à procéder à la réécriture de l’article 222-33 du Code pénal avec la loi no 2012-954 du 6 août 2012. Ainsi, le harcèlement sexuel est désormais défini « comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (v. Ph. Conte, « Invenias disjecti membra criminis : lecture critique de la nouvelle définition du harcèlement sexuel », Dr. pénal 2012, étude no 24; v. Crim. 18 nov. 2015, Dr. pénal 2016, comm. no 21, note Ph. Conte; Crim. 16 nov. 2016, Dr. pénal 2017, comm. no 53, note Ph. Conte). Comme Portalis l’écrivait, « en matière criminelle, il faut des lois et point de jurisprudence »; sans aucun doute, méconnaissent le principe de légalité des textes d’incrimination confiant de larges pouvoirs d’interprétation au juge répressif, en favorisant l’arbitraire judiciaire. Par ailleurs, il est des domaines dans lesquels le législateur ne peut pas entrer dans des définitions par trop précises. Tel est le cas des infractions politiques, qui comportent fréquemment des définitions 61 89 > 91 L’infraction extrêmement larges. Cela permet à la jurisprudence de donner des solutions correspondant à l’évolution de la notion d’ordre public. 89 2 Conséquences du principe Si, sur le plan de la morale et de la justice, le principe de la légalité, qui exige un texte à la base de toute poursuite, apparaît comme une garantie contre l’arbitraire, sa mise en œuvre soulève de délicats problèmes. Nous étudierons tour à tour les sources du droit pénal (A), la détermination des infractions (B), la détermination des peines (C), les règles de procédure (D) et l’interprétation des lois pénales (E). Enfin, on pourra constater que le principe de la légalité comporte quelques limites (F). 89 A. Sources du droit pénal 90 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 § Pendant longtemps on a pensé, depuis le droit intermédiaire, que seule la loi pouvait être la source du droit pénal. C’est une garantie contre le totalitarisme que de réserver au seul pouvoir législatif le soin de prévoir les incriminations et les sanctions qui s’y attachent. Avec le développement du dirigisme économique et avec l’évolution de plus en plus technique des sociétés modernes, il est apparu que, pour les infractions les moins graves, la procédure législative était une source de droit trop lourde et qu’il convenait de faire une place au règlement et à certains actes administratifs comme sources du droit pénal. 90 1° La loi, source principale du droit pénal 91 La source principale du droit pénal reste la loi. Le Code pénal de 1810, décrété par Napoléon Ier, était une longue loi consacrée au droit pénal général et au droit pénal spécial (V. supra, nos 12 et s.). Modifié de très nombreuses fois (V. supra, no 13), il a été remplacé en 1994 par le nouveau Code pénal qui a fait l’objet de plusieurs réformes (V. supra, nos 19 et s.). Au Code d’instruction criminelle de 1808 traitant de la procédure criminelle et de l’exécution des peines, a été substitué, en décembre 1958, le Code de procédure pénale (entré en vigueur le 2 mars 1959). Ce code a été modifié à diverses reprises (v. supra, nos 20 et s.). En dehors de ces codes, de très nombreuses lois traitent de questions de droit pénal lato sensu. Non intégrées au Code pénal, elles sont dites « lois spéciales » (V. Appendice du Code pénal, éd. Dalloz, 2018), (v. aussi supra, nos 13 et 17). Depuis la Ve République et à la suite de l’élargissement en 1974 de la saisine du Conseil constitutionnel, ce dernier peut être appelé à apprécier la conformité des textes adoptés par le Parlement à la Constitution. En particulier, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs (art. 61 Const.). Ainsi saisi, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce qui s’impose au législateur (Cons. const. 1991 62 La légalité criminelle 92 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 20 janv. 1981 JCP 1981. II. 19701, note C. Franck, D. 1982, p. 441, note A. Dekeuwer). Il a, par ailleurs, estimé qu’une loi nouvelle ne pouvait pas sanctionner des situations existantes légalement acquises (Cons. const. 10-11 oct. 1984, RSC 1985, p. 341), et qu’un texte répressif devait définir les éléments constitutifs d’une infraction en termes clairs et précis (Cons. const. 18 janv. 1985, RSC 1985, p. 609; Cons. const. 5 mai 1998, D. 1999, p. 209, note B. Mercuzot). En outre, depuis la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, les dispositions législatives d’un texte pénal peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, sur décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation (art. 61-1 Const.). Il en est ainsi, lorsqu’il est soutenu, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, que les dispositions en cause portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2010, a défini les principales règles de procédure selon lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, soulevées à l’occasion des litiges devant les deux ordres de juridiction. Ainsi, les juges constitutionnels ont déclaré les dispositions de droit commun applicables à la garde à vue contraires à la Constitution, car elles n’instituaient pas les garanties appropriées à l’utilisation qui était faite de cette mesure (Cons. const., déc. no 2010-14/22 QPC, 30 juill. 2010, D. 2010, p. 1949, Point de vue P. Cassia, p. 2259, obs. J. Pradel). En outre, ils ont considéré que l’article L. 7 du Code électoral, qui prévoyait la peine automatique (cette peine suit automatiquement une condamnation principale sans que le juge pénal ait besoin de la prononcer expressément) d’interdiction de s’inscrire « sur la liste électorale (cette radiation entraînait une inéligibilité de 10 ans), pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive » (cette peine s’appliquait automatiquement, d’une part, aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour une infraction portant atteinte au devoir de probité imposé aux fonctionnaires et décideurs publics, telle que la corruption ou le trafic d’influence; d’autre part, elle s’appliquait aux particuliers ayant commis une infraction portant atteinte à l’administration publique), n’était pas conforme à la Constitution (Cons. const., déc. no 2010-6/7 du 11 juin 2010, JO 11 juin 2010, p. 10849, Dr. pénal 2010, comm. no 84, 3e esp., note J.-H. Robert, D. 2010, p. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, RTD com. 2010, p. 815, obs. B. Bouloc), car il méconnaissait le principe d’individualisation des peines. De même, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l’article 22233 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel (v. supra, no 88). Plus récemment, la Haute juridiction, après avoir dégagé ses propres critères interdisant le cumul des poursuites et des sanctions pour des faits identiques, a mis partiellement fin à un tel cumul pour le délit d’initié et le manquement d’initié (Cons. const., 18 mars 2015, décis. no 2014-453/454 QPC et no 2015-462 QPC, JCP G 2015, 368, note F. Sudre et ibid. 369, note J.-H. Robert; Rev. sociétés 2015, p. 380, note H. Matsopoulou; RSC 2015, p. 374, obs. F. Stasiak, ibid. 705, obs. B. de Lamy). À la suite de cette décision, le législateur est intervenu, avec la loi no 2016-819 du 21 juin 2016, afin d’interdire le cumul des sanctions administratives et pénales, prononcées respectivement par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers et par le juge pénal pour les mêmes faits. Les juges constitutionnels ont également déclaré, à deux reprises, contraires 92 63 93 > 94 L’infraction – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 à la Constitution les dispositions de l’article 421-2-5-2 du Code pénal définissant le délit de consultation habituelle de sites terroristes (Cons. const., 10 févr. 2017, no 2016-611 QPC; Cons. const., 15 déc. 2017, no 2017-682 QPC), créé par la loi du 3 juin 2016 (le Conseil constitutionnel ayant abrogé, par sa décision du 10 févr. 2017, cette incrimination, la loi du 28 févr. 2017 a repris ce délit qui a connu le même sort). En particulier, ils ont considéré que ce texte portait « une atteinte à l’exercice de la liberté de communication » qui n’était pas « nécessaire, adaptée et proportionnée ». En outre, la Constitution, elle-même, contient des dispositions concernant le droit pénal; ainsi en est-il de l’organisation du droit de grâce, des immunités parlementaires (V. infra, no 764) et de l’institution de la Cour de justice de la République (V. infra, no 485). Enfin, il convient d’observer que se multiplient depuis quelques décennies les Conventions ou Accords internationaux qui « retentissent » au droit pénal et/ou à la procédure pénale (Convention européenne des droits de l’Homme, Accord de Schengen, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décisions-cadres du Conseil de l’Union européenne, etc. V. infra, nos 148 et s.). On signalera que la France a ratifié les accords ou conventions instituant un tribunal pénal international pour juger certains agissements commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que la convention de Rome du 17 juillet 1998 ayant créé la Cour pénale internationale (ratifiée par la France le 9 juin 2000 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002; cf. infra, no 157). On peut encore y ajouter un certain nombre de décisions-cadres prises par le Conseil de l’Union européenne, comme celles du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, du 22 juillet 2003 concernant la lutte contre la corruption dans le secteur privé, du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie ou du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime. Les lois antérieures à la promulgation des codes ont pour la plupart été abrogées, soit de manière expresse, soit de façon tacite, parce que les textes nouveaux traitaient de la même matière. Cependant, dans la mesure où un texte antérieur au nouveau Code pénal et non abrogé n’est pas incompatible avec l’ordre public moderne, on doit considérer qu’il est toujours en vigueur. – Il faut assimiler aux lois, c’est-à-dire aux actes du pouvoir législatif, les ordonnances et les décretslois des gouvernements provisoires, actes émanant du gouvernement investi de la plénitude du pouvoir législatif; il en est de même des décisions prises par le président de la République en vertu de l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958. En revanche, les ordonnances de l’article 38 de la Constitution, qui sont prises par le gouvernement pour l’exécution de son programme, sur autorisation du Parlement, doivent donner lieu à une ratification législative pour valoir « lois ». 93 94 S’agissant des lois étrangères, elles ne sont pas, en principe, sources de droit pénal français en raison de la territorialité du droit pénal. Il en est autrement des traités passés avec les États étrangers. Il convient de noter que ces traités, une fois ratifiés par la France, ont, en vertu de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de nos lois. 93 Enfin, la coutume ne peut pas être source de droit pénal, comme elle est source de droit civil et surtout de droit commercial. Il peut arriver, par exemple, que le parquet laisse, pendant longtemps, un texte en sommeil sans l’appliquer. Ce texte n’est pas abrogé pour autant. Une longue tolérance à l’accomplissement d’un acte, qui constitue une infraction, ne confère aucun droit aux citoyens. C’est ce que décida la Cour de cassation en matière 94 64 La légalité criminelle 2° Les actes du pouvoir exécutif Les actes du pouvoir exécutif peuvent être également une source de droit pénal. Il est possible que, pour ne pas se contenter d’incriminations trop vagues, le pouvoir législatif, incapable d’entrer dans le détail de certaines matières techniques, confie au pouvoir exécutif le soin d’établir les règlements qui fourniront des incriminations suffisamment précises (L. du 15 juillet 1845 pour la police des chemins de fer, abrogée par l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du Code des transports; L. du 1er août 1905 pour les fraudes et falsifications, abrogée et insérée dans le Code de la consommation par l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation [art. L. 451-1 et s. et L. 454-1 et s.]). Dans ce cas, le législateur prévoit lui-même les peines qui sanctionneront la réglementation à établir. 95 95 – 96 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 d’avortement; les personnes poursuivies avaient prétendu qu’il y avait une tolérance qui leur assurait l’impunité et que la loi était « objectivement mauvaise et immorale, caduque ». Le législateur est alors intervenu pour mettre la loi en harmonie avec les mœurs (L. du 17 janv. 1975, puis du 31 déc. 1979 modifiée par celle du 4 juill. 2001), mais subsiste l’incrimination d’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée (art. 223-10 C. pén.; il est à noter que la loi no 2013-711 du 5 août 2013 a expressément incriminé la tentative de cette infraction [art. 223-11 C. pén.]). L’autorité de ces « textes administratifs » d’incrimination est sensiblement moindre que celle des lois. Ils n’ont de valeur qu’autant qu’ils se maintiennent bien dans le cadre de la délégation législative qui les a autorisés; tout ce qui dépasse ce cadre est illégal, et le règlement illégal est dépourvu d’autorité en matière pénale. Il y a illégalité quand l’autorité qui a pris le texte n’avait pas qualité pour ce faire, quand ce texte n’a pas reçu la publicité voulue, quand il contredit une loi ou un principe constitutionnel, quand il est entaché de détournement de pouvoirs, etc. L’illégalité du texte administratif peut être mise en relief par deux procédés différents : 1° l’acte peut être attaqué directement par voie d’action au moyen d’un recours en annulation porté devant les juridictions administratives; si cet acte est annulé, aucune poursuite ne peut plus se fonder sur lui; 2° l’illégalité peut être invoquée aussi par voie d’exception : poursuivi devant le tribunal répressif, le prévenu peut opposer l’illégalité du texte administratif qu’on lui reproche d’avoir enfreint; si le tribunal estime ce texte illégal, il refusera d’en faire application et relaxera le prévenu, mais le règlement ne sera pas annulé pour autant et pourra servir de base à de nouvelles poursuites. C’est l’exception d’illégalité. Les ordonnances, prises en vertu de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, n’ont pas une autorité législative complète et peuvent elles aussi faire l’objet du double recours ci-dessus, notamment se voir opposer l’exception d’illégalité, tant qu’elles ne sont pas ratifiées. L’article 111-5 du Code pénal dispose que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » (v. Crim. 3 juin 1998, Bull. crim. no 182, RSC 1999, p. 314, obs. B. Bouloc; Crim. 1er oct. 2002, Dr. pénal 2003, comm. no 7, note J.-H. Robert, RSC 2003, p. 342, obs. J.H. Robert). Elles sont tenues d’examiner le bien-fondé de l’exception d’illégalité d’un 96 65 97 > 97 L’infraction acte administratif ayant servi de fondement aux poursuites, même dans l’hypothèse où cet acte a été précédemment validé par le juge administratif (Crim. 17 déc. 2014, no 1386.686). Ainsi la cour d’appel de Paris a pu constater, par application de l’article 111-5 du Code pénal, l’illégalité d’un arrêté municipal interdisant la possession, la détention et la circulation de certains chiens (Pitt Bull) sur le territoire de la commune, mais condamner le propriétaire d’un tel chien, qui, par défaut de surveillance de l’animal, avait causé à autrui une incapacité de travail (Paris, 13e ch., 17 déc. 1996, Dr. pénal 1997, comm. no 46, note M. Véron). international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 – En réalité, la règle posée par l’article 111-5 du Code pénal ne fait que consacrer la jurisprudence déjà existante en la matière. À vrai dire, la notion d’acte administratif, dont le juge pénal peut apprécier la légalité, avait été conçue, pendant longtemps, de manière stricte. Dans la majorité des cas, l’exception d’illégalité ne concernait que les actes pénalement sanctionnés ayant servi de fondement aux poursuites. Cependant, sous l’empire de l’état d’urgence, certains tribunaux correctionnels n’ont pas hésité à contrôler, en vertu de l’article 111-5 du Code pénal, la légalité des arrêtés préfectoraux autorisant des perquisitions et, à la suite d’un tel contrôle, à relaxer les personnes poursuivies, au motif que lesdits arrêtés ne satisfaisaient pas aux exigences imposées par l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, telles que la « motivation » des décisions préfectorales, l’identification des personnes visées par les perquisitions ou l’indication du « lieu » et du « moment » de l’opération. Pour sa part, la chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé, par les arrêts du 13 décembre 2016, une telle position, en énonçant « qu’en application de l’article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité de l’ordre de perquisition, qui, sans constituer le fondement des poursuites, détermine la régularité de la procédure » (Crim. 13 déc. 2016, no 16-82.176, no 16-84.162 et no 1684.794, JCP G 2017, no 206, note J.-H. Robert, D. 2017, p. 275, note J. Pradel). C’est qu’en effet, « de la légalité de ces actes dépend […] la régularité de la procédure pénale subséquente et donc la “solution du procès” au sens de l’article précité » (v. les conclusions de M. l’avocat général F. Desportes, JCP G 2017, no 141). Puis, une jurisprudence ultérieure, tout en rappelant la compétence de l’autorité judiciaire pour apprécier la légalité des ordres préfectoraux de perquisition, a apporté une précision importante quant à l’étendue du contrôle exercé par cette autorité. En particulier, lorsque le juge judiciaire estime l’arrêté préfectoral insuffisamment motivé, il lui appartient « de solliciter le ministère public afin d’obtenir de l’autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s’était fondée pour prendre sa décision » (Crim. 28 mars 2017, no 16-85.073 et no 1685.072, JCP G 2017, no 473, note J.-B. Perrier; Crim. 3 mai 2017, no 16-86.155 [à propos d’une mesure d’assignation à résidence]). 97 En outre, depuis la Constitution du 4 octobre 1958, dont l’article 34 n’a rangé dans le domaine propre de la loi que la « détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables », sans faire allusion aux contraventions, le gouvernement a reçu le droit de « légiférer » dans ce dernier domaine par voie de décrets en Conseil d’État (Ord. no 58-1297 du 23 déc. 1958 et Décr. no 58-1303 de la même date). L’article 111-2, alinéa 2, du Code pénal confirme le principe : « Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ». 97 66 La légalité criminelle 98 Le décret no 93-726 du 29 mars 1993, « portant réforme du Code pénal (Deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) en modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale » : 1° a abrogé les articles R. 1er à R. 43 de l’ancien Code pénal (les articles R. 25 à R. 41-1 étaient afférents aux contraventions de police); 2° a abrogé les dispositions des textes législatifs antérieurs à l’entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui édictaient des peines d’emprisonnement pour des contraventions et qui prévoyaient la récidive des contraventions des quatre premières classes; 3° a modifié les textes afin qu’ils fassent désormais référence aux dispositions de l’article 131-13 du nouveau Code pénal qui fixe le montant de l’amende en matière contraventionnelle, cinq classes de contraventions étant aménagées (comme dans l’ancien code) : la 1re faisant encourir 38 € au plus d’amende; la 2e, 150 € au plus; la 3e, 450 € au plus; la 4e, 750 € au plus; la 5e, 1 500 € au plus, et 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, sauf dans les hypothèses où la loi énonce que la récidive de la contravention constitue un délit (ainsi, le législateur a fait de la contravention de grand excès de vitesse un délit en cas de récidive; art. L. 413-1 C. route). 99 En résumé, le gouvernement détermine les incriminations de caractère contraventionnel et fixe les peines applicables dans les limites ainsi déterminées par la loi (amendes relatives aux cinq catégories de contraventions prévues par l’article 131-13 du Code pénal et autres peines contraventionnelles prévues aux articles 131-14 et suivants du Code pénal). Le décret no 93-726 du 29 mars 1993 a encore prévu que « les dispositions du Code pénal (Deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) sont fixées par les livres Ier à VI annexés au présent décret ». Sont ainsi substitués aux anciens articles R. 25 à R. 41 relatifs aux « contraventions de police et peines », les nouveaux articles R. 610-1 à R. 655-1 (livre VI du décret du 29 mars 1993 : « Des contraventions ») qui répriment les contraventions contre les personnes, les biens, la nation, l’État ou la paix publique. L’inobservation du « règlement de police » (par exemple un arrêté du préfet ou du maire) fait encourir à son auteur, comme par le passé, la peine d’amende attachée aux contraventions de la 1re classe. Ainsi, l’article R. 610-5 du Code pénal dispose-t-il que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ». 9 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 98 3° Les conventions européennes ou internationales 100 L’article 55 de la Constitution énonce que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Or, tel est le cas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1974. Le 2 octobre 1981, la France ayant accepté le recours individuel ouvert par l’article 25 de la Convention, la victime de la violation de l’un des droits fondamentaux consacrés par la Convention (par exemple, le droit à la vie, à la liberté, à un procès équitable, au respect de la vie privée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion…) peut, de plein droit, saisir l’organe de contrôle : la Cour européenne des droits de l’Homme. 10 67 101 > 102 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 Dans le même esprit, a été adoptée à Nice, le 7 décembre 2000, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui reconnaît un ensemble de droits (dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice) au citoyen européen. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, cette charte s’est vue accorder la même valeur juridique que les traités (art. 6, 1 TUE, selon lequel « l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités »). 101 S’agissant du droit européen, il est constitué de deux ensembles. Il y a, d’abord, le droit composé du Traité de Rome du 25 mars 1957, instituant une Communauté économique européenne (CEE), de l’Acte unique européen entré en vigueur en 1987, du Traité de Maastricht du 7 février 1992 et du traité d’Amsterdam entré en vigueur en 1999. Toutefois, le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009, a profondément modifié le Traité de Rome de 1957, rebaptisé « Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (TFUE), et le Traité sur l’Union européenne – TUE (Traité de Maastricht de 1992). L’Union européenne est désormais régie par ces deux traités. Il est vrai que le Traité de Rome du 25 mars 1957 n’a pas créé, en dehors de certaines règles sanctionnatrices concernant les ententes et abus de position dominante (art. 85 et 86, devenus art. 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), d’incriminations s’appliquant directement dans les ordres répressifs des États membres. En revanche, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet désormais à l’Union de déterminer des sanctions minimales pour les comportements punissables, contrairement à la CJCE qui avait estimé, par une décision du 23 octobre 2007, que la détermination du type et du niveau des sanctions pénales applicables ne relève pas de la compétence de la Communauté. On rappellera que l’article 83 du TFUE dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Ces domaines sont : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. Il en résulte donc que le législateur français n’aura pas le choix de sanctionner tel ou tel comportement, dès lors que la décision a été prise au niveau de l’Union européenne. Certes, il pourra déterminer la peine maximale encourue, mais il sera lié à la fois par la nature de la peine définie par la directive et par le quantum minimum à prévoir pour cette peine au cas où la directive comporterait une telle précision. 102 Il y a, en outre, le droit ayant comme source les actes unilatéraux des institutions européennes, tels que les règlements et les directives. Les règlements sont directement applicables (Crim. 6 févr. 2001, Bull. crim. no 37), ce qui signifie que les législateurs nationaux n’ont pas besoin de les transposer. Parfois, ils se substituent aux normes internes dont la violation est pénalement sanctionnée. Un règlement de l’Union européenne peut donc paralyser une incrimination interne, par exemple en raison de l’application du principe 10 102 68 La légalité criminelle international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 de libre circulation des marchandises (Crim. 18 sept. 1997, Bull. crim. no 305). Aussi bien, le juge français doit-il refuser d’appliquer un texte répressif interne qui irait à l’encontre d’un règlement (Crim. 10 avr. et 12 juin 1995, Bull. crim. nos 152 et 213). En cas de difficultés d’interprétation, les juridictions nationales peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une exception préjudicielle. L’interprétation donnée s’impose alors au juge interne. Quant aux directives européennes, elles imposent aux États de prendre une ou plusieurs mesures en vue de les transposer mais ces derniers disposent du choix d’en définir les modalités. À cet égard, on pourra faire observer que l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne indique que « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence, quant à la forme et aux moyens ». Ainsi, le législateur français a-t-il transposé : avec la loi no 2013-711 du 5 août 2013, trois directives européennes (v. supra, no 19); avec celle no 2014-535 du 27 mai 2014, la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (v. supra, no 26); avec la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 – renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale –, la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers (dite « directive C »). B. Détermination des infractions 103 Aucun fait ne peut faire l’objet de poursuites s’il n’a pas été expressément prévu par un texte. Les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal confirment ce principe fondamental : « La loi détermine les crimes et délits […] le règlement détermine les contraventions » (art. 111-2) – « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement » (art. 111-3). L’article 112-1 du Code pénal « reprend » le principe : « Sont seuls punissables [pénalement] les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». Le fait critiquable moralement, voire socialement (tel le fait d’accepter de mauvaise foi un paiement indu), qui n’est pas visé par la loi pénale, ne saurait être pénalement réprimé. Le législateur se trouve en quelque sorte en faute de ne l’avoir pas prévu et il lui appartient, pour l’avenir, d’édicter une règle nouvelle érigeant le fait blâmable en infraction (ce que le législateur a fait le 26 juillet 1873 pour incriminer la grivèlerie ou la filouterie d’aliments, qui ne constituait ni un vol, ni une escroquerie, ni un abus de confiance [art. 313-5 C. pén.]; il a de même réprimé le défaut de paiement du péage d’autoroute par l’art. R. 421-9 C. route). En l’absence de texte, l’auteur d’un comportement blâmable ne peut être pénalement poursuivi mais il pourrait éventuellement être condamné par les tribunaux civils à indemniser la victime. Aussi bien, les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement doivent-elles viser expressément, dans les actes de la procédure, le texte applicable à chaque fait poursuivi. Le principe de la légalité est conforté par deux corollaires : celui de la non-rétroactivité de la loi pénale (V. infra, nos 113 et s.) – celui de l’interprétation stricte de la loi pénale (V. infra, no 107). 103 69 104 > 107 L’infraction C. Détermination des peines 104 Le juge ne peut prononcer que les peines expressément prévues par la loi. Il ne peut, par exemple, prononcer une peine d’emprisonnement ou d’amende excédant le maximum prévu par le texte d’incrimination pour l’infraction considérée (Crim. 26 sept. 2007, Bull. crim. no 223). Il ne peut pas non plus infliger une peine d’amende à un mineur âgé de cinq ans (après l’avoir déclaré coupable de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique), car une telle peine n’est pas prévue par l’article 21 de l’ordonnance du 2 février 1945 applicable aux mineurs (Crim. 14 nov. 2017, no 17-80.893). L’article 112-1, alinéa 2, du Code pénal dispose que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date » (date à laquelle les faits constitutifs de l’infraction ont été commis). Ainsi, la peine complémentaire de confiscation de biens ne peut être prononcée, dès lors qu’à l’époque des faits, la loi ne la prévoyait pas pour l’infraction incriminée (Crim. 29 juin 2016, Bull. crim. no 209). Le Code pénal ne fixe que la peine maximale attachée à chaque infraction. Dans l’ancien code, la peine principale attachée à une infraction comportait, sauf exception, un maximum et un minimum; le nouveau code ne comporte plus de mention d’un minimum. Cette modification est de peu d’importance : depuis des décennies le juge descendait souvent en dessous de ce minimum par le jeu des circonstances atténuantes. Cellesci ne sont pas conservées dans le nouveau Code, compte tenu du pouvoir confié au juge de déterminer librement la peine en respectant le maximum prévu par la loi. À la phase de l’exécution, le régime de la peine peut évoluer à la suite des décisions du juge ou du tribunal de l’application des peines (art. 712-1 et s. C. pr. pén.). 105 Il arrive que, par suite d’un oubli du législateur ou par suite de l’emploi d’une peine par référence à un texte postérieurement abrogé, des faits incriminés par la loi ne se trouvent frappés d’aucune peine. Le juge ne peut pas se substituer au législateur défaillant. On est en présence d’une loi imparfaite et aucune sanction ne peut être prononcée par analogie ou tout autre raisonnement. 105 D. Règles de procédure 106 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 104 Bien que l’article 4 de l’ancien Code pénal n’affirmait le principe de la légalité que pour la définition des infractions et des peines, on a toujours pensé que ce principe concernait également l’organisation de la procédure pénale. Il est certain, en effet, que la compétence des juridictions, leur organisation, les pouvoirs des juges, du parquet, de la police, l’organisation des voies de recours intéressent de près la liberté des citoyens. L’article 34 de la Constitution de 1958 le reconnaît, du reste, expressément en rangeant la procédure pénale dans le cadre, pourtant restreint, des matières qui relèvent de la loi. Le Code pénal (art. 112-2) consacre, en outre, le principe de l’application immédiate de ces lois, sauf exception (V. infra, no 122). 106 E. Interprétation des lois pénales 107 L’article 111-4 du Code pénal confirme un principe fondamental, qui n’est qu’un corollaire du principe de la légalité : « La loi pénale est d’interprétation stricte ». 107 70 La légalité criminelle 108 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 On dit souvent que les lois pénales doivent s’interpréter restrictivement. Le terme est impropre : la loi pénale est déclarative et le juge doit en tirer toutes les conséquences que le législateur a entendu y attacher, rien de plus mais rien de moins. Les juges se livrent pour cela à une analyse minutieuse des textes répressifs, mais le raisonnement par analogie, qui est peut-être possible en matière de lois de procédure pénale, est certainement prohibé chaque fois qu’on est en présence d’un texte instituant une incrimination ou une peine. Cela serait, en effet, un moyen facile de tourner le principe de la légalité que de pouvoir poursuivre des faits non expressément visés par la loi mais ressemblant à des faits déjà prévus. De ressemblance en ressemblance, on arriverait à créer de toutes pièces des incriminations nouvelles. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que les communications téléphoniques constituent des prestations de service, insusceptibles de faire l’objet d’une appropriation frauduleuse, ce qui l’a conduite à exclure, en l’espèce, la qualification de vol (Crim. 12 déc. 1990, Bull. crim. no 430, D. 1991, p. 364, note S. Mirabail). Statuant en Assemblée plénière, la Haute juridiction a décidé que l’interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce que le délit d’homicide involontaire ait pour victime un enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus (Ass. plén. 29 juin 2001, Bull. cass. plén. no 165, D. 2001, chron. p. 2907, note J. Pradel et p. 2917, note Y. Mayaud). La même formule a été, par la suite, reprise par la chambre criminelle (Crim. 25 juin 2002, Bull. crim. no 144, RSC 2003, p. 91, obs. B. Bouloc et p. 95, obs. Y. Mayaud; v. aussi : Crim. 4 mai 2004, Bull. crim. no 108, D. 2004, p. 3097, note J. Pradel, RSC 2004, p. 884, obs. Y. Mayaud; Crim. 2 oct. 2007, Bull. crim. no 234, Dr. pénal 2008, comm. no 1, note M. Véron). Depuis, la Cour de cassation a rappelé la même règle, à propos du délit de discrimination visé à l’article 432-7 du Code pénal, impliquant une entrave à l’exercice d’une activité économique (Crim. 24 mai 2005, Bull. crim. no 151). Ce n’est pas à dire cependant que le juge pénal soit voué à l’automatisme d’une inter108 prétation passive des textes. Il doit faire œuvre d’interprète, scruter, en fonction des travaux préparatoires et du contexte, le sens véritable de la loi, sans s’en tenir fatalement à une interprétation rigoureusement grammaticale. À cet égard, on peut citer un texte sur la police des chemins de fer assez malheureusement rédigé qui interdisait « de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté ». La lettre du texte obligeait les voyageurs à descendre en marche ! La Cour de cassation n’en a pas moins confirmé la condamnation d’un voyageur qui prétendait avoir obéi à la lettre de la loi (Crim. 8 mars 1930, D. 1930. 1. 301). De même, les tribunaux répressifs ont fait entrer les vols de gaz ou d’électricité dans le champ d’application de l’article 379 de l’ancien Code pénal rédigé cependant à un moment où l’on n’employait pas ces sources d’énergie. En se prononçant ainsi, la jurisprudence a donc considéré le courant électrique comme une chose mobilière susceptible d’appropriation (on peut faire observer que les rédacteurs du nouveau Code pénal ont entériné cette solution dans l’actuel article 311-2, selon lequel « la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol »). Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qui concernent la diffamation ou l’injure, ont été aussi appliquées aux infractions perpétrées à l’aide des moyens modernes de transmission de la pensée, tels que la radio, le cinéma, la télévision (Chavanne, note JCP 1954. II. 8229) ou même le disque (Crim. 14 janv. 1971, Gaz. Pal. 1971. 1. 180). Par ailleurs, la jurisprudence a jugé que le fait, pour une personne, de se faire remettre des marchandises, dont elle a acquitté le 71 109 > 109 L’infraction 109 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 prix au moyen de cartes de crédit volées en faisant frauduleusement usage du nom de leurs titulaires, constituait les manœuvres frauduleuses visées à l’article 405 de l’ancien Code pénal (actuel art. 313-1, nouveau C. pén.; v. Crim. 19 mai 1987, Gaz. Pal. 1988. I. som. 5). Actuellement, on peut constater que les modes opératoires de nombreuses infractions étant de plus en plus dématérialisés, la jurisprudence ne cesse de s’adapter aux évolutions de la technologie. Ainsi, les juges répressifs ont retenu les manœuvres frauduleuses, constitutives du délit d’escroquerie (art. 313-1 C. pén.), en cas de télétransmission, par une infirmière, des feuilles de soins attestant de kilomètres fictifs parcourus (Crim. 11 juill. 2017, no 16-84.828). Dans d’autres cas, la jurisprudence se montre beaucoup moins respectueuse de la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale en élargissant de manière abusive le domaine d’application de tel ou tel texte d’incrimination. On en voudra, notamment, pour preuve les solutions adoptées en matière d’abus de confiance, la jurisprudence ayant admis que l’acte de détournement, élément constitutif du délit, peut porter sur « un bien incorporel » (Crim. 21 sept. 2011, no 11-80.305; Crim. 16 déc. 2015, Bull. crim. no 304), tel que le numéro d’une carte de crédit (Crim. 14 nov. 2000, Bull. crim. no 338, D. 2001, p. 1423, note B. de Lamy), un projet de borne informatique (Crim. 22 sept. 2004, Bull. crim. no 218) ou des informations relatives à la clientèle d’une société (l’absence de détournement préalable de fichiers informatiques ou de tout autre support écrit relatifs à la clientèle est indifférente; v. Crim. 16 nov. 2011, Bull. crim. no 233, D. 2012, p. 137, note G. Beaussonie, JCP G 2012, no 322, note S. Detraz; Crim. 22 mars 2017, no 15-85.929). Il a même été décidé, par un arrêt du 19 juin 2013 (Crim., 19 juin 2013, JCP G 2013, no 37, p. 933, note S. Détraz, Dr. pénal 2013, comm. no 158, note M. Véron, RSC 2013, p. 813, obs. H. Matsopoulou), que constitue un abus de confiance « l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur ». Mais, admettre que « le temps de travail » puisse faire l’objet d’un détournement, c’est vouloir écarter la définition légale de l’abus de confiance en violation d’un principe à valeur constitutionnelle, celui de l’interprétation stricte de la loi pénale. On rappellera à cet égard que l’article 314-1 du Code pénal exige que les « biens » détournés aient été préalablement « remis » et « acceptés », à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. La solution adoptée est loin de respecter les termes de la loi, car on voit mal le « temps de travail » faire l’objet d’une « remise » de la part de l’employeur. On remarquera que ce mouvement jurisprudentiel de « dématérialisation » a été également étendu au délit de vol exigeant la « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (art. 311-1 C. pén.). En particulier, il a été jugé que cette infraction peut porter sur des « informations personnelles sur un réseau informatique », susceptibles de faire l’objet d’une « appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction » (Crim. 28 juin 2017, no 16-81.113; v. aussi : Crim. 20 mai 2015, D. 2015, p. 1466, note L. Saenko, JCP G 2015, no 887, note G. Beaussonie, RSC 2015, p. 860, obs. H. Matsopoulou). Il en résulte donc que le vol peut, comme l’abus de confiance, être retenu indépendamment de tout support matériel. Les difficultés d’interprétation donnent parfois lieu à des controverses doctrinales et à une jurisprudence dépourvue d’homogénéité. Ainsi en est-il au sujet du sens qu’il con109 72 La légalité criminelle 110 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 vient d’accorder au mot domicile en matière de violation de domicile, d’une part, et de perquisitions, d’autre part. Certains auteurs – et même certaines juridictions (Toulon 26 avr. 1983, JCP 1984. II. 20214) – considèrent que la voiture automobile est un prolongement du domicile, thèse que repousse la Cour de cassation (V. H. Matsopoulou, « Violation de domicile », J.-Cl. Pén., art. 226-4, no 24). De même, il est parfois difficile de distinguer le harcèlement sexuel des « manœuvres de séduction » (V. Douai 10 sept. 1997, JCP 1998. II. 10037, note Garé). En outre, le viol a donné lieu à des controverses; étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise », la chambre criminelle a jugé, dans un premier temps, que tout acte de fellation est susceptible de constituer un viol, dès lors qu’il est imposé par l’un des moyens précités à celui qui le subit ou à celui qui le pratique (Crim. 16 déc. 1997, D. 1998, chron. p. 212, Y. Mayaud). Elle a, par la suite, considéré que lorsqu’une fellation est pratiquée sur un homme contre son gré, en l’absence de pénétration sexuelle de la victime, il ne s’agit pas d’un viol mais d’une agression sexuelle (Crim. 22 août 2001, Bull. crim. no 169; v. aussi Crim. 21 févr. 2007, Bull. crim. no 61, RSC 2007, p. 301, obs. Y. Mayaud [« pour être constitutive d’un viol, la fellation implique une pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par un objet le représentant »]). Parfois, les difficultés d’interprétation amènent le législateur à modifier les textes. Ainsi, la loi du 22 juillet 1996 (art. 132-75, dernier al., C. pén.) a assimilé à l’usage d’une arme l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer. Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale a, en outre, conduit la jurisprudence à refuser de sanctionner, au titre du vol, la captation frauduleuse des programmes télédiffusés, réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service (CA Paris, 24 juin 1987, RSC 1987, p. 211, obs. P. Bouzat). Cette attitude jurisprudentielle a amené le législateur à intervenir pour réglementer expressément la question. Plus précisément, la loi no 87-520 du 10 juillet 1987, dont les dispositions ont été initialement insérées dans le Code pénal, puis dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a institué certaines incriminations spécifiques (art. 79-1 à 79-5) ayant pour finalité d’empêcher tout accès frauduleux à des émissions télévisées codées par l’emploi de certains moyens (équipements, matériels, dispositifs ou instruments). 10 F. Limites à l’application du principe de la légalité 111 Les juridictions disciplinaires, chargées de sanctionner les manquements aux règles déontologiques d’une profession, ont fréquemment de très larges pouvoirs d’appréciation, aussi bien en ce qui concerne les incriminations que les sanctions à prendre. Il n’en va autrement que lorsque la profession envisagée comporte un code déontologique très précis (les juridictions disciplinaires ne sauraient être confondues avec les juridictions pénales : supra, no 8). On doit rappeler que le cumul des sanctions pénales et disciplinaires est autorisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (V. Cons. const. 17 janv. 2013, déc. no 2012-289 QPC; Cons. const. 24 oct. 2014, déc. no 2014-423 QPC, Dr. pénal 2015, comm. no 14, note V. Peltier; Cons. const. 1er juill. 2016, déc. no 2016-550, QPC). Quant à la Cour de cassation, elle se prononce pour un tel cumul, en affirmant que la 11 73 112 > 113 L’infraction section 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 règle non bis in idem n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif, car les deux sanctions « sont de finalité, de nature et de sévérité différentes » (Crim. 10 janv. 2017, Bull. crim. no 12). L’application de la loi pénale dans le temps 112 12 Nous examinerons successivement : • § 1 Le principe de la non-rétroactivité des lois pénales • § 2 Son application aux lois de fond • § 3 Son application aux lois de forme • § 4 L’application immédiate des lois plus douces § 1 Le principe de la non-rétroactivité des lois pénales A. Fondement 113 Le principe de la non-rétroactivité des lois pénales est un corollaire du principe de la légalité des délits et des peines. Il ne servirait à rien, en effet, qu’une poursuite pénale ne puisse avoir lieu qu’en raison d’un texte, si ce texte pouvait être promulgué pour les besoins de la cause, après que le fait poursuivi a été accompli. Le Préambule de la Constitution de 1958 renvoyant solennellement à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui consacre le principe de la non-rétroactivité des lois pénales, ce dernier principe a valeur constitutionnelle et s’impose donc au législateur (V. Cons. const. 10-11 oct. 1984, JO 13 oct. 1984, p. 3200). On ne saurait, par conséquent, s’étonner de ce que l’article 112-1 du Code pénal énonce : « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». Ce principe de la non-rétroactivité des lois pénales est – comme celui de la légalité – une garantie importante de la liberté des citoyens. Dans le procès qui les oppose, en cas d’infraction, aux pouvoirs publics, il serait choquant que la norme soit fixée après coup par l’une des parties. Il faut que les citoyens, lorsqu’ils agissent, sachent exactement quelles sont les conséquences possibles de leurs actes sur le plan de la répression. Ils ont, en quelque sorte, un « droit d’attente légitime » à ce que leurs actes obéissent aux lois qu’ils connaissaient ou pouvaient connaître au moment où ils les ont accomplis. Si, donc, une loi nouvelle modifie, postérieurement à la commission des faits, les conditions de la répression, cette loi nouvelle ne pourra pas s’appliquer aux faits commis et la loi ancienne continuera à jouer. 13 74 La légalité criminelle – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 Cependant, comme la loi nouvelle constitue, en principe, un progrès par rapport à la loi ancienne, c’est la loi nouvelle qui prévaudra chaque fois qu’il sera possible de l’appliquer sans que soient lésés les « droits d’attente légitime » des citoyens, et tout particulièrement lorsque la loi nouvelle est plus douce pour l’individu poursuivi. C’est ainsi que l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal énonce que les dispositions nouvelles « s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Si la condamnation a été prononcée à raison d’un fait qui, en vertu de la loi nouvelle, est dépouillé de tout caractère pénal, la peine « cesse de recevoir exécution » (art. 112-4, al. 2, C. pén.). B. Difficultés d’application En cas de changement de loi entre la commission de l’infraction et le jugement, c’est la loi en vigueur au moment de la commission de l’infraction qui s’applique. On peut faire observer que les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française qui, depuis le 1er janvier 2016, n’est mis à la disposition du public que « sous forme électronique » (art. LO 6213-2 CGCT, modifié par la loi organique no 2015-1712 du 22 déc. 2015, portant dématérialisation du Journal officiel de la République française, art. 1er). 114 14 – Il existe, par ailleurs, des lois interprétatives qui se contentent de préciser le sens d’une loi ancienne, sans y ajouter aucune règle de fond. Dans ce cas, la loi interprétative sera considérée comme étant en vigueur à la même date que la loi interprétée, avec laquelle elle forme un tout (V. Crim. 15 avr. 2015, Bull. crim. no 93; Crim. 25 mai 2016, Bull. crim. no 161; Crim. 15 nov. 2017, no 17-85.272). Encore faut-il qu’il s’agisse d’une véritable loi interprétative. Parfois les pouvoirs publics ont faussement qualifié d’interprétatifs des textes qui, en fait, comportaient des règles nouvelles. Les tribunaux ont refusé, dans de tels cas, d’appliquer ces textes à des situations antérieures. Il peut aussi arriver que l’infraction accomplie s’étende sur une période de temps plus ou moins longue et que l’on ait du mal à déterminer la date de sa commission pour en déduire quelle est la loi qui doit s’appliquer; c’est ce qui se passe lorsque, entre le commencement et la fin de la commission de l’infraction, deux lois se sont succédées. En principe, pour que la loi nouvelle s’applique, il faut que tous les éléments constitutifs de l’infraction aient été accomplis sous son empire. – Les infractions d’habitude exigent la commission de deux actes au moins. Il est donc nécessaire, si l’on veut appliquer la loi nouvelle, que les deux derniers faits, au moins, se soient produits sous son empire. La jurisprudence se contente cependant – et sur ce point elle est critiquable – de ce que le dernier fait seul ait été accompli sous l’empire de la nouvelle loi pour appliquer celle-ci (Poitiers 16 août 1940, DC 1941. 78, note Lebrun). Certains auteurs approuvent cette solution en faisant observer que lorsqu’il a accompli le dernier acte, le délinquant connaissait la loi nouvelle et savait, par conséquent, ce que le nouvel acte qui consommait le délit d’habitude allait lui coûter. C’est un point de vue moins soucieux du respect total du principe de la légalité que celui qui aboutit à la solution opposée. – Un raisonnement identique peut être suivi en ce qui concerne la récidive, lorsque le premier et le second terme de la récidive ont été accomplis sous l’empire de deux lois successives, dans lesquelles l’aggravation de la peine résultant de la récidive n’est pas la même. Le respect intégral du principe de la légalité voudrait que, dans un tel cas, on applique la loi ancienne sous l’empire de laquelle la première infraction a été accomplie. C’est ce qu’a décidé la loi du 2 février 1981 en disposant que l’aggra- 75 115 > 116 L’infraction § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 vation de la peine résultant des nouvelles règles de récidive qu’elle établissait ne jouerait que pour les infractions ayant donné lieu à des condamnations prononcées postérieurement à son entrée en vigueur (cf. CEDH 10 nov. 2004, D. 2005, p. 1203, note Roets). – En revanche, pour les infractions continues successives, où l’intention coupable se perpétue ou se renouvelle tant que l’état de choses délictueux subsiste (port illégal de décoration, par exemple), la loi nouvelle s’appliquera, dès lors que l’état délictueux persiste après sa parution, étant donné qu’il eût été facile à l’intéressé de mettre fin à l’état délictueux quand le changement de législation s’est produit (V. Crim. 25 févr. 2015, Dr. pénal 2015, comm. no 81, 1re esp., note M. Véron [poursuite des faits délictueux après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle qui les incrimine]). – Enfin, pour les infractions permanentes, où l’état de choses délictueux subsiste en l’absence de toute nouvelle manifestation de volonté de l’agent, la loi applicable sera celle en vigueur au moment où la volonté de l’agent s’était manifestée, même si le résultat s’est prolongé sous l’empire d’une loi nouvelle (par ex. : immeuble construit en violation des textes régissant la construction; la loi pénale applicable sera celle qui était en vigueur à la fin de la construction). De telles infractions doivent être assimilées, du reste, à des infractions instantanées (V. supra, nos 74 et s.). 2 L’application du principe aux lois de fond A. Lois concernant les incriminations Est applicable la loi définissant l’infraction au moment où celle-ci a été accomplie (art. 112-1 C. pén.). 115 15 – Cette application peut présenter un grave danger d’inefficacité en matière politique et certains auteurs pensent que, de même que le principe de la légalité convient assez mal à cette catégorie d’infractions, de même son corollaire, celui de la non-rétroactivité, n’y est pas parfaitement adapté. En droit positif, cependant, on s’efforce de le faire jouer même pour cette catégorie d’infractions. C’est ainsi qu’après des périodes troublées, les lois nouvelles organisent la répression en se référant aux textes qui existaient avant ces périodes (Ord. du 28 août 1944 sur les crimes de guerre, qui renvoyait à certains textes du Code pénal). Selon la jurisprudence antérieure à 1958, le principe de la non-rétroactivité ne s’imposait pas au législateur; celui-ci pouvait donc attribuer expressément un effet rétroactif à une loi pénale (Crim. 15 mars 1956, Gaz. Pal. 1956. 1. 426). La constitutionnalité d’une telle loi serait aujourd’hui, eu égard au texte de la Constitution de 1958, vivement contestée. C’est ce qu’a confirmé le Conseil constitutionnel en écartant, dans sa décision du 20 janvier 1981, certaines dispositions du texte voté par le Parlement (et qui devint la loi du 2 févr. 1981, aujourd’hui abrogée) qui permettaient d’appliquer aux auteurs de certaines infractions, dites de « violence », des peines plus élevées que celles édictées par la loi applicable au moment des faits. B. Lois concernant les peines et les mesures de sûreté 116 La peine applicable à une infraction est celle prévue par la loi au moment où cette infraction a été commise. Toutefois, le Code pénal dispose que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont applicables immédiatement à la répression 16 76 La légalité criminelle des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf lorsque ces lois nouvelles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, auquel cas elles ne sont applicables qu’aux « condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur » (art. 112-2, 3° C. pén.). En ce qui concerne les mesures de sûreté, qui peuvent être prononcées pour faire face à un état dangereux et qui poursuivent essentiellement des buts préventif (faire obstacle au renouvellement d’infractions graves qui doivent être identiques à celles ayant donné lieu à des condamnations) et curatif (comme c’est le cas, par exemple, de l’injonction de soins), les lois nouvelles, qui les prévoient, s’appliquent en principe immédiatement, même en raison d’infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur (déchéance du droit d’être banquier par exemple, art. L. 500-1 C. mon. et fin.). Pour la même raison, les lois prévoyant à l’égard des mineurs délinquants des mesures, qui se proposent moins de les punir pour leurs infractions que de les amender de leurs mauvaises tendances, s’appliquent immédiatement, même à des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur (Crim. 11 juin 1953, JCP 1953. II. 7708, note Brouchot). De même, la surveillance judiciaire des personnes dangereuses (instituée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive), qualifiée par le législateur de « mesure de sûreté » (art. 723-29 C. pr. pén.), s’applique immédiatement aux « condamnés dont le risque de récidive est constaté », après la date de l’entrée en vigueur de la loi précitée. Cette mesure pourra donc être prononcée à l’encontre des condamnés pour des faits commis antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 12 décembre 2005 (V. art. 42). 118 Toutefois, la rétention de sûreté, instituée par la loi no 2008-174 du 25 février 2008 (art. 706-53-13 C. pr. pén.) et qualifiée expressément par celle-ci de mesure de sûreté, ne peut être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de cette loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Sur ce point, on pourra faire observer que le Conseil constitutionnel a censuré le texte initial, ayant prévu l’application immédiate des dispositions relatives à la rétention de sûreté, en estimant que cette mesure, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction », ne saurait être appliquée rétroactivement (Cons. const., 21 févr. 2008, no 2008-562 DC, JO 26 févr. 2008, p. 3272, considérant no 10). Par conséquent, la rétention de sûreté ne peut concerner que les personnes condamnées pour des faits commis postérieurement à la loi du 25 février 2008 (V. toutefois, Crim. 28 mars 2018, no 17-86.938 : la rétention de sûreté peut être appliquée, conformément aux articles 723-37 et 706-53-19 C. pr. pén., à une personne, même condamnée avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008, qui méconnaît, après l’entrée en vigueur de cette loi, les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté). 119 Pour sa part, la Cour de cassation a, dans un premier temps, refusé, au nom du principe de la légalité, l’application immédiate de la loi du 25 février 2008, instituant la nouvelle procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, au motif que cette procédure « a pour effet de faire encourir à une personne des peines prévues à l’article 706-136 du Code de procédure pénale que son état mental ne lui faisait pas 17 18 19 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 117 77 120 > 121 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 encourir sous l’empire de la loi ancienne applicable au moment où les faits ont été commis » (Crim. 21 janv. 2009, D. 2009, p. 1111, note H. Matsopoulou). Puis, par un arrêt du 16 décembre 2009 (V. à propos de cet arrêt : H. Matsopoulou, Dr. pénal 2010, étude no 4), la chambre criminelle, réunie en formation plénière, est revenue sur sa position, en se prononçant pour l’application immédiate du nouveau dispositif. En particulier, elle a décidé que le principe de la légalité des peines ne peut s’appliquer « aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 et 706-136 du Code de procédure pénale ». Il en résulte donc qu’après avoir disqualifié les mesures visées à l’article 706-136 du Code de procédure pénale en peines, en les soumettant ainsi à la règle de la non-rétroactivité, la Haute juridiction a finalement tenu compte, dans l’arrêt du 16 décembre 2009, de la dénomination législative. Une telle position est approuvée par la Cour EDH, ayant estimé que l’hospitalisation d’office (devenue hospitalisation complète; art. 706-135 C. pr. pén.) et les mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du Code de procédure pénale, susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’une personne ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ne sont pas des peines auxquelles le principe de non-rétroactivité, énoncé par l’article 7 § 1, seconde phrase, de la Convention, a vocation à s’appliquer (CEDH, 3 sept. 2015, no 42875/10, Berland c/ France, Dr. pénal 2015, comm. no 134, note V. Peltier; v. aussi : CEDH, 7 janv. 2016, no 23279/14, Bergmann c/ Allemagne, Dr. pénal 2016, comm. no 70, note V. Peltier [à propos de l’application rétroactive de la prolongation de la détention de sûreté allemande en cas de trouble mental]). Il faut bien reconnaître que cette solution s’oppose à celle adoptée par les juges européens, dans l’affaire M. c/Allemagne (CEDH, 17 déc. 2009, no 19359/04), qui, statuant sur la régularité de l’internement de sûreté (mesure équivalente à la rétention de sûreté) prévu par le droit allemand, n’ont pas hésité à le qualifier de « peine » relevant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme. 120 En tout cas, il serait souhaitable qu’un régime minimum applicable aux mesures de sûreté figure dans le Code pénal (V. H. Matsopoulou, « Le renouveau des mesures de sûreté », D. 2007, chron. p. 1607 et s.). Aussi bien, toutes les mesures de sûreté, qui emportent des atteintes à la liberté d’aller et de venir, ne devraient concerner que les actes accomplis après leur entrée en application. Il appartient donc au législateur de définir le statut-cadre des mesures de sûreté (V. H. Matsopoulou, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la “dangerosité” et l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux », Dr. pén. 2008, étude no 5, p. 7 et s.). 121 Quant aux lois qui concernent le régime pénitentiaire, la jurisprudence décide toujours leur application immédiate, même aux auteurs d’infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur et non encore jugées, et même aux peines en cours relatives à des condamnations prononcées sous l’empire d’une autre législation. On affirme que le fonctionnement interne du régime des peines concerne la marche d’un service public administratif et que nul n’a de droit acquis à telle ou telle forme de fonctionnement des services pénitentiaires. Cette solution présente le grand avantage de simplifier la gestion de l’Administration pénitentiaire, qui n’a pas à mettre en œuvre en même temps plusieurs régimes de la même peine. C’est ainsi que la loi du 25 décembre 1880 décida que la transportation des condamnés aux travaux forcés devait désormais se faire vers la 120 12 78 La légalité criminelle – Cependant, cette solution peut sembler critiquable, car le délinquant a présent à l’esprit, lorsqu’il commet une infraction, le régime concret de la peine encourue plus que sa dénomination juridique abstraite; aussi peut-on penser qu’un changement de régime en ce domaine vient décevoir « un droit d’attente légitime ». Il y a ainsi, avec le régime pénitentiaire, tout un secteur important de la répression qui échappe au principe de la non-rétroactivité. (V. sur ce point, G. Levasseur, Mélanges A. Vitu, p. 349). § 3 L’application du principe aux lois de forme A. Principes Les lois de forme échappent, selon une jurisprudence constante, au principe de la nonrétroactivité; elles s’appliquent immédiatement, même à des infractions commises antérieurement. Le Code pénal confirme cette jurisprudence : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance; 2° les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure » (art. 112-2). Il s’agit de lois organisant le fonctionnement d’un service public, celui de la justice, et nul ne peut arguer d’un droit acquis à être jugé selon une procédure déterminée. 122 12 – Si cet argument est valable, lorsqu’il s’agit de détails d’organisation dont la modification est incontestablement inspirée par un souci de progrès technique et peut tourner aussi bien à l’avantage du prévenu qu’à son détriment, il est inexact qu’il en soit toujours ainsi. Il existe des cas où l’application immédiate d’une loi de forme aboutit à des solutions d’une grande rigueur, par exemple lorsque la loi nouvelle établirait pour une infraction la compétence de « juridictions d’exception », dont la composition répond à un désir de sévérité (V. G. Levasseur, « Réflexions sur la compétence », Mélanges Hugueney, Sirey 1964, p. 13). Il y aurait, cependant, certaines difficultés pratiques à faire fonctionner à la fois plusieurs types de procédure et même parfois à maintenir en service des juridictions abolies. B. Applications pratiques 123 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 Guyane et non vers la Nouvelle-Calédonie comme auparavant. Elle s’appliqua immédiatement, même à des personnes antérieurement condamnées, quelque déplaisir qu’elles puissent en éprouver. De même, la loi du 10 juin 1983 prévoyait que « toute période de sûreté exécutée en application des dispositions abrogées prendra fin dès l’entrée en vigueur de la présente loi ». Les lois qui modifient les règles de compétence des tribunaux s’appliquent immédiatement, même pour juger des infractions commises antérieurement. En cas de correctionnalisation légale, lorsque la loi nouvelle transforme un crime en délit et le fait donc relever de la compétence du tribunal correctionnel et non plus de celle 123 79 123 > 123 L’infraction – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 de la cour d’assises, les infractions envisagées, qui étaient des crimes au moment où elles ont été commises, seront jugées par les tribunaux correctionnels. De même, pour un délit transformé en contravention. Il n’en irait autrement que si un jugement au fond avait déjà été rendu en première instance. Dans ce cas, on terminerait la procédure en appliquant la loi ancienne. En cas de simple saisine des tribunaux selon la loi ancienne sans décision sur le fond, la loi nouvelle s’applique immédiatement et entraîne, au besoin, un dessaisissement. Il en est également ainsi lorsque la modification de compétence est l’objet direct de la loi nouvelle et non la conséquence indirecte de la disqualification légale de l’infraction (transfert de compétence des juridictions de droit commun aux juridictions militaires, ou réciproquement; institution de juridictions pour mineurs ou de juridictions spéciales, etc.). Les lois de procédure stricto sensu s’appliquent immédiatement aux procès en cours (règles de preuve, de tenue des audiences, de composition des tribunaux, etc. v. par exemple, Crim. 24 janvier 2007, Dr. pénal 2007, comm. no 47, 2e esp., note M. Véron : l’article 13 de la loi du 30 décembre 2004, qui prévoit la possibilité pour les juridictions civiles, pénales ou administratives d’inviter la Halde à présenter des observations sur les faits dont elles sont saisies, ne contient que des dispositions de procédure fixant les modalités des poursuites et immédiatement applicables, au sens de l’article 112-2 du Code pénal, aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur). Le législateur pourrait toutefois en disposer autrement : ainsi, selon l’article 10 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme (loi comportant tout à la fois de nouvelles circonstances aggravantes et des dispositions de procédure dérogatoires au droit commun), ladite loi n’était applicable qu’aux « faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ». De cette non-rétroactivité, on ne tarda pas à ressentir de fâcheux effets : dans une affaire criminelle relevant du terrorisme (les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986), des jurés, gravement menacés, firent défection… Ce qui détermina le législateur (L. 30 déc. 1986) à compléter l’article 10 de la loi du 9 septembre 1986 par le texte suivant : « Toutefois l’article 706-25 du Code de procédure pénale est applicable aux procédures en cours » (ce qui signifie que les crimes relevant du terrorisme, commis avant septembre 1986, pouvaient être jugés par une cour d’assises ne comportant pas de jury). L’application immédiate concerne même les voies de recours nouvelles qui peuvent être utilisées aussitôt. Cependant, si une loi nouvelle supprimait une voie de recours, la loi ancienne, autorisant celle-ci, continuerait à s’appliquer, si le recours avait déjà été introduit. Il en serait de même, si la loi ancienne était encore en vigueur au moment où la décision, pouvant en faire l’objet, a été rendue, peu important qu’au moment de l’exercice de la voie de recours, la loi nouvelle, plus sévère, ait été mise en application. La jurisprudence a beaucoup hésité et varié en ce qui concerne les lois de prescription de l’action publique ou de la peine. Selon l’article 112-2, 4° du Code pénal, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur (cf. Crim. 4 oct. 1982, Bull. crim. no 204; Crim. 4 juin 1984, Bull. crim. no 202). Et, depuis la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, il en est ainsi, même dans l’hypothèse où la loi nouvelle aurait pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Il en résulte donc que si un nouveau texte allonge un délai de prescription, la prescription de l’action publique ou de la peine d’une infraction com80 La légalité criminelle § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 mise avant l’adoption de ce texte sera soumise au nouveau délai de prescription plus long (V. aussi : Crim. 16 mai 1931, Gaz. Pal. 1931, 2. 178 qui, en matière de prescription de l’action publique, avait décidé l’application immédiate des lois de prescription, qu’elles soient ou non plus favorables, à toutes les prescriptions non encore acquises). Les lois de prescription sont alors considérées comme des lois pénales de forme (v., pour une étude détaillée, infra nos 330 et s.). 4 L’application immédiate des lois plus douces A. Le principe Lorsqu’une loi nouvelle comporte des dispositions plus douces à l’égard des délinquants, une tradition qui remonte au XVIe siècle décide l’application immédiate de cette loi plus douce, même à des infractions commises antérieurement (c’est la règle de la rétroactivité in mitius). Comme la loi nouvelle constitue en principe un progrès, il y a intérêt à l’appliquer tout de suite, et comme elle est plus douce, on ne voit pas qui pourrait se plaindre d’une telle application qui, loin de porter atteinte à « l’attente légitime » du délinquant, entraîne au contraire pour lui une solution plus favorable. 124 124 – Les positivistes ont critiqué cette règle en faisant observer que ce parti pris d’indulgence, à l’égard du délinquant, risquait parfois d’être mal placé. C’est qu’en effet, lorsqu’il a commis son infraction, il avait manifesté une volonté antisociale correspondant à la peine prévue par la loi ancienne et son état est toujours aussi dangereux. – Depuis un arrêt du 3 février 1986 (Bull. crim. no 41), la chambre criminelle affirme qu’« en l’absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui édicte des peines plus douces s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés » (v. aussi : Crim. 20 mars 1997, Bull. crim. no 116). Comme la doctrine l’a fait, à juste titre, observer, la réserve de la Cour de cassation (« en l’absence de dispositions contraires expresses ») n’est pas à l’abri de toute critique, dans la mesure où l’article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York (en vigueur en France) consacre le principe de la rétroactivité in mitius (v. A. Huet, « Une méconnaissance du droit international », JCP 1987. I. 3293; néanmoins : Crim. 24 sept. 1987, JCP 1987. IV. 368). Plus récemment, la chambre criminelle a écarté l’application de ce dernier principe, en se retranchant derrière les « objectifs recherchés par le droit de l’Union [européenne], tel qu’interprété par la Cour de justice » (Crim. 12 déc. 2017, Dr. pénal 2018, comm. no 21, note Ph. Conte; v. aussi : Crim. 7 juin 2017, no 15-87.214, Dr. pénal 2017, comm. no 131, obs. J.-H. Robert). Le dernier alinéa de l’article 112-1 du Code pénal est dépourvu d’ambiguïté : « Les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Ainsi, a-t-il été jugé que les dispositions de la loi du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, modifient les éléments constitutifs de l’homicide involontaire ou de blessures involontaires dans des conditions moins rigoureuses, la rendant applicable aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur (Crim. 5 sept. 2000, Bull. crim. no 262; Crim. 15 mai 2001, Bull. crim. no 123; v. aussi : Crim. 1er avr. 2015, Dr. pénal 2015, 2e esp., comm. no 81, 81 125 > 125 L’infraction B. Difficultés d’application international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 note M. Véron [n’est pas justifiée la décision qui condamne un prévenu pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière sans tenir compte des dispositions plus douces intervenues après la commission des faits poursuivis]). Il n’est pas toujours facile de savoir si une loi nouvelle est plus douce qu’une loi ancienne. S’il s’agit d’une incrimination, la loi nouvelle est plus douce lorsqu’elle limite moins que la précédente la liberté individuelle, ou lorsqu’elle admet des causes nouvelles d’impunité ou d’atténuation de la responsabilité. Lorsqu’il s’agit de lois portant sur des peines, la loi nouvelle est plus douce, si elle supprime une peine ou en abaisse le niveau; si elle remplace une peine par une autre, il faut se référer à l’échelle des peines : les peines correctionnelles sont plus douces que les peines criminelles (même plus courtes); les peines de police sont plus douces que les peines correctionnelles; la peine d’amende est plus douce que celle d’emprisonnement. Ainsi, a-t-il été jugé que les dispositions de l’article 262 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », ayant supprimé la peine d’emprisonnement qui était jusqu’alors attachée au délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un comité d’entreprise ou d’un comité d’établissement (art. L. 2346-1 al. 2 C. trav., sanctionnant l’entrave au fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen), étaient moins sévères que les dispositions anciennes et pouvaient, par conséquent, s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée (Crim. 26 janv. 2016, no 13-82.158). Dans l’hypothèse où, postérieurement à une infraction commise sous l’empire d’une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d’incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère, il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable (Crim. 14 juin 2017, nos 16-81.926 et 16-81.927). Parfois, il est difficile de se prononcer sur le caractère plus doux ou plus rigoureux d’une loi nouvelle. Tel est le cas lorsque celle-ci comporte à la fois des dispositions plus sévères et des dispositions plus douces. Dans une telle hypothèse, il est permis de procéder à la distinction suivante : – lorsque les dispositions de la loi nouvelle sont divisibles, on pourra faire rétroagir la partie la plus douce; – dans le cas contraire, il faut prendre en considération la disposition principale, en donnant la plus grande importance à la peine principale. 125 125 – Lorsqu’on est en présence de mesures qui ne figurent pas dans l’échelle des peines, c’est la jurisprudence qui doit déterminer la mesure qui est la plus douce. Elle décide, par exemple, que les mesures éducatives sont plus douces que les peines proprement dites. – Les mesures susceptibles d’être substituées aux peines d’emprisonnement doivent être considérées comme plus douces que celles-ci. Les jours-amende et le travail d’intérêt général doivent être considérés plus doux que l’emprisonnement. Par ailleurs, la chambre criminelle a estimé que la contrainte pénale, définie à l’article 131-4-1 du Code pénal, qui « constitue une peine alternative à l’emprisonnement sans sursis », doit être considérée comme une peine plus douce que ce dernier, si bien qu’elle peut être appliquée à des faits commis antérieurement à son entrée en 82 La légalité criminelle section 3 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 vigueur (Crim. 14 avr. 2015, trois arrêts, JCP G 2015, no 697, note V. Peltier; E. Bonis-Garçon, « De l’application dans le temps de la contrainte pénale », Dr. pénal 2015, chron. no 13). – La loi nouvelle plus douce va s’appliquer aux infractions antérieures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Une voie de recours et même un pourvoi en cassation peuvent être introduits contre une décision, uniquement pour faire appliquer une loi pénale plus douce qui est apparue pendant qu’on était encore dans le délai utile pour exercer un recours (cf. en matière de chèques sans provision, pour l’application de la loi du 3 janv. 1972, Crim. 21 nov. 1972, Gaz. Pal. 1973. 1. 78). – Si une loi nouvelle apparaît alors que la décision est devenue définitive, il est trop tard pour agir. Toutefois, le condamné, exerçant un recours en grâce, peut solliciter une réduction de peine et obtenir un résultat analogue à celui qu’aurait produit la loi nouvelle. Il n’en est différemment que si cette dernière abroge l’incrimination. L’application de la loi pénale dans l’espace 126 L’application des lois pénales peut donner lieu à des difficultés dès qu’un élément d’extranéité (élément « étranger ») s’introduit dans le débat : cet élément peut résulter du lieu où l’infraction a été commise, de la nationalité des personnes qui ont participé à l’infraction ou de la nationalité de celles qui en ont été les victimes. Il convient d’examiner successivement : Le principe de la territorialité du droit pénal • § 1 – L’entraide répressive internationale • § 2 – Le droit international pénal • § 3. 126 § 1 Le principe de la territorialité du droit pénal A. Compétence législative et judiciaire 127 Le droit pénal met en œuvre la souveraineté des États, investis du droit de punir les auteurs des infractions commises sur le territoire où s’exerce leur souveraineté. La conséquence en est que, sauf exceptions, les tribunaux nationaux sont compétents, et seuls compétents, pour juger, conformément à la loi nationale, les infractions commises sur le territoire national (comp. art. 3 C. civ.), quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes (Crim. 1er mars 2000, Bull. crim. no 101, RSC 2000, p. 814, obs. B. Bouloc; Crim. 29 mars 2000, Bull. crim. no 146). On entend par territoire national les terres délimitées par les frontières, les eaux territoriales (et éventuellement les eaux au-delà de cette limite, en raison de conventions internationales; v. art. 113-12 C. pén.) et l’espace aérien qui se trouve au-dessus de ces territoires. Selon l’article 113-2 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Ainsi, les tribunaux français sont compétents pour juger les auteurs d’une escroquerie, les 127 83 128 > 128 L’infraction – 128 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 manœuvres frauduleuses étant commises en France, mais la remise étant faite en Suisse. De même, relève de la compétence des juridictions répressives françaises le détournement à l’étranger d’un véhicule remis en France à un employé de nationalité allemande et domicilié en Allemagne (Crim. 2 décembre 2009, Dr. pénal 2010, comm. no 42, 1re esp., note M. Véron); la remise du véhicule ayant eu lieu sur le territoire français, le juge national peut se déclarer compétent pour se prononcer sur le délit d’abus de confiance, dans la mesure où un des éléments constitutifs de ce délit a bien été commis en France (en réalité, la remise d’un bien n’est qu’une condition préalable à l’infraction, mais les tribunaux la considèrent comme un élément constitutif, ce qui leur permet de retenir leur compétence; Crim. 12 février 1979, Bull. crim. no 60, D. 1979, inf. rap. 177, obs. G. Roujou de Boubée; Crim. 2 déc. 2009, Dr. pénal 2010, comm. no 42, 1re esp., note M. Véron; v. toutefois : CA Paris, 30 mai 2002, Dr. pénal 2002, comm. no 132, note M. Véron. En tout cas, le lieu de la conclusion du contrat ne peut servir à localiser l’abus de confiance : Crim. 22 avr. 1966, Bull. crim. no 121). Par ailleurs, l’article 113-2-1 du Code pénal, inséré par la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 (art. 28), indique que « Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République ». Ces dispositions permettent donc de justifier la compétence des juridictions françaises en matière de crimes et délits relatifs à la cybercriminalité, dès lors que la victime, personne physique, réside sur le territoire national (ou s’agissant d’une personne morale, elle doit avoir son siège sur le territoire national). On peut rappeler que, antérieurement à l’adoption de ce texte, la jurisprudence avait déjà jugé que lorsqu’une infraction était commise sur Internet, les juridictions répressives françaises pouvaient se déclarer compétentes pour la juger, si elle était réalisée via un site qui s’adressait effectivement au public français (Crim. 14 déc. 2010, D. 2011, p. 1055, note E. Dreyer, RSC 2011, p. 651, obs. J. Francillon). Les tribunaux nationaux peuvent également connaître des infractions commises à l’étranger, dès lors qu’il y a un lien d’indivisibilité entre celles-ci et d’autres commises sur le territoire français. On peut considérer que les faits sont indivisibles « lorsqu’ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres » (Crim. 31 mai 2016, no 15-85.920, Dr. pénal 2016, comm. no 122, note Ph. Conte; Crim. 20 sept. 2016, no 16-84.026). Ainsi, a-t-il été décidé que le délit d’association de malfaiteurs commis à l’étranger par un étranger était indivisiblement lié à des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en France par le même auteur (V. Crim. 11 juin 2008, Dr. pénal 2008, comm. no 107, note M. Véron; v. aussi : Crim. 27 oct. 2004, Bull. crim. no 262, Dr. pénal 2005, comm. no 16, 1re esp., note A. Maron). La jurisprudence va encore plus loin, en admettant la compétence des juridictions françaises lorsque le résultat d’une infraction commise à l’étranger s’est « fait sentir » en France. En particulier, elle a considéré que le délit de contrefaçon est réputé commis sur le territoire de la République, bien que l’œuvre protégée ait été reproduite à l’étranger, dès lors que l’atteinte portée aux droits de l’auteur a eu lieu en France : Crim. 6 juin 1991, Bull. crim. no 240; Crim. 29 janv. 2002, Bull. crim. no 13. L’article 113-3 du Code pénal dispose, en outre, que « La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français ou à 128 84 La légalité criminelle international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 l’encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent » (v., pour une application : Crim. 16 nov. 2016, no 14-86.980). « Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent » (cependant, les bateaux de navigation fluviale ne sont pas concernés par les termes de ce texte : Crim. 18 sept. 2007, Bull. crim. no 211, RSC 2008, p. 69, obs. E. Fortis). De même, selon l’article 113-4 du Code pénal, la loi pénale française est aussi « applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l’encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l’encontre de tels aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu’ils se trouvent ». 129 En ce qui concerne les navires battant pavillon étranger, des cas délicats se présentent lorsqu’ils sont dans les eaux territoriales françaises ou dans un port français. La loi dite du pavillon s’applique, mais la loi française devient applicable si le capitaine a réclamé l’aide des autorités françaises ou si l’ordre public a été troublé dans le port français (pour les infractions commises dans les aéronefs, v. infra, no 138), ou s’il s’agit d’un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures (art. L. 5122-26 du Code des transports art. L. 218-2 et s. C. env.). 130 La coutume internationale et la Convention de Vienne (ratifiée par la France en 1970) assurent l’immunité aux diplomates dûment accrédités, ainsi qu’aux membres de leurs familles. Les membres du personnel de service, ayant la même nationalité que le diplomate, bénéficient de cette même immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions (Cour sûreté État 1er juill. 1975, Gaz. Pal. 1975. 2. 66). Si les locaux de la mission diplomatique et la demeure privée de l’agent diplomatique sont inviolables (Convention de Vienne, art. 30), la police ne pouvant y pénétrer qu’avec le consentement ou sur la réquisition du chef de mission, cela ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions françaises pour connaître d’un crime commis dans ces lieux (Crim. 30 janv. 1979, Bull. crim. no 43, affaire de l’ambassade d’Irak). Il est vrai que l’immunité, dont jouit la personne de l’agent diplomatique (ainsi que les membres de sa famille et, à un degré moindre, les membres du personnel de service), tempère ce principe. Seul l’État étranger, que représente le diplomate, peut déclarer renoncer au bénéfice de l’immunité, permettant ainsi à l’autorité judiciaire française de juger l’intéressé. 129 130 Les articles 113-6 à 113-13 du Code pénal traitent, par ailleurs, « des infractions commises hors du territoire de la République ». Selon l’article 113-6, « la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République », tandis qu’en ce qui concerne les délits, la loi française ne s’applique que « si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ». Il faut donc que le parquet, avant d’exercer des poursuites, s’assure que la législation étrangère est bien en ce sens (principe de la double incrimination). La participation, par un acte de complicité commis en France, à une infraction commise 132 à l’étranger, ne peut être poursuivie en France que si ladite infraction est à la fois punie par les deux législations et si elle a fait l’objet d’une décision définitive de la juridiction 131 131 132 85 133 > 134 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 étrangère (art. 113-5 C. pén.; Crim. 29 janv. 2008, Dr. pénal 2008, comm. no 60, note M. Véron). Cependant, cette dernière condition n’est pas exigée pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, de l’une des infractions de corruption et de trafic d’influence (visées aux art. 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 C. pén.), qui a été commise à l’étranger (art. 435-6-2, al. 2, et 435-11-2, al. 2, C. pén., introduits par la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). Lorsque la juridiction française est compétente pour juger l’infraction principale, elle l’est aussi pour juger le complice, quels que soient sa nationalité et le lieu où les actes de complicité ont été accomplis (Crim. 29 nov. 2016, no 15-86.712, Dr. pénal 2017, comm. no 32, note Ph. Conte). 133 Les juridictions répressives françaises sont également compétentes dans certains cas où la victime de l’infraction est française : « La loi française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction » (art. 113-7). Seule la qualité de victime « directe » de nationalité française au moment de la commission d’une infraction commise à l’étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises (v. Crim. 8 nov. 2016, no 16-84.115, Dr. pénal 2017, comm. no 16, note Ph. Conte [ne sont pas susceptibles de conférer la qualité de victime au sens de l’article 113-7 du Code pénal les préjudices allégués par une personne, constituée partie civile, qui découleraient des infractions commises à l’étranger à l’encontre de son époux de nationalité étrangère]). Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 du Code pénal, la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et au vu d’une plainte de la victime (ou de ses ayants droit) ou d’une dénonciation officielle émanant de l’autorité du pays où le fait a été commis (art. 113-8). Cependant, ces exigences n’ont pas à être respectées dans certaines hypothèses expressément visées par la loi. Ainsi, l’article 227-27-1 du Code pénal prévoit que, s’agissant de certaines infractions dont les victimes sont des mineurs, telles que la corruption de mineurs ou l’atteinte sexuelle sur un mineur (c’est notamment l’odieux « tourisme sexuel » qui est visé), commises à l’étranger par un français, la loi pénale française est applicable par dérogation aux dispositions précédentes. Cependant, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger (v. Crim. 10 sept. 2014, Bull. crim. no 184 [l’exception de la chose jugée à l’étranger ne peut être invoquée dès lors que la décision de relaxe prononcée par une juridiction étrangère, frappée d’un pourvoi formé devant la Haute juridiction de l’État étranger, n’est pas devenue définitive]; v. aussi : Crim. 6 déc. 2005, Bull. crim. no 317) pour les faits considérés (les décisions rendues par les juridictions étrangères n’ont l’autorité de la chose jugée que lorsqu’elles concernent des faits commis en dehors du territoire de la République : Crim. 17 janv. 2018, no 16-86.491, Dr. pénal 2018, comm. no 59, note Ph. Conte) et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite (art. 113-9). 134 La loi pénale française est aussi applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger, dont l’extradition a été refusée à l’État requérant par les autorités françaises pour l’un des motifs suivants : 1° soit le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est sanctionné par 13 134 86 La légalité criminelle international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 l’État requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français; 2° soit la personne réclamée aurait été jugée par ledit État par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense; 3° soit le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique; 4° soit l’extradition ou la remise serait susceptible d’avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé (art. 113-8-1 C. pén.). Dans ces cas, la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. 135 De même, la loi pénale française est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l’Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l’article 692 du Code de procédure pénale ou de la justification d’une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. Et il en est ainsi même dans l’hypothèse où le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé (art. 113-6, al. 3 et 4, insérés par la loi no 2009-1503 du 8 décembre 2009, art. 36-1; v. aussi art. 689-12 C. pr. pén.). 136 Le nouveau Code pénal applique, en outre, la « compétence réelle » en certaines circonstances où les intérêts de l’État français sont directement en cause. L’article 113-10 dispose, en effet, que la loi pénale française s’applique : aux crimes et délits « qualifiés d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV » (trahison, espionnage, atteinte à la défense nationale, etc.) – à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l’État, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics (réprimés par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1) – à « tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République ». On peut aussi faire observer que la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a eu pour objectif d’étendre l’application de la loi française aux actes de terrorisme de nature délictuelle commis à l’étranger par des ressortissants français ou par des personnes titulaires d’un titre de séjour les autorisant à résider sur le territoire français, sans que les conditions prévues par les articles 113-6 et 113-8 du Code pénal soient remplies (on rappellera ici que selon ces textes, les faits doivent également être punis par la législation du pays étranger; par ailleurs, leur poursuite n’est possible que s’ils ont fait l’objet d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de la part des autorités de ce pays). Par conséquent, la règle de la réciprocité d’incrimination et l’exigence d’une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle de l’État étranger ne peuvent recevoir application en la matière. Ainsi, l’article 113-13 du Code pénal indique que « La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français ». Ce dispositif peut donc « répondre à des menaces qui proviendraient, par exemple, de ressortissants français ayant quitté la France et participant à des “camps 135 136 87 137 > 140 L’infraction d’entraînement” terroristes à l’étranger » (Rapport Sénat, no 35, fait par M. J. Mézard, enregistré à la présidence du Sénat le 10 octobre 2012, p. 7). 137 Comme dans l’hypothèse précédente, la règle de la réciprocité d’incrimination ne joue pas non plus lorsqu’il s’agit de l’une des infractions de corruption ou de trafic d’influence visées aux articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du Code pénal, qui est commise à l’étranger par un français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français (art. 435-6-2, al. 1er, et 43511-2, al. 1er, C. pén.; ces dispositions ont été introduites par la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). S’agissant, par ailleurs, de la condition procédurale, l’exigence d’une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle de l’État étranger est également écartée dans cette hypothèse. 138 Enfin, l’article 113-11 du Code pénal vise le cas des crimes et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en France (lesquels sont réputés faire partie du territoire de l’État où ils sont immatriculés) ou des personnes se trouvant à bord. Selon ce texte, la loi pénale française est applicable dans les hypothèses visées (sous réserve des dispositions de l’article 113-9) : 1° lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française; 2° lorsque l’appareil atterrit en France après le crime ou le délit; 3° lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République. En outre, l’article 113-12 déclare la loi pénale française applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que des conventions internationales et la loi le prévoient. 139 Application des règles internationales sur la compétence universelle. La loi du 30 décembre 1986 (modifiée par L. 19 juill. 1993) a ajouté au Code de procédure pénale un article 689-2, aux termes duquel l’individu qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable de tortures au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s’il se trouve en France (V. Crim. 23 oct. 2002, Rev. crit. DIP 2003, p. 309, obs. H. Matsopoulou). 140 La loi du 16 juillet 1987 (modifiée par L. 19 juill. 1993), relative à la répression du terrorisme (prise pour l’application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme et de l’accord de Dublin), a inséré dans le Code de procédure pénale un article 689-3, selon lequel peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s’il se trouve en France, quiconque s’est rendu coupable, hors du territoire de la République : 1° de l’un des crimes ou délits spécifiés (homicide volontaire, empoisonnement, coups et blessures graves, etc. : v. art. 689-3-1° C. pr. pén.) commis contre « une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques » – 2° de l’un des crimes ou délits spécifiés (arrestation illégale, séquestration, enlèvement de mineur : v. art. 689-3-2° C. pr. pén.), ou de tout autre crime ou délit comportant l’utilisation de bombes, grenades, armes à feu automatiques, etc., lorsque l’infraction est en relation avec une entreprise « ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». 138 139 140 88 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 137 La légalité criminelle Dans une même préoccupation, la loi du 30 juin 1989 a inséré, dans le Code de procédure pénale, un article 689-4 qui dispose que peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s’il se trouve en France, quiconque, hors du territoire de la République, se sera rendu coupable soit d’une infraction relative à la protection ou au contrôle des matières nucléaires, soit de l’un des crimes ou délits énumérés (V. ledit article) commis au moyen de matières nucléaires visées par la Convention internationale du 3 mars 1980 (Vienne et New York). Dans un domaine voisin, pour l’application du protocole international pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale (Montréal, 24 février 1988), l’article 689-7 du Code de procédure pénale dispose que quiconque s’est rendu coupable hors de notre territoire, par certains moyens (arme, explosif, etc.), de l’une des infractions énumérées par ce texte, qui ont pour finalité de porter atteinte à la sécurité des aérodromes affectés au trafic international, peut être jugé par les juridictions françaises s’il se trouve en France. – Les articles 689-8 et 689-9 du Code de procédure pénale reprennent aussi le principe de la compétence universelle pour l’application de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes et de la convention sur la lutte contre la corruption des fonctionnaires des États de l’Union européenne, ainsi que pour l’application de la convention de New York sur la répression des attentats terroristes. Quant à l’article 689-10 du Code de procédure pénale, il permet, pour l’application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000 et publiée par le Décr. no 2002-935 du 14 juin 2002), le jugement en France de personnes coupables d’un crime ou d’un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du Code pénal, lorsque cette infraction constitue un financement d’actes de terrorisme au sens de l’article 2 de la convention. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 – 141 De même, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire national et qui s’est rendue coupable à l’étranger de l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée (art. 689-11 inséré par la loi no 2010-930 du 9 août 2010). La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de l’intéressé. À cette fin, le ministère public s’assure, auprès de la Cour pénale internationale, qu’elle décline expressément sa compétence et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. 142 En outre, pour l’application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York (le 20 déc. 2006), peut être poursuivie et jugée par les tribunaux répressifs français toute personne coupable ou complice d’un crime défini au 9° de l’article 212-1 ou à l’article 221-12 du Code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l’article 2 de la convention précitée (art. 689-13 C. pr. pén.). L’article 689-5 du Code de procédure pénale autorise aussi la poursuite des personnes trouvées en France ayant commis l’une des infractions retenues par ledit article en application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Enfin, dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie toute personne coupable d’infractions à la réglementation issue du règlement CE 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (art. 689-12 C. pr. pén.). 141 142 89 143 > 144 L’infraction B. Les effets en France des sentences pénales étrangères En principe, de telles sentences n’ont aucun effet en France; étant des actes de souveraineté, leurs effets ne dépassent pas le cadre du territoire du pays où elles ont été rendues, sauf convention diplomatique en sens contraire ou texte particulier. Cependant, l’article 132-23-1 du Code pénal, introduit par la loi no 2010-242 du 10 mars 2010, prévoit que « les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations ». Sans aucun doute, cette disposition peut jouer en matière de récidive ou lorsqu’il s’agit d’accorder un sursis. Il est, par ailleurs, précisé que « pour l’appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française » (art. 132-23-2 C. pén.). 143 – Par ailleurs, de nombreux textes permettent de tenir compte en France, en vue de l’application de mesures de sûreté, de condamnations prononcées à l’étranger. De plus, la France a ratifié trois conventions internationales signées sous l’égide du Conseil de l’Europe, l’une sur les infractions à la circulation routière, l’autre sur la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, en reconnaissant certains effets aux décisions répressives étrangères. La troisième convention a trait au transfèrement des personnes condamnées et permet l’exécution d’une sanction dans un État autre que celui de condamnation. En outre, la Convention de Schengen du 19 juin 1990 (art. 54 et s.) reconnaît un effet à la chose jugée à l’étranger, en interdisant une nouvelle poursuite pour les mêmes faits. – Enfin, la loi no 2013-711 du 5 août 2013 a transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne. Ainsi, les articles 728-10 et s. C. pr. pén. déterminent les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d’un autre État membre. Et dans la continuité de cet effort, la loi no 2015-993 du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, a inséré, dans le Code de procédure pénale, un dispositif tendant à transposer la décision-cadre 2008/947JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (art. 764-1 et s. C. pr. pén.). § 144 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 143 2 L’entraide répressive internationale Face à certaines manifestations internationales du crime (trafic de stupéfiants, fausse monnaie, proxénétisme, etc.), le besoin s’est fait sentir d’une entraide judiciaire et d’une coopération policière internationales. Dans ce but, et après de timides essais limités à des domaines restreints, s’est créée la Commission internationale de police criminelle (1923), devenue l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL), qui groupe aujourd’hui 192 adhérents. 14 90 La légalité criminelle 145 146 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 Il ne s’agit pas d’une organisation supranationale : l’OIPC a pour but la coopération des polices criminelles « dans le cadre des lois existant dans les différents pays », les polices membres de l’organisation étant tenues de « faire tous les efforts compatibles avec leurs propres nécessités pour mettre à exécution les décisions de l’Assemblée générale » (Statuts de l’OIPC), tant en matière répressive que préventive. Le gouvernement français a signé avec INTERPOL un « accord de siège », par lequel sont reconnus à l’OIPC tout un ensemble de privilèges et immunités habituellement consentis aux représentations diplomatiques (Accord 3 nov. 1982, pub. Décr. 6 mars 1984). Ainsi, les fichiers et archives d’INTERPOL sont inviolables. Le Secrétariat général de l’Organisation (dont les services sont installés à Lyon) est en contact permanent avec les « Bureaux centraux nationaux » (BCN). Chaque adhérent d’INTERPOL désigne un BCN pour le représenter aux assemblées générales de l’OIPC, et assurer, en collaboration avec les services du Secrétariat général et ceux des autres BCN, l’œuvre quotidienne de coopération internationale dévolue à INTERPOL. La Direction centrale de la police judiciaire de la police nationale a été désignée (Décr. 26 mai 1975) comme « BCN-France ». Les missions assumées par le Secrétariat général comportent, outre un important volet de transmissions, de diffusions et de traductions, une œuvre de centralisation et d’exploitation (à l’aide de techniques contemporaines) des renseignements afférents à la criminalité présentant un caractère international et aux délinquants dits internationaux, renseignements que sont tenus de lui transmettre les BCN. En outre, d’autres progrès ont été réalisés dans le domaine de la coopération européenne (tant judiciaire que policière) en matière de lutte contre la criminalité et, plus largement, contre les troubles causés à l’ordre public. On examinera succinctement : l’Accord de Schengen et sa Convention d’application – le Traité de Lisbonne – le système Europol – et la Convention européenne sur l’entraide judiciaire en matière pénale. 145 L’Accord de Schengen, signé le 14 juin 1985 entre les gouvernements de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à « la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes » entre les partenaires, a été publié par la France le 30 juillet 1986. En 1990, est signée la Convention d’application de l’Accord (auquel se joindront l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce) et, en 1991, le Parlement français adopte le projet de loi autorisant l’approbation de la Convention (en dépit des critiques arguant d’un transfert de souveraineté découlant, en particulier, du « droit de poursuite transfrontière »). La Convention est entrée en application en ce qui concerne la France, le 26 mars 1995. Pour l’essentiel, elle dispose : 1° que les services de police (lato sensu) des Hautes parties contractantes se prêteront assistance afin de réaliser un efficace contrôle aux « frontières extérieures » des contractants (les « frontières intérieures » pouvant être franchies sans qu’un contrôle soit exercé sur les personnes); 2° que les contractants s’engagent à ce que leurs services de police lato sensu s’accordent, dans le respect de leur législation nationale, toute l’assistance souhaitable tant en matière de prévention que de recherche des faits punissables (sous réserve du respect, par chaque partenaire, des attributions de l’autorité judiciaire); 146 91 147 > 147 L’infraction 147 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 3° que les agents d’une partie contractante diligentant une enquête judiciaire, qui « observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à l’extradition », sont autorisés à poursuivre « l’observation » de cette personne sur le territoire d’une autre partie contractante, soit sur autorisation de ladite partie, soit, en cas d’urgence, sans autorisation, avis immédiat étant alors donné à cette partie (l’intervention est étroitement réglementée par la Convention); 4° que les agents d’une partie contractante, qui, dans leur pays, « suivent une personne prise en flagrant délit de commission des infractions visées au paragraphe 4 » (il s’agit d’infractions d’une certaine gravité, que chaque partie contractante précise dans une « Déclaration » annexée à la Convention), sont autorisés « à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d’une autre partie contractante lorsque les autorités de celle-ci n’auront pu être averties de l’exercice du droit de poursuite » (les modalités de l’exercice de ce droit de poursuite sont aménagées par chaque partie contractante dans la « Déclaration » évoquée ci-dessus); 5° qu’un « système d’information Schengen » est créé, qui permet aux autorités désignées par les parties contractantes, grâce à une procédure « d’interrogation automatisée », de disposer des signalements de personnes et d’objets à l’occasion du contrôle des frontières, afin de « préserver l’ordre et la sécurité publics et l’application de la circulation des personnes » sur le territoire des contractants (l’accès aux données est strictement réglementé, tandis que le système est contrôlé par une autorité composée de représentants de chaque autorité nationale). Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009 (v. supra, no 101), tend à renforcer la coopération policière et judiciaire en matière pénale, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, et à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions (v. art. 82 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE). Aussi bien, pour faciliter une telle coopération, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives, peuvent établir des règles minimales portant sur : l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres; les droits des personnes dans la procédure pénale; les droits des victimes de la criminalité; d’autres éléments spécifiques de la procédure pénale que le Conseil aura préalablement identifiés par une décision. Par ailleurs, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave (terrorisme, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des femmes et des enfants, trafic illicite de drogues et d’armes, blanchiment d’argent, corruption, contrefaçon de moyens de paiement, criminalité informatique et criminalité organisée) revêtant une dimension transfrontalière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes (art. 83 TFUE). S’agissant, en particulier, de la coopération policière, l’Union européenne développe celle-ci en associant toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière. Ainsi, afin de satisfaire un tel objectif, le Parlement européen et le Conseil peu147 92 La légalité criminelle 148 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 vent établir des mesures portant sur : la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes; un soutien à la formation de personnel, ainsi que sur la coopération relative à l’échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique; les techniques communes d’enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée (art. 87 TFUE). Enfin, le Traité de Lisbonne rend possible la création du « Parquet européen » qui serait compétent pour poursuivre les auteurs et complices d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ses attributions pouvant, en outre, être étendues à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière. On pourra faire observer que le règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 met en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dont les membres bénéficient d’une indépendance statutaire (art. 6). En particulier, cette indépendance est assurée par les règles régissant les procédures de nomination et de révocation de chacun des membres dudit parquet (art. 14 et s.). Europol Tout d’abord, le Traité sur l’Union européenne (TUE qui a été profondément modifié par le Traité de Lisbonne), signé à Maastricht le 7 février 1992 par les Douze de l’Europe de cette époque, comportait des « dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures » (art. K 1 à K 9). Une Déclaration des principaux signataires (dont la France) précisait qu’il s’agissait d’instituer une coopération en matière de justice et de police pour « accompagner » la libre circulation des personnes décidée par l’Acte unique et la Convention de Schengen, coopération ayant pour but d’assurer la sécurité et la protection des personnes dans le nouvel espace ainsi créé. Ce Traité visait particulièrement : les règles de franchissement des frontières, la lutte contre le terrorisme, la criminalité, le trafic de drogue, la fraude internationale. Il prévoyait la création d’un Office européen de police doté d’un Système d’échange d’informations. Aussi, la loi no 97-1089 du 27 novembre 1997 a autorisé la ratification d’une Convention d’application, établie sur la base de l’article K 3 du Traité portant création de cet office (la Convention EUROPOL a été signée en 1995). En résumé, les États membres de l’Union européenne signataires s’engageaient à coopérer : par la constitution de banques de données, par l’assistance dans les enquêtes, par l’élaboration de stratégies communes de prévention et de mesures tendant à harmoniser et coordonner leurs procédés de police scientifique et technique. Il était, par ailleurs, décidé d’échanger des officiers de liaison et il était envisagé de créer des « groupes opérationnels d’enquête », agissant dans le respect des législations nationales, ainsi que des commissariats frontières « biface » ou communs. Puis, le Traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 par les quinze États européens, a intégré le Système Schengen dans le Traité de l’Union et confirmé les objectifs assignés à l’Office européen de police, dit EUROPOL. Ce Traité appelle à une coopération judiciaire et policière accrus et il prône un rapprochement des normes pénales des États membres. Dans le prolongement des Conventions précitées, le Traité de Lisbonne a renforcé les pouvoirs de l’Office européen de police (EUROPOL, v. art. 88 TUE). En particulier, il précise la mission d’Europol qui « est d’appuyer et de renforcer l’action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet 148 93 149 > 149 L’infraction 149 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 d’une politique de l’Union ». Le Parlement européen et le Conseil déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches d’Europol. Celles-ci peuvent comprendre : la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers; la coordination, l’organisation et la réalisation d’enquêtes et d’actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes conjointes d’enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust (v. infra, no 149). Toute action opérationnelle d’Europol doit être menée et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L’application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes. La Convention européenne du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, complétée par un protocole du 16 octobre 2001, a constitué la première étape d’une réforme d’envergure des règles d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. En réalité, ce texte complète d’autres conventions plus anciennes, telles la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, la convention du 17 mars 1978 et la convention d’application de l’accord de Schengen conclue le 14 juin 1990. La convention du 29 mai 2000 comporte plusieurs innovations importantes. En particulier, il s’agit de la consécration du principe de transmission directe des demandes d’entraide entre les autorités judiciaires de l’espace européen, de la légalisation de l’utilisation de moyens de communication modernes pour procéder à des auditions de témoins par vidéoconférence ou encore de la mise en place de moyens d’investigation opérationnels spécialisés, comme les livraisons surveillées particulièrement efficaces pour lutter contre les trafics internationaux et la mise en place d’équipes communes d’enquête. La loi no 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a introduit, dans le Code de procédure pénale, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la convention du 29 mai 2000 (art. 694 et s. C. pr. pén.), en transposant des mécanismes d’entraide spécialisés ayant vocation à fonctionner à l’échelle européenne, et a procédé, par ailleurs, à une refonte complète du régime d’entraide judiciaire internationale. Plus précisément, le dispositif issu de la loi du 9 mars 2004 regroupe les règles relatives à la transmission des demandes d’entraide judiciaire internationale, en établissant une distinction en fonction de l’origine (française ou étrangère) de la demande d’entraide. Pour les demandes d’entraide formulées par les juridictions françaises, une transmission par l’intermédiaire du ministère de la Justice est prévue, le retour des pièces devant emprunter une voie identique. S’agissant des demandes d’entraide formulées par les autorités judiciaires étrangères, la transmission s’effectue par voie diplomatique, ainsi que le retour des pièces d’exécution. Toutefois, en cas d’urgence, les demandes d’entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l’État requis compétentes pour les exécuter (le renvoi des pièces d’exécution est aussi effectué selon les mêmes modalités). Quant aux demandes d’entraide entre la France et les États membres de l’Union européenne (et aux pièces d’exécution retournées), elles sont transmises directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter. 149 94 La légalité criminelle international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères doivent être exécutées selon les règles de la procédure pénale française. Cependant, une dérogation à cette règle est prévue, qui consiste à donner la possibilité à l’autorité étrangère requérante de préciser les règles de procédure de son choix. L’exercice de cette faculté est soumis aux conditions suivantes : 1° la requête de l’autorité étrangère doit figurer dans la demande d’entraide; 2° les règles de procédure indiquées par l’autorité compétente de l’État requérant ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le droit français, cette dernière exigence s’imposant à peine de nullité. En tout cas, il ne peut être donné suite à une demande d’entraide de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation. La loi du 9 mars 2004 a prévu les auditions à distance (utilisation de moyens de communication audiovisuelle et téléphonique) pour l’exécution simultanée en France et à l’étranger des demandes d’entraide (art. 694-5 C. pr. pén.), tandis que l’interrogatoire ou la confrontation d’une personne poursuivie ne peut être effectué qu’avec son propre consentement. D’autres dispositions autorisent, par ailleurs, la poursuite dans un État étranger des opérations de surveillance effectuées par les autorités de police françaises dans le cadre d’une affaire de criminalité organisée (dans les conditions prévues par les conventions internationales), ainsi que la poursuite sur le territoire français d’opérations d’infiltration décidées par les autorités étrangères et effectuées par des agents étrangers (art. 694-5 à 694-9 C. pr. pén.). Aussi bien, ces derniers peuvent-ils, dans certaines conditions, participer à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale. La loi prévoit également la création d’équipes communes d’enquête. C’est qu’en effet, avec l’accord préalable du ministre de la Justice et le consentement des États membres concernés, l’autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d’enquête, dans les deux hypothèses suivantes : 1° soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer, dans le cadre d’une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres États membres; 2° soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés. Transposant l’article 13 de la Convention du 29 mai 2000, et conformément à la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (JOCE 20 juin 2002, no L 162, p. 1), les articles 695-2 et 695-3 du Code de procédure pénale ont respectivement pour objet de définir le domaine de compétence des agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête intervenant sur le territoire national et de préciser les modalités d’intervention des agents français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête opérant dans un autre État membre. En outre, afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l’unité Eurojust, organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l’intermédiaire du membre national (sur les missions de ce membre, v. art. 695-8 à 695-9 C. pr. pén.), est chargée de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence (V. art. 695-4 à 695-9 C. pr. pén.). Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 (JOCE 6 mars 2002, no L 63, p. 1), la compétence d’Eurojust couvre les types de criminalité et les 95 150 > 151 L’infraction 150 151 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 infractions pour lesquels Europol a compétence (par ex. : trafic de drogue, terrorisme, blanchiment de capitaux, traite des êtres humains, criminalité informatique, fraude et corruption, participation à une organisation criminelle). L’unité Eurojust peut également, avec l’accord des États membres concernés : coordonner l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un État non membre de l’Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux États membres au moins; faciliter l’exécution des demandes d’entraide judiciaire devant être exécutées dans un État non membre de l’Union européenne lorsqu’elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d’au moins deux États membres. En outre, l’unité Eurojust, agissant par l’intermédiaire du membre national, peut demander au procureur général de faire prendre toute mesure d’investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites (art. 695-5 C. pr. pén., modifié par la loi no 2013-711 du 5 août 2013). Le Traité de Lisbonne définit, d’une manière plus large, la mission d’Eurojust qui « est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol » (v. art. 85 TUE). À cet égard, le Parlement européen et le Conseil déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches d’Eurojust. Celles-ci peuvent comprendre : le déclenchement d’enquêtes pénales, ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; la coordination des enquêtes et poursuites visées dans l’hypothèse précédente; le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen. La loi no 2005-750 du 4 juillet 2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice, et celle no 2010-768 du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, ont complété le dispositif d’entraide entre la France et les autres États membres de l’Union européenne, sur la base d’une décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 2003. Il s’agit essentiellement d’exécuter des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (art. 695-9-1 à 695-9-30 C. pr. pén.; ces dispositions ont été complétées par une ordonnance no 2016-1636 du 1er déc. 2016). De même, la loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a inséré, dans le Code de procédure pénale, les articles 695-9-50 à 695-9-53, tendant à assurer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007. 150 Enfin, il existe une institution d’entraide judiciaire internationale, dont les contours sont nettement définis, c’est l’extradition. Il s’agit de la procédure par laquelle un État, appelé État requérant, demande à un autre État, appelé État requis (ou État refuge), de lui 15 96 La légalité criminelle – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 livrer un délinquant, afin qu’il puisse le juger ou lui faire subir sa peine s’il a déjà été condamné. La France ayant ratifié la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, celle-ci a remplacé entre les Hautes parties contractantes les traités bilatéraux conclus précédemment. Deux conventions de l’Union européenne ont, par la suite, simplifié la procédure d’extradition entre les différents États membres; il s’agit de celles du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996. Pendant longtemps, en France, c’était la loi du 10 mars 1927 qui réglementait l’extradition. Depuis la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, les dispositions y relatives sont insérées dans le Code de procédure pénale (art. 696 et s.). Les principales conditions qui doivent être remplies, pour que la France, État requis, accorde l’extradition sont les suivantes : 1° il ne doit pas s’agir d’un délinquant français (la France est compétente pour le juger elle-même); 2° il doit s’agir d’un crime, ou d’un délit faisant encourir une peine de 2 ans au moins d’emprisonnement, ou lorsqu’il s’agit d’une condamnation, la peine prononcée par la juridiction de l’État requérant doit être égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement; 3° il ne doit pas s’agir d’une infraction a) commise sur le territoire de la République; b) prescrite; c) sanctionnée par la législation de l’État requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français; d) de caractère politique ou militaire (mais aux termes de la Convention européenne de Strasbourg de 1977 et de l’accord de Dublin, relatifs à la répression du terrorisme, ratifiés par la France en 1987, certaines infractions graves, telles que la prise d’otages ou l’attentat à la bombe, ne peuvent, en principe, être considérées comme des infractions politiques du point de vue de l’extradition, quel qu’en soit le mobile). Les demandes d’extradition sont adressées au ministre des Affaires étrangères qui les transmet au ministre de la Justice (pour les États membres de l’Union européenne, la demande est adressée directement par l’autorité compétente au ministre de la Justice). Ce dernier, après s’être assuré de la régularité de la requête, l’adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République qui ordonne l’incarcération de la personne réclamée, sauf s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie. L’examen de la demande d’extradition se décompose en deux phases. Il s’agit, d’une part, d’une phase judiciaire, au cours de laquelle la personne, dont l’extradition est demandée, comparaît devant la chambre de l’instruction, éventuellement assistée d’un avocat. Dans l’hypothèse où l’intéressé consent à son extradition, la chambre de l’instruction lui donne acte de cette déclaration, une telle décision n’étant pas susceptible de recours. Dans le cas contraire, la chambre de l’instruction rend un avis motivé sur la demande d’extradition, qui pourra être défavorable, si cette juridiction estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente. Cet avis peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation qui ne peut être fondé que sur des vices de forme, conformément aux dispositions de l’article 696-15 du Code de procédure pénale (en réalité, cette dernière disposition ne fait que consacrer la jurisprudence établie, depuis 1984, dans ce domaine). En tout cas, si la chambre de l’instruction émet un avis négatif, l’extradition ne peut être accordée. Le dossier est, par la suite, transmis au ministre de la Justice (pour l’examen des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de celle-ci ainsi que 97 152 > 152 L’infraction – 152 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 la chambre de l’instruction de ladite cour et son président exercent une compétence concurrente à celle résultant des articles 696-9, 696-10 et 696-23 C. pr. pén.; v. art. 696-24-1 C. pr. pén.). Cette phase est suivie, d’autre part, d’une phase administrative qui se déroule uniquement en cas d’avis favorable de la chambre de l’instruction. Le ministre de la Justice apprécie les suites à donner à la demande et peut soumettre à la signature du Premier ministre un décret autorisant l’extradition, susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. L’extradition ne vaut que pour l’infraction ayant fait l’objet de la demande; l’État requérant, auquel on a livré le délinquant, ne pourrait pas le juger pour une autre infraction antérieure à sa remise. C’est ce qu’on appelle la règle de la spécialité. Il n’en est autrement que lorsque la personne réclamée y renonce (dans les conditions prévues aux art. 696-28 et 696-40 C. pr. pén.) ou lorsque le gouvernement français donne son consentement (dans les conditions prévues à l’art. 696-35 C. pr. pén.). En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne, une décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 a substitué au mécanisme traditionnel et contraignant de l’extradition, un dispositif exclusivement judiciaire souple et rapide, qui est plus adapté au fonctionnement de l’espace judiciaire européen. Il s’agit de la procédure du mandat d’arrêt européen (v. J. Pradel, « Le mandat d’arrêt européen. Un premier pas vers une révolution copernicienne dans le droit français de l’extradition », D. 2004, Doctr. p. 1392 et 1462; V. Malabat, « Observations sur la nature du mandat d’arrêt européen », Dr. pénal 2004, chron. no 17; B. de Lamy, La confiance mutuelle comme fondement du mandat d’arrêt européen. Un peu, mais pas trop… pour l’instant, Mélanges dédiés à B. Bouloc, Les droits et le Droit, Dalloz, 2007, pp. 559 à 572). Actuellement, les articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale, insérés par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, ont transposé ce dispositif en droit français. Le mandat d’arrêt européen consiste en une décision judiciaire émise par un État membre, appelé État d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté. Un mandat d’arrêt européen ne pourra être exécuté que pour des faits qui ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993, conformément à la déclaration faite par le gouvernement français au moment de l’adoption de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 (art. 32; v. aussi art. 215 de la loi du 9 mars 2004. – Crim. 23 nov. 2004, Bull. crim. no 293; Crim. 21 sept. 2004, Bull. crim. no 217). Tout mandat d’arrêt européen contient les renseignements suivants : l’identité et la nationalité de la personne recherchée; la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane; l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’État membre d’émission et entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et 694-32; la nature et la qualification juridique de l’infraction (notamment au regard de l’article 694-32 qui précise les catégories d’infractions pour lesquelles une décision d’enquête européenne ne peut être refusée); la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée; la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction (art. 695-13 C. pr. pén.). 152 98 La légalité criminelle Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, les suivants : 1° les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à 4 mois d’emprisonnement; 2° les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à 4 mois de privation de liberté (art. 695-12 C. pr. pén.). 153 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 153 Dans l’hypothèse où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d’un autre État membre, le mandat d’arrêt européen peut être adressé directement à l’autorité judiciaire de l’État chargé de l’exécution. Lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu inconnu, plusieurs modes de transmission sont possibles : soit la voie du système d’information Schengen, soit le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit la voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou tout autre moyen laissant une trace écrite (V. art. 695-15 C. pr. pén.). En ce qui concerne l’émission d’un mandat d’arrêt européen par les juridictions françaises, l’article 695-16 du Code de procédure pénale précise que le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour délivrer un mandat d’arrêt européen, en vue de l’exécution des mandats d’arrêt décernés par les juridictions d’instruction, de jugement ou d’application des peines. En l’absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d’instruction ou d’application des peines ayant décerné un mandat d’amener met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen. Le ministère public est également compétent, s’il estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution des peines privatives de liberté d’une durée supérieure ou égale à 4 mois prononcées par les juridictions de jugement (art. 695-16 C. pr. pén.). Lorsque le ministère public, ayant émis le mandat d’arrêt européen, a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait antérieur à sa remise et différent de celui ayant motivé son extradition (art. 695-18 C. pr. pén.). Il en résulte donc que la règle de la spécialité s’applique en la matière. Cependant, la loi prévoit un certain nombre de dérogations, notamment lorsque la personne remise y renonce explicitement ou l’autorité judiciaire de l’État d’exécution, ayant remis la personne, y consent expressément (par exemple pour une réextradition; v. Crim. 3 nov. 2011, Bull. crim. no 227 [la méconnaissance des conditions de forme, prévues par l’article 695-20, al. 2, C. pr. pén. pour écarter le principe de spécialité qui limite les effets d’un mandat d’arrêt européen, constitue une nullité substantielle qui porte atteinte aux intérêts de la personne concernée]). Quant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par les juridictions étran155 gères, elle peut être refusée (v. art. 695-22 C. pr. pén.) : 1° soit si l’infraction à l’origine du mandat d’arrêt européen, qui pouvait donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions françaises, se révèle couverte par une loi d’amnistie; 2° soit si une décision définitive, portant sur les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, a déjà été rendue à l’encontre de la personne recherchée, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus l’être selon les lois de l’État de condamnation; 3° soit si la personne recherchée était âgée 154 154 15 99 156 > 156 L’infraction – Toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les 48 heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, l’intéressé bénéficie de toutes les garanties prévues par les articles 63-1 à 63-7 du Code de procédure pénale, applicables en matière de garde à vue (art. 695-27, al. 1er, C. pr. pén.). Si le procureur décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, il la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui (art. 695-28, al. 1er, C. pr. pén.), qui peuvent ordonner son incarcération, à moins qu’ils n’estiment que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie. Le procureur général en avise, par ailleurs, sans délai le ministre de la Justice et lui adresse une copie du mandat d’arrêt. La chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l’instruction rend un arrêt par lequel elle lui donne acte de son consentement, après avoir vérifié si les conditions légales d’exécution du mandat d’arrêt européen sont réunies. Dans l’hypothèse contraire, la chambre de l’instruction statue par une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Cette décision est notifiée, par tout moyen et sans délai, à l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission, par les soins du procureur général. Aussi bien, ce dernier prend toutes les mesures nécessaires, afin que la personne recherchée soit remise à cette autorité (art. 695-37 C. pr. pén.; v. en ce qui concerne les procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États : art. 695-52 à 695-58 C. pr. pén. introduits par la loi no 2013-711 du 5 août 2013). § 156 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1442799123:88866209:196.200.176.177:1592997850 de moins de 13 ans au moment des faits visés dans le mandat d’arrêt européen; 4° soit en cas de prescription de la peine ou de l’action publique relative à des faits susceptibles de relever des juridictions françaises (Crim. 29 nov. 2006, Bull. crim. no 303; Crim. 8 août 2012, Bull. crim. no 172); 5° soit lorsqu’il est établi que l’émission du mandat d’arrêt européen se justifie par le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques, de son orientation sexuelle…; 6° soit lorsque le fait, faisant l’objet du mandat d’arrêt, ne constitue pas une infraction selon la loi française (principe de la double incrimination; v. toutefois les dérogations prévues par l’article 695-23 C. pr. pén.; ce texte prévoit qu’un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits, lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 3 ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions prévues par l’article 694-32 : terrorisme, participation à une organisation criminelle, traite des êtres humains, trafic illicite de stupéfiants, corruption, cybercriminalité, etc. L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut également être refusée pour l’une des raisons énumérées par les articles 695-22-1 et 695-24 C. pr. pén. [Crim. 5 nov. 2014, Bull. crim. no 229; la remise peut être refusée pour l’exécution d’une peine privative de liberté si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français]). 3 Le droit international pénal C’est une branche du droit pénal apparue récemment et encore très imparfaitement élaborée. Il s’agit de réprimer des infractions commises dans les rapports entre États et, notamment, à l’occasion des guerres : massacres de populations civiles, de prisonniers, 156 100 La légalité criminelle emploi de gaz, d’armes bactériologiques, déportation de civils, etc. À cet égard, il faut mentionner les quatre conventions signées à Genève en 1949 sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge. Pour être efficace, ce droit devrait être sanctionné et il faudrait pour cela qu’existe un tribunal supérieur, dont la compétence est reconnue de tous. Après la guerre de 1939-1945, les procès des criminels de guerre par le tribunal de Nuremberg et par celui de Tokyo constituèrent les premières applications de ce droit international pénal. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 – Par la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 mai 1993 (no 827), a été institué un tribunal international (dit tribunal pénal international : TPI), en vue de juger les auteurs présumés de violations graves du « droit international humanitaire » commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. La résolution des Nations unies fait obligation aux États d’apporter « leur pleine collaboration » au tribunal pénal international. 157 157 La loi no 95-1 du 2 janvier 1995 dispose que la France participe à la répression de ces infractions et coopère au fonctionnement de cette juridiction. Aux termes de cette loi : les auteurs présumés des infractions précisées peuvent être poursuivis et jugés en France s’ils sont « trouvés » sur notre territoire – toute personne lésée par l’une de ces infractions peut se constituer partie civile – le tribunal pénal international est informé de toute procédure pouvant relever de sa compétence – le dessaisissement des juridictions françaises au bénéfice du tribunal pénal international est réglementé, de même que la coopération judiciaire, l’arrestation des auteurs présumés et leur transfèrement devant le tribunal international. On pourra faire observer : que le tribunal pénal international peut délivrer des délégations judiciaires internationales et des mandats internationaux; que l’Organisation internationale de police-Interpol accorde sa pleine collaboration en l’occurrence. – De même, une loi no 96-432 du 22 mai 1996 a adopté la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994 (no 955) instituant un TPI pour juger les mêmes faits commis au Rwanda. – Par ailleurs, le 17 juillet 1998, a été signée à Rome, par les représentants de 120 États, la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, ratifiée par la France le 9 juin 2000, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Suite à l’adoption de la loi du 26 février 2002 portant adaptation du droit français en vue d’assurer la coopération entre les autorités judiciaires françaises et la Cour, un décret du 6 juin 2002 a publié cette Convention (V. J.-F. Seuvic, Chron. législ., RSC 2002, p. 849) qui fixe, d’une façon détaillée, l’organisation et le fonctionnement de la Cour pénale internationale appelée à juger les auteurs des crimes contre l’humanité (tel le génocide) et des crimes de guerre, cette juridiction n’ayant qu’une compétence complémentaire (v. art. 627 à 627-20 C. pr. pén.). 158 Les conventions internationales, pour importantes qu’elles soient, engagent simplement les Hautes parties contractantes à édicter les dispositions législatives nécessaires pour réprimer sévèrement les faits incriminés (V., par exemple, Convention de La Haye du 16 décembre 1970, sur la capture illicite d’aéronefs. – V. Convention de Genève, pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, publiée par Décr. du 10 déc. 1985 : JO 15 déc. 1985; la Convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, entrée en vigueur en France le 26 juin 1987). 158 101 158 > 158 Les détournements d’aéronefs et les prises d’otages, qui les accompagnent le plus souvent, ont déterminé un grand nombre de pays, dont la France, à signer des conventions internationales (Tokyo 1963, La Haye 1970, Montréal 1971), tendant à assurer une meilleure répression de ces crimes qui ont, dans la plupart des cas, un caractère international (mais seules les législations nationales – mises en harmonie entre les signataires desdites Conventions – s’appliquent). Dans ces cas, le droit français adopte le plus souvent le principe de la compétence universelle, permettant de poursuivre et de juger les personnes qui, hors du territoire de la République, se sont rendues coupables des infractions visées par ces conventions et sont trouvées en France. En pareille hypothèse, les règles du droit français pourront recevoir application (Crim. 23 oct. 2002, Rev. crit. DIP 2003, p. 309, obs. H. Matsopoulou). 102 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 – L’infraction Chapitre 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 L’essentiel L’article 111-3 du Code pénal consacre le principe de la légalité des délits et des peines, qui est un principe fondamental du droit pénal. Quant à l’article 112-1 du Code pénal, il dispose que : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». Ce texte consacre par là le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, qui est un corollaire du principe de la légalité. Enfin, la loi pénale étant une manifestation de l’autorité de l’État, son emprise ne s’étend en général que sur le territoire national; ce qu’on appelle le principe de la territorialité du droit pénal. Dès lors, il convient d’examiner ces différents aspects de l’élément légal de l’infraction. 1. Le principe de la légalité des délits et des peines et ses corollaires Le principe de la légalité est le principe selon lequel aucune incrimination ni aucune peine ne peuvent être retenues, sans avoir été prévues par un texte émanant des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire sous peine d’encourir une sanction pénale. C’est qu’en effet, la liberté des citoyens serait gravement menacée, si les pouvoirs publics pouvaient les poursuivre pour des faits qui n’auraient pas été incriminés par un texte préexistant porté à leur connaissance. Il s’agit donc d’une règle fondamentale tendant à empêcher toute arrestation ou toute poursuite arbitraire. Aussi bien, le principe de la légalité des délits et des peines est apparu comme tellement important qu’il fut inscrit dans de nombreuses Constitutions et dans certaines Déclarations des droits de l’Homme et du citoyen. L’article 111-3 du Code pénal indique en termes clairs et précis que « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ». Il en résulte donc qu’aucun fait ne peut faire l’objet de poursuites, s’il n’a pas été expressément prévu par un texte. Le fait critiquable moralement, voire socialement, qui n’est pas visé par la loi pénale, ne saurait être pénalement sanctionné. Par ailleurs, le juge répressif ne peut prononcer que les peines expressément prévues par la loi. À cet égard, l’article 112-1, alinéa 2, du Code pénal indique que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables » à la date à laquelle les faits constitutifs de l’infraction ont été commis. Le principe de la légalité des délits et des peines est conforté par deux corollaires : celui de l’interprétation stricte de la loi pénale et celui de la non-rétroactivité de la loi pénale. 103 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 S’agissant du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, il est expressément consacré par l’article 111-4 du Code pénal. La loi pénale est déclarative et le juge doit tirer toutes les conséquences que le législateur a entendu y attacher, rien de plus mais rien de moins. Les juridictions répressives se livrent pour cela à une analyse minutieuse des textes répressifs, mais le raisonnement par analogie, qui est peut-être possible en matière de lois de procédure pénale, est certainement interdit chaque fois qu’on est en présence d’un texte instituant une incrimination ou une peine. Quant au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, expressément consacré par l’article 112-1 du Code pénal, il a valeur constitutionnelle et s’impose, par conséquent, au législateur. Ce principe est, comme celui de la légalité, une garantie importante de la liberté des citoyens. Dans le procès qui les oppose, en cas d’infraction, aux pouvoirs publics, il serait choquant que la norme soit fixée après coup par l’une des parties. Il faut que les citoyens, lorsqu’ils agissent, sachent exactement quelles sont les conséquences possibles de leurs actes sur le plan de la répression. Ils ont, en quelque sorte, un « droit d’attente légitime » à ce que leurs actes obéissent aux lois qu’ils connaissaient ou pouvaient connaître au moment où ils les ont accomplis. En cas de changement de loi entre la commission de l’infraction et le jugement, c’est la loi en vigueur au moment de la commission de l’infraction qui s’applique. De même, la peine applicable à une infraction est celle prévue par la loi au moment où cette infraction a été commise. Toutefois, le Code pénal dispose que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf lorsque ces lois nouvelles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, auquel cas elles ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur (art. 112-2, 3° C. pén.). En ce qui concerne les mesures de sûreté, qui peuvent être prononcées pour faire face à un état dangereux et qui poursuivent essentiellement des buts préventif (faire obstacle au renouvellement d’infractions graves qui doivent être identiques à celles ayant donné lieu à des condamnations) et curatif (comme c’est le cas, par exemple, de l’injonction de soins), les lois nouvelles, qui les prévoient, s’appliquent en principe immédiatement, même en raison d’infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur. Toutefois, la rétention de sûreté, instituée par la loi du 25 février 2008 et qualifiée expressément par celle-ci de mesure de sûreté, ne peut être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de cette loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement (v. Cons. const., 21 févr. 2008, no 2008-562 DC, JO 26 févr. 2008, p. 3272, considérant no 10). S’agissant des lois de forme, elles échappent à la règle de la non-rétroactivité; elles s’appliquent immédiatement, même à des infractions commises antérieurement. Tel est le cas des lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance. De même, entrent, dans cette hypothèse, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure. En réalité, il s’agit de lois organisant le fonctionnement d’un service 104 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 public, celui de la justice, et nul ne peut arguer d’un droit acquis à être jugé selon une procédure déterminée. Quant aux lois de prescription de l’action publique, l’article 112-2, 4° du Code pénal prévoit que lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Il en est ainsi, même dans l’hypothèse où la loi nouvelle aurait pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Enfin, lorsqu’une loi nouvelle comporte des dispositions plus douces à l’égard des délinquants, celles-ci s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée (art. 112-1, al. 3, C. pén.). Il s’agit de la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (rétroactivité in mitius). Peut être considérée comme une loi pénale plus douce celle qui limite moins que la précédente la liberté individuelle ou celle qui admet des causes nouvelles d’impunité ou d’atténuation de la responsabilité pénale. Lorsqu’il s’agit de lois portant sur des peines, la loi nouvelle est plus douce, si elle supprime une peine ou en abaisse le niveau. Parfois, il est difficile de se prononcer sur le caractère plus doux ou plus rigoureux d’une loi nouvelle. Tel est le cas lorsque celle-ci comporte à la fois des dispositions plus sévères et des dispositions plus douces. Dans une telle hypothèse, il est permis de faire rétroagir la partie de la loi la plus douce, dès lors que les dispositions du nouveau texte sont divisibles. Dans l’hypothèse contraire, il faut prendre en considération la disposition principale, en donnant la plus grande importance à la peine principale. Mais si l’application de la loi pénale dans le temps suscite certaines difficultés, il en est de même, dès lors qu’il s’agit de l’application de la loi pénale dans l’espace. 2. L’application de la loi pénale dans l’espace L’article 113-2 du Code pénal consacre le principe de la territorialité de la loi pénale française. Selon ce texte : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Par ailleurs, l’article 113-2-1 du Code pénal indique que « Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République ». La loi pénale française est également « applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République », tandis qu’en ce qui concerne les délits, la loi française ne s’applique que « si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis » (art. 113-6 C. pén.). Il faut donc que le parquet, avant d’exercer des poursuites, s’assure que la législation étrangère est bien en ce sens (principe de la double incrimination). La participation, par un acte de complicité commis en France, à une infraction commise à l’étranger, ne peut être poursuivie en France que si ladite infraction est 105 à la fois punie par les deux législations et si elle a fait l’objet d’une décision définitive de la juridiction étrangère (art. 113-5 C. pén.). international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 Les juridictions répressives françaises sont également compétentes dans certains cas où la victime de l’infraction est française. En particulier : « La loi française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction » (art. 113-7 C. pén.). Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 du Code pénal, la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et au vu d’une plainte de la victime (ou de ses ayants droit) ou d’une dénonciation officielle émanant de l’autorité du pays où le fait a été commis (art. 113-8 C. pén.). De même, la loi pénale française s’applique aux crimes et délits « qualifiés d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation », à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l’État, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics, ainsi qu’à « tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République » (art. 113-10 C. pén.). Enfin, « La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français » (art. 113-13 C. pén.). Dans cette hypothèse, la règle de la réciprocité d’incrimination et l’exigence d’une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle de l’État étranger ne sont pas applicables. 3. L’entraide répressive internationale L’entraide répressive internationale se manifeste au niveau de la police comme au stade judiciaire. Au niveau de la police, la coopération s’effectue par l’intermédiaire d’Interpol qui assure des échanges d’informations sur la criminalité internationale et la délinquance transfrontière. C’est aussi en application de l’accord de Schengen que les services de police s’accordent assistance en matière de prévention et de recherche des faits punissables. Un renforcement de la coopération policière résulte du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007. Au stade judiciaire, il existe une entraide judiciaire en matière pénale depuis la convention du Conseil de l’Europe du 20 avril 1959. Cette entraide résulte aussi de la Convention européenne du 29 mai 2000, qui permet une transmission directe entre les autorités judiciaires de l’espace européen. Des mesures de gel, de saisie et de confiscation peuvent intervenir. Il existe aussi une entraide par l’intermédiaire de l’extradition (art. 696 et s. C. pr. pén.). Depuis une décision-cadre du Conseil de l’Europe du 13 juin 2002, un dispositif souple et efficace a été mis en place; c’est le mandat d’arrêt européen (art. 69511 et s. C. pr. pén.). 106 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 Sujets de concours Chapitre 2 Administrateur territorial, concours externe, 2000 Le juge pénal et l’action administrative Greffier en chef, épreuve orale, 2003 Le principe de légalité Greffier en chef, épreuve écrite, 2010 L’application de la loi dans le temps Magistrat, concours externe, 2004 Les contraventions Greffier, concours externe, 2010 L’application de la loi dans le temps Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation, concours externe, 2013 La non-rétrocativité de la loi pénale Officier de police, concours externe, 2016 L’entraide répressive européenne 107 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 3 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 chapitre L’élément matériel de l’infraction 159 Pour qu’une poursuite soit possible, il faut que l’infraction se soit révélée à l’extérieur par un fait matériel objectivement constatable. La simple pensée criminelle, le simple projet ne concerne que la conscience et ne doit pas pouvoir donner lieu à des poursuites. C’est là une des différences qui existe entre le droit pénal et la morale et c’est une garantie contre l’arbitraire des pouvoirs publics qui ne pourront pas faire de procès de tendance, d’opinion. Le point délicat est de savoir à partir de quel moment la volonté coupable d’un agent se sera manifestée de manière suffisamment nette pour que les pouvoirs publics puissent mettre la répression en mouvement. C’est un des aspects de ce conflit qui commande tout le droit pénal et oppose les nécessités de la répression et de la défense de la société, d’une part, aux impératifs du respect de la personne et de la liberté individuelle, d’autre part. 159 section 1 Le contenu de l’élément matériel 160 L’élément matériel des infractions peut consister soit dans un agissement positif (délit d’action ou de commission), soit dans un comportement négatif (délit d’inaction ou d’omission). La question qui se pose parfois est de savoir si un délit d’action peut être constitué par une simple omission ou abstention. 160 § 161 1 Action ou omission Le plus souvent, l’infraction définie par la loi réside dans un acte positif. Tuer, voler, injurier sont des infractions d’action ou de commission, supposant que l’agent accom161 109 162 > 164 L’infraction § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 plisse un acte aboutissant à priver une personne de la vie ou d’une partie de ses biens, voire à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui. Mais, dans certains cas, la loi sanctionne celui qui aura omis d’accomplir une formalité ou un geste salvateur, ainsi que celui qui n’aura pas été prudent. Dans ces hypothèses, l’infraction résulte de l’omission (ou abstention) que la loi a spécifiquement incriminée. Il est permis de constater que le législateur moderne a tendance à multiplier les infractions d’omission. 2 Le problème de la commission par omission A. Position du problème Lorsque l’inaction volontaire d’une personne aboutit à un résultat semblable à celui qui aurait été causé par une action incriminée, peut-elle faire l’objet de poursuites ? Voici, par exemple, un promeneur dans un bois, qui voit un début d’incendie causé par une allumette jetée devant lui par un fumeur négligent. Loin de mettre le pied sur l’allumette, notre promeneur regarde avec intérêt le développement de l’incendie. Peut-on sanctionner son attitude fondamentalement antisociale et le poursuivre pénalement pour incendie volontaire ? Il a été purement passif, mais sa passivité volontaire a permis le résultat dommageable. 162 162 B. Solution Dans notre ancien droit, « Qui peut et n’empêche, pèche » (Loysel), mais l’aphorisme n’était pas toujours observé. Dès le droit intermédiaire, les principes de la légalité des incriminations et des peines, d’une part, et de l’interprétation stricte de la loi pénale, d’autre part, amenèrent les juridictions à refuser l’assimilation d’une abstention, aussi grave soitelle, à une action positive. On ne saurait retenir un délit de commission par abstention. 163 163 – La jurisprudence a posé la règle, selon laquelle une abstention ou omission ne peut être assimilée à une action, dans la célèbre affaire de la séquestrée de Poitiers, où une femme avait été laissée, pendant 24 ans, sans soins par sa famille dans un état sanitaire effroyable. La cour d’appel de Poitiers refusa de prononcer une condamnation pour blessures volontaires, malgré le résultat découlant de l’inaction de la famille (Poitiers 20 nov. 1901, S. 1902, 2. 305, note Hémard). De même, ne sauraiton voir un vol (une « soustraction frauduleuse ») dans le fait pour un individu de ne payer – sciemment – qu’une somme très inférieure à celle qu’il doit à un pompiste, par suite du fonctionnement défectueux d’un distributeur de carburant (Crim. 1er juin 1988, JCP 1989. II. 21172). Cette solution est conforme au principe de la légalité des délits et des peines. Tout ce qui n’est pas défendu est permis et c’est au législateur qu’il appartient d’édicter un texte prévoyant un délit d’omission dans le cas où l’abstention risque d’avoir les résultats les plus graves et apparaît comme particulièrement choquante. 164 C’est d’ailleurs ce qu’il n’a pas manqué de faire. On peut notamment citer sur ce plan : la très importante ordonnance du 25 juin 1945 qui a créé le délit de non-dénonciation de 164 110 L’élément matériel de l’infraction – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 crime (art. 62 de l’ancien C. pén.), le délit d’omission de témoignage en faveur d’un innocent (art. 63, al. 3 de l’ancien C. pén.), le délit de non-dénonciation de sévices ou privations infligés à un mineur de 15 ans (L. du 15 juin 1971 et du 2 février 1981; art. 62, al. 2 de l’ancien C. pén.), le délit de non-obstacle à la commission de certaines infractions (art. 63, al. 1 de l’ancien C. pén.). Le nouveau Code pénal a repris ces dispositions : l’article 434-1 réprime le fait pour celui qui a « connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives… » – l’article 434-3 sanctionne le fait pour celui qui a connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives – l’article 434-11 punit celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter le témoignage – l’article 223-6, al. 1er, frappe de peines correctionnelles quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui et pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire – l’article 223-6, al. 2, sanctionne des mêmes peines celui qui s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pourrait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Il est à noter que ces textes instituent des infractions ayant leurs éléments constitutifs et leurs peines propres, et qui sont de simples délits, alors que le résultat obtenu aurait pu parfois entraîner l’application des peines criminelles s’il avait procédé d’un agissement positif; il ne s’agit donc pas d’une assimilation de l’omission à une commission. Certains voudraient que l’on aille plus loin et qu’un texte général permette de frapper toutes les abstentions coupables volontaires. À notre avis, un tel texte serait dangereux, car il serait très difficile de savoir où faire commencer l’inaction coupable. Sans doute, il n’y a pas de droit à l’égoïsme ou à l’indifférence, mais ce serait très dangereux pour la liberté individuelle que d’exiger de manière générale et vague, et sous sanction pénale, un esprit d’initiative de la part des citoyens, sans préciser exactement dans quels cas ces initiatives peuvent être exigées et leur absence entraînerait des sanctions pénales. section 2 Le problème de la tentative Il convient d’examiner successivement : L’infraction tentée • § 1 – L’infraction manquée • § 2 – L’infraction impossible • § 3. § 165 1 L’infraction tentée Une infraction est souvent le résultat d’une série de réflexions, de résolutions et de préparations. Sans doute, ne faut-il pas attendre que l’infraction soit consommée pour 165 111 166 > 168 L’infraction A. Conditions 1° Commencement d’exécution international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 déclencher la répression, mais on doit se demander à partir de quel moment les pouvoirs publics sont autorisés à poursuivre l’auteur d’une infraction non consommée et quelle peine ils peuvent lui infliger. L’article 121-4 du Code pénal dispose qu’est « auteur de l’infraction la personne qui : 1° commet les faits incriminés; 2° tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». Par ailleurs, l’article 121-5 du même code énonce : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». En réalité, ce texte reprend, mot pour mot, la définition que l’article 2 de l’ancien Code pénal donnait à la tentative; la jurisprudence antérieure au nouveau code conserve donc toute sa valeur. La tentative punissable requiert d’abord un commencement d’exécution : la simple intention de commettre une infraction ne saurait être poursuivie, même si la preuve pouvait en être apportée. Les manifestations verbales ou écrites, par lesquelles l’individu extériorise parfois son intention de commettre une infraction, ne sont pas, en principe, punissables, car rien ne prouve que l’intéressé passera à l’action, et le législateur estime qu’il est de bonne politique criminelle de ne pas poursuivre encore. 166 16 – Certaines manifestations d’une intention criminelle ont cependant été érigées par le législateur en infractions sui generis. Ainsi, en est-il de la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, punissable lorsque cette menace est « soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet » (art. 222-17 C. pén.). Il est vrai que l’on peut faire valoir qu’une telle « manifestation d’intention » constitue en soi un trouble intolérable de l’ordre public et entraîne un préjudice pour celui qui en est l’objet. 167 Après les manifestations verbales ou écrites de l’intention criminelle (qui peuvent faire défaut), l’agent passe, parfois, au stade des actes préparatoires. Ce ne sont pas nécessairement, contrairement à ce qu’on affirme souvent, des actes équivoques. Les renseignements pris sur les habitudes du propriétaire d’une villa, que l’on a décidé de cambrioler, ne peuvent pas être considérés comme des actes équivoques. Le législateur estime, cependant, bien que le danger pour la société se précise, qu’il est de bonne politique de ne pas intervenir : l’ordre public n’a pas encore été sérieusement troublé et on peut espérer que l’agent renoncera à son entreprise criminelle. 168 Toutefois, certains actes préparatoires constituent en eux-mêmes des faits délictueux distincts de l’infraction projetée; ainsi en est-il du port d’arme prohibé ou de la détention illégale d’arme (v. art. 222-52 C. pén.) par l’individu qui se propose de commettre un vol à main armée (art. 311-8 C. pén.). On écrit parfois qu’il s’agit là de « délits-obstacles ». 167 168 – Relève de cette dernière hypothèse l’association de malfaiteurs, infraction consommée dès qu’un « groupement est formé » ou une « entente est établie en vue de la préparation, caractérisée par 112 L’élément matériel de l’infraction – 169 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement » (art. 450-1, al. 1er, C. pén.). Ce dernier texte reprenant les dispositions de l’ancien Code pénal, la jurisprudence développée sous l’empire de celui-ci conserve sa valeur. Ainsi doit-on considérer : 1° que la loi sanctionne en l’occurrence des actes qui ne seraient considérés que comme actes « préparatoires » en dehors de cette hypothèse (Crim. 5 janv. 1984, Gaz. Pal. 1984. 2 Pan. 264) – 2° que le délit d’association de malfaiteurs est distinct des crimes préparés ou perpétrés par les membres de l’association formée en vue de leur préparation ou de leur commission (Crim. 22 janv. 1986, Bull. crim. no 29; Crim. 19 janv. 2010, Bull. crim. no 11; Crim. 15 juin 2011, Bull. crim. no 133). En instituant cette incrimination, le législateur a donc érigé en délit autonome de simples actes préparatoires. L’association de malfaiteurs ne doit toutefois pas être confondue avec la bande organisée, qui constitue, dans certains cas, une circonstance aggravante (la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres; v. Crim. 8 juill. 2015, Dr. pénal 2015, comm. no 120, note Ph. Conte; Crim. 22 juin 2016, no 16-81.834). Par ailleurs, afin de prendre en considération « l’évolution de la menace terroriste » et « la possibilité pour une personne seule de préparer un acte de terrorisme », la loi du no 2014-1353 du 13 novembre 2014 a incriminé, à l’exemple des législations britannique et allemande, « l’entreprise terroriste individuelle ». Ainsi, un nouvel article 421-2-6 a-t-il été introduit dans le Code pénal, qui a pour objet de réprimer le fait de préparer la commission « des actes terroristes les plus graves et les plus violents ». En réalité, l’infraction de l’article 421-2-6 du Code pénal constitue un délit-obstacle visant à réprimer toute une série d’actes préparatoires, énumérés par ce texte, qui caractérisent un comportement dangereux, et ce, indépendamment de la réalisation d’un résultat dommageable. Avec le commencement d’exécution, on entre dans la zone de répression et la tentative est constituée (même si elle n’est pas encore toujours punissable, infra, no 171). Le passage de l’acte préparatoire au commencement d’exécution est souvent difficile à déterminer et deux théories se sont efforcées de dégager un critère. D’après une théorie objective, qui s’attache exclusivement aux actes déjà commis, seuls constituent un commencement d’exécution les actes qui font partie soit des éléments constitutifs de l’infraction, tels qu’ils sont définis par la loi, soit des circonstances qui peuvent en renforcer la répression. Tous les autres actes doivent être considérés comme des actes préparatoires. D’après une théorie subjective, qui s’attache au contraire à l’intention de l’auteur, sujet actif de l’infraction, il y a commencement d’exécution, dès qu’on se trouve en présence d’un acte positif, extérieur, non équivoque, qui, quoique ne constituant pas l’élément matériel de l’infraction, est assez proche moralement de celle-ci, pour que l’on puisse considérer comme infiniment probable le fait que l’agent serait allé jusqu’au bout de son dessein si rien ne l’en avait empêché. La théorie objective, trop abstraite, trop « juridique », si l’on peut dire, ne permet pas une défense satisfaisante de la société. Le vol, par exemple, étant la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, ne pourrait être poursuivi que lorsque le voleur a mis la main sur l’objet convoité, mais pas encore lorsqu’il a percé le mur pour arriver jusqu’à la salle des coffres d’une banque ! Il est vrai que la jurisprudence adopte souvent une formule faisant à la fois allusion à toutes les deux théories, objective et subjective. Dans de nombreuses affaires, la Cour de cassation a affirmé que « constitue un commencement d’exécution tout acte qui tend directement au délit, lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre » (Crim. 29 déc. 1970, JCP 1971. II. 16770). Ainsi, elle admet qu’il y a commencement d’exécution, dans l’hypothèse où l’auteur est déjà « en 169 113 170 > 170 L’infraction 170 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 action du crime tenté » et les « faits d’ores et déjà accomplis permettent de penser que l’agent serait allé jusqu’au bout de son entreprise criminelle ». Cette « distance morale » est appréciée concrètement, eu égard, en particulier, à la nature de l’infraction : le fait de fracturer la porte d’une villa sera considéré comme susceptible de constituer une tentative de vol, mais il est trop lointain du meurtre pour qu’on puisse considérer qu’il y a commencement d’exécution d’un meurtre. De même, le fait de taper à la porte d’une habitation, choisie de par son apparence isolée et inoccupée, est un acte qui précède immédiatement l’entrée dans les lieux et tend directement à l’action du vol que le prévenu avait eu l’intention de commettre (Crim. 13 déc. 2016, Bull. crim. no 342). Par ailleurs, le fait de faire le guet, en attendant la victime du vol à accomplir (Crim. 3 janv. 1913, D. 1914. 1. 41), a été considéré comme un commencement d’exécution. Dans d’autres décisions, la jurisprudence définit plus objectivement le commencement d’exécution, en indiquant qu’il s’agit d’« un acte devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime ». Ainsi, elle avait refusé de voir un commencement d’exécution dans le fait de donner des instructions précises à un tiers et de lui remettre des fonds en vue de commettre un meurtre (Crim. 25 oct. 1962, Lacour, D. 1963. 221, note Bouzat, JCP 1963. II. 12985, note Vouin; cf. aussi : Crim. 15 mai 1979, D. 1980. 409). C’est qu’en effet, dès lors que « le tueur à gage » s’était abstenu d’accomplir l’acte pour lequel il était engagé, le commanditaire ne pouvait être poursuivi. Ce vide juridique a été comblé par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 ayant inséré, dans le Code pénal, un article 221-5-1 qui incrimine le fait de faire à une personne des offres ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n’a été ni tenté ni commis. La Cour de cassation a vu, en revanche, un commencement d’exécution, et par suite une tentative d’agression sexuelle, dans le fait pour un faux médecin de demander à une femme de se déshabiller en vue de subir un examen médical présenté comme un préalable obligatoire à son embauche (Crim. 19 juin 1995, RSC 1996.365, obs. Bouloc). Il faut bien reconnaître que, dans cette dernière affaire, les actes accomplis ne révélaient pas clairement l’intention de l’agent. En d’autres termes, les circonstances ne permettaient pas de dire avec certitude que l’auteur avait la volonté de violer ou de commettre une autre agression, « voire de contempler une beauté de la nature » (V. obs. Bouloc, préc.). Il est clair que la chambre criminelle a adopté ici une notion extensive du commencement d’exécution. Elle a aussi confirmé la même position dans une autre espèce, où une personne avait tenté infructueusement de payer les services d’un pilote d’hélicoptère susceptible de poser son appareil dans la cour d’une prison, afin de permettre l’évasion d’un détenu (qui ne sera pas identifié). La Cour de cassation n’a pas hésité à voir dans une telle démarche le commencement d’exécution d’une tentative punissable d’évasion (Crim. 3 sept. 1996, Dr. pénal 1997, comm. no 17). En pratique, des difficultés sont souvent rencontrées en raison de l’ambiguïté de certains actes, de certaines attitudes, de certaines « démarches ». Ainsi, la tentative de vol a donné lieu à une jurisprudence importante. En particulier, il a été jugé qu’entre dans le champ d’application de la tentative punissable le fait pour un individu de pénétrer dans un véhicule en stationnement et de s’installer au volant (Crim. 29 juin 1960, Bull. crim. no 351; Crim. 2 nov. 1961, Bull. crim. no 439) ou le fait pour certaines personnes, porteuses des armes apparentes ou cachées et revêtues de cagoules, de marcher en file indienne 170 114 L’élément matériel de l’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 en se tenant courbées pour ne pas être vues à l’intérieur d’un bureau de poste vers lequel elles se dirigeaient (Crim. 19 juin 1979, Bull. crim. no 219, RSC 1980, p. 969, obs. J. Larguier. V. aussi : Crim. 7 sept. 1993, Bull. crim. no 262, RSC 1994, p. 323, obs. B. Bouloc). De même, certaines difficultés se rencontrent dans le domaine de l’escroquerie à l’assurance. Le fait de détruire un véhicule et de déclarer le « sinistre » auprès de l’assureur, en vue de toucher l’indemnisation, peut-il constituer un commencement d’exécution ? La jurisprudence a jugé, à plusieurs reprises, que la seule déclaration d’un sinistre volontairement provoqué à la compagnie d’assurances suffit à caractériser le commencement d’exécution de la tentative d’escroquerie (Crim. 6 avr. 1994, Bull. crim. no 135; Crim. 1er juin 1994, Dr. pénal 1994, comm. no 234, note M. Véron; Crim. 22 févr. 1996, Bull. crim. no 89, RSC 1996, p. 846, obs. B. Bouloc; Crim. 8 sept. 2004, Dr. pénal 2005, comm. no 13, note M. Véron; Crim. 28 févr. 2012, RSC 2012, p. 865, obs. H. Matsopoulou; V. toutefois : Crim. 17 déc. 2008, Bull. crim. no 259, D. 2009, p. 1796, note A. Prothais [la destruction volontaire d’un bien et la plainte pour vol de ce dernier ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l’absence de déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances, constituer un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie]), indépendamment de toute demande de remboursement ou de production de documents (il est évident que la tentative est constituée en cas de demande d’indemnisation ou de production de documents certifiant le sinistre; v. Crim. 22 mai 1984, Bull. crim. no 187, RSC 1985, p. 63, obs. A. Vitu; cf. aussi : Crim. 6 avr. 1994, précité [production d’un certificat de dépôt de plainte pour vol]; Crim. 22 févr. 1996, Bull. crim. no 89, RSC 1996, p. 846, obs. B. Bouloc [production d’un faux certificat de marquage de vitres]; Crim. 26 juin 1997, RGDA 1997, p. 1115, note E. Fortis). Toutefois, il est permis d’isoler certains arrêts ayant estimé qu’une telle déclaration doit être accompagnée d’une demande d’indemnisation formulée auprès de l’assureur (Crim. 7 janv. 1980, Bull. crim. no 8, RSC 1981, p. 365, obs. J. Larguier; Crim. 22 mai 1984, Bull. crim. no 187, D. 1984, p. 602, note J.-M. Robert, RSC 1985, p. 63, obs. A. Vitu; contra : Crim. 9 janv. 1992, Dr. pénal 1992, comm. no 176, note M. Véron). À notre avis, la fausse déclaration d’un sinistre à la compagnie d’assurances devrait seule suffire à caractériser le délit tenté, indépendamment de toute demande d’indemnisation, car une telle déclaration n’a pour finalité que de mettre en mouvement le mécanisme de l’assurance. Quant à l’escroquerie au jugement, la tentative consiste à produire, de mauvaise foi, à l’occasion d’une instance judiciaire, des documents mensongers, tels qu’une facture mensongère faisant état d’un prix supérieur à celui réellement acquitté (Crim. 3 juin 2004, Dr. pénal 2004, comm. no 155, note M. Véron.), ou des documents devenus sans valeur, dans le but de tromper la religion du juge (Crim. 12 mai 1970, Bull. crim. no 160; Crim. 26 mars 1998, Bull. crim. no 117, RTD com. 1998, p. 955, obs. B. Bouloc). 2° Absence de désistement volontaire 171 Outre le commencement d’exécution, la tentative punissable requiert une absence de désistement volontaire, ainsi qu’il découle du texte de l’article 121-5 du Code pénal. Toujours dans un but de politique criminelle, la loi décide que l’agent, même s’il a franchi le seuil du commencement d’exécution, échappera à toute sanction, s’il s’est volontairement désisté. C’est une dernière chance que la loi lui offre de rentrer impunément dans le chemin de la légalité. 171 115 171 > 171 L’infraction 116 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 Pour être pris en considération, le désistement devra être volontaire; il ne faut donc pas qu’il soit dû à un élément étranger à la volonté de l’agent, tel qu’un manque de coordination ou l’arrivée inopinée des agents de police qui auraient empêché l’auteur de consommer son infraction. Ainsi, en matière d’escroquerie au jugement, le désistement n’est certainement pas volontaire, lorsque la fraude cesse à la suite de la découverte de la supercherie (Crim. 31 mars 1931, Gaz. Pal. 1931. 2. 10; v. aussi : Cass., ass. plén., 18 janv. 2006, Bull. crim. (Ass. plén.) no 1, JCP G 2006. II. 10075, note J. Leblois-Happe [à propos d’une tentative d’escroquerie à la provision]). Il en est de même dans l’hypothèse où un individu, qui avait tenté d’avoir un rapport sexuel avec sa victime, n’a été contraint de renoncer à son acte qu’en raison d’une déficience physique momentanée (Crim. 10 janv. 1996, Bull. crim. no 14). Le désistement du prévenu n’est pas non plus volontaire, lorsqu’il résulte de la réaction de l’occupant d’une habitation (Crim. 13 déc. 2016, Bull. crim. no 342 [en l’espèce, l’auteur a quitté les lieux en constatant qu’une personne, résidant sur place, avait allumé une lumière et s’était penchée à l’extérieur]). La même solution peut également s’appliquer dans le cas où la libération de la victime d’un enlèvement (en l’espèce, il s’agissait d’une mineure de 15 ans), n’était due qu’à la résistance qu’elle avait opposée, ses appels au secours ayant seuls mis fin à l’acte en cours d’exécution (Crim. 26 avr. 2000, Bull. crim. no 164). Le désistement, qui est au contraire le résultat d’une volonté libre de l’agent, assure l’impunité, même si le mobile n’est pas noble. Tel est le cas d’une renonciation provoquée par la crainte d’une arrestation, par la pitié ou par le remords, en cours d’exécution. Quant à l’intervention d’un tiers, elle ne fait pas toujours échec au désistement volontaire. Ainsi, a-t-il été décidé qu’on est en présence d’un acte libre et spontané, lorsque le tiers, qui est intervenu, s’est seulement borné à dissuader l’auteur de la tentative de son entreprise, sans exercer sur lui aucune contrainte (Crim. 20 mars 1974, Gaz. Pal. 1974. 1. 449). Le désistement doit intervenir avant que l’infraction soit consommée. Après, il n’y a de place que pour un repentir actif, dont on pourra tenir compte pour modérer la sanction, mais qui n’empêchera pas que des poursuites soient possibles contre l’agent. C’est ainsi que celui qui a volé la chose d’autrui, puis, pris de remords, va la restituer, peut faire l’objet de poursuites pour vol. De même, en matière d’urbanisme, l’obtention éventuelle d’un permis de construire, alors que la construction a été réalisée, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit de construction sans permis antérieurement consommé (Crim. 19 mars 1992, Bull. crim. no 121; v. aussi : Crim. 22 sept. 2004, Dr. pénal 2004, comm. no 177 : le fait de régulariser postérieurement les prélèvements illégaux effectués dans la caisse d’une société n’enlève pas aux abus de biens sociaux leur caractère délictueux). Le désistement doit intervenir particulièrement tôt pour les délits formels, qui sont consommés dès l’emploi d’un moyen, abstraction faite de tout résultat; dès l’administration d’un poison à la victime, il y a empoisonnement consommé (art. 221-5 C. pén.), même si on lui administre aussitôt un antidote. Au contraire, pour les délits matériels, il n’y a consommation que si un résultat est obtenu : pour le meurtre, il y aura désistement volontaire dans le fait de se jeter à l’eau pour sauver la victime que l’on avait tenté de noyer. L’élément matériel de l’infraction 3° Intention coupable Le troisième élément, pour que la tentative soit punissable, est l’intention de commettre l’infraction tentée. C’est ce qui explique que la tentative est inconcevable à propos des infractions non intentionnelles. 172 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 172 B. Infractions dont la tentative est punissable L’article 121-4 du Code pénal dispose qu’est « auteur de l’infraction » celui qui « tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». Il en résulte donc que la tentative de crime est toujours punissable, de quelque nature qu’il soit, celle de délit ne peut être sanctionnée que dans les cas expressément visés par la loi. Ainsi, la tentative de vol (art. 311-13 C. pén.) ou celle d’escroquerie (art. 313-3 C. pén.) est punissable; en revanche, la tentative d’abus de confiance ne l’est pas (en l’absence d’une disposition expresse l’incriminant). Enfin, la tentative de contravention n’est jamais punissable. 173 173 C. Peines encourues Selon l’article 121-4 du Code pénal, « est auteur de l’infraction la personne qui […] tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». L’auteur d’une tentative est donc passible de la même peine que celle qu’il eût encourue si le crime ou le délit avait été consommé. 174 174 – Sans doute, la tentative n’a pas donné lieu à un résultat dommageable, puisque l’action a pu être arrêtée à temps. Mais ce n’est pas dû au fait de l’agent, qui a manifesté la même intention coupable que celui qui a pu aller jusqu’au bout de son dessein criminel. Il est donc exposé à la même peine. Le juge pourra éventuellement trouver dans la non-consommation de l’infraction une circonstance qui lui permettra de modérer la peine. Cette identité de répression de l’infraction tentée et de l’infraction consommée concerne non seulement la peine principale mais aussi les peines complémentaires et, éventuellement, les peines accessoires. § 175 2 L’infraction manquée Une analyse sommaire de la notion d’infraction « manquée » démontre qu’il s’agit d’une forme de tentative punissable, d’une action criminelle lato sensu qui « n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (art. 121-5 C. pén.). L’action n’a pas été « suspendue »; elle s’est développée en totalité, mais l’acte ou les actes volontairement accomplis n’ont pas procuré le résultat recherché par l’agent (en raison, par exemple, de sa maladresse). Le résultat recherché, dans le cas de l’infraction manquée, pouvait être atteint, ce qui différencie cette hypothèse de celle de l’infraction impossible. Ainsi, le mis en cause a tiré un coup de feu sur sa victime, laquelle n’a pas été atteinte, soit que le coup ait été mal ajusté, soit que la personne visée, par un brusque mouvement du corps, ait esquivé la balle. L’agent a accompli tous les actes, qu’il dépen175 117 176 > 177 L’infraction – Les infractions formelles (consommées sans égard au résultat) ne peuvent être manquées. Lorsque l’agent a accompli tous les actes nécessaires à la constitution de l’infraction, il y a infraction consommée, quel que soit le résultat. Par exemple, celui qui administre le poison à quelqu’un qui est immunisé, commet un empoisonnement pur et simple et non une simple tentative, bien que sa victime n’ait pas été incommodée. § 3 L’infraction impossible Le délit impossible est celui qui était irréalisable, soit par un manque d’objet (« meurtre » de quelqu’un qui est déjà mort), soit à raison de l’inadéquation des moyens employés (empoisonnement par administration de substances non toxiques, « meurtre » avec un fusil qui n’est pas chargé). Le résultat était objectivement impossible à atteindre, alors que, dans le délit manqué, plus d’habileté chez l’agent aurait permis de l’obtenir à l’aide des moyens mis en œuvre. 176 176 – 177 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 dait de lui de commettre, et n’a pas été arrêté en cours d’exécution, de sorte qu’il n’y a plus aucun doute à avoir sur son intention d’aller jusqu’au bout de son projet criminel. Des articles 121-4 et 121-5 du Code pénal, il ressort que celui qui s’est rendu coupable d’une infraction « manquée » doit être considéré comme l’auteur de cette infraction et, par conséquent, puni de la même peine. La volonté criminelle lato sensu de l’agent est indiscutable, et c’est elle, autant que le résultat de l’action, qui trouble l’ordre public et appelle une sanction pénale. On ne saurait donc s’étonner de ce que très rares sont les dispositions de la loi dans lesquelles apparaît la notion d’infraction impossible. L’article 221-5 du Code pénal dispose que « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement ». L’impossibilité d’obtention du résultat souhaité, découlant du caractère inoffensif des substances administrées, fait donc obstacle aux poursuites. C’est ce que R. Garraud appelait « l’impossibilité légale » de réaliser l’infraction. À l’inverse, l’article 317 de l’ancien Code pénal punissait celui qui avait procuré ou tenté de procurer l’avortement à une « femme enceinte ou supposée enceinte », réprimant ainsi expressément les manœuvres abortives sur une personne qui n’était pas enceinte. Le nouveau Code pénal n’a pas repris ces dispositions dans l’actuel article 223-10, sanctionnant l’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée, la tentative de ce délit étant punie par l’article 223-11. En dehors des rares hypothèses prévues par la loi, comment régler le problème du délit impossible ? La doctrine et la jurisprudence ont longuement hésité. La doctrine proposait de distinguer entre l’impossibilité absolue (tirer avec un fusil non chargé), où la répression aurait été écartée, et l’impossibilité relative (tirer avec un fusil n’ayant pas la portée suffisante) qui aurait été punie au même titre que la tentative. Cette distinction a été condamnée par la Cour de cassation (Crim. 9 nov. 1928, D. 1929. 1. 97). La doctrine a encore proposé une distinction entre impossibilité de droit (tirer sur une personne déjà morte), en cas d’absence d’un élément de la définition légale de l’infraction, et impossibilité de fait (tirer avec un fusil non chargé – poche de la victime momentanément vide). La poursuite ne serait possible qu’en cas d’impossibilité de fait. La jurisprudence, après bien des vicissitudes, assimile aujourd’hui le délit impossible au délit tenté, sans faire aucune distinction entre les diverses sortes d’impossibilité. Ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 1986 (JCP 1987. II. 20774, note Roujou de Boubée, obs. 17 118 L’élément matériel de l’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 Levasseur, RSC 1986, p. 849, obs. Vitu, ibid., p. 839), la chambre criminelle a déclaré coupable d’une tentative d’homicide volontaire celui qui, croyant une personne encore en vie, avait exercé sur elle des violences dans l’intention de lui donner la mort, car le décès de la victime, antérieur aux violences, constituait une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur. De même, ont été condamnés pour tentative de vol avec effraction les individus qui, s’étant introduits par effraction des volets et vitres de fenêtres dans une maison, étaient ressortis sans rien emporter « en raison de l’inexistence dans les lieux de tout objet de valeur » (Crim. 15 mars 1994, Dr. pénal 1994, comm. no 153, note M. Véron). En effet, l’absence de tels objets constituait une circonstance indépendante de la volonté des auteurs, par suite de laquelle la tentative a manqué son effet. Si l’impossibilité de réaliser l’infraction est tellement évidente qu’elle aurait dû apparaître à un agent d’intelligence normale, il n’y aura pas de poursuite. Mais l’impunité procède alors non pas de ce qu’on se trouve en présence d’un délit impossible, mais de l’irresponsabilité pénale révélée par les moyens mêmes employés : on a affaire à un dément ou à un simple d’esprit (par exemple, tentative de meurtre avec un pistolet d’enfant ou par des pratiques d’envoûtement). Il s’agit d’infractions putatives, qui n’existent que dans l’esprit de leur auteur et on ne peut pousser le subjectivisme jusqu’à poursuivre dans de telles circonstances. Il en va de même, lorsque l’agent a cru commettre une infraction, alors qu’il a accompli un acte qui n’était pas défendu par la loi pénale. 119 Chapitre 3 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 L’essentiel Pour qu’une poursuite soit possible, il faut que l’infraction se soit révélée à l’extérieur par un fait matériel objectivement constatable. Mais le point délicat est de savoir à partir de quel moment la volonté coupable d’un agent se sera manifestée de manière suffisamment nette pour que les pouvoirs publics puissent mettre la répression en mouvement. Il convient, dès lors, de fournir certaines précisions, d’une part, sur le contenu de l’élément matériel de l’infraction et, d’autre part, sur le problème de la tentative. 1. Le contenu de l’élément matériel L’élément matériel des infractions peut consister soit dans un agissement positif (délit d’action ou de commission), soit dans un comportement négatif (délit d’inaction ou d’omission). Le plus souvent, l’infraction définie par la loi réside dans un acte positif (tuer, voler, violer, etc.). Mais, dans certains cas, l’infraction peut résulter de l’omission (ou abstention) que la loi pénale a spécifiquement incriminée (par exemple, le délit de non-dénonciation de crime, celui de non-obstacle à la commission de certaines infractions, etc.). La question qui se pose, par ailleurs, est celle de savoir si l’inaction volontaire d’une personne, qui aboutit à un résultat semblable à celui qui aurait été causé par une action positive incriminée, peut faire l’objet de poursuites. À cet égard, on pourra faire valoir que les principes de la légalité des délits et des peines, d’une part, et de l’interprétation stricte de la loi pénale, d’autre part, doivent conduire les juridictions répressives à refuser l’assimilation d’une abstention, aussi grave soit-elle, à une action positive. C’est qu’en effet, les actes d’omission ou d’abstention ne peuvent être poursuivis que si le législateur les a érigés en délits autonomes. Mais, en dehors de ces difficultés liées aux délits d’omission ou d’abstention, il en existe d’autres posées par l’infraction tentée. 2. La tentative Une infraction est souvent le résultat d’une série de réflexions, de résolutions et de préparations. Sans doute, ne faut-il pas attendre que l’infraction soit consommée pour déclencher la répression, mais on doit se demander à partir de quel moment les pouvoirs publics sont autorisés à poursuivre l’auteur d’une infraction non consommée. À cet égard, l’article 121-5 du Code pénal énonce que « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a 120 été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». De cette définition, il résulte donc que la tentative punissable exige, d’une part, un commencement d’exécution et, d’autre part, une absence de désistement volontaire. À ces deux conditions, on doit ajouter l’intention coupable de l’agent. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 S’agissant de la première condition relative au commencement d’exécution, elle peut être définie soit de manière objective, soit de manière subjective. Selon la première théorie, qui s’attache exclusivement aux actes déjà commis, seuls constituent un commencement d’exécution les actes qui font partie soit des éléments constitutifs de l’infraction, soit des circonstances qui peuvent en aggraver la répression. Quant à la théorie subjective, qui s’attache au contraire à l’intention de l’agent, il y a commencement d’exécution, dès lors qu’on se trouve en présence d’un acte positif, extérieur, non équivoque, qui, quoique ne constituant pas l’élément matériel de l’infraction, est assez proche moralement de celle-ci, pour que l’on puisse considérer comme très probable le fait que l’auteur serait allé jusqu’au bout de son dessein si rien ne l’en avait empêché. Pour sa part, la jurisprudence adopte souvent une formule faisant à la fois allusion à toutes les deux théories, objective et subjective. Ainsi, dans de nombreuses affaires, la Cour de cassation a affirmé que « constitue un commencement d’exécution tout acte qui tend directement au délit, lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre ». Dans d’autres décisions, la jurisprudence définit plus objectivement le commencement d’exécution, en indiquant qu’il s’agit d’« un acte devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime ». Ainsi, elle a refusé de voir un commencement d’exécution dans le fait de donner des instructions précises à un tiers et de lui remettre des fonds en vue de commettre un meurtre. C’est qu’en effet, dès lors que « le tueur à gage » s’était abstenu d’accomplir l’acte pour lequel il était engagé, le commanditaire ne pouvait être poursuivi. Ce vide juridique a été comblé par l’article 221-5-1 du Code pénal, qui incrimine le fait de faire à une personne des offres ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n’a été ni tenté ni commis. En tout cas, les simples actes préparatoires ne sont pas pénalement sanctionnés, sauf s’ils constituent en eux-mêmes une infraction autonome (par exemple, le port d’arme prohibé). Quant à la seconde condition concernant l’absence de désistement volontaire, la jurisprudence en fournit de nombreux exemples. Ainsi, est considéré comme involontaire le désistement qui est dû à un élément étranger à la volonté de l’agent, tel qu’un manque de coordination ou l’arrivée inopinée des agents de police qui auraient empêché l’auteur d’aller jusqu’au bout de son projet criminel. En revanche, le désistement, qui est le résultat d’une volonté libre de l’agent, assure l’impunité, même si le mobile n’est pas noble (par exemple, le cas d’une renonciation provoquée par la crainte d’une arrestation, par la pitié ou par le remords, en cours d’exécution). En tout cas, le désistement volontaire doit intervenir avant que l’infraction soit consommée. Après, il n’y a de place que pour un repentir actif, dont le juge répressif pourra tenir compte pour modérer la sanction. Aussi bien, le désistement doit 121 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 intervenir particulièrement tôt pour les délits formels, qui sont consommés dès l’emploi d’un moyen, abstraction faite de tout résultat (par exemple, l’empoisonnement qui est consommé dès l’administration d’un poison à la victime, peu important que l’agent ait administré aussitôt un antidote). Au contraire, pour les délits matériels, il n’y a consommation que si un résultat est obtenu. Concrètement, pour le meurtre, il y aura désistement volontaire dans le fait de se jeter à l’eau pour sauver la victime que l’on avait tenté de noyer. Enfin, la tentative punissable requiert l’intention coupable de l’auteur. C’est ce qui explique que la tentative est inconcevable à propos des infractions non intentionnelles. Quant à la répression, la tentative de crimes est toujours punissable, celle de délits ne l’est que dans les hypothèses expressément prévues par la loi, tandis que celle de contraventions n’est jamais sanctionnée. Dans les hypothèses où la tentative est punissable, l’auteur s’expose à la même peine que celle qu’il eût encourue si l’infraction avait été consommée (art. 121-4 C. pén.). Est également assimilée au délit tenté, en ce qui concerne la répression, l’infraction manquée. Dans ce cas, l’action de l’agent n’a pas été « suspendue »; elle s’est développée en totalité, mais l’acte ou les actes volontairement accomplis n’ont pas procuré le résultat recherché par l’agent (en raison, par exemple, de sa maladresse). En réalité, l’infraction manquée n’est qu’une forme de tentative punissable, qui « n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (art. 121-5 C. pén.). La situation est plus délicate, dans l’hypothèse du délit impossible. Il s’agit de l’infraction qui était irréalisable, soit par un manque d’objet (« meurtre » d’une personne qui est déjà morte), soit à raison de l’inadéquation des moyens employés (empoisonnement par administration de substances non toxiques). Le résultat était objectivement impossible à atteindre, alors que, dans le délit manqué, plus d’habileté chez l’agent aurait permis de l’obtenir à l’aide des moyens mis en œuvre. Cependant, la jurisprudence n’hésite pas à assimiler le délit impossible au délit tenté. Ainsi, elle a déclaré coupable d’une tentative d’homicide volontaire celui qui, croyant une personne encore en vie, avait exercé sur elle des violences dans l’intention de lui donner la mort, car le décès de la victime, antérieur aux violences, constituait une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur (Crim. 16 janv. 1986, RSC 1986, p. 849, obs. Vitu). Si l’impossibilité de réaliser l’infraction est tellement évidente qu’elle aurait dû apparaître à un agent d’intelligence normale, il n’y aura pas de poursuite. Mais, dans cette hypothèse, l’impunité procède alors non pas de ce qu’on se trouve en présence d’un délit impossible, mais de l’irresponsabilité pénale révélée par les moyens mêmes employés (tel est, par exemple, le cas d’un dément). 122 Greffier, concours interne, 2011 La tentative Greffier, concours externe, 2014 La tentative Magistrat, concours externe, 2008 Le résultat international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 Sujets de concours 123 Chapitre 3 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 4 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 chapitre L’élément moral de l’infraction 178 Toute infraction comporte un élément moral. Comme on l’a écrit, l’élément moral est l’essence de l’acte infractionnel, l’élément matériel n’étant que la simple manifestation extérieure. L’élément moral est nécessaire pour que l’agissement délictueux puisse être imputé à son auteur. C’est qu’en effet, il faut que ce dernier ait commis une « faute », c’est la condition indispensable de sa responsabilité pénale. Le droit pénal français repose, au moins en ce qui concerne la culpabilité, sur l’hypothèse du libre arbitre. Si l’auteur n’a pas agi librement ou n’a pas agi consciemment, on ne peut alors rien lui reprocher pénalement, mais tout au plus lui appliquer des mesures de sûreté sans coloration morale, destinées à le soigner et à protéger la société, s’il apparaît dangereux. 179 L’élément moral n’est pas le même pour toutes les infractions; il appartient au législateur, ou au besoin à la jurisprudence, de préciser sa nature et son degré. 178 179 section 1 Les formes de l’élément moral 180 L’article 121-3 du Code pénal énonce : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, voire en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui (v. infra, no 185). Dès lors, il convient d’étudier, d’une part, la « faute intentionnelle » et, d’autre part, la « faute non intentionnelle ». 180 125 181 > 182 § 1 Faute intentionnelle Au sommet de l’échelle se trouve la « faute intentionnelle », appelée parfois « intention criminelle » ou « dol » (ce mot étant pris ici dans un sens différent de celui du droit civil). Il y a « faute intentionnelle », lorsque l’auteur de l’acte a voulu pleinement tout à la fois son acte et le résultat obtenu ou tout au moins recherché. Parfois, la loi punit plus sévèrement celui qui a agi non seulement de façon volontaire mais en « machinant » à l’avance son infraction. C’est la circonstance aggravante de préméditation (art. 132-72, 221-3, 222-3-9°, etc., C. pén.; v. infra, no 198). Dans certains cas, le législateur souligne l’exigence d’une « faute intentionnelle » pour incriminer un agissement; il emploie dans la définition de l’infraction les mots « sciemment », « à dessein », « avec connaissance », « frauduleusement », « volontairement », « de mauvaise foi » ou d’autres expressions analogues. Le cas est quasi général pour les crimes et fréquent pour les délits. Ainsi le vol est la soustraction « frauduleuse » de la chose d’autrui (art. 311-1 C. pén.); ainsi la soustraction « frauduleuse » d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol (art. 311-2 ibid.); de même, le code réprime le fait d’entraver « volontairement » l’arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent (art. 223-5); ainsi est puni de peines correctionnelles le fait de porter « volontairement » atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui par l’un des procédés énumérés à l’article 226-1 du Code pénal; l’abus « frauduleux » de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne particulièrement vulnérable, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique, est réprimé par l’article 223-15-2 du Code pénal; enfin, l’article 323-1 du Code pénal réprime le fait d’accéder ou de se maintenir « frauduleusement » dans un système de traitement automatisé de données. À vrai dire, de telles précisions peuvent paraître superfétatoires, l’article 121-3 du Code pénal requérant pour tous les crimes et délits (sauf exceptions prévues par la loi en ce qui concerne ces derniers) « l’intention de le commettre ». 181 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 18 – 182 L’infraction Il arrive qu’un texte portant incrimination manque de précision et que l’infraction qu’il réprime puisse être soit intentionnelle, soit non intentionnelle. Il en était ainsi de l’outrage public à la pudeur de l’article 330 de l’ancien Code pénal, qui réprimait indifféremment l’exhibitionniste et « l’imprudent ». Quant à la jurisprudence, elle n’hésitait pas à sanctionner, sur la base de ce texte, aussi bien la volonté délibérée de froisser la pudeur publique que la seule négligence apportée à dissimuler l’acte obscène à la vue des tiers (Crim. 17 juin 1965, Bull. crim. no 161). Le nouveau Code pénal (art. 222-32) sanctionne « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public », définition qui semble, en l’occurrence, exclure la répression de la simple faute d’imprudence (v. en ce sens, CA Paris, 11e ch. A, 13 déc. 1994, Dr. pénal 1995, comm. no 89, note M. Véron). Les juridictions répressives peuvent toutefois se fonder sur les circonstances particulières entourant les faits pour en déduire l’intention coupable de l’auteur (Crim. 27 janv. 2016, Dr. pénal 2016, comm. no 56, note Ph. Conte [en l’espèce, il a été jugé que, « compte tenu du contexte dans lequel se sont déroulés ces faits, en pleine journée, sur un parking public face à un immeuble d’habitation avec des commerces au rez-de-chaussée », le prévenu « n’a pu ignorer qu’il pouvait être vu »]). Le principe étant que les crimes et délits sont des infractions intentionnelles (sauf exception prévue par la loi pour les délits), le législateur n’a pas toujours estimé nécessaire d’exprimer le caractère intentionnel de certains délits, ce qui a parfois donné lieu à con182 126 L’élément moral de l’infraction 183 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 troverse. Ainsi en est-il en matière d’abandon de famille : l’article 227-3 du Code pénal n’a pas repris la définition de l’article 357-2 de l’ancien code (disposant que « le défaut de paiement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire »), mais il n’en demeure pas moins que ce délit est intentionnel (Crim. 9 juin 2004, Dr. pénal 2004, comm. no 154, 2e esp., note M. Véron; Crim. 12 juin 2013, no 13-82.622), la carence du débiteur devant être « volontaire » (Crim. 28 juin 1995, Bull. crim. no 243; Crim. 21 mai 1997, Bull. crim. no 190 [l’élément intentionnel est caractérisé dès lors que le prévenu ne peut se prévaloir d’une impossibilité matérielle de payer pendant la période visée à la prévention : Crim. 28 juin 2000, Bull. crim. no 250; v. aussi : Crim. 16 nov. 2016, no 2016-024075]). S’agissant du crime d’empoisonnement, l’article 221-5 du Code pénal sanctionne « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ». Que le crime d’empoisonnement soit une infraction intentionnelle, on ne saurait en discuter, mais certaines décisions de la chambre criminelle laissent perplexe quant à la définition de l’élément intentionnel de cette infraction. Ainsi, selon la Cour de cassation, la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide (Crim. 2 juill. 1998, Bull. crim. no 211, JCP G 1998. II. 10132, note Rassat : en l’espèce, le crime d’empoisonnement n’a pas été retenu à l’encontre d’une personne qui avait sciemment transmis sa séropositivité à sa partenaire en lui imposant des rapports non protégés. V. aussi : Crim. 10 janv. 2006, Bull. crim. no 11, Dr. pénal 2006, comm. no 30, note M. Véron; v. aussi : Crim. 5 oct. 2010, Bull. crim. no 147, RSC 2011, 101, obs. Y. Mayaud [en l’espèce, a été retenu le délit d’administration de substances nuisibles défini à l’article 222-15 du Code pénal]; Adde A. Prothais, « Le sida par complaisance rattrapé par le droit pénal », D. 2006, chron. 1068). À notre avis, il est difficile de concevoir que l’individu, qui a volontairement administré une substance mortelle à autrui, puisse ne pas être animé d’une intention homicide. L’affaire dite du sang contaminé – qui a défrayé la chronique – illustre ces difficultés. C’est sous la qualification d’homicides involontaires et d’atteintes involontaires à l’intégrité des personnes que la Commission d’instruction de la Cour de justice de la République a décidé, le 17 juillet 1998, de renvoyer devant ladite Cour les anciens ministres impliqués en excluant la qualification d’empoisonnement (V. dans la même affaire : CA Paris 13 juill. 1993, D. 1994. 118, note Prothais : l’empoisonnement est un meurtre spécial en raison du moyen employé par son auteur et implique, pour être constitué, que soit rapportée la preuve chez son auteur de la volonté de donner la mort; v. aussi : Crim. 22 juin 1994, RSC 1995, p. 347, obs. Y. Mayaud; Crim. 18 juin 2003, Bull. crim. no 127, RSC 2003, p. 781, obs. Y. Mayaud). La « faute intentionnelle » ne doit toutefois pas être confondue avec le mobile, c’est-àdire le sentiment ou l’intérêt qui a incité l’agent à commettre l’infraction. En principe, le mobile est juridiquement indifférent et n’a pas d’incidence légale sur la qualification et la répression de l’infraction. Ainsi, le meurtre ou l’empoisonnement commis par vengeance, par pitié (en cas d’euthanasie; v. toutefois l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique, introduit par la loi no 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie, qui pose le principe de l’exclusion de la mise en œuvre ou de la poursuite des soins et traitements « lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont 183 127 184 > 184 L’infraction 184 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire ». V. aussi : art. L. 1111-4 du Code de la santé publique, qui laisse également une place importante à la volonté du malade, en indiquant qu’il a le droit « de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ») ou par amour demeure punissable. Il en est de même pour le vol qui est constitué quel que soit le mobile ayant inspiré son auteur (Crim. 8 janv. 1992, Bull. crim. no 5, RSC 1993, p. 311, obs. B. Bouloc; Crim. 8 déc. 1998, Bull. crim. no 336; Crim. 24 avr. 2001, Bull. crim. no 98, RSC 2001, p. 829, obs. G. Giudicelli-Delage). Ainsi, l’infraction a-t-elle été retenue à l’encontre des ouvriers forestiers qui avaient vendu des bois appartenant à leur employeur, pour se payer, sur le prix de vente, des salaires dont ils avaient été privés durant une grève (Crim. 8 janv. 1992, Bull. crim. no 5). Ont été également déclarés coupables de ce délit ceux qui avaient soustrait des animaux au préjudice du CNRS en prétendant qu’ils subissaient des mauvais traitements (Crim. 13 mai 1992, Dr. pénal 1992, comm. no 279, note M. Véron). La chambre criminelle a, par ailleurs, défini, dans de nombreux arrêts, l’élément moral des violences qui se trouvent constituées « dès lors qu’il existe un acte volontaire de violence, dirigé contre une ou plusieurs personnes, quel que soit le mobile qui l’a inspiré… ». Par conséquent, sont punissables les violences commises par plaisanterie qui se terminent mal (Crim. 7 juin 1961, Bull. crim. no 290; v. aussi : Crim. 7 avr. 2010, no 09-81.978). De même, la séquestration des dirigeants d’une entreprise, réalisée dans le cadre d’un conflit du travail, ne saurait être justifiée du fait qu’elle pourrait être considérée comme « un mode d’expression de la liberté des uns par rapport au pouvoir de direction des autres » (sic), (Crim. 23 déc. 1986, Bull. crim. no 384). Dans toutes les hypothèses précitées, les infractions se trouvent donc constituées, indépendamment du mobile qui a inspiré les auteurs. Il est vrai que les tribunaux en tiennent, parfois, compte en vue de déterminer la peine applicable. Aussi bien, est-il permis de constater que les cours d’assises se montrent parfois indulgentes à l’égard des auteurs de crimes passionnels. Néanmoins, exceptionnellement, certains textes prennent en considération le but poursuivi par l’agent; ce que certains auteurs appellent le « dol spécial ». Ainsi, les actes de terrorisme doivent avoir « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (art. 421-1 C. pén.), tandis qu’en cas de diffamation, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 requiert la volonté de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. De même, le délit d’organisation de sa propre insolvabilité exige que l’auteur ait eu pour but de « se soustraire » à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, par une juridiction civile (art. 314-7 C. pén.). On peut encore citer l’exemple du délit de fuite, défini à l’article 434-10 du Code pénal (ce texte déclare pénalement responsable celui qui « sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident » ne s’arrête pas), qui exige, en dehors du dol général, un dol spécial, en sanctionnant le conducteur qui ne s’est pas arrêté afin de « tenter d’échapper […] à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue » (Crim. 17 janv. 1973, Bull. crim. no 21, RSC 1973, p. 685, obs. A. Vitu; Crim. 25 févr. 1981, Bull. crim. no 75). Il est clair que, dans les hypothèses précédemment visées, les infractions concernées ne peuvent être constituées, en l’absence de dol spécial. 184 128 L’élément moral de l’infraction § 2 Faute non intentionnelle 185 Au-dessous de la faute intentionnelle, la loi retient, dans certains cas, la faute d’imprudence ou de négligence. Aussi bien, cette faute est un élément constitutif des atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire; art. 221-6 C. pén. [ce texte sanctionne le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui]) et à l’intégrité physique ou psychique des personnes (coups et blessures involontaires; v. art. 222-19, R. 625-2, R. 622-1 C. pén.). Ces infractions donnent lieu, chaque année, à de nombreuses condamnations en raison des accidents de la circulation et des accidents du travail qui constituent un « véritable contentieux de masse ». Ces précisions fournies, l’article 121-3 du Code pénal (modifié par les lois no 96-393 du 13 mai 1996 et 2000-647 du 10 juillet 2000), après avoir posé le principe que les crimes et délits sont des infractions intentionnelles, énonce, dans son alinéa 3, qu’« il y a […] délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Des dispositions analogues ont été insérées dans le Code général des collectivités territoriales (art. L. 2 123-34, L. 3 123-28, L. 4 135-28, etc.) et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 11 bis A). Ces textes tendent à ne retenir la responsabilité pénale des élus et des fonctionnaires que si ceux-ci n’ont pas accompli toutes les diligences normales, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. 186 Faute d’imprudence ou de négligence et lien de causalité « direct ». La loi visant l’imprudence, celle-ci peut résulter d’un comportement positif (acte de commission) se traduisant par une violation des règles de prudence ou des normes professionnelles occasionnant le résultat dommageable, tel que le décès d’une personne ou des coups et blessures causés à autrui (les qualifications retenues, dans ces hypothèses, sont celles d’homicide involontaire et d’atteintes involontaires à l’intégrité physique de la personne). Tel était le cas d’un pilote qui, à l’occasion d’une épreuve de vitesse spéciale d’un rallye automobile, avait perdu le contrôle de son véhicule et avait renversé cinq spectateurs, alors qu’il circulait à une vitesse exagérée sur une route mouillée et grasse, dans un virage rendu dangereux par une bosse dont la présence pouvait être décelée par une reconnaissance approprié de l’itinéraire (Crim. 8 mars 2005, Bull. crim. no 78, RSC 2005, p. 557, obs. Y. Mayaud). Quant à la faute de négligence, elle procède essentiellement d’actes d’omission ou d’abstention. Il s’agit, en particulier, du défaut de précaution ou du manque de vigilance susceptible d’être imputé à des auteurs d’homicide ou de blessures involontaires; ces derniers peuvent avoir agi avec étourderie, insouciance, légèreté. Ainsi, des fautes de négligence ont été retenues à l’encontre des médecins ayant omis de procéder à des examens postopératoires imposés par les données acquises de la science médicale (Crim. 7 juill. 1993, Dr. pénal 1993, comm. no 255, note M. Véron) ou s’étant 186 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 185 129 187 > 188 L’infraction abstenus de mettre en œuvre une surveillance vigilante exigée par l’état de santé des patients (Crim. 26 févr. 1997, Dr. pénal 1997, comm. no 109, 2e esp., note M. Véron). 187 L’appréciation de la faute d’imprudence ou de négligence. Sous le régime de l’ancien Code pénal, la faute pénale d’imprudence ou de négligence a été appréciée, par les juges répressifs, d’une manière abstraite, c’est-à-dire par référence à un homme moyen ou au modèle du bon père de famille. Cette position jurisprudentielle a été maintenue même sous l’empire de la loi no 96393 du 13 mai 1996 ayant introduit, dans l’article 121-3 du Code pénal, certains critères en fonction desquels la faute d’imprudence ou de négligence devait être établie. En particulier, l’alinéa 3 de ce texte indiquait que la responsabilité pénale ne pouvait être retenue si l’auteur des faits avait accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Même si la nouvelle rédaction incitait les juridictions pénales à adopter une appréciation in concreto, celles-ci ont continué d’apprécier la faute d’imprudence in abstracto et, surtout, de la présumer en affirmant que les diligences normales n’avaient pas été accomplies puisqu’un accident était survenu (V. par ex., Crim. 19 févr. 1997, JCP G 1997. II. 22889 note J.-Y. Chevallier; Crim. 14 oct. 1997, Bull. crim. no 334). La loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 ayant modifié celle no 96-393 du 13 mai 1996, il est permis de se demander si la jurisprudence a évolué sous l’empire de la loi nouvelle. Tout d’abord, on doit faire observer que les modifications apportées par la loi du 10 juillet 2000 sont mineures. En particulier, celle-ci a légèrement retouché l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal, qui énonce désormais que la responsabilité pénale peut être retenue en cas de faute d’imprudence, s’il est établi que l’agent n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu des circonstances (nature des missions ou fonctions, compétences et moyens disponibles). Si l’on se fonde sur les termes employés par ce texte, on peut penser que la nouvelle formule « s’il est établi » impose aux juges répressifs d’apprécier la faute d’imprudence ou de négligence in concreto et de ne plus la présumer ou de la déduire du seul fait de la survenance d’un accident (B. Bouloc, « Existe-t-il une responsabilité pénale du fait d’autrui ? », Responsabilité civile et assurances [nov.] 2000, no spécial, p. 36, et spéc. p. 39). Néanmoins, on est amené à reconnaître que la jurisprudence continue, dans un certain nombre de cas, d’apprécier in abstracto la faute d’imprudence qui, seule, suffit à engager la responsabilité pénale de l’auteur direct d’un homicide ou de blessures involontaires, en plaçant l’homme moyen ou le professionnel normalement attentif dans la situation du prévenu. Ainsi, elle n’hésite pas à condamner des conducteurs imprudents (Crim. 8 mars 2005, Bull. crim. no 78, RSC 2005, p. 557, obs. Y. Mayaud) ou des professionnels, tels que les médecins, qui ont fait preuve de négligence, en affirmant que leurs fautes n’auraient pas été commises par « un praticien normalement prudent, diligent et avisé » (V. à propos d’un chirurgien, Crim. 21 sept. 2004, Bull. crim. no 216). 188 La remise en cause du principe de l’identité des fautes civile et pénale d’imprudence. Les rédacteurs de la loi du 10 juillet 2000 ont entendu revenir sur la jurisprudence existant depuis 1912, qui affirmait le principe de l’unité des fautes civile et pénale d’imprudence (Civ. 18 déc. 1912, S. 1914. 1. 249, note Morel, Crim. 18 nov. 1986, Bull. crim. 18 130 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 187 L’élément moral de l’infraction 189 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 no 343). La faute pénale d’imprudence n’est plus identifiée à la faute civile d’imprudence; l’absence de faute pénale n’exclut pas l’existence d’une faute civile d’imprudence. Ainsi, la loi du 10 juillet 2000 a-t-elle pris soin de préciser, dans l’article 4-1 du Code de procédure pénale, que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles, afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du Code civil (depuis ord. no 2016-131, 10 févr. 2016; ancien art. 1383 C. civ.) si l’existence d’une faute civile est établie ou en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l’existence d’une faute inexcusable est établie (V. Crim. 4 juin 2002, Bull. crim. no 127, RSC 2003, p. 92, obs. B. Bouloc, ibid. p. 127, obs. A. Giudicelli; Civ. 1re, 30 janv. 2001, Bull. civ. I, no 19, JCP G 2001. I. 338, no 4, obs. G. Viney; Civ. 2e, 16 sept. 2003, Bull. civ. II, no 263, D. 2004, p. 721, note Ph. Bonfils). Par ailleurs, l’article 470-1 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Sans aucun doute, si l’on s’appuie sur ces textes, il est permis d’affirmer la fin du principe de l’identité des fautes civile et pénale d’imprudence, ce qui constitue une importante innovation. Cependant, l’étude de la jurisprudence laisse penser que ce principe continue d’exister dans certaines hypothèses (v. Crim. 15 nov. 2016, no 15-84.509 [le gérant d’une société, qui n’a pas commis une faute personnelle d’imprudence civile, ne peut pas engager la responsabilité pénale de ladite société, en sa qualité d’organe ou de représentant, sur le fondement de l’article 121-2 du Code pénal; cela signifie donc qu’il ne pourra pas non plus se voir imputer une faute pénale d’imprudence, susceptible d’engager sa propre responsabilité pénale, en qualité d’auteur direct ou indirect du dommage]). En outre, par toute une série d’arrêts, la chambre criminelle a jugé que la juridiction, qui statue, après une décision de relaxe, sur la demande de la partie civile, doit caractériser la faute civile « à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite » (v. par ex. Crim. 19 mai 2016, Bull. crim. no 152; Crim. 5 avr. 2018, nos 16-87-669 et 16-83.961, JCP G 2018, no 644, note J.-H. Robert; Crim. 2 mai 2018, no 17-82.449). La notion de lien de causalité « direct » et le critère du « paramètre déterminant ». Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal ne s’appliquent qu’aux auteurs de délits d’imprudence ayant directement causé le dommage. On parle, dans une telle hypothèse, des auteurs directs ou d’un lien de causalité direct. Dès lors que les juges répressifs qualifient le lien de causalité de « direct », une simple faute d’imprudence ou de négligence est suffisante pour engager la responsabilité pénale de l’agent. Sur ce point, il est utile de rappeler que, selon la circulaire d’application du 11 octobre 2000 (Crim. 00-9/F1), « il n’y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura, soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime ». À vrai dire, sous l’empire de la loi du 10 juillet 2000, la jurisprudence adopte une conception large de la notion de causalité directe. Tout d’abord, elle considère comme cause directe celle qui est immédiate et « qui 189 131 189 > 189 L’infraction 132 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 se définit par la proximité, dans le temps et l’espace, entre le fait générateur et le dommage » (B. Cotte et D. Guihal, « La loi Fauchon, 5 ans de mise en œuvre jurisprudentielle », Dr. pénal 2006, étude no 6, no 18). Puis, elle fait entrer dans cette notion une faute qui, même si elle ne satisfait pas au critère de l’immédiateté car elle peut être suivie, dans le processus causal, par d’autres fautes ou événements plus proches du résultat dommageable, a joué un rôle déterminant et essentiel dans la réalisation de ce résultat qui apparaît, dans ces conditions, comme la conséquence directe de cette faute initiale (critère du paramètre déterminant). Ainsi, dans une espèce où un automobiliste, roulant à une vitesse excessive, avait heurté un sanglier, avant d’entrer en collision avec une voiture qui circulait en sens inverse, les juges répressifs ont relevé que « sa vitesse, qui l’a[vait] empêché de maîtriser son véhicule [était] un paramètre déterminant dans les causes et les conséquences de l’accident » qui avait provoqué le décès de la conductrice de l’autre véhicule. Même si le prévenu prétendait que la « cause première de l’accident » était « la survenance inopinée » du sanglier sur la route, qui constituait, selon lui, « un cas de force majeure », la chambre criminelle a affirmé, avec fermeté, que « l’excès de vitesse [était] constitutif d’une faute en relation directe avec le décès de la victime » (Crim. 25 sept. 2001, Bull. crim. no 188, RSC 2002, p. 101, obs. Y. Mayaud; v. aussi : Crim. 5 avr. 2005, Dr. pénal 2005, comm. no 103, 2e esp., note M. Véron). Sans aucun doute, l’application du critère du paramètre déterminant ne fait que confirmer une jurisprudence ancienne, rendue sous le régime du Code pénal de 1810, qui, appliquant la théorie de l’équivalence des conditions, n’hésitait pas à retenir des fautes lointaines du dommage et à en écarter d’autres plus proches, dès lors que les premières avaient contribué, de manière déterminante, à la réalisation du résultat. À notre avis, demeure toujours valable la solution admise par un vieil arrêt de la chambre criminelle concernant un piéton grièvement blessé par un automobiliste imprudent (Crim. 10 juill. 1952, Bull. crim. no 185). La victime, ayant été transportée à l’hôpital, est décédée au cours d’une opération chirurgicale. En l’espèce, la faute du chirurgien a été considérée si légère que les juges répressifs n’ont retenu que la faute très grave du conducteur, bien qu’elle ait été éloignée du dommage, à savoir le décès de la victime. Néanmoins, on peut se demander si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, conservent leur intérêt les décisions jurisprudentielles qui ont reconnu la responsabilité pénale des prévenus pour le délit d’homicide involontaire, en estimant que leurs fautes avaient été la cause du décès des victimes qui s’étaient suicidées en raison d’une « affection mélancolique, elle-même révélée ou provoquée par le traumatisme » consécutif à l’accident dont lesdits prévenus étaient à l’origine. Pourtant, selon les rapports d’expertise, le développement de l’état dépressif des victimes a été, en grande partie, dû à « une prédisposition pathologique d[es] sujet[s] sans manifestation antérieure » (Crim. 24 nov. 1965, D. 1966, p. 104; Crim. 14 janv. 1971, Bull. crim. no 13, D. 1971, p. 164, rapp. E. Robert; v. aussi : Crim. 8 janv. 1985, Gaz. Pal. 1985. 2. somm. 385, note J.-P. Doucet). Cette jurisprudence, qui avait pour fondement la théorie de l’équivalence des conditions et qui pouvait se justifier, à l’époque, par l’absence d’un texte distinguant entre lien de causalité direct et indirect, pourrait-elle aujourd’hui être maintenue ? Une telle question devrait, à notre avis, recevoir une réponse positive, car le recours au critère du paramètre déterminant permet actuellement au juge pénal de considérer comme directe une cause entretenant en réalité un lien indirect avec le dommage, si bien que la nature de la faute n’a ici aucune importance puisqu’une simple faute d’imprudence ou de négligence L’élément moral de l’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 suffit à engager la responsabilité pénale de l’agent. Ainsi, dans une affaire où le décès d’une patiente était dû, selon l’expertise médico-légale, au grave processus de détresse neurologique observé immédiatement après une intervention chirurgicale, les juges répressifs ont estimé que les fautes commises par le praticien au cours de l’opération étaient « à l’origine directe du processus » de cette détresse, « cause de la mort de la patiente survenue près de deux ans plus tard » (Crim. 23 oct. 2001, Bull. crim. no 218, RSC 2002, p. 102, obs. Y. Mayaud. V. aussi : Crim. 23 oct. 2001, Bull. crim. no 217). Dans cette hypothèse, le chirurgien a été considéré comme auteur direct, et non indirect, du délit d’homicide involontaire. Il en résulte donc que l’utilisation arbitraire du critère du « paramètre déterminant » rend peu étanche la frontière entre lien de causalité direct (Crim. 21 janv. 2014, D. 2014, p. 1317, note Ph. Conte, Dr. pénal 2014, comm. no 39, note M. Véron [« cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l’animal l’ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse »]; en l’espèce, le propriétaire du chien aurait dû être considéré comme auteur indirect du délit d’homicide involontaire, puisqu’il n’a fait que « créer la situation » ayant permis la réalisation du dommage) et indirect, et relativise, par là même, la portée de la loi du 10 juillet 2000, dont les rédacteurs avaient pour objectif principal d’exclure la responsabilité pénale des auteurs indirects (personnes physiques) en cas de faute simple. 190 Pluralité de fautes. Dans certaines hypothèses, il est pratiquement impossible d’identifier l’incidence directe, sur la victime, des fautes successives commises par différents agents intervenant dans le processus causal. On peut citer l’exemple de deux automobilistes qui, conduisant sous l’empire d’un état alcoolique, ont percuté l’un et l’autre un piéton, sans qu’on puisse déterminer lequel des deux a provoqué sa mort. Dans une hypothèse analogue, les deux conducteurs ont été déclarés pénalement responsables d’homicide involontaire, car ils « ont participé ensemble à une action dangereuse et créé, par leur imprudence, un risque grave dont un tiers a été victime » (Crim. 23 juill. 1986, Bull. crim. no 243; Crim. 23 mars 1994, Bull. crim. no 112). 191 Les fautes « qualifiées » et le lien de causalité « indirect ». À la différence de la causalité directe, l’article 121-3, al. 4, du Code pénal fournit quelques précisions sur le lien de causalité indirect. En particulier, ce texte distingue entre les personnes physiques qui « ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » et celles qui « n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ». La première hypothèse suppose qu’entre l’acte de l’agent et le résultat dommageable s’interpose un événement (le terme « contribuer » laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’un enchaînement de causes) ayant abouti à la réalisation de ce résultat. Dans ces conditions, la faute imputée à l’agent apparaît comme une cause lointaine du préjudice. Quant à la seconde hypothèse, elle vise les personnes ayant omis de prendre les mesures nécessaires permettant d’éviter le dommage. Une telle abstention peut donc être à l’origine d’un accident entraînant le résultat dommageable. Qu’il s’agisse de la première ou de la seconde situation, l’agent ne peut être considéré que comme un « auteur indirect ». L’étude de la jurisprudence démontre clairement que les fautes retenues à l’encontre des décideurs, publics ou privés, sont considérées comme des causes indirectes des dom- 190 191 133 192 > 192 L’infraction 192 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 mages dont la source directe peut être soit un accident, soit l’imprudence, l’étourderie ou l’inexpérience d’un préposé. Lorsque le lien de causalité est indirect, les fautes (lointaines) commises ne peuvent être retenues que si elles sont graves ou lourdes. Le législateur a donc réagi contre la tendance jurisprudentielle, consistant à retenir souvent, en matière d’homicide ou de blessures par imprudence, la responsabilité pénale des agents éloignés de l’événement qui était à l’origine du dommage. C’est qu’en effet, les tribunaux répressifs adoptaient, pendant longtemps, la théorie de l’équivalence des conditions, selon laquelle toute faute peut engager la responsabilité de son auteur, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage. Il n’est pas alors indispensable, selon cette théorie, que la faute soit la cause directe et immédiate de l’accident (on peut faire observer que dans l’affaire du sang contaminé, ont été mises en cause les responsabilités pénales du Centre national de transfusion sanguine, du ministre de la Santé et de deux anciens ministres, ainsi que la responsabilité d’un ancien Premier ministre). Le nouveau texte, inséré par la loi du 10 juillet 2000, incite désormais les juges à faire application de la théorie de la causalité adéquate; seule une faute délibérée ou caractérisée peut engager la responsabilité pénale d’un auteur indirect. La notion de « faute délibérée ». Il s’agit de la violation, en pleine connaissance de cause, d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par un texte législatif ou réglementaire (Crim. 12 sept. 2000, Bull. crim. no 268). En réalité, cette faute ne constitue qu’une forme de dol éventuel. C’est qu’en effet, l’auteur, sans chercher à provoquer le résultat dommageable découlant de son action volontaire, a dû cependant (ou aurait dû) le prévoir comme possible. Dans cette hypothèse, l’agent reste totalement indifférent à la survenance de ce résultat. Ainsi, a-t-il été jugé que le dirigeant de fait d’une association propriétaire d’un avion, qui exerçait également les fonctions de chef pilote, « a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par un règlement », en s’abstenant de s’assurer que les conditions d’entretien et de révision de l’appareil étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à son utilisation (Crim. 18 nov. 2008, Bull. crim. no 232; v. aussi : Crim. 3 déc. 2002, Bull. crim. no 219, RSC 2003, p. 334, obs. Y. Mayaud; Crim. 16 oct. 2012, Dr. pénal 2013, 1er arrêt, comm. no 3, note M. Véron). Il a été alors condamné pour homicide et blessures involontaires à la suite d’un accident dû à une panne de moteur de l’avion trouvant son origine dans le défaut d’entretien. La Cour de cassation se montre exigeante quant à la source et à la nature de l’obligation de sécurité à laquelle l’agent aurait manqué, et dont l’inobservation peut caractériser la faute délibérée. À cet égard, on pourra citer l’exemple d’un maire qui avait organisé une fanfare, au cours de laquelle un automobiliste, roulant à une vitesse excessive, avait blessé deux enfants. Les juges du second degré avaient condamné le maire pour blessures involontaires, en lui reprochant de n’avoir pas interdit la circulation pendant la durée du défilé et d’avoir seulement délégué un conseiller municipal en avant du cortège pour en assurer la sécurité. Toutefois, la Haute juridiction a censuré cette décision, car la cour d’appel ne pouvait relever à la charge du maire « un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi, sans préciser la source et la nature de cette obligation » (Crim. 18 juin 2002, Bull. crim. no 138; v. aussi : Crim. 2 sept. 2014, no 13-83.956). En particulier, l’obligation méconnue doit être imposée par une « loi » ou un « règlement ». S’agissant, plus précisément, de cette dernière notion, il est permis de faire 192 134 L’élément moral de l’infraction 193 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 observer que les rédacteurs du nouveau Code pénal avaient opté pour l’expression « la loi et les règlements ». Le terme de « règlements » a été entendu largement, si bien qu’on pouvait y faire entrer les circulaires ministérielles (v. antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal : CA Paris, 20 déc. 1971, RSC 1972, p. 610, obs. G. Levasseur) et les règles déontologiques ou professionnelles. La circulaire d’application du nouveau Code pénal indiquait même que le règlement intérieur d’une entreprise, lorsqu’il comporte des obligations de sécurité ou de prudence, peut être considéré comme un règlement au sens des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal (sanctionnant l’homicide involontaire et les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne). Cependant, le législateur du 10 juillet 2000, mettant le terme de « règlement » au singulier, a entendu mettre fin à cette interprétation extensive. Désormais, cette notion doit être entendue strictement, c’est-à-dire au sens constitutionnel. Par conséquent, la faute délibérée devrait être écartée en cas de violation d’un règlement intérieur ou d’une norme professionnelle. La notion de « faute caractérisée ». En dehors de l’hypothèse précédente, la personne physique, ayant contribué indirectement à la réalisation d’un homicide ou de blessures involontaires (appelé « auteur indirect »), peut aussi engager sa responsabilité pénale s’il est établi qu’elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer (art. 121-3, al. 4, C. pén.). Le législateur n’ayant pas défini la notion de faute caractérisée (V. Y. Mayaud, « La faute caractérisée selon la Cour de cassation », RSC 2001, p. 577; A. Ponseille, « La faute caractérisée en droit pénal », RSC 2003, p. 79), la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester la conformité des dispositions de l’article 121-3, al. 4 du Code pénal, notamment, aux principes constitutionnels de nécessité et de légalité des délits et des peines, a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel. En particulier, elle a déclaré que les dispositions critiquées, qui laissent « au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive », sont rédigées « en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que [leur] interprétation se fasse sans risque d’arbitraire et dans des conditions garantissant tant le respect de la présomption d’innocence que l’intégralité des droits de la défense » (Crim. 24 sept. 2013, QPC, Bull. crim. no 180, JCP G 2013, 1176, note S. Detraz). Malgré l’absence de définition législative claire et précise, il est permis de penser que la faute caractérisée se situe entre la faute simple d’imprudence et la faute délibérée; sans aucun doute, il s’agit d’une faute lourde d’imprudence comparable à la « faute inexcusable » du droit social. En particulier, cette faute peut être définie : soit comme « l’erreur unique mais grossière qu’un professionnel avisé ne commet pas » (V. D. Commaret, « La loi Fauchon, cinq ans après », Dr. pénal 2006, chron. no 7, spéc. no 18); soit comme « une série de négligences et d’imprudences qui entretiennent chacune un lien de causalité certain avec le dommage, et dont l’accumulation permet d’établir l’existence d’une faute […] d’une particulière gravité dont ses auteurs ne pouvaient ignorer les conséquences » (Crim. 10 janv. 2006, no 04-86.428). En outre, la jurisprudence fait entrer dans la notion de faute caractérisée l’inobservation des prescriptions contenues dans un texte qui, pour différentes raisons, ne peuvent recevoir application en tant que telles (V. B. Cotte et D. Guihal, « La loi Fauchon, cinq ans 193 135 193 > 193 L’infraction 136 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 de mise en œuvre jurisprudentielle », Dr. pénal 2006, chron. no 6, et spéc. no 37; v. aussi : Crim. 15 oct. 2002, Bull. crim. no 186, RSC 2003, p. 96, obs. Y. Mayaud). En tout cas, si les conditions requises pour l’admission d’une faute délibérée ne sont pas réunies, les juges répressifs n’hésitent pas à recourir à la « notion floue » de faute caractérisée (V. Crim. 12 mai 2015, Dr. pénal 2015, comm. no 94, note M. Véron [le fait que le juge d’instruction ait déclaré que le manquement à la législation invoquée ne soit pas applicable aux personnes mises en examen ne fait pas obstacle à ce que ce manquement puisse être constitutif d’une faute caractérisée]). Pour être retenue, la faute caractérisée doit exposer autrui à un risque particulièrement grave que l’agent ne pouvait ignorer. Ce dernier doit donc avoir conscience du danger que son comportement fait courir aux autres. En matière de sécurité, les juridictions pénales se montrent même très exigeantes en imposant « au coordonnateur […] dans la phase de réalisation de l’ouvrage, d’anticiper les situations de risque pouvant résulter notamment des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier » (Crim. 9 juin 2009, Bull. crim. no 11). Il faut être prévoyant et prendre des mesures de précaution en amont pour éviter tout danger. Ainsi, s’est vu imputer une faute caractérisée l’adjoint d’une commune aux affaires culturelles, bénéficiaire d’une délégation pour l’organisation d’une kermesse, pour avoir exposé des enfants utilisateurs d’une structure gonflable « à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer au regard des préconisations des moniteurs de la société ayant installé les jeux et de la configuration des lieux » (Crim. 28 juin 2016, Bull. crim. no 201). Un examen attentif de la jurisprudence fait apparaître que la connaissance du risque est, dans certains cas, présumée en raison de la qualité du prévenu ou de la nature des activités ou fonctions qu’il exerce. On peut citer, à cet égard, l’exemple du chef d’entreprise dont la responsabilité repose sur sa qualité ou, plus exactement, est attachée à la fonction exercée (V. infra nos 313 et s.). Il appartient au chef d’entreprise de veiller en permanence au respect de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs et de mettre en place, à titre préventif, des dispositifs de sécurité afin d’éviter que des accidents ne surviennent (Crim. 12 nov. 2014, Dr. pénal 2015, comm. no 5, note M. Véron). En ne veillant pas au respect de cette réglementation, un chef d’entreprise ne peut valablement prétendre « ignorer le risque découlant de son manquement » (Crim. 11 févr. 2003, Bull. crim. no 28, RSC 2003, p. 801, obs. G. GuidicelliDelage; Crim. 11 janv. 2005, no 04-84.196; Crim. 12 nov. 2014, Dr. pénal 2015, comm. no 5, note M. Véron). Dans de nombreuses hypothèses, les juges se fondent sur la formation et les expériences professionnelles du prévenu pour en déduire la connaissance par lui du risque encouru (Crim. 13 févr. 2007, Bull. crim. no 44, RSC 2007, p. 295, obs. Y. Mayaud [« en sa qualité d’anesthésiste expérimenté, la prévenue ne pouvait en effet ignorer qu’elle faisait courir à l’enfant un risque d’une particulière gravité »]). Tel était le cas d’un garagiste ayant prêté à une personne une voiture dont les pneumatiques étaient trop usagés, ce qui avait contribué à la survenance d’un accident ayant entraîné un homicide et des blessures involontaires. La faute caractérisée a été retenue à l’encontre du prévenu, car, « par sa profession, [il] connai[ssai]t les graves dangers de l’utilisation de pneumatiques trop usagés » (Crim. 4 févr. 2003, Dr. pénal 2003, comm. no 71, note M. Véron; v. aussi : Crim. 5 oct. 2004, Bull. crim. no 236, RSC 2005, p. 71, obs. Y. Mayaud). L’élément moral de l’infraction 194 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 La connaissance du danger peut parfois découler du fait que d’autres accidents survenus préalablement avaient pour origine la même cause, si bien que les prévenus, en omettant de prendre les mesures indispensables pour éviter que de tels accidents ne se renouvellent, avaient commis des fautes caractérisées (Crim. 22 janv. 2008, Dr. pénal 2008, comm. no 43, note M. Véron). Enfin, la connaissance du risque peut être établie par des signalements (Crim. 2 déc. 2003, Bull. crim. no 231; Crim. 22 janv. 2008, RS 2008, p. 899, obs. Y. Mayaud) ou des avertissements même « répétés » adressés aux personnes concernées, professionnels (Crim. 2 mars 2010, Bull. crim. no 44 [à propos d’un maître d’ouvrage]; Crim. 10 janv. 2006, no 05-82.649) ou non. L’appréciation de la « faute caractérisée ». La jurisprudence n’apprécie pas de manière homogène la faute caractérisée, puisqu’elle adopte, en fonction de la qualité des prévenus, soit une conception subjective (in concreto), soit une conception abstraite (in abstracto). On doit faire observer que la loi du 10 juillet 2000 est due aux nombreuses condamnations prononcées à l’encontre de « décideurs publics » pour des homicides et blessures involontaires, alors que les prévenus étaient souvent très éloignés de l’événement qui était à l’origine du dommage (application de la théorie de l’équivalence des conditions). Or, il est permis de constater que la jurisprudence, rendue sous l’empire de la loi du 10 juillet 2000, semble mettre un terme à la présomption de responsabilité pesant sur les élus et agents publics ou fonctionnaires (Crim. 12 déc. 2000, BICC 2001, no 529, p. 3, concl. D. Commaret et rapp. Ferrari, Bull. crim. no 371, RSC 2001, p. 157, obs. Y. Mayaud, ibid. p. 372, obs. B. Bouloc [à propos de l’affaire de l’accident de la rivière du Drac : ni l’institutrice ni la directrice de l’école n’avaient commis, en l’espèce, une faute caractérisée car elles n’avaient pu envisager le risque auquel étaient exposés les élèves]; Crim. 18 juin 2002, Bull. crim. no 139, Dr. pénal 2002, comm. no 121, note M. Véron), à la suite d’accidents ayant entraîné des homicides ou blessures involontaires, en faisant une appréciation in concreto de la faute caractérisée (Crim. 18 mars 2003, Bull. crim. no 71, RSC 2003, p. 783, obs. Y. Mayaud; Crim. 10 juin 2008, Dr. pénal 2008, comm. no 123, note M. Véron). Ainsi, la chambre criminelle a-t-elle estimé qu’une cour d’appel n’avait pas justifié sa décision, dans la mesure où elle avait retenu la faute caractérisée à l’encontre d’un maire, « sans rechercher en quoi les diligences du prévenu n’étaient pas normales au regard de l’article 121-3, al. 3, du Code pénal, et adaptées aux risques prévisibles » (Crim. 18 juin 2002, Bull. crim. no 138). En s’appuyant donc sur les circonstances précises de différentes espèces, les juges répressifs n’hésitent pas à relaxer des maires en considérant qu’ils n’avaient commis qu’une simple faute de négligence susceptible d’engager leur responsabilité civile (Crim. 4 juin 2002, Bull. crim. no 127, RSC 2003, p. 127, obs. A. Giudicelli) mais non pénale. En revanche, la jurisprudence est beaucoup plus nuancée en ce qui concerne les médecins et les autres professionnels de santé. Dans certains cas, elle opte pour une appréciation in concreto, tandis que dans d’autres, pour une appréciation in abstracto. S’agissant du premier courant jurisprudentiel, on peut faire observer que la chambre criminelle a confirmé la décision d’une cour d’appel ayant condamné un médecin régulateur des appels du SAMU pour homicide involontaire, en retenant à son encontre une faute caractérisée. Pour ce faire, les juges répressifs ont tenu compte du fait que le praticien avait fait le choix d’envoyer au domicile du patient un médecin de quartier dépourvu des 194 137 195 > 195 L’infraction 195 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 moyens d’intervention nécessaires, plutôt que l’une des trois ambulances du service médical d’urgence alors disponibles (Crim. 2 déc. 2003, Bull. crim. no 226, RSC 2004, p. 344, obs. Y. Mayaud. V. aussi : Crim. 8 févr. 2011, Dr. pénal 2011, comm. no 61, note M. Véron; Crim. 1er oct. 2013, deux arrêts, Dr. pénal 2013, comm. no 168, note M. Véron; Crim. 21 janv. 2014, Dr. pénal 2014, comm. no 54, note M. Véron). Le prévenu avait donc fait « un mauvais choix » quant aux moyens employés, non justifié « eu égard à son expérience de praticien et aux informations qui lui étaient communiquées ». Néanmoins, la solution adoptée suscite des réserves, dans la mesure où les hauts magistrats n’ont pas pris soin de s’assurer de l’existence d’un lien de causalité entre la faute caractérisée imputée au prévenu et la mort du patient. Était-il certain que celle-ci aurait pu être évitée si le médecin avait fait le « bon choix » en envoyant au domicile du malade une ambulance du service d’urgence ? La Cour de cassation est restée discrète sur cette question. Mais, dans d’autres décisions, la jurisprudence adopte une conception plus objective, en se référant au modèle du « professionnel attentif » placé dans les mêmes circonstances. Ainsi, a-t-elle retenu la faute caractérisée d’un chirurgien, qui n’avait pas appliqué le « standard minimal des soins appropriés » à son patient (Crim. 23 févr. 2010, Dr. pénal 2010, comm. no 58, note M. Véron; v. aussi : Crim. 19 mai 2015, Dr. pénal 2015, comm. no 108, note M. Véron), ou du pharmacien d’officine qui avait omis d’analyser, « en méconnaissance des bonnes pratiques des préparations officinales et des recommandations du conseil de l’ordre », l’identité de la matière première qui lui avait été livrée (Crim. 1er avr. 2008, Bull. crim. no 88). Quant aux chefs d’entreprise, on sait qu’une jurisprudence ancienne n’hésitait pas à mettre à leur charge les délits d’homicide et de blessures involontaires (Crim. 4 déc. 1979, D. 1980. IR, p. 312) en se fondant sur la présomption d’une faute (Crim. 4 nov. 1964, Gaz. Pal. 1965. I. 80) commise par les intéressés. Concrètement, cette faute consistait en une négligence ou imprudence résultant du seul fait de la violation d’une disposition législative ou réglementaire par un préposé (Crim. 8 nov. 1983, Bull. crim. no 292). Ces solutions jurisprudentielles demeurent valables sous l’empire de la loi du 10 juillet 2000. En effet, dès lors qu’un accident survient, ayant entraîné des homicides ou des coups et blessures involontaires, le chef d’entreprise se voit imputer une faute caractérisée (Crim. 10 janv. 2001, Bull. crim. no 2; Crim. 16 janv. 2001, deux arrêts, Bull. crim. nos 14 et 15, RSC 2001, p. 572, obs. B. Bouloc, ibid. 2001, p. 579, obs. Y. Mayaud, ibid. 2001, p. 824, obs. G. Giudicelli-Delage; Crim. 5 oct. 2004, Bull. crim. no 235; Crim. 31 janv. 2006, JCP G 2006. II. 10079, note E. Dreyer; Crim. 9 juin 2009, Bull. crim. no 117; Crim. 29 juin 2010, Bull. crim. no 119) qui est constamment présumée, et qui permet, dans la plupart des cas, d’engager sa seule responsabilité pénale. Exemples jurisprudentiels. Un bilan jurisprudentiel fait apparaître que la plupart des décisions de condamnation rendues en la matière a pour fondement la faute caractérisée des prévenus, à qui il est reproché de n’avoir pas pris les mesures de sécurité et de prudence nécessaires pour éviter le résultat dommageable. Ainsi, s’est vu imputer une faute caractérisée l’instituteur qui, connaissant la dangerosité de la situation résultant de l’ouverture des fenêtres pour les enfants, n’avait pas pris, à leur arrivée dans la classe, les mesures de fermeture permettant d’éviter la chute d’un élève par la fenêtre (Crim. 6 sept. 2005, Bull. crim. no 218, RSC 2006, p. 62, obs. Y. Mayaud; v. aussi : Crim. 12 janv. 2010, 195 138 L’élément moral de l’infraction 196 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 Bull. crim. no 5 [la faute caractérisée a été retenue à l’encontre de l’enseignant d’un centre de formation, qui avait laissé, par suite d’un défaut de surveillance, un élève quitter l’établissement au volant de son véhicule, alors qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique]). De même, des fautes caractérisées ont été retenues à l’encontre d’un médecin qui s’était abstenu de vérifier personnellement le réel état du malade (Crim. 8 févr. 2011, Dr. pénal 2011, comm. no 61, note M. Véron; v. aussi : Crim. 1er oct. 2013, Dr. pénal 2013, comm. no 168, note M. Véron) ou d’un chef d’entreprise qui, ayant sous-traité l’exploitation d’un chantier, avait omis de transmettre au sous-traitant les consignes de sécurité élaborées par le maître d’ouvrage et de veiller à l’entretien des équipements de sécurité dont ladite entreprise avait conservé la charge (Crim. 5 déc. 2000, Bull. crim. no 363, RSC 2001, p. 372, obs. B. Bouloc, ibid. 2001, p. 379, obs. Y. Mayaud. V. aussi : Crim. 29 avr. 2014, Dr. pénal 2014, comm. no 103, note M. Véron [s’est vu imputer une « faute caractérisée » le vendeur de pizzas qui s’était reconverti dans la construction et l’équipement de navires de plaisance sans aucune connaissance en matière maritime]). Les limites à l’application de l’article 121-3, al. 4, du Code pénal. Alors que les person196 nes physiques, auteurs indirects de délits d’imprudence, ne peuvent engager leur responsabilité pénale qu’en cas de faute délibérée ou caractérisée, les personnes morales ne bénéficient pas des dispositions de l’article 121-3, al. 4, du Code pénal et peuvent donc voir leur responsabilité mise en jeu même pour une faute simple d’imprudence ou de négligence commise par un de leurs organes ou représentants (V. sur les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales, infra nos 280 et s.), bien que cette faute soit lointaine. Ainsi, a-t-il été décidé qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pouvait être recherchée, mais que la relaxe de la société n’était pas justifiée (Crim. 24 octobre 2000, Bull. crim. no 308, JCP G 2001. II. 10535, note M. Daury-Fauveau; v. aussi : Crim. 14 sept. 2004, Dr. pénal 2005, comm. no 11, note M. Véron). C’est qu’en effet il y avait eu, en l’espèce, manquement aux prescriptions d’un règlement, et les juges auraient dû rechercher si ce manquement ne résultait pas d’un défaut de surveillance ou d’organisation du travail imputable au chef d’établissement ou à son délégataire en matière de sécurité. La faute simple du dirigeant ou de la personne déléguée est donc susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale qui peut être considérée comme auteur indirect d’un homicide ou des blessures involontaires (Crim. 28 avr. 2009, Bull. crim. no 80, JCP G 2009, no 402, note J.-Y. Maréchal; Crim. 8 janv. 2013, Dr. pénal 2013, comm. no 55, 3e esp., note M. Véron). Sans aucun doute, on assiste ici à une situation étonnante où la personne morale doit répondre d’un agissement accompli par un organe ou un représentant déclaré comme non fautif ! Aussi bien, la différence de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales a servi de fondement à une question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester la conformité des dispositions de l’article 121-3, al. 4, du Code pénal aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi, d’égalité devant la justice et de garantie des droits découlant des articles 6 et 16 DDHC. Toutefois, la chambre criminelle a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel, car la question posée ne présentait pas « un caractère sérieux, dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Pour la Haute juridiction, « la différence de situation entre les personnes physiques et les personnes morales justifie 139 197 > 198 L’infraction § 197 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 la différence de traitement induite par l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, laquelle est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Crim. 21 mars 2017, no 17-90.003, QPC). Mais qu’il s’agisse des personnes morales ou des personnes physiques, les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal ne peuvent recevoir application dès lors qu’il s’agit d’une infraction qui ne comporte pas, parmi ses éléments constitutifs, la réalisation d’un dommage (V. à propos du délit de « publicité trompeuse » : Crim. 26 juin 2001, Bull. crim. no 160, Dr. pénal 2001, comm. no 143, note J.-H. Robert, RSC 2002, p. 98, obs. B. Bouloc). 3 Faute contraventionnelle La faute contraventionnelle résulte du seul fait de la violation d’une prescription législative ou réglementaire. Cette faute est présumée, le ministère public étant dispensé d’apporter la preuve de celle-ci. En principe, l’intéressé devrait pouvoir combattre cette présomption en démontrant qu’il n’a commis aucune faute, mais cette possibilité lui est refusée. Il en est ainsi pour la plupart des contraventions et autrefois pour certains délits (en matière économique), appelés pour cette raison « délits contraventionnels ». Certains auteurs ont fait remarquer qu’il s’agissait, dans ce cas, d’infractions purement matérielles, laissant entendre que l’élément matériel, joint à l’élément légal, suffit à constituer l’infraction. Ceci est inexact, les infractions en question comportent bien un élément moral, quoiqu’extrêmement mince. Il est vrai que, si la preuve de l’absence de faute n’a pas d’effet exonératoire, l’irresponsabilité sera toutefois acquise, s’il est établi que l’intéressé était en état de démence ou a agi sous la contrainte, c’est-à-dire s’il peut invoquer une des causes de non-imputabilité qui font disparaître l’élément moral. L’article 121-3, dernier al., du Code pénal confirme ce principe : « Il n’y a point de contravention en cas de force majeure » (sur la force majeure, v. infra, no 257). 197 section 2 Les degrés de l’élément moral § 198 1 La préméditation L’article 132-72 du Code pénal énonce : « La préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Elle est une circonstance entraînant l’aggravation des peines attachées à certaines infractions : le meurtre constitue, lorsqu’il est assorti de la préméditation, un « assassinat », puni de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 221-3 C. pén.), tandis que le meurtre simple n’est puni que de 30 ans de réclusion criminelle (art. 221-1 C. pén.) – les actes de torture ou de barbarie (art. 222-3-9° C. pén.) – les violences volontaires (art. 222-10-9°, 222-13-9° C. pén.). La préméditation est souvent établie par l’examen des faits antérieurs à la commission de l’infraction (repérage des lieux de commission, achat d’une arme ou d’outils d’effrac198 140 L’élément moral de l’infraction L’article 132-71 du Code pénal vise une certaine forme de préméditation : la « constitution de bande organisée », c’est-à-dire de « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs actes matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». Ainsi, a-t-il été jugé que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres (V. Crim. 8 juill. 2015, Dr. pénal 2015, comm. no 120, note Ph. Conte; Crim. 22 juin 2016, no 16-81.834). 199 19 – Cette circonstance entraîne l’aggravation des peines attachées à toute une série d’infractions (il s’agit d’une circonstance aggravante réelle qui, ayant trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été commise, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des coauteurs et complices : Crim. 11 janv. 2017, no 16-80.610) : trafic de stupéfiants (art. 222-35 et s. C. pén.), enlèvement ou séquestration de personnes (art. 224-5-2 C. pén.), proxénétisme (art. 225-8 C. pén.), vol (311-9 C. pén.), extorsion de fonds (312-6 C. pén.), escroquerie (313-2 C. pén.), recel (321-2 C. pén.), etc. On peut, par ailleurs, faire observer qu’un certain nombre d’infractions (meurtre, torture et actes de barbarie, crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien, crimes et délits d’enlèvement et de séquestration, etc.) commises en bande organisée relève de la criminalité et de la délinquance organisées (art. 706-73, 706-73-1 et 706-74 C. pr. pén.; v. supra, no 71). § 200 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 tion, par exemple). En tout cas, « le caractère impulsif et irraisonné des faits » permet d’écarter la circonstance aggravante de préméditation (Crim. 16 déc. 2014, Dr. pénal 2015, comm. no 49, note M. Véron [la rapidité et la violence de l’action survenue après un échange de regards entre l’auteur et la victime établissent clairement « le caractère irraisonné et impulsif des faits »]). 2 Le dol éventuel On considère qu’il y a dol éventuel, lorsque l’agent, sans vouloir expressément le résultat dommageable découlant de son action volontaire, a dû cependant (ou aurait dû) le prévoir comme « possible ». C’est le cas de l’armateur qui fait prendre la mer à un navire qu’il sait en très médiocre état (après avoir souscrit une forte assurance pour le bâtiment et sa cargaison). C’est aussi le cas de l’automobiliste qui double dangereusement des véhicules en coupant sciemment une « ligne continue » au sommet d’une côte. La majorité de la doctrine considère que le dol éventuel constitue une faute lourde d’imprudence, mais en tout cas non intentionnelle (B. Bouloc, Droit pénal général, 25e éd. Dalloz, 2017, no 288). Aussi bien, cette faute a été retenue par l’ancien Code pénal dans quelques textes visant de rares hypothèses : ainsi l’article 435 réprimait de lourdes peines la destruction ou la dégradation d’un objet ou d’un immeuble par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire « de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes » (v. art. 322-5 C. pén. sanctionnant les destructions ou dégradations dangereuses pour les personnes). En s’inspirant d’un certain nombre de législations étrangères qui répriment le « dol éventuel » en instituant des délits de « mise en danger d’autrui », les rédacteurs du nouveau Code pénal ont adopté des dispositions analogues. Tout d’abord, l’article 121-3, alinéa 2, du Code pénal dispose que : « Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». En outre, selon le 4e alinéa de la même disposition, inséré par la loi du 10 juillet 2000 (V. supra, 20 141 201 > 201 L’infraction 201 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 no 193), la responsabilité pénale des personnes physiques, n’ayant pas causé directement le dommage, mais ayant créé la situation qui a permis la réalisation de ce dommage, ne peut être retenue que « s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». La faute « délibérée » et la faute « caractérisée », visées par cette disposition, constituent des nouvelles formes de dol éventuel (V. aussi supra, nos 192 et s.). Ensuite, les articles 223-1 et suivants du Code pénal sanctionnent des « mises en danger de la personne d’autrui », dont certaines s’apparentent au dol éventuel. Tel est « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence… », réprimé par l’article 223-1 du Code pénal. Dès lors, la question qui se pose ici est celle de savoir quelle est la véritable nature du délit de risques causés à autrui. S’agit-il d’un délit intentionnel ou d’imprudence ? Une telle question a reçu des réponses différentes de la part de la Cour de cassation. Celle-ci a, d’abord, décidé que l’article 223-1 du Code pénal « n’exige pas que l’auteur du délit ait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement » (Crim. 16 févr. 1999, Bull. crim. no 24, Dr. pénal 1999, comm. no 82, note M. Véron, RSC 1999, p. 581, obs. Y. Mayaud). Même si une telle déclaration manque de clarté, il est permis de penser que la formule employée par la chambre criminelle consacre la thèse du délit d’imprudence. Puis, la Haute juridiction a mis fin à toute incertitude en optant clairement pour le caractère intentionnel du délit. Ainsi, a-t-elle affirmé que « l’élément intentionnel de l’infraction résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui » (Crim. 9 mars 1999, Bull. crim. no 34, RSC 1999, p. 581, obs. Y. Mayaud, ibid. 1999, p. 808, obs. B. Bouloc; Crim. 1er juin 1999, Gaz. Pal. 1999. 2. chron. crim. 143). Il appartient donc aux juges du fond d’établir, à partir des circonstances précises de chaque espèce, « le caractère manifestement délibéré de la violation de l’obligation » (Crim. 16 oct. 2007, Bull. crim. no 246, Dr. pénal 2008, comm. no 3, note M. Véron). À vrai dire, cette position jurisprudentielle suscite des réserves, car le délit de risques causés à autrui sanctionne, en réalité, une hypothèse du « dol éventuel ». L’auteur, en transgressant volontairement une disposition législative ou réglementaire lui imposant une obligation de prudence ou de sécurité (v. Crim. 22 sept. 2015, JCP G 2015, no 1284, note H. Matsopoulou, Dr. pénal 2015, comm. no 157, note Ph. Conte [il appartient aux juges répressifs de rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée de façon manifestement délibérée]), pourrait prévoir comme possible la réalisation d’un dommage corporel grave, sans avoir pour autant l’intention de le provoquer. L’infraction est donc non intentionnelle par rapport au résultat qu’elle tend à prévenir (la production d’un dommage corporel). En revanche, elle peut être considérée comme intentionnelle en ce qui concerne l’exposition à un risque. C’est qu’en effet, la violation consciente, par l’agent, d’une prescription législative ou réglementaire implique sa volonté de créer un risque pour autrui. Sous cet aspect, le délit peut alors paraître intentionnel, ce qui justifie, pour partie, la position de la jurispru201 142 L’élément moral de l’infraction § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 dence. Il est, en tout cas, regrettable que celle-ci ne soit pas allée jusqu’au bout de son analyse et n’ait pas envisagé la nature de l’infraction en tenant compte de la probabilité de la survenance du résultat, ce qui aurait laissé une place importante au dol éventuel. Enfin, la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement constitue une circonstance aggravante des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de la personne. Ainsi, l’article 221-6, al. 2, du Code pénal dispose qu’en « cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence… », les peines encourues du chef d’homicide involontaire sont aggravées; l’article 222-19, al. 2, prévoit également une aggravation des peines en cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois, si celle-ci procède d’une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence… ». Des dispositions analogues figurent aussi dans les articles 222-20 et R. 625-3 du Code pénal (V. aussi : art. 2216-1, 222-19-1, 222-20-1 C. pén., sanctionnant les délits d’homicide et de blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule). 3 Le dol indéterminé, le délit praeterintentionnel 202 Dans le dol indéterminé, l’agent, tout en recherchant un résultat, n’a pas voulu de façon précise le résultat dommageable obtenu; le dol est encore dit indéterminé lorsque l’indétermination porte sur l’identité de la victime. Dans la première hypothèse – illustrée par les suites possibles d’un coup de poing porté au visage de la victime (banale ecchymose sans incapacité, ou énucléation, voire mort de la victime) – la peine est généralement proportionnée par la loi à la gravité du préjudice subi par la victime. Ainsi, les auteurs de violences volontaires, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, encourent 10 ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros (art. 222-9 C. pén.); si les violences ont seulement entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, la peine est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 222-11 C. pén.); si les violences ont entraîné une incapacité de travail d’une durée inférieure ou égale à 8 jours, l’auteur encourt (sous réserve de l’éventuelle application de circonstances aggravantes) les peines attachées aux contraventions de la 5e classe (art. R. 625-1 C. pén.). Dans la seconde hypothèse, (c’est-à-dire lorsque l’indétermination porte sur l’identité de la victime), la répression s’exerce sans égard à cette simple circonstance de fait. 203 On donne le nom de délit praeterintentionnel à l’infraction constituée par un acte intentionnel, dont les résultats ont totalement dépassé le but recherché par l’agent. Ainsi, en est-il des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, que l’article 222-7 du Code pénal punit de 15 ans de réclusion criminelle, alors que le meurtre, qui est le fait de donner volontairement la mort à autrui, est puni de 30 ans de réclusion criminelle (art. 221-1 C. pén.). 202 203 143 Chapitre 4 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 L’essentiel Toute infraction comporte un élément moral. Cet élément est nécessaire pour que l’agissement délictueux puisse être imputé à son auteur. C’est qu’en effet, pour que la responsabilité pénale de ce dernier puisse être engagée, il faut qu’il ait commis une « faute ». Le droit pénal repose, au moins en ce qui concerne la culpabilité, sur l’hypothèse du libre arbitre. Cela signifie que l’agent doit avoir agi librement ou consciemment. L’élément moral n’est pas le même pour toutes les infractions. Dès lors, il convient de préciser, d’une part, les différentes formes et, d’autre part, les degrés de l’élément moral. 1. Les formes de l’élément moral Au sommet de l’échelle se trouve la faute intentionnelle, appelée parfois « intention criminelle » ou « dol ». Il y a faute intentionnelle, lorsque l’auteur de l’acte a voulu pleinement tout à la fois son acte et le résultat obtenu ou tout au moins recherché. Dans certains cas, le législateur souligne l’existence d’une faute intentionnelle pour incriminer un agissement; il emploie dans la définition de l’infraction les termes « sciemment », « frauduleusement », « de mauvaise foi », « volontairement » ou d’autres expressions analogues. Tous les crimes et la plupart des délits sont des infractions intentionnelles. L’intention criminelle ne doit pas être confondue avec le mobile, c’est-à-dire le motif qui a incité l’agent à commettre l’infraction. En principe, le mobile est juridiquement indifférent et n’a pas d’incidence légale sur la qualification et la répression de l’infraction. Ainsi, le vol commis dans un but philanthropique demeure punissable. Cependant, les tribunaux tiennent, parfois, compte du mobile, en vue de déterminer la peine applicable. En outre, certains textes prennent, exceptionnellement, en considération le but poursuivi par l’agent; ce que certains auteurs appellent le « dol spécial ». Ainsi, les actes de terrorisme doivent avoir « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur », tandis que le délit de diffamation exige la volonté de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Au-dessous de la faute intentionnelle, la loi retient, dans certains cas, la faute d’imprudence ou de négligence. Aussi bien, l’article 121-3, alinéa 3, du Code pénal dispose qu’« il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou 144 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 de sécurité prévue par la loi ou le règlement… ». Ce texte s’applique aux auteurs de délits d’imprudence ayant directement causé le dommage; on parle, en pareil cas, des auteurs directs ou d’un lien de causalité direct. Dans cette hypothèse, la simple faute d’imprudence ou de négligence de l’agent est suffisante pour engager sa responsabilité pénale. Toutefois, celle-ci ne devra être retenue que s’il est établi que l’auteur n’a pas effectué les diligences normales, compte tenu « de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». La faute pénale d’imprudence ou de négligence doit être appréciée in concreto, et non in abstracto. En outre, l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, inséré par la loi du 10 juillet 2000, prévoit que les personnes physiques, qui n’ont pas causé directement le dommage, mais ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont commis une faute délibérée ou caractérisée. Il en résulte donc que, lorsque le lien de causalité est indirect, les fautes (lointaines) commises ne peuvent être retenues que si elles sont graves ou lourdes. Contrairement à la jurisprudence antérieure qui adoptait la théorie de l’équivalence des conditions (toute faute pouvait engager la responsabilité de son auteur, dès lors qu’elle avait contribué à la réalisation du dommage), la nouvelle formule législative incite les juges répressifs à faire application de la théorie de la causalité adéquate; seule une faute délibérée ou caractérisée peut engager la responsabilité pénale d’un auteur indirect. En ce qui concerne la faute délibérée, il s’agit de la violation, en pleine connaissance de cause, d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par un texte législatif ou réglementaire. En réalité, cette faute ne constitue qu’une forme de dol éventuel; dans cette hypothèse, l’agent, sans chercher à provoquer un dommage précis, reste indifférent à sa survenance. Quant à la faute caractérisée, elle peut être définie : – soit comme une faute lourde d’imprudence ou de négligence qu’un professionnel avisé ne commet pas; – soit comme « une série de négligences et d’imprudences qui entretiennent chacune un lien de causalité certain avec le dommage, et dont l’accumulation permet d’établir l’existence d’une faute (…) d’une particulière gravité dont ses auteurs ne pouvaient ignorer les conséquences ». Cette faute doit également être établie par les juridictions répressives, qui doivent tenir compte des critères visés à l’article 121-3, alinéa 3, du Code pénal (nature des missions ou fonctions, compétences et moyens). D’une manière générale, il est permis de constater que la jurisprudence, rendue sous l’empire de la loi du 10 juillet 2000, semble mettre un terme à la présomption de responsabilité pesant sur les élus et agents publics ou fonctionnaires, à la suite d’accidents ayant provoqué des homicides ou des blessures involontaires. Néanmoins, les personnes morales sont exclues du bénéfice de cette faveur législative et peuvent donc voir leur responsabilité pénale engagée pour une faute simple, fût-elle lointaine, commise par leurs organes ou représentants. Enfin, il existe la faute contraventionnelle résultant du seul fait de la violation d’une prescription législative ou réglementaire. Cette faute est présumée, le ministère public étant dispensé d’apporter la preuve de celle-ci. 145 Ces précisions données, il convient de se demander quels sont les différents degrés de l’élément moral. 2. Les degrés de l’élément moral international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 Il s’agit, tout d’abord, de la préméditation définie à l’article 132-72 du Code pénal. Celle-ci « est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». La préméditation est une circonstance entraînant l’aggravation des peines attachées à certaines infractions. Tel est le cas du meurtre qui constitue, lorsqu’il est assorti de la préméditation, un « assassinat », puni de la réclusion criminelle à perpétuité. On pourra, ensuite, retenir le dol éventuel. Dans la présente hypothèse, l’agent, sans vouloir expressément le résultat dommageable découlant de son action volontaire, a dû cependant (ou aurait dû) le prévoir comme « possible ». Tel est le cas de l’armateur qui fait prendre la mer à un navire qu’il sait en très médiocre état. La majorité de la doctrine considère que le dol éventuel constitue une faute lourde d’imprudence, mais en tout cas non intentionnelle. La faute délibérée et la faute caractérisée constituent des formes de dol éventuel. Par ailleurs, les articles 223-1 et s. du Code pénal sanctionnent des mises en danger de la personne d’autrui, dont certaines s’apparentent au dol éventuel. Enfin, il est permis de distinguer le dol indéterminé et le délit praeterintentionnel. Dans le dol indéterminé, l’agent, tout en recherchant un résultat, n’a pas voulu de façon précise le résultat dommageable obtenu; le dol est encore indéterminé lorsque l’indétermination porte sur l’identité de la victime. Dans la première hypothèse, la peine est généralement proportionnée par la loi à la gravité du préjudice subi par la victime. Tel est le cas des atteintes volontaires à l’intégrité physique. Dans la seconde hypothèse (c’est-à-dire lorsque l’indétermination porte sur l’identité de la victime), la répression s’exerce sans égard à cette simple circonstance de fait. Quant au délit praeterintentionnel, il s’agit de l’infraction constituée par un acte intentionnel, dont les résultats ont totalement dépassé le but recherché par l’agent. Ainsi, en est-il des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 146 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 Sujets de concours Chapitre 4 Greffier, concours interne et externe, 2009 L’élément moral de l’infraction Magistrat, 2005 La causalité en droit pénal Sous-directeur de l’Administration pénitentiaire, concours externe et interne, 2001 Les délits non intentionnels Magistrat, 2012 La faute et les délits non intentionnels Lieutenant pénitentiaire, 2013 L’intention, facteur de responsabilité dans la constitution de l’infraction pénale Officier de police, concours externe, 2014 Les infractions non intentionnelles 147 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 5 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 chapitre Les causes de non-responsabilité 204 Pour qu’une personne puisse être déclarée coupable d’une infraction, il faut qu’elle ait accompli l’action prohibée en ayant conscience de l’interdiction légale. Or, dans certains cas, elle peut ne pas avoir voulu violer la loi, en raison d’un trouble l’atteignant ou des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à agir. La responsabilité se distingue de l’imputabilité, hypothèse dans laquelle on impute un acte délictueux précis à une personne déterminée. L’imputabilité requiert une conscience minimale chez l’agent (ainsi, on ne saurait imputer une infraction à un dément). Elle se différencie aussi de la culpabilité qui exige une « faute volontaire » ou « d’imprudence » commise par l’auteur des faits. Concrètement, le Code pénal déclare non pénalement responsables des personnes pouvant se prévaloir des causes extérieures à elles, qui enlèvent à leur acte tout caractère délictueux; ce sont les faits justificatifs. Il en est de même des individus qui peuvent invoquer des causes tenant à eux-mêmes, faisant disparaître l’élément moral de l’infraction; ce sont les causes de non-imputabilité. Enfin, le Code pénal traite du cas des mineurs à l’article 122-8. 204 section 1 Les faits justificatifs 205 Un fait normalement puni par la loi doit être considéré comme objectivement légitime, lorsqu’il apparaît comme l’exercice d’un droit ou comme l’accomplissement d’un devoir. L’acte, qui présente toutes les apparences d’une infraction punissable, cesse d’en être une en raison des circonstances dans lesquelles il a été accompli. On appelle de telles circonstances des faits justificatifs. Ceux-ci se distinguent des autres causes d’impunité en raison de leur caractère objectif qui supprime l’élément délictueux de l’acte accompli. 205 149 206 > 207 L’infraction – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889280361:88866209:196.200.176.177:1592998478 L’impunité procède donc ici d’une cause d’irresponsabilité, de la disparition de l’incrimination, c’est-à-dire de l’élément légal. Elle ne doit pas être confondue avec celle qui résulte des causes de non-imputabilité qui sont subjectives et personnelles, ni avec les causes d’exemption ou d’atténuation de la peine encourue prévues par le Code pénal, simples mesures de politique criminelle qui laissent intactes la criminalité des faits et la responsabilité civile de leur auteur. Ainsi en est-il de l’exemption de peine dont bénéficie celui qui : ayant participé à un complot, révèle, avant toute poursuite, ce dernier aux autorités et permet l’identification de ses auteurs (art. 414-2 et 414-3 C. pén.) – ayant tenté de commettre un acte de terrorisme, avertit les autorités permettant « d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » (art. 422-1 C. pén.) – ayant tenté de commettre un crime de fausse monnaie, avertit les autorités, permettant d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les autres participants (art. 442-9 C. pén.) – ayant participé à une association de malfaiteurs, révèle, avant toute poursuite, « le groupement ou l’entente » consommant l’infraction aux autorités et permet l’identification des autres membres de l’association (art. 450-2 C. pén.). À noter encore les dispositions de l’article 222-43 du Code pénal, selon lesquelles la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un trafic de stupéfiants est réduite de moitié s’il avertit les autorités permettant ainsi de « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables ». La loi no 2004-204 du 9 mars 2004 a multiplié les causes d’exemption ou de réduction de peine pouvant jouer en faveur des personnes ayant permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé ou d’identifier les auteurs ou complices (art. 132-78 C. pén.). Ainsi, toute personne, qui a tenté de commettre des actes de torture ou de barbarie, est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction. Dans le même cas, la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est réduite de moitié, si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que celle-ci n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente (art. 222-6-2 C. pén.) Par ailleurs, la loi no 20131117 du 6 décembre 2013 a institué une cause de réduction de peine en matière de corruption (v. pour la corruption passive : art. 432-11-1, 434-9-2, 435-6-1, 435-11-1; pour la corruption active : art. 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1, 435-11-1) et de trafic d’influence (art. 432-11-1, 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1); en particulier, la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice peut être réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. – Enfin, les faits justificatifs ne doivent pas être confondus avec les immunités (diplomatique, parlementaire, familiale) (Sur la comparaison des principales causes d’impunité, v. infra, Tableau II, p. 177). 206 La loi a prévu trois faits justificatifs : la légitime défense (art. 122-5 et 122-6 C. pén.) – l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime, sauf si l’acte commandé est manifestement illégal (art. 122-4 C. pén.) – l’état de nécessité (art. 122-7 C. pén.). En dehors des faits justificatifs prévus par la loi, la jurisprudence en a créé un autre, celui tiré de l’« exercice des droits de la défense ». Enfin, certains auteurs se demandent si le consentement de la victime pourrait être une cause d’irresponsabilité pénale. 206 § 207 1 La légitime défense L’article 122-5 du Code pénal énonce : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de 207 150 Les causes de non-responsabilité A. Domaine d’application international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ». Cet article constitue une apparente exception au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même. En raison de l’urgence et de l’impossibilité matérielle de se faire défendre par la police, la loi a permis aux particuliers de se substituer en quelque sorte, dans les circonstances précisées ci-dessus, à celle-ci. Cette interprétation donnée à l’article 122-5 du Code pénal permet de résoudre des questions controversées, aussi bien quant au domaine d’application de la légitime défense que quant à ses conditions et à ses effets, questions que les rédacteurs du nouveau Code pénal se sont efforcés d’éclaircir. 208 Des dispositions du premier alinéa de l’article 122-5 du Code pénal, il ressort que le bénéfice du fait justificatif de la légitime défense requiert que la personne, qui s’en prévaut, ait été confrontée « à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui ». Le terme « atteinte » vise, à l’évidence, toutes les agressions contre la vie ou l’intégrité corporelle (par exemple violences volontaires), mais aussi les agressions sexuelles (cas de viol), voire les atteintes à l’honneur ou à la considération d’une personne (pour une légitime défense en matière de diffamation : T. corr. Paris 25 oct. 1971, RSC 1972, p. 396, no 5-IV, obs. Levasseur). 209 Les dispositions du second alinéa de l’article 122-5 du Code pénal consacrent expressément le principe, jusqu’alors parfois discuté, de la légitime défense des biens. Aussi bien, l’article 122-6 du Code pénal accorde une présomption de légitime défense à celui qui « se défend contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence » (V. infra, no 217). Toutefois, il est permis de faire observer : qu’une atteinte aux biens ne peut justifier l’homicide volontaire de l’agresseur; que le fait justificatif n’est pas reconnu si les moyens employés ne sont pas « proportionnés à la gravité de l’infraction » (art. 122-5, al. 2, C. pén.). Or, tel est le cas, lorsqu’une personne en frappe une autre, parce qu’elle avait donné un coup de pied dans la carrosserie de son véhicule (CA Toulouse, 24 janv. 2002, Dr. pénal 2002, comm. no 52). La légitime défense des biens soulève le délicat problème de la mise en œuvre des pièges contre les personnes, qui a donné lieu à une abondante jurisprudence. En principe, la licéité du procédé n’est pas admise (T. corr. Troyes, 24 mai 1978 et CA Reims 9 nov. 1978, JCP G 1978. II. 19046, note Bouzat et obs. Levasseur in RSC 1979, p. 329, au sujet d’un transistor piégé). En l’occurrence, les tribunaux correctionnels saisis, de façon critiquable, du chef d’homicide involontaire condamnent le plus souvent les individus ayant recours à de telles pratiques, tandis que les cours d’assises rendent fréquemment des verdicts d’acquittement. À vrai dire, dans ces hypothèses, il est parfois difficile de distinguer entre la légitime défense de la personne et celle des biens, l’action de l’agent visant à la fois l’individu lui-même et une chose lui appartenant. C’est qu’en effet, l’agression, dont il 208 209 151 210 > 211 L’infraction sera par la suite établi qu’elle n’était dirigée que « contre un bien », peut avoir été perçue par la victime comme une grave menace à son intégrité corporelle… Lorsqu’un voleur est surpris par une personne en train de fracturer son armoire, la victime, en l’absence de forces de police, a les pouvoirs qu’aurait un policier. Elle peut procéder elle-même à l’arrestation du voleur, au besoin par la force, tout comme le policier l’aurait fait (V. art. 73 C. pr. pén.), mais elle n’a évidemment pas le droit de l’abattre, à moins que l’attitude du voleur ait été telle que sa victime ait pu croire que sa vie, ou, pour le moins, son intégrité corporelle, était en danger (V. infra, nos 211 et s.). Enfin, la jurisprudence a limité l’application de la légitime défense aux seules infractions volontaires, en affirmant que ce fait justificatif « est inconciliable avec le caractère involontaire d’une infraction » (Crim. 28 nov. 1991, RSC 1993, p. 90, obs. Bouloc; cf. cependant : Crim. 21 févr. 1996, Bull. crim. no 84). 210 B. Conditions international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 210 Elles concernent les unes l’acte d’attaque, les autres l’acte de riposte. 1° L’attaque qui provoque la riposte doit être actuelle ou imminente 211 Si l’on est en présence d’une simple menace et s’il est possible de prévenir la police pour conjurer le péril, on ne saurait arguer de la légitime défense et se faire justice à soi-même. L’attaque peut n’être que vraisemblable dans l’esprit du prévenu, compte tenu de ce que la situation lui permet d’imaginer normalement. En d’autres termes, la personne agressée ne peut s’en remettre, pour apprécier le danger, qu’aux apparences. Ainsi, l’article 132-75 du Code pénal disposant qu’est « assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa (“est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser”) une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser… », il ne fait pas de doute que la personne menacée par une arme factice, une quasi-arme, peut se prévaloir de la légitime défense (T. corr. Lyon, 16 juill. 1948, D. 1948, p. 550). Il en est de même de celle qui est menacée par un individu brandissant en sa direction un pistolet automatique, dont il sera établi ultérieurement qu’il était non approvisionné ou hors d’usage. La notion de légitime défense « putative » permet de considérer que l’auteur d’un acte prohibé par la loi pénale peut se prévaloir des dispositions de l’article 122-5 du Code pénal lorsqu’il a pu légitimement penser être l’objet d’une attaque (Crim. 14 févr. 1957, Bull. crim. no 155; Crim. 20 oct. 1993, Gaz. Pal. 1994. 1. somm. 16 ; Crim. 8 juill. 2015, no 15-81.986, Dr. pénal 2015, comm. no 138, note Ph. Conte). Dans cette hypothèse, il faut toutefois que la réaction de l’intéressé soit celle d’un « homme moyen » ou d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Le juge pénal doit aussi tenir compte de ce que celui qui a été agressé et se réclame de la légitime défense se trouve sous le coup de l’émotion causée par l’agression, et de l’interprétation naturelle qu’il peut donner de l’attitude de l’agresseur (V. au sujet d’un forcené abattu par un brigadier de police pouvant « craindre pour sa vie et celle des autres personnes présentes », Crim. 20 avr. 1982, JCP G 1983. II. 19958). Ainsi, a agi en état de légitime 21 152 Les causes de non-responsabilité 2° L’attaque doit être injuste 212 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 défense le policier qui, ayant interpellé un individu inscrit au fichier du banditisme, a ouvert le feu et blessé aux jambes cette personne, alors que celle-ci avait une attitude pouvant laisser penser qu’elle se préparait à user d’une arme (Lyon, Ch. acc., 16 déc. 1986, Gaz. Pal. 20 mai 1987, somm. p. 17; v. aussi : Crim. 16 juill. 1986, D. 1988. 390 [1re esp.]). Il en est de même de l’employeur d’un établissement, qui, dans un climat de peur, d’abord nourri par l’irruption des cambrioleurs en pleine nuit puis exacerbé par la frayeur ressentie au moment où le véhicule de ces derniers avait foncé sur lui, avait tiré un coup de feu ayant mortellement blessé l’un des cambrioleurs. En l’espèce, la « riposte » a été considérée comme proportionnée à l’attaque dont il pouvait légitimement penser faire l’objet (Crim. 8 juill. 2015, no 15-81.986, précité). L’appréciation du caractère actuel de la défense appartient aux juridictions répressives. Il n’y a pas de légitime défense contre celui qui ne fait qu’exercer un droit. La résistance opposée au policier qui procède à une arrestation, à une perquisition en cas de flagrance ou à la dispersion d’un attroupement, par exemple, n’entre pas dans la légitime défense. La légalité de l’action de police étant parfois contestée en l’occurrence, il importe de rappeler que selon la jurisprudence, l’illégalité d’un acte accompli par un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, à la supposer établie, ne saurait entraîner la nullité des poursuites pour des faits de rébellion commis contre cet agent à l’occasion de l’opération litigieuse (Crim. 1er sept. 2004, Bull. crim. no 190, Dr. pénal 2004, comm. no 164, note A. Maron [à propos d’un contrôle d’identité]; v. en ce sens, Crim. 7 févr. 1995, Bull. crim. no 51, Dr. pénal 1995, comm. no 156, note A. Maron, RSC 1996, p. 133, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire [« le délit de rébellion ne saurait être excusé à raison de la prétendue illégalité de l’acte accompli par l’agent »]). Une telle position peut se comprendre puisque les actes des agents publics bénéficient, de manière générale, d’une présomption de légalité; il appartient, par conséquent, à ceux qui s’en prétendent victimes d’exercer toutes les voies de recours offertes par la loi pour contester la régularité de tels actes. Il semble toutefois qu’une dérogation doit être admise au cas où le caractère illégal de l’acte serait manifeste. Ainsi, la résistance pourrait-elle être considérée comme légitime lorsque l’agent agit motu proprio, hors de l’exercice de ses fonctions (Crim. 25 mars 1852, Bull. crim. no 108; v. aussi : CA Reims, 18 mai 1984, JCP G 1985. II. 20422, note P. Chambon, RSC 1985, p. 69, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire) ou commet de véritables abus dans l’exercice de celles-ci (par exemple des actes de séquestration; Crim. 20 oct. 1993, Dr. pénal 1994, comm. no 34, note M. Véron [en l’espèce, il a été admis que la victime du comportement abusif d’un huissier puisse faire usage d’une bombe lacrymogène, ce qui constituait un acte de légitime défense]). 212 3° La riposte doit être nécessaire 213 Elle est considérée comme nécessaire, même dans l’hypothèse où la personne agressée a d’autres moyens que la commission de l’infraction, pour se défendre contre l’attaque (par exemple, elle peut prendre la fuite). Cette solution paraît justifiée, dans la mesure où la légitime défense apparaît comme l’exercice d’un droit ou comme l’accomplissement d’un devoir (V. supra, no 205). 213 153 214 > 215 L’infraction 4° La riposte doit être proportionnée à l’attaque La riposte doit être proportionnée à l’attaque, ainsi que le précise désormais l’article 122-5 du Code pénal. Si la défense est démesurée par rapport à la gravité de l’agression, l’acte ne se trouve plus justifié. La peine qu’il fait encourir à son auteur pourra être diminuée par le juge, mais le Code pénal a supprimé l’excuse de provocation qui avait pour effet de limiter très sensiblement le maximum de la peine encourue. En outre, la légitime défense des biens ne saurait justifier un homicide volontaire (V. supra, no 209). La question de la proportionnalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges répressifs. Ainsi, ceux-ci ont estimé que les coups de bâton commis par un prévenu en riposte à un jet de gaz lacrymogène étaient manifestement disproportionnés à l’attaque, compte tenu de la gravité des blessures infligées aux victimes (CA Paris 12 oct. 1999, Dr. pénal 2000, comm. no 29; v. aussi : Crim. 7 déc. 1999, Bull. crim. no 292, RSC 2000, p. 602, obs. B. Bouloc). De même, il a été jugé que n’est pas en état de légitime défense l’individu qui tire deux coups de feu dans la cuisse d’un agresseur sans arme, qui ne s’est pas laissé impressionner par un premier tir d’avertissement (Crim. 26 juin 2012, Dr. pénal 2012, comm. no 139, note M. Véron). En revanche, un léger coup de pied dans la jambe d’une élève, qui insultait grossièrement et projetait son cartable dans la direction de son professeur, a été considéré comme proportionné à l’agression subie par l’enseignant (Crim. 18 juin 2002, Dr. pénal 2002, comm. no 134, note M. Véron). A également accompli un acte de légitime défense, le fils qui a tué le conducteur d’un véhicule, qui menaçait de reprendre la route alors que son père se trouvait à terre, une de ses jambes happée par ce véhicule (Crim. 24 févr. 2015, Dr. pénal 2015, comm. no 65, note M. Véron). En l’espèce, la personne poursuivie n’a accompli qu’« un acte nécessaire à la protection de son père en danger de mort »; « il n’existait aucune disproportion entre la gravité de l’atteinte commise par l’agresseur et les moyens de défense employés […], pour l’interrompre, l’empêcher ou y mettre fin » (v. aussi : Crim. 9 févr. 2010, no 0981.399). Selon la jurisprudence, « la notion de proportionnalité ne doit être appréhendée qu’entre l’atteinte injustifiée et l’acte commandé par la légitime défense et nullement, […] entre le mal que l’on cherchait à éviter et le préjudice effectif » (Crim. 10 oct. 2007, no 06-88. 426). Les juges répressifs ont également précisé que le caractère proportionné de la riposte ne doit s’apprécier qu’en considération « des moyens de défense employés, peu important […] le résultat de l’action ». Cela signifie donc que l’appréciation de la proportionnalité doit se faire indépendamment du résultat de la riposte (Crim. 17 janv. 2017, no 15-86.481, Dr. pénal 2017, comm. no 54, note Ph. Conte, JCP G 2017, no 410, note P.-J. Delage [en l’espèce, l’agressé, « contraint de se défendre et de riposter pour éviter de recevoir d’autres coups », avait porté un coup de poing à son agresseur, lequel avait fait une chute entraînant sa paraplégie]). 214 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 214 5° La riposte doit être concomitante à l’attaque Si le mal a déjà été accompli et si le danger a cessé, la violence privée est condamnable. La défense est légitime mais la vengeance ne l’est pas. 215 215 – Sortant de sa maison, un homme s’était trouvé face à un individu qui avait tenté en vain de tirer sur lui avec une arme qui s’était enrayée. La victime de cette attaque rentrait alors chez elle, y chargeait un fusil et revenait sur son agresseur qu’elle blessait. La cour d’appel de Paris a vu dans les faits 154 Les causes de non-responsabilité international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 une « très grave provocation », mais, considérant que le danger n’était plus « imminent » lors de la riposte, a refusé d’admettre la légitime défense (CA Paris 22 juin 1988, D. 1988. IR., p. 244). La Cour de cassation a confirmé cet arrêt (Crim. 26 sept. 1989, Dr. pénal 1990, no 125). – Quid de l’usage des armes, et en particulier des armes à feu, pour « stopper » un tel agresseur dans sa fuite ? La victime d’une tentative de vol, commise dans une maison habitée, la nuit et par effraction, ayant tiré de la fenêtre de sa chambre à l’étage dans la direction des auteurs de cette tentative alors qu’ils prenaient la fuite (et ayant blessé grièvement l’un d’eux), la chambre criminelle a jugé que l’article 73 du Code de procédure pénale permet à celui qui s’en prévaut de s’assurer de la personne du délinquant, afin de le remettre à l’officier de police judiciaire le plus proche, non pas de l’abattre (Crim. 11 mai 1995, Minet, inédit), (V. infra, no 678). 6° La riposte est justifiée pour repousser toute agression La riposte est justifiée non seulement pour repousser l’agression dont on est soimême victime, mais encore celle dont un tiers quelconque est victime (et un policier a le devoir d’intervenir en l’occurrence). 216 216 C. Cas privilégiés de légitime défense La jurisprudence décide que c’est à celui qui invoque la légitime défense qu’il appartient de prouver que les conditions de celle-ci s’appliquent à l’acte reproché. À ce principe, l’article 122-6 du Code pénal (reprenant sensiblement les dispositions de l’article 329 de l’ancien code) apporte deux exceptions en énonçant : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». Dans les deux hypothèses, la légitime défense est présumée, mais il faut observer que, de jurisprudence désormais constante, il s’agit d’une présomption simple, non irréfragable. Cela signifie que, si la preuve est apportée que celui qui invoque la légitime défense savait qu’il ne s’agissait pas d’une agression contre son intégrité corporelle ou contre ses biens (et qu’il ne courait donc aucun danger), le bénéfice de ce fait justificatif ne lui sera pas accordé (Crim. 19 févr. 1959, D. 1959, 161 et JCP 1959. II. 11112, note critique Bouzat; Crim. 20 déc. 1983, JCP 1984. IV. 68; Crim. 11 mai 1995, Gaz. Pal. 1995. 2. somm. 443). 217 217 Il est vrai que, dès le XIXe siècle, alors que la chambre criminelle se prononçait en faveur du caractère absolu de la présomption ici évoquée (11 juill. 1844, S. 1844. 1. 778), des arrêts de mise en accusation saisissaient des cours d’assises de faits illustrant les graves inconvénients découlant d’une telle interprétation de la loi. Ainsi, la comtesse de Jeufosse, ayant fait abattre par son garde-chasse un ami de sa fille qui venait, par escalade du mur de clôture du parc, porter à celle-ci un « billet doux » (ce que ladite comtesse n’ignorait pas), fut-elle traduite en cour d’assises (qui l’acquitta), (C. assises Évreux 10 déc. 1857). À la même époque, on poursuivit (mais on acquitta) des maris qui avaient tué non pour se défendre mais pour venger un honneur conjugal menacé. – L’arrêt Reminiac, rendu par la chambre criminelle le 19 février 1959 (Bull. crim. no 121; [« La présomption de légitimité résultant de l’article 329 du Code pénal n’est pas absolue »]), et confirmé par d’autres décisions ultérieures (v. par ex., Crim. 20 déc. 1983, no 83-94.077), a mis fin à la discussion : la présomption de légitime défense de l’article 329 de l’ancien Code pénal (aujourd’hui de l’article 122-6 du Code pénal) n’est pas irréfragable. Comme la doctrine l’a fait observer, « l’effraction et l’escalade nocturnes ne sauraient, à elles seules, justifier ni l’homicide ni les blessures quand il est – 155 218 > 220 L’infraction D. Effets de la légitime défense international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 établi que celui qui a tué ou blessé savait que sa vie ou celle des siens n’était pas menacée » (B. Bouloc, Droit pénal général, op. cit., no 431). En d’autres termes : « la présomption légale, loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve du contraire ». L’article 122-5 du Code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne » qui agit en état de légitime défense. Des poursuites contre celui qui se défendait ne seront pas engagées et, si elles l’ont été, elles se termineront par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement total. L’acte accompli était, en effet, un acte licite. Aucune mesure de sûreté ne peut intervenir (contrairement à ce qui peut se passer dans l’hypothèse d’une cause de non-imputabilité ou d’exemption de peine); l’auteur n’est pas dangereux, il a au contraire rendu service à la société. Sur le plan civil, aucune indemnité ne pourra être accordée à l’agresseur qui aurait pu subir un préjudice du fait de la légitime défense. Le dommage qu’il subit est dû, en réalité, à l’agression dont il avait pris l’initiative. Aussi bien, a-t-il été décidé que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire (Civ. 2e, 22 avr. 1992, Bull. civ. II no 127). C’est qu’en effet, la victime d’une telle action ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité civile, y compris celles de la responsabilité du fait des choses inanimées (art. 1242 C. civ.), pour demander réparation du préjudice subi (Crim. 13 déc. 1989, JCP 1990. IV. 102; v. aussi : Crim. 29 juin 2010, pourvoi no 09-87.463). 218 218 § 2 L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime L’article 122-4 du Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Certaines précisions doivent être données quant au domaine et aux conditions d’application de ce fait justificatif. 219 219 A. Domaine d’application 220 – 20 Sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 327), il n’y avait « ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures ou les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime ». Interprété étroitement, ce texte n’aurait couvert que les atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne. Par ailleurs, on observait que la loi n’ordonnait pratiquement jamais explicitement « d’homicider » 156 Les causes de non-responsabilité – 221 On ajoutait, en outre, que l’article 186 de l’ancien Code pénal réprimant l’usage « sans motif légitime » de violences par un préposé du gouvernement ou de la police, on devait a contrario admettre qu’était – et que demeure – justifiée la coercition, y compris la coercition mesurée et indispensable, mise en œuvre par un policier lato sensu pour que « force reste à la loi », lorsque le représentant de celle-ci agit pour son exécution, ce qui constitue, à l’évidence, un « motif légitime » (V. Decheix, « À côté de la légitime défense, le motif légitime », D. 1980, chron. 89). La formule employée par les rédacteurs du nouveau Code pénal ne laisse place à aucune ambiguïté. Le fait justificatif prévu par l’article 122-4 du Code pénal s’applique à toutes les infractions, sans distinction. Ainsi les gardiens de la paix, qui pénètrent (même la nuit et par effraction) dans un appartement afin d’y porter secours à une personne en danger (art. 223-6 al. 2 C. pén.), ne sont pas coupables du délit de violation de domicile. 21 B. Conditions 222 L’article 327 de l’ancien Code pénal requérait cumulativement, pour que le fait justificatif soit retenu, l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime. Si l’ordre de la loi n’a pas été transmis par l’autorité légitime ou, au contraire, si le commandement de celleci ne reposait pas sur l’ordre de la loi, l’infraction ne pouvait pas être justifiée. Actuellement, le nouveau Code pénal (art. 122-4, cité supra, no 219) scinde le fait justificatif considéré en deux aspects apparemment distincts : d’une part, serait justifié l’acte accompli lorsque celui-ci est « prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires », d’autre part, serait justifié l’acte « commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». En d’autres termes, l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime produisent chacun un effet exonératoire autonome de la responsabilité pénale. 22 1° L’ordre de la loi 223 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 (sauf au bourreau) ou de porter des coups et blessures (l’article 104 de l’ancien Code pénal, relatif aux attroupements, disposait que la force publique pouvait dissiper « par la force » les participants, après sommations; v. aussi art. 431-3 C. pén., relatif à la participation délictueuse à un attroupement). Cependant, l’article 327 de l’ancien Code pénal a fait l’objet d’une interprétation large par la jurisprudence. On convenait, en effet, que lorsque la loi ordonne la recherche d’un résultat, par le fait même, elle permet la mise en œuvre des moyens adéquats, y compris l’usage de la coercition nécessaire et suffisante pour atteindre le but assigné (V. Crim. 2 juill. 1970, D. 1971, p. 150, au sujet d’un usage de la coercition par des gardes-chasses à l’égard d’un individu surpris par eux en flagrant délit de braconnage et ayant refusé de les suivre). L’article 122-4, al. 1er, du Code pénal confirme la jurisprudence constante qui assimile au commandement de la loi la permission expresse ou tacite de celle-ci. On ne conçoit pas, en effet, que la loi concède un droit sans par là même justifier les actes qui résultent de l’exercice normal de ce droit. Selon l’article 122-4 du Code pénal, l’acte prescrit ou autorisé peut résulter d’une disposition législative ou réglementaire. Ainsi, l’officier de police judiciaire, qui prononce à l’encontre d’une personne une mesure de garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance (art. 62-2 C. pr. pén.), ne commet pas une séquestration arbitraire. De même, le directeur du Journal officiel ne saurait encourir aucune responsabilité pénale pour le délit de diffamation, du fait de l’insertion dans ledit journal d’une déclaration d’association dont il ne peut légalement se dispenser (Crim. 23 157 223 > 223 L’infraction 158 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 14 nov. 1989, Bull. crim. no 418; v. aussi : Crim. 27 mai 2015, no 14-83.061, D. 2015, p. 1583, note A. Serinet [en l’espèce, la chambre criminelle a censuré la décision d’une cour d’appel, qui avait déclaré coupable de la contravention de diffamation non publique le prévenu qui avait adressé au maire de sa commune une lettre lui demandant d’exercer, au nom de celle-ci, une action pour prise illégale d’intérêts en raison de faits imputés au maire lui-même, alors qu’il invoquait l’application des dispositions de l’article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, autorisant tout contribuable à exercer les actions que la commune a refusé ou négligé d’exercer, et qu’il lui incombait d’énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l’action en justice qu’il requérait et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer]). La même solution s’applique également au directeur de publication d’un journal tenu de publier l’annonce d’une sanction disciplinaire infligée à un médecin (Crim. 15 oct. 1995, Bull. crim. no 311). Aux hypothèses visées par l’article 122-4, al. 1er, du Code pénal, il est permis d’assimiler la coutume. Ainsi, la pratique des sports violents entraîne parfois des blessures, dont les auteurs échappent à la sanction pénale, dès lors qu’elles ont été administrées dans le respect des règles du sport considéré (ce qui exclut les violences gratuites qui entachent parfois la pratique de certains sports). De même, les règlements relatifs à l’exercice de la médecine et de la chirurgie justifient les « blessures volontaires » administrées par les praticiens dans l’exercice de leur profession, à des fins curatives. Enfin, un droit de correction est reconnu aux parents ou aux enseignants pouvant justifier, dans certaines situations, l’exercice de violences légères (T. corr. Paris, 24 mai 1972, Gaz. Pal. 1972. 2. 560 : le comportement inadmissible d’un enfant peut parfois justifier ces violences). Cependant, ce droit se trouve très strictement encadré par la jurisprudence qui joue un rôle créateur en la matière. En particulier, en ce qui concerne les parents, elle n’hésite pas à réprimer « les violences qui, par leur nature et par leurs conséquences, dépassent les limites du droit de correction » (Crim. 21 févr. 1990, Dr. pénal 1990, comm. no 216, note M. Véron, RSC 1990, p. 785, obs. G. Levasseur); elle se montre même réservée quant à l’admission des « châtiments corporels » comme mode d’éducation (T. corr. Chateaudun, 27 avr. 1972, Gaz. Pal. 1972. 2. 561, note L. B.; v. toutefois, CA Angers, 23 mars 2006, JCP G 2006. IV. 2905, coups de pied aux fesses donnés par un père à son fils, qui n’ont entraîné aucune incapacité de travail). S’agissant, en outre, des enseignants et éducateurs, la chambre criminelle a clairement affirmé que le pouvoir disciplinaire ne peut être invoqué par ces derniers que « s’il s’exerce de manière inoffensive ». Or, tel n’était pas le cas d’un instituteur qui avait violemment pincé et tiré les oreilles d’un enfant âgé de 9 ans, ce qui a entraîné une incapacité de travail de 6 jours (Crim. 31 janv. 1995, Bull. crim. no 38, RSC 1995, p. 814, obs. Y. Mayaud; v. aussi CA Angers, 17 juin 1997, Dr. pénal 1998, comm. no 34, note M. Véron [condamnation en cas de gifles ayant exigé des soins à l’infirmerie de l’établissement]; Trib. pol. Bordeaux, 18 mars 1981, D. 1982, p. 182, note D. Mayer, RSC 1982, p. 347, obs. G. Levasseur [en l’espèce, ont été admises les « gifles ou tapes inoffensives »]). De même, il a été jugé que ne pouvaient être considérés comme des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à de jeunes pensionnaires autistes par le personnel éducatif d’une institution spécialisée, lesquels consistaient en des « privations de repas, enfermement dans un placard, administration de douche froide ou obligation de ramassage de leurs excréments » (Crim. 2 déc. 1998, Bull. crim. no 327, Dr. pénal 1999, comm. no 83, Les causes de non-responsabilité – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 note M. Véron, D. 2000, somm. p. 32, obs. Y. Mayaud). Sans aucun doute, les juges répressifs condamnent fermement les violences (v. Crim. 7 nov. 2017, no 16-84.329, Dr. pénal 2018, comm. no 3, note Ph. Conte [en l’espèce, « les violences physiques, psychologiques ou verbales », dont la prévenue avait été déclarée coupable, « excédaient le pouvoir disciplinaire dont disposent les enseignants »]) et voies de faits exercées sur des mineurs par des éducateurs qui invoquent « un prétendu droit de correction ». De tels actes tombent sous le coup de l’interdiction de la loi pénale, puisqu’ils dépassent largement « les limites du droit de correction par la durée et la nature des mauvais traitements » (Crim. 21 févr. 1967, Bull. crim. no 73). Mais, alors que les juridictions répressives justifient, dans certaines circonstances, les violences légères exercées sur des enfants ou des adolescents, le Comité européen des Droits sociaux du Conseil de l’Europe a reproché au législateur français de n’avoir pas prévu « d’interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels » (décision publiée le 4 mars 2015; JCP G 2015, no 338, obs. H. Matsopoulou). Il a, par conséquent, estimé que notre législation n’est pas conforme à l’article 17, 1-b de la Charte sociale européenne, qui impose aux États parties de « protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation ». Il appartient, dès lors, au législateur français d’en tirer les conclusions. Quant aux autorisations administratives, elles ne constituent pas des faits justificatifs (V. pour le visa de la commission de contrôle des films cinématographiques : Crim. 26 juin 1974, Bull. crim. no 241). Il en est de même de la tolérance de l’Administration, celle-ci étant sans effet juridique devant les juridictions répressives (« il n’y a pas de tolérances administratives opposables devant les tribunaux répressifs »; v. Crim. 11 mai 1992, Bull. crim. no 183; v. Crim. 25 janv. 1996, Bull. crim. no 50; Crim. 18 janv. 2005, Bull. crim. no 22). 224 Cas particuliers d’autorisations de la loi. – Autorisation de l’usage d’une arme pour empêcher la réitération d’un ou plusieurs meurtres. La loi no 2016-731 du 3 juin 2016 (art. 51), renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, a inséré, dans le Code pénal, un nouvel article 122-4-1 ayant pour objet de créer un cadre juridique permettant aux agents de la force publique – policiers, militaires et douaniers – de faire usage de leur arme sans qu’ils puissent être mis en cause pénalement, dans le but d’empêcher la réitération d’une « attaque meurtrière d’ampleur » (v. Rapport Sénat, no 491, 23 mars 2016, p. 179). En particulier, ce texte prévoyait une cause d’irresponsabilité pénale pour les agents mentionnés, qui faisaient « un usage absolument nécessaire et strictement proportionné » de leur arme « dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis », lorsqu’ils avaient « des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération [était] probable au regard des informations dont il[s] dispos[aient] au moment où il[s] fai[saien]t usage de [leur] arme ». Ce texte a été abrogé par la loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, qui a créé un cadre de l’usage des armes commun à toutes les forces de l’ordre. C’est qu’en effet, antérieurement à cette loi, les policiers ne pouvaient faire usage de leurs armes que si les conditions de la légitime défense de droit commun étaient réunies, à la différence des gendarmes qui disposaient d’un tel droit dans les quatre cas prévus par l’ancien article L. 2338-3 du Code de la défense. Par la loi précitée, le législateur a institué un régime unique d’usage des armes, en introduisant un nouvel article L. 435-1 dans le 24 159 224 > 224 L’infraction 160 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 Code de la sécurité intérieure qui définit cinq situations autorisant un tel usage. Les bénéficiaires de ce dispositif sont les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prises pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles (art. L. 2338-3 C. défense), les agents des douanes (art. 56 C. douanes), les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national (à l’exclusion du 5° cas visé par l’article L. 435-1 CSI; v. art. L. 2338-3 C. défense). S’agissant des agents de police municipale, ils ne peuvent faire usage de leurs armes que dans le 1er cas prévu par l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure (art. L. 511-5-1 CSI), qui « correspond en réalité à une situation de légitime défense » (v. M. Daury-Fauveau, « Les nouvelles modifications apportées par la loi sur la sécurité publique au droit pénal », JCP G 2017, no 265, et spéc. p. 471). Quant aux agents de l’administration pénitentiaire, ils disposent d’un droit analogue dans les deux premières hypothèses visées à l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure (art. 12 de la loi pénitentiaire no 2009-1436, 24 nov. 2009). L’usage des armes n’est autorisé que si les agents agissent « dans l’exercice de leurs fonctions » et sont « revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité » (v. déjà avant la loi du 28 février 2017 : Crim. 16 janv. 1996, Bull. crim. no 22). De plus, et surtout, un tel usage n’est autorisé qu’« en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». Le législateur, ayant soumis l’usage d’une arme aux critères d’« absolue nécessité » et de « stricte proportionnalité », n’a fait que se conformer aux exigences imposées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qui la force utilisée doit être « absolument nécessaire » et « strictement proportionnée aux buts légitimes visés » (CEDH, 17 avr. 2014, aff. Guerdner c/ France, no 68780/10; CEDH, 27 sept. 1995, aff. Mc Cann et autres c/ Royaume-Uni, no 18984/91; v. aussi : CEDH 7 juin 2018, no 19510/15, Toubache c/ France [il n’y a pas de nécessité absolue « lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent… »]). Et on retrouve également le critère d’« absolue nécessité » dans la jurisprudence de la chambre criminelle, ayant affirmé qu’un gendarme en service ne pouvait bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-4, al. 1er du Code pénal que s’il était établi que l’usage de son arme « était absolument nécessaire compte tenu des circonstances de l’espèce » (Crim. 12 mars 2013, Bull. crim. no 63; Crim. 21 oct. 2014, no 13-85.519). Ces précisions données, l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure n’autorise l’usage des armes par les agents de la force publique que dans les cinq hypothèses suivantes : – 1° « Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui » (en effet, il s’agit ici d’une situation de légitime défense); – 2° « Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées »; – 3° « Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui »; – 4° « Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont Les causes de non-responsabilité international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui »; – 5° « Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes » (cette hypothèse a été visée par l’ancien article 122-4-1 C. pén., introduit par la loi du 3 juin 2016 et abrogé par celle du 28 février 2017). – Divulgations autorisées au profit des lanceurs d’alerte. La loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit un dispositif protecteur au profit du lanceur d’alerte. Ce dernier est défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » (art. 6 L. 9 déc. 2016). Le régime de l’alerte ne s’applique toutefois pas aux « faits, informations ou documents, quelle que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ». En ce qui concerne les faits pouvant faire l’objet du signalement, l’article 122-9 du Code pénal a institué une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale pour « la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de la définition du lanceur d’alerte ». 2° Le commandement de l’autorité légitime 225 1° L’ordre doit émaner d’une autorité légitime Celle-ci doit être une autorité publique. Ainsi, le fait justificatif tiré du commandement de l’autorité légitime a été admis dans une espèce où un maire avait giflé un adolescent surpris en train d’escalader un grillage installé par la municipalité, car le jeune homme, ayant fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la part de l’élu, avait insulté et menacé ce dernier. Contrairement aux juges correctionnels qui avaient condamné le maire pour violences volontaires en écartant la légitime défense invoquée par l’intéressé, la juridiction du second degré a prononcé une décision de relaxe en sa faveur. Pour ce faire, elle s’est fondée sur les dispositions de l’article 122-4, al. 2, du Code pénal relatif au commandement de l’autorité légitime. En particulier, il a été jugé que « le geste du maire, mesuré et adapté aux circonstances de fait de l’espèce, même s’il l’a[vait] lui-même regretté, était justifié en ce qu’il s’[était] avéré inoffensif et était une réponse adaptée à l’atteinte inacceptable portée publiquement à l’autorité de sa fonction » (CA Douai, 10 oct. 2012, no 12/01253, Gaz. Pal. 2012. 2. 3321, note C. Pautrel et B. Partouche, RSC 2013, p. 343, obs. Y. Mayaud). En revanche, une autorité privée, comme celle qui est exercée par un employeur sur son salarié (v. Crim. 12 janv. 1977, Bull. crim. no 18 [le fait, pour un prévenu, de se conformer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer ni un fait justificatif, ni une excuse permettant d’échapper aux conséquences de l’infraction commise]) 25 161 226 > 227 L’infraction 2° L’ordre de l’autorité ne doit pas être manifestement illégal On peut faire observer que l’article 327 de l’ancien Code pénal n’évoquait pas l’exécution de l’ordre de l’autorité légitime frappé d’illégalité. Sur ce point, deux théories s’opposaient : celle dite de l’obéissance « passive », selon laquelle le fait justificatif devait être reconnu malgré l’illégalité de l’acte au bénéfice de l’agent d’exécution, la responsabilité étant parfois « reportée » sur celui qui avait donné l’ordre (V. en ce sens art. 114 de l’ancien code); celle dite des « baïonnettes intelligentes », selon laquelle l’agent d’exécution n’était pas « couvert » par l’ordre illégal, les partisans de cette dernière thèse faisant valoir que le fait justificatif ici évoqué requérait cumulativement l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime. 226 26 – 227 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 ou celle des parents sur leur enfant, n’entre pas dans les prévisions de l’article 122-4 du Code pénal. Ne constitue pas non plus une « autorité légitime » un administrateur judiciaire, qui ne dispose pas d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique (Crim. 20 avr. 2017, no 16-80.808). Mais que doit-on décider lorsque l’ordre émane d’une autorité qui n’a que l’apparence de la légitimité ? Les fonctionnaires d’autorité du Gouvernement dit de Vichy – déclaré de pur fait par l’Ordonnance du 9 août 1944 – s’étaient-ils rendus coupables d’actes arbitraires en exécutant les ordres de l’autorité judiciaire de l’époque tendant à des arrestations, par exemple ? Une ordonnance du 28 novembre 1944 disposa que lorsque les faits incriminés n’avaient comporté que la « stricte exécution, exclusive de toute initiative personnelle », des ordres ou instructions, le bénéfice du fait justificatif devait être accordé à l’agent d’exécution (V. infra, no 227, au sujet des crimes contre l’humanité). Ces deux théories manichéennes doivent être rejetées. La théorie des « baïonnettes intelligentes » est, dans l’absolu, incompatible avec le respect de l’autorité hiérarchique confiée par l’autorité légitime aux responsables de la force publique et aurait pour effet de mettre gravement en péril l’ordre public. On ne saurait, par exemple, admettre que des gardiens de la paix contestent la légalité de l’ordre de dispersion d’un attroupement émanant de leurs supérieurs. On ne doit pas s’étonner de ce que le statut général des fonctionnaires (L. no 83-634, 13 juill. 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires) rappelle que ceux-ci « doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques » (art. 28), tandis que le Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui fait l’objet du Chapitre IV du Titre III du Livre IV du Code de la sécurité intérieure, dispose que « l’autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer » (art. R. 434-4 CSI). À l’opposé, la théorie de l’obéissance « passive » mène, dans l’absolu, à des solutions incompatibles avec le respect des droits et libertés fondamentaux consacré tant par le droit interne que par les conventions internationales que la France a ratifiées. Le second alinéa de l’article 122-4 du Code pénal a mis fin à toute controverse, en disposant que n’est pas pénalement responsable celui qui « accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Il ne s’agit pas là d’une innovation, puisque d’autres textes interdisent expressément d’exécuter l’ordre d’un supérieur prescrivant l’accomplissement d’un acte dont le caractère illicite est manifeste. En effet : 1° l’article D. 4122-3, 3° du Code de la défense prévoit qu’en tant que subordonné, le militaire ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur – 2° le statut général des fonctionnaires (procédant de la loi du 13 juillet 1983, art. 28) indique que le fonctionnaire est délié de l’obligation d’obéir à son supérieur hiérarchique lorsque l’ordre donné est « manifestement 27 162 Les causes de non-responsabilité international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » – 3° l’article R. 434-5 du Code de la sécurité intérieure affirme que « le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». On observera encore en ce sens que l’article 213-4 du Code pénal, relatif aux « crimes contre l’humanité », énonce que l’auteur ou le complice d’un tel crime ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu’il a accompli l’acte incriminé sur ordre de l’autorité légitime (la juridiction étant seulement invitée à « tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant »). Ces textes, pour importants qu’ils soient, n’apportent qu’une solution partielle au problème, dans la mesure où, d’une part, il est parfois difficile pour le subordonné d’apprécier l’illégalité de l’ordre reçu et, d’autre part, le refus d’obéissance, lorsqu’il n’est pas fondé, peut valoir à ce subordonné des sanctions disciplinaires, voire pénales dans certains cas. Dans une affaire à grand retentissement médiatique, la chambre criminelle a jugé qu’un haut fonctionnaire du gouvernement dit de Vichy, accusé de complicité de crime contre l’humanité, ne pouvait arguer, pour se justifier, ni des dispositions législatives ou réglementaires alors en vigueur, ni de l’ordre de l’autorité légitime (Crim. 23 janv. 1997, D. 1997, jur. p. 147, note J. Pradel, JCP G 1997. II. 22812, note J.-H. Robert). Constitue donc un ordre manifestement illégal celui portant sur la commission de crimes contre l’humanité ou sur la destruction de biens, de manière clandestine, par des moyens dangereux pour les personnes (Crim. 13 oct. 2004, aff. des « paillotes corses », Bull. crim. no 243, Dr. pénal 2005, comm. no 2, obs. M. Véron). De même, dans l’affaire des « écoutes de l’Élysée » (Crim. 30 sept. 2008, D. 2008, jur. p. 2975, note H. Matsopoulou), la Cour de cassation a considéré que les ordres prescrivant des interceptions administratives, non autorisées au moment des faits par un texte législatif, et dont étaient destinataires des hauts fonctionnaires, civils ou militaires, présentaient un caractère manifestement illicite. C’est qu’en effet, en l’absence de loi permettant des écoutes téléphoniques discrétionnairement décidées par le président de la République, un officier supérieur de la gendarmerie et des hauts fonctionnaires ne pouvaient pas ne pas avoir conscience d’accomplir un acte illicite. Par conséquent, la Haute juridiction a confirmé la condamnation prononcée à l’encontre de ces derniers pour le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée en écartant le fait justificatif tiré du commandement de l’autorité légitime (Crim. 30 sept. 2008, préc.). 228 – Il arrive parfois que l’agent, ayant exécuté un ordre entaché d’illégalité, invoque la contrainte morale exercée sur lui (procédant du risque d’encourir de graves sanctions à raison de l’inobservation du devoir d’obéissance, en particulier pour un militaire). En tout cas, l’emprise de la contrainte considérée doit s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce (V. infra, no 257). 229 Il convient, enfin, de signaler un délicat problème lié à l’exécution de l’ordre émanant de « la loi » ou de « l’autorité légitime ». Il s’agit de l’indispensable adéquation des moyens mis en œuvre pour exécuter un tel ordre. Le législateur ne peut, à l’évidence, prévoir concrètement la coercition qu’il convient d’exercer pour mettre fin à un trouble de l’ordre public déterminé (pour appréhender l’auteur d’un flagrant délit, par exemple; v. Crim. 13 avr. 2005, Bull. crim. no 131 [« si, aux termes de l’article 73 du Code de procédure pénale, toute personne est investie du pouvoir d’appréhender l’auteur présumé d’une infraction fla- 28 29 163 230 > 231 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 grante et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, l’usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l’arrestation »]). La règle fondamentale en l’occurrence est celle de la proportionnalité : toute violence manifestement disproportionnée compte tenu de la résistance rencontrée, afin que « force reste à la loi » (ou, a fortiori, toute violence gratuite), est condamnable. Cependant, tel n’était pas le cas du gendarme ayant fait usage de son arme de service pour contraindre le conducteur d’un véhicule, qui avait commis des infractions graves et refusé, à plusieurs reprises, d’obtempérer aux ordres d’arrêt des gendarmes dans des circonstances dangereuses pour la sécurité (Crim. 12 mars 2013, Dr. pénal 2013, comm. no 88, note M. Véron). Il est évident que celui qui se réclame de l’ordre de la loi doit avoir respecté les formalités imposées par celle-ci : un OPJ, qui aurait réalisé une perquisition en flagrant délit au mépris des heures légales (V. art. 59 C. pr. pén.), se réclamerait en vain du fait justificatif de l’ordre de la loi. Celui-ci comporte, au moins implicitement, le respect des formalités essentielles prévues par elle. 230 230 § 3 L’état de nécessité L’ancien Code pénal ne comportait aucune disposition sur l’état de nécessité. Cependant, la jurisprudence a été amenée à l’admettre comme cause de justification, lorsque l’agent n’avait pas créé par sa faute préalable cet état (Crim. 25 juin 1958, JCP 1959. II. 10941; 27 déc. 1961, JCP 1962. II. 12652). En particulier, pour ne pas sanctionner l’auteur du délit nécessaire, les juges invoquaient soit le défaut d’intention de sa part (lorsque l’auteur avait agi pour sauvegarder la vie et les biens d’autrui), soit la notion de contrainte morale (lorsque l’auteur avait agi dans son intérêt personnel et non dans celui d’un tiers). Le nouveau Code pénal a expressément reconnu ce fait justificatif à l’article 122-7, selon lequel « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». L’état de nécessité est donc la situation dans laquelle une personne commet volontairement un acte interdit par la loi pénale, afin d’éviter pour elle-même ou pour autrui un péril actuel ou imminent. Cette situation se différencie de la légitime défense en ce que le mal, dont on est menacé, ne résulte pas de l’agression d’un tiers mais d’un concours de circonstances. 231 231 – Ce sera, par exemple, le cas d’un pompier qui pénètre dans la propriété d’autrui d’où il pourra combattre plus efficacement l’incendie qui ravage l’immeuble voisin, ou le cas de l’officier de marine qui, lors de l’évacuation d’un navire naufragé, inflige des violences à un passager qui veut prendre place dans les canots avant les femmes et les enfants. De même, on a invoqué l’état de nécessité pour le touriste qui fracture la porte d’un chalet de montagne et mange les provisions qu’il contient pour échapper à une tourmente de neige; pour la mère indigente qui vole un pain afin d’éviter que son enfant meure de faim (Amiens 22 avr. 1898, DP 1899. 2. 329, note Josserand). Pour que l’état de nécessité puisse produire un effet exonératoire, il faut que certaines conditions soient réunies. 164 Les causes de non-responsabilité A. Conditions requises 232 Il résulte de l’article 122-7 du Code pénal que l’état de nécessité ne peut, tout d’abord, être admis qu’en présence d’« un danger actuel ou imminent » qui menace l’auteur, autrui ou un bien. Ainsi, a-t-il été jugé que les difficultés financières sont insuffisantes pour caractériser un danger actuel ou imminent; par conséquent, a été condamnée une mère de famille ayant commis d’importants vols de denrées alimentaires pour « améliorer l’ordinaire » de ses enfants, alors que ceux-ci n’étaient pas menacés par la faim (CA Poitiers 11 avr. 1997, RSC 1998, 110, obs. Ottenhof). Par ailleurs, la Cour de cassation n’a pas hésité à censurer la décision des juges du fond, ayant relaxé la gérante d’une SARL exploitant une bijouterie, poursuivie du chef d’omission de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels et le rapport de gestion de la société, en relevant, notamment, que le fonds de commerce de bijouterie était particulièrement exposé aux vols et agressions et que la publicité des comptes sociaux et documents annexes, qui comportaient des indications utilisables par les malfaiteurs pour commettre leurs exactions, plaçait l’intéressée face à un danger actuel et imminent (Crim. 1er juin 2005, Bull. crim. no 168, Dr. pénal 2005, comm. no 130, obs. J.-H. Robert). Dès lors, la simple crainte d’éventuels cambriolages ou agressions ne suffisait pas à caractériser l’état de nécessité. Ensuite, il faut que l’acte accompli soit « nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ». En d’autres termes, la commission de l’infraction doit apparaître comme le moyen indispensable d’éviter le mal, dont l’agent (ou un tiers) est menacé. Selon une jurisprudence constante, l’acte doit être l’unique moyen de conjurer le danger. Ainsi, une rupture de stock n’autorise pas un distributeur à copier un modèle d’un de ses fournisseurs, dans la mesure où l’intéressé disposait d’autres solutions que la commission d’un délit de contrefaçon pour pallier les simples difficultés commerciales (Crim. 11 févr. 1986, Bull. crim. no 54; v. aussi : Crim. 9 nov. 2004, Bull. crim. no 273, à propos d’une entrave à l’exercice normal d’une activité économique). De même, le malaise de la conductrice d’un véhicule ne peut justifier l’infraction de conduite sans permis commise par le passager de ce véhicule, à qui s’offraient d’autres solutions pour regagner son domicile (Crim. 4 mars 1998, Gaz. Pal. 1998. 2, chron. crim. 125). 233 Ensuite, la loi exige que les moyens employés par celui qui invoque l’état de nécessité soient proportionnés à la gravité de la menace. Cette exigence sera parfois d’appréciation délicate. Ainsi, en cas de « squattage » réalisé à l’aide d’un bris de clôture et/ou d’une violation de domicile, le juge aura à apprécier la proportion entre le droit au respect du domicile, ou le droit de propriété du citoyen, et la nécessité pour celui qui est dépourvu de toit de s’abriter, le droit au logement étant un « objectif de valeur constitutionnelle » (Cons. const. 19 janv. 1995, JO 21 janv. 1995, p. 1167). Il faut, en outre, que le mal écarté soit grave, et plus grave que celui qui résulte de l’infraction. Ainsi, a été relaxée une personne paraplégique qui, pour soulager ses souffrances constantes, détenait des pieds et des pousses de cannabis pour la consommation de tisanes nécessaires à la sauvegarde de sa santé (CA Papeete 27 juin 2002, Dr. pénal 2003, comm. no 3). Dans certains cas, le mal écarté peut même être d’ordre moral. Dès lors, a pu être justifiée l’introduction brutale d’un mari en instance de divorce dans le 23 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 232 165 234 > 236 L’infraction Enfin, il faut que le mal écarté n’ait pas été créé par celui qui fait valoir l’état de nécessité. En d’autres termes, le délit nécessaire ne doit pas être la conséquence d’une faute antérieure de l’agent. Cette condition, contestée par la doctrine, a été expressément retenue par la Cour de cassation sous l’empire du nouveau Code pénal (Crim. 22 sept. 1999, Bull. crim. no 193; v. aussi : Crim. 11 janv. 2017, no 16-80.610). 234 234 B. Effets Le nouveau Code pénal, en classant l’état de nécessité dans les « causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité » (art. 122-1 à 122-8), confirme qu’il s’agit bien d’un fait justificatif, exonérant l’auteur de toute responsabilité pénale. Mais on se trouve devant un fait justificatif original : l’acte, qui se trouve justifié, a causé un préjudice à un innocent, et la principale conséquence est que son auteur, tout en bénéficiant d’une impunité, reste tenu sur le plan civil. Il doit donc réparer le préjudice que son acte aura pu causer à des tiers. Entre le sacrifice de deux valeurs, il a légitimement choisi de sacrifier la moindre. Mais si c’est dans son propre intérêt qu’il a fait ce choix, il est normal que ce soit lui qui en supporte les conséquences civiles. 235 235 – Cependant, on discute sur le fondement de la réparation qui est due. Puisque l’auteur du dommage n’a pas commis de « faute », ce ne peut pas être un cas de responsabilité civile, sinon à base de risque. On pourrait éventuellement fonder la réparation sur la notion d’enrichissement sans cause. Et il pourrait en être ainsi même au cas où le bénéficiaire de l’infraction nécessaire ne serait pas l’auteur mais un tiers. § 236 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 domicile imparti par le juge à son épouse, pour soustraire sa fille mineure à des scènes de débauche (CA Colmar 6 déc. 1957, D. 1958. 357 [1re esp.], note Bouzat). Lorsque les intérêts en conflit sont de valeur égale, certains auteurs fondent l’impunité sur la théorie de la contrainte morale et non sur l’état de nécessité (V. sur cette question : B. Bouloc, Droit pénal général, op. cit., no 438). En tout cas, la jurisprudence a admis, dans une telle hypothèse, l’état de nécessité. Tel était le cas d’un agent de la surveillance générale de la SNCF qui, pour sauvegarder son propre chien, s’est trouvé dans la nécessité d’abattre un autre chien qui l’agressait et le blessait, le moyen de défense n’étant pas « disproportionné » (Crim. 8 mars 2011, D. 2011. pan. 2826, obs. G. Roujou de Boubée, Dr. pénal 2011, comm. no 75, note M. Véron). Il en était de même du chasseur qui, après avoir tenté de faire partir les chiens en criant et tiré en l’air, s’est trouvé dans la nécessité de tirer dans la direction de ces chiens pour éviter qu’ils ne viennent tuer ses canards appelants (Crim. 5 avr. 2011, Dr. pénal 2011, comm. no 92, note M. Véron). 4 Le fait justificatif tiré de l’« exercice des droits de la défense » En dehors des faits justificatifs prévus par la loi, la jurisprudence en a créé un autre, celui tiré de l’« exercice des droits de la défense ». En particulier, la chambre criminelle refuse de retenir la qualification de vol dans l’hypothèse où un salarié appréhende ou 236 166 Les causes de non-responsabilité 237 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 reproduit, sans l’autorisation de son employeur, des documents appartenant à l’entreprise, dont il a connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors que ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le litige l’opposant à son employeur (Crim. 11 mai 2004, deux arrêts, Bull. crim. n os 113 et 117, RSC 2004, p. 635, obs. E. Fortis, ibid. p. 866, obs. G. Vermelle, RPDP 2004, p. 861, obs. A. Lepage, ibid. p. 875, obs. J.-Ch. Saint-Pau; comp. Crim. 4 janv. 2005, Bull. crim. no 5). La même solution a été également étendue au délit d’abus de confiance (Crim. 16 juin 2011, Dr. pénal 2011, comm. no 100, note M. Véron, RSC 2011, p. 836, obs. H. Matsopoulou). Il en résulte donc que le fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense, et dont l’admission s’impose par les exigences du procès équitable, ne peut jouer que dans le cadre d’un contentieux prud’homal. Par conséquent, se rend coupable de vol le salarié qui remet les photocopies qu’il a soustraites à son employeur, non pour assurer sa défense dans un litige prud’homal, mais lors de son audition à la suite d’une plainte déposée contre lui par ledit employeur, afin de prouver la vérité des faits diffamatoires qu’il a dénoncés (Crim. 9 juin 2009, Bull. crim. no 118). Ce fait justificatif ne peut pas non plus jouer lorsque le prévenu utilise les pièces détenues frauduleusement non pour les besoins de sa défense, mais dans le but de conforter une procédure qu’il a lui-même initiée (Crim. 5 janv. 2017, no 15-86.484 [en l’espèce, le délit de recel de chose a été retenu à l’encontre des prévenus]). De même, la jurisprudence retient l’infraction lorsque la condition relative à la stricte nécessité de se défendre, dans le cadre d’un litige prud’homal, n’est pas satisfaite. Ainsi, affirme-t-elle que les faits conservent leur caractère délictueux dans l’hypothèse où les documents découverts en la possession du salarié « étaient bien plus nombreux que le seul […] qui serait à même d’éclairer [la juridiction prud’homale] sur les difficultés rencontrées avec son ancien employeur » (Crim. 21 juin 2011, Dr. pénal 2011, comm. no 121, note M. Véron). Il est évident que si les limites posées par le critère de « stricte nécessité » sont dépassées, la responsabilité pénale du préposé peut être pleinement engagée. Ces précisions données, la question qui se pose est celle de savoir à quel fait justificatif 237 prévu par la loi on doit rattacher celui tiré de l’exercice des droits de la défense. Certains auteurs pensent qu’il s’agit du « fait justificatif tiré de l’état de nécessité » (M. Véron, note sous Crim. 9 juin 2009, Dr. pénal 2009, comm. no 127), tandis que d’autres soutiennent que c’est celui de « permission de la loi » (« la nécessité de l’exercice des droits de la défense »; v. M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, 8e éd., Dalloz, 2018, no 120). Pour notre part, nous estimons que le fait justificatif de l’exercice des droits de la défense, pure création jurisprudentielle, ne peut se rattacher ni à l’« état de nécessité », dont les conditions requises par l’article 122-7 du Code pénal sont loin d’être réunies, ni à la « permission de la loi ». Comme on le sait, cette dernière autorise largement l’exercice des droits de la défense et ne restreint pas, de manière arbitraire, leur champ d’application à un contentieux déterminé. À notre avis, en érigeant l’exercice des droits de la défense en un fait justificatif et en prenant soin de bien encadrer les hypothèses dans lesquelles ce fait peut produire un effet exonératoire (procès prud’homal), la jurisprudence a entendu lui réserver une certaine autonomie, si bien qu’il est difficile de considérer qu’il s’agit d’une forme particulière d’un des faits justificatifs réglementés par la loi. 167 238 > 238 § L’infraction 5 Rôle du comportement de la victime international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 Deux questions méritent d’être examinées : celle de savoir si le consentement de la victime peut justifier une infraction et celle concernant la provocation à l’action. A. Le consentement de la victime 238 Le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif. L’infraction est réprimée par la société parce qu’elle cause un trouble à l’ordre public et l’appréciation de ce trouble appartient aux pouvoirs publics et non aux particuliers. C’est ainsi que le fait, pour un industriel, de payer ses ouvriers à un taux inférieur au salaire légal, même si, afin d’éviter d’être au chômage, ils y consentent, est une infraction punissable. De même, le fait pour l’employeur de faire travailler ses salariés le dimanche, avec leur consentement, est punissable, dès lors qu’une dérogation légale ne peut en l’occurrence être invoquée (V. en ce sens : Crim. 5 déc. 1989, Bull. crim. no 466). Le meurtre d’un malade incurable, qui supplie qu’on mette fin à ses souffrances, est un meurtre, malgré le mobile altruiste qui peut l’inspirer. Toutefois, la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (V. sur cette loi, J. Pradel, « La Parque assistée par le droit – Apports de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie », D. 2005, p. 2106) et, notamment, celle no 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie (V. sur cette loi, P. Mistretta, « De l’art de légiférer avec tact et mesure – À propos de la loi no 2016-87 du 2 février 2016 », JCP G 2016, no 240) ont réservé une place importante à la volonté du malade en reconnaissant expressément à ce dernier « le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement » (art. L. 1111-4 CSP). Lorsqu’ils résultent d’une « obstination déraisonnable » (cette notion est appréciée in concreto; v. CE, 8 mars 2017, no 408146, § 23; CE, 5 janv. 2018, no 416689, § 14), les traitements et soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis. S’ils « apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire » (art. L. 1110-5-1 CSP; dans le cas d’un patient mineur, il incombe « au médecin de rechercher l’accord des parents ou du représentant légal de celui-ci, d’agir dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et de faire de son intérêt supérieur une considération primordiale » : v. CE, 5 janv. 2018, no 416689, § 11 et CEDH, 5e sect., 23 janv. 2018, no 1828/ 18, D. A. et M. B. c/ France; § 32 et § 36). La loi reconnaît également à toute personne majeure le droit de rédiger des « directives anticipées » pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. Elles sont, à tout moment et par tout moyen, « révisables et révocables » (art. L. 1111-11 CSP). Enfin, dans la continuité du droit au refus de l’obstination déraisonnable et de celui « d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » (art. L. 1110-5 CSP), la 238 168 Les causes de non-responsabilité – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 loi du 2 février 2016 a institué un nouveau droit, au profit du malade, qui lui permet de demander la mise en œuvre d’« une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès » (art. L. 1110-5-2 CSP). Le droit à la sédation n’est reconnu que dans deux hypothèses : 1° lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements; 2° lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. On voit donc que, bien que notre législation actuelle n’autorise pas l’euthanasie, des avancées importantes ont été réalisées ayant pour fondement principal la volonté de la personne malade en fin de vie. On peut, par ailleurs, faire observer que certaines atteintes bénignes à l’intégrité corporelle réalisées à la demande de la « victime » (tatouage, percement du nez ou de la langue à des fins prétendument esthétiques) bénéficient d’une tolérance. Quant aux violences infligées entre adultes pleinement consentants (il s’agit des pratiques sadomasochistes), la Cour européenne des droits de l’Homme, ayant statué sur la conformité de ces pratiques à l’article 8 de la Convention, a estimé que le droit au respect de la vie privée ne fait pas obstacle à la répression de tels actes suivis de blessures d’une gravité suffisante (CEDH, 19 févr. 1997, Laskey, Jaggard et Brown c/ Royaume Uni, JCP G 1998. I. 107, no 34, obs. F. Sudre). Cependant, cette solution a été remise en cause par une jurisprudence ultérieure qui réserve une place importante à la volonté de la « victime », et qui refuse, par conséquent, de sanctionner ces pratiques dès lors que cette dernière a été consentante (CEDH 17 févr. 2005, K. A. et A. D. c/ Belgique, JCP G 2005. I. 159, no 12, obs. F. Sudre; adde M. Fabre-Magnan, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », D. 2005, chron. p. 297). 239 Le consentement de la victime peut cependant être efficace, lorsqu’il s’agit d’une infraction exigeant chez son auteur une contrainte, une violence ou une fraude. Dans ces hypothèses, l’acceptation de l’intéressé supprime l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Ainsi, le délit de violation de domicile n’est pas constitué si l’occupant a consenti à l’entrée de l’individu poursuivi (toutefois, si le consentement a été obtenu à l’aide de manœuvres, l’infraction est consommée : art. 226-4 C. pén. – V. H. Matsopoulou, Violation de domicile, J.-Cl. Pén., art. 226-4). De même, le viol et les agressions sexuelles ne sont pas constitués, si la victime a été consentante. 240 Mais, pour que le consentement de la victime produise un effet exonératoire, certaines conditions doivent être réunies. Tout d’abord, le consentement doit être antérieur ou concomitant à la commission des faits incriminés. Ensuite, il doit être donné librement et en connaissance de cause. Enfin, il faut que l’intéressé soit capable de comprendre la portée de son consentement. Ainsi, en matière d’agressions ou d’atteintes sexuelles, le consentement donné par un enfant ne dispense pas l’auteur de sa responsabilité pénale (V. au sujet des atteintes sexuelles commises sans violences sur les mineurs : art. 227-25 et s. C. pén.). 241 239 240 Pratiques médicales et consentement des intéressés. La question qui se pose ici est celle de savoir si les médecins sont autorisés à procéder à des interventions justifiant des atteintes au corps humain, et ce, avec le consentement des intéressés. Contrairement à certaines infractions qui ne sont pas constituées lorsque la victime est consentante, telles 241 169 242 > 243 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 que le viol ou les agressions sexuelles, l’accord de l’intéressé ne produit, en matière de violences, aucun effet exonératoire. Ainsi, a été condamné le médecin qui avait pratiqué des stérilisations, sans objectif thérapeutique, à la demande de ses patients (Crim. 1er juill. 1937, affaire des stérilisés de Bordeaux, S. 1938. 1. 193, note Tortat). De même, s’est rendu coupable de violences le chirurgien qui avait procédé à l’ablation de l’appareil génital externe d’un patient, une telle opération n’ayant pas été réalisée dans l’intérêt thérapeutique de ce dernier mais pour satisfaire la curiosité scientifique du praticien (Crim. 30 mai 1991, Bull. crim. no 232). À l’exception des hypothèses expressément visées par la loi, le consentement des intéressés n’enlève pas à de telles pratiques leur caractère délictueux, dès lors qu’elles ne poursuivent aucune finalité thérapeutique. Comme le précisent les articles 16-1 et 16-3 du Code civil, « le corps humain est inviolable »; il ne peut y être porté atteinte « qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». Dans ces cas, le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, sauf si son état de santé rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas en mesure de consentir. Toutefois, il existe des textes spécifiques qui autorisent à pratiquer ou à faire pratiquer sur une personne des recherches biomédicales, avec le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé (art. L. 1126-1 à L. 1126-5 CSP; art. 223-8 et 223-9 C. pén.). Cependant, le fait de pratiquer (ou de faire pratiquer) de telles recherches sans avoir recueilli le consentement de la personne concernée (ou des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur), dans les cas prévus par les dispositions du Code de la santé publique, constitue un délit (art. 223-8 C. pén.). Par ailleurs, des prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain peuvent être pratiqués, sous certaines conditions prévues par la loi (art. L. 1231-1 et s. et L. 1241-1 et s. CSP; art. 511-2 à 511-13 C. pén.). Les praticiens sont donc tenus de respecter ces dernières afin de ne pas se voir imputer l’infraction de violences. B. La question de la provocation Les articles 321 à 326 de l’ancien Code pénal traitaient des « Crimes et délits excusables et des cas où ils pouvaient être excusés »; sous ce titre, apparaissait l’excuse atténuante de provocation. 242 24 – Le meurtre, les blessures et les coups étaient excusables s’ils avaient été provoqués par des « coups ou violences graves envers les personnes » (art. 321) ou s’ils avaient été commis « en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances » (art. 322). Le parricide n’était jamais excusable (art. 323), tandis que le meurtre commis par l’époux sur la personne de l’épouse ou par l’épouse sur la personne de l’époux n’était pas excusable si la vie du conjoint qui avait commis le meurtre n’avait « pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre » avait été commis (art. 324). Le crime de castration était excusable s’il avait été provoqué par un « outrage violent à la pudeur » (art. 325). – L’excuse de provocation atténuait la peine encourue (selon les dispositions de l’art. 326). 243 Le nouveau Code pénal n’a pas repris les dispositions citées ci-dessus relatives à l’excuse de provocation. Il a pu paraître que le juge dispose aujourd’hui d’un très large pouvoir d’appréciation quant à la peine applicable « en fonction des circonstances de 243 170 Les causes de non-responsabilité section 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » (art. 132-1, al. 3, C. pén.). Or, la provocation est une circonstance de fait qui atténue, à l’évidence, la culpabilité de l’agent. Cependant, on a pu regretter la disparition de l’excuse de provocation, qui permettait de retenir une peine correctionnelle réduite à 5 ans au lieu d’une peine criminelle perpétuelle et à 2 ans au lieu d’une peine criminelle temporaire. La provocation peut, toutefois, être considérée comme une agression permettant à la victime d’invoquer la légitime défense (telle que celle-ci est définie par l’article 122-5 du Code pénal), ou comme une circonstance de fait permettant au juge de modérer la peine, lorsqu’il l’estimera opportun. Les causes de non-imputabilité 244 L’élément moral exige d’abord la capacité de comprendre, puis de vouloir. Dans certaines situations, l’intéressé n’a pas atteint le seuil de compréhension. Tel peut être le cas d’un aliéné (personne atteinte d’un trouble mental). Dans d’autres hypothèses, c’est la volonté de l’agent qui n’a pas été libre (contrainte-erreur). Les causes de non-imputabilité ne produisent un effet exonératoire qu’à l’égard des personnes chez qui elles se trouvent; en revanche, elles laissent subsister la responsabilité pénale des coauteurs ou des complices. 24 § 245 1 Le trouble psychique ou neuropsychique L’article 122-1, al. 1er, du Code pénal énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». On peut faire remarquer que le terme « trouble psychique ou neuropsychique » a été substitué à celui de « démence » visé par l’article 64 du Code pénal de 1810 (« il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action… »). Même si le terme de démence a été largement interprété par la jurisprudence, les rédacteurs du nouveau Code pénal ont procédé à son remplacement, cette notion apparaissant désormais étroite compte tenu de l’évolution de la psychiatrie. Le terme de « trouble psychique ou neuropsychique » désigne toute forme d’aliénation mentale enlevant à l’individu le contrôle de ses actes. Il peut s’agir d’une affection de l’intelligence, aussi bien congénitale (imbécillité, idiotie) qu’acquise par l’effet d’une maladie (démence précoce), d’une psychose (par exemple schizophrénie) ou d’une folie spécialisée (par exemple la folie de la persécution). Cependant, quelle que soit la forme de maladie, elle n’est retenue que si l’acte prohibé par la loi pénale a été commis sous son empire. Avant de distinguer les troubles psychiques ou neuropsychiques de certaines situations voisines, il convient de 245 171 246 > 249 L’infraction préciser dans quelles conditions ces troubles entraînent une irresponsabilité pénale et quelles sont les conséquences de cette irresponsabilité. 246 247 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 A. Conditions de l’irresponsabilité des personnes atteintes d’un trouble mental L’article 122-1, al. 1er, du Code pénal indique que le trouble mental doit exister au moment des faits. Si la personne atteinte d’un tel trouble se trouve dans un intervalle lucide au moment de la commission de l’infraction, sa responsabilité pénale pourra être engagée. À cet égard, il est utile de faire observer qu’il n’y a pas en droit pénal de présomption de trouble psychique ou neuropsychique, comme en droit civil, même en cas de mise en tutelle d’un incapable majeur. Il s’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges (Crim. 6 juin 1979, Bull. crim. no 194). À vrai dire, ceux-ci ordonnent souvent, en pratique, une expertise psychiatrique. Même si les conclusions de l’expert ne lient pas les juges, il faut bien reconnaître que cette expertise pourra les éclairer et sera déterminante pour le sort de l’intéressé. 246 La responsabilité pénale de l’agent reste entière, lorsque le trouble survient postérieurement aux faits délictueux. Plus précisément, s’il survient après la commission de l’infraction, mais avant le jugement, la poursuite sera suspendue; s’il survient après une condamnation définitive, il empêche d’exécuter les peines privatives de liberté, tandis que l’exécution des peines pécuniaires ou des peines privatives de droits pourra être poursuivie. Toutefois, le trouble mental n’exclut la responsabilité pénale que s’il a aboli le discernement de la personne ou le contrôle de ses actes. En revanche, les troubles, qui « altèrent » seulement le discernement ou « entravent » le contrôle des actes de l’individu, ne produisent pas d’effet exonératoire; cependant, le juge peut prendre en considération cette circonstance quand il détermine la peine et en fixe le régime (art. 122-1, al. 2, C. pén.). Dans cette dernière hypothèse, l’état mental déficient ne fait pas disparaître l’élément moral de l’infraction, celle-ci étant donc constituée. 247 B. Conséquences de l’irresponsabilité des personnes atteintes d’un trouble mental 248 L’existence du trouble mental au moment de l’acte fait disparaître la responsabilité pénale de l’auteur. Néanmoins, la personne atteinte d’un tel trouble reste civilement responsable de ses actes en vertu de l’article 414-3 du Code civil (« Celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation »). 249 La loi no 2008-174 du 25 février 2008 a institué, à l’exemple de certaines législations étrangères, une nouvelle procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (V. pour une étude détaillée, H. Matsopoulou, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la « dangerosité » et l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux », Dr. pénal 2008, étude no 5, p. 7, et spéc. no 36 à 53). Cette procédure 248 249 172 Les causes de non-responsabilité 250 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 permet à la juridiction constatant une telle irresponsabilité de se prononcer sur la réalité des faits délictueux commis par la personne mise en cause et sur les mesures de sûreté nécessitées par son état de santé. Aussi bien, l’article 706-119 du Code de procédure pénale détermine-t-il la procédure que le juge d’instruction doit suivre, s’il estime que l’article 122-1, al. 1er, du Code pénal, relatif à l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental, pourra être applicable. En outre, l’article 706-122 du Code de procédure pénale organise la procédure suivie devant la chambre de l’instruction, en prévoyant une véritable audience qui doit se dérouler conformément aux règles régissant une audience correctionnelle. Si la chambre de l’instruction estime, d’une part, qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, que l’article 122-1, al. 1er, du Code pénal est applicable, elle rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (Crim. 21 mars 2012, Bull. crim. no 77 : l’appréciation, par une chambre de l’instruction, de l’abolition, pour cause de trouble psychique ou neurologique, du discernement d’une personne mise en examen est souveraine). Les juridictions de jugement peuvent également déclarer l’irresponsabilité pénale de l’accusé ou du prévenu pour trouble mental par un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcé par la cour d’assises ou par un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendu par le tribunal correctionnel. Par ailleurs, la loi du 25 février 2008 a institué des mesures de sûreté susceptibles d’être ordonnées par la chambre de l’instruction ou les juridictions de jugement en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du discernement. Ces mesures ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique destinée à établir l’existence de tels troubles. En particulier, il s’agit de « l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous forme d’une hospitalisation complète » (art. 706-135 C. pr. pén.). Celle-ci peut être ordonnée par décision motivée s’il est établi, par cette expertise, que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. On peut faire observer qu’antérieurement à la loi du 25 février 2008, l’hospitalisation complète (appelée par cette loi « hospitalisation d’office »; la loi du 15 août 2014 a par la suite substitué à cette formule celle d’hospitalisation complète) échappait à la compétence de l’autorité judiciaire et ne pouvait être prononcée que par l’autorité administrative conformément aux dispositions du Code de la santé publique (art. L. 3213-1 CSP; v. toutefois, art. L. 3213-7 CSP qui impose aux autorités judiciaires d’aviser immédiatement la commission départementale des soins psychiatriques ainsi que le représentant de l’État dans le département, qui ordonne « sans délai » la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques). Peuvent, en outre, être retenues à l’égard des personnes atteintes de troubles mentaux toutes les mesures de sûreté visées à l’article 706136 du Code de procédure pénale (en ce qui concerne l’application de ces mesures dans le temps, v. supra, no 119). Ces mesures peuvent entraîner : – l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment avec les mineurs; 250 173 251 > 252 L’infraction 251 En ce qui concerne les individus qui, sans être en état de démence complète, souffrent cependant de troubles mentaux altérant de façon sensible leurs facultés intellectuelles (on les qualifie parfois d’anormaux mentaux : déficients mentaux, demi-fous, hystériques), leur responsabilité pénale pourra être engagée, mais les juges peuvent tenir compte de leur situation, lorsqu’ils déterminent la peine applicable et en fixe le régime (V. art. 122-1, al. 2, C. pén.; v. aussi supra, no 247). La loi du 15 août 2014 a complété l’article 122-1 du Code pénal, en prévoyant qu’en cas de peine privative de liberté encourue, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion (ou de la détention) criminelle à perpétuité, la peine est ramenée à trente ans (ces dispositions ont été jugées plus favorables que les anciennes, ce qui peut justifier leur application immédiate : Crim. 15 sept. 2015, no 14-86.135, JCP G 2015, no 1209, note V. Peltier, Dr. pénal 2015, comm. no 152, note Bonis-Garçon). La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette réduction de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins appropriés à son état. Si la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du Code pénal n’a pas été soumise à un suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines peut ordonner, à la libération de la personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu’il fixe, et qui ne peut excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement (art. 706-136-1 C. pr. pén.). 251 C. Cas particuliers 252 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 – l’interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné; – l’interdiction de détenir ou de porter une arme; – l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée; – la suspension du permis de conduire et l’annulation de celui-ci avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis. Les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental figurent sur le casier judiciaire national automatisé, lorsqu’est ordonnée l’« hospitalisation complète » ou lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 C. pr. pén. ont été prononcées (V. art. 768, 10° et 769 C. pr. pén.). Hors le cas de la maladie mentale proprement dite, l’agent peut avoir été privé de discernement, par exemple dans l’hypothèse du somnambulisme, de l’hypnose ou de l’ivresse. On admet que le somnambule n’est pas responsable des actes qu’il commet en état de sommeil, car il obéit à des pulsions inconscientes et irrésistibles. Cependant, on pourrait lui reprocher une faute d’imprudence commise à l’état de veille, si, par exemple, il a placé, à portée de main, un revolver chargé. Une solution identique est admise pour la personne qui, ayant négligé de prendre du repos, s’endort au volant de son véhicule et blesse grièvement un piéton. 25 174 Les causes de non-responsabilité 253 S’agissant de l’individu en état d’ivresse, il ne se rend qu’imparfaitement compte de ses actes, et cet état est parfois la cause d’infractions. Même si l’ivresse entraîne une altération de la volonté, la jurisprudence, ayant recours à la notion de dol éventuel, estime qu’elle laisse subsister la responsabilité pénale (Crim. 5 févr. 1957, Bull. crim. no 112). C’est qu’en effet, celui qui s’est enivré a commis par là une faute consciente qui suffit à le rendre responsable des agissements qu’il commettra sous l’influence de l’ivresse. On peut, par ailleurs, constater que la loi non seulement ne fait pas de l’ivresse une cause d’irresponsabilité, mais, au contraire, elle la sanctionne expressément dans certaines circonstances. Ainsi, elle incrimine le comportement de celui qui conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse (art. L. 234-1 C. route). Dans d’autres hypothèses, l’ivresse (et, à défaut, l’état d’imprégnation alcoolique) est retenue comme circonstance aggravante de certaines infractions; tel est le cas de l’homicide involontaire ou des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art. 221-6-1-2°, 222-19-1-2°, 222-20-1-2° C. pén., insérés par la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière; v. aussi : art. L. 232-1 et L. 232-2 C. route). De même, depuis la loi no 2003-87 du 3 février 2003, la conduite d’un véhicule sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants constitue une infraction (art. L. 235-1-I C. route, modifié par la loi no 2016-41 du 26 janv. 2016, art. 45) et une circonstance aggravante de l’homicide involontaire ou des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (art. 221-6-1-3°, 222-19-1-3°, 22220-1-3° C. pén.). L’usage de stupéfiants ne saurait donc être une cause de non-imputabilité. Quant aux états passionnels ou émotifs, ils modifient l’équilibre mental du sujet. Mais la jurisprudence refuse d’y voir une altération de l’élément moral; elle estime qu’il faut savoir dominer ses passions et maîtriser son tempérament. L’infraction est donc constituée. Cependant, la peine peut, là encore, être modérée par le juge. 253 § 254 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 En cas d’hypnose, la doctrine décide que l’hypnotisé n’engage pas sa responsabilité, lorsqu’il a commis l’infraction par suggestion, celle-ci lui enlevant toute liberté au moment de l’acte. Il est évident que dans cette hypothèse, l’hypnotisé n’est qu’un instrument inconscient entre les mains de l’hypnotiseur. 2 La contrainte L’article 122-2 du Code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». La contrainte, en abolissant la volonté, supprime toute liberté de l’agent. Plus précisément, comme le trouble psychique ou neuropsychique, elle fait disparaître, à l’égard de la personne qui l’invoque, l’élément moral de l’infraction et, par là même, supprime la responsabilité pénale de l’auteur. Il convient, d’une part, de définir la notion de « contrainte » et, d’autre part, de déterminer à quelles conditions celle-ci peut entraîner un effet exonératoire de responsabilité. 254 175 255 > 256 L’infraction A. Notion de contrainte 256 On distingue la contrainte physique et la contrainte morale. La contrainte physique, qui suppose une force s’exerçant sur le corps même de l’agent, peut avoir soit une origine externe, soit une origine interne. D’origine externe, la contrainte physique peut provenir d’une force de la nature (tempête, inondation), du fait d’un animal ou d’un tiers. Ainsi, a été relaxé le coureur cycliste qui, enfermé dans un peloton, a renversé et tué un policier de la route (Crim. 5 janv. 1957, Bull. crim. no 17). Il en est de même pour un individu détenu, qui n’a pas pu se rendre à une convocation de l’autorité militaire. Mais la contrainte physique peut aussi avoir une origine interne, c’est-à-dire provenir d’une cause inhérente à l’auteur de l’infraction. Aussi bien, la jurisprudence a-t-elle admis l’effet exonératoire de la contrainte à l’égard d’un voyageur, poursuivi pour défaut de titre de transport, alors que, s’étant endormi sous l’effet d’une grande fatigue physique, il avait dépassé la station pour laquelle il avait pris son billet (Crim. 19 oct. 1922, DP 1922. 1. 233). Il en était de même du conducteur d’une automobile, poursuivi pour homicides involontaires, mise en danger d’autrui et défaut de maîtrise, victime d’un malaise brutal et imprévisible qui lui a fait perdre le contrôle de l’accélération de son véhicule, lancé à une vitesse croissante sur l’autoroute, puis l’aire de repos où il s’est immobilisé, après avoir heurté les véhicules occupés par les victimes (Crim. 15 nov. 2005, Bull. crim. no 295, RSC 2006, p. 61, obs. Mayaud; v. aussi : Douai, 24 oct. 2000, JCP 2002. II. 10012, note Maréchal). 25 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 255 La contrainte morale peut être provoquée par une pression exercée sur la volonté d’une personne ayant pour conséquence d’abolir son libre arbitre. Comme la contrainte physique, elle peut avoir une cause externe ou une cause interne. La contrainte morale externe peut résulter soit des menaces, soit d’une provocation émanant d’un tiers. S’agissant des menaces, elles doivent être pressantes pour supprimer la liberté de l’esprit de l’agent (tel n’était pas le cas des menaces de représailles allemandes contre des fonctionnaires français, dans la mesure où elles n’étaient pas d’une intensité de nature à abolir le libre arbitre de ces derniers; v. Crim. 23 janv. 1997, D. 1997, jur. p. 147, note J. Pradel, JCP G 1997. II. 22812, note J.-H. Robert). La simple crainte révérencielle de l’enfant à l’égard de ses parents ou de l’employé vis-à-vis de son patron ne produit aucun effet exonératoire. Quant aux provocations, elles ne sont retenues que lorsque le tiers provocateur a utilisé des manœuvres, telles qu’elles ont aboli le libre arbitre du prévenu (à propos des provocations policières : v. Crim. 2 mars 1971, RSC 1971, p. 930; H. Matsopoulou, Les enquêtes de police, LGDJ 1996, nos 921 et s.). La contrainte morale interne peut provenir des passions, des émotions ou des convictions de l’auteur d’une infraction. Selon une jurisprudence constante, cette forme de contrainte ne constitue pas une cause d’irresponsabilité pénale. Une telle solution peut se comprendre, puisque le droit pénal est notamment édicté pour ceux qui ne savent pas résister à leurs passions ou émotions. Ainsi, a été condamnée une femme qui, sous l’influence d’une grande émotion, avait écrit des lettres d’injure au ministre, au procureur de la République et au juge d’instruction, parce que son mari fonctionnaire était 256 176 Les causes de non-responsabilité menacé d’une mise à la retraite anticipée (Crim. 11 avr. 1908, S. 1909. 1. 473, note Roux). Néanmoins, bien que la contrainte morale interne ne soit pas exclusive de responsabilité pénale, la jurisprudence se montre souvent indulgente à l’égard des auteurs d’un crime passionnel. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 – B. Conditions de l’irresponsabilité 257 Qu’il s’agisse d’une contrainte physique ou morale, d’origine externe ou interne, elle n’exclut la responsabilité pénale que si elle a été irrésistible (l’article 122-2 C. pén. fait état de la « personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister »). Selon la jurisprudence, la contrainte ne peut être retenue que si elle résulte d’un événement que « la volonté humaine n’a pu ni prévenir, ni conjurer ». Ainsi, a été condamnée pour violation d’un arrêté d’expulsion une personne qui s’était vue opposer un refus d’entrée de la part de tous les pays limitrophes de la France, mais n’a pas établi la preuve qu’aucun pays non limitrophe ne l’aurait accueillie (Crim. 8 févr. 1936, DP 1936. I. 44, note Donnedieu de Vabres). Les juges répressifs sont tenus d’établir le caractère irrésistible de la contrainte, en précisant en quoi la défaillance physique invoquée par la personne intéressée l’avait placée dans l’impossibilité absolue de se conformer à la loi (Crim. 15 nov. 2006, Bull. crim. no 295, Dr. pénal 2007, comm. no 32, obs. Véron). On pourra, par ailleurs, faire observer que la contrainte visée à l’article 122-2 du Code pénal évoque la force majeure du droit civil, à laquelle se réfère expressément la Cour de cassation (Crim. 11 oct. 1993, Bull. crim. no 282). Logiquement, le caractère irrésistible de la contrainte devrait être apprécié in concreto, mais les juridictions répressives adoptent plutôt une conception abstraite. Une telle jurisprudence est fort contestable, car elle méconnaît le principe de l’individualisation de la peine. 258 La loi imposant la condition de l’irrésistibilité, la jurisprudence en a dégagé une autre : celle de l’imprévisibilité. C’est qu’en effet, les juges n’admettent la contrainte que si celleci n’a pas été précédée par une faute de l’agent. Ainsi, a été déclaré coupable de désertion un marin, qui n’a pu regagner son navire avant le départ, parce qu’il avait été placé en garde à vue pour cause d’ivresse publique (V. Crim. 29 janv. 1921, S. 1922. 1. 185, note Roux; Crim. 30 juin 1981, Bull. crim. no 223). Il en a été de même pour le conducteur d’un véhicule automobile, qui ne pouvait valablement soutenir que la survenance d’une défaillance mécanique constituait un événement de force majeure, alors qu’il avait omis de vérifier l’état de son véhicule, avant d’en faire usage, contrairement aux dispositions de l’article L. 311-1 du Code de la route (Crim. 6 nov. 2013, Bull. crim. no 215, Dr. pénal 2014, comm. no 24, note J.-H. Robert). 257 258 § 259 3 L’erreur On peut distinguer entre l’erreur de droit et l’erreur de fait. Si l’erreur de droit a été expressément consacrée par le législateur avec parcimonie, celui-ci a, en revanche, ignoré l’erreur de fait. 259 177 260 > 261 L’infraction A. L’erreur de droit Toute personne est présumée connaître les lois applicables et ne peut se prévaloir de son ignorance pour échapper à toute sanction. La jurisprudence affirme depuis longtemps la règle selon laquelle « nul n’est censé ignorer la loi ». Cependant, les textes d’incrimination sont de plus en plus nombreux (certains auteurs parlent même d’une « inflation pénale » : v. B. Bouloc, Droit pénal général préc., no 471), de sorte que les simples particuliers ont des difficultés à suivre les multiples évolutions législatives et ne peuvent avoir une parfaite connaissance du droit en vigueur. C’est pour cette raison que certaines restrictions ont été exceptionnellement apportées au principe « nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, l’article 4 du décret-loi du 5 novembre 1870 prévoyait que « les tribunaux pourront, selon les circonstances, accueillir l’exception d’ignorance alléguée par les contrevenants si la contravention a eu lieu dans le délai de 3 jours francs à partir de la promulgation ». Ce texte n’a toutefois pas été repris par le dispositif actuel. Comme on le sait, les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, qui, depuis le 1er janvier 2016, n’est mis à la disposition du public que « sous forme électronique » (art. LO 6213-2 du CGCT, modifié par la loi organique no 2015-1712 du 22 déc. 2015, portant dématérialisation du Journal officiel de la République française, art. 1er). Par ailleurs, même si la Cour de cassation semble sanctionner aussi bien l’erreur pénale que l’erreur « non pénale » (Crim. 8 févr. 1966, Bull. crim. no 36), les juges du fond se sont parfois montrés indulgents à l’égard de ceux ayant commis une erreur sur une disposition étrangère à la loi pénale. 260 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 260 Sur ce point, on peut citer un vieil arrêt de la cour d’appel de Paris (2 déc. 1924, Rec. Dr. comm., 1925. 2. 359), ayant refusé de condamner pour vol l’inventeur d’un trésor qui, ignorant l’article 716 C. civ., se l’était approprié en totalité. Mais, il ne s’agit que de décisions isolées, la jurisprudence faisant preuve d’une grande sévérité en la matière (Crim. 26 févr. 1964, Bull. crim. no 71). 261 En réaction contre la position jurisprudentielle, les rédacteurs du nouveau Code pénal ont retenu « l’erreur invincible ». Selon l’article 122-3 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». Deux situations ont été essentiellement évoquées lors des travaux préparatoires : le défaut de publicité du texte normatif et l’information erronée donnée par l’Administration, préalablement à l’acte accompli. Il est évident qu’en cas de doute sur la portée d’un texte, l’intéressé doit s’adresser à l’Administration compétente. S’agissant de l’interprétation des textes sur la durée hebdomadaire du travail, la consultation de l’inspection du travail s’impose (Crim. 5 mars 1997, RSC 1997, 827, obs. Bouloc). Seule une information erronée fournie par l’Administration compétente peut produire un effet exonératoire (Crim. 24 nov. 1998, JCP G 2000. I. 235). Ainsi, l’erreur sur le droit ne saurait être retenue dans l’hypothèse où le dirigeant d’une société a étendu sans autorisation la surface de vente d’un hypermarché, en se prévalant d’un avis du ministère, selon lequel l’opération envisagée ne nécessitait pas une autorisation; cet avis 261 178 Les causes de non-responsabilité 262 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 ne produisait aucun effet, dès lors que la société s’était vue refuser à cinq reprises l’autorisation d’extension qu’elle avait déjà sollicitée auprès de la commission d’équipement commercial (Crim. 19 mars 1997, Bull. crim. no 115). Ne peut pas non plus alléguer une erreur sur le droit le gérant d’une société allemande, qui ne déclarait les salariés aux organismes de protection sociale que postérieurement à leur embauche (Crim. 20 janv. 2015, Dr. pénal 2015, comm. no 32, note M. Véron). En l’espèce, pour échapper à sa condamnation pour travail dissimulé, le prévenu faisait valoir qu’il ignorait que la législation française, contrairement à la législation allemande, imposait une déclaration préalable à l’embauche des salariés. Mais, un tel argument ne pouvait prospérer dès lors que l’entreprise était « implantée de longue date en France », et que l’intéressé avait la possibilité de solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en la matière. A été également rejetée l’erreur sur le droit invoquée par une personne qui détenait un colis renfermant des objets à caractère pornographique, et qui prétendait que, dès lors que l’administration des Douanes avait laissé parvenir ledit colis à destination, il avait pu croire que l’origine des objets litigieux était licite (Crim. 9 juin 1999, Dr. pénal 1999, comm. no 138). Néanmoins, l’attitude de l’administration des Douanes ne pouvait constituer pour l’intéressé une « erreur de droit invincible », exclusive de toute responsabilité. Enfin, n’a pas été considérée comme une telle erreur celle ayant pour fondement des circulaires ministérielles, à caractère interprétatif, qui remettaient en cause les termes d’un texte clair portant interdiction absolue de faire travailler un apprenti les jours fériés (Crim. 18 janv. 2005, Bull. crim. no 22). Quant au renseignement erroné donné par un professionnel du droit, il ne peut constituer une erreur inévitable. Ainsi, la chambre criminelle a-t-elle repoussé le moyen pris de l’erreur sur le droit invoqué par un mari en instance de divorce qui, ayant pénétré, à l’aide de l’un des moyens énumérés à l’article 226-4 du Code pénal, dans le domicile attribué à son épouse par décision judiciaire, arguait de ce que son avoué lui avait déclaré – par erreur – pouvoir agir de la sorte. C’est qu’en effet, s’agissant de la portée d’une décision judiciaire, « tout risque d’erreur pouvait être évité par une demande d’interprétation en application de l’article 461 du Code de procédure civile » (Crim. 11 oct. 1995, Dr. pénal 1996, comm. no 56; v. aussi : Crim. 17 févr. 1998, Bull. crim. no 60; à propos d’une lettre du représentant des créanciers, chargé du redressement judiciaire d’une personne poursuivie pour abandon de famille, qui enjoignait à celle-ci de cesser de payer la pension alimentaire, faute de déclaration de cette créance au passif : Crim. 7 janv. 2004, Bull. crim. no 5, RSC 2004, p. 635, obs. E. Fortis). L’article 122-3 du Code pénal n’admet donc l’erreur de droit que si celle-ci est invincible (Crim. 9 nov. 2004, Bull. crim. no 273) et a conduit la victime à croire que son acte est légitime (V. Crim. 12 sept. 2006, Bull. crim. no 218, RSC 2007, p. 73, obs. E. Fortis). Ainsi, a-t-il été jugé que l’erreur de droit était caractérisée, dès lors que l’intéressé a pu légitimement croire qu’il était autorisé à conduire avec son permis de conduire international, même s’il a été avéré que l’attestation, selon laquelle sa situation administrative était parfaitement régulière, lui avait été remise par erreur (Crim. 11 mai 2006, Bull. crim. no 128, Dr. pénal 2006, comm. no 109, obs. Véron). En revanche, l’existence de jurisprudences divergentes (entre la chambre criminelle et la chambre sociale) ne constitue pas une erreur de droit invincible permettant la relaxe du salarié ayant photocopié, sans autorisation, des documents appartenant à son employeur (Crim. 11 mai 2004, Bull. crim. no 113, 262 179 263 > 263 L’infraction B. L’erreur de fait 263 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 Dr. pénal 2004, comm. no 122, obs. M. Véron, RSC 2004, p. 866, obs. G. Vermelle; [on remarquera que, dans l’hypothèse visée, la chambre criminelle avait retenu, dans un premier temps, la qualification de vol, en affirmant que « toute appropriation de la chose d’autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l’utilisation du bien appréhendé » : Crim. 24 avr. 2001, Bull. crim. no 98, RSC 2001, p. 829, obs. G. Giudicelli-Delage. Puis, par les arrêts du 11 mai 2004 précités, elle a écarté cette qualification en s’alignant sur la position de la chambre sociale : Soc. 30 juin 2004, D. 2004, p. 2326, 3e esp., note H.-K. Gaba]. V. pour une étude détaillée, supra nos 205 et 205-1). L’erreur de droit n’a pas été non plus admise dans l’hypothèse où une société, qui s’était contentée de vérifier la définition des médicaments vétérinaires dans le dictionnaire, avait commercialisé certains produits en les considérant à tort comme des compléments alimentaires, alors qu’ils relevaient du monopole pharmaceutique (Crim. 4 oct. 2011, Bull. crim. no 191, Dr. pénal 2011, comm. no 146, note M. Véron). En cas de doute sur la légalité de l’acte accompli, l’erreur de droit ne pourra être retenue (Crim. 10 avr. 1997, Bull. crim. no 140). Quoi qu’il en soit, comme pour les autres causes de non-imputabilité, seule la personne poursuivie est fondée à se prévaloir de l’erreur de droit (Crim. 15 nov. 1995, RSC 1996, p. 647, obs. Bouloc), les juges du fond ne devant pas la relever d’office. Toutefois, cette erreur ne peut être soulevée par le prévenu pour la première fois devant la Cour de cassation (v. à propos des termes d’une circulaire interprétative : Crim. 27 mars 1996, Bull. crim. no 136). Dans certains cas, l’erreur de fait, qui porte sur l’un des éléments constitutifs de l’infraction ou sur une condition préalable, fait disparaître la responsabilité pénale de l’auteur. Ainsi, ne peut être considéré comme un voleur celui qui, par erreur, s’empare, dans le filet à bagages d’un wagon, d’une valise absolument identique à la sienne (on examinera toutefois la réalité de la bonne foi, car il peut s’agir d’un vol « à la substitution »; v. Crim. 17 nov. 2015, Dr. pénal 2016, comm. no 26, obs. Ph. Conte [l’élément intentionnel du vol fait défaut, lorsque « le prévenu avait pu croire de bonne foi à une autorisation tacite de l’employeur de disposer des chutes de câbles, compte tenu de l’ancienneté d’une telle pratique en cours dans l’entreprise »]). Dans d’autres hypothèses, l’erreur emporte changement de qualification, en transformant une infraction intentionnelle en délit d’imprudence. Ne commet donc pas le crime d’empoisonnement celui qui, par erreur, a fait absorber un poison à autrui (le fait constitue le délit d’homicide par imprudence). En ce qui concerne l’erreur sur l’identité de la victime, elle est juridiquement indifférente. Si, par exemple, le prévenu, voulant atteindre A d’un coup de feu, a tué par erreur B, il n’en est pas moins responsable d’un meurtre (son erreur n’altérant en rien l’élément moral de l’infraction). L’erreur de fait ne produit pas non plus un effet exonératoire en cas d’infractions non intentionnelles. Dans ces cas où l’élément moral consiste précisément en une négligence ou imprudence, l’erreur de fait ne fait pas disparaître ledit élément moral. Ainsi, le chas263 180 Les causes de non-responsabilité section 3 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 seur qui, persuadé de tirer sur un sanglier, blesse grièvement son camarade, est coupable du délit d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. La minorité pénale Évolution. Alors qu’actuellement, on insiste beaucoup sur la norme d’égalité et donc sur l’interdiction d’effectuer des discriminations, il peut paraître étonnant que parmi les personnes physiques, auteurs d’infractions, on fasse une distinction entre les majeurs et les mineurs. 264 264 – À vrai dire, cette distinction existe depuis très longtemps, puisque, en droit romain et dans le droit ancien, on tenait déjà compte de la « faiblesse naturelle » du discernement, au cours des diverses étapes de l’enfance (infantia et proximitas pubertatis…). Aussi bien, les rédacteurs de l’ancien Code pénal de 1810 ont conservé un statut spécial pour les mineurs, la majorité pénale étant alors fixée à 16 ans. À la différence des majeurs, les mineurs n’étaient responsables pénalement que s’ils avaient agi avec discernement. Si la réponse était affirmative, le mineur était pénalement responsable de ses actes. Toutefois, il s’exposait à une peine atténuée, puisqu’il bénéficiait de l’excuse légale atténuante (excuse de minorité). À l’inverse, si le mineur n’avait pas discerné, il devait être acquitté; mais en ce cas, il pouvait être soit remis à ses parents, soit conduit dans une maison de correction où il pouvait rester interné jusqu’à l’âge de 20 ans (art. 66 ancien C. pén.). – En réalité, même si la loi faisait état des maisons de correction, celles-ci n’avaient jamais été créées, et ce sont des initiatives privées qui ont œuvré jusqu’à l’intervention de la loi du 5 avril 1850 organisant des établissements spéciaux pour les mineurs. Il s’agissait des colonies pénitentiaires de jeunes détenus. Mais, dans ces établissements, on envoya non seulement ceux qui n’avaient pas discerné, mais encore ceux qui avaient discerné, de sorte que les mineurs recevaient le même traitement. Les « moins mauvais » pouvaient donc être pervertis. – Le premier pas vers un changement d’orientation résulte d’une loi du 19 avril 1898 qui a permis au juge d’instruction ou de jugement de confier la garde de l’enfant soit à ses parents, soit à une autre personne, soit à une institution charitable ou à l’Assistance publique. – Plus importantes ont été les lois du 12 avril 1906 et du 22 juillet 1912. La première a fixé la majorité pénale à 18 ans, mais les mineurs de 16 à 18 ans ne bénéficiaient pas de l’excuse atténuante de minorité. Le deuxième texte a institué, en faveur des mineurs de 13 ans, une présomption absolue d’irresponsabilité pénale; cette catégorie de mineurs ne pouvait être soumise qu’à des mesures éducatives. 265 Pendant la seconde guerre mondiale, une réforme a été réalisée par la loi du 17 juillet 1942 qui supprimait la question du discernement et affirmait l’irresponsabilité pénale totale du mineur de 13 ans. Par ailleurs, elle instituait le tribunal pour enfants, juridiction régionale présidée par un conseiller de cour d’appel, et prévoyait la création d’un centre d’observation. En réalité, cette loi n’a pas été appliquée, mais elle a servi de trame à l’ordonnance du 2 février 1945 qui, selon la doctrine, constitue actuellement « la charte en la matière » (V. B. Bouloc, Droit pénal général, op. cit., no 489). Cette ordonnance a supprimé la question du discernement pour tous les mineurs de 18 ans et étendu le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité aux mineurs de 16 à 18 ans, tout en autorisant le juge à l’écarter pour ces derniers par une décision spécialement motivée. Par ailleurs, elle a 265 181 266 > 266 L’infraction maintenu le tribunal pour enfants et a créé, pour présider cette juridiction, le juge des enfants. Depuis lors, de nombreux textes sont venus modifier cette ordonnance. Parmi ceux-ci, on en retiendra notamment la loi du 9 septembre 2002 qui a donné un sens à l’article 122-8 du Code pénal. Par ailleurs, de nombreux projets de réforme ont été envisagés. À vrai dire, une réforme de la matière paraît absolument nécessaire, car l’ordonnance du 2 février 1945, ayant été modifiée substantiellement à de très nombreuses reprises en 73 ans, a perdu de sa pertinence et de son efficacité. C’est pour cette raison qu’une commission, présidée par le recteur A. Varinard, a été chargée de formuler des propositions pour réformer la justice pénale des mineurs. Cette commission a rendu un rapport comportant 70 propositions, parmi lesquelles figurent notamment « la fixation à 12 ans de l’âge de la responsabilité pénale, l’élaboration d’une liste exhaustive et simplifiée des sanctions éducatives et des peines, la constitution d’un dossier unique de personnalité » (V. Dr. pénal 2008, no 12, dossier spécial sur la Réforme de la justice des mineurs, p. 6 et s.). Mais ces suggestions n’ont pas, pour le moment, donné lieu à une réforme de grande ampleur en la matière. La loi no 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs n’a pas modifié les règles de fond contenues dans l’ordonnance du 2 février 1945 mais uniquement celles de procédure. En particulier, ce texte avait pour objectif d’« améliorer l’efficacité de la procédure de jugement des mineurs, en permettant des réponses pénales plus rapides et mieux adaptées à leur personnalité ». Plus précisément, selon la loi du 10 août 2011, les mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans et commis en état de récidive légale, devaient être jugés par un tribunal correctionnel pour mineur, présidé par un juge des enfants et appliquant les règles de procédure édictées par l’ordonnance du 2 février 1945 pour le jugement des mineurs par le tribunal pour enfants (ancien art. 24-1 de l’Ord. du 2 févr. 1945). Le juge des enfants, ayant renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ne pouvait présider cette juridiction. Le même texte a, en outre, élargi les possibilités de placer des mineurs en centre éducatif fermé ou de convertir leur peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (cette possibilité concerne les mineurs âgés de 16 ans au jour de la décision; v. art. 20-5 de l’Ord. du 2 févr. 1945). Enfin, la loi du 10 août 2011 a prévu la création d’un « dossier unique de personnalité », commun aux différentes procédures pouvant concerner le mineur en cause et a renforcé l’implication des parents des mineurs poursuivis. Ces derniers (et les représentants légaux) sont informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions (art. 6-1 de l’Ord. du 2 févr. 1945). Le droit pénal des mineurs a également fait l’objet d’une réforme due à la loi no 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette dernière a, d’abord, supprimé le tribunal correctionnel pour mineurs (art. 29 de la loi), dont la création avait donné lieu à de nombreuses critiques car elle méconnaissait le principe de la spécialisation de la justice pénale des mineurs (la majorité des magistrats, constituant cette juridiction, était non spécialisée). De plus, les statistiques démontraient que peu d’affaires avaient été soumises à la connaissance de cette juridiction, et que ses décisions 26 182 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 266 Les causes de non-responsabilité 267 Droit actuel. En ce qui concerne la responsabilité pénale des mineurs, l’article 122-8 du Code pénal, inséré par la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002, indique que seuls « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ». Le même texte précise, par ailleurs, que cette loi (Ord. du 2 févr. 1945 mod.) détermine les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans, ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de 13 à 18 ans. Sans aucun doute, ce texte est en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 (JO 10 sept. 2002, p. 14953) qui a expressément reconnu le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, ainsi que la nécessité de privilégier l’application des mesures éducatives personnalisées prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Le principe est donc que le mineur doit bénéficier prioritairement de mesures éducatives (art. 2 de l’Ord. du 2 févr. 1945) et, à titre exceptionnel, il peut faire l’objet de véritables peines. En outre, le cumul entre les mesures éducatives et les peines est autorisé. 267 § 268 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 ne faisaient pas preuve d’une grande sévérité, si bien que les objectifs législatifs étaient loin d’être atteints (C. Fleuriot, « Tribunaux correctionnels pour mineurs : le bilan de la Chancellerie », Dalloz actualité, 3 févr. 2015). En outre, la loi précitée a facilité le cumul entre les peines et les mesures éducatives (v. infra no 271). Ces précisions données, et en attendant éventuellement l’adoption d’un Code de la justice pénale des mineurs, tel qu’il a été annoncé en 2009 (V. Dr. pénal avril 2009, focus 17, p. 3), il convient d’étudier les principales règles du droit actuel applicables aux mineurs. 1 Les mesures applicables aux mineurs Les mesures éducatives. La « préférence éducative » résulte clairement de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui accorde une priorité indiscutable aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation (v. aussi art. 15). En particulier, s’agissant des mineurs de 13 ans, cette préférence est « absolue » (B. Bouloc, Droit pénal général, op. cit., no 491). C’est qu’en effet, ces mineurs ne peuvent se voir appliquer que des mesures de sûreté, tandis que, en cas de contraventions des quatre premières classes, ils ne peuvent faire l’objet que d’une admonestation prononcée par le tribunal de police. Cependant, comme l’a clairement affirmé la chambre criminelle, par l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 (D. 1957, p. 349, note Patin), une mesure de protection et d’assistance (comme la remise de l’enfant à sa famille) ne peut être ordonnée qu’à condition que le mineur ait compris et voulu l’acte délictueux qu’il a commis. Aussi bien, la loi du 9 septembre 2002 a repris cette solution, les mesures éducatives ne devant être prononcées qu’à l’encontre des mineurs capables de discernement. On remarquera que cette règle a été expressément rappelée, par un arrêt de la chambre cri268 183 269 > 269 L’infraction 269 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 minelle du 14 novembre 2017 (no 17-80.893), dans une affaire où un mineur âgé de cinq ans avait été déclaré, par la juridiction de proximité, coupable de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique, comme étant titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant fait l’objet des procès-verbaux de constatation de ces infractions. Cette décision, qui tendait, en effet, à stigmatiser la pratique des prête-noms, a été censurée par la Cour de cassation ayant déclaré qu’« en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu était capable de discernement », la juridiction de proximité avait méconnu les dispositions de l’article 122-8 du Code pénal. Ces précisions données, les mesures éducatives (v. art. 15 et 16 de l’Ord. du 2 févr. 1945) consistent dans la remise du mineur à sa famille, au tuteur ou à une personne digne de confiance, quel que soit l’âge du mineur (ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur de treize ans, dans la remise au service de l’assistance à l’enfance). Le tribunal pour enfants peut aussi placer le mineur dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité, dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire (ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur de plus de treize ans, dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective). On pourra faire observer que la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance a ajouté à cette liste la mesure d’activité de jour, consistant dans la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire, soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fixe la durée de cette mesure, qui ne peut excéder douze mois, et les modalités d’exercice (art. 16 ter de l’Ord. du 2 févr. 1945). En tout cas, la mesure d’activité de jour doit être compatible avec les obligations scolaires. Mais, en dehors des mesures éducatives, la loi du 9 septembre 2002 a accordé au juge la possibilité de prononcer des sanctions éducatives. Les sanctions éducatives. Les mineurs âgés d’au moins 10 ans peuvent faire l’objet d’une ou de plusieurs sanctions éducatives visées par l’article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945. À vrai dire, le choix de ce terme ne peut que susciter les plus grandes réserves, dans la mesure où il réunit deux notions opposées, ce qui a amené certains à penser que les mineurs de 10 ans pouvaient être punis. Les sanctions éducatives peuvent revêtir plusieurs formes. Il peut s’agir de la confiscation d’un objet détenu ou appartenant au mineur, de l’interdiction de paraître, pour une durée maximale d’un an, dans les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, de l’interdiction de rencontrer ou de recevoir la victime, les coauteurs ou les complices de l’infraction, de l’obligation de suivre un stage de formation civique, d’une durée maximale d’un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. La loi vise également, parmi d’autres mesures, le placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité permettant la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social, l’exécution des travaux scolaires ou le placement dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant à une année scolaire. 269 184 Les causes de non-responsabilité § 270 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 La question qui se pose ici est celle de savoir quelle est la véritable nature de ces mesures. Certaines de celles-ci sont qualifiées de peines à l’égard du sursis avec mise à l’épreuve. Tel est, par exemple, le cas de l’obligation de ne pas fréquenter les auteurs ou les complices de l’infraction ou de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime de celle-ci. En revanche, d’autres mesures, telles que le placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité, présentent un caractère éducatif accentué. Vu le caractère contestable de ces sanctions, il est permis de penser que certaines de celles-ci ne devraient s’appliquer qu’aux mineurs d’au moins 13 ans. Quoi qu’il en soit, le tribunal pour enfants devra désigner le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution des sanctions éducatives. Aussi bien, la violation par le mineur de ces dernières peut-elle entraîner son placement dans une institution ou un établissement d’éducation ou de formation professionnelle, dans un établissement médical ou médico-pédagogique ou dans un internat approprié. Enfin, la loi prévoit la possibilité de prononcer de véritables peines à l’encontre des mineurs. 2 Les peines applicables aux mineurs L’article 2, al. 2, de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent prononcer une peine à l’encontre des mineurs de 13 à 18 ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Il est vrai que tous les mineurs de 13 à 18 ans ne peuvent, en principe, se voir appliquer que des mesures éducatives. Cependant, devant la recrudescence de la délinquance juvénile, les statistiques les plus récentes font apparaître une augmentation du nombre de mineurs faisant l’objet d’une condamnation à une véritable peine. Mais, avant d’y recourir, les juges devront prendre en considération la gravité de l’infraction, les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise et le caractère dangereux de la personnalité du délinquant mineur. À vrai dire, une condamnation à une peine peut, notamment, paraître justifiée dans l’hypothèse où le mineur de 13 à 18 ans méconnaît systématiquement les mesures éducatives dont il fait l’objet, ce qui peut entraîner le prononcé d’une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve. On est amené à reconnaître qu’une peine d’emprisonnement ferme n’est qu’exceptionnellement prononcée à l’encontre d’un mineur de 13 à 18 ans. Dans la plupart des cas, les juges retiennent la peine d’emprisonnement assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve. Dans toutes ces hypothèses, ils sont même tenus de motiver spécialement le choix de la peine, qu’il s’agisse d’une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis (art. 2, al. 3, de l’Ord. du 2 févr. 1945). Lorsque la peine encourue est une peine privative de liberté, le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. S’il s’agit de la réclusion ou de la détention criminelle à perpétuité, le mineur ne peut être condamné à plus de 20 ans de réclusion ou de détention criminelle (art. 20-2 de l’Ord. du 270 185 271 > 271 L’infraction § 271 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 2 févr. 1945). Toutefois, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, décider d’écarter la réduction de peine (« cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une décision spécialement motivée »). Aussi bien, doivent-ils le faire, en tenant compte des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, ainsi que de sa situation (la loi no 20071198 du 10 août 2007 avait prévu de limiter la diminution de la peine pour les mineurs récidivistes ou auteurs de certaines infractions commises avec violence mais la loi no 2014-896 du 15 août 2014 a abrogé ces dispositions). S’il s’agit de la peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. Les dispositions relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs. Par ailleurs, certaines peines complémentaires, telles que l’interdiction du territoire français, le jour-amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l’interdiction de séjour, ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur (art. 20-4 de l’Ord. du 2 févr. 1945). En revanche, le stage de citoyenneté peut être prononcé à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans (art. 20-4-1 de l’Ord. du 2 févr. 1945), tandis que ceux de seize à dix-huit ans peuvent être condamnés à l’exécution de travaux d’intérêt général qui doivent présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés (art. 20-5 de l’Ord. du 2 févr. 1945; le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice propose d’appliquer la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique, dont la création est prévue par ce texte [art. 131-4-1 C. pén., modifié]), aux mineurs de seize à dix-huit ans; cette peine ne pourrait être prononcée sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement (art. 20-7 de l’Ord. du 2 févr. 1945 rétabli). Quant à la peine d’amende, elle ne peut être d’un montant supérieur à la moitié de l’amende encourue ou excéder 7 500 euros (art. 20-3 de l’Ord. du 2 févr. 1945). Enfin, aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un mineur (art. 20-6 de l’Ord. du 2 févr. 1945). 3 Le cumul entre les mesures éducatives et les peines Lorsque le tribunal pour enfants prononce une condamnation pénale, il peut, en outre, « si la personnalité du mineur le justifie », prononcer des mesures éducatives, comme celles définies aux articles 12-1 (une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité), 16 (la remise du mineur à sa famille, au tuteur ou à une personne digne de confiance, le placement du mineur dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité, dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire…), 16 bis (la mise sous protection judiciaire) et 16 ter (une mesure d’activité de jour) de l’ordonnance du 2 février 1945. De même, la Cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives visées aux articles 16 (1° à 4°), 16 bis et au 271 186 Les causes de non-responsabilité international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 chapitre IV de l’ordonnance précitée (art. 30, 1°, loi 18 nov. 2016; art. 2, al. 4, de l’ord. du 2 févr. 1945). Le cumul entre les peines et les mesures éducatives est donc possible (toutefois, les mesures ou les sanctions éducatives prononcées à l’encontre d’un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive). Ainsi, le mineur, à l’encontre duquel a été prononcée une peine d’emprisonnement assorti, par exemple, d’un sursis avec mise à l’épreuve, pourra faire l’objet d’un placement dans un centre éducatif fermé ou dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité. Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce une mesure éducative (mentionnée aux articles 15, 16 et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945), elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. La dispense et l’ajournement ne peuvent pas seulement être ordonnés pour le prononcé des peines, mais aussi pour des mesures ou des sanctions éducatives. Toutefois, en cas d’ajournements successifs, la décision sur la mesure éducative, sur la sanction éducative ou sur la peine doit intervenir au plus tard un an après la première décision d’ajournement (art. 32 de la loi 18 nov. 2016; art. 24-5, al. 3 mod., de l’ord. du 2 févr. 1945). 187 Faits justificatifs 188 Cause générale (profite aux complices) Cause générale (toutes infractions sauf involontaires) Dès que la cause est constatée (même à l’instruction) Non-lieu ou relaxe (acquittement) Aucune peine Aucune réparation Aucune mesure 2° Conséquences quant aux participants 3° Conséquences quant aux infractions couvertes 1° Moment de l’effet 2° Forme de la décision 1° Sanction pénale 2° Sanction civile 3° Mesures de sûreté Causes de non-imputabilité Cause générale (toutes infractions) Cause personnelle (ne profite pas aux complices) Efface l’élément moral de l’infraction et la culpabilité de l’agent Trouble psychique ou neuropsychique Exemption de peine Cause particulière (pour les infractions prévues) Cause personnelle à ceux qui réalisent la condition Exempte de peine sans effacer la criminalité de l’acte ni la culpabilité Dénonciateur ou « repenti » Immunités Cause générale (toutes infractions) Cause personnelle (ne profite pas aux complices) Intangibilité du souverain ou de l’État étranger Diplomate Mesure possible (l’hospitalisation complète et les « mesures de sûreté » visées à l’art. 706-136 C. pr. pén.) Sanction civile possible Aucune peine Ordonnance d’irresponsabilité pénale ou décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Dès que la cause est constatée (même à l’instruction) Mesure possible (par exemple confiscation) Sanction civile possible Aucune peine Exemption de peine Après la culpabilité reconnue (par la juridiction de jugement) Aucune mesure Aucune sanction Aucune peine Irrecevabilité de la poursuite Dès que la cause est constatée international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 Disparition de l’incrimination (c’est-à-dire de l’élément légal) Légitime défense 1° Quant au principe Exemple caractéristique Tableau no II Tableau comparatif des principales causes d’impunité 271 > 271 L’infraction Chapitre 5 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 L’essentiel L’acte qui présente toutes les apparences d’une infraction punissable cesse d’en être une en raison des circonstances dans lesquelles il a été accompli. On appelle de telles circonstances des faits justificatifs. Ceux-ci se distinguent des autres causes d’impunité en raison de leur caractère objectif qui supprime l’élément délictueux de l’acte accompli. L’impunité procède donc ici de la disparition de l’incrimination, c’est-à-dire de l’élément légal. Elle ne doit pas être confondue avec celle qui résulte des causes de non-imputabilité qui sont subjectives et personnelles, et font disparaître l’élément moral de l’infraction. Enfin, le Code pénal traite de la question de la responsabilité pénale des mineurs à l’article 122-8. 1. Les faits justificatifs La loi a prévu trois faits justificatifs : la légitime défense, l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime, l’état de nécessité. En dehors de ces faits justificatifs, la jurisprudence en a créé un autre, celui tiré de l’« exercice des droits de la défense ». Enfin, une partie de la doctrine se demande si le consentement de la victime pourrait être une cause d’irresponsabilité pénale. En ce qui concerne la légitime défense (art. 122-5 C. pén.), elle suppose, d’une part, un acte d’attaque et, d’autre part, un acte de riposte. L’attaque doit être actuelle ou imminente. En outre, elle doit être injuste. Ainsi, il n’y a pas de légitime défense contre celui qui ne fait qu’exercer un droit (par exemple, un policier procédant à une perquisition en cas de flagrance). Quant à la riposte, elle doit être nécessaire; par ailleurs, elle doit être proportionnée (une atteinte aux biens ne peut justifier l’homicide volontaire de l’agresseur) et concomitante à l’attaque. Aussi bien, elle peut être justifiée non seulement pour repousser l’agression dont on est soi-même victime, mais encore celle dont un tiers quelconque est victime. En tout cas, la jurisprudence limite l’application de la légitime défense aux seules infractions volontaires, en affirmant que ce fait justificatif « est inconciliable avec le caractère involontaire d’une infraction ». Quand il concerne la défense des biens, l’acte de riposte doit être mesuré et ne peut justifier un acte homicide. Lorsque la légitime défense est reconnue par le juge pénal, elle ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire. 189 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 S’agissant de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime, ils sont visés à l’article 122-4 du Code pénal. Le premier cas concerne l’acte prescrit ou autorisé par la loi, pouvant résulter d’une disposition législative ou réglementaire. À ces hypothèses, il est permis d’assimiler la coutume. Quant au commandement de l’autorité légitime, il peut exonérer de toute responsabilité pénale, sauf si l’ordre donné est manifestement illégal. Par autorité légitime, il faut entendre une autorité publique; en revanche, une autorité privée, comme celle des parents sur leur enfant, n’entre pas dans les prévisions de la loi. Il en est de même, dès lors que l’on est en présence d’un ordre, dont le caractère illicite est manifeste (par exemple, un ordre portant sur la destruction de biens, de manière clandestine, par des moyens dangereux pour les personnes). Un troisième fait justificatif prévu par la loi est l’état de nécessité (art. 122-7 C. pén.). Il s’agit de la situation dans laquelle une personne commet volontairement une infraction, afin d’éviter pour elle-même ou pour autrui un danger actuel ou imminent. À vrai dire, cette situation se différencie de la légitime défense en ce que le mal, dont on est menacé, ne résulte pas de l’agression d’un tiers mais d’un concours de circonstances. Dans la présente hypothèse, la commission de l’infraction doit apparaître comme le moyen indispensable d’éviter le mal, dont l’agent (ou un tiers) est menacé. Selon la loi, l’acte accompli doit être « nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ». Aussi bien, la jurisprudence estime que cet acte doit être l’unique moyen de conjurer le danger. Par ailleurs, il faut que les moyens employés par celui qui invoque l’état de nécessité soient proportionnés à la gravité de la menace et que le mal écarté soit grave, et plus grave que celui résultant de l’infraction. Aux faits justificatifs prévus par la loi, il faut en ajouter un autre, créé par la jurisprudence, celui tiré de l’« exercice des droits de la défense ». En particulier, la chambre criminelle refuse de retenir la qualification de vol dans l’hypothèse où un salarié appréhende ou reproduit, sans l’autorisation de son employeur, des documents appartenant à l’entreprise, dont il a connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors que ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le litige l’opposant à son employeur. En érigeant l’exercice des droits de la défense en un fait justificatif et en prenant soin de bien encadrer les hypothèses dans lesquelles ce fait peut produire un effet exonératoire (procès prud’homal), la jurisprudence a entendu lui réserver une certaine autonomie, si bien qu’il est difficile de considérer qu’il s’agit d’une forme particulière d’un des faits justificatifs réglementés par la loi. Les lois du 9 décembre 2016 et du 28 février 2017 ont prévu une cause de justification pour le lanceur d’alerte en matière de crimes ou de délit ou d’une violation d’un engagement international. Les forces de l’ordre, les douaniers et les agents pénitentiaires peuvent faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité, et de matière proportionnée, notamment en cas d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, ou après sommation en cas de fuite de personnes pouvant porter atteinte à leur vie, leur intégrité physique ou à celles d’autrui. Enfin, contrairement aux faits justificatifs, le consentement de la victime ne produit, en principe, aucun effet exonératoire. C’est qu’en effet, l’infraction est réprimée par la société parce qu’elle cause un trouble à l’ordre public et l’appréciation 190 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 de ce trouble appartient aux pouvoirs publics et non aux particuliers. Cependant, le consentement de la victime peut être efficace, lorsqu’il s’agit d’une infraction exigeant chez son auteur une contrainte, une violence ou une fraude. Dans ces hypothèses, l’acceptation de l’intéressé supprime l’un des éléments constitutifs de l’infraction (tel est, par exemple, le cas pour le viol ou le délit de violation de domicile). Toutefois, pour que le consentement de la victime produise un effet exonératoire, il faut qu’il soit antérieur ou concomitant à la commission des faits incriminés. Ensuite, il doit être donné librement et en connaissance de cause. Enfin, il faut que l’intéressé soit capable de comprendre la portée de son consentement. Mais, en dehors des faits justificatifs, l’existence d’une cause subjective de nonimputabilité peut également exonérer de toute responsabilité pénale. 2. Les causes de non-imputabilité Tout d’abord, l’article 122-1, al. 1er, du Code pénal déclare une personne pénalement irresponsable si elle a été atteinte, au moment des faits, de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le terme de « trouble psychique ou neuropsychique » désigne toute forme d’aliénation mentale enlevant à l’individu le contrôle de ses actes. Ce trouble doit exister au moment de la commission de l’acte prohibé par la loi pénale. Si la personne se trouve dans un intervalle lucide au moment des faits, sa responsabilité pénale pourra être engagée. De même, ne produisent pas d’effet exonératoire les troubles qui « altèrent » seulement le discernement ou « entravent » le contrôle des actes de l’individu. Les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent, depuis la loi du 25 février 2008, faire l’objet d’une nouvelle procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La même loi a, en outre, prévu toute une série de mesures de sûreté, susceptibles d’être prononcées à leur encontre, visées aux articles 706-135 et 706-136 du Code de procédure pénale. Ces personnes restent, par ailleurs, civilement responsables de leurs actes, en vertu de l’article 414-3 du Code civil. La loi vise, ensuite, la contrainte (art. 122-2 C. pén.) qui, comme le trouble psychique ou neuropsychique, fait disparaître l’élément moral de l’infraction et, par là même, supprime la responsabilité pénale de l’auteur. La contrainte, en abolissant la volonté, supprime toute liberté de l’agent. On peut distinguer la contrainte physique (qui suppose une force s’exerçant sur le corps même de l’agent) et la contrainte morale (qui peut être provoquée par une pression exercée sur la volonté d’une personne ayant pour conséquence d’abolir son libre arbitre). Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre, elle n’exclut la responsabilité pénale que si elle a été irrésistible. Selon la jurisprudence, la contrainte ne peut être retenue que si elle résulte d’un événement que « la volonté humaine n’a pu ni prévenir, ni conjurer ». Par ailleurs, elle ne doit pas être précédée par une faute de l’agent (elle doit être imprévisible). Enfin, aux précédentes causes de non-imputabilité, il faut ajouter l’erreur. On peut distinguer entre l’erreur de droit et l’erreur de fait. L’erreur de droit se trouve expressément consacrée par l’article 122-3 du Code pénal qui dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légi191 timement accomplir l’acte ». Il en résulte donc que l’erreur de droit ne doit être admise que si celle-ci est invincible et a conduit la victime à croire que son acte est légitime. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 Quant à l’erreur de fait, elle peut faire disparaître la responsabilité pénale de l’auteur, si elle porte sur l’un des éléments constitutifs de l’infraction ou sur une condition préalable. Dans d’autres hypothèses, cette erreur emporte changement de qualification, en transformant une infraction intentionnelle en délit d’imprudence. En revanche, l’erreur sur l’identité de la victime est juridiquement indifférente. De même, l’erreur de fait ne produit aucun effet exonératoire en cas d’infractions non intentionnelles. Ces précisions données, il est permis de se demander si la minorité de l’auteur peut produire des effets analogues. 3. La minorité pénale Selon l’article 122-8 du Code pénal, les « mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ». En particulier, en ce qui concerne les mineurs de 13 ans, la « préférence éducative » est « absolue ». C’est qu’en effet, ces mineurs ne peuvent se voir appliquer que des mesures éducatives (par exemple, la remise du mineur à sa famille, au tuteur ou à une personne digne de confiance, son placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité, la mesure d’activité de jour, etc.), tandis que, en cas de contraventions des quatre premières classes, ils peuvent faire l’objet d’une admonestation prononcée par le tribunal de police. Cependant, comme l’a clairement affirmé la chambre criminelle, par l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 (D. 1957, p. 349, note Patin), une mesure de protection et d’assistance (comme la remise de l’enfant à sa famille) ne peut être ordonnée qu’à condition que le mineur ait compris et voulu l’acte délictueux qu’il a commis. S’agissant des mineurs âgés d’au moins 10 ans, ils peuvent faire l’objet d’une ou de plusieurs sanctions éducatives visées à l’article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 (placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation habilité, exécution des travaux scolaires, interdiction de paraître dans certains lieux ou de recevoir certaines personnes, etc.). Quant aux mineurs de 13 à 18 ans, le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent prononcer une peine à leur encontre en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945. Lorsque la peine encourue est une peine privative de liberté, le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. S’il s’agit de la réclusion ou de la détention criminelle à perpétuité, le mineur ne peut être condamné à plus de 20 ans de réclusion ou de détention criminelle (art. 20-2 de l’Ord. du 2 févr. 1945). Toutefois, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tri192 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 bunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, décider d’écarter la réduction de peine. Aussi bien, ils doivent le faire, en tenant compte des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, ainsi que de sa situation. S’il s’agit de la peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. Enfin, le cumul entre les mesures éducatives et les peines est autorisé. 193 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 Sujets de concours Chapitre 5 Commissaire de police, concours externe, 2010 La responsabilité pénale des mineurs doit-elle évoluer ? Greffier en chef, concours externe et interne, 2008 La minorité pénale Commissaire de police, concours externe, 2013 La légitime défense Greffier, concours externe et interne, 2006 La responsabilité pénale des mineurs Greffier, épreuve orale, 2004 Le trouble psychique et neuropsychique Magistrat, concours externe, 2010 La condition du mineur délinquant : un statut autonome protecteur ? Commissaire de police, 2013 La légitime défense Officier de gendarmerie, 2013 La notion de discernement Greffier, concours interne, 2014 La contrainte 194 6 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 chapitre Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices 272 Dans la conception classique, qui est celle du droit pénal français, les délinquants sont ceux qui ont commis un acte prévu et défini par la loi pénale. Dès lors que l’infraction comporte un élément moral, ni les choses ni les animaux ne peuvent être des sujets actifs d’un fait délictueux. Seuls les êtres humains peuvent être responsables pénalement. Est-ce à dire que les groupements de personnes – auxquels le droit reconnaît une existence juridique, et qu’on dénomme les personnes morales, – ne puissent pas être pénalement responsables ? Le nouveau Code pénal a résolu cette question. Par ailleurs, n’y a-t-il que les personnes ayant matériellement commis l’action prohibée qui puissent être pénalement responsables ? Ne doit-on pas aussi punir celui qui a aidé, en connaissance de cause, l’auteur de l’infraction ? C’est le problème de la complicité punissable qui se pose. Enfin, il faudra se demander si le droit contemporain n’admet pas parfois une certaine responsabilité pénale du fait d’autrui, quand il s’agit du chef d’entreprise. 272 section 1 Les personnes punissables § 273 1 Les personnes physiques Engage sa responsabilité pénale la personne physique qui accomplit matériellement tous les actes prohibés par la loi. On appelle cette personne l’auteur matériel. C’est, par exemple, celui qui tire le coup de feu mortel ou celui qui dérobe des bijoux ou de l’argent. Dans l’hypothèse d’une infraction d’omission, est auteur celui sur qui pesait l’obligation d’agir. 273 195 274 > 276 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 Si deux ou plusieurs personnes accomplissent les actes matériels constitutifs d’une infraction, elles seront considérées comme coauteurs. Cette situation est à distinguer de celle de la complicité où un auteur bénéficie de l’aide d’autrui pour des actes antérieurs ou concomitants à la consommation de l’infraction, mais ne faisant pas partie de l’élément matériel de celle-ci. 274 Parfois, la loi fait de la pluralité de personnes ayant participé à un agissement délictueux une condition nécessaire d’une incrimination particulière. Ainsi, l’association de malfaiteurs (définie comme étant « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement »; art. 450-1 C. pén.) est punissable en tant qu’infraction autonome (et expose à un emprisonnement correctionnel de dix ou de 5 ans selon la gravité des infractions projetées). La loi réprime, par ailleurs, la violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, qualifiée de « mouvement insurrectionnel » (art. 412-3 C. pén.). Cette infraction ne requiert pas un accord ou une entente, à la différence du complot, nécessitant une résolution arrêtée entre plusieurs personnes (art. 412-2 C. pén.). Il est permis de constater que, dans toutes ces hypothèses, la pluralité des participants constitue une forme de criminalité particulièrement dangereuse pour l’ordre public, justifiant l’application de graves sanctions. 275 Dans d’autres cas, le législateur fait de la pluralité de personnes une circonstance aggravante de certaines infractions. Ainsi, la bande organisée (définie comme étant tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions; art. 132-71 C. pén.) est une circonstance aggravante attachée au trafic des stupéfiants, à l’enlèvement et à la séquestration de personnes, au proxénétisme, au vol, à l’extorsion de fonds, à la fausse monnaie, etc. On peut aussi faire observer qu’un certain nombre d’infractions (meurtre, tortures et actes de barbarie, vol…), commises en bande organisée, relève de la délinquance et de la criminalité organisées (art. 706-73, 706-73-1, 706-74 C. pr. pén.), justifiant l’application des règles de procédure dérogatoires à celles du droit commun (V. supra, no 72). En outre, la loi se montre plus sévère en cas d’infraction commise en réunion. Ainsi, la « rébellion commise en réunion » entraîne une aggravation de la peine (art. 433-7, al. 2, C. pén.). On s’accorde généralement pour admettre que la réunion requiert une entente préalable entre les participants. 276 En dehors de l’auteur matériel, certaines législations incriminent l’auteur intellectuel ou moral d’une infraction. En France, ce dernier ne peut être considéré comme « auteur » que dans les hypothèses où la loi le prévoit expressément (v. art. 432-4 C. pén., sanctionnant le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, tel qu’une arrestation, une détention ou une rétention arbitraires). Les rédacteurs du nouveau Code pénal avaient envisagé de généraliser ces situations et d’incriminer directement l’instigateur, c’est-à-dire celui qui fait sciemment commettre par un tiers l’acte délictueux. Mais le Parlement n’a pas retenu cette suggestion. Toutefois, de nombreux 274 275 276 196 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices textes, parfois extérieurs au Code pénal, assimilent à l’auteur « matériel » celui qui fait faire. 277 2 Les personnes morales international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 § Évolution. Sous l’empire du Code pénal de 1810, l’irresponsabilité pénale des personnes morales avait prévalu, car elles ne pouvaient commettre une faute personnelle et les peines prévues par la loi pour les personnes physiques (peines privatives de liberté) étaient inadaptées. Cependant, à l’appui de la thèse de la responsabilité pénale des personnes morales, on a fait valoir que celles-ci constituent une réalité juridique et ont une volonté propre; il est donc possible de leur imputer une faute. Quant à l’argument tiré de ce que les sanctions pénales (comme la peine d’emprisonnement) sont inapplicables aux personnes morales, il n’est pas fondé, dans la mesure où certaines peines peuvent être prononcées à leur encontre (par exemple, l’amende, la confiscation ou la dissolution). Ces derniers arguments, en combinaison avec l’apparition de nombreux scandales financiers, ont finalement incité les rédacteurs du nouveau Code pénal à retenir la responsabilité pénale des personnes morales. Ainsi, l’article 121-2 du Code pénal, modifié par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, prévoit que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Il convient donc de déterminer les personnes morales pouvant être pénalement responsables et les conditions requises pour l’engagement de leur responsabilité. Par ailleurs, il est permis de se demander si la responsabilité pénale des personnes morales pourrait exclure celle des personnes physiques. 27 A. Les personnes morales pénalement responsables 278 Règles générales. Toutes les personnes morales sont visées par l’article 121-2 du Code pénal, à l’exclusion de l’État, qui a le monopole de la répression, et des collectivités territoriales, lorsque celles-ci accomplissent des activités régaliennes. En revanche, les collectivités territoriales et leurs groupements sont pénalement responsables des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de donner lieu à des conventions de délégation de service public. Ainsi, a-t-il été jugé que l’animation des classes de découverte pendant le temps scolaire constitue une activité du service public de l’enseignement public et ne peut donner lieu à des conventions de délégation de service public (de ce fait, la responsabilité pénale de la ville de Grenoble n’a pas été retenue : Crim. 12 déc. 2000, aff. du Drac, Bull. crim. no 371, Dr. pénal 2001, comm. no 43). En revanche, les collectivités territoriales peuvent engager leur responsabilité pénale, quand elles exploitent un domaine skiable (Crim. 14 mars 2000, Bull. crim. no 114, RSC 2000, p. 816, obs. B. Bouloc). De même, l’activité d’exploitation d’un théâtre peut être accomplie en régie ou par délégation. Aussi bien, si un accident survient lors de travaux de rénovation, la responsabilité pénale de la commune peut être mise en jeu (Crim. 3 avr. 2002, Bull. crim. 278 197 279 > 279 L’infraction 279 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 no 77, RSC 2002, p. 810, obs. B. Bouloc). Une solution analogue peut également recevoir application lorsqu’un accident survient « à l’occasion d’une activité de loisirs susceptible d’une délégation de service public, mise en œuvre par la commune au moyen d’un contrat de prestation de service conclu avec une société privée » (Crim. 28 juin 2016, no 15-83.862; v. aussi : Crim. 6 avr. 2004, Bull. crim. no 89 : si l’exploitation du service des transports scolaires peut faire l’objet d’une délégation de service public, il n’en est pas de même de son organisation qui est confiée au seul département). Mais, en dehors de ces réserves, toutes les personnes morales de droit public et de droit privé (à but lucratif ou non) sont concernées par la loi (sociétés civiles ou commerciales, associations, syndicats). Il suffit que le groupement soit doté de la personnalité morale, ce qui exclut les sociétés en formation et les groupes de sociétés. Quant à la nationalité de la société, elle importe peu, car le droit pénal est territorial (V. supra, no 127). Une société étrangère peut donc être pénalement responsable, dès lors qu’elle a accompli une infraction en France ou relevant de la compétence législative du droit français (v. par ex. Crim. 21 janv. 2007, Bull. no 28). La possibilité ou non de poursuivre pénalement pour des infractions commises par une société disparue à la suite des opérations de fusion ou de scission. Certaines difficultés pratiques peuvent surgir lorsqu’une société, à qui tel ou tel manquement constitutif d’infraction pénale est imputé, disparaît à la suite des opérations de fusion (ou de scission). Dans le cas d’une fusion par absorption, l’une des deux sociétés disparaît et son patrimoine est dévolu à la société absorbante (ou à une société nouvelle). En pareille hypothèse, si une infraction a été commise par la société absorbante, comme celle-ci demeure, sa responsabilité pénale ne disparaît pas. En revanche, la personnalité morale cesse pour la société absorbée et, sur le terrain du droit des personnes morales, on considère qu’il y a dissolution sans liquidation. Par conséquent, la société absorbée ne pourra pas être poursuivie et condamnée pour une infraction commise avant la fusion. Comme la Cour de cassation l’a clairement affirmé (Crim. 18 févr. 2014, no 12-85.807), la fusion-absorption faisant perdre son existence juridique à la société absorbée, l’action publique est éteinte à son égard, conformément aux prescriptions de l’article 6 du Code de procédure pénale (En revanche, dans l’hypothèse de la transformation d’une personne morale au cours de son existence, la personnalité morale demeure, comme l’exprime l’article 1844-3 du Code civil; il n’y a pas alors de création de personne morale nouvelle et, de ce fait, les agissements délictueux ne cessent d’être imputables à ladite personne morale). Néanmoins, la question qui se pose est celle de savoir si la société absorbante peut être responsable pénalement des infractions commises par la société absorbée. La chambre criminelle, en se fondant sur l’article 121-1 du Code pénal qui institue le principe de la responsabilité pénale personnelle, a estimé, par un arrêt du 20 juin 2000 (Bull. crim. no 237, D. affaires 2001, p. 853, note H. Matsopoulou, RSC 2001, p. 153, obs. B. Bouloc, Bull. Joly Sociétés 2001, p. 39, note C. Mascala, Rev. sociétés 2001, p. 851, note I. Urbain-Parleani), que la société absorbante ne pouvait répondre des infractions imputables à la société absorbée. Cette solution est pleinement justifiée, puisqu’il y avait bien eu, en l’espèce, disparition de la personne morale par suite d’une fusion-absorption, celle-ci ayant fait perdre à la société absorbée son existence juridique. Comme la scission, 279 198 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 la fusion est une dissolution sans liquidation, emportant, dès qu’elle est réalisée, transmission des éléments actifs et passifs au bénéficiaire de l’opération. Il est clair que, si de tels actes sont effectués sans fraude (V. en matière boursière : Com. 15 juin 1999, Bull. civ. IV, no 127, Bull. Joly Bourse 1999, p. 579, note N. Rontchevsky, Rev. dr. bancaire et bourse 1999, p. 123, obs. M. Germain et M.-A. Frison-Roche [en l’espèce, il a été jugé que le principe de la personnalité des poursuites et des peines s’oppose à ce que, en l’absence de dispositions dérogatoires expresses, des personnes physiques ou morales autres que l’auteur du manquement puissent se le voir imputer; toutefois, la chambre commerciale a réservé le cas d’une fraude à la loi, ce qui n’était pas établi en l’espèce]), on ne saurait faire supporter au successeur aux biens une responsabilité pénale ne provenant pas de son action personnelle. Même si certains auteurs ont pu émettre des doutes sur l’intransmissibilité de la responsabilité pénale en cas de fusion ou de scission (F. Desportes, « Responsabilité pénale des personnes morales », J.-Cl. Pénal, art. 121-2, no 68), la solution adoptée par la chambre criminelle est fondée, car, pour les personnes physiques, on ne distingue pas entre la mort non voulue et le suicide. La mort faisant cesser les poursuites, il ne peut qu’en être de même pour les personnes morales, même si celles-ci peuvent être tentées de décider de se dissoudre volontairement. On peut relever que cette position a été confirmée par une jurisprudence ultérieure (Crim. 3 nov. 2011, no 10-87.945). Une autre solution pourrait éventuellement être envisagée dans le cas où une condamnation à une peine d’amende, prononcée à l’encontre de la société absorbée ou scindée, deviendrait définitive avant la fusion ou scission. C’est qu’en effet, cette condamnation pécuniaire est une dette patrimoniale et elle devrait être supportée par la société absorbante ou par celle issue d’une opération de scission. Mais si l’action publique ne peut plus aboutir dans les hypothèses précitées, il en est autrement lorsqu’il s’agit de l’action civile qui doit, en revanche, demeurer, car la réparation du dommage incombe au successeur aux biens. C’est qu’en effet, la société absorbante hérite non seulement des éléments d’actif mais aussi du passif pris en compte ou latent. En particulier, dans le cas d’une fusion, il y a transmission universelle du patrimoine et, parmi les dettes transmises, se trouve celle liée à la réparation que la société absorbée ne pourra plus exécuter. L’exclusion de la responsabilité pénale de la société absorbante ne devrait pas exclure la réparation civile éventuelle accordée aux victimes (Crim. 14 oct. 2003, Bull. crim. no 189, RSC 2004, p. 339, note E. Fortis, Rev. sociétés 2004, p. 161, note B. Bouloc). Il semble toutefois que la chambre criminelle réserve un sort différent aux actions civiles ayant pour fondement un délit d’imprudence ou un délit intentionnel imputé à la société absorbée. Ainsi, a-t-il été jugé que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction intentionnelle que s’il a été préalablement statué au fond sur l’action publique (Crim. 23 avr. 2013, no 12-83.244, Bull. crim. no 95; v. en ce sens : Crim. 28 févr. 2017, no 15-81.469, JCP G 2017, no 474, note B. Lapérou-Scheneider [la société absorbée avait été condamnée pour le délit de travail dissimulé en première instance avant l’opération de fusion-absorption]). Telles étant les grandes lignes suivies par la jurisprudence nationale, il est permis de se demander si cette dernière ne devrait pas évoluer sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. À cet égard, on doit rappeler que, saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 19, § 1 de la troisième direc199 279 > 279 L’infraction 200 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1022544162:88866209:196.200.176.177:1592998823 tive no 78/855/CEE du 9 octobre 1978 (désormais codifiée dans la directive no 2011/35/ UE du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes; selon l’article précité, une fusion par absorption entraîne ipso jure la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante), la CJUE a estimé, par une décision du 5 mars 2015 (no C-343/13, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condiçöes de Trabalho – Centro Local do Lis [ACT]), qu’une fusion par absorption entraîne la transmission, à la société absorbante, de l’obligation de payer une amende infligée par décision définitive après cette fusion, pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée avant ladite fusion. La CJUE a même pris soin de souligner que, « si la transmission d’une telle responsabilité était exclue, une fusion constituerait un moyen pour une société d’échapper aux conséquences des infractions qu’elle aurait commises, au détriment de l’État membre concerné ou d’autres intéressés éventuels ». Si l’on s’appuie sur les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à la décision précitée, on pourrait penser que la solution adoptée ne concernait que la matière contraventionnelle, puisque la peine d’amende était infligée pour des contraventions prévues par le droit du travail. À l’appui d’un tel argument, on peut relever que la CJUE a visé à plusieurs reprises, dans sa décision du 5 mars 2015, « la responsabilité contraventionnelle » (§ 24, § 28 et § 32), qui consistait en particulier en l’obligation de payer l’amende fixée après la fusion par absorption de la société concernée pour des infractions commises avant une telle opération. On pourrait alors se demander si la nature contraventionnelle des infractions imputées à la société absorbée avait conduit la CJUE à admettre une dérogation au principe de la personnalité des peines. On sait que, en dehors de quelques exceptions, seule l’existence de l’élément matériel, à savoir la violation d’une « prescription légale ou réglementaire » (B. Bouloc, Droit pénal général, op. cit., no 301), suffit à constituer une contravention, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention coupable ou la faute d’imprudence du contrevenant, comme c’est le cas en matière délictuelle. En tout cas, la chambre criminelle a écarté, par une décision du 25 octobre 2016 (Bull. crim. no 275, Rev. sociétés 2017, p. 234, note H. Matsopoulou, RSC 2017, p. 297, obs. H. Matsopoulou), la solution adoptée par la CJUE, en invoquant deux raisons principales. D’une part, elle a considéré que la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative aux fusions des sociétés anonymes (codifiée par la directive 2011/ 35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011), telle qu’interprétée en son article 19 § 1 par la CJUE dans l’arrêt du 5 mars 2015 précité, « est dépourvue d’effet direct à l’encontre des particuliers ». D’autre part, l’article 121-1 du Code pénal, qui consacre le principe de la responsabilité pénale personnelle, « ne peut s’interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique ». Ce faisant, la Haute juridiction a censuré, en l’espèce, la décision de la chambre de l’instruction qui avait méconnu les dispositions de l’article 121-1 du Code pénal et le principe de la personnalité des poursuites. Mais la solution adoptée peut-elle être justifiée ? La question qui s’était posée ici était celle de savoir si la chambre criminelle devait suivre l’interprétation, donnée par la CJUE, de l’article 19 § 1 de la directive relative aux fusions des SA, selon laquelle le paiement des amendes prononcées pour des infractions commises par la société absorbée pouvait être mis à la charge de la société absorbante, ou maintenir sa jurisprudence ayant pour fondement l’article 121-1 du Code pénal. La Cour Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 de cassation a écarté ladite interprétation, en estimant qu’elle « est dépourvue d’effet direct à l’encontre des particuliers ». Une telle déclaration est surprenante, car l’interprétation d’un texte européen, donnée par la plus haute juridiction de l’Union européenne ayant compétence pour le faire, fait corps avec ce dernier. Sur ce point, on peut faire observer que la chambre criminelle n’a pas hésité, dans le passé, à faire application de l’article 6 § 3 de la Convention EDH, tel qu’il a été interprété par les juges européens (v. Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, no 10-17.049, no 10-30.313, no 10-30.136 et no 10-30.242, D. 2011, p. 1080, JCP G 2011, act. 483, obs. S. Detraz; Crim. 31 mai 2011, no 10-80.034, no 1181.412, no 10-88.293 et no 10-88.809, D. 2011, p. 2084, note H. Matsopoulou, JCP G 2011, no 756, note J. Pradel). Néanmoins, dans l’arrêt du 25 octobre 2016, la chambre criminelle a indiscutablement adopté une position différente en faisant primer le principe à valeur constitutionnelle de la responsabilité pénale personnelle (Cons. const., 16 juin 1999, déc. no 99-411 DC, consid. 7 [pour les juges constitutionnels, il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen que « nul n’est punissable que de son propre fait »]) sur l’interprétation donnée par la CJUE, qui contrevenait à ce principe. Pour notre part, nous approuvons pleinement une telle solution. C’est qu’en effet, l’article 62, al. 3, de la Constitution impose clairement aux juridictions nationales de respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Ainsi, le Conseil d’État a-t-il affirmé que « la suprématie conférée par l’article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » (CE, ass., 30 oct. 1998, nos 200286 et 200287, Sarran, Rev. fr. dr. adm. 1999, p. 57, obs. L. Dubouis; CE, 3 déc. 2001, no 226514. V. aussi : Cass., ass. plén., 2 juin 2000, no 99-60.274, Bull. ass. plén., no 4). Bien que la Cour de justice pose le principe de primauté du droit de l’Union européenne (CJCE, 15 juill. 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64, Rec. 1964. 1141; CJCE, 9 mars 1978, Simmentahl, aff. 106/77, Rec. 1978. 629) sur les normes constitutionnelles (CJCE, 11 janv. 2000, Tanja Kreil, aff. C-285/98, Rec. p. 69; CJCE, 11 janv. 2000, no C-285/98, Kreil (Mme) c/ Bundesrepublik Deutschland, D. 2000. 192, obs. J. Rideau, AJDA 2000. 307, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues, RFDA 2000. 342, étude A. Haquet) des États membres, il demeure que les blocs de conventionnalité et de constitutionnalité sont distincts et indépendants l’un de l’autre. Cela signifie que les juridictions nationales pourraient faire prévaloir les principes de la responsabilité pénale personnelle et de la personnalité des peines, qui relèvent du bloc de constitutionnalité, sur les normes européennes. Au surplus, l’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne indique qu’aucune disposition de ladite charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’Homme et libertés fondamentales reconnus « par les constitutions des États membres ». Il appartient, en tout cas, au législateur de réfléchir à une éventuelle extension du champ d’application de l’article 121-2 du Code pénal à d’autres groupements (M. DelmasMarty, « La responsabilité pénale des groupements dans l’avant-projet de révision du Code pénal », Rev. int. dr. pén. 1980, p. 38 et s.; M. Pariente, « Les groupes de sociétés et la responsabilité pénale des personnes morales », Rev. sociétés 1993, p. 247) ou entités économiques n’ayant pas de personnalité morale, telles que les entreprises. Sur ce point, on 201 280 > 280 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 pourra citer l’exemple du code pénal suisse dont l’article 102 vise expressément la responsabilité pénale de ces entités (« entreprises »). Une telle extension permettrait d’appliquer, dans les hypothèses envisagées, la solution consacrée en matière de concurrence. Dans ce secteur, il est décidé qu’en cas de disparition de la personne morale ayant procédé aux pratiques prohibées, la sanction pécuniaire peut être prononcée contre l’« entreprise » ayant repris une branche d’activité et les personnels, bien qu’elle n’ait pas personnellement accompli l’action prohibée. La raison de cette solution tient au fait que les articles L. 410-1 et s. du Code de commerce s’adressent aux « entreprises » en tant qu’entités économiques, lesquelles peuvent faire l’objet de sanctions, même si, entre le moment de commission des pratiques et celui où elles doivent en répondre, la personne morale a disparu (v. Com. 21 janv. 2014, Bull. civ. IV, no 11 [le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise]; et, pour sa part, le Conseil constitutionnel a approuvé, par une décision no 2016-542 QPC du 18 mai 2016, l’interprétation jurisprudentielle des dispositions du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui autorise le prononcé de l’amende civile à l’encontre de la société absorbante pour des pratiques restrictives commises par la société absorbée avant la fusion [en particulier, il a été décidé que les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence, « ne méconnaissent pas, compte tenu de la mutabilité des formes juridiques sous lesquelles s’exercent les activités économiques concernées, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait »). Une réforme législative s’impose donc afin d’élargir les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales rendant ainsi efficace le dispositif qui tend à lutter contre la criminalité de l’entreprise (H. Matsopoulou, « Faut-il réécrire l’article 121-2 du Code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales ? », in Le Code pénal – 20 ans après, état des questions, Lextenso, LGDJ, 2014, p. 107 s., et spéc. p. 123). B. Les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales 280 Pour qu’une poursuite puisse être exercée à l’encontre d’une personne morale, il faut qu’une infraction ait été accomplie pour son compte par l’un de ses organes ou représentants. En ce qui concerne les infractions susceptibles d’être imputées à une personne morale, les rédacteurs du nouveau Code pénal avaient édicté le principe de spécialité, selon lequel une personne morale ne pouvait être pénalement responsable que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». C’est qu’en effet, il fallait un texte spécifique, qui précisait, d’une part, que la personne morale était pénalement responsable, et indiquait, d’autre part, les peines auxquelles elle était exposée (faute de texte particulier, seules les personnes physiques pouvaient être poursuivies; v. Crim. 18 avr. 2000, Bull. crim. no 153 : la responsabilité pénale d’une société ne pouvait être retenue pour l’infraction aux dispositions relatives à l’ordre des licenciements réprimée par l’article R. 362-1-1 de l’ancien Code du travail [art. R. 1238-1 et s. nouveau C. trav.], lequel ne visait pas expressément les personnes morales). À vrai dire, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, un mouvement législatif s’était amorcé tendant à élargir progressivement le domaine d’application 280 202 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 de la responsabilité pénale des personnes morales. Ainsi, celles-ci pouvaient être poursuivies pour de nombreuses infractions définies par le Code pénal : crimes contre l’humanité, homicide, violences volontaires, atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, proxénétisme, trafic de stupéfiants, actes de terrorisme, discriminations, faux, fausse monnaie, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, etc. Par ailleurs, d’autres textes extérieurs au Code pénal avaient également consacré une telle responsabilité. Tel était le cas de la loi du 29 janvier 1993 sur la prévention de la corruption ou de celle du 2 février 1995 sur la protection de l’environnement, tandis que la loi du 13 mai 1996 avait prévu la responsabilité pénale des personnes morales dans le domaine du blanchiment (art. 324-9 C. pén.). À ces textes, on peut encore ajouter la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 (JO 13 juin 2001, p. 9337), tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires, ayant étendu la responsabilité pénale des personnes morales à d’autres infractions : empoisonnement, tortures et actes de barbarie, appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, menaces, viol, agressions sexuelles… Même si la responsabilité pénale des personnes morales était largement consacrée, elle n’était pas généralisée. Dans certains secteurs, comme le droit pénal des sociétés commerciales, le droit de l’urbanisme ou une grande partie du droit du travail, une telle responsabilité n’était pas envisagée. La loi du 9 mars 2004 a comblé ce vide juridique en généralisant la responsabilité pénale des personnes morales pour toute infraction (v. H. Matsopoulou, « La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales », Rev. sociétés 2004, p. 283, et spéc. p. 287; du même auteur, Les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, Droit et Patrimoine 2006, no 149, p. 48; C. Mascala, L’élargissement de la responsabilité pénale des personnes morales : la fin du principe de spécialité, Bull. Joly Sociétés 2006, no 1, p. 5). C’est qu’en effet, à l’occasion de la discussion du projet de cette loi, les sénateurs ont introduit un amendement, selon lequel à l’article 121-2, al. 1er, du Code pénal étaient supprimés les mots « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Ce faisant, ils ont généralisé, par l’article 54 de la loi adoptée, la responsabilité pénale des personnes morales, à compter du 31 décembre 2005. Mais les parlementaires ont profité de l’occasion pour exclure la responsabilité pénale des personnes morales en cas d’application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (cf. art. 43-1) et de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (v. art. 93-4), qui est devenue la communication au public par voie électronique en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi no 2004-575 du 21 juin 2004, JO 22 juin 2004, p. 11168). Il faut bien reconnaître que cette généralisation met fin à certaines incohérences législatives. À cet égard, il est permis de faire observer que le législateur avait consacré, lors de l’adoption de la loi du 12 juin 2001, la responsabilité pénale des personnes morales en matière d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, ce qu’il n’avait cependant pas fait pour l’incrimination jumelle visée à l’ancien article L. 122-8 du Code de la consommation (v. actuels art. L. 121-8 à 121-10 et L. 132-14, Ord. no 2016-301 du 14 mars 2016). Elle met également un terme à certaines applications jurisprudentielles qui, en se retranchant derrière une large formule législative, avaient étendu la responsabilité pénale des personnes morales à des domaines où elle n’était pas expressément prévue. Ainsi, la Cour de cassation avait admis qu’une personne morale pouvait être pénalement responsable pour un délit de contrebande, alors qu’aucune disposition du Code des douanes ne 203 281 > 282 L’infraction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 prévoyait expressément une telle responsabilité (Crim. 5 févr. 2003, Bull. crim. no 24, RSC 2003, p. 554, obs. B. Bouloc : pour la Haute juridiction, l’article 399 du Code des douanes, énonçant que tous ceux qui ont participé d’une manière quelconque à un délit de contrebande sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction, pouvait être applicable aux personnes morales). En réalité, la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales ne peut qu’emporter la généralisation de la peine d’amende, en excluant les autres peines visées à l’article 131-39 du Code pénal pouvant être adaptées à la nature des infractions retenues. Aussi bien, l’article 131-38, al. 2, du Code pénal indique que, pour les crimes pour lesquels la loi ne fixe pas de peine d’amende, les personnes morales pourront être exposées à une amende d’un million d’euros. On constate donc que, dans ces hypothèses, la nature de la peine est identique, quelle que soit la gravité de l’infraction. Le principe de l’individualisation des peines, applicable aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales, est donc loin d’être respecté. On pourra toutefois faire observer que la loi no 2009-526 du 12 mai 2009, relative à la simplification du droit, a partiellement remédié à cet inconvénient, en comblant la lacune dans de nombreux domaines (par exemple, en matière d’assurances, de consommation, d’environnement, douanière… etc. V. notamment art. 125 de la loi précitée). 281 Mais, pour que la responsabilité pénale des personnes morales soit engagée, encore faut-il que l’infraction ait été accomplie pour leur compte par un organe ou représentant. L’expression « pour le compte » signifie que l’organe ou le représentant agit ès qualités, ou bien dans l’exercice de ses fonctions ou peut-être à l’occasion de l’exercice de celles-ci. Ainsi, la jurisprudence a-t-elle pu considérer que le recrutement des travailleurs clandestins était effectué pour le compte de la société qui devait exécuter plusieurs marchés, un tel acte ayant pour conséquence d’engager la responsabilité pénale de la personne morale (Crim. 7 juill. 1998, Bull. crim. no 216, RSC 1999, p. 317, obs. B. Bouloc). Pour résumer la situation, il suffit donc que l’infraction commise soit en relation avec les missions ou les fonctions confiées aux organes ou représentants de la personne morale. Si l’acte est accompli dans l’intérêt personnel du dirigeant, il ne peut pas engager la responsabilité pénale de la personne morale. Il appartient donc aux juridictions répressives de s’assurer, de manière concrète, que l’organe ou le représentant (ou la personne déléguée) a commis, pour le compte de la personne morale, les manquements ayant engendré la situation infractionnelle (Crim. 6 mai 2014, no 13-82.677 et 13-81.406, JCP G 2014, no 716, note J.H. Robert; Crim. 8 juill. 2015, no 14-83.926; Crim. 5 avr. 2018, no 15-86.574, Dr. pénal 2018, comm. no 104, note Ph. Conte). 282 La loi indique, par ailleurs, qu’une telle responsabilité ne peut être retenue que si l’infraction est commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Ces vocables ont parfois suscité des commentaires. En réalité, le terme « organe » convient parfaitement aux personnes morales, pour lesquelles la loi, sans être totalement contraignante, a fixé le cadre de leur organisation. Tel est le cas pour les sociétés anonymes ou pour les sociétés à responsabilité limitée. Les organes seront le président ou le gérant, le conseil d’administration et l’assemblée générale, dont on sait qu’ils ont des pouvoirs propres sur lesquels d’autres organes ne sauraient empiéter. 281 28 204 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 Quant au terme « représentant », il convient notamment aux personnes morales, pour lesquelles la loi n’a pas fixé d’une façon précise le cadre de leur organisation, laissant ainsi aux fondateurs ou organisateurs le soin d’établir les règles de fonctionnement de ces groupements. Tel est le cas des sociétés civiles (art. 1846 C. civ.), des associations, ainsi que des groupements d’intérêt économique. Dans ces hypothèses, il faudra se référer aux statuts pour déterminer qui peut engager la personne morale à l’égard des tiers. Il a même été jugé qu’un salarié, tel que le chef de service d’une société, peut avoir la qualité de représentant de la personne morale qui l’emploie en fonction des pouvoirs que lui confèrent « son statut et ses attributions » (Crim. 21 nov. 2017, no 16-86.667 [« le chef de service […] disposait d’un statut et des attributions propres à en faire le représentant »]; v. aussi : Crim. 11 oct. 2011, Bull. crim. no 202; Crim. 13 oct. 2015, no 14-84.760). En outre, il peut arriver que des groupements organisés soient dotés de représentants qui ne sont pas des organes, tout simplement parce que ceux-ci sont défaillants ou ne peuvent plus fonctionner. C’est qu’en effet, en cas de crise, l’autorité judiciaire peut, à la demande de certaines personnes, être amenée à désigner un administrateur provisoire. Celui-ci peut suppléer un président, et il est clair que, pendant le temps de sa mission, il aura en charge la représentation de la personne morale. Par ailleurs, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la personne morale sera soit assistée, soit représentée par l’administrateur judiciaire, selon ce qui aura été décidé par le jugement d’ouverture (art. L. 631-12 C. com.). Une fois la procédure de redressement transformée en liquidation, c’est le liquidateur qui représentera la personne morale (art. L. 641-4, al. 4, C. com.). Il en résulte donc que le terme « représentant » peut aussi bien désigner les personnes qui, en vertu des statuts, ont la possibilité d’agir au nom de la personne morale que celles à qui des textes spéciaux confient le soin d’agir pour le compte de ladite personne morale, le plus souvent suite à une désignation par l’autorité judiciaire. Mais peut-on considérer qu’un représentant conventionnel pourrait engager la responsabilité pénale de la personne morale, voire un dirigeant de fait ? S’agissant de la représentation conventionnelle, la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer, à plusieurs reprises, sur le cas des personnes bénéficiant d’une délégation de pouvoirs consentie par le chef d’entreprise. Dans une telle hypothèse, elle a estimé que les personnes titulaires d’une délégation de pouvoirs sont les représentants de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal. Elles peuvent donc engager la responsabilité pénale de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’elles étaient tenues de faire respecter en vertu de la délégation (V. par exemple : Crim. 9 nov. et 14 déc. 1999, Bull. crim. nos 252 et 306, RSC 2000, p. 600, obs. Bouloc; v. aussi : Crim. 15 mai 2007, pourvoi no 05-87.260; Crim. 17 oct. 2017, no 16-80.821). De même, il a été admis que les manquements dans l’organisation et la surveillance du travail, constitutifs de fautes d’imprudence et imputables à des personnes titulaires d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, pouvaient engager la responsabilité pénale des sociétés, dans la mesure où ces fautes avaient été commises par « des représentants » de celles-ci (Crim. 1er sept. 2010, deux arrêts, nos 09-87.331 et 0987.234; Crim. 23 nov. 2010, Bull. crim. no 186; Crim. 25 févr. 2014, no 13-80.516; Crim. 25 mars 2014, no 13-80.376). Il a encore été jugé que la directrice d’un magasin de détail pouvait engager la responsabilité de la personne morale qui l’employait du chef « d’entrave aux fonctions d’un délégué du personnel », dès lors qu’elle était investie de 205 282 > 282 L’infraction 206 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 pouvoirs dont il se déduisait qu’elle exerçait une délégation de pouvoirs de fait (Crim. 27 févr. 2018, no 17-81.457, Dr. pénal 2018, comm. no 76, note Ph. Conte). À vrai dire, cette jurisprudence, qui considère le délégataire comme le représentant de la personne morale, nous paraît contestable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, lors des travaux préparatoires du nouveau Code pénal, il est apparu clairement que des salariés ne peuvent pas engager la responsabilité pénale de la personne morale (v., en ce sens, Crim. 13 oct. 2015, Dr. pénal 2016, comm. no 5, note Ph. Conte; Crim. 17 oct. 2017, no 1680.821 [le préposé d’une société, qui agit pour le compte et dans l’intérêt de celle-ci, n’est pas son représentant en l’absence d’une délégation de pouvoirs]). Comme on l’a fait, à juste titre, observer, les compétences du délégué « sont bornées par les limites d’un service ou d’une fonction », tandis que « ses décisions, et donc ses fautes, sont impuissantes à modifier la structure et la politique de la personne morale dont il est le salarié » (J.H. Robert, « Les préposés délégués sont-ils les représentants de la personne morale ? », Mélanges offerts à P. Couvrat, PUF, 2001, p. 383). Ensuite, on peut faire observer que l’article 706-43, al. 2, C. pr. pén., discuté par les parlementaires en même temps que l’article 121-2 du Code pénal, indique expressément que la personne morale peut être représentée à tous les actes de la procédure « par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet » (H. Matsopoulou, La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, Rev. sociétés 2004, p. 283 et s., et spéc. p. 292). Or, il est permis de constater que l’article 121-2 du Code pénal, qui précise les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales, ne comporte aucune disposition analogue, visant explicitement la personne déléguée par le chef d’entreprise. On voit donc que pour le législateur, le représentant ne peut être le délégué ou le subdélégué du président. Enfin, la délégation n’est consentie que par le chef d’entreprise, personne physique, et non par l’organe de la société, de sorte que, si elle peut exonérer le délégant, elle n’emporte pas mise à la charge de la société d’une responsabilité, le chef d’entreprise ne pouvant transférer des pouvoirs attribués à un organe de la personne morale. En d’autres termes, la personne déléguée n’est que le représentant du dirigeant, personne physique, et non celui de la personne morale. Par ailleurs, elle ne peut exercer toutes les prérogatives du président; on en voudra pour preuve le cas du délégué ou du subdélégué qui ne saurait convoquer une assemblée générale ou réunir un conseil d’administration. Quoi qu’il en soit, la Haute juridiction reste insensible à tous ces arguments, comme en témoigne un arrêt de la chambre criminelle du 13 octobre 2009 (Dr. pénal 2009, comm. no 154, note M. Véron, Rev. sociétés 2010, no 1, p. 53, note H. Matsopoulou). En l’espèce, il a été jugé que dans l’hypothèse où plusieurs sociétés œuvrent sur le même chantier, il est possible à ces différentes sociétés de désigner un délégataire commun. En cas d’accident du travail, les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire commun engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est l’employeur de la victime (V. aussi en ce sens, Crim. 14 déc. 1999, RSC 2000, p. 600, note B. Bouloc). On voit donc que pour la Haute juridiction, la délégation accordée par le dirigeant de la société employeur de la victime à un préposé d’une autre société n’a pas seulement entraîné, au profit de ce dernier, transfert des missions et des pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, mais aussi transfert de représentation. Par conséquent, le manquement commis par le délégataire, qui agissait en tant que représentant de la société employeur de la victime, ne pouvait que mettre Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 en cause la responsabilité pénale de cette société (art. 121-2, al. 1er, C. pén.). La Cour de cassation a confirmé la même solution, par un arrêt postérieur du 23 novembre 2010 (Bull. crim. no 186), affirmant qu’en cas d’accident du travail, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs, commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l’employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main-d’œuvre intérimaire, de la personne morale ayant la qualité d’entreprise utilisatrice au sens des dispositions du Code du travail relatives au travail temporaire. 283 Quant au dirigeant de fait ou au gérant de fait, la jurisprudence le considère également comme le représentant de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal (V. par exemple : Crim. 13 avr. 2010, no 09-86.429; Crim. 10 avr. 2013, no 12-82.088; Crim. 21 mai 2014, Dr. pénal 2014, comm. no 106, note M. Véron [à propos des dirigeants de fait d’une association qui ont agi pour son compte en apportant un soutien logistique et financier à une organisation classée comme terroriste]). Certains auteurs sont favorables à cette solution, car il serait regrettable qu’une personne morale puisse rester impunie, alors que les dirigeants de droit ne sont que des prête-noms (M. DelmasMarty, Droit pénal des affaires, PUF, coll. « Thémis », T. 1, 1990, p. 119). À vrai dire, quand la loi veut prendre en considération le dirigeant de fait et l’assimiler au dirigeant de droit, elle l’indique explicitement, comme en matière de droit pénal des sociétés (v. art. L. 241-9, L. 244-4 et L. 246-2 C. com.) ou de banqueroute (art. L. 654-1 C. com.). Or, dans le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales, la loi est muette, et on ne saurait, en principe, étendre les textes répressifs à des hypothèses non expressément visées, en raison de la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale (V. l’opinion contraire de M. Desportes, Juris-Classeur pénal, Art. 121-2 C. pén., no 119, qui fait état de « l’assimilation de l’organe de fait à l’organe de droit »). Toutefois, si étendue que puisse être la responsabilité pénale de la personne morale, il faut quand même établir par qui elle a pu être engagée. 284 Pour pouvoir imputer une infraction à la personne morale, la jurisprudence a, pendant longtemps, estimé qu’il était nécessaire que les juges établissent en quoi les organes ou représentants ont commis une « faute pénale ». Concrètement, il fallait caractériser « la volonté infractionnelle » ou les négligences et manquements aux obligations de sécurité en la personne de ses organes ou représentants. Plus précisément, s’agissant d’infractions intentionnelles, il ne pouvait y avoir responsabilité pénale de la personne morale que si l’organe ou le représentant avait eu conscience de commettre un délit (V. Crim. 2 déc. 1997, Bull. crim. no 408; Crim. 7 juill. 1998, Bull. crim. no 216; Crim. 1er avr. 2008, Dr. pénal 2008, 1re esp., comm. no 140, note Véron). Ainsi, a-t-il été décidé que la condamnation d’une personne morale était justifiée en raison de la production d’un document faisant état d’une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que de tels faits avaient été commis en connaissance de cause par le représentant de la société devant le Conseil de prud’hommes (Crim. 21 mars 2000, Bull. crim. no 128, Dr. pénal 2000, comm. no 131, obs. J.-H. Robert). Quant aux infractions d’imprudence ou de négligence, il suffisait d’établir qu’il y a eu manquement par la personne physique, organe ou représentant, au respect de telle ou telle disposition législative ou réglementaire, voire commission d’une 283 284 207 285 > 285 L’infraction 285 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 faute simple ou d’une faute caractérisée ou délibérée (Crim. 18 janv. 2000, Bull. crim. no 28; Crim. 23 mai 2006, Dr. pénal 2006, comm. no 128, 1re esp., note Véron). Dès lors, quelle que soit la nature de la faute, intentionnelle ou non, il fallait la caractériser en la personne des organes ou représentants de la personne morale (Crim. 29 avr. 2003, Bull. crim. no 91). À vrai dire, cette analyse jurisprudentielle rejetait la thèse soutenue par une partie de la doctrine, au lendemain du nouveau Code pénal, qui proposait de subordonner la responsabilité pénale des personnes morales, non seulement à la commission d’une infraction par un organe ou un représentant agissant pour leur compte, mais aussi à l’existence d’une faute « distincte » susceptible d’être imputée à ladite personne morale et ayant permis ou favorisé l’accomplissement de cette infraction. C’est qu’en effet, il existe des hypothèses où l’infraction est due à la mauvaise politique commerciale ou sociale de la personne morale ou à l’organisation et fonctionnement défectueux de celle-ci. Il faut bien reconnaître que la solution proposée a influencé certaines juridictions du fond, qui n’ont pas hésité à écarter la responsabilité pénale des personnes morales, au motif qu’il n’était pas établi à leur encontre « l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction », et qu’il ne fallait pas « ériger une responsabilité pénale de plein droit du fait de leurs dirigeants » (V. en ce sens : T. corr. Lyon 9 oct. 1997, JCP G 1998. I. 105, note J.-H. Robert). Néanmoins, une telle analyse n’a pas été accueillie favorablement par la Cour de cassation qui avait clairement énoncé que la faute pénale de l’organe ou du représentant suffisait à engager la responsabilité pénale de la personne morale, lorsqu’elle était commise pour le compte de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de ladite personne morale (Crim. 26 juin 2001, Bull. crim. no 161, Dr. pénal 2002, comm. no 8, note M. Véron, RSC 2002, p. 99, obs. B. Bouloc). Dès lors, en se fondant sur une telle jurisprudence, la doctrine a estimé que la responsabilité pénale de la personne morale est une responsabilité « reflet » ou une responsabilité « par ricochet » (J.-H. Robert, Droit pénal général, 6e éd., PUF, coll. Thémis, 2005, p. 376), voire « une responsabilité du fait personnel par représentation » (F. Desportes, rapport sur Crim. 2 déc. 1997, JCP G 1998. II. 10023). Néanmoins, ce courant jurisprudentiel a été sérieusement remis en cause par toute une série d’arrêts qui ont déclaré des sociétés coupables des délits de blessures ou d’homicide involontaires, sans préciser par l’intermédiaire de quelle personne, ayant la qualité d’organe ou de représentant, la responsabilité pénale desdites sociétés s’était trouvée engagée (V. notamment : Crim. 20 juin 2006, Bull. crim. no 188, D. 2007, p. 617, note J.Ch. Saint-Pau; Crim. 26 juin 2007, Dr. pénal 2007, comm. no 135, note M. Véron; Crim. 15 janv. 2008, Bull. crim. no 6; Crim. 9 mars 2010, D. 2010, p. 2136, note J.-Y. Maréchal; Crim. 16 mars 2010, Dr. pénal 2010, comm. no 74, 3e espèce, note M. Véron; Crim. 15 février 2011, Dr. pénal 2011, comm. no 62, note M. Véron). En reprenant une formule stéréotypée, la Cour de cassation a considéré que les infractions en cause ne pouvaient être commises, pour le compte de ces sociétés, que par leurs organes ou représentants. Puis, cette nouvelle règle jurisprudentielle a été progressivement appliquée aux infractions intentionnelles. Ainsi, dans une espèce ayant donné lieu à un important arrêt de la chambre criminelle du 25 juin 2008 (Dr. pénal 2008, comm. no 140, 2e esp., note M. Véron, Rev. sociétés 2008, p. 873, note H. Matsopoulou), certaines sociétés avaient fait l’objet 285 208 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices 286 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 d’une condamnation pour faux et complicité de faux, alors que les juges répressifs n’avaient pas pris soin d’identifier les organes ou représentants qui, agissant pour leur compte, avaient commis les faits délictueux. Pour la Haute juridiction, les infractions retenues s’inscrivaient « dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause » et ne pouvaient, dès lors, « avoir été commises, pour leur compte, que par leurs organes ou représentants ». L’étude de la jurisprudence, rendue notamment entre 2006 et 2011, fait apparaître qu’en matière de responsabilité pénale des personnes morales, il existe deux courants jurisprudentiels divergents. Le premier exige l’identification de l’organe ou du représentant ayant pu engager la responsabilité pénale de la personne morale, tandis que le second présume la commission d’une infraction qui s’est produite dans le cadre de l’activité de l’entreprise par un organe ou un représentant non identifié. À l’appui du premier courant jurisprudentiel, on pourra citer un arrêt de la chambre criminelle du 23 février 2010 (pourvoi no 09-81.819) qui affirme clairement que la faute pénale de l’organe ou du représentant, qui était en l’espèce identifié, « suffit… à engager la responsabilité pénale de [la personne morale], sans que doive être établie une faute distincte à la charge de [cette dernière] ». Sans aucun doute, la solution adoptée, qui rappelle celle retenue par l’arrêt du 26 juin 2001 précité, ne faisait que démentir l’opinion d’une partie de la doctrine qui pensait que l’on va de plus en plus vers une responsabilité pénale directe ou quasi-directe des personnes morales. En outre, on peut constater que depuis le début de l’année 2010, un bloc d’arrêts n’a retenu la responsabilité pénale des sociétés poursuivies qu’une fois que l’organe ou le représentant, ayant agi pour leur compte, avait été identifié (Crim. 16 févr. 2010, Dr. pénal 2010, comm. no 74, 1re espèce, note M. Véron; Crim. 2 mars 2010, no 09-82.607; Crim. 9 mars 2010, no 09-83.401; Crim. 13 avr. 2010, no 09-86.429), ce qui a permis, dans certains cas, aux juges répressifs de faire jouer la règle du cumul des responsabilités (V. par ex. : Crim. 2 mars 2010, no 09-82.607; Crim. 9 mars 2010, no 09-82.823). Mais, pendant la même période, on trouve aussi toute une série de décisions qui relèvent du second courant jurisprudentiel, puisqu’elles prononcent des condamnations à l’encontre des personnes morales, sans que soit identifié l’organe ou le représentant qui, agissant pour le compte de celles-ci, a commis les faits délictueux. On peut même isoler quelques arrêts, par lesquels certaines juridictions n’ont pas hésité à imputer directement des délits d’homicide involontaire à des personnes morales, sans prendre soin d’utiliser une formule permettant de présumer la commission de ces délits par un organe ou un représentant non identifié (Crim. 9 mars 2010, D. 2010, p. 2136, note J.-Y. Maréchal; Crim. 16 mars 2010, Dr. pénal 2010, comm. no 74, 3e espèce, note M. Véron). Dans ces hypothèses, il était certainement permis de penser que la thèse de la responsabilité pénale directe des personnes morales gagnait du terrain ! On pourra, par ailleurs, faire observer que la Haute juridiction, en faisant usage de son pouvoir de filtre, a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel toutes les questions prioritaires de constitutionnalité tendant à contester la conformité de l’article 121-2 du Code pénal aux principes à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, de l’interprétation stricte de la loi pénale et de la présomption d’innocence (Cass. QPC, 11 juin 2010, JCP G 2010, nos 1030 et 1031, notes J.-H. Robert et H. Matsopoulou; Crim., 286 209 287 > 287 L’infraction 287 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 QPC, 18 janv. 2011, no 09-87.889; Crim., QPC, 29 mars 2011, no 11-90.007; Crim., QPC, 27 avril 2011, no 11.90013). Aussi bien, par une décision du 11 juin 2010 (Cass. QPC, 11 juin 2010, préc.), la Cour de cassation a expressément reconnu que « la question posée, sous le couvert de la prétendue imprécision des dispositions critiquées, tend en réalité à contester l’application qu’[elle] en fait », elle-même. Mais on peut se demander si les hauts magistrats ont le droit de réserver une telle application aux dispositions de l’article 121-2 du Code pénal, alors que la matière, dont ce texte relève, est soumise au principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. Quoi qu’il en soit, le courant jurisprudentiel, qui n’exige pas l’identification des organes ou des représentants, pénalise gravement les personnes morales, puisque, dès lors qu’il s’agit de faits délictueux, intentionnels ou non, se produisant au sein de l’entreprise, ils sont présumés avoir été commis par les organes ou les représentants de la personne morale. Ce faisant, la Cour de cassation heurte le principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et expressément consacré par l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Elle méconnaît aussi la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale (art. 111-4 C. pén.). Faut-il encore rappeler que l’article 121-2 du Code pénal indique, en termes clairs et précis, que l’infraction doit être commise, pour le compte de la personne morale, par ses organes ou représentants ? Cela signifie que, avant de condamner une personne morale pour une infraction déterminée, il convient d’établir l’intervention ou l’implication personnelle desdits organes ou représentants dans la commission des faits illicites. Ces précisions données, il est toutefois permis de se demander si la jurisprudence n’a pas évolué sous l’influence de ces critiques. Actuellement, il semble que la jurisprudence, qui présumait la commission d’une infraction par un organe ou un représentant non identifié, a été remise en cause par toute une série d’arrêts, par lesquels la chambre criminelle a censuré des décisions de cours d’appel qui n’avaient pas recherché si les manquements imputés à des personnes morales avaient été commis par des organes ou des représentants, au sens de l’article 121-2 du Code pénal. Ce mouvement jurisprudentiel s’est amorcé par un arrêt du 11 octobre 2011 (JCP G 2011, no 1385, note J.-H. Robert, Dr. pénal 2011, comm. no 149, note M. Véron, Rev. sociétés 2012, p. 52, note H. Matsopoulou, RJDA 2012, p. 99, note D. Boccon-Gibod). Par cette décision, la Haute juridiction a reproché à la cour d’appel d’avoir condamné la société EDF pour le délit d’homicide involontaire, sans avoir fourni les précisions nécessaires « sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause », ce qui aurait permis de vérifier si ceux-ci étaient réellement dotés d’un pouvoir de représentation, comme l’exige l’article 121-2 du Code pénal. Puis, par un arrêt plus récent du 11 avril 2012 (JCP G 2012. II. 740, note J.-H. Robert, D. 2012, p. 1381, note J.-Ch. Saint-Pau. V. aussi : B. Bouloc, « Regard sur l’actualité de la responsabilité pénale des personnes morales », Lamy Droit pénal des affaires, juin 2012, no 118, actualités, p. 1 et s.), la chambre criminelle a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait déclaré une société coupable de blessures involontaires et d’infraction à la sécurité des travailleurs, à la suite d’un accident du travail subi par un salarié sous contrat de professionnalisation ayant œuvré sur un chantier de cette entreprise. Pour ce faire, les juges répressifs avaient relevé « qu’à défaut d’avoir dispensé une formation pratique et appro287 210 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 priée, la personne morale a[vait] créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ou n’a[vait] pas pris les mesures permettant de l’éviter ». À vrai dire, si les termes de l’article 121-2 du Code pénal n’autorisent pas le juge pénal à retenir une telle solution, il n’en est pas de même de ceux de l’article L. 4741-1 du Code du travail qui désignent, comme auteur de l’infraction, l’employeur ou son délégataire de pouvoirs. Or, l’employeur est la personne morale, si bien que l’on pourrait penser que l’infraction définie à l’article L. 4741-1 du Code du travail pourrait être directement imputée à ladite personne morale, sans que ses organes ou représentants soient préalablement identifiés. Cependant, la Cour de cassation n’adopte pas un tel raisonnement qui écarte les conditions générales de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales, telles qu’elles sont fixées par l’article 121-2 du Code pénal. Ainsi, les hauts magistrats ont estimé, en l’espèce, que la juridiction du second degré n’avait pas justifié sa décision, dans la mesure où elle n’avait pas recherché « si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants » de la société condamnée, « et s’ils avaient été commis pour le compte » de celle-ci, au sens de l’article 121-2 du Code pénal. Loin de reprendre sa formule stéréotypée, selon laquelle les infractions en cause ne pouvaient être commises, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants, les hauts magistrats ont pris soin, par cette décision du 11 avril 2012, de souligner les termes employés par l’article 121-2 du Code pénal. Puis, cette jurisprudence a été confirmée par de nombreux arrêts postérieurs (Crim. 2 oct. 2012, no 11-84.415; Crim. 11 déc. 2012, no 11-87.421; Crim. 8 janv. et 22 janv. 2013, Dr. pénal 2013, comm. no 55, note M. Véron; Crim. 19 juin 2013, no 12-82.827, Rev. sociétés 2014, p. 55, note B. Bouloc; Crim. 1er avr. 2014, no 12-86.501; Crim. 6 mai 2014, Bull. crim. nos 124 et 125, JCP G 2014, no 716, note J.-H. Robert; Crim. 8 juill. 2015, no 14-83.926; Crim. 17 nov. 2015, Dr. pénal 2016, comm. no 22, note Ph. Conte). On pourra, en outre, relever que, lorsqu’il s’agit d’une infraction d’imprudence, et lorsque l’organe ou le représentant, dont la faute est à l’origine du dommage, n’est pas identifié en l’état de la procédure, la chambre criminelle exige que les juges du fond procèdent à une telle identification, « au besoin en ordonnant un supplément d’information » (Crim. 31 oct. 2017, no 16-83.683, Dr. pénal 2018, no 2, note Ph. Conte, Rev. sociétés 2018, p. 190, note H. Matsopoulou [« Lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d’identifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute est à l’origine du dommage »]; v. aussi : Crim. 27 sept. 2016, no 15-85.248, Bull. crim. no 251) Que faut-il alors conclure de ce tour d’horizon ? Si l’on s’appuie sur la jurisprudence actuelle, il est permis de penser que, à l’exception de certaines décisions isolées (v. par ex. : Crim. 18 juin 2013, no 12-85.917, RSC 2013, p. 807, obs. Y. Mayaud; Crim. 5 nov. 2013, no 12-85.193), la chambre criminelle fait désormais une application correcte des dispositions de l’article 121-2 du Code pénal en se montrant respectueuse de la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale (toutefois, l’obligation d’identifier l’organe ou le représentant de la personne morale ne s’impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, l’information judiciaire ayant, notamment, pour objet l’identification de la personne physique pouvant engager la responsabilité pénale de ladite personne morale; v. Crim. 12 avr. 2016, no 15-86.169, Bull. crim. no 130). 211 288 > 288 L’infraction C. Le cumul des poursuites Lors de la présentation du projet de Code pénal, il avait été indiqué que la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales limiterait les poursuites contre les dirigeants ou les chefs d’entreprise. Cependant, l’article 121-2, al. 3, du Code pénal énonce que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ». Ce dernier texte interdit de retenir une faute lointaine à l’égard des personnes physiques n’ayant pas causé directement le dommage, à moins qu’il ne s’agisse d’une faute « délibérée » ou d’une faute « caractérisée » (V. supra, nos 185 et s.). Toutefois, les personnes morales ne bénéficient pas de ces dispositions et peuvent donc voir leur responsabilité pénale mise en jeu même pour une faute simple, fût-elle lointaine, commise par un de leurs organes ou représentants (V. supra no 196). De fait, la Cour de cassation a décidé que les personnes morales sont pénalement responsables de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, même si, en l’absence de faute délibérée ou caractérisée, les personnes physiques sont relaxées (Crim. 24 oct. 2000, Bull. crim. no 308, RSC 2001, p. 162, obs. Y. Mayaud; v. aussi : Crim. 14 sept. 2004, Dr. pénal 2005, comm. no 11, note M. Véron; Crim. 28 avr. 2009, Bull. crim. no 80, JCP G 2009, no 402, note J.-Y. Maréchal; Crim. 8 janv. 2013, Dr. pénal 2013, comm. no 55, 3e espèce, note M. Véron). On assiste donc à une situation étonnante où la personne morale va devoir répondre d’un agissement accompli par un organe ou un représentant, considéré comme non fautif (toutefois, pour la Cour de cassation, « la différence de situation entre les personnes physiques et les personnes morales justifie la différence de traitement induite par l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, laquelle est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » : Crim. 21 mars 2017, no 17-90.003, QPC, v. supra no 196). Malgré le silence législatif, la circulaire du garde des Sceaux Crim-06-3 / E8 du 13 février 2006 (V. H. Matsopoulou, « Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales » : présentation de la circulaire Crim-06-3 / E8 du 13 février 2006, Rev. sociétés 2006, p. 483 et s., et spéc. p. 488) incite les magistrats du ministère public à poursuivre, en cas d’infraction intentionnelle, à la fois la personne physique, auteur ou complice des faits, et la personne morale, dès lors que les faits ont été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants. En revanche, dans l’hypothèse d’une infraction non intentionnelle ou d’une infraction de nature technique pour laquelle l’intention coupable peut résulter, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, de la simple inobservation, en connaissance de cause, d’une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devraient être privilégiées, et la responsabilité pénale de la personne physique ne devrait être engagée que si une faute personnelle était suffisamment établie à son encontre pour justifier la condamnation pénale. En tout cas, si l’on s’appuie sur les différentes solutions jurisprudentielles, il est permis de distinguer deux situations. D’une part, le mouvement jurisprudentiel, qui tend à condamner les personnes morales pour une infraction intentionnelle ou non en présumant sa commission par un organe ou un représentant non identifié, ne peut que profiter entièrement aux dirigeants sociaux (Crim. 1er déc. 2009, JCP G 2010, no 689, note J.28 212 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 288 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices section 2 La complicité § 289 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 H. Robert; Crim. 9 mars 2010, D. 2010, no 2136, note J.-Y. Maréchal; Crim. 16 mars 2010, Dr. pénal 2010, comm. no 74, 3e espèce, note M. Véron). C’est qu’en effet, en l’absence d’identification de la personne physique, ces derniers ne peuvent pas être poursuivis cumulativement avec la personne morale, comme l’autorise l’article 121-2, al. 3, du Code pénal. Peut-être, dans ces hypothèses, est-ce un moyen de mettre à néant les prescriptions de ce texte et de satisfaire partiellement au vœu des rédacteurs de la circulaire du garde des Sceaux Crim-06-3/E8 du 13 février 2006. Quant au second courant jurisprudentiel qui exige l’identification de la personne physique ayant la qualité d’organe ou de représentant de la personne morale, les solutions adoptées sont loin d’être homogènes, puisque dans certaines hypothèses, la jurisprudence fait jouer la règle du cumul (Crim. 13 oct. 2009, Dr. pénal 2009, comm. no 154, note M. Véron, Rev. sociétés 2010, no 1, p. 53, note H. Matsopoulou; Crim. 16 févr. 2010, no 09-83.991 à propos du délit de blessures involontaires; Crim. 2 mars 2010, no 0982.607, à propos du délit d’homicide involontaire; Crim. 9 mars 2010, no 09-82.823, à propos du délit de publicité trompeuse; Crim. 9 mars 2010, no 09-83.401, à propos de la violation des dispositions du Code de l’urbanisme; Crim. 13 avr. 2010, no 09-86.429, à propos du délit d’homicide involontaire) et dans d’autres, elle l’écarte (Crim. 28 janv. 2009, no 07-81.674, à propos du délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un marché réglementé; Crim. 1er sept. 2010, deux arrêts, no 09-87.331 et 09-87.234, à propos des délits d’homicide et de blessures involontaires). Toutefois, on peut relever que, dans certaines affaires où des personnes physiques, ayant la qualité d’organes de la personne morale (tel un gérant), avaient pris une part personnelle et déterminante aux infractions reprochées, les juges n’ont pas hésité à retenir leur seule responsabilité pénale, en excluant celle de la personne morale (Crim. 30 janv. 2018, no 17-81.595, JCP G 2018, no 317, note J.-H. Robert). Quoi qu’il en soit, une intervention législative serait la bienvenue en la matière, afin de fournir des critères précis permettant de remédier à tous les inconvénients résultant de la règle du cumul des poursuites. Ce qui, à notre sens, paraît le plus logique, c’est que pour les infractions d’imprudence ou de négligence, il y ait, en principe, responsabilité pénale de la personne morale, parce que l’organisation de celle-ci est défectueuse, tandis que la responsabilité pénale de la personne physique ne devrait être retenue que lorsqu’elle a pris une part personnelle et déterminante à la commission de l’infraction (V. en ce sens, Crim. 30 janv. 2018, no 17-81.595 préc.). En revanche, s’agissant d’infractions intentionnelles, la responsabilité pénale de la personne physique devrait être prioritairement recherchée, à moins que la personne morale n’ait tiré un profit de l’infraction. 1 La notion de complicité Définition. Hors les cas de participation à un groupement criminel ou à une bande organisée, il arrive qu’une personne décide d’apporter à un agent une aide en vue de faci289 213 290 > 291 L’infraction 290 291 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 liter la réalisation d’une infraction déterminée. On fournit le fusil permettant un délit de chasse prohibée, ou le couteau devant servir à un assassinat. Sans aucun doute, l’on est ici en présence des actes de complicité, dès lors que l’assistant ne prend pas part de façon directe à l’exécution des éléments constitutifs de l’infraction, et qu’il n’est associé que de manière incidente ou accessoire à l’action. À l’égard de ce participant, deux solutions existent : soit on peut envisager une sanction diminuée (l’agent n’a fait qu’aider sans prendre l’initiative de l’action), soit une sanction égale à celle applicable à l’auteur de l’infraction. Dans cette dernière hypothèse, le complice se trouve donc exposé aux mêmes peines que l’auteur principal. Ce système a été consacré par le Code pénal de 1810 qui prévoyait, dans son article 59, que les complices d’un crime ou d’un délit étaient « punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit ». Quant au nouveau Code pénal, il indique, dans son article 121-6, que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». On remarquera, par ailleurs, qu’exceptionnellement, la pluralité de participants, agissant en qualité d’auteur ou de complice, emporte une aggravation de la sanction. C’est, par exemple, le cas du viol (art. 222-24-6° C. pén.) ou du vol (art. 311-4-1° C. pén.; on est ici en présence de ce que l’on appelait autrefois « vol en réunion » exigeant la participation d’au moins deux personnes qui agissent en tant qu’auteurs ou complices). Distinction de l’auteur et du complice. Alors que certaines législations se fondent sur le rôle accessoire ou déterminant du « complice », auquel cas il serait l’instigateur (ou l’auteur moral), le droit français prend en compte un élément objectif, tenant à l’existence de tous les éléments, matériel et moral, de l’infraction (auteur), ou à une simple coopération à certains stades de l’infraction (complice). En outre, du fait de l’exposition du complice aux peines prévues pour l’auteur, la jurisprudence n’a pas toujours appliqué avec rigueur la distinction. Dans l’intérêt de la répression, elle a parfois considéré comme coauteur celui qui n’était qu’un complice. Ainsi, elle a retenu la « coaction » pour faire échec à l’impunité de la complicité en matière de contraventions, ou pour faire jouer, dans certains cas, la circonstance aggravante de réunion (Crim. 25 janv. 1973, Gaz. Pal. 1973. 1, somm. 94). Il n’en demeure pas moins que l’auteur est celui qui réunit en sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction, le complice n’étant qu’un participant de deuxième zone. 290 La « complicité corespective ». Une personne ne devait pas avoir à la fois la qualité de coauteur et de complice des mêmes faits délictueux. Cependant, une vieille jurisprudence a estimé que « le coauteur d’un crime aide nécessairement l’autre coupable dans les faits qui consomment l’action, et devient par la force des choses légalement son complice » (Crim. 9 juin 1848, arrêt Igneux, Bull. crim. no 178). Il s’agit de la théorie de la « complicité corespective ». Le recours à cette théorie avait permis aux juges répressifs d’appliquer au coauteur les circonstances aggravantes qui ne pouvaient normalement jouer qu’à l’égard de l’autre coauteur ayant la qualité requise par la loi. Ainsi, a été condamné à « la peine [aggravée] du parricide » un mari qui avait tué, conjointement avec son épouse, la mère naturelle de celle-ci. En l’espèce, l’intéressé faisait valoir qu’il avait été « à tort » condamné à cette peine aggravée, car il n’était « point fils de la victime ». Toutefois, en affirmant que le coauteur « aide nécessairement l’autre coupable dans les faits » et « devient […] son complice », la Haute juridiction a pu justifier l’application de la « peine du parricide » au 291 214 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices 292 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 mari qui, en tant que complice, s’exposait à la « même peine » que « l’auteur » (art. 59 ancien C. pén.). Actuellement, cette solution jurisprudentielle ne présente plus aucun intérêt puisque le complice est sanctionné des peines qu’il aurait encourues s’il avait été l’auteur principal de l’infraction (art. 121-6 C. pén.; v. infra, no 310). Par conséquent, il ne devrait pas se voir appliquer les circonstances aggravantes liées à la qualité de ses coauteurs. En outre, la jurisprudence adopte une conception très large de la complicité, dans l’hypothèse où plusieurs personnes participent à « une scène unique de violences » et où il est particulièrement difficile de préciser la part individuellement prise par chacune d’elles, ainsi que la nature des coups portés à chacune des victimes. En pareil cas, les juges répressifs estiment que chaque participant à une telle scène prend, certes, une part active et personnelle aux violences exercées mais aussi apporte son aide aux autres en vue d’atteindre le résultat réalisé. Il en résulte donc que chacun des participants n’est pas seulement auteur de ses propres agissements mais aussi complice des autres. Il s’agit encore ici de l’application de la théorie de la « complicité corespective ». En y ayant recours, la jurisprudence retient, à l’encontre de tous les participants, la même infraction, sans prendre soin d’établir le rôle que chacun a effectivement joué dans la réalisation du dommage (Crim. 14 déc. 1955, Bull. crim. no 56; Crim. 30 nov. 1961, Bull. crim. no 487; Crim. 13 juin 1972, Bull. crim. no 195; Crim. 25 févr. 1975, Bull. crim. no 65, RSC 1975, p. 1016, obs. G. Levasseur; Crim. 10 avr. 1975, Bull. crim. no 90; Crim. 12 janv. 2010, Gaz. Pal. 2425 mars 2010, p. 19, obs. S. Detraz). Intérêts de la distinction. Tout d’abord, la qualification d’un agissement dépend exclusivement de la qualité personnelle de l’auteur et non de celle du complice (par exemple, lorsque la loi vise une personne dépositaire de l’autorité publique ou ayant la qualité de président d’une société…). Ensuite, l’auteur, qui conserve l’objet d’autrui frauduleusement appréhendé, ne commet que le délit de vol, tandis que celui qui intervient avant ou pendant et après la consommation de l’infraction, peut être poursuivi comme complice et receleur du même délit (Crim. 9 févr. 1967, Bull crim. no 62). En effet, ce cumul est possible, parce que les deux qualifications sont parfaitement conciliables. La raison en est qu’il y a ici deux activités distinctes, l’une (complicité) étant antérieure ou concomitante au fait délictueux préalable et l’autre (recel) postérieure à celui-ci. La jurisprudence a également retenu le cumul de recel et de complicité d’escroquerie (Crim. 10 oct. 1996, Dr. pénal 1997, comm. no 48, note M. Véron), d’abus de confiance ou d’abus de biens sociaux (Crim. 6 janv. 1970, Bull. crim. no 11, Rev. sociétés 1971, p. 25, obs. B. Bouloc; Crim. 25 avr. 1974, Bull. crim. no 152). Par ailleurs, en matière de contraventions, seule la complicité par instigation est incriminée (la complicité par aide ou assistance n’est punissable qu’exceptionnellement : v. en matière de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes : art. R. 623-2, dernier al., C. pén.; en matière de violences : art. R. 624-1, dernier al., et art. R. 625-1, avant dernier al., C. pén.). Enfin, le plus grand intérêt de la distinction réside aujourd’hui, comme par le passé, dans le fait que le complice, dont l’acte emprunte sa criminalité à celle de l’acte principal, échappe à la répression, lorsque l’auteur de celui-ci n’a pas franchi le seuil de la tentative punissable (V. supra, no 169). 292 215 293 > 295 § 2 Les conditions de la complicité punissable L’article 121-7 du Code pénal énonce : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Trois conditions doivent donc être réunies pour que la complicité soit punissable; il faut qu’existent : 1° un fait principal punissable; 2° un acte matériel défini par la loi; 3° une intention. 293 A. Le fait principal punissable international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 293 L’infraction 294 L’acte du complice emprunte sa criminalité à l’acte de l’auteur principal. Il en découle : 1° que l’on ne saurait réprimer une « complicité » apportée à l’accomplissement d’un acte qui n’est pas sanctionné par la loi pénale; ainsi la provocation au suicide, aussi critiquable soit-elle, ne pouvait être réprimée au titre de la complicité, le suicide n’étant pas une infraction (c’est pourquoi le législateur a érigé cette provocation « suivie d’un suicide ou d’une tentative de suicide » en délit autonome [art. 223-13 C. pén.]); 2° que l’on ne peut réprimer un acte de « complicité » si l’auteur principal du crime ou du délit envisagé n’a pas pour le moins franchi le seuil du commencement d’exécution qui caractérise la tentative punissable. Ainsi, selon une jurisprudence constante, celui qui avait payé un « tueur à gages » pour commettre un assassinat demeurait impuni, si le « tueur » se contentait « d’empocher l’argent » sans passer à l’acte (V. Crim. 25 oct. 1962, Lacour, D. 1963. 221, note Bouzat). En pareil cas, on dit que la tentative de complicité n’est pas punissable; l’instigateur échappant à toute sanction pénale en raison de l’abstention de l’auteur principal. Une telle solution avait fait apparaître une grave lacune de notre législation. Pour compléter ce vide juridique, le projet de nouveau Code pénal comportait un article 121-6, selon lequel l’instigateur qui, par don, promesse, ruse, etc. aurait provoqué directement un tiers à commettre un crime, eût été passible de la peine attachée à ce crime (V. Projet de nouveau Code pénal, présenté par M. R. Badinter, Dalloz, 1988). Finalement, le Parlement, en refusant d’étendre la répression à l’instigateur, n’avait pas retenu cette proposition. À vrai dire, la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 a partiellement réglé le problème en insérant un nouvel article 221-5-1 dans le Code pénal, selon lequel est désormais pénalement sanctionné « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement […], lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté ». Dans les hypothèses visées par ce texte, la tentative de complicité est donc érigée en une infraction autonome punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 295 En ce qui concerne l’aide apportée aux actes préparatoires suivis d’un commencement d’exécution, constitutif d’une tentative punissable, elle est un acte de complicité incriminé; la complicité de tentative est donc punissable. 294 295 216 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 Tel est le cas de l’individu qui, sciemment : a fourni à un cambrioleur des renseignements sur la façon de s’introduire dans les lieux, le malfaiteur ayant été appréhendé à l’occasion d’une tentative – ou de celui qui a fourni des armes à des individus qui ont tenté infructueusement de commettre avec celles-ci une agression. Certains actes de cette nature constituent en eux-mêmes des infractions autonomes (ainsi le fait de procurer à une personne, non titulaire d’une autorisation de détention, une arme de défense ou de guerre est un délit; v. art. 222-52 C. pén.). 296 Pour pouvoir condamner un complice, il est absolument nécessaire qu’existe un fait principal punissable (Crim. 1er déc. 1987, Bull. crim. no 438 : les juges doivent constater l’existence d’une infraction principale). Cependant, par un arrêt du 8 janvier 2003 (Bull. crim. no 5, RSC 2003, p. 553, note B. Bouloc) qui suscite les plus grandes réserves, la Cour de cassation a condamné un complice, malgré la relaxe de l’auteur principal, pour défaut d’intention coupable. En l’espèce, il a été décidé qu’une telle relaxe n’exclut pas la culpabilité du complice, dès lors que l’existence d’un fait principal punissable, soit l’exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par les juges du fond. La solution retenue paraît fort contestable, dans la mesure où l’infraction principale ne pouvait être valablement constituée, en l’absence de toute intention coupable de l’agent (V. aussi : Crim. 15 déc. 2004, Dr. pénal 2005, comm. no 79, note J.-H. Robert). Bien évidemment, si tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, le complice peut faire l’objet d’une condamnation, et il importe peu que l’auteur ne soit pas puni (Crim. 28 nov. 2006, Bull. crim. no 294, Dr. pénal 2007, comm. no 31, note M. Véron). Ainsi, le complice peut être poursuivi, même si l’auteur principal ne l’est pas, soit parce que celui-ci est décédé ou bénéficie d’une cause d’impunité strictement personnelle (il a, par exemple, agi sous l’empire de la démence ou de la contrainte, ce qui n’enlève rien à la criminalité de l’acte), soit parce qu’il est en fuite ou n’a pu être identifié. Au contraire, si la cause d’impunité de l’auteur principal est objective (fait justificatif, prescription de l’action publique), le complice ne peut pas être poursuivi, en l’absence d’un fait principal punissable. En ce qui concerne la complicité apportée à l’infraction consommée par le bénéficiaire de l’immunité familiale, il était décidé, sous l’empire de l’ancien Code pénal, qu’elle ne pouvait être punissable. Néanmoins, les tribunaux voyaient souvent un coauteur dans l’individu qui avait fourni une aide ou une assistance concomitante à la commission de l’infraction. Cette jurisprudence pourrait être maintenue sous l’empire du nouveau Code pénal, et ce d’autant plus que les dispositions de l’article 380 de l’ancien Code pénal, maintenant expressément le recel en pareil cas, n’ont pas été reprises par les rédacteurs du nouveau Code (selon l’article 380 précité, les individus qui « auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés » par le bénéficiaire de l’immunité familiale « seront punis comme coupables de recel »). Il est vrai que les juges pourraient considérer, dans cette hypothèse, que le fait d’origine demeure objectivement une infraction, l’immunité familiale étant propre à l’agent. En effet, celle-ci a un caractère strictement personnel et ne doit profiter qu’aux personnes visées par les textes et non aux coauteurs ou même aux complices qui, n’ayant pas les liens requis par la loi avec la victime, demeurent pénalement responsables des actes accomplis. 297 Il existe, en outre, des causes d’impunité chez l’auteur principal qui sont de caractère mixte et peuvent, selon les cas, profiter au complice ou non. Il s’agit de l’amnistie et d’une 296 297 217 298 > 300 L’infraction 298 Enfin, si le fait principal punissable a été commis en France, le complice peut être poursuivi devant une juridiction française, même si l’acte de complicité a été réalisé à l’étranger. De même, la loi pénale française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, si l’infraction est punie à la fois par la loi française et par la loi étrangère et si les faits ont été constatés par une décision définitive de la juridiction étrangère (art. 113-5 C. pén., v. supra no 132). Lorsque la juridiction française est compétente pour juger l’infraction principale, elle l’est aussi pour juger le complice, quels que soient sa nationalité et le lieu où les actes de complicité ont été accomplis (Crim. 29 nov. 2016, no 1586.712, Dr. pénal 2017, comm. no 32, note Ph. Conte). 298 B. L’acte matériel de complicité 299 Une personne ne peut être poursuivie comme complice que si sa participation à la commission de l’infraction a revêtu l’une des formes limitativement énumérées par la loi. De l’article 121-7 du Code pénal, il ressort : 1° que la complicité punissable requiert l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes positifs énumérés par cette disposition, réalisés sciemment dans le but d’aider à la commission d’une infraction (ou de provoquer celle-ci); 2° et que ces actes peuvent être soit antérieurs, soit concomitants à la commission de l’infraction. 29 1° Nécessité d’un acte positif 300 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 décision de relaxe ou d’acquittement. Plus précisément, si l’amnistie a un caractère réel (et concerne par exemple telle ou telle infraction), elle profite au complice. En revanche, si elle est accordée en raison des qualités personnelles de l’auteur de l’infraction (fils de tué, résistant, etc.), elle ne profite qu’à celui en la personne duquel ces qualités sont réunies. De même, la relaxe ou l’acquittement de l’auteur principal ne profite au complice que s’il est dû à des motifs objectifs (par exemple, l’auteur agissait en état de légitime défense) et non subjectifs (comme c’est le cas lorsque l’auteur est atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques, cf. Crim. 29 mai 1990, Bull. crim. no 203, RSC 1991, pp. 345 et 1993, p. 100; v. aussi les réserves formulées à propos de l’arrêt du 8 janvier 2003 : supra, no 296). Toutefois, si l’auteur principal est relaxé ou acquitté, la condamnation du complice peut donner lieu à une révision (Commission de révision, 16 nov. 1998, Bull. crim. no 299). La complicité punissable exige, en principe, un acte positif et non pas une simple abstention ou une omission. Celui qui assiste simplement à la commission d’une infraction, sans y intervenir, ne peut être poursuivi comme complice, si blâmable que soit sa passivité (Crim. 15 janv. 1948, S. 1949. 1. 81, note Légal). La loi ne sanctionne pas la complicité par abstention. La meilleure preuve en est qu’il a fallu créer des incriminations spécifiques (délits d’omission), pour punir de telles abstentions (V. par ex., art. 223-6, al. 2, C. pén. réprimant la non-assistance à personne en péril). 30 218 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices Cependant, la jurisprudence reconnaît parfois un caractère d’« aide positive » à un comportement passif. Ainsi, la chambre criminelle a jugé, le 20 janvier 1992, que pouvaient être condamnés du chef de complicité de coups et blessures, les membres d’un « groupe de skins » qui avaient assisté à la scène de violences administrées par leurs « camarades », au motif que, par leur « présence volontaire faisant nombre dans la troupe des agresseurs », ils avaient facilité aux autres les actes de violence et « contribué à la réalisation de l’infraction » (Lesclous et Marsat, Dr. pénal 1993, chron. no 13). – De même, la Haute juridiction prend en compte la collusion frauduleuse, lorsqu’elle décide que certains professionnels ont accepté de fermer les yeux sur une action illicite (V. pour un notaire : Crim. 10 avr. 1975, Bull. crim. no 89). Aussi bien, la chambre criminelle a-t-elle affirmé qu’était complice d’un délit de fraude fiscale un expert-comptable qui avait omis de vérifier et de redresser la comptabilité de son client (Crim. 15 janv. 1979, Bull. crim. no 21, RJ com. 1982, p. 293, note B. Bouloc). Elle a, par ailleurs, décidé qu’un expert-comptable, en attestant de la conformité et de la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper et un commissaire aux comptes, en certifiant en connaissance de cause et sur plusieurs exercices lesdits comptes, avaient sciemment fourni à l’auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l’escroquerie à la TVA (Crim. 31 janv. 2007, Bull. crim. no 25, D. 2007, p. 1843, note B. Bouloc, Rev. sociétés 2007, p. 351, note H. Matsopoulou). Il en résulte donc que la Cour de cassation se montre particulièrement exigeante à l’égard des « professionnels des chiffres » qui doivent être vigilants. C’est qu’en effet, leur inaction pourrait ne pas être le signe d’une simple négligence, mais d’une abstention volontaire (V. A. Decocq, « Inaction, abstention et complicité par aide et assistance », JCP G 1983. I. 3124), surtout si les faits sont réitérés sur une longue durée. Dès lors que la loi impose des obligations particulières à certains professionnels, ceux-ci doivent accomplir leur mission en procédant à tous les contrôles et vérifications nécessaires. Dans le cas contraire, on serait amené à penser qu’ils agissent de connivence ou en concert frauduleux avec l’auteur des agissements délictueux. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 – Il en résulte donc que la jurisprudence admet la complicité par abstention (v. par ex., Crim. 30 juin 1999, Bull. crim. no 175; Crim. 25 févr. 2004, Bull. crim. no 53; Crim. 22 sept. 2010, no 09-87.363, Dr. pénal 2010, comm. no 19, note J.-H. Robert), dès lors que le complice apporte un « soutien moral » à l’auteur principal ou omet, dans l’exercice de ses fonctions ou missions, d’effectuer les contrôles nécessaires, comme il a l’obligation de le faire, ce qui facilite la commission de l’infraction. Ainsi, a été condamné, pour complicité d’exercice illégal de la médecine et de blessures involontaires, un médecin qui « n’est intervenu à aucun moment avant ou pendant les séances d’opérations d’épilation comme il en avait l’obligation » (Crim. 13 sept. 2016, no 15-85.046, Bull. crim. no 238, JCP G 2016, no 1067, note F. Rousseau, Dr. pénal 2016, no 153, note Ph. Conte, RSC 2016, p. 760, obs. Y. Mayaud; v. aussi : infra no 309). En l’espèce, l’acte de complicité imputé au médecin était donc caractérisé par l’absence de surveillance médicale des opérations d’épilation, pratiquées par des personnes non-qualifiées (des esthéticiennes ou secrétaires médicales, ayant suivi une formation de quelques heures). 2° Faits de complicité antérieurs à la consommation de l’infraction 301 Les faits de complicité antérieurs à la commission de l’infraction peuvent revêtir la forme soit d’une provocation, soit d’une aide ou d’une assistance dans les actes préparatoires à la commission de l’infraction, soit d’instructions données pour faciliter cette commission. 301 219 302 > 304 L’infraction a) Provocation 302 La provocation à la commission de l’infraction doit, pour tomber sous le coup de la loi pénale, être assortie de « don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir » (art. 121-7, al. 2, C. pén.). Il en résulte donc que la complicité par provocation ne saurait être constituée par une simple suggestion à commettre l’infraction, mais doit être accompagnée de certaines circonstances (un don, une promesse, un ordre…, etc.) qui lui donnent plus de force (on dit que la provocation doit être « circonstanciée »). Aussi bien, le juge, qui condamne du chef de complicité par provocation, doit préciser la forme revêtue par celle-ci. Par ailleurs, il est nécessaire que la provocation s’adresse à un individu déterminé (elle doit donc être « personnelle ») et exprime nettement l’idée de la commission d’une infraction (provocation « directe »). Enfin, pour constituer un acte de complicité punissable, la provocation doit être « suivie d’effet ». 303 Le législateur a toutefois exceptionnellement érigé, sous certaines conditions, la simple provocation (c’est-à-dire celle qui n’est pas assortie de l’un des adminicules énumérés par l’article 121-7, al. 2, C. pén.) en infraction autonome. Ainsi en est-il : de la provocation directe à un attroupement armé (art. 431-6 C. pén.) – de la provocation publique et collective par la voie de la presse (L. 29 juill. 1881, art. 23 et 24) – de la provocation à s’armer contre l’autorité de l’État ou contre une partie de la population (art. 412-8 C. pén.) – de la provocation au suicide (art. 223-13 C. pén.) – de la provocation directe d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants (art. 227-18 C. pén.) ou à consommer de façon excessive de l’alcool (art. 227-19 C. pén.) – de la provocation directe d’un mineur à commettre des crimes ou des délits punis de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (art. 22721 C. pén.). 30 – Dans certains cas, la provocation évoquée ci-dessus est réprimée, même si elle n’a entraîné aucun résultat (par exemple, la provocation prévue par l’art. 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse). b) La fourniture d’instructions 304 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 302 L’article 121-7, al. 1er, du Code pénal retient aussi, comme acte de complicité, la fourniture d’instructions. C’est qu’en effet, il doit s’agir de renseignements précis, en sachant qu’ils vont servir à la réalisation d’un crime ou d’un délit (Crim. 23 mai 1973, JCP G 1974. II. 17675, note D. Mayer). Ainsi, a été considéré comme complice celui qui a indiqué l’adresse d’une avorteuse ou a donné des instructions en vue de faciliter l’évasion d’un détenu, accompagnées si nécessaire de la suppression de ses gardiens (V. Crim. 23 mai 1973, préc.). Il n’est pas indispensable que les instructions soient données directement par leur auteur, pour que la complicité de celui-ci soit légalement constituée (Crim. 30 mai 1989, Bull. crim. no 222 : les renseignements peuvent parfaitement être fournis par l’intermédiaire d’un tiers; v. aussi : Crim. 15 déc. 2004, Bull. crim. no 322). Le complice est punissable, même si l’auteur de l’infraction, pour parvenir au résultat, utilise finalement des moyens différents de ceux proposés par le complice (Crim. 31 janv. 1974, RSC 1975, 679, obs. Larguier). En revanche, la complicité par instructions ne peut être retenue à l’encontre de celui qui donne mission à un « homme de main » de tuer une personne nommément désignée, dès lors que, de sa propre volonté, l’individu devant accomplir ce crime s’abstient de le commettre et donne volontairement la mort à une autre victime (Crim. 10 mars 1977, D. 1977. IR. 237). Désormais, dans cette hypothèse, 304 220 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices l’« instigateur » s’expose aux peines prévues par l’article 221-5-1 du Code pénal (inséré par la loi du 9 mars 2004 : supra, no 294) qui a institué une infraction autonome. c) L’aide ou l’assistance donnée au stade des actes préparatoires Cette forme de complicité vise essentiellement « la fourniture de moyens » ayant servi à commettre l’infraction ou facilitant la préparation ou l’exécution de celle-ci (l’article 59 de l’ancien Code pénal visait « ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir »). Il peut donc s’agir de moyens matériels quelconques : armes, engins d’effraction (tel un chalumeau), véhicules « maquillés » devant servir à commettre une agression contre une agence bancaire, etc. Ainsi, a été considéré comme complice l’auteur d’un ouvrage pornographique, qui a procuré le texte de cet ouvrage à l’éditeur en sachant qu’il sera édité et publié (Crim. 14 nov. 1962, Bull. crim. no 323), ou le propriétaire d’un véhicule ayant confié le volant à une personne en état d’ivresse (CA Alger 20 oct. 1965, Gaz. Pal. 1966. 1. 133). De même, la complicité a été retenue à l’encontre du dirigeant d’une officine de fausse facturation, qui a fourni, en connaissance de cause, un lot de factures fictives destinées à justifier dans la comptabilité d’une entreprise des sorties d’argent et à obtenir la récupération de la TVA (Crim. 13 mars 1995, RSC 1996.113, obs. Bouloc). 305 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 305 3° Faits de complicité concomitants à la commission de l’infraction 306 Une autre forme de complicité constitue l’aide ou l’assistance concomitante à la commission de l’infraction. Tel est le cas de l’individu qui joue de la musique pour couvrir les cris de la personne qu’on assassine ou de celui qui, par un montage financier, dissimule le versement d’une somme rémunérant une corruption (Crim. 9 nov. 1995, Bull. crim. no 346). Il est vrai que la jurisprudence, dans un souci de répression, a pu considérer comme coauteurs les personnes ayant simplement coopéré à la commission de l’infraction, sans participer directement à la réalisation de l’élément matériel constitutif de celle-ci (ainsi, pour faire jouer la circonstance aggravante de la réunion, elle a considéré comme coauteur l’individu qui faisait le guet pendant un cambriolage : Crim. 25 janv. 1973, Gaz. Pal. 1973. 1. somm. 94). Sont également complices, les faux joueurs à un jeu de bonneteau (Crim. 25 mars 2015, Bull. no 69). 306 4° Aide ou assistance apportée par l’intermédiaire d’un autre complice 307 308 Constitue également une complicité punissable l’aide ou l’assistance apportée, en connaissance de cause, à l’auteur de l’infraction principale, par l’intermédiaire d’un autre complice. Dans cette hypothèse, il suffit d’établir à l’encontre de ce dernier la volonté d’adhérer à l’activité délictueuse (V. Crim. 15 déc. 2004, Bull. crim. no 322, RSC 2005, p. 298, note G. Vermelle; en ce qui concerne la fourniture d’instructions pouvant être fournies par l’intermédiaire d’un tiers, v. supra, no 304). 307 En ce qui concerne les actes postérieurs à la consommation de l’infraction, ils ne sont pas, en principe, considérés comme des actes de complicité (Crim. 4 mai 2000, Bull. crim. no 178), même s’ils sont de nature à soustraire les auteurs à l’identification ou à l’arresta- 308 221 309 > 309 L’infraction – On observera, en ce sens, que l’article 311-11 du Code pénal dispose que constitue « un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice ». C. L’élément intentionnel 309 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 tion, ou s’ils tendent à détruire ou à altérer les traces ou indices permettant l’aboutissement de l’enquête. Certains de ces actes ont d’ailleurs été érigés en infractions autonomes; ainsi en est-il : du recel de choses (qui, depuis la loi du 22 mai 1915, constitue un délit distinct; art. 321-1 C. pén.) – du recel de criminel, consommé par celui qui fournit à l’auteur ou au complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement un « logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen » de le « soustraire aux recherches ou à l’arrestation » (art. 434-6 C. pén.) – du recel de cadavre, consommé par celui qui cache « le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences » (art. 434-7 C. pén.) – du blanchiment sanctionnant : d’une part, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit, direct ou non; d’autre part, le concours apporté à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit (art. 324-1 C. pén.) – de la destruction ou de l’altération des traces ou indices sur les lieux d’un crime ou d’un délit (art. 434-4 C. pén.). Toutefois, l’aide ou l’assistance postérieure à l’infraction constitue un acte de complicité, lorsqu’elle résulte d’un accord antérieur. Ainsi, celui qui aide et assiste, dans sa fuite, l’auteur d’un vol peut être considéré comme un complice par aide ou assistance, si cette protection a été assurée en exécution d’une entente préalable (Crim. 11 juill. 1994, Bull. crim. no 274; v. aussi : Crim. 1er déc. 1998, JCP G 1999. I. 151). Dans cette hypothèse, on peut considérer que le temps de « commission » de l’infraction ne saurait être réduit au seul instant de la commission de l’acte matériel constituant le crime ou le délit. L’assistance du ou des complices peut parfaitement prendre place dans les instants ayant immédiatement suivi l’acte de commission (en revanche, en l’absence d’accord antérieur à l’infraction, l’intervention d’un tiers tendant à aider l’auteur dans sa fuite ne constitue pas un acte de complicité punissable : Crim. 4 mai 2000, Bull. crim. no 178, Dr. pénal 2000, comm. no 112, note Véron). Il est nécessaire que le complice ait conscience de l’aide apportée à la commission de l’infraction perpétrée par l’auteur principal (Crim. 28 juin 1995, Bull. crim. no 241; Crim. 19 juin 2001, Bull. crim. no 148). Certains faits de complicité impliquent nécessairement cette intention : provocation, instructions fournies en vue de « commettre » l’infraction (et non renseignements fortuitement donnés), aide ou assistance prêtée « sciemment ». L’intention doit exister chez le complice au moment même où il a fourni les moyens et les instructions ou a prêté son concours facilitant ainsi l’accomplissement de l’infraction (V. Crim. 23 avr. 1997, Bull. crim. no 143). En d’autres termes, l’intention doit être concomitante de l’acte matériel de complicité. Tel était le cas d’un haut fonctionnaire français qui, à l’instigation de responsables d’une organisation criminelle nazie, avait apporté, en connaissance de cause, son concours aux arrestations et internements de personnes, choisies exclusivement en raison de leur appartenance à la communauté 309 222 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 juive, en vue de leur déportation vers les camps d’extermination (Crim. 23 janv. 1997, Bull. crim. no 32, JCP G 1997. II. 22812, note J.-H. Robert, D. 1997, p. 147, note J. Pradel). En revanche, le comportement du complice ne devrait pas être sanctionné au cas où il n’aurait commis qu’une simple faute d’imprudence ou de négligence. C’est qu’en effet, la complicité suppose une faute intentionnelle. Cependant, la jurisprudence n’hésite pas à réprimer la complicité d’une infraction d’imprudence (Crim. 17 nov. 1887, Bull. crim. no 392; Crim. 14 déc. 1934, Bull. crim. no 209. V. aussi, pour une complicité en matière de publicité trompeuse, considérée comme un délit d’imprudence : Crim. 23 avr. 1997, Bull. crim. no 143; pour la complicité du délit de mise en danger de la personne d’autrui : Crim. 6 juin 2000, Bull. crim. no 213, RSC 2000, p. 821, obs. Y. Mayaud). Ainsi, a été déclaré coupable de complicité de blessures involontaires un médecin qui « n’est intervenu à aucun moment avant ou pendant les séances d’opérations d’épilation », pratiquées par des personnes non-qualifiées, alors qu’il avait l’obligation d’exercer une surveillance effective sur lesdites opérations (Crim. 13 sept. 2016, no 15-85.046, Bull. crim. no 238, JCP G 2016, no 1067, note F. Rousseau, Dr. pénal 2016, no 153, note Ph. Conte, RSC 2016, p. 760, obs. Y. Mayaud. V. aussi : supra no 255). À vrai dire, dans cette hypothèse, il aurait convenu que le médecin soit considéré comme un auteur indirect du délit de blessures involontaires (art. 121-3, al. 4, C. pén.), d’autant plus que les juges du fond avaient caractérisé à son encontre une faute délibérée (v. sur cette notion, supra no 192), puisqu’il avait méconnu l’obligation réglementaire de surveillance des opérations d’épilation au laser. 3 Les peines de la complicité 310 L’article 121-6 du Code pénal dispose que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ». On voit, dans cette disposition, l’application du principe de la criminalité d’emprunt total qui est adopté par le système du droit français. Le complice s’expose aux peines qu’il aurait encourues s’il avait été l’auteur principal de l’infraction. Au niveau de la répression, il est donc considéré comme auteur. En particulier, il est passible de toutes les peines principales et complémentaires qui peuvent frapper l’auteur principal; déchéances, incapacités, dans la mesure naturellement où elles peuvent s’appliquer au complice (si, par exemple, le complice n’est pas banquier ou médecin, la déchéance de ces professions applicable à l’auteur principal ne pourra évidemment pas jouer contre lui). Cependant, la règle consacrée par l’article 121-6 du Code pénal ne signifie pas que le complice va être condamné à la peine qui frappera l’auteur principal; le juge restera libre d’individualiser la peine par les divers procédés que le législateur met à sa disposition. 311 Les causes d’aggravation de la peine nées en la personne de l’auteur principal rejailliront sur le complice, lorsqu’elles ont un caractère objectif (circonstances réelles) et modifient la matérialité de l’infraction. C’est ainsi que les circonstances aggravantes du vol, telles que les actes de violence, font encourir au complice les peines du vol aggravé (Crim. 28 juill. 1953, Bull. crim. no 262), même si son aide n’a porté que sur une phase antérieure à la commission des faits, et même s’il a ignoré telle ou telle des circonstances entraînant l’aggravation (Crim. 9 juin 310 31 223 312 > 313 L’infraction 312 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 1982, Bull. crim. no 155); ses prévisions peuvent donc se trouver dépassées. Ainsi, celui qui avait ordonné à un individu de « faire une grande frayeur » à la victime d’actes de violence a-t-il été reconnu complice des coups et blessures administrés par son homme de main, quoique celui-ci ait outrepassé les instructions reçues (Crim. 21 mai 1996, Dr. pénal 1996, comm. no 213, obs. Véron). Néanmoins, la complicité n’est pas retenue, lorsque l’auteur principal commet une infraction totalement différente, quant à ses éléments constitutifs, de celle à laquelle le complice avait voulu apporter son concours (Crim. 13 janv. 1955, D. 1955, 291, note Chavanne). S’agissant des circonstances personnelles à l’auteur de l’infraction, elles n’exercent aucune influence sur la peine applicable au complice. Ainsi, lorsque l’auteur principal est un récidiviste, l’aggravation de la peine, que cette qualité entraîne, ne joue nullement à l’égard du complice. De même, la minorité de l’auteur principal ne profite pas au complice, car elle est strictement personnelle et n’enlève pas à l’acte son caractère délictueux. Quant aux circonstances dites « mixtes », tenant à la personne de l’auteur mais modifiant la criminalité de l’acte (telles que la préméditation transformant un meurtre en un assassinat, qualité de fils de la victime chez l’auteur d’un meurtre), la jurisprudence avait estimé qu’elles pouvaient rejaillir sur le complice; la peine de celui-ci se trouvant aggravée comme celle de l’auteur principal, même si ledit complice ignorait la circonstance aggravante (Crim. 13 mai 1970, D. 1970. 515, note Chapar). Cependant, il est permis de se demander si ces solutions jurisprudentielles sont justifiées sous le régime du nouveau Code pénal, sanctionnant le complice des mêmes peines que celles encourues s’il avait été lui-même l’auteur principal de l’infraction. À notre avis, ces circonstances ne doivent être prises en considération, pour déterminer la peine du complice, que si elles lui sont personnelles (V. toutefois Crim. 7 sept. 2005, Bull. crim. no 219, Dr. pénal 2005, comm. no 167, note Véron : en l’espèce, ont été applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l’auteur principal). 312 section 3 La responsabilité pénale du chef d’entreprise 313 À la différence du droit civil qui connaît de nombreux cas de responsabilité du fait d’autrui, le droit pénal consacre le principe de la responsabilité pénale personnelle (art. 121-1 C. pén.). Pourtant, la jurisprudence a admis, depuis la fin du XIXe siècle, qu’un chef d’entreprise pouvait être pénalement responsable des agissements commis par son préposé, car il avait l’obligation de veiller au respect de la réglementation. Ce principe de responsabilité, que les rédacteurs du nouveau Code pénal n’ont pas expressément réglementé, malgré certaines tentatives en ce sens, a été maintenu par la jurisprudence intervenue depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code. La responsabilité pénale du chef d’entreprise, en sa qualité de dirigeant, pour des infractions commises au sein de son entreprise, doit être distinguée des hypothèses où la loi met, pour des raisons utilitaires 31 224 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 ou techniques, à la charge du commettant le paiement des amendes prononcées du fait des agissements du préposé ou salarié. Ainsi, dans le domaine de la circulation routière, l’article L. 121-1, al. 2, du Code de la route autorise le tribunal à mettre à la charge du commettant le paiement total ou partiel des amendes de police prononcées en raison des conditions de travail du salarié ou préposé. En outre, l’article L. 121-3 du Code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation peut être redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État (V. pour une application : Crim. 21 sept. 2004, Dr. pénal 2004, comm. no 176, obs. J.-H. Robert; cf. aussi : Crim. 13 oct. 2010, Dr. pénal 2011, comm. no 7, note J.-H. Robert, Rev. sociétés 2011, p. 307, note H. Matsopoulou : lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue). Dans ces cas, il s’agit d’une responsabilité objective qui tend à garantir, au profit du Trésor public, le paiement des amendes encourues et non d’une responsabilité pénale. En revanche, il en va différemment quand le dirigeant ou le chef d’entreprise est recherché en raison de la méconnaissance d’une réglementation précise (V. H. Matsopoulou, « La responsabilité pénale du chef d’entreprise », RJ com. nov. 2001, no spécial, p. 45 et s.). Est-ce à dire cependant que, dans cette hypothèse, il ne peut pas éluder sa responsabilité ? 1 Le domaine de la responsabilité pénale du chef d’entreprise 314 Le chef d’entreprise est, d’abord et avant tout, pénalement responsable des actes ou omissions qu’il a personnellement accomplis en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Ainsi, le directeur général d’une banque a été déclaré pénalement responsable d’un délit d’obstacle au contrôle de la Commission bancaire, car il avait personnellement pris la décision de dissimuler le montant réel des prêts accordés à la clientèle. En particulier, il avait participé à la décision de falsification des comptes, pour ne pas faire apparaître que les engagements de prêts excédaient le seuil autorisé par la réglementation bancaire (Crim. 20 mars 1995, Bull. crim. no 114). 315 Le chef d’entreprise est, par ailleurs, pénalement responsable des infractions commises, au sein de son entreprise, en sa qualité de dirigeant. C’est notamment à partir des dispositions spécifiques du Code du travail que la jurisprudence a fait remonter la responsabilité de certains actes pénalement répréhensibles jusqu’au chef d’entreprise (Crim. 28 oct. 1986, Bull. crim. no 311 : en l’espèce, il s’agissait d’un accident du travail causé par le non-respect des règles concernant les dispositifs de protection). Elle a, par la suite, étendu la même solution aux infractions de droit commun, c’est-à-dire les délits d’imprudence (homicide involontaire ou atteintes involontaires à l’intégrité de la personne) pouvant être retenus cumulativement avec les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs. La chambre criminelle devait affirmer que « la responsabilité pénale peut naître du fait d’autrui, dans les cas exceptionnels où certaines obligations 314 315 225 316 > 316 L’infraction 316 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un subordonné » (Crim. 25 juin 1969, Bull. crim. no 213; Crim. 19 avr. 1972, Rev. sociétés 1972, p. 739, note Bouloc). Cependant, la Cour de cassation n’admet une telle responsabilité que dans les entreprises et les professions réglementées, où le chef d’entreprise a légalement l’obligation d’assurer l’exécution de nombreuses prescriptions (par exemple, en matière de droit du travail, de sécurité sociale, etc.; v. Crim. 6 oct. 1955, JCP 1956. II. 9098, note de Lestang; Crim. 19 juin 2013, no 12-83.684 [en l’absence de toute délégation de pouvoirs, le dirigeant légal ou statutaire d’une société doit être tenu pour responsable des obligations comptables et fiscales de l’entreprise]; Crim. 31 oct. 2017, no 16-83.683, Dr. pénal 2018, no 2, note Ph. Conte, Rev. sociétés 2018, p. 190, note H. Matsopoulou [la responsabilité pénale du représentant légal a été retenue, car il avait omis « de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs »]). Le plus souvent, les infractions retenues ne requièrent comme élément moral qu’une imprudence ou une négligence, et précisément ce que l’on peut reprocher au chef d’entreprise c’est d’avoir été négligent dans l’organisation de l’activité. Mais la jurisprudence n’hésite pas parfois à déclarer pénalement responsable le chef d’entreprise en raison d’infractions intentionnelles commises par ses préposés (V. en ce qui concerne le délit volontaire de pollution des eaux : Crim. 23 avr. 1992, Bull. crim. no 179). Il est, par ailleurs, permis de constater que la Cour de cassation énonçait, de plus en plus souvent, que le prévenu était responsable de plein droit des infractions commises en sa qualité de chef d’entreprise. Tel a été le cas pour un délit de publicité illicite en faveur du tabac (Crim. 28 oct. 1998, Bull. crim. no 281), ou même pour un délit de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée (Crim. 19 nov. 1998, Bull. crim. no 310). Il est vrai que le chef d’entreprise souhaite être déchargé de cette responsabilité. Cependant, la jurisprudence avait estimé que celle-ci était présumée et ne pouvait pas tomber même devant la preuve de l’absence de faute de contrôle ou de surveillance (Crim. 4 nov. 1964, Gaz. Pal. 1965. 1. 80). On observera toutefois que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000, il faut établir que l’agent a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par un texte législatif ou réglementaire, faute d’avoir accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (art. 121-3, al. 3, C. pén.). La faute d’imprudence ou de négligence du chef d’entreprise devrait donc être appréciée in concreto. C’est qu’en effet, les termes de la loi incitent désormais les juges répressifs à se fonder, pour retenir une telle faute, sur les circonstances précises de l’espèce, et non à la présumer en affirmant que les diligences normales n’avaient pas été accomplies puisqu’un accident était survenu (V. supra, no 187). En outre, la personne physique, qui n’a pas causé directement le dommage (lien de causalité indirect), n’est responsable pénalement que s’il est établi qu’elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par un texte (V. pour une application : Crim. 28 mars 2006, Bull. crim. no 91), ou commis une faute caractérisée (V. Crim. 2 mars 2010, Bull. crim. no 44) exposant autrui à un risque d’une particulière gravité (art. 121-3, al. 4, C. pén.). 316 226 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices § 317 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 Le chef d’entreprise pourra donc bénéficier de ces dispositions. Cependant, même sous l’empire de la loi du 10 juillet 2000, il semble que la jurisprudence continue, dans certaines hypothèses, à présumer la faute caractérisée à l’égard du chef d’entreprise (V. par ex. : Crim. 10 janv. 2001, Bull. crim. no 2; Crim. 16 janv. 2001, deux arrêts, Bull. crim. nos 14 et 15; Crim. 13 sept. 2005, Bull. crim. no 224; v. supra no 194). Ainsi, a-t-il été décidé qu’il appartenait à ce dernier de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions destinées à assurer la sécurité de son personnel, d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs temporaires auxquels il faisait appel et de prendre les mesures nécessaires pour que soient respectées les règles de sécurité. Ces manquements constituaient une faute caractérisée imputée au chef d’entreprise (Crim. 5 mars 2013, no 12-82.820; v. aussi : Crim. 12 nov. 2014, Dr. pénal 2015, comm. no 5, note M. Véron). Cependant, dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de tout contrôler ou surveiller, le chef d’entreprise peut déléguer à un ou plusieurs de ses subordonnés tout ou partie de ses pouvoirs, en vue de faire respecter la réglementation. 2 L’exonération par l’effet de la délégation de pouvoirs La jurisprudence a admis depuis longtemps que le chef d’entreprise puisse déléguer certains de ses pouvoirs, notamment en matière de réglementation de l’hygiène et de sécurité des travailleurs. La délégation de pouvoirs a été, par la suite, admise dans d’autres secteurs, comme en matière de publicité mensongère (Crim. 7 déc. 1981, Bull. crim. no 325), de réglementation de la durée du travail dans les entreprises de travaux publics (Crim. 19 janv. 1988, Bull. crim. no 29) ou de coordination des transports (Crim. 13 mai 1969, 2e arrêt, Bull. crim. no 167). Mais la Cour de cassation refusait parfois d’admettre les effets exonératoires d’une délégation, en considérant que telle ou telle mission, comme par exemple la fixation des prix, relevait de la compétence exclusive du chef d’entreprise, et ne pouvait être déléguée en l’absence d’une disposition particulière (Crim. 11 mars 1991, Rev. sociétés 1991, p. 565, note Bouloc). La chambre criminelle a toutefois mis un terme aux incertitudes. Par cinq arrêts du 11 mars 1993 (Bull. crim. no 112, Bull. Joly 1993, p. 666, note Cartier, RSC 1994, p. 101, obs. Bouloc), elle a décidé que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il apporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ». Tout d’abord, il appartient au chef d’entreprise d’établir la réalité de la délégation (V. Crim. 16 janv. 2002, Bull. crim. no 6, Dr. pénal 2002, comm. no 56, note J.-H. Robert : avant d’écarter la responsabilité pénale du chef d’entreprise, les juges ne doivent pas se contenter de relever que le prévenu, compte tenu de la structure de la société, n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, mais ils doivent rechercher si l’intéressé a réellement délégué ses pouvoirs relatifs au respect de la réglementation violée). Ainsi, la Cour de cassation n’hésite pas à censurer des décisions de cours d’appel qui ne s’étaient pas suffisamment expliquées « sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en 317 227 318 > 318 L’infraction 318 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 faire des représentants de la personne morale, au sens de l’article 121-1 du Code pénal » (Crim. 11 oct. 2011, Rev. sociétés 2012, p. 52, note H. Matsopoulou; v. aussi : Crim. 13 oct. 2015, Dr. pénal 2016, comm. no 5, note Ph. Conte). Il est évident qu’en l’absence de preuve de cette délégation, la responsabilité pénale du chef d’entreprise pourra être retenue, car c’est à lui qu’il appartient de veiller au respect de la législation (Crim. 21 juin 2000, Dr. pénal 2000, comm. no 116, obs. J.-H. Robert). Il a donc été jugé qu’engage sa propre responsabilité pénale « le représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur » (Crim. 31 oct. 2017, no 16-83.683, préc.). La délégation peut être prouvée par tout moyen. Un écrit n’est donc pas nécessaire (Crim. 27 févr. 1979, Bull. crim. no 88; Crim. 11 mars 1993, préc.). Ainsi, a-t-il été admis qu’une personne, « désignée verbalement comme responsable » d’une flottille, avait la qualité de « subdélégué de fait, chargé de la sécurité » (Crim. 6 déc. 2011, no 10-83.581; v. aussi : Crim. 27 févr. 2018, no 17-81.457, Dr. pénal 2018, comm. no 76, note Ph. Conte [en l’espèce, la directrice d’un magasin de détail a été considérée comme une déléguée de fait]). Cependant, bien que la jurisprudence n’exige pas la rédaction d’un écrit, il sera souhaitable d’en produire un. Cet écrit devra être non équivoque (v. Crim. 20 juill. 2011, no 10-87.348 [en l’espèce, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du second degré qui n’avaient pas recherché « si la fusion-absorption invoquée, qui avait donné lieu à la création d’une société distincte de la précédente et à un changement de dirigeant social, n’avait pas eu pour effet d’entraîner la caducité de la délégation de pouvoirs accordée… »]) et précis quant à la compétence du délégataire et aux moyens mis à sa disposition (Crim. 21 févr. 2006, no 05-84.365; Crim. 19 sept. 2007, no 06-85.899). Il doit, par ailleurs, fixer les secteurs de la délégation de pouvoirs. De plus, celle-ci devra être acceptée par l’intéressé. (Crim. 23 mai 2007, Bull. crim. o n 138, RSC 2008, p. 615, obs. H. Matsopoulou; Crim. 22 sept. 2015, JCP G 2015, no 1284, note H. Matsopoulou); celui-ci doit avoir compris que, dans le secteur considéré, il est susceptible d’être poursuivi en cas de manquement. En tout cas, « la réalité et la portée d’une délégation de pouvoirs relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Crim. 23 mai 2007, préc.; Crim. 13 oct. 2009, Dr. pénal 2009, comm. no 154, note M. Véron, Rev. sociétés 2010, p. 53, note H. Matsopoulou; Crim. 24 janv. 2012, no 1184.045; Crim. 22 sept. 2015, préc.). Si la délégation est valable, une subdélégation pourra intervenir, comme l’a admis la Cour de cassation (Crim. 30 oct. 1996, Bull. crim. no 389, Rev. sociétés 1997, p. 364, note Bouloc; Crim. 17 janv. 2006, no 05-81.254). Dans cette hypothèse, le subdélégataire doit être clairement informé de la charge pesant sur lui. S’agissant de la personne bénéficiant d’une délégation de pouvoirs (ou du subdélégataire), elle doit être compétente et disposer d’une autorité, ainsi que des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation. En ce qui concerne la compétence, elle suppose, en principe, des connaissances techniques, sans lesquelles le délégataire serait hors d’état d’exercer utilement ses prérogatives. La compétence du délégué doit être appréciée en fonction de la norme qu’il faut faire respecter. Ainsi, avant 318 228 Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices 319 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 d’accorder une délégation de pouvoirs, le chef d’entreprise doit apprécier les compétences de son délégataire et tenir compte de ses expériences professionnelles (v. Crim. 22 sept. 2015, préc. [la compétence limitée du chef d’entreprise délégant dans le secteur pour lequel une délégation de pouvoirs a été consentie ne peut « avoir aucune incidence sur la valeur de la délégation », dès lors que l’intéressé avait « été embauché en raison même de sa compétence »]). À cet égard, on pourra faire remarquer que la chambre criminelle a estimé que le critère de compétence n’était pas rempli, dès lors qu’une délégation de pouvoirs avait été consentie à un salarié le jour même de son embauche (Crim. 2 sept. 2008, no 08-80.408); ce qui démontrait que le délégant n’avait pas pu précédemment vérifier si le délégué présentait toutes les qualités requises pour mener à bien les missions qui lui avaient été confiées. Dans l’hypothèse où le délégant conteste les capacités du préposé, bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs, celle-ci n’est pas effective et ne peut, par conséquent, produire aucun effet exonératoire (tel était le cas d’un chef d’entreprise qui a malencontreusement déclaré au juge d’instruction que le chef d’équipe sur un chantier, à qui une délégation de pouvoirs avait été accordée, était « un bon ouvrier », « gentil », mais il n’était pas « d’une intelligence foudroyante »… c’était « un bon exécutant » ! [Crim. 17 févr. 2004, no 03-81.687]). De même, le jeune âge d’un salarié, titulaire d’une délégation de pouvoirs, et son arrivée récente dans l’entreprise (v. Crim. 14 mai 2013, no 12-81.847; en l’espèce, il a été jugé que le délégué, « arrivé depuis peu dans l’entreprise, ne disposait ni des compétences, ni de l’autorité suffisante pour assumer une délégation de pouvoirs ») ne pouvaient satisfaire aux critères jurisprudentiels nécessaires à la validité de cette délégation, à savoir la compétence et l’autorité suffisante (Crim. 8 déc. 2009, Bull. crim. no 210, Rev. sociétés 2010, p. 332, note H. Matsopoulou). À notre avis, le jeune âge et le peu d’ancienneté du délégué ne devraient pas être des critères déterminants permettant d’apprécier la validité d’une délégation de pouvoirs. C’est qu’en effet, malgré son jeune âge, une personne peut disposer des aptitudes suffisantes pour remplir la mission du délégué et avoir sous ses ordres une équipe dont certains membres pourraient être forcément plus âgés et avoir beaucoup plus d’ancienneté dans l’entreprise (V. toutefois : Crim. 25 sept. 2007, no 06-85.945 : en l’espèce, il a été jugé qu’un chef de chantier, malgré son ancienneté, n’avait jamais reçu de formation adaptée à l’exercice de ses fonctions, de sorte que la délégation de pouvoirs lui ayant été consentie ne pouvait être tenue pour valide). S’agissant, en outre, de l’autorité dont le délégué doit être investi, elle doit s’entendre du pouvoir de donner, au nom de l’employeur, des ordres que commande le respect de la réglementation (V. Crim. 21 oct. 1975, JCP G 1975. II. 12010 : est valable une délégation comportant le pouvoir de licenciement). Enfin, le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du délégué tous les moyens, financiers ou techniques, en vue de satisfaire aux exigences légales, surtout dans le domaine de la sécurité (v. Crim. 22 sept. 2015, préc. [il appartient au délégataire de faire savoir au chef d’entreprise délégant qu’il n’a pas « les moyens de remplir sa mission »]). Ces trois conditions doivent être réunies cumulativement. Lorsque la délégation de pouvoirs est régulière et valable, elle exonère le chef d’entreprise de toute responsabilité pénale. En pareil cas, le délégataire sera poursuivi et lui seul, en raison du manquement pénal accompli par un subordonné ou préposé. C’est qu’en effet, les mêmes manquements ne pourront entraîner un cumul de condamnations du 319 229 319 > 319 L’infraction 230 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 chef d’entreprise délégant et du préposé délégataire (Crim. 14 mars 2006, Bull. crim. no 75; Crim. 14 nov. 2006, JCP G 2007. I. 203, no 3, obs. J.-F. Cesaro). Toutefois, le cumul des responsabilités n’est pas exclu si des fautes de nature différente peuvent être reprochées au chef d’entreprise et à son préposé. Même si une telle éventualité est rare en jurisprudence, on pourra isoler un arrêt du 23 octobre 1984 (Bull. crim. no 316), par lequel la chambre criminelle a approuvé la décision d’une cour d’appel ayant déclaré que le principe de l’engagement de la responsabilité pénale du chef d’entreprise en cas de violation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs « ne saurait mettre obstacle à ce que des maladresses, imprudences, inattentions ou inobservations des règlements, relevées à la charge d’autres membres de l’entreprise dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, donnent lieu à des poursuites » pénales (v. aussi : Crim. 8 sept. 2015, Dr. pénal 2015, comm. no 137, note Ph. Conte [« la délégation générale en matière d’hygiène et de sécurité du capitaine d’un navire ne décharge pas l’armateur de la responsabilité pénale qu’il encourt personnellement pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage »]). S’agissant des obligations que la loi met à la charge du chef d’entreprise, parce qu’il est le mandataire social ou le responsable des activités de la société, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation. Ces missions relèvent du « noyau dur » de ses obligations. Il ne peut confier à personne le soin de convoquer l’assemblée générale, d’arrêter les comptes et de proposer le montant des dividendes distribuables. Aussi bien, lorsqu’un président, à qui on reprochait le défaut de publication au registre du commerce, invoquait une délégation donnée à l’expert-comptable, la Cour de cassation a refusé d’admettre une telle justification exonératoire (Crim. 15 mai 1974, Bull. crim. no 176; v. aussi : J.-H. Robert, « Qui répond de l’inobservation des règles de publicité et d’information imposées aux sociétés anonymes ? », D. 1976, chron. p. 171). Cette solution jurisprudentielle ne peut qu’être approuvée, dans la mesure où il s’agit d’obligations destinées à assurer l’exacte information des associés et du public, qui ressortissent aux pouvoirs d’administration générale exercés par les mandataires sociaux (V. Crim. 19 déc. 1977, Bull. crim. no 402). Le chef d’entreprise ne peut pas davantage rejeter la responsabilité du défaut de consultation du comité d’entreprise (Crim. 3 mars 1998, Bull. crim. no 81) ou du comité d’hygiène et de sécurité sur autrui (Crim. 15 mars 1994, Bull. crim. no 100, D. 1995, p. 30, note Reinhard; Crim. 14 oct. 2003, Bull. crim. no 190, Dr. pénal 2004, comm. no 11, obs. J.-H. Robert). Dans ces hypothèses, c’est le chef d’entreprise et lui seul qui est pénalement responsable et toute délégation de pouvoirs accordée ne pourra produire aucun effet exonératoire. Il en est de même lorsque le chef d’entreprise, après avoir consenti une délégation de pouvoirs à l’un de ses subordonnés, continue à conserver le contrôle réel du respect par l’entreprise de ses obligations dans le secteur pour lequel une telle délégation a été donnée et détermine les décisions du délégué. Ainsi, la chambre criminelle a déclaré personnellement responsable d’un délit de fraude fiscale le chef d’entreprise qui s’était réservé la signature des chèques et la remise de comptes rendus hebdomadaires, ce qui avait pour conséquence d’anéantir les effets exonératoires d’une délégation de pouvoirs accordée au profit de son directeur financier. Dans cette hypothèse, il était clair que le dirigeant de la société avait conservé le contrôle effectif du respect par l’entreprise de ses obligations à l’égard de l’administration fiscale (Crim. 19 août 1997, Rev. sociétés 1997, p. 863, note B. Bouloc. V. aussi : Crim. 19 oct. 1995, Bull. crim. no 317, Rev. sociétés 1996, p. 323, note Les responsables pénaux : auteurs – coauteurs – complices international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 B. Bouloc; Crim. 4 août 1998, Bull. crim. no 224; Crim. 9 oct. 2007, no 06-89.028). Sans aucun doute, toute intervention personnelle du délégant dans les missions confiées au préposé délégataire vide la délégation de son contenu (Crim. 7 juin 2011, no 10-84.283) et la rend totalement inefficace (Crim. 20 mars 2007, Bull. Joly Sociétés 2007, p. 953, § 269, note J.-F. Barbièri, Rev. sociétés 2007, p. 590, note B. Bouloc; v. aussi : Crim. 17 sept. 2002, Dr. pénal 2003, comm. no 9, note J.-H. Robert, RSC 2003, p. 339, obs. R. Ottenhof). Enfin, ne produit pas non plus un effet exonératoire une délégation consentie par le chef d’entreprise à plusieurs personnes pour l’exécution d’un même travail. C’est qu’en effet, un tel « cumul » est « de nature à restreindre l’autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires » (Crim. 6 juin 1989, Bull. crim. no 243; Crim. 23 nov. 2004, Bull. crim. no 295). 231 Chapitre 6 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 L’essentiel Dans la conception classique, qui est celle du droit pénal français, les délinquants sont ceux qui ont commis un acte prévu et défini par la loi pénale. Peut donc engager sa responsabilité pénale la personne physique qui a accompli matériellement tous les actes prohibés par la loi. On appelle cette personne l’auteur matériel. Si deux ou plusieurs individus accomplissent les actes matériels constitutifs d’une infraction, ils seront considérés comme coauteurs. Mais, en dehors des personnes physiques, les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables. En outre, la loi pénale réprime, au titre de la complicité, tous ceux qui ont aidé, en connaissance de cause, l’auteur principal. Enfin, il est permis de se demander si l’on n’admet pas une responsabilité pénale du fait d’autrui, dès lors qu’il s’agit du chef d’entreprise. 1. Les personnes morales Selon l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutes les personnes morales sont concernées, à l’exclusion de l’État qui a le monopole de la répression, et des collectivités territoriales, lorsque celles-ci accomplissent des activités régaliennes. Toutefois, pour qu’une poursuite pénale puisse être exercée à l’encontre d’une personne morale, il faut qu’une infraction ait été accomplie pour son compte par l’un de ses organes ou représentants. En ce qui concerne les infractions susceptibles d’être imputées à une personne morale, les rédacteurs du nouveau Code pénal avaient édicté le principe de spécialité, selon lequel une personne morale ne pouvait être pénalement responsable que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Cependant, la loi du 9 mars 2004 a supprimé ce principe, en généralisant la responsabilité pénale des personnes morales pour toute infraction. Mais, pour que cette responsabilité soit engagée, encore faut-il que l’infraction ait été accomplie pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants. L’expression « pour le compte » signifie que l’organe ou le représentant agit ès qualités, ou bien dans l’exercice de ses fonctions ou peut-être à l’occasion de l’exercice de celles-ci. La loi indique, par ailleurs, qu’une telle responsabilité ne peut être retenue que si l’infraction est commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Aussi bien, la Cour de cassation a considéré que les personnes bénéficiant d’une délégation de pouvoirs consentie par le chef d’entreprise peuvent être considérées 232 2. La complicité international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 comme les représentants de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal. Elles peuvent donc engager la responsabilité pénale de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’elles étaient tenues de faire respecter en vertu de la délégation. Pour pouvoir imputer une infraction à la personne morale, la jurisprudence a, pendant longtemps, estimé qu’il était nécessaire que les juges établissent en quoi les organes ou représentants ont commis une « faute pénale ». Concrètement, il fallait caractériser « la volonté infractionnelle » ou les négligences et manquements aux obligations de sécurité en la personne de ses organes ou représentants. Néanmoins, ce courant jurisprudentiel a été sérieusement remis en cause par toute une série de décisions qui n’ont pas hésité à déclarer des sociétés coupables des délits de blessures ou d’homicide involontaires, sans préciser l’identité de l’auteur des imprudences ou négligences constitutives de ces infractions. Cette solution a été, par la suite, étendue aux délits intentionnels. Dès lors qu’une infraction, intentionnelle ou non, a été réalisée dans le cadre de l’activité de l’entreprise, elle était présumée avoir été commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Actuellement, il semble que cette jurisprudence est remise en cause par de nombreux arrêts, par lesquels la chambre criminelle censure des décisions de cours d’appel n’ayant pas recherché si les manquements imputés à des personnes morales avaient été commis par des organes ou des représentants, au sens de l’article 121-2 du Code pénal. On pourra, en outre, relever que, lorsqu’il s’agit d’une infraction d’imprudence, et lorsque l’organe ou le représentant, dont la faute est à l’origine du dommage, n’est pas identifié en l’état de la procédure, la chambre criminelle exige que les juges du fond procèdent à une telle identification, « au besoin en ordonnant un supplément d’information ». Si l’on s’appuie sur ces solutions jurisprudentielles, il est permis de penser que la chambre criminelle fait désormais une application correcte des dispositions de l’article 121-2 du Code pénal en se montrant respectueuse de la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale. En tout cas, le mouvement jurisprudentiel, qui exige l’identification des organes ou représentants ayant commis les faits délictueux susceptibles d’engager la responsabilité pénale des personnes morales, permet de mettre en œuvre la règle du cumul des responsabilités, comme l’autorise l’article 121-2, al. 3, du Code pénal. On rappellera que selon ce texte, « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ». Quoi qu’il en soit, depuis la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, celles-ci peuvent désormais être poursuivies et condamnées, au titre de la complicité, pour toute infraction. Trois conditions doivent être réunies pour que la complicité soit punissable : un fait principal, un acte matériel défini par la loi, une intention coupable. S’agissant de la première condition, l’acte du complice emprunte sa criminalité à l’acte de l’auteur principal. Il en découle donc : 233 a) que l’on ne saurait réprimer une complicité apportée à l’accomplissement d’un acte qui n’est pas sanctionné par la loi pénale; international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 b) qu’on ne peut réprimer un acte de complicité, si l’auteur principal n’a pas pour le moins franchi le seuil du commencement d’exécution qui caractérise la tentative punissable. Aussi bien, l’aide apportée aux actes préparatoires suivis d’un commencement d’exécution est un acte de complicité incriminé; la complicité de tentative est donc punissable. En ce qui concerne l’acte matériel de complicité, il doit s’agir d’un ou de plusieurs actes positifs énumérés par l’article 121-7 du Code pénal, réalisés sciemment dans le but d’aider à la commission d’une infraction. Ces actes doivent, par ailleurs, être antérieurs ou concomitants à la commission de l’infraction. La complicité punissable exige, en principe, un acte positif et non pas une simple abstention ou une omission. Cependant, la jurisprudence admet la complicité par abstention, dès lors que le complice apporte un « soutien moral » à l’auteur principal ou omet, dans l’exercice de ses fonctions ou missions, d’effectuer les contrôles nécessaires, comme il a l’obligation de le faire, ce qui facilite la commission de l’infraction. S’agissant des actes matériels de complicité antérieurs à la commission de l’infraction, ils peuvent revêtir la forme soit d’une provocation, soit d’une aide ou d’une assistance dans les actes préparatoires à la commission de l’infraction, soit d’instructions données pour faciliter cette commission. Toutefois, la provocation ne peut tomber sous le coup de la loi pénale que si elle est assortie de « don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir » (on dit que la provocation doit être circonstanciée). Quant aux actes postérieurs à la consommation de l’infraction, ils peuvent constituer un acte de complicité, lorsqu’ils résultent d’un accord antérieur. Enfin, il est nécessaire que le complice ait conscience de l’aide apportée à la commission de l’infraction par l’auteur principal. Cette conscience doit être concomitante de l’acte matériel de complicité. En revanche, le comportement du complice ne devrait pas être sanctionné au cas où il n’aurait commis qu’une simple faute d’imprudence ou de négligence. C’est qu’en effet, la complicité suppose une faute intentionnelle. Cependant, la jurisprudence n’hésite pas à réprimer la complicité d’une infraction d’imprudence. Si les conditions prévues par la loi sont réunies, le complice s’expose aux peines qu’il aurait encourues, s’il avait été l’auteur principal de l’infraction. Au niveau de la répression, il est donc considéré comme auteur (art. 121-6 C. pén.). Les causes d’aggravation de la peine nées en la personne de l’auteur principal rejailliront sur le complice, lorsqu’elles ont un caractère objectif (circonstances réelles) et modifient la matérialité de l’infraction. En revanche, les circonstances personnelles à l’auteur de l’infraction (qui peut, par exemple, être un récidiviste) n’exercent aucune influence sur la peine applicable au complice. Par ailleurs, le complice peut être poursuivi, même si l’auteur principal ne l’est pas, soit parce que celui-ci est décédé ou bénéficie d’une cause d’impunité strictement personnelle, soit parce qu’il est en fuite ou n’a pu être identifié. Au contraire, si la cause d’impunité de l’auteur principal est objective (fait justificatif, prescrip234 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 tion), le complice ne peut pas être poursuivi, en l’absence d’un fait principal punissable. Mais si le législateur a pris soin de définir les conditions de la complicité punissable, il n’en est pas de même, dès lors qu’il s’agit de celles de la responsabilité pénale du chef d’entreprise. 3. La responsabilité pénale du chef d’entreprise Le chef d’entreprise est pénalement responsable des actes ou omissions qu’il a personnellement accomplis en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Il l’est aussi des infractions commises, au sein de son entreprise, en sa qualité de dirigeant. À cet égard, on pourra faire observer que la Cour de cassation admet une telle responsabilité dans les entreprises et professions réglementées, où le chef d’entreprise a légalement l’obligation d’assurer l’exécution de nombreuses prescriptions (par exemple, en matière de droit du travail, de sécurité sociale, etc.). Le plus souvent, les infractions retenues ne requièrent comme élément moral qu’une imprudence ou une négligence, et précisément ce que l’on peut reprocher au chef d’entreprise c’est d’avoir été négligent dans l’organisation de l’activité. Il est vrai que le chef d’entreprise souhaite être déchargé de cette responsabilité. Mais la jurisprudence avait estimé que celle-ci était présumée et elle ne pouvait pas tomber devant la preuve de l’absence de faute de contrôle ou de surveillance. On observera toutefois que depuis la loi du 10 juillet 2000, il faut établir la faute d’imprudence du chef d’entreprise, celle-ci devant être appréciée in concreto. En outre, lorsque le chef d’entreprise est un auteur indirect (comme c’est le plus souvent le cas), sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute délibérée ou caractérisée. Cependant, même sous l’empire de la loi du 10 juillet 2000, il semble que les juges continuent à présumer la faute caractérisée à l’égard du chef d’entreprise. De toute façon, ce dernier, qui est souvent dans l’impossibilité matérielle de tout contrôler ou surveiller, peut déléguer à un ou plusieurs de ses subordonnés tout ou partie de ses pouvoirs, en vue de faire respecter la réglementation. C’est qu’en effet, la jurisprudence a admis, depuis longtemps, que le chef d’entreprise puisse déléguer certains de ses pouvoirs, notamment en matière de réglementation de l’hygiène et de sécurité des travailleurs. La délégation doit être acceptée par l’intéressé. Quant à la personne bénéficiant d’une délégation de pouvoirs, elle doit être compétente; par ailleurs, elle doit disposer d’une autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation. Si la délégation est régulière et valable, seul le délégataire sera poursuivi en raison du manquement pénal accompli par un préposé ou subordonné. 235 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 Sujets de concours Administrateur territorial, concours externe, 2005 La responsabilité pénale des collectivités territoriales Administrateur territorial, concours externe, 2002 La responsabilité pénale de l’élu local Greffier, concours externe, 2013 La responsabilité pénale des personnes morales Greffier en chef, concours externe, 2000 La complicité Magistrat, concours externe, 2001 L’entreprise et le risque pénal Officier de police, concours externe, 2006 Conséquences en droit pénal et en procédure pénale de la pluralité d’auteurs d’une infraction 236 Chapitre 6 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 Deuxième partie Le procès pénal, étude de la procédure pénale 320 Les règles relatives à la procédure pénale sont particulièrement importantes, tant pour la protection de la société (car la procédure doit permettre de confondre les coupables en dépit de leurs dénégations) que pour la sauvegarde de la liberté individuelle (car elles doivent permettre à l’innocent d’éviter d’être victime d’une erreur judiciaire, et au coupable de faire valoir ses moyens de défense, de façon à ce que la peine qui sera éventuellement prononcée contre lui soit vraiment équitable). L’intérêt social voudrait une procédure rapide, mais une certaine prudence est nécessaire car il faut laisser à la personne poursuivie la possibilité d’organiser sa défense. De 1808 à la mise en application du Code de procédure pénale, de nombreuses réformes ont atténué le caractère inquisitoire de l’instruction préparatoire (les droits de la défense sont consacrés par la loi du 8 décembre 1897), et cette évolution, après avoir trouvé un aboutissement provisoire dans le nouveau Code de procédure (1959), s’est poursuivie par de nombreuses lois (en particulier L. 9 juill. 1984 et 6 juill. 1989 relatives à la détention provisoire – L. no 93-22, 4 janv. 1993 modifiée par L. no 93-1013, 24 août 1993, loi du 15 juin 2000 et loi du 5 mars 2007, supra, nos 18 et s.). L’intervention possible de l’avocat lors de la garde à vue, l’intervention d’un juge des libertés et de la détention et le statut du témoin assisté constituent des manifestations certaines du libéralisme de la procédure contemporaine. 321 Les deux premiers chapitres traiteront des rouages de la procédure à l’état statique : le premier sera consacré à l’objet et aux parties du procès pénal, c’est-à-dire à l’action publique et à l’action civile ainsi qu’à ceux qui exercent ces actions. Le deuxième chapitre sera réservé à l’examen des diverses juridictions répressives, leur organisation et leur compétence. 320 321 321 > 321 Le procès pénal, étude de la procédure pénale 238 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 Le chapitre troisième traitera des preuves en droit répressif. Enfin les chapitres suivants examineront le fonctionnement de la procédure pénale sous son aspect dynamique, en suivant l’ordre chronologique de son déroulement. Ainsi, le chapitre quatre sera consacré à la recherche des infractions; dans le chapitre cinquième sera étudiée la poursuite, le sixième traitera de l’instruction; un septième chapitre concernera le jugement et un huitième, les voies de recours; enfin un neuvième chapitre sera consacré à l’autorité de la chose jugée. 1 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 chapitre L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal Successivement, il sera traité des actions, puis des parties au procès répressif. section 1 L’action publique et l’action civile 322 L’action publique est l’action répressive mise en mouvement et exercée par « les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi » (art. 1er C. pr. pén.), au nom de la société, contre l’auteur de l’infraction, et tendant à le faire condamner à une peine (ou à une mesure de sûreté), ou tout au moins à faire constater son comportement (l’auteur des faits incriminés pouvant échapper à la sanction à raison d’une cause d’irresponsabilité pénale, telle la légitime défense [V. supra, nos 207 et s.]). L’action civile est l’action en dommages-intérêts introduite par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (art. 2 C. pr. pén.), afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction (ou de ses coparticipants ou des personnes civilement responsables des uns et des autres) la réparation du préjudice causé par l’infraction. Si l’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, l’article 3 du Code de procédure pénale dispose que « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». Ainsi donc, l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal, et, mieux encore, la partie lésée par l’infraction peut souvent mettre en mouvement l’action publique en exerçant l’action civile (art. 1er, al. 2, C. pr. pén.). 32 239 323 > 323 Le procès pénal, étude de la procédure pénale § 1 La comparaison entre l’action publique et l’action civile A. Différences 323 32 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 Cette jonction possible de l’action publique et de l’action civile devant la même juridiction répressive est une particularité de la procédure pénale française, et ne se retrouve ni dans la procédure anglo-américaine ni même dans la plupart des procédures continentales. Ce sont surtout les différences qui apparaissent au premier abord. 1° Différence de but L’action publique tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la loi; l’action civile tend à la réparation du préjudice individuel (dommages-intérêts, éventuelles restitutions) occasionné « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». 2° Différence de fondement L’action publique repose toujours sur un texte précis de la loi pénale, celui posant la norme qui a été enfreinte (principe de la légalité); l’action civile est toujours fondée sur les articles 1382 ou 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 (responsabilité du fait personnel). 3° Différence de nature L’action publique est d’ordre public, il n’est donné à personne d’y renoncer; le ministère public, à qui est confié son exercice (art. 1er C. pr. pén.) n’en a pas la disposition et ne peut transiger à son sujet (sauf exceptions prévues par la loi); elle appartient à la société qui ne peut y renoncer que par la voie du pouvoir législatif (loi d’amnistie). L’action civile est dans le patrimoine privé de la victime; celle-ci peut y renoncer ou transiger à son sujet. 4° Différence d’objet L’action publique a pour objet, une peine infligée à l’individu, proportionnée à la faute qu’il a commise (ou une mesure proportionnée à son état dangereux); l’action civile a pour objet la réparation proportionnée au dommage subi (sans considération de la gravité de la faute commise). 5° Différence portant sur les parties à l’action Les demandeurs à l’action publique et à l’action civile sont respectivement le ministère public et la victime, les défendeurs sont respectivement : exclusivement les coupables (auteurs ou complices) pour l’action publique – outre les présumés coupables, les héri240 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal B. Rapprochement 324 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 tiers de ceux-ci ou les personnes civilement responsables pour l’action civile. Il y a lieu de rapprocher de ceux-ci le tiers qui est menacé de supporter personnellement le fardeau de certaines peines à caractère réel prononcées contre le coupable; (ainsi en est-il du propriétaire de l’immeuble, du bailleur ou du propriétaire du fonds d’un établissement dans lequel ont été constatés des faits de proxénétisme hôtelier réprimé par l’article 225-10 du Code pénal [V. art. 706-37 s. C. pr. pén.]). La loi du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions réglemente l’intervention – dans certaines hypothèses – de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès (art. 388-1 C. pr. pén. – V. infra, no 389). Les différences sont donc très apparentes et très sensibles, mais il y a aussi entre les deux actions de nombreux points de contact qui expliquent que la loi ait établi une certaine solidarité entre les deux actions. L’action civile et l’action publique sont nées du même fait. Les agissements poursuivis ont à la fois réalisé l’infraction et, dans certains cas tout au moins, causé le dommage individuel. Ils ont donc fait naître à la fois, en pareil cas, l’action publique et une action civile. Il est à noter que certaines infractions ne causent pas de préjudice individuel (port d’arme prohibé, ou infraction à un arrêté d’expulsion, par exemple) mais seulement un trouble social, et ne donnent alors naissance qu’à l’action publique. D’autre part, un même élément moral (la faute) est à la base de l’une et l’autre de ces deux actions (pour l’action civile une faute même très légère suffit). Aussi y a-t-il avantage à ce que les deux actions soient examinées parallèlement, et c’est la raison pour laquelle le législateur a établi entre elles une solidarité qui se manifeste à plusieurs points de vue. 1° Les deux actions peuvent (sauf exception) être portées ensemble devant les mêmes juges, c’est-à-dire les juges répressifs qui seront compétents pour connaître à la fois de l’action publique et de l’action civile. Au surplus, il n’y a là qu’une faculté ouverte à la victime qui conserve le droit de porter son action civile devant le juge civil; une option lui est offerte dans des conditions qui seront examinées ci-dessous (V. infra, no 383). 2° Si la victime porte son action civile devant le juge répressif, son initiative a pour effet de déclencher automatiquement l’action publique si celle-ci ne l’avait pas encore été. 3° Ce qui a été jugé sur l’action publique a autorité sur l’action civile. Cependant la loi du 3 janvier 1972 instituant le procédé de l’ordonnance pénale a établi une dérogation importante; d’après les articles 495-5 et 528-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’ordonnance pénale (V. infra, nos 926 et s.) n’a pas autorité de la chose jugée sur l’action civile que la victime peut intenter soit devant le juge civil, soit même devant le tribunal pénal (V. en matière de composition pénale : soc. 13 janv. 2009, D. 2009 p. 709). Par ailleurs, la loi du 8 juillet 1983, renforçant la protection des victimes d’infractions, dispose que « Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des 2e, 3e et 4e alinéas de l’article 121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de 324 241 325 > 325 Le procès pénal, étude de la procédure pénale § 2 Causes d’extinction communes à l’action publique et à l’action civile A. Principes 325 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » (art. 470-1 C. pr. pén.). Le même texte précise que lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal doit renvoyer l’affaire devant la juridiction civile compétente (qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée). La loi du 10 juillet 2000 a également précisé que l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant un juge civil pour obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du Code civil ou de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (art. 4-1 C. pr. pén.). Il y avait autrefois une étroite solidarité entre l’action publique et l’action civile. C’est ainsi que la prescription de l’action publique entraînait celle de l’action civile, solution qui comportait de sérieux inconvénients pratiques, et dont la jurisprudence s’efforçait de limiter la portée. L’ordonnance du 23 décembre 1958 modifiant l’article 10 du Code de procédure pénale avait réduit la solidarité des deux prescriptions en indiquant que l’action civile ne pouvait être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique; au contraire, si l’action publique avait été engagée et une condamnation prononcée, la prescription de l’action civile retrouvait son délai normal de 30 ans (aujourd’hui 5 ans, sauf en cas de dommage corporel – 10 ans – ou d’une créance soumise à l’une des prescriptions plus courtes du Code civil). Une nouvelle modification, beaucoup plus importante, a été réalisée par la loi du 23 décembre 1980. Le premier alinéa de l’article 10 est depuis la loi du 17 juin 2008 ainsi conçu : « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil ». Le second alinéa du même article dispose que : « Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ». Ainsi, le seul lien entre les deux actions, sur le plan de la prescription, c’est que l’action civile peut être portée devant le juge civil pendant 5 ans (délai de prescription de l’action civile), (V. infra, no 351), mais que si la victime opte pour la voie répressive, elle doit agir avant que le délai de prescription de l’action publique ne soit écoulé. En effet, ce délai expiré, le juge répressif ne peut plus connaître de l’action publique, or il ne peut connaître de l’action civile qu’accessoirement à l’action publique. Désormais l’expiration du délai de prescription de l’action publique n’éteint plus l’action civile, elle oblige simplement la victime à porter son action en réparation devant le juge civil. La seule cause vraiment commune d’extinction de l’action civile et de l’action publique est donc aujourd’hui l’autorité de la chose jugée, la prescription de l’action publique ne gardant, quant à l’action civile, que l’effet précisé ci-dessus. 325 242 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal B. L’autorité de la chose jugée 326 Il y a chose jugée au pénal (V. infra, nos 1070 et s.) lorsque les faits reprochés ont donné lieu à une poursuite qui a été terminée par une décision définitive sur le fond, c’est-à-dire contre laquelle il n’y a plus de voie de recours. Les décisions rendues par les juridictions de jugement ont autorité de la chose jugée, quel que soit le sens dans lequel elles ont été rendues (qu’il y ait eu condamnation, absolution, acquittement ou relaxe). Cependant les ordonnances pénales instituées par la loi du 3 janvier 1972 pour tenir lieu de décision de jugement en matière de contraventions et de certains délits n’ont pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile (cf. art. 495-6 et 528-1, al. 2, C. pr. pén.). Les décisions des juridictions d’instruction (V. infra, nos 891 et s.) n’ont pas cette autorité (les décisions de renvoi devant la juridiction de jugement ne lient même pas cette dernière; les décisions de non-lieu n’empêchent pas la reprise des poursuites s’il survient des charges nouvelles [V. infra, no 891]). 327 La décision qui a autorité de chose jugée au pénal éteint l’action publique; désormais aucune poursuite pénale ne peut plus être intentée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente (Crim. 20 mars 1956, D. 1957, p. 333, note Hugueney; Crim. 19 janv. 2005, Bull. crim. no 25). 327 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 326 Il en est ainsi quand bien même des charges nouvelles (des aveux) apparaîtraient après la décision d’acquittement ou de relaxe (d’où l’intérêt à se borner parfois à une décision de non-lieu plutôt que de saisir la juridiction de jugement). – À plus forte raison en est-il ainsi quand la décision intervenue est une décision de condamnation. Cependant, s’il s’agit d’une infraction continue, une nouvelle poursuite est possible si l’état délictueux persiste après la première condamnation (car tous les éléments de l’infraction, y compris l’élément moral, se trouvent à nouveau réalisés); en effet ce ne sont pas les faits ayant donné lieu à la première condamnation, mais des faits nouveaux quoique de même nature, qui sont poursuivis. Ce sera, par exemple, l’hypothèse d’un receleur qui persiste à rester en possession de la chose après avoir été condamné pour recel. Le point de savoir s’il s’agit ou non de faits identiques aux précédents est du reste parfois difficile à résoudre. Ainsi, il a été décidé que des faits d’homicide volontaire étaient différents de ceux poursuivis précédemment du chef d’homicide involontaire. La décision pénale dotée de l’autorité de la chose jugée, qu’elle soit d’acquittement ou de condamnation, a une influence capitale sur l’action civile. C’est ce qu’on appelle le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. 328 328 – Si le jugement rendu sur l’action publique est une condamnation, l’action civile sera admise, à moins qu’elle ne se heurte à une cause spéciale d’irrecevabilité. En effet, ce jugement établit irréfragablement la faute commise par l’auteur de l’infraction (il en est autrement en cas d’ordonnance pénale; cf. art. 495-6 et 528-1, al. 2, C. pr. pén.), (V. supra, no 324). – Inversement une décision d’acquittement ou de relaxe entraînerait automatiquement l’insuccès de l’action civile car elle établirait de façon tout aussi irréfragable que la personne poursuivie n’a commis aucune faute, tout au moins lorsque l’élément moral de l’infraction est constitué par une simple faute d’imprudence (la relaxe par ordonnance pénale n’a pas le même effet; cf. art. 495-6 et 528-1, al. 2, C. pr. pén.); une relaxe fondée sur l’absence de faute intentionnelle n’aurait pas le même effet. Ainsi la personne qui a pris par erreur la chose d’autrui et qui, dans ces conditions, a été relaxée du chef de vol, peut faire l’objet de poursuites civiles aux fins de restitution de la chose ou d’indemnisation. – Ainsi qu’il a été signalé (V. supra, no 324), depuis les lois du 8 juillet 1983 et du 10 juillet 2000, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi 243 329 > 330 Le procès pénal, étude de la procédure pénale 329 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires, qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur, formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite (art. 470-1 et 541 C. pr. pén.). Par ailleurs, l’absence de faute pénale d’imprudence n’exclut pas l’existence d’une faute civile d’imprudence ou d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 CSS (art. 4-1 C. pr. pén.). Il convient encore de noter les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984, admettant que le mineur soit tenu de réparer des dommages, sur le fondement de la responsabilité « objective », même s’il est pénalement irresponsable (D. 1984, p. 525, concl. Cabannes, note F. Chabas). En cas d’acquittement, le verdict négatif de la cour d’assises n’étant pas motivé ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts par la Cour si celle-ci peut relever l’existence d’une faute dommageable résultant des faits qui sont l’objet de l’accusation et que le verdict a dépouillés de leur caractère criminel (art. 372 C. pr. pén.). Encore faut-il que le fait invoqué soit distinct du crime considéré (Crim. 3 janv. 1952, D. 1952, 146; Crim. 20 oct. 1993, Bull. crim. no 298). 329 § 3 Causes d’extinction propres respectivement à l’action publique ou à l’action civile A. Causes d’extinction propres à l’action publique 1° Prescription de l’action publique 330 Fondement de la prescription. On justifie d’abord cette institution par le fait que le trouble que l’infraction avait causé à l’ordre public s’est apaisé avec le temps (plus ou moins vite selon la gravité de l’infraction), et que ce trouble serait ravivé par des poursuites tardives qui auraient en outre l’inconvénient de mettre en évidence la défaillance prolongée des pouvoirs publics. On a également fait valoir que des poursuites intentées longtemps après les faits seront difficiles à mener à bien, car les preuves ne seront plus faciles à réunir (il s’agit du danger du dépérissement des preuves). Enfin, on fait état de l’insécurité dans laquelle le coupable a dû vivre pendant la durée de la prescription et qui a pu constituer une forme de châtiment. Cependant, la jurisprudence se montre, de manière générale, hostile au mécanisme de la prescription. Il semble qu’elle subit plus qu’elle n’accepte la prescription de l’action publique (B. Bouloc, Procédure pénale, 26e éd., 2018, no 227). Ainsi, fait-elle sienne l’opinion de l’école positiviste italienne, pour qui le temps n’atténue ni ne supprime le danger que le délinquant présente pour la société. Malgré ces critiques, le législateur a maintenu cette institution, qui a donné lieu à une réforme importante opérée par la loi no 2017-242 du 27 février 2017 (v. sur cette loi : A. Lepage et H. Matsopoulou, « La prescription de l’action publique entre pérennité et innovations », Dr. pénal (mai) 2017, Dossier, étude no 1, p. 17 et s.; J. Leblois-Happe, « La réforme de la prescription, enfin ! », JCP G 2017, no 424, p. 738). Cette réforme s’inscrit 30 244 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 dans la continuité des propositions de la « mission d’information sur la prescription pénale », tendant à rendre le dispositif applicable en la matière « lisible » et « cohérent », ainsi qu’« à assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique » (Rapport d’information, Ass. nat. no 2778, 20 mai 2015, p. 9). Ces précisions données, la prescription de l’action publique est actuellement réglementée par les articles 7 à 9-3 du Code de procédure pénale. Délais de la prescription. La loi du 27 février 2017 a sensiblement allongé les délais de prescription de droit commun, en matière délictuelle et criminelle, par rapport à ceux prévus par le droit antérieur. Ainsi, le délai de prescription de l’action publique des délits passe de trois à six ans (art. 8, al. 1er, C. pr. pén.) et celui des crimes passe de dix à vingt ans (art. 7, al. 1er, C. pr. pén.). Ce faisant, le législateur a donc unifié, dans les domaines concernés, les délais de prescription de l’action publique et de la peine (art. 133-2 et 133-3 C. pén.; v. supra no 53). En revanche, tenant compte des nécessités de la pratique, il a renoncé à procéder à une telle harmonisation en matière contraventionnelle, le délai de prescription de l’action publique étant maintenu à un an (art. 9 C. pr. pén.; le délai de prescription de la peine contraventionnelle de trois ans n’a pas non plus été modifié). 331 31 – Plusieurs raisons ont justifié l’allongement légal des délais de prescription de l’action publique. C’est qu’en effet, les anciens délais apparaissaient très courts et étaient, dans l’ensemble, plus brefs que ceux retenus par la plupart des législations européennes. Lors des travaux préparatoires de la loi du 27 février 2017, on a fait valoir que cette évolution devrait permettre « de faciliter la répression des délits les plus graves et les plus complexes à poursuivre, notamment en matière économique et financière ». En outre, on a invoqué les progrès réalisés dans le domaine de la preuve scientifique (empreintes génétiques, traces papillaires) et les intérêts des victimes et de leur famille. 332 Délais dérogatoires. Les rédacteurs de la loi du 27 février 2017 n’ont pas entendu modifier les délais dérogatoires. Ainsi, certains crimes particulièrement graves (crimes de guerre, disparition forcée, terrorisme, trafic de stupéfiants) continuent d’être soumis au délai dérogatoire de trente ans (art. 7, al. 2, C. pr. pén.; on pourra faire observer que le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes propose d’allonger le délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes de nature sexuelle mentionnés à l’article 706-47 C. pr. pén. et pour celui de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente visé à l’article 222-10 du Code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ce délai devant courir à compter de la majorité des victimes). De même, les délais dérogatoires de dix ans et de vingt ans continuent de s’appliquer à certains délits commis sur un mineur (art. 8, al. 2 et 3, C. pr. pén.), tandis que le délai de vingt ans est maintenu à l’égard d’autres délits, tels que ceux relatifs au terrorisme ou au trafic de stupéfiants (art. 8, al. 4, C. pr. pén.). En outre, les délais spéciaux, plus courts, prévus en matière d’infractions de presse (délai de trois mois) et d’infractions au Code électoral (délai de six mois) sont également maintenus. Enfin, les crimes contre l’humanité (art. 211-1 à 212-3 C. pén.) continuent d’être imprescriptibles (art. 7, dernier al., C. pr. pén.). 333 Point de départ du délai. Le délai de la prescription commence à courir à partir du jour où l’infraction a été commise, bien que ce jour ne compte pas dans le calcul de ce délai. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une infraction continue (tel le recel), le point de départ se 32 33 245 334 > 334 Le procès pénal, étude de la procédure pénale international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 situe au moment où l’état délictueux a cessé « dans ses actes constitutifs et dans ses effets » (Crim. 30 sept. 1992, Bull. crim. no 300; Crim. 24 mai 2018, no 17-86.340 [à propos du crime de séquestration arbitraire]). Pour les délits d’habitude, qui résultent de la commission de plusieurs faits dont la répétition seule est pénalement sanctionnée, tel l’exercice illégal de la médecine, la prescription commence à courir à compter du jour du dernier acte constitutif de l’habitude, qui réalise l’infraction. En outre, le point de départ d’un certain nombre d’infractions commises sur un mineur a été fixé à la majorité de la victime. Ainsi, les crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, le crime de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commis avec une circonstance aggravante (art. 222-10 C. pén.) et le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis avec une circonstance aggravante (art. 222-12 C. pén.), lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrivent à partir de la majorité de la victime (art. 9-1, al. 1er, C. pr. pén). Le report législatif du point de départ du délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées. Par dérogation au principe législatif qui fixe le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la commission de l’infraction, les juridictions répressives, ayant recours au critère de « dissimulation » ou au caractère « occulte » de certaines infractions, reculaient constamment ce point dans de nombreux secteurs. Tel était le cas de l’abus de confiance, dont le caractère clandestin a conduit la jurisprudence à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (v. not. Crim. 8 févr. 2006, Bull. crim. no 34; Crim. 16 déc. 2009, RSC 2010, p. 627, obs. H. Matsopoulou). Ce mouvement jurisprudentiel a été progressivement étendu à de nombreuses autres infractions : abus de biens sociaux, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme, tromperie, ententes prohibées. 334 34 – La non-conformité de cette jurisprudence à des principes constitutionnels a servi de fondement à des questions prioritaires de constitutionnalité invoquant la violation des « principes constitutionnels de légalité et de prévisibilité de la loi, garantis par l’article 8 de la DDHC ». Sans entrer dans les détails, on se contentera simplement d’indiquer ici que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que ces questions n’étaient pas sérieuses, car « les règles, relatives au point de départ de la prescription de l’action publique […], sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs » (Cass., ass. plén., 20 mai 2011, Dr. pénal 2011, comm. no 95, note J.-H. Robert, Rev. sociétés 2011, p. 512, note H. Matsopoulou). Sans aucun doute, cette affirmation est contestable car la procédure pénale ne relève que de la matière législative, comme l’indique l’article 34 de la Constitution. Or, seul le législateur peut prévoir des exceptions ou des dérogations, le juge ne devant pas empiéter sur le domaine qui est exclusivement réservé au premier. À vrai dire, ces critiques ne devraient plus avoir lieu, car le troisième alinéa du nouvel article 9-1 C. pr. pén. vise à donner « un fondement législatif » à la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique des infractions occultes ou dissimulées au « jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ». Le dispositif actuel se trouve complété par deux autres alinéas insérés dans le nouvel article 9-1 C. pr. pén., qui ont pour objectif de préciser ce qu’il faut entendre par infraction « occulte » et « dissimulée ». S’agissant, en particulier, de cette dernière notion, elle couvre l’hypothèse où « l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte » de ladite infraction. Si, jusqu’à présent, la jurisprudence 246 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal 335 336 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 appliquait essentiellement le critère de dissimulation aux infractions relevant de la délinquance économique et financière, la définition retenue par le législateur lui permettra désormais d’en faire usage pour toute infraction (V. avis du CE, no 390335 du 1er oct. 2015, p. 6). Quant à l’infraction occulte, elle est définie comme celle « qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire ». Si l’on s’appuie sur les travaux préparatoires de la loi du 27 février 2017 (Rapport, Ass. nat., no 3540, par M. A. Tourret, p. 92), il est permis de penser que relèvent de cette catégorie non seulement les infractions dont la définition légale requiert que la clandestinité soit un de leurs éléments constitutifs (par ex., la simulation ou dissimulation d’enfant, la mise en mémoire informatisée de données à caractère personnel, l’atteinte à la vie privée) mais aussi toutes celles qui peuvent être matérialisées par des actes commis de manière occulte, comme c’est le cas du détournement constitutif d’abus de confiance. En outre, la loi du 27 février 2017 a abrogé le dernier alinéa de l’article 8 C. pr. pén. (introduit par la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure), qui prévoyait le report du point de départ du délai de prescription au jour de la révélation des faits, dès lors qu’il s’agissait de certains délits (par ex., abus de faiblesse, vols aggravés, abus de confiance, escroquerie), commis à l’encontre d’une personne « vulnérable ». À l’appui d’une telle suppression, plusieurs arguments ont été avancés, tels que « [le] manque de précision et d’objectivité dans la définition des motifs de vulnérabilité, [l’]insécurité juridique générée par l’indétermination du jour auquel le point de départ du délai de prescription est reporté, [l’]incohérence de la liste des infractions soumises au régime dérogatoire… » (Rapport d’information sur la prescription en matière pénale, Ass. nat. no 2778, 20 mai 2015, p. 109). Institution d’un délai butoir. Afin de faire obstacle à ce que les infractions « occultes » ou « dissimulées » puissent être poursuivies longtemps après leur commission et d’éviter « tout risque d’imprescriptibilité de fait » (Rapport, Ass. nat., no 4309, par M. A. Tourret, p. 27), l’article 9-1, al. 3, in fine C. pr. pén. prévoit que, dans les hypothèses visées, le délai de prescription ne pourra « excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ». Cela signifie donc que les poursuites ne pourront valablement être engagées à l’expiration d’un délai de douze ans pour les délits et de trente ans pour les crimes, à partir du jour de leur commission. Toutefois, le délai butoir pourra être interrompu et suspendu dans les mêmes conditions que le délai de prescription. Il en résulte donc que si un délit occulte ou dissimulé est découvert huit ans après sa commission, tout acte interruptif de prescription pourra faire courir un nouveau délai de prescription, si bien que le législateur est loin d’avoir consacré par ce texte le principe d’une prescription absolue. 35 Interruption de la prescription. À l’exemple de son prédécesseur, le Code de procédure pénale avait expressément consacré l’interruption de la prescription dans son article 7, qui reconnaissait comme causes interruptives les actes d’instruction et de poursuite. La jurisprudence a entendu, dans un but répressif, largement ces termes. Ainsi, en dehors des actes du procureur, tel un réquisitoire introductif, et la citation émanant de la victime, elle a fait entrer, dans la catégorie d’actes de poursuite, les actes judiciaires, comme le jugement, et la mise en œuvre des voies de recours. En bref, tous actes, qui tendaient à 36 247 337 > 337 Le procès pénal, étude de la procédure pénale 337 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 mettre en œuvre ou à entretenir l’exercice de l’action publique, étaient considérés comme des actes de poursuite. La Haute juridiction a aussi jugé que le soit transmis, adressé par le procureur à une autorité administrative, afin de l’interroger sur le sort de personnes disparues de façon suspecte, était un acte interruptif de la prescription (Crim. 20 févr. 2002, Bull. crim. no 42; v. aussi : Crim. 28 juin 2005, Bull. crim. no 194). Quant aux actes des enquêtes de police, les juridictions répressives n’ont pas hésité, dans le silence de la loi, à les assimiler aux actes de poursuite ou d’instruction en ce qui concerne les effets interruptifs de la prescription (Crim. 15 mai 1973, Bull. crim. no 222; Crim. 23 juin 1998, Bull. crim. no 203). Mais, en dehors de ces « constructions jurisprudentielles », le législateur a reconnu, pour sa part, un effet interruptif à certains actes, tels que ceux tendant à la mise en œuvre et à l’exécution de la composition pénale (art. 41-2, al. 8, C. pr. pén.) ou de la transaction pour certaines contraventions (art. 44-1, al. 3, C. pr. pén.; v. aussi : art. 41-1-1, III, al. 1er). Liste limitative des actes interruptifs. Contrairement au droit antérieur, le nouvel article 9-2 C. pr. pén. détermine désormais limitativement les actes susceptibles d’interrompre le délai de prescription. Parmi ceux-ci figurent : les actes, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévus par toute une série de textes; les actes d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal établi par un officier de police judiciaire ou par un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche ou à la poursuite des auteurs d’une infraction (Crim. 5 avr. 2018, no 17-83.166 [la prescription n’est pas interrompue par le compte rendu effectué par le service enquêteur au procureur de la République, ni par la transmission de la procédure d’enquête à celui-ci, quand bien même il les aurait sollicités]); les actes d’instruction visés aux articles 79 à 230 C. pr. pén., accomplis par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire délégués par eux, ayant également pour objectif la recherche et la poursuite des auteurs d’une infraction; les jugements ou arrêts, même non définitifs, s’ils ne sont pas entachés de nullité. À vrai dire, si la présence d’une liste limitative pourrait satisfaire à l’objectif de sécurité juridique, il est toutefois permis de se demander si le nouveau texte ne mettrait pas en cause la conception large de la notion d’acte d’instruction interruptif de la prescription, telle qu’adoptée par la jurisprudence. Pourrait-on désormais considérer que les ordonnances de non-lieu (Crim. 25 févr. 1998, Bull. crim. no 76; Crim. 28 juin 2000, Bull. crim. no 255) ou de restitution d’objets saisis (Crim. 10 févr. 2004, Bull. crim. no 36), qui ne tendent pas à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction, produisent un effet interruptif de prescription ? La jurisprudence sera certainement amenée à statuer sur de telles questions et elle ne devrait pas reprendre les solutions admises antérieurement à la loi du 27 février 2017, en marge de celle-ci. Quoi qu’il en soit, les simples plaintes ne produisent aucun effet interruptif. Les effets des actes interruptifs. L’interruption de la prescription efface le temps déjà écoulé avant sa survenance et fait courir un nouveau délai, dont la durée est la même que celle du délai initial interrompu. À notre avis, vu la longueur des délais actuels de prescription, il aurait été préférable d’opter, à l’exemple d’autres pays européens (Allemagne, Suisse), pour un système de prescription absolue, instituant un délai butoir (qui aurait pu, par exemple, être le double 37 248 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal 338 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 du délai de prescription à partir de la date des faits), au-delà duquel les actes interruptifs (ou suspensifs) n’auraient pu produire aucun effet sur la prescription de l’action publique (sauf pour certains crimes graves). Il est regrettable que le législateur ait écarté une telle possibilité, en se montrant hostile à l’instauration d’un tel « délai butoir » au terme duquel l’action publique devrait, en toute hypothèse, être éteinte. L’adoption d’un tel dispositif contribuerait à garantir le droit de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la CEDH. Ces réserves formulées, le dernier alinéa du nouvel article 9-2 C. pr. pén. précise que les actes interruptifs de prescription produisent des effets à l’égard des auteurs ou complices non visés par ces actes, ainsi qu’à l’égard des infractions connexes. Ce texte consacre donc expressément une jurisprudence constante et, surtout, le critère de « connexité » visé par de nombreuses décisions (v. par ex., Crim. 19 sept. 2006, Bull. crim. no 228; Crim. 14 nov. 2013, RSC 2014, p. 559, obs. H. Matsopoulou). On rappellera qu’en se servant du lien de connexité unissant plusieurs infractions, la chambre criminelle estime que les actes interruptifs de prescription concernant les unes produisent nécessairement le même effet à l’égard des autres. Suspension de la prescription. À la différence de l’effet interruptif, la suspension arrête le cours de la prescription, si bien que le temps déjà écoulé avant sa survenance entre en ligne de compte pour le calcul du délai. Le législateur a prévu certaines causes de suspension, par exemple, dans les cas où : une décision judiciaire, prenant appui sur de faux documents, a déclaré éteinte l’action publique (art. 6, al. 2, C. pr. pén.); une autorité administrative, telle que l’Autorité de la concurrence (art. L. 462-3 C. com.), est saisie pour consultation par le juge pénal; une mesure alternative aux poursuites est mise en œuvre (art. 41-1, al. 2, C. pr. pén.); certaines personnes bénéficient d’une protection particulière en raison de l’exercice d’un mandat, tel le président de la République (art. 67, al. 2, Const.)… etc. Mais, en dehors de ces hypothèses, la jurisprudence a admis que le cours de la prescription soit arrêté au profit de celui qui ne peut valablement agir (Cass., ass. plén., 23 déc. 1999, Bull. no 139). Aussi bien, à côté des causes légales de suspension, a-t-elle décidé que la prescription peut être suspendue lorsqu’il y a un obstacle de droit ou un obstacle de fait à l’exercice de l’action publique. En particulier, ont été considérés comme des obstacles de droit l’examen d’une question préjudicielle (Crim. 28 mars 2000, Bull. crim. no 139) ou la demande d’autorisation d’exercer une action appartenant à une collectivité territoriale (Crim. 3 déc. 2003, Bull. crim. no 233). Quant aux obstacles de fait, les juges répressifs y ont fait entrer certains événements présentant les caractéristiques de la force majeure ou d’une circonstance insurmontable, telle qu’une occupation militaire, une catastrophe naturelle ou la démence du délinquant survenue après la commission d’une infraction. Par un arrêt important du 7 novembre 2014 (Cass., ass. plén., 7 nov. 2014, Bull. no 1, A. Lepage, JCP G, 2015, étude no 69; v. aussi : Crim. 20 juill. 2011, no 11-83.086; Crim. 13 déc. 2017, no 17-83.330), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré, à propos de faits d’infanticide, que la prescription pouvait être « suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». À vrai dire, la solution adoptée en l’espèce suscite des réserves, car il n’est nullement raisonnable d’admettre un effet suspensif tant que le délai de prescription n’a pas encore commencé à courir. 38 249 339 > 341 Le procès pénal, étude de la procédure pénale 339 340 L’application de la loi du 27 février 2017 dans le temps. Les lois relatives à la prescription de l’action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises (art. 112-2, 4°, C. pén.; v. supra no 123). Et il en est ainsi même dans l’hypothèse où les nouvelles dispositions auraient pour résultat d’aggraver la situation des intéressés. Il en résulte donc que le nouveau texte, qui allonge considérablement les délais de prescription, sera applicable à des infractions commises avant son entrée en vigueur dès lors qu’elles ne sont pas encore prescrites. L’article 4 de la loi du 27 février 2017 indique toutefois que celle-ci « ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ». L’introduction de cette disposition transitoire a été rendue nécessaire afin d’empêcher que l’application des nouvelles règles relatives au « délai butoir », qui régissent les infractions occultes et dissimulées, conduise à la prescription de ces infractions dans les hypothèses où les poursuites auraient été engagées plus de douze ou de trente ans après les faits. Le nouveau texte ne pourra donc régir que les infractions occultes ou dissimulées découvertes après son entrée en vigueur. Si la démarche législative est compréhensible, il est toutefois difficilement concevable qu’une loi valide formellement une jurisprudence, qui s’est développée pendant de nombreuses années, en marge des dispositions légales claires et précises quant au point de départ du délai de prescription de l’action publique. N’y aurait-il pas ici une méconnaissance de l’article 34 de la Constitution, selon lequel la procédure pénale relève de la matière législative ? 39 Appréciation du nouveau dispositif. Si la présente réforme tend à assurer une sécurité juridique, le nouveau texte laisse toutefois une large marge d’appréciation aux juges répressifs. C’est qu’en effet, ces derniers seront amenés à fixer la liste des infractions occultes ou dissimulées, à déterminer les actes d’enquête ou d’instruction interruptifs de la prescription, compte tenu des finalités requises par la loi, et à définir les obstacles de fait entraînant la suspension du délai de prescription. Sans aucun doute, la jurisprudence continuera encore à jouer un rôle créateur en la matière. 340 2° Décès du délinquant 341 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889390413:88866209:196.200.176.177:1592999297 Tenant compte des critères jurisprudentiels, le législateur a inscrit, dans le nouvel article 9-3 C. pr. pén., les causes générales de suspension du délai de prescription. En particulier, ce texte dispose que « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription ». Certes, ces causes pourront recevoir application sans préjudice de celles visées par certaines dispositions du Code de procédure pénale ou d’autres textes particuliers. Le décès du délinquant éteint l’action publique, qu’il survienne avant le déclenchement des poursuites ou après celui-ci, avant la décision définitive. Il en est de même en cas de 341 250 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal 3° Amnistie international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 dissolution d’une personne morale, avec transmission du patrimoine (Crim. 17 févr. 2014, no 12-85.807, comp. CJUE 5 mars 2015, Rev. sociétés. 2015. 677, note B. Lecourt). De toute façon, en cas de fusion-absorption intervenue avant le jugement définitif, l’action publique est éteinte à l’encontre de la société absorbée, auteur de l’infraction tandis qu’elle ne peut être exercée contre la société absorbante. En revanche, l’action civile peut être poursuivie contre les héritiers du de cujus, ou contre la société absorbante. Selon l’article 133-9 du Code pénal : « L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure ». L’amnistie est une institution par laquelle le pouvoir législatif fait disparaître rétroactivement le caractère délictueux d’une infraction. Primitivement, l’amnistie était réservée aux infractions politiques et était destinée à refaire l’unité de la nation après des périodes troublées. Mais l’amnistie peut jouer aussi en faveur des infractions de droit commun, ce qui n’est du reste pas sans apporter des troubles dans l’Administration de la justice. Un délinquant qui est criminologiquement un récidiviste aura devant ses juges l’apparence d’un délinquant primaire puisque son casier judiciaire sera vierge. Depuis 2002, aucune loi d’amnistie n’est intervenue. 342 342 – Il ne faut pas croire que du fait de l’amnistie les faits commis sont censés n’avoir pas eu lieu, ils sont simplement censés n’avoir pas eu de caractère délictueux. Si l’amnistie fait disparaître les interdictions, déchéances ou incapacités qui résultent de plein droit de la condamnation, en revanche les faits subsistent sur le plan disciplinaire, et l’Administration peut en arguer « au regard du bon fonctionnement du service public » (réponse question écrite secret. État chargé fonct. publ. à M. BourgBroc, JO déb. Ass. nat. 20 juin 1983). L’amnistie a un effet non seulement sur les poursuites mais également sur les peines qui avaient été prononcées à la suite de celles-ci (V. infra, no 1344). Seul le législateur peut décider une amnistie (art. 34, al. 5, de la Constitution du 4 oct. 1958); c’est lui qui avait incriminé les faits; c’est donc lui qui doit décider cette sorte d’abrogation rétroactive temporaire et partielle. L’amnistie éteint immédiatement l’action publique (art. 6 C. pr. pén.) pour tous les faits visés par la loi d’amnistie et antérieurs à la date fixée par elle (par ex. : le 22 mai 1981 pour la loi du 4 août 1981, le 18 mai 1995 pour la loi du 3 août 1995, le 17 mai 2002 pour la loi du 6 août 2002). 343 343 – Autrefois l’amnistie était accordée en considération des infractions commises, mais elle a perdu à l’époque contemporaine ce caractère « réel » et certaines amnisties ont un caractère personnel; ce ne sont pas tous les auteurs de telle infraction qui sont amnistiés mais seulement ceux qui sont anciens combattants, ou décorés, ou parents de déportés, etc. Dans ces conditions, l’application immédiate de l’amnistie n’est plus possible car les poursuites continuent jusqu’à ce que l’on ait identifié l’auteur de l’infraction découverte. 344 – De même certaines amnisties ne sont accordées que si la peine infligée pour l’infraction ne dépasse pas une certaine durée (L. du 4 août 1981, art. 6, peine n’excédant pas 6 mois de prison ferme ou avec sursis probatoire, ou 15 mois avec sursis simple; L. du 3 août 1995, peine n’excédant pas 3 mois 34 251 345 > 346 Le procès pénal, étude de la procédure pénale – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 de prison sans sursis ou 9 mois dans certains cas d’application du sursis simple, de sursis probatoire ou de sursis avec application d’un travail d’intérêt général; L. du 6 août 2002, art. 6, peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 mois sans sursis, ou 6 mois assortie du sursis simple); dans ces conditions, si l’infraction n’a pas encore été jugée il faut que les poursuites continuent jusqu’à ce que la juridiction répressive ait prononcé une peine; en la prononçant, le tribunal constatera l’amnistie si cette peine ne dépasse pas la durée prévue. Le pouvoir judiciaire reçoit ainsi du législateur une sorte de délégation du pouvoir amnistiant, qui aboutit à une individualisation très poussée des effets de celui-ci. Il arrive même (L. du 3 août 1995, art. 17, al. 3; L. 6 août 2002, art. 5, al. 2) que le législateur subordonne l’amnistie au paiement des amendes qui ont pu sanctionner l’infraction, en sorte que l’extinction de l’action publique se trouve encore retardée davantage, il faut attendre non seulement le jugement mais encore l’exécution des dispositions portant condamnation pécuniaire. – La loi du 6 août 2002 combine tous ces critères. Certaines infractions sont amnistiées à raison de leur nature (art. 1 à 4 : délits de presse, délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural ou de droit du travail, etc.); d’autres à raison de la nature, du quantum et des modalités de la peine appliquée (art. 5 à 8, v. supra); d’autres peuvent l’être par mesure individuelle du président de la République (grâce amnistiante, art. 10). L’article 11 dispose que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles; sont toutefois exceptés de l’amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur. En 2007 et en 2012, aucune loi d’amnistie n’a été votée. 345 – Parmi les lois d’amnistie à caractère moins général, on mentionnera la loi du 9 novembre 1988, modifiée le 10 janvier 1990, portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie; la loi du 10 juillet 1989 (concernant les événements survenus dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique); la loi du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques; la loi du 19 décembre 1991 relative à l’amnistie de certaines infractions concernant le trafic de stupéfiants imputées à certains OPJ ou APJ et aux agents des douanes ayant agi aux seules fins de constater et de rechercher les infractions à la législation sur les stupéfiants. – Les lois d’amnistie de caractère général prévoient de plus en plus l’exclusion du bénéfice de l’amnistie d’infractions de plus en plus nombreuses, alors qu’autrefois ce bénéfice s’attachait au contraire aux infractions que la loi énumérait en s’attachant à leur nature; la loi du 6 août 2002 prévoit ainsi, dans son article 14, quarante-neuf cas d’exclusion extrêmement variés (la loi du 20 juillet 1988 ne prévoyait que 17 cas et celle du 3 avril 1995, 28). Dans ces conditions, l’application des lois d’amnistie est devenue de plus en plus complexe. Il y a longtemps qu’elles contiennent des dispositions sur le contentieux qu’elles font naître (v. L. 6 août 2002, art. 9), mais les difficultés se multiplient (V. par exemple : G. Lorho, « Deux ou trois choses que je sais de la loi du 3 août 1995 portant amnistie », Dr. pénal, mars 1996, p. 1). 345 346 L’effet extinctif de l’amnistie est d’ordre public; le tribunal doit l’appliquer d’office et l’intéressé, s’il n’a pas encore été jugé, ne peut refuser le bénéfice de l’amnistie ni demander à prouver son innocence (par contre si la condamnation avait déjà été prononcée la loi lui laisse toujours le droit d’agir en révision). En outre, les lois d’amnistie interdisent formellement de faire état des condamnations, sanctions disciplinaires ou déchéances effacées par l’amnistie. En les rappelant sous quelque forme que ce soit, un fonctionnaire ou un magistrat encourt des sanctions disciplinaires (les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction). La loi du 4 août 1981 prévoit même des sanctions pénales (art. 25, amende de 500 à 15 000 F). Le nouveau Code pénal a fait de cette disposition particulière, habituelle aux 346 252 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal lois d’amnistie, une règle générale (art. 133-11). La loi du 6 août 2002 prévoit une amende de 5 000 € (art. 15). L’amnistie éteint l’action publique mais non l’action civile : « L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers » (art. 133-10 C. pén.). Le fait dommageable reste une faute, quoiqu’il soit réputé n’avoir jamais constitué une infraction; l’action civile reste possible (pendant 5 ans) mais ne peut être portée que devant les tribunaux civils (à moins que le juge répressif n’ait déjà été saisi de l’action civile; L. du 4 août 1981, art. 23; L. du 3 août 1995, art. 21; L. du 6 août 2002, art. 21). L’action civile peut cependant être éteinte exceptionnellement dans un intérêt national; c’est alors à l’État qu’il appartient d’indemniser la victime (L. du 5 janv. 1951, art. 33, pour les infractions commises par la Résistance). 4° Abrogation de la loi pénale international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – L’abrogation de la loi pénale produit sensiblement les mêmes effets que l’amnistie. Cette dernière est une sorte d’abrogation partielle, ne visant que le passé. Au contraire l’abrogation a un caractère définitif : le fait n’est plus une infraction; il n’est plus incriminé pour l’avenir. Il ne l’est plus également pour le passé en vertu de l’effet immédiat des lois pénales plus douces, de sorte que les poursuites ne sont plus possibles. 347 347 5° Transaction La transaction n’est pas possible, en principe, car l’action publique est d’ordre public. Dans certaines matières cependant (infractions fiscales, infractions douanières, infractions du titre IV du livre IV C. com. n’exposant pas à un emprisonnement, art. L. 470-1 C. com.; certaines contraventions visées à l’art. L. 2212-5 CGCT, art. 44-1 C. pr. pén.) la loi dispose qu’une transaction peut mettre fin aux poursuites, mais c’est qu’ici la répression est fortement mélangée à la réparation du préjudice pécuniaire causé à l’État. L’article 6, alinéa 3 du Code de procédure pénale, a rappelé cette possibilité exceptionnelle. On peut en rapprocher la procédure de composition pénale (V. infra, no 760), ou de jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité. 348 348 – La loi du 30 décembre 1985 (art. 529-3 C. pr. pén.) dispose que pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, constatées par les agents assermentés de l’exploitant, l’action publique peut être éteinte par une « transaction entre l’exploitant et le contrevenant » (V. art. 529-4 et s. C. pr. pén.), (V. infra, nos 923 et s.). – On peut rapprocher de cette hypothèse le cas prévu par l’art. R. 131-16 C. mon. fin., selon lequel le tireur d’un chèque sans provision qui, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi par le tiré d’une lettre d’injonction, « régularise » en constituant la provision suffisante et disponible, échappe – sous certaines réserves – aux sanctions bancaires prévues par la loi (remise des chéquiers, interdiction pendant un an d’émettre aucun chèque si ce n’est un chèque de retrait ou certifié). – La loi du 2 août 2005 autorise une transaction pour les délits du titre IV Livre IV du Code de commerce non punis d’emprisonnement, et la loi du 13 décembre 2011 la permet pour les infractions du Livre II du même code. – Une ordonnance du 11 janvier 2012 a permis une transaction en matière d’environnement (art. L. 173-12 C. envir.). La proposition de transaction est établie par le préfet du département (ou le préfet maritime). La proposition est adressée à l’intéressé qui doit en retourner un exemplaire dans le délai d’un mois. Une fois acceptée, le dossier est transmis au procureur de la République pour homologation (art. R. 173-1 C. envir., décr. 2014-368 du 24 mars 2014). 253 349 > 349 349 La loi du 15 août 2014 a permis la mise en œuvre de transactions par un officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République (art. 41-1-1 C. pr. pén.). La transaction est possible pour les contraventions du Code pénal (à l’exception de celles donnant lieu à une amende forfaitaire), les délits du Code pénal punis d’une amende ou d’un an d’emprisonnement (sauf celui de l’art. 433-5, al. 2 C. pén.), les petits vols, le délit de l’art. 3421-1 CSP et le délit de l’art. L. 126-3 CCH. L’OPJ peut soumettre l’auteur à une obligation de consigner une somme d’argent. L’amende transactionnelle ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue. La proposition acceptée par le délinquant est homologuée par le président du tribunal. L’homologation interrompt la prescription de l’action publique. Cette voie de transaction sera abrogée par le projet de loi Justice 2018 (art. 39). international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – Le procès pénal, étude de la procédure pénale L’amende forfaitaire en matière de délits. Une loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 a prévu que l’action publique était éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle. Cette cause d’extinction de l’action publique doit avoir été prévue par la loi, mais l’amende forfaitaire ne concerne pas les mineurs, les personnes en récidive légale, ou la pluralité d’infractions, si l’une d’entre elles ne peut bénéficier de l’amende (art. 495-17 C. pr. pén.). L’amende doit être acquittée dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction. Elle est minorée si elle donne lieu à paiement entre les mains de l’agent verbalisateur ou dans un délai de 15 jours. Au-delà de 45 jours, l’amende est majorée et donne lieu à recouvrement par un titre exécutoire rendu par le ministère public (art. 495-18 C. pr. pén). Une requête en exonération peut être présentée dans les 45 jours au service indiqué dans l’avis d’infraction, qui la transmettra au procureur de la République. La requête n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée et accompagnée d’un document établissant une consignation d’une somme correspondant au montant de l’amende forfaitaire. Le procureur peut renoncer à l’exercice de poursuites, soit procéder conformément aux art. 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495-8 à 495-5, 495-7 à 495-16. En cas de condamnation, l’amende ne peut pas être inférieure à l’amende forfaitaire (normale ou majorée). Le paiement de l’amende ou l’émission du titre exécutoire sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive. La personne condamnée à l’amende forfaitaire majorée peut, en cas de difficultés financières, solliciter du comptable public des délais de paiement ou une remise gracieuse partielle ou totale. L’article D. 45-3 du Code de procédure pénale indique que l’amende forfaitaire concerne la conduite sans permis et la conduite sans assurance des art. L. 221-2 et L. 324-2 du Code de la route. Le projet de loi Justice 2018 propose d’étendre les amendes forfaitaires au délit de vente illicite de boissons alcoolisées aux mineurs (art. L. 3353-2 CSP), à l’usage illicite de stupéfiants (art. L. 3421-1 CSP) et à la conduite de certains véhicules (art. L. 3315-5 C. transp.). L’amende forfaitaire est de 300 € pour ces délits du Code de la santé publique, et de 800 € en matière de transports routiers. Les amendes majorées sont fixées au double de l’amende. Le même projet complète les mentions portées sur le casier judiciaire; les fiches étant retirées 3 ans après le paiement de l’amende (art. 768, 768-1 et 769 C. pr. pén.). L’amende forfaitaire prévue par le Code de la route (art. L. 121-5) ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mesures administratives de rétention ou de suspension du permis de conduire, ou d’immobilisation ou de mise en fourrière du véhicule. 349 254 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal 6° Retrait de plainte Le retrait de plainte de la victime n’est pas une cause d’extinction de l’action publique; il est juridiquement indifférent. Toutefois, ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article 6 du Code de procédure pénale, l’action publique peut s’éteindre en cas de retrait de plainte « lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite » (exemples : abandon de foyer, atteintes à la personnalité, ou à l’intimité de la vie privée, chasse sur le terrain d’autrui). Il s’agit là de cas exceptionnels. 350 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 350 B. Causes d’extinction propres à l’action civile 1° Prescription de l’action civile Lorsqu’elle n’a pas été portée devant le juge pénal avant l’expiration du délai de prescription de l’action publique, l’action civile se prescrit selon les règles du Code civil comme en dispose l’article 10 du Code de procédure pénale. Il y a donc lieu d’appliquer à cette prescription le délai de droit commun de 5 ans (art. 2224 C. civ.), sauf dans le cas où la créance mise en recouvrement serait soumise à l’une des courtes prescriptions prévues par le droit civil. En cas de dommages corporels, la prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé et en cas de préjudices causés par des tortures, actes de barbarie ou agressions sexuelles contre des mineurs, la prescription est portée à 20 ans (art. 2226-1, al. 2, C. civ.). 351 351 – La loi du 2 février 1981 a modifié l’article 10 du Code de procédure pénale pour ajouter une disposition (actuellement al. 2) aux termes de laquelle « lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile », ce texte vise le cas où l’action civile a été portée devant le juge répressif en même temps que l’action publique; la juridiction répressive a donné une solution à celle-ci en condamnant la personne poursuivie, mais elle a, par exemple, ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice subi par la victime; cette mesure est soumise aux dispositions du Code de procédure civile. Le délai de prescription de l’action civile obéit aux règles de computation prévues par le droit civil, ainsi qu’aux règles relatives à l’interruption ou à la suspension de la prescription. Cette solution était déjà admise par la jurisprudence avant les modifications de l’article 10 du Code de procédure pénale. 352 352 353 – 35 On pouvait se demander si l’action civile en réparation du préjudice subi en cas de diffamation se prescrit par le délai ordinaire du droit civil ou par le délai de 3 mois qui est celui prévu pour la prescription de l’action publique concernant ce délit (L. du 29 juill. 1881). Cette dernière solution a été consacrée; en effet l’article 65 de la loi précitée sur la presse, prévoit expressément que ce délai de 3 mois concerne aussi bien l’action civile que l’action publique. 2° Autres causes d’extinction de l’action civile 354 Toutes les causes d’extinction des obligations en droit civil peuvent s’appliquer à l’action civile, sans avoir pour autant d’incidence sur l’action publique. Il en est ainsi, par exemple, du paiement effectué par le débiteur, de la transaction intervenue entre celui-ci et le créancier, et de la renonciation totale ou partielle du créancier à sa créance. 354 255 355 > 357 Le procès pénal, étude de la procédure pénale section 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 Les parties au procès pénal Il y a toujours au minimum deux parties dans le procès pénal : le ministère public demandeur à l’action publique au nom de la société, et la personne poursuivie, défenderesse à cette action. Mais il est possible que d’autres parties soient en cause, notamment si l’action civile est jointe à l’action publique; ce sont la victime partie civile et les personnes civilement responsables de la personne poursuivie. 355 35 – Depuis la loi du 11 juillet 1975, on peut même voir figurer parmi les parties au procès pénal le tiers qui est menacé de supporter personnellement le fardeau de la confiscation du fonds de commerce ou de la fermeture d’établissement prononcée contre le coupable (ainsi le propriétaire de l’immeuble ou le bailleur du propriétaire du fonds d’un établissement dans lequel ont été constatés des faits de proxénétisme hôtelier : v. art. 706-37 C. pr. pén.). Enfin, depuis la loi du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions, les assureurs appelés à garantir les dommages en matière d’homicide ou de blessures involontaires peuvent être mis en cause devant la juridiction pénale et sont admis à intervenir devant celle-ci. § 1 La personne pénalement poursuivie 356 La personne poursuivie porte un nom variable selon le stade de la procédure où l’on se trouve. Devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel (de même devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants) il s’agit du prévenu (comme auteur ou comme complice); devant la cour d’assises il s’agit de l’accusé (à partir du moment où l’intéressé a été renvoyé devant la cour d’assises). Au cours de l’instruction préparatoire devant le juge d’instruction, la personne à qui une mesure de « mise en examen » a été notifiée est dite « mise en examen » (anciennement « inculpée »). 357 Sous l’empire de l’ancien Code pénal, les personnes poursuivies comme auteur(s), coauteur(s) ou complice(s) d’une infraction ne pouvaient être que des personnes physiques, et nul ne pouvait être pénalement puni qu’à raison de son propre fait. Depuis le Code pénal de 1994 (modifié par la loi du 9 mars 2004), les personnes morales sont également responsables pénalement (à l’exclusion de l’État, et des collectivités territoriales, dans certains cas). 356 357 – On rappellera que parfois la loi rend l’employeur pénalement responsable de fautes constitutives d’infractions matériellement commises par son préposé (en matière d’infractions à la réglementation du travail, de fraudes alimentaires, d’interdiction d’entrée des mineurs dans la salle de spectacles où certains films sont projetés, etc.). – Cette situation est à distinguer de celle où l’employeur peut être tenu au paiement des amendes prononcées à l’encontre de son employé. Ainsi, selon l’article L. 121-1 du Code de la route, lorsque le conducteur d’un véhicule a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, « compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le payement des amendes de police prononcées en vertu du présent code ainsi que les frais de justice […] seront en totalité ou 256 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal en partie à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience » (le préposé qui conduit un véhicule de son employeur muni de pneus lisses n’est pas responsable pénalement de cet état de fait). Une importante jurisprudence relative aux homicides et blessures involontaires, tels ceux prenant place dans le cadre des accidents du travail, ou provoqués par l’effondrement ou l’incendie d’un bâtiment (un stade, un magasin, une salle de spectacles) était également invoquée pour soutenir la thèse de l’existence d’une responsabilité pénale du fait d’autrui. Il était aisé de démontrer qu’en l’occurrence nos tribunaux ne s’arrêtaient pas à l’auteur « immédiat et apparent » de l’accident, mais recherchaient et sanctionnaient le ou les auteurs de fautes plus ou moins lointaines – telles celles de l’architecte – étant à l’origine, peu ou prou, de l’événement. Ainsi l’employeur ayant confié à son préposé un matériel en mauvais état pour exécuter une tâche périlleuse est responsable pénalement des atteintes involontaires à l’intégrité des personnes qui découlent de l’usage de ce matériel par son salarié (l’éventuelle faute de celui-ci n’excluant pas la faute de son « patron »). Depuis la loi du 10 juillet 2000, les fautes lointaines qui auraient créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ne peuvent être retenues contre les personnes physiques que si celles-ci ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. 359 « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », dispose l’article 121-1 du nouveau Code pénal. Ce texte condamne toute recherche de la responsabilité pénale collective (on sait les critiques adressées à la loi dite anti-casseurs, du 8 juin 1970, abrogée par la loi du 23 décembre 1981). Actuellement, les personnes morales peuvent être responsables pénalement, en cas d’infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. En pareil cas, c’est la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites qui s’exprimera, au nom de la personne morale (art. 706-43 C. pr. pén.). En cas de changement de représentant légal, c’est la nouvelle personne physique qui devra se faire connaître au juge. La société peut désigner un mandataire spécifique, titulaire d’une délégation de pouvoirs. Dans l’hypothèse de la défaillance des organes de la personne morale, un représentant pourra être désigné par le président du tribunal de grande instance. Cette personne physique étant dans la procédure, ès qualités, ne pourra pas faire l’objet de contraintes (telles que la détention provisoire ou le contrôle judiciaire). Si le représentant légal est en même temps poursuivi, à propos des mêmes faits, il peut saisir le président du tribunal de grande instance, en vue de la désignation d’un mandataire de justice représentant la personne morale. 360 En cas de pluralité de personnes ayant commis des fautes de nature différente, toutes peuvent être poursuivies du chef d’homicide involontaire; l’une pour avoir, la première, projeté une personne avec son véhicule au milieu de la chaussée, la seconde écrasé alors le corps, le tout entraînant la mort de la victime. Dans cette hypothèse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a jugé que les prévenus, « en participant ensemble à une action dangereuse et créant par leur imprudence un risque grave […] même s’il n’a pas été possible de déterminer l’incidence directe sur la victime des actes accomplis par chacun d’eux », ont commis, l’un et l’autre, la faute réprimée par l’article 221-6 du Code pénal (Crim. 23 juill. 1986, JCP 1987. II. 20897, note Borricand. – V. obs. Levasseur, RSC 1987, p. 199). 361 À défaut d’appréhension ou d’identification de l’auteur d’une infraction, des poursuites peuvent être engagées en ouvrant une information contre X (ce qui interrompra la prescrip- 358 359 360 361 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 358 – 257 362 > 364 Le procès pénal, étude de la procédure pénale 362 Il est possible que la personne poursuivie ne se présente pas matériellement devant ses juges; si elle est autorisée à se faire représenter (V. infra, no 951), elle sera néanmoins jugée contradictoirement; dans le cas contraire (et à moins que son absence implique son mépris de la justice, v. ibid.), elle ne sera jugée que par défaut, c’est-à-dire qu’elle disposera d’une voie de recours spéciale, l’opposition, permettant de revenir sur la décision rendue en son absence (V. infra, no 986). Si l’infraction est un crime, la procédure en pareil cas est comparable (V. infra, no 953). 362 § 363 2 Le ministère public C’est le ministère public qui est demandeur à l’action publique (exceptionnellement, dans certaines matières spéciales, le soin de déclencher l’action publique, et même parfois de la soutenir, peut être confié aux fonctionnaires de certaines Administrations : art. 1er C. pr. pén.). 36 A. Rôle du ministère public 364 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 tion), mais on ne pourra continuer la procédure jusqu’au jugement, car le tribunal ne peut convoquer et condamner que des personnes déterminées. Si, au contraire, l’auteur a été appréhendé mais n’a pu être identifié, il peut être condamné même s’il déguise son identité; on peut le condamner comme « s’étant dit Dupont » ou « supposé Durand »; (cf. T. corr. Chambéry 21 déc. 1973, JCP 1974. II. 17678, note Lécrivain). Selon l’un des principes fondamentaux de notre droit pénal, seule la responsabilité personnelle de l’individu poursuivi est de nature à entraîner une sanction pénale (Crim. 16 déc. 1948, Bull. crim. no 291; 21 déc. 1971, Bull. crim. no 366). Cependant, il peut y avoir, dans certains cas, faute personnelle à ne pas avoir surveillé le comportement d’autrui. Il en est ainsi du chef d’entreprise qui ne prend pas toutes les dispositions pour faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers (Crim. 15 févr. 1994, Bull. crim. no 69). Alors qu’en matière civile, le ministère public intervient rarement comme partie principale, en matière pénale c’est toujours à ce titre qu’il est présent dans toutes les affaires répressives. Il fait rechercher et constater les infractions par les services mis à sa disposition à cette fin et qui forment la police judiciaire. Après avoir déclenché l’action publique (à moins que celle-ci n’ait été mise en mouvement par la victime, voir infra, no 756), le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi (art. 31 C. pr. pén.). Il va soutenir les intérêts de la société offensée aussi bien à la phase de l’instruction qu’à la phase du jugement; c’est pourquoi il est représenté, ainsi qu’on le verra, auprès de toutes les juridictions. En tant que partie demanderesse, il prendra des réquisitions, et exercera au besoin des voies de recours contre les décisions judiciaires. 364 258 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal Garde des Sceaux Parquet de la Cour de cassation procureur général avocats généraux Parquet général (Cour d’appel) procureur général avocats et substituts généraux Procureur de la République financier Parquet Tribunal grande instance (en principe niveau départemental) procureur de la République vice-procureur et substituts Parquet près le Tribunal de police (en principe niveau arrondissement) Commissaire de police (ou membre du parquet TGI pour les contraventions de 5e classe) ou maire international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 Tableau no III Organisation du ministère public en matière répressive de droit commun 259 Chambre criminelle Chambre des appels de l’application des peines Chambre des appels correctionnels Chambre de l’instruction Cour d’assises d’appel Cour d’assises Tribunal correctionnel Juge d’instruction Juge de l’application des peines Tribunal de l’application des peines Tribunal de police 365 > 367 Le procès pénal, étude de la procédure pénale international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 Enfin c’est au ministère public qu’il appartiendra de faire exécuter la décision (et notamment la condamnation) lorsque celle-ci sera définitive (art. 707-1 C. pr. pén.). Il intervient donc dans tous les secteurs de l’activité répressive. Toutefois le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations sont faits au nom du procureur par le comptable public compétent ou par l’agent de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. B. Composition du ministère public Le ministère public est un corps de magistrats professionnels recrutés de la même façon que les magistrats du siège; ils peuvent du reste, au cours de leur carrière, être affectés dans un poste du ministère public ou dans un poste du siège car ils ne sont pas spécialisés de façon durable. Dans certains pays, au contraire, les membres du ministère public forment un corps spécial de fonctionnaires doté d’un statut propre. 365 365 – Les magistrats qui font partie du ministère public sont parfois appelés magistrats debout (parce qu’ils se lèvent pour prendre la parole devant le tribunal) alors que les magistrats du siège sont dits « assis ». On les appelle aussi magistrats du parquet. Aujourd’hui ils figurent sur l’estrade, mais à une place distincte de celle des juges. On emploie souvent le mot « parquet » pour désigner l’ensemble des magistrats du ministère public près d’un tribunal ou d’une cour (on parle ainsi du parquet de Paris, du parquet de Versailles, du parquet général de Rouen, etc.). Auprès de chaque tribunal de grande instance, le ministère public est composé d’un ou plusieurs membres chargés de représenter la société auprès de cette juridiction : le procureur de la République, assisté éventuellement d’un ou plusieurs vice-procureurs et de substituts du procureur de la République. 366 36 – Dans les tribunaux très importants, il existe également un ou plusieurs procureurs de la République adjoints outre des premiers substituts. L’ensemble de ces magistrats constitue le parquet du tribunal correctionnel. La loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 a institué auprès du tribunal de grande instance de Paris, un procureur de la République financier dont les attributions sont fixées par le Code de procédure pénale. Il n’exerce ses fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de ses attributions (art. L. 217-3 COJ). Ce magistrat a une compétence nationale. Le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 institue un procureur national antiterroriste (art. 43). Ce procureur voit son statut déterminé d’après celui du procureur national financier (art. L. 217-1 à L. 217-4 COJ). Il peut exercer ses attributions en matière de crimes contre l’humanité, de crimes et de délits de guerre, mais surtout en matière de terrorisme (art. 706-17 et s. C. pr. pén.). 367 Auprès de chaque cour d’appel, la société est représentée par un procureur général, assisté d’un ou plusieurs avocats généraux et de substituts du procureur général (dits parfois substituts généraux). L’ensemble des uns ou des autres forme le parquet général. Auprès de chaque cour d’assises, le ministère public est un membre du parquet général ou du parquet du tribunal de grande instance (V. infra, no 426). 367 260 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal Auprès de la Cour de cassation, il y a un procureur général près de la Cour de cassation assisté de plusieurs premiers avocats généraux et d’un certain nombre d’avocats généraux à la Cour de cassation. Devant le tribunal de police, les fonctions du ministère public peuvent toujours être remplies par un membre du parquet du tribunal correctionnel; il en est même obligatoirement ainsi pour le jugement des contraventions de 5e classe. Pour le jugement des autres contraventions, le soin de représenter le ministère public est normalement confié au commissaire de police de la ville où siège le tribunal (art. 45 et s. C. pr. pén.); s’il y en a plusieurs, le procureur général désigne celui qui exercera ces fonctions. 368 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 368 En cas d’empêchement du commissaire de police, le procureur général « désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu’il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. À titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l’audience, le juge du tribunal d’instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints » (art. 46 C. pr. pén.). S’il n’y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne un commissaire ou un commandant ou un capitaine de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance, ou à défaut, d’un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département (art. 48 C. pr. pén., modif. L. 22 juill. 1996). – Lorsque des infractions forestières doivent être jugées, les fonctions du ministère public sont remplies par un ingénieur des eaux et forêts ou un chef de district ou un agent technique désigné par le conservateur des eaux et forêts (art. 45 in fine C. pr. pén.). 369 370 Devant les juridictions de mineurs, les fonctions du ministère public sont exercées par un membre du parquet du tribunal correctionnel, et devant la cour d’assises par un membre du parquet général désigné par le procureur général (Ord. no 58-1274 du 22 déc. 1958, art. 4 modifié par la L. du 12 juill. 1967 et art. 6), qui les chargera spécialement des affaires concernant les mineurs. 369 Devant les tribunaux permanents des forces armées, supprimés par la loi du 21 juillet 1982 (V. supra, no 70), le ministère public était composé de commissaires du gouvernement, assistés de substituts. Ce sont aujourd’hui – en temps de paix – les juridictions de droit commun qui jugent les infractions militaires. Le procureur de la République près le TGI seul compétent par ressort de cour d’appel, est saisi, en principe, par dénonciation des faits par l’autorité militaire habilitée par le ministre de la Défense. À défaut de cette dénonciation, le parquet doit recueillir l’avis de cette autorité (sauf en cas de crime ou délit flagrant), (V. infra, no 474). 370 C. Caractères du ministère public a) Unité (ou indivisibilité) du ministère public 371 Chaque membre du parquet représente valablement et intégralement le ministère public de son échelon, et les différents membres d’un même parquet peuvent se remplacer les uns les autres pour remplir la tâche du ministère public au cours d’une même 371 261 372 > 373 Le procès pénal, étude de la procédure pénale affaire (au contraire, les magistrats de la juridiction de jugement doivent avoir assisté à toutes les audiences de l’affaire qu’ils jugent). b) Hiérarchie du ministère public Les membres du ministère public sont hiérarchisés à l’intérieur d’un même parquet et doivent se conformer aux ordres de leur chef. Le chef du parquet du tribunal correctionnel est le procureur de la République, le chef du parquet général est le procureur général. 372 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 372 L’ensemble du parquet du tribunal correctionnel, par l’intermédiaire de son chef, est subordonné au procureur général et à ceux qui agissent en son nom. Le procureur général peut donc donner des ordres aux parquets correctionnels fonctionnant dans le ressort de la Cour (art. 36 C. pr. pén.). – Les parquets généraux eux-mêmes sont soumis à l’autorité hiérarchique du ministre de la Justice, garde des Sceaux. – L’article 30 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 25 juillet 2013, dispose que le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement et veille à la cohérence de son application. Il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales, mais ne peut leur adresser aucune instruction pour des affaires individuelles. Le ministre ne peut donc pas donner au procureur général un ordre de classement sans suite, ou de poursuite. – Le procureur de la République peut donner des ordres aux représentants du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. – Les actes accomplis contrairement aux instructions reçues n’en sont pas moins valables; il faut d’ailleurs remarquer que l’obligation d’exécuter des ordres n’empêche pas le magistrat d’agir selon sa conscience; en effet, il n’est tenu de se conformer aux ordres reçus que dans ses réquisitions écrites adressées aux autorités judiciaires, mais « il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice » (art. 33 C. pr. pén.); c’est la consécration du vieil adage : « La plume est serve mais la parole est libre ». – Pour remédier aux critiques suscitées par une possibilité de détournement des pouvoirs du ministre, un projet envisageait de donner au ministre le pouvoir d’exercer l’action publique dans certaines matières. Ce projet a été abandonné. L’article 30 du Code de procédure pénale (réd. loi du 25 juillet 2013) précise que le ministre adresse des instructions générales d’action publique. – 373 La loi no 2016-731 du 3 juin 2016 a introduit un article 39-3 dans le Code de procédure pénale qui précise que le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre, la proportionnalité des actes d’investigation, l’orientation donnée à l’enquête et la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations soient menées à charge et à décharge dans le respect des droits de la défense et des personnes en cause. Les magistrats du parquet appartenant à un corps hiérarchisé et devant exécuter les ordres de leurs supérieurs, ne bénéficient pas de l’inamovibilité comme les magistrats du siège. Aussi les magistrats debout qui n’exécutent pas les ordres reçus s’exposent à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation (certaines garanties résultent cependant des art. 59 et s. de l’Ord. no 58-1270 du 22 déc. 1958 modifiée par la L. no 94101 du 5 févr. 1994). La loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 a modifié l’article 65 de la Constitution, relatif au Conseil supérieur de la magistrature, dont la présidence n’est plus confiée au président de la République. Il comprend deux formations, l’une d’elles étant compétente à l’endroit des magistrats du parquet. Ladite formation (composée d’une majorité des personnalités qualifiées et 7 magistrats) donne un « avis » sur les nominations (à l’exception de celles prononcées en Conseil des ministres) ainsi que sur les sanctions disci37 262 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 plinaires dont peuvent faire l’objet ces magistrats. Pour importante que soit cette réforme, qui accorde certaines garanties aux membres du parquet, elle ne confère pas à ceux-ci le bénéfice de l’inamovibilité, qui demeure l’apanage des magistrats du siège. Néanmoins, le Conseil constitutionnel, par une décision du 8 décembre 2017 (no 2017/680 QPC), a considéré que dans l’exercice de ses fonctions, le magistrat du parquet était indépendant. c) Irresponsabilité du ministère public Le ministère public n’est pas une partie ordinaire au procès pénal; s’il succombe dans sa demande, il ne sera pas, comme les autres demandeurs, condamné à des dommagesintérêts. En raison de la loi organique du 18 janvier 1979 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, les magistrats composant le ministère public ne sont, comme tous les autres magistrats du corps judiciaire, responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité civile des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’État devant la chambre civile de la Cour de cassation. Cette procédure remplace la « prise à partie » prévue par les articles 505 et s. du Code de procédure civile, abrogés par la loi du 5 juillet 1972 (mais demeurés en vigueur jusqu’à la loi du 18 janvier 1979). 374 374 – Quant à la responsabilité pénale, la loi du 4 janvier 1993 a abrogé les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale qui constituaient au bénéfice « des magistrats et de certains fonctionnaires » un « privilège de juridiction », en vertu duquel des règles particulières étaient applicables en l’occurrence en matière de poursuites et d’instruction (ainsi le parquet, alerté sans retard, devait saisir par requête la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui désignait la juridiction chargée de l’instruction et du jugement). C’est désormais le droit commun qui s’applique, étant observé qu’il pourra être fait application de l’article 662 du Code procédure pénale autorisant la chambre criminelle à dessaisir la juridiction initialement saisie pour renvoyer devant une autre juridiction du même ordre (V. Stéfani, Levasseur et Bouloc, op. cit. no 195). – Toutefois, en cas de crime ou délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquant la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si, préalablement, le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte a été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive saisie (art. 6-1 C. pr. pén., L. 8 févr. 1995). § 375 3 La partie civile La troisième partie que l’on peut rencontrer dans le procès pénal (sa présence, assez fréquente, n’est cependant pas générale) est la partie civile, la personne lésée dans ses intérêts par l’infraction commise, celle que l’on appelle souvent la victime, et qui porte devant la juridiction répressive son action civile en réparation du dommage subi. La loi du 2 février 1981 insiste sur la protection de la victime et consacre à cet objet l’intégralité de son titre III (art. 81 à 100). Le garde des Sceaux a fait éditer en 1982 un guide des droits de la victime. Les lois du 8 juillet 1983, du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 ont modifié le Code de procédure pénale afin de « renforcer la protection des victimes d’infractions ». Une 375 263 376 > 378 Le procès pénal, étude de la procédure pénale loi du 6 juillet 1990 (mod. L. 19 juill. 1993) a aussi amélioré cette protection (V. infra, no 978). international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 A. Conditions nécessaires pour se porter partie civile 376 Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». En outre, l’article 3 du même code, qui prévoit que cette action « peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction », ajoute que cette action « sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ». Pour pouvoir se porter partie civile, il faut avoir été lésé par l’infraction commise. Mais cette lésion ne suffit pas; il faut que le préjudice subi (qui peut être corporel, matériel ou moral) soit actuel, personnel et direct. 377 Le préjudice actuel est un préjudice dont l’existence est certaine, indubitable, par opposition au préjudice éventuel, qui est possible mais dont on n’est pas sûr qu’il se réalise. Il peut se placer dans le futur à condition d’être certain (Crim. 8 oct. 1980, Bull. no 252). Il peut aussi consister dans la perte d’une chance. 378 Le préjudice doit être personnel, c’est-à-dire être un dommage individuel, nettement distinct du préjudice social, et ressenti personnellement par celui qui en réclame réparation. 376 37 378 – La question donne lieu à difficulté lorsque le préjudice invoqué est un dommage moral, particulièrement lorsque la prétendue victime est un groupement, une personne juridique. Le groupement ne peut se porter partie civile qu’à l’occasion des infractions qui ont lésé ses intérêts propres, et non pas les intérêts de tel ou tel membre du groupement, ou les valeurs morales que le groupement entend défendre (il s’agira souvent en ce dernier cas, d’un préjudice social, que seul le ministère public est autorisé à faire valoir). Il a fallu des textes spéciaux, déjà nombreux, pour que certains groupements soient autorisés à se porter partie civile à l’occasion d’infractions portant atteinte à l’intérêt général (Ord. 3 mars 1945 autorisant les associations familiales à exercer les droits de la partie civile à propos d’infractions portant atteinte aux intérêts de la famille; Loi du 27 décembre 1973 pour les associations de consommateurs; Loi du 9 novembre 1919 pour les associations antialcooliques; Loi du 1er juillet 1972 ajoutant un article 2-1 au Code de procédure pénale, pour les associations combattant le racisme; Loi du 9 avril 1975 pour les associations contre le proxénétisme; Loi du 10 juillet 1976, article 14 pour les associations de protection animale reconnues d’utilité publique; Loi du 4 janvier 1993 pour les associations se proposant de combattre la délinquance routière; Loi du 1er février 1994 pour les associations de défense et de protection des animaux, etc.). – D’autre part, les syndicats peuvent se porter partie civile à l’occasion d’infractions qui causent un préjudice même indirect à la profession, sans qu’il soit nécessaire que le syndicat lui-même ait subi un préjudice (art. L. 2132-3 C. trav.); encore le préjudice professionnel doit-il être suffisamment distinct du préjudice social. – Les lois des 23 décembre 1980, 2 février 1981, 10 juin 1983, 25 juillet 1985, 22 juillet 1987, 12 juillet 1990, 17 décembre 1991, 4 janvier 1993, 1er février 1994, 4 août 1994, 8 janvier 1995, 8 février 1995, 13 mai 1996, 15 juin 2000, 5 août 2013 et 6 décembre 2013, ont inséré dans le Code de procédure pénale les nouveaux articles 2-1 à 2-23 qui accordent, sous certaines conditions que l’on ne saurait exposer ici, les droits reconnus à la partie civile : 1° aux associations déclarées depuis au moins 5 ans, se proposant : de combattre le racisme ou certaines discriminations (art. 2-1) – de 264 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 combattre les violences sexuelles ou les violences contre les membres de la famille (art. 2-2) – de défendre l’enfance en danger ou victime de maltraitance ou les mineurs victimes d’atteintes sexuelles (art. 2-3) – de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ou d’assurer la défense des intérêts moraux ou l’honneur de la Résistance ou des déportés, de combattre l’apologie des crimes de collaboration avec l’ennemi, etc. (art. 2-4 et 2-5) – de combattre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, etc. en ce qui concerne des incriminations énumérées (art. 2-6) – 2° aux personnes morales de droit public en cas d’incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, etc. (art. 2-7) – 3° aux associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans ayant vocation à défendre ou assister les personnes malades ou handicapées en ce qui concerne certaines infractions (art. 2-8) – 4° aux associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans qui se proposent : d’assister les victimes d’infractions de terrorisme (art. 2-9 et 706-16) – de lutter contre les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal (art. 2-10) – de défendre les intérêts moraux et l’honneur des anciens combattants, des victimes de guerre, des morts pour la France (art. 2-11) – de combattre la délinquance routière et de défendre les victimes de cette délinquance (art. 2-12) – d’agir en cas d’infractions réprimant les sévices graves, actes de cruauté et mauvais traitements aux animaux (art. 2-13) – d’agir en cas d’infractions aux textes pris pour la défense de la langue française (art. 2-14) – d’intervenir dans les poursuites pour accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d’habitation et regroupant plusieurs personnes (art. 2-15) – de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants (art. 2-16), – de défendre et assister l’individu à propos d’actes exploitant une sujétion psychologique, pour les infractions d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou d’atteintes aux biens (art. 2-17 C. pr. pén., loi du 12 juin 2001), – de défendre les victimes d’accidents du travail (art. 2-18 C. pr. pén., loi du 15 juin 2000), – de défendre les élus municipaux pour certaines infractions liées à leurs fonctions (art. 2-19), ou de défendre les intérêts des locataires, propriétaires ou bailleurs d’immeubles collectifs à usage d’habitation (art. 2-20 C. pr. pén.) – 5° aux associations déclarées depuis 3 ans ayant pour but la protection archéologique (art. 2-21 C. pr. pén.), aux associations déclarées depuis 5 ans ayant pour objet la lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage (art. 2-22 C. pr. pén.), aux associations agréées luttant contre la corruption pour les délits d’atteinte à la probité, la corruption, le trafic d’influence, le recel et le blanchiment de ces infractions (art. 2-23 C. pr. pén.), aux associations ou syndicats professionnels pour les infractions du Livre II de la huitième partie du Code du travail (art. 2-21-1 C. pr. pén.). – La loi du 13 avril 2016 a permis l’exercice de l’action civile aux associations luttant contre l’esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme, si l’action a été engagée par le ministère public ou la victime (art. 2-22 C. pr. pén.), et celle du 3 juin 2016 ont permis aux associations défendant les victimes d’infractions de terrorisme de regrouper plusieurs victimes (art. 2-9, al. 2 C. pr. pén.). – Les associations luttant contre la corruption peuvent agir pour les délits des art. 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 439-1, 435-1 à 445-2-1 du Code pénal, le recel et le blanchissement de ces infractions (art. 2-23 C. pr. pén.). La loi du 27 janvier 2017 a aussi permis à des associations déclarées, ayant pour objet la défense et l’assistance d’étudiants victimes de bizutage, d’agir pour les infractions du livre II, titre II, chap. V, sect. 3 bis du Code pénal (art. 2-24 C. pr. pén.). Les associations habilitées à agir ne peuvent se constituer que pour les infractions visées (Crim. 31 janv. 2018, no 17-80.659, JCP 2018. 316, note Bouloc). 379 – Ajoutons qu’en dehors des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, des pouvoirs analogues sont accordés aux associations de défense des intérêts des consommateurs (L. 5 janv. 1988, art. L. 421-1, devenu L. 621-2 C. consom.), aux associations agréées d’investisseurs (L. 8 août 1994), aux associations agréées de protection de la nature, de l’eau, de l’air et de l’urbanisme (L. 2 févr. 1995, art. L. 142-3 C. envir.). 380 – Parfois, la jurisprudence a considéré que telle infraction ne pourrait pas donner lieu à une action civile parce que l’infraction tendrait à protéger l’intérêt général. Cette théorie est en régression, la 379 380 265 381 > 384 Le procès pénal, étude de la procédure pénale Cour de cassation considérant que la législation en cause vise à la fois la protection de l’intérêt général et celle des particuliers (par ex. : urbanisme, droit de la pharmacie, etc.). Le préjudice direct est celui qui est la conséquence immédiate de l’infraction, ou qui puise sa source dans le délit, c’est-à-dire les agissements incriminés par la loi comme légalement constitutifs d’une infraction (ce que l’on a appelé le « dommage pénal »). 381 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 381 Le préjudice qui ne découle qu’indirectement de l’infraction ne peut pas être réparé par la voie de l’action civile (ex : tiers lésé par une escroquerie, chef d’entreprise dont les salariés ont été corrompus…). Seuls les syndicats sont autorisés à demander par cette voie la réparation du dommage causé directement ou indirectement à la profession; de même les associations de protection des consommateurs, de protection animale ou de protection de la nature sont habilitées à agir pour la réparation du préjudice indirect aux intérêts collectifs dont elles ont la charge ou qu’elles ont pour objet de défendre. Il faut ajouter que la personne lésée ne peut se porter partie civile que si elle a la capacité juridique d’ester en justice; c’est par conséquent le représentant légal du mineur ou du majeur protégé ou un administrateur ad hoc, ou le représentant de la personne morale qui devra se constituer partie civile au nom de la victime. 382 382 B. L’option ouverte à la personne lésée L’article 3 du Code de procédure pénale dispose que « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». La victime peut, à son choix, porter son action en réparation du dommage qu’elle a subi du fait des agissements constitutifs de l’infraction, soit devant la juridiction répressive, soit devant la juridiction civile. 383 38 1° Avantages et inconvénients respectifs de l’option en faveur de l’une ou l’autre voie L’avantage le plus sensible dans le choix de la voie répressive est sans doute celui de la rapidité; la justice répressive, bien qu’elle manque de toute la célérité souhaitable, parvient à une décision définitive beaucoup plus rapidement que la justice civile. Un second avantage est celui de l’économie (la voie répressive est beaucoup moins coûteuse que la voie civile). Alors que la preuve est réglementée dans le domaine civil, le Code de procédure pénale dispose qu’en matière pénale, elle est libre (art. 427 C. pr. pén.), sauf dispositions contraires de la loi, et étant entendu qu’un élément de preuve recueilli à l’aide d’une infraction ne saurait, en principe, être accueilli. Des procédés coercitifs sont susceptibles d’être mis en œuvre par le juge pénal pour recueillir tous les éléments de preuve (la voie répressive comporte des moyens énergiques tels que perquisitions, écoutes téléphoniques, géolocalisations, saisies, détention provisoire, etc. qui ne sont pas utilisables en procédure civile). 384 384 – Enfin, il est avantageux pour la victime d’être présente au procès pénal puisque, de toute façon, la décision qui interviendra sur celui-ci sera opposable à l’auteur des faits incriminés par suite de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Quoique la partie civile, une fois constituée, ne puisse plus être entendue comme témoin (art. 422 C. pr. pén.), la loi du 2 février 1981 a décidé que « la partie 266 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal ». 2° Limites de l’option international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 Cependant, le choix de la voie répressive présente certains inconvénients. Si la victime échoue dans sa demande en réparation, elle engage sa responsabilité pour son action téméraire, et cette responsabilité sera plus lourde si elle a choisi la voie répressive car le préjudice subi par son adversaire sera plus grand. Elle est également exposée à l’amende civile pour procédure abusive (art. 177-2 ou 212-2 C. pr. pén.). De plus, la partie civile ne peut être entendue comme témoin, or la déposition de la victime joue souvent un rôle important dans l’administration de la preuve (il est vrai que l’on peut attendre d’avoir déposé pour se constituer partie civile, mais cet artifice est de nature à réduire l’autorité du témoignage). En outre, la partie civile peut être entendue (ainsi par un OPJ, agissant sur commission rogatoire), à titre de simple renseignement, si elle en fait la demande (art. 152 C. pr. pén.). La constitution de partie civile n’est pas possible devant toutes les juridictions. Elle est ouverte devant les juridictions d’instruction, les juridictions de jugement de droit commun et les juridictions de mineurs; elle n’est pas possible, en principe, devant les juridictions d’exception. 385 385 – Ainsi n’était-elle pas recevable devant les tribunaux permanents des forces armées (supprimés par L. du 21 juill. 1982), tandis qu’elle était recevable uniquement devant la juridiction de jugement de la Cour de sûreté de l’État (supprimée par L. du 4 août 1981). La victime d’une infraction de droit commun commise par un militaire dans le service ou dans un établissement militaire peut se constituer partie civile selon le droit commun. – Par ailleurs, même s’il s’agit de juridictions de droit commun, la constitution de la partie civile n’est pas possible, en principe, si la demande de réparation est de la compétence des juridictions d’un autre ordre, par exemple des juridictions administratives (dommage résultant d’une faute de service dans le fonctionnement d’un service public) ou des juridictions de la Sécurité sociale (dommage résultant d’un accident du travail). Cependant, depuis la loi du 31 décembre 1957, la constitution de partie civile est recevable pour la réparation du dommage causé par un véhicule administratif. – De plus, la Cour de cassation admet que la constitution de partie civile n’implique pas l’obligation de demander des dommages-intérêts à la juridiction répressive; elle met l’action publique en mouvement quand bien même la victime se réserve le droit de demander ultérieurement à la juridiction compétente la réparation du préjudice subi, en faisant état de l’autorité de la chose jugée au pénal (Crim. 15 oct. 1970, D. 1970, 733, note Costa; Crim. 8 juin 1971, D. 1971. 594, note J. Maury). La victime qui veut se porter partie civile doit le faire dès le premier degré de juridiction. L’article 85 du Code de procédure pénale disposant que « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent », on en déduit que le droit de provoquer l’ouverture d’information par une plainte assortie de constitution de partie civile ne s’étend pas à la matière des contraventions de police (art. 79 C. pr. pén.). La victime d’une contravention peut, évidemment, dénoncer les faits et joindre son action civile à l’action publique intentée par le ministère public (Crim. 28 oct. 1974, Bull. crim. no 304). 386 386 – On peut se porter partie civile en première instance jusqu’à la fin des débats, tant que le ministère public n’a pas encore exposé ses réquisitions sur le fond (art. 421 C. pr. pén.). Les procédés techni- 267 387 > 388 Le procès pénal, étude de la procédure pénale ques de la constitution de partie civile seront exposés ci-dessous no 794. La recevabilité est appréciée par le tribunal (art. 423 C. pr. pén.). 3° Effets de l’option 387 387 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 L’option en faveur de la voie répressive cesse lorsque celle-ci est fermée par suite de l’extinction de l’action publique (décès du délinquant ou amnistie) avant que la juridiction répressive de jugement ait été saisie de l’action civile. L’option une fois exercée est en principe irrévocable. Cependant, cette règle a subi de très nombreuses atténuations. La victime qui avait choisi la voie répressive peut l’abandonner pour saisir la juridiction civile. Mais la demande tendant à obtenir une provision, n’est pas considérée comme un abandon de la voie pénale (art. 5-1 C. pr. pén.). Si elle avait choisi au contraire la voie civile, elle pourra exceptionnellement l’abandonner pour aller devant la juridiction répressive si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond n’ait été rendu par la juridiction civile (art. 5 C. pr. pén.), ou si son action repose sur un fondement délictuel. Si la victime a choisi la voie civile, le procès engagé par elle risque d’être suspendu si l’action publique est exercée par le ministère public. En effet, de façon à sauvegarder l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le législateur a donné priorité à la voie répressive, et l’article 4, alinéa 2, du Code procédure pénale prévoit que la juridiction civile doit surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et est relative aux mêmes faits. On traduit cette règle par l’adage : « Le criminel tient le civil en état ». La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas nécessairement la suspension des autres actions civiles, même si la décision du juge pénal peut exercer une influence sur la solution du procès civil (art. 4, al. 3 C. pr. pén.). § 4 Les personnes civilement responsables et les assureurs Les personnes qui, d’après les règles du droit civil, sont civilement responsables des personnes poursuivies, peuvent être appelées devant la juridiction répressive et condamnées à répondre civilement des indemnités allouées à la victime (à la suite de l’action civile portée par celle-ci devant le juge répressif). 388 38 – Il en est ainsi des parents responsables des agissements de leurs enfants âgés de moins de 18 ans habitant avec eux, des commettants responsables de certains agissements de leurs préposés dans l’exercice de leurs fonctions, etc. Lorsqu’il existe une personne civilement responsable, elle peut être appelée au procès pénal même si le tribunal n’est saisi que de l’action publique. Elle peut alors, pour éviter sa propre condamnation, soit soutenir que l’infraction n’a pas été commise, soit que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile font défaut. Dans certains cas exceptionnels (droit pénal économique, droit pénal du travail) elles peuvent même être déclarées civilement responsables du paiement des peines pécuniaires. 268 L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal La loi du 8 juillet 1983 (renforçant la protection des victimes d’infractions) dispose : 1° que « la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur, doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci ainsi que le no de sa police d’assurance » – 2° que lorsque des poursuites pénales sont exercées, « les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel » – 3° qu’en ce qui concerne les débats et les voies de recours, « Les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile » (sous certaines réserves), (art. 388-1 C. pr. pén.). 389 § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 389 5 Les tiers menacés par l’incidence de la peine à caractère réel prononcée contre le coupable Certaines peines à caractère réel, telles que la confiscation spéciale et la fermeture d’établissement (V. infra, no 1106), peuvent être supportées en fait par le propriétaire de la chose confisquée ou du fonds de commerce fermé, voire par les créanciers ayant des droits sur les éléments en question du patrimoine de leur débiteur, ce qui constitue alors une atteinte au principe de la personnalité des peines. Aussi la loi du 11 juillet 1975 a-telle prévu (art. 3 et 9) la possibilité pour le tiers menacé ainsi dans ses intérêts personnels, de présenter ses explications lorsqu’il s’agit de la confiscation du fonds de commerce d’un proxénète ou de la fermeture temporaire ou définitive d’un débit de boissons. 390 390 – En pareil cas, le tiers ainsi exposé alors qu’il n’est pas englobé dans les poursuites, doit être cité à la requête du ministère public, et peut présenter ses explications à l’audience par l’intermédiaire d’un avocat, et interjeter appel de la décision qui lui porte préjudice (art. 706-38 C. pr. pén.). En l’absence de tout texte, la Cour de cassation a considéré qu’un tiers dont le bien peut être confisqué doit être appelé à l’audience (Crim. 29 nov. 2000, Bull. crim. no 356). 269 Chapitre 1 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 L’essentiel Le procès pénal présente des caractéristiques particulières. En effet, il peut donner lieu à deux actions, si bien que plusieurs parties peuvent s’y trouver. 1. Les actions Le procès pénal donne lieu nécessairement à une action publique tendant à sanctionner l’auteur d’une infraction. Peut être jointe à cette action, l’action civile, c’est-à-dire l’action en réparation du dommage subi personnellement par la victime de cette infraction. La comparaison de ces deux actions fait apparaître des différences quant à leur but, leur nature et leur objet (peine pour l’action publique et dommages-intérêts pour l’action civile). Mais, il existe aussi des rapprochements, qui tiennent au fait qu’elles naissent du même événement, qu’elles peuvent être portées ensemble devant les mêmes juges, et que ce qui a été jugé sur l’action publique a autorité sur l’action civile. Ces deux actions peuvent s’éteindre par l’effet de la prescription et par la chose jugée. S’agissant de la prescription de l’action publique, elle est acquise par 20 ans (crimes), 6 ans (délits) et 1 an (contraventions), sauf délais plus longs (terrorisme, trafic de stupéfiants, agressions ou atteintes sexuelles notamment) et sauf imprescriptibilité (génocide et crimes contre l’humanité). En principe, le point de départ du délai est fixé au jour de la commission de l’infraction, toutefois, s’agissant d’infractions dissimulées ou occultes, il peut être retardé « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », auquel cas le délai est de 30 ans pour les crimes et 12 ans pour les délits. La prescription peut être interrompue par l’un des actes mentionnés à l’article 9-2 C. pr. pén. (actes d’enquête ou d’instruction, jugements ou arrêts…) ou être suspendue en cas d’obstacle de droit, prévue par la loi, ou d’« obstacle de fait » insurmontable et assimilable à la force majeure (art. 9-3 C. pr. pén.). L’action publique peut s’éteindre aussi par le décès du délinquant (on ne juge pas les morts), l’abrogation de la loi pénale, une loi d’amnistie et plus exceptionnellement par une transaction (matières fiscale ou douanière, notamment) ou par le retrait de la plainte (quand celle-ci est indispensable à la poursuite, comme une atteinte à la vie privée). 270 Quant à l’action civile, elle peut s’éteindre par la prescription (de 5 ou de 10 ans selon la nature du dommage), par la renonciation, l’indemnisation ou une transaction. 2. Les parties au procès pénal international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 La personne pénalement poursuivie peut être une personne physique ou une personne morale. On ne peut cependant être pénalement puni qu’en raison de son propre fait. À la phase de jugement, la personne poursuivie doit être identifiée. La partie poursuivante est toujours le ministère public (procureur de la République, Procureur général et en matière de contraventions des 4 premières classes, commissaire de police). Le ministère public est un corps hiérarchisé, les procureurs généraux étant soumis à l’autorité du garde des Sceaux qui ne peut adresser que des instructions générales d’action publique. Le ministère public est irresponsable et irrécusable; les différents membres d’un même parquet pouvant se remplacer. Quant à la victime, elle est partie au procès si elle se constitue partie civile. Sa constitution est recevable si elle peut invoquer un préjudice certain, actuel et personnel, découlant directement de l’infraction poursuivie. Depuis plus de 50 ans, le législateur a permis à certaines associations, visées aux articles 2-1 à 2-24 du Code de procédure pénale, la possibilité d’agir devant le juge pénal. Qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une association, le titulaire de l’action civile a le choix d’agir devant le juge pénal ou devant le juge civil. Mais en cas d’option pour la voie civile, il n’est plus possible de se tourner vers le juge pénal (irrévocabilité de l’option). Outre les victimes, d’autres personnes peuvent exceptionnellement être présentes devant le juge pénal : le tiers civilement responsable, l’assureur du prévenu et éventuellement l’assureur de la victime. Le tiers menacé par une peine à caractère réel (fermeture d’un fonds de commerce, confiscation de certains biens) peut (et doit) être présent dans la procédure, afin qu’il puisse faire valoir ses droits. 271 Commissaire de police, 2005 (externe) Le rôle du ministère public Greffier, 1999 (externe et interne) L’action civile Greffier, 2014 (externe) L’exercice de l’action civile Lieutenant de police, 2004 (externe) La victime dans le procès pénal Magistrat, 2009 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 Sujets de concours Chapitre 1 Le procureur de la République, clé de voûte de la procédure pénale Magistrat, 2011 La victime dans la procédure pénale Magistrat, 2015 La prescription de l’action publique Officier de gendarmerie, 2011 Le ministère public est-il une autorité judiciaire ? Lieutenant pénitentiaire, 2011 La notion de préjudice dans l’action civile 272 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 chapitre Les juridictions répressives et leur compétence 391 Il convient d’étudier successivement les principes généraux de l’organisation judiciaire, puis les diverses juridictions répressives et leur compétence. 391 section 1 Principes généraux de l’organisation judiciaire en matière pénale 392 Les uns concernent l’organisation des juridictions, les autres concernent le statut des magistrats. 392 § 1 Principes concernant l’organisation des juridictions répressives A. Unité de la justice civile et de la justice pénale 393 Le premier de ces principes est l’unité de la justice civile et de la justice répressive. Les juges répressifs sont des magistrats de l’ordre judiciaire et non des magistrats administratifs. Bien mieux, au sein des tribunaux judiciaires, les mêmes juges sont chargés à la fois de la justice civile et de la justice répressive. Le tribunal d’instance connaît des contraven393 273 394 > 394 Le procès pénal, étude de la procédure pénale tions sous le nom de tribunal de police en matière pénale; le tribunal de grande instance connaît des délits sous le nom de tribunal correctionnel; la cour d’appel comprend une chambre des appels correctionnels, et la Cour de cassation comporte une chambre criminelle. Sauf en ce qui concerne la Cour de cassation, où les magistrats sont spécialisés dans l’examen des affaires civiles ou des affaires répressives, toutes les autres juridictions jugent successivement l’une ou l’autre catégorie d’affaires, tantôt selon les jours de la semaine s’il s’agit d’un petit tribunal, tantôt selon les années, car, dans les tribunaux importants et dans les cours d’appel qui sont divisées en diverses chambres, les magistrats siègent parfois une année à une chambre civile et une autre à une chambre répressive. – Cette unité s’explique par l’utilisation de nombreuses notions communes et par la possibilité donnée à la victime de porter son action civile devant le juge répressif, conjointement à l’action publique (V. supra, no 324). international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – De plus en plus cependant, en raison de la technicité croissante des fonctions répressives, on préconise une spécialisation du juge pénal. – Pour l’instant, le droit positif connaît une demi-spécialisation, limitée et temporaire : les juges d’instruction, les juges des libertés et de la détention, les juges des enfants et les juges de l’application des peines sont investis de leurs fonctions par décret pour un temps indéterminé. – Les articles 704 à 706-2 du Code de procédure pénale (L. 6 août 1975, mod. L. no 94-89, 1er févr. 1994 et no 2013-1117 du 6 déc. 2013) disposent que dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents pour la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions spécifiées par l’article 704 (V. infra, no 481, la liste de ces infractions requérant, eu égard à leur nature, une particulière technicité : affaires économiques et financières, affaires relevant du Code de l’urbanisme, du Code monétaire et financier, de la propriété intellectuelle, etc.). Depuis la loi du 2 juillet 1998, ces formations spéciales sont aidées, dans l’accomplissement de leurs missions, par des assistants spécialisés (art. 706 C. pr. pén.). La loi du 9 mars 2004 a prévu des juridictions spécialisées à compétence étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour connaître des infractions définies à l’article 704 du Code de procédure pénale (JIRS). En outre, des juridictions sont spécialisées en matière de terrorisme, sanitaire ou en matière maritime. La compétence des juridictions spécialisées est concurrente de celle des juridictions de droit commun qui peuvent être appelées à se dessaisir. – L’unité d’organisme entre la justice civile et la justice répressive n’empêche d’ailleurs pas que l’une et l’autre suivent des procédures sensiblement différentes. C’est ainsi que les règles relatives à la preuve ou aux voies de recours ne se ressemblent pas. D’une façon générale, la procédure répressive est plus rapide que la procédure civile. B. Séparation des fonctions 394 Un second principe fondamental est celui de la séparation des fonctions. La conduite du procès pénal met en œuvre trois catégories de fonctions bien distinctes : la fonction de poursuite, la fonction d’instruction et la fonction de jugement. La fonction de poursuite consiste à faire rechercher l’infraction, à la faire constater, à déclencher l’action publique et, au cours de cette action publique, à soutenir les intérêts de la société puis à faire exécuter la sentence. Cette fonction est confiée à un corps de magistrats, le « ministère public », dont nous avons vu la composition (V. supra, nos 363 et s.). La fonction d’instruction consiste à réunir objectivement les éléments du dossier. Les éléments recherchés portent aussi bien sur les faits reprochés à la personne poursuivie (cir394 274 Les juridictions répressives et leur compétence constances exactes dans lesquelles les faits se sont produits) que sur la personnalité de celle-ci (art. 81, al. 6, 7 et 8 C. pr. pén.), ou de la victime (art. 81-1 C. pr. pén.). Les affaires compliquées ou les affaires graves doivent être examinées attentivement avant d’être portées devant le magistrat chargé de les juger. Cette instruction doit être menée de façon objective, « à charge et à décharge ». Elle est confiée aux « juges d’instruction ». Si elle permet d’établir l’insignifiance des charges ou quelque cause d’extinction de l’action publique, ou encore l’existence d’un fait justificatif ou d’une cause de non-imputabilité, etc., il sera inutile de porter cette affaire devant la juridiction de jugement. Parfois le législateur a prévu que l’instruction serait obligatoire (V. infra, no 789); dans d’autres cas, elle est seulement facultative et la juridiction de jugement peut être saisie par citation directe (V. infra, no 776) ou par voie de comparution immédiate (V. infra, no 783) ou de comparution sur reconnaissance de culpabilité. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – La fonction de jugement consiste à se prononcer sur la participation de l’individu aux agissements reprochés et sur la peine qu’appellent ces agissements. Elle est confiée aux « magistrats du siège », qui doivent faire preuve d’une parfaite objectivité, pesant attentivement le pour et le contre, afin de ne sacrifier, comme dit l’article 304 du Code de procédure pénale, « ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse ». Notre droit pose en principe la séparation de ces trois fonctions et il les a confiées à des techniciens différents afin d’obtenir un meilleur rendement et une plus grande efficacité car elles nécessitent chacune des qualités et aptitudes particulières. Le magistrat qui, dans une affaire, a fait un acte de poursuite ne pourra pas, dans cette même affaire, procéder à des actes d’instruction, ni participer au jugement; de même, le juge d’instruction ne peut siéger dans la juridiction qui juge une affaire qu’il a instruite. Le jugement doit être rendu par des magistrats « impartiaux et indépendants » (art. 6 Conv. EDH). 395 395 – Cependant, il existe à ce principe certains tempéraments; en cas d’infraction flagrante, le procureur de la République (ou ses substituts), en principe chargé de la poursuite, peut faire certains actes de police judiciaire étroitement apparentés aux actes d’instruction; d’autre part le juge des enfants, pour des raisons particulières, peut exercer parfois des fonctions d’instruction et des fonctions de jugement dans les affaires qui lui sont confiées (V. infra, no 454). C. Collégialité des juridictions Un troisième principe est celui de la collégialité des juridictions. Cela signifie que la juridiction répressive est en principe composée par un collège de magistrats et non par un juge unique. Ce principe existe également en matière civile, mais il est appliqué plus strictement en matière pénale. Il offre l’avantage de susciter des confrontations d’opinions et diminue le risque d’erreur, tout en assurant au surplus l’anonymat de la sentence. 396 396 – Le principe de la collégialité comporte certaines exceptions : le juge d’instruction (qui est investi, comme on le verra, de certains pouvoirs de juridiction pour le contentieux de l’instruction, infra, nos 885 et s.); le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants (qui peut prononcer certaines mesures éducatives bénignes comme juge unique), et le tribunal de police (qui n’est composé que d’un seul magistrat, et qui ne connaît que des contraventions). La loi du 29 décembre 1972 a prévu également la possibilité d’un juge unique devant les tribunaux correctionnels pour certaines infractions mineures limitativement énumérées par la loi (chèques sans provision, délits routiers, de chasse, de pêche, etc., art. 398-1 C. pr. pén.). C’est la généralisation de ce système pour le jugement de tous 275 397 > 398 Le procès pénal, étude de la procédure pénale les délits correctionnels qui avait été décidée par un vote du parlement en juin 1975; le Conseil constitutionnel dans une décision du 23 juillet 1975, a estimé qu’il était contraire à la Constitution car le choix opéré par le président du tribunal entre le juge unique et la formation collégiale portait atteinte à l’égalité des citoyens. La loi (du 6 août 1975) a donc été amputée des dispositions ainsi condamnées. D. Double degré de juridiction international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 Une nouvelle loi – du 8 février 1995 modifiant l’article 398-1 du Code de procédure pénale – est intervenue pour élargir les exceptions au principe de collégialité en ce qui concerne les délits, et sa constitutionnalité n’a pas été contestée, car sa mise en œuvre ne dépend pas du président de la juridiction. Outre les catégories précitées, il s’agit désormais de certains délits de violence, de vols simples et même de certains vols aggravés; la liste complète de ces infractions sera fournie (V. infra, no 411). La loi du 9 mars 2004 a prévu quelques extensions du juge unique pour l’exercice de l’action civile après ordonnance pénale (art. 495-6 C. pr. pén.; appel en matière de police, art. 547, al. 3, C. pr. pén.). Un quatrième principe important est celui du double degré de juridiction, qui signifie que chaque affaire peut être examinée successivement par deux degrés de juridiction, le second étant saisi en appel du premier. Les juges du second degré sont plus expérimentés que ceux du premier, et parfois aussi plus nombreux. Tel est le cas en matière criminelle; la loi du 15 juin 2000 a prévu des cours d’assises d’appel comprenant, outre 3 magistrats, 9 jurés (au lieu de 6 au premier degré). Cette réforme, demandée depuis longtemps, supprime les critiques tirées de la Convention européenne des droits de l’Homme, ou du pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques. 397 397 – La règle du double degré de juridiction comporte, elle aussi, des exceptions : certaines décisions du tribunal de police prononçant des condamnations minimes (art. 546 C. pr. pén., v. infra, no 983) ne sont pas susceptibles d’appel. E. Fixité et permanence des juridictions Le dernier principe est celui de la fixité et de la permanence des juridictions répressives. Toutes les juridictions ont un siège fixe, et fonctionnent d’une manière continue. Le décret du 27 février 1974 a supprimé les « vacances judiciaires », et même pendant les périodes où le service est allégé on peut toujours faire juger les affaires urgentes, notamment les infractions flagrantes dont les auteurs sont susceptibles de faire l’objet de la procédure de comparution immédiate substituée en 1983 à la procédure de la saisine directe, elle-même substituée en 1981 à la procédure du flagrant délit (V. infra, no 780). 398 398 – Une juridiction de jugement n’obéit pas complètement à ces règles, c’est encore la cour d’assises du premier ou du deuxième degré. (V. infra, no 441). Elle est considérée comme une section de la cour d’appel qui tient périodiquement ses assises (d’où le nom) dans les différents départements du ressort de la cour d’appel (en principe tous les 3 mois, tous les 15 jours à Paris où la cour d’assises comporte, au surplus, trois sections) et ne siège que le temps nécessaire pour juger les affaires inscrites au rôle de la session. La cour d’assises peut siéger dans une autre ville du département que celle où se tient d’habitude sa session (art. 235 C. pr. pén.); il en est de même des juridictions spécialisées en matière de terrorisme du ressort de la cour d’appel de Paris (art. 706-17-1 C. pr. pén., L. 29 déc. 1997). 276 Les juridictions répressives et leur compétence 2 Principes concernant le statut des magistrats répressifs international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 § Les magistrats répressifs sont en principe des professionnels. Ce sont des « fonctionnaires » ayant un statut sui generis (les dispositions générales et communes à la fonction publique ne s’appliquent pas aux magistrats de l’ordre judiciaire : v. L. 13 juill. 1983), recrutés selon les dispositions de la loi organique du 18 janvier 1979 modifiant l’ordonnance du 22 décembre 1958, relative au statut de la magistrature. Plusieurs concours sont ouverts pour le recrutement des auditeurs de justice. Le premier est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant un second cycle d’études supérieures (ou d’un titre ou diplôme équivalent). Le second est ouvert aux candidats justifiant d’une durée de 5 ans au moins de services en qualité de fonctionnaires ou d’agents de l’État, des collectivités territoriales ou d’un établissement public, et remplissant certaines conditions fixées par décret. Les conditions de recrutement concernent tous les magistrats, aussi bien ceux qui siègent au pénal que ceux qui siègent au civil (des recrutements particuliers peuvent aussi avoir lieu). Il y a cependant une exception importante, celle de la cour d’assises, qui comprend, à côté de 3 magistrats professionnels, 6 (ou 9 en appel) jurés qui sont des profanes. Une autre exception existe au tribunal pour enfants, où le juge des enfants, président, est assisté de deux assesseurs non professionnels recrutés parmi les spécialistes des questions de l’enfance et de l’adolescence. La loi du 10 août 2011 avait organisé la présence de citoyens – assesseurs en matière correctionnelle pour les délits de violence exposant à au moins cinq années d’emprisonnement (art. 399-2 C. pr. pén.). Cette expérimentation a cessé depuis un arrêté du 18 mars 2013. 399 39 – En outre, depuis une loi du 2 juillet 1998, des assistants spécialisés apportent leur collaboration aux magistrats spécialisés en matière économique et financière. Ce sont des fonctionnaires d’autres Administrations, justifiant d’au moins quatre années d’expérience professionnelle. Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats mais sans délégation de signature (art. 706 nouveau C. pr. pén.). Les magistrats répressifs ont des garanties d’indépendance. Leur indépendance à l’égard du gouvernement est garantie par l’inamovibilité dont bénéficient les juges du siège (chargés de l’instruction et du jugement). Leur indépendance à l’égard des justiciables est assurée par leur irresponsabilité (v. supra, no 374). Leur indépendance à l’égard du public est protégée par les textes réprimant les outrages ou violences à magistrat, les diffamations et les attaques contre leurs décisions (art. 434-24 C. pén.). Leur indépendance à l’endroit du pouvoir exécutif a été renforcée par les lois constitutionnelles du 27 juillet 1993 et du 23 juillet 2008 réformant le Conseil supérieur de la magistrature, et emportant en conséquence l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature (formation magistrats du parquet) pour le prononcé d’une sanction disciplinaire. 400 40 401 – 401 Les parties qui ont des raisons sérieuses de douter de l’impartialité d’un magistrat peuvent utiliser les possibilités limitées de récusation, ouvertes par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale et invoquer l’article 6-1 de la Convention européenne. 277 402 > 404 Le procès pénal, étude de la procédure pénale section 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 Les juridictions d’instruction Il existe deux juridictions dites d’instruction de droit commun, c’est-à-dire chargées non seulement d’enquêter mais aussi de juger les incidents contentieux qui se présentent au cours de l’instruction préparatoire. Ce sont : le juge d’instruction au premier degré et la chambre de l’instruction (qui est une chambre de la cour d’appel) au second degré. 402 402 – La composition, la compétence et le fonctionnement de ces juridictions seront examinés en même temps que le déroulement de l’instruction préparatoire, à propos des pouvoirs de juridiction du juge d’instruction (V. infra, nos 885 et s.), car ces différents points sont liés très étroitement à ce déroulement. 403 – La loi no 85-1303 du 10 décembre 1985, portant réforme de la procédure d’instruction en matière pénale, prévoyait l’institution auprès de chaque tribunal de grande instance de chambres d’instruction. Ces chambres auraient, dans certains cas, délivré des mandats de justice. Devant entrer en vigueur en 1988, cette loi a été abrogée en sa quasi-totalité par la loi no 87-1062 du 30 décembre 1987 relative aux garanties individuelles en matière de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, nouvelle loi qui créait, au sein de chaque tribunal de grande instance, une « chambre des demandes de mise en détention provisoire » chargée de prescrire le placement en détention provisoire de l’inculpé (art. 137 nouveau C. pr. pén.) et pouvant décider sa mise sous contrôle judiciaire. Ces dispositions ont été abrogées, elles aussi, avant la date de leur mise en application, par la loi du 6 juillet 1989 modifiant les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention provisoire. – La loi du 4 janvier 1993 disposait que la détention provisoire serait prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire (composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs), son application étant fixée au 1er janvier 1994. Cette disposition, à son tour, a été abrogée par la loi du 24 août 1993. La loi du 15 juin 2000, reprenant le principe d’un double examen, a concentré les questions relatives à la détention provisoire entre les mains d’un « juge des libertés et de la détention » qui est le président ou un vice-président du tribunal de grande instance (ou en cas d’empêchement, le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé), et est saisi par le juge d’instruction. La loi du 5 mars 2007 avait prévu que l’instruction serait conduite collégialement mais cette disposition n’est pas entrée en vigueur. La collégialité pourrait ne pas être obligatoire. 403 section 3 Les juridictions de jugement de droit commun 404 On appelle juridictions de droit commun celles qui ont « compétence pour juger toutes les infractions d’une catégorie déterminée, sauf celles dont un texte spécial leur a retiré la connaissance ». Elles sont opposées traditionnellement aux juridictions d’exception, c’est-àdire celles qui n’ont qu’une compétence d’attribution étroitement délimitée par la loi, soit 40 278 Les juridictions répressives et leur compétence § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 en considération de la nature des infractions (infractions militaires, par exemple), soit en raison de la qualité de leurs auteurs (mineurs, par exemple). Les juridictions de droit commun sont : Le tribunal de police • § 1 – La juridiction de proximité • § 2 – Le tribunal correctionnel • § 3 – La cour d’appel (chambre des appels correctionnels) • § 4 – La cour d’assises • § 5 – La Cour de cassation • § 6. 1 Le tribunal de police 1° Sa composition est très simple; il ne comporte qu’un seul magistrat qui, par conséquent, le préside, le juge d’instance. 405 405 – Comme dans toute juridiction, il est assisté d’un greffier (celui du tribunal d’instance) et le ministère public y est représenté pour les contraventions des quatre premières classes soit par le commissaire de police (désigné par le procureur général s’il y en a plusieurs au lieu où siège le tribunal), soit, s’il n’y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou à défaut d’un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département (art. 48 C. pr. pén.), soit pour les contraventions de la 5e classe, par le procureur de la République, un de ses substituts ou exceptionnellement le maire ou un adjoint, dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants du Code de procédure pénale qui ont été exposées ci-dessus dans l’étude du ministère public (V. supra, no 368). Le service de l’audience est assuré par un huissier. La décision est donc prise, comme il a été signalé ci-dessus, par un juge unique, ce qui est une situation exceptionnelle (V. supra, no 396). 406 2° Le tribunal de police siège au même lieu que le tribunal d’instance, c’est-à-dire en principe (depuis la réforme judiciaire du 22 déc. 1958) au chef-lieu de l’arrondissement (parfois au chef-lieu d’un des cantons formant sa circonscription). Il y avait autrefois un tribunal de police dans chaque chef-lieu de canton. 407 3° Au point de vue de la compétence d’attribution, le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions de 5e classe (et quelques contraventions des autres classes définies par décret), sauf : 1° celles qui, connexes à un délit, sont jugées avec celui-ci (infractions au Code de la route ayant entraîné un homicide par imprudence, par exemple); 2° celles qui font l’objet d’une amende forfaitaire, soit par versement immédiat entre les mains de l’agent verbalisateur, soit par apposition de timbre-amende sur l’avis de contravention (V. infra, nos 930 et s.); 3° celles qui sont réglées par la procédure simplifiée des articles 524 et suivants du Code de procédure pénale (régime dit de l’ordonnance pénale : v. infra, nos 926 et s.); 4° les contraventions de 5e classe commises par des mineurs (elles sont jugées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants); 5° certaines contraventions en matière fiscale; 6° certaines contraventions en matière de grande voirie. 408 4° Au point de vue de la compétence territoriale, la loi du 10 juin 1983 a modifié l’article 522 du Code de procédure pénale; alors qu’antérieurement était compétent exclusivement le tribunal de police dans le ressort duquel la contravention avait été commise, désormais sont compétents : 1° le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention; 2° celui de la résidence du prévenu; 3° le tribunal de police « du siège de l’entreprise détentrice du véhicule, en cas de contravention soit aux règles relati- 406 407 408 279 409 > 411 Le procès pénal, étude de la procédure pénale § 2 La juridiction de proximité La loi du 9 septembre 2002 avait institué des juridictions de proximité. Les juges en sont d’anciens magistrats ou juristes, recrutés pour un temps limité. En matière pénale, le juge de proximité avait compétence pour juger les contraventions des quatre premières classes, en suivant la procédure applicable devant le tribunal de police (art. 521, al. 2, C. pr. pén.). Sa compétence a cessé le 1er juillet 2017 (L. 2016-1547 18 nov. 2016, art. 15 IV 3°). 409 409 § 3 Le tribunal correctionnel 1° Composition Le tribunal correctionnel se compose, en principe, de trois membres (art. 398 C. pr. pén.) : un président qui dirige les débats (art. 401 C. pr. pén.) et assure la police de l’audience, et deux juges du tribunal de grande instance. Mais le tribunal peut juger à juge unique. 410 410 – 411 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 ves au chargement ou à l’équipement du véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ». Est également compétent le tribunal de police du lieu de débarquement d’une personne mise en cause, du port d’immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé, lorsque la contravention a été commise à bord d’un navire. Le contrevenant qui préfère ne pas se déplacer, a la possibilité de se faire représenter à l’audience ou d’envoyer des explications écrites (art. 544 C. pr. pén., faisant renvoi aux art. 410 à 415). Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats; cependant ils ne participeront au jugement de l’affaire que si un ou plusieurs des membres titulaires auront été empêchés de suivre les débats jusqu’à leur clôture (art. 398, al. 2, C. pr. pén.). Le tribunal correctionnel peut également, dans certains cas, siéger à juge unique. Le système inauguré en 1972 dans des conditions critiquables (qui avaient amené l’invalidation, par le Conseil constitutionnel, de l’extension que voulait réaliser la loi du 6 août 1975) a été élargi et régularisé par la loi du 8 février 1995. Les infractions délictuelles suivantes doivent être portées devant le tribunal correctionnel siégeant à juge unique (art. 398, al. 3 et 4, et art. 398-1 C. pr. pén.) : a) les infractions aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du Code monétaire et financier concernant des délits en matière de chèques ou de cartes de paiement (ne sont pas comprises les falsifications ou contrefaçons relatives à ces titres de paiement); b) les homicides ou blessures involontaires, les délits de fuite, et, de façon générale les délits prévus par le Code de la route; c) les délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres; 41 280 Les juridictions répressives et leur compétence – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 d) les délits de port ou transport d’armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État prévu par l’art. 317-8 du Code de la sécurité intérieure; e) les violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours (art. 222-11 C. pén.) même celles commises avec l’une des circonstances aggravantes de l’article 22212 du Code pénal – les violences n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours commises avec l’une des circonstances aggravantes de l’article 222-13 du Code pénal – les persécutions téléphoniques (art. 222-16 C. pén.) – les menaces des articles 222-16 à 18 du Code pénal; f) l’exhibition sexuelle imposée à autrui dans un lieu accessible aux regards du public (art. 222-32 C. pén.) et le racolage (art. 225-10-1); g) l’abandon de famille et les atteintes à l’autorité parentale (art. 227-3 à 227-11 C. pén.); h) le vol simple (art. 311-3 C. pén.) et le vol accompagné de l’une des circonstances aggravantes de l’article 311-4 du Code pénal; les filouteries (art. 313-5 C. pén.); le détournement de gage ou d’objets saisis (art. 314-5 et 6 C. pén.); le recel simple (art. 321-1 C. pén.); la destruction, la dégradation ou la détérioration du bien d’autrui et les graffitis (art. 322-1 C. pén.) commis ou non avec les circonstances aggravantes des articles 322-2 à 4-1; les menaces de telles destructions ou dégradations (art. 322-12 et 13 C. pén.); la divulgation de fausse information à ce sujet (art. 322-14 C. pén.); l’intrusion dans un établissement scolaire (art. 431-22 à 431-24); i) les outrages à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public (art. 433-5 C. pén.) ainsi que les menaces à l’encontre de personnes exerçant une fonction publique (art. 433-3, al. 1 et 2, C. pén.); j) les délits de rébellion (art. 433-6 à 433-10, al 1er); k) les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (art. 521-1 C. pén.); l) l’usage illicite de stupéfiants (art. L. 3421-1 CSP); m) les délits prévus par le Code rural (C. envir.) en matière de chasse, et pêche et de protection de la flore et de la faune; les délits prévus par le titre VIII du livre V du Code de l’environnement; n) les délits du Code forestier et du Code de l’urbanisme pour la protection des bois et forêts; o) le délit de l’article L. 126-3 et L. 152-1 al. 2 du Code de la construction et de l’habitation; p) les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse; q) les délits prévus par le Code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux; r) les délits des articles L. 335-2 à L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle commis au moyen d’un service de communication en ligne. Le projet de loi de programmation pour la justice 2018 modifie l’article 398 bis. Il y ajoute : - les menaces prévues par les articles 222-17 à 222-18-3; - la cession ou l’offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, de l’article 222-39; - le délit de risques causés à autrui, de l’article 223-1; - les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne, des articles 226-1 à 226-2-1, 226-4 à 226-4-2, et 226-8; 281 412 > 414 Le procès pénal, étude de la procédure pénale international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 - l’opposition à exécution de travaux publics, de l’article 433-11; - les usurpations de fonctions, de signes, de titres et d’usage irréguliers de qualité, de l’article 43312 à 433-18; - les atteintes à l’état civil des personnes, des articles 433-18 à 433-21-1; - le délit de prise de nom d’un tiers, de l’article 434-23; - les atteintes au respect dû à la justice, des articles 434-24 à 434-26, 434-35 à 434-35-1, 434-38 à 434-43-1; - les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 à 441-8; - la vente à la sauvette prévue par les articles 446-1 et 446-2; - les délits en matière d’habitat insalubre, de l’article L. 1337-4 du Code de la santé publique. – Pour l’appréciation du seuil de cinq ans d’emprisonnement, il ne sera pas tenu compte de l’aggravation résultant de la récidive ou des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 C. pén. Pour qu’un délit appartenant aux catégories ci-dessus puisse être déféré au juge correctionnel unique, certaines conditions supplémentaires sont requises (art. 398-1 C. pr. pén.) : a) il faut que le prévenu ne se trouve pas en détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou qu’il ne soit pas poursuivi selon la procédure de comparution immédiate; b) il ne faut pas que les infractions en question soient connexes à d’autres délits non prévus à l’article 398-1. Si l’on ne se trouve pas dans l’un de ces deux cas exceptionnels, la compétence du juge correctionnel unique est automatique et n’est plus laissée, comme autrefois, à la décision du président du tribunal, ce qui exempte ce système de l’inconstitutionnalité qui résultait de l’organisation antérieure. 412 412 – Cependant encore faut-il que la juridiction saisie vérifie la légalité de la qualification donnée aux faits poursuivis et n’estime pas que ceux-ci relèvent d’une qualification différente. C’est pourquoi l’article 398-2 du Code de procédure pénale prévoit que le juge unique qui constate une telle irrégularité doit renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel collégial. Inversement, le tribunal correctionnel collégial qui constate que la qualification qu’il retient relève du juge unique, peut soit renvoyer devant ce juge unique, soit retenir l’affaire qui sera jugée alors par le seul président de la juridiction collégiale. Le juge unique peut aussi renvoyer l’affaire à la formation collégiale si la complexité des faits ou l’importance de la peine pouvant être prononcée le justifie. Mais, il ne peut pas prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. 413 Afin que les citoyens puissent mieux comprendre les difficultés de l’acte de juger, la loi du 10 août 2011 avait prévu que pour le jugement des délits de violence exposant à au moins 5 années d’emprisonnement, le tribunal correctionnel comprendrait deux assesseurs issus des listes établies selon les règles des articles 10-1 à 10-13 du Code de procédure pénale. Le tribunal était alors dénommé « tribunal correctionnel citoyen ». La loi avait prévu une expérimentation pendant 2 ans dans les ressorts des cours d’appel de Toulouse et de Dijon. Mais cette expérimentation a prix fin par un arrêté du 18 mars 2013. 414 Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance (art. 398, al. 2). Le service de l’audience est assuré par un huissier. 413 41 282 Les juridictions répressives et leur compétence 2° Siège La formation du tribunal de grande instance siégeant au pénal prend le nom de tribunal correctionnel. Cette juridiction se trouve donc, en principe, depuis la réforme judiciaire de 1958, au chef-lieu du département, sous réserve des modifications résultant de la révision de la carte judiciaire. Toutefois, des considérations diverses (topographie, densité de population, raisons d’ordre historique) ont fait apporter de nombreuses dérogations au principe. 415 3° Compétence d’attribution international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 415 Le tribunal correctionnel est chargé du jugement des délits, c’est-à-dire des infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 € (art. 381 C. pr. pén.). 416 416 Tableau no IV Juridictions d’instruction et juridictions de jugement de droit commun Chambre criminelle Cour cassation Cour d’assises (2e deg.) Chambre des appels correctionnels Cour d’assises (1er deg.) Tribunal correctionnel collégial ou à juge unique Chambre de l’instruction Juge d’instruction Tribunal de police (contraventions de 5e classe et contraventions des 4 1res classes) procédure et juridictions de jugement – procédure et juridictions d’instruction Cependant, la connaissance de certains délits lui échappe exceptionnellement; il en est ainsi des délits connexes à un crime (qui sont jugés, avec ce crime, par la cour d’assises), et des délits commis par les mineurs. 283 417 > 418 En revanche, le tribunal correctionnel juge valablement les contraventions connexes aux délits portés devant lui, et celles dont le caractère contraventionnel n’apparaît qu’à la suite des débats et qui avaient été portées devant le tribunal correctionnel à raison de leur apparence délictuelle (art. 466 C. pr. pén.). 4° Compétence territoriale international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – Le procès pénal, étude de la procédure pénale De ce point de vue, la question est moins simple pour le tribunal correctionnel que pour le tribunal de police (V. supra, no 408). Un délit peut être déféré valablement (art. 43 et 52 C. pr. pén.) soit au tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’infraction a été commise, soit à celui dans le ressort duquel réside la personne poursuivie ou l’une des personnes poursuivies, soit à celui dans le ressort duquel cette personne a été arrêtée ou est détenue, même lorsque l’arrestation ou la détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause. La loi du 3 juin 2016 a ajouté qu’en cas de faits mettant en cause un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de police ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, le procureur général peut d’office ou sur proposition d’un intéressé, transmettre la procédure au procureur du tribunal le plus proche du ressort de la cour d’appel. Le projet de loi de 2018 étend cette solution au cas de la personne en cause en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel. 417 417 – Il est possible que ces divers chefs de compétence aboutissent à la saisine d’un seul et unique tribunal, mais il arrive qu’ils aboutissent à deux tribunaux ou davantage (s’il y a de nombreuses personnes poursuivies ou s’il s’agit d’un délit continu). En ce cas, il appartient aux représentants du ministère public de s’entendre sur le tribunal à saisir, en s’inspirant des commodités et des intérêts de la justice. Si plusieurs tribunaux se reconnaissaient simultanément compétents, il y aurait lieu à « règlement de juges » opéré par la cour d’appel ou la Cour de cassation (art. 657 et s. C. pr. pén.). – La compétence du tribunal s’étend aux délits et contraventions connexes. La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs ou complices. La compétence généralement retenue est celle du tribunal du lieu de commission de l’infraction; elle présente de grands avantages : c’est là qu’on trouvera les preuves de l’infraction et les témoins, c’est là que l’ordre public a été troublé, trouble que l’exercice de la justice va compenser dans une certaine mesure. 418 418 – La compétence du tribunal de la résidence de la personne poursuivie (ou de l’une des personnes poursuivies soit comme auteur soit comme complice) rappelle la règle de procédure civile qui attribue normalement compétence au tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur afin de rendre la défense plus facile. Elle présente l’avantage que le prévenu étant mieux connu à cet endroit, il sera plus facile d’y réunir des renseignements sur sa personnalité (or la considération de la personnalité prend une importance de plus en plus grande dans la justice répressive moderne). En outre, l’effet d’intimidation sur l’entourage sera plus important. Enfin, si l’auteur a commis en divers endroits plusieurs infractions non encore jugées, on peut les faire juger toutes par le tribunal du lieu de résidence, ce qui simplifie l’exercice de la justice. – La compétence du tribunal du lieu d’arrestation est avantageuse lorsque le délinquant est dangereux et risquerait de s’évader au cours de son transfert. Elle permet d’autre part de juger au même lieu les diverses infractions que cette personne a pu commettre (notamment quand elle n’a pas de domicile fixe). 284 Les juridictions répressives et leur compétence 419 Dans certains cas exceptionnels, les règles de compétence précisées ci-dessus reçoivent une certaine adaptation : a) Certaines affaires économiques ou financières sont, à raison de leur grande complexité, confiées à un tribunal correctionnel spécialisé, dont la compétence est en principe, régionale (art. 704 s. C. pr. pén.). Il en est de même en matière financière (art. 705 C. pr. pén.). b) Les articles 706-16 à 706-25 du Code de procédure pénale (L. 9 sept. 1986, modif. L. 16 déc. 1992 et 19 juill. 1993) disposent que lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions énumérées par l’article 706-16 (association de malfaiteurs, attentat à l’explosif, homicide, etc.) sont poursuivies, instruites et jugées selon le droit commun sous les importantes réserves des articles 706-17 et suivants. Le parquet, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel, la cour d’assises de Paris exercent en l’occurrence une compétence concurrente à celle de droit commun (qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du Code de procédure pénale). Ainsi le procureur de la République près un tribunal de grande instance de province peut, en matière de terrorisme, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au bénéfice de la juridiction d’instruction de Paris (art. 706-18 C. pr. pén., modif. L. 4 janv. 1993). Le procureur national antiterrorisme dispose de la même possibilité. Pour le jugement, la juridiction peut éventuellement siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d’appel de Paris pour raisons de sécurité (art. 706-17-1 C. pr. pén.). 420 Il y a également des règles particulières lorsque la bonne administration de la justice exige que l’on déroge aux règles normales de la compétence territoriale (art. 662 C. pr. pén.), (V. aussi l’article 382 du Code de procédure pénale relatif à la compétence en matière d’abandon de famille [art. 227-3 C. pén.]). 420 § 4 La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel 1° Composition 421 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 419 La chambre des appels correctionnels est une formation de la cour d’appel. Elle est composée (art. 510 C. pr. pén.) d’un président de chambre et de deux conseillers à la cour d’appel. En cas d’appel d’un jugement rendu à juge unique, la cour statuera à juge unique. La loi du 10 août 2011 avait prévu que pour les délits de violence relevant de la compétence du tribunal correctionnel citoyen, la chambre des appels correctionnels comprendrait en outre deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13 du Code de procédure pénale. Cette expérience a été abandonnée. Les fonctions du ministère public sont exercées par un membre du parquet général (V. supra, no 367) c’est-à-dire par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou de ses substituts. Le greffe est assuré par un greffier de la cour d’appel et le service de l’audience par un huissier. 421 285 422 > 426 Le procès pénal, étude de la procédure pénale 2° Siège 42 – La chambre des appels correctionnels fonctionne au siège de la cour d’appel. On sait que les cours d’appel, qui sont en France au nombre de 33, ont pour ressort plusieurs départements et siègent le plus souvent au chef-lieu de l’un d’eux (sauf quelques exceptions dues à des raisons historiques : Douai, Aix, Riom, Colmar, etc.). 3° Compétence d’attribution international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 422 La chambre des appels correctionnels connaît, en qualité de second degré de juridiction, des contraventions ou des délits jugés en première instance par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels. Elle peut, à titre exceptionnel, juger en premier et dernier ressort les délits et contraventions commis à son audience (art. 676 C. pr. pén.). 423 423 4° Compétence territoriale La chambre des appels correctionnels connaît des appels dirigés contre les décisions rendues par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels siégeant dans le ressort de la cour d’appel. Au besoin, elle vérifiera si la juridiction du premier degré était bien territorialement compétente; si elle l’était, la chambre des appels correctionnels l’est aussi automatiquement. En cas de cassation de l’arrêt rendu par une chambre des appels correctionnels, la Cour de cassation désigne la cour qui connaîtra à nouveau de l’affaire sur renvoi. Il peut s’agir de la même cour, autrement composée. 424 42 § 5 La cour d’assises La cour d’assises, considérée comme une émanation de la cour d’appel, devrait être une juridiction du second degré. En fait, elle juge en premier ressort les affaires qui lui sont déférées, mais elle n’est saisie qu’après que le dossier a fait l’objet d’une instruction (V. infra, no 942). Depuis la loi du 15 juin 2000, il existe une cour d’assises d’appel. 425 425 A. Composition La composition de la cour d’assises est complexe du fait qu’à côté de certains magistrats professionnels qui constituent ce que l’on appelle « la cour » siègent un certain nombre de profanes qui forment « le jury ». Ces deux éléments sont unis pour constituer la cour d’assises. Le ministère public est représenté par un membre du parquet général ou éventuellement du parquet de grande instance si la cour d’assises se tient dans une ville qui n’est pas le siège de la cour d’appel (le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort : art. 241 C. pr. pén., L. 30 déc. 1985); de même le greffier est le greffier en chef de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance en question (sauf à Paris). 426 426 – La loi du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’État, dispose que lorsqu’il s’agit d’un crime de droit commun et que son évocation 286 Les juridictions répressives et leur compétence 1° Magistrats professionnels 427 427 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 présente un risque de divulgation d’un secret de défense nationale, le jury n’entre pas dans la composition de la cour d’assises, laquelle est alors composée de cinq magistrats professionnels au premier degré et de neuf magistrats en appel (art. 698-6 C. pr. pén.). La même formation (cour d’assises sans jurés) juge les accusés de crimes de terrorisme (art. 706-25 C. pr. pén.), y compris les mineurs d’au moins 16 ans (deux des assesseurs sont pris parmi les juges des enfants du ressort de la Cour d’appel). L’élément professionnel, la cour au sens strict, comprend trois magistrats. Le président de la cour d’assises est un président de chambre ou un conseiller à la cour d’appel (art. 244 C. pr. pén.); il est désigné pour chaque trimestre par l’ordonnance du premier président qui fixe la date d’ouverture des sessions (art. 245), et qui pourrait d’ailleurs présider lui-même (art. 247). Les deux autres membres sont choisis, dans les mêmes conditions, parmi les conseillers de la cour d’appel ou parmi les membres du tribunal de grande instance où se tiennent les assises (art. 249 et 250). Si la session risque d’être longue, on peut désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires; ils assistent aux audiences mais ne participent aux délibérations que pour remplacer un assesseur titulaire défaillant (art. 248, al. 2 et 3). 2° Jury L’élément non professionnel, dit populaire, constitue le jury. Il est composé de 6 citoyens au premier degré et de 9 en appel dont la désignation est l’aboutissement d’une procédure compliquée, réglementée par les articles 255 et suivants du Code de procédure pénale modifiés par les lois des 28 juillet 1978, 6 juillet 1984, 30 décembre 1985, 16 décembre 1992. 428 428 – Il est établi annuellement dans le ressort de chaque cour d’assises une liste de jury criminel, qui comprend pour Paris 1 800 jurés et pour les autres ressorts un juré pour 1 300 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 200 (art. 260 C. pr. pén.). Afin de dresser la liste : 1° le nombre des jurés est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population par commune ou communes regroupées par arrêté préfectoral; 2° dans chaque commune, le maire tire au sort publiquement, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de celui déterminé par arrêté préfectoral proportionnellement à la population des communes; 3° la liste préparatoire ainsi constituée est dressée en deux exemplaires, l’un déposé en mairie, l’autre adressé au greffe de la juridiction siège de la cour d’assises; 4° le maire avertit les personnes tirées au sort et les informe de la possibilité de demander une dispense (dans les cas prévus à l’article 258 : personnes âgées de plus de 70 ans ou n’ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d’assises, ou arguant d’un motif grave reconnu par une commission ad hoc); 5° la liste annuelle est ensuite dressée au siège de la cour d’assises par une commission présidée soit par le président de la cour d’appel ou son délégué, soit par le président du tribunal de grande instance ou son délégué lorsque la cour d’assises est rattachée au siège du tribunal; la commission comprend en outre trois magistrats du siège (désignés par l’assemblée générale de la juridiction où siège la cour d’assises), le procureur général ou son délégué, ou le procureur de la République ou son délégué, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de la juridiction siège de la cour d’assises ou son représentant, cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général. La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude et statue sur les requêtes tendant à obtenir une dispense. – La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n’ont pas été exclus. 429 Outre la liste annuelle du jury criminel, la commission dresse une liste spéciale de jurés suppléants. Le nombre des jurés figurant sur cette liste – qui ne peut être inférieur à 50 ni 429 287 430 > 434 Le procès pénal, étude de la procédure pénale supérieur à 700 – est fixé, pour chaque cour d’assises, par arrêté du ministre de la Justice (art. 264 C. pr. pén., modif. L. 9 mars 2004). Ces jurés suppléants doivent être domiciliés dans la commune où siège la cour d’assises. Pour être inscrit sur la liste annuelle, il faut remplir certaines conditions (art. 255 C. pr. pén.) : être français de l’un ou de l’autre sexe, âgé de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par la loi. 430 – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 430 Sont « incapables » d’être jurés, les individus ayant été condamnés pour crime ou pour délit; les personnes en état d’accusation ou de contumace ou se trouvant sous mandat de dépôt ou d’arrêt; les anciens fonctionnaires révoqués; les officiers ministériels destitués; les faillis non réhabilités; les personnes frappées d’une interdiction d’être juré en vertu de l’article 131-26 du Code pénal; les majeurs sous sauvegarde de justice et ceux en tutelle ou en curatelle ou ceux placés dans un établissement d’aliénés (art. 256 C. pr. pén.). – Les fonctions de jurés sont incompatibles notamment avec celles de membres du gouvernement, du Parlement, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique et social, du Conseil d’État, de la Cour des comptes, de magistrats de l’ordre judiciaire, de membres des tribunaux administratifs, de fonctionnaires des services de police ou de l’administration pénitentiaire, de militaires de la gendarmerie en activité de service (art. 257 C. pr. pén., modif. L. 30 déc. 1985). Trente jours au moins avant l’ouverture de la session d’assises, le premier Président de la cour d’appel ou son délégué tire au sort en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de 35 jurés qui forment la liste de session. Il tire en outre les noms de 10 jurés suppléants. Sont remplacées les personnes qui auraient été frappées d’incapacité ou d’incompatibilité depuis l’établissement de la liste annuelle. Le préfet notifie à chacun des jurés de la liste de session et de la liste des jurés suppléants l’extrait de ladite liste le concernant, 15 jours au moins avant l’ouverture de la session (art. 267 C. pr. pén.). 431 431 432 – La fonction de juré est une véritable charge publique dont on ne peut en principe se dispenser. Les personnes dont les noms figurent sur la liste de session ont l’obligation de se présenter lors de l’ouverture de la session et au début de chaque affaire. On ne peut être dispensé que dans les cas spéciaux prévus à l’article 258 du Code de procédure pénale : pour « motif grave » ou si l’on est âgé de plus de 70 ans ou si l’on n’a pas sa résidence dans le département siège de la cour, ou si l’on a déjà exercé ces fonctions depuis moins de 5 ans. Les jurés touchent une indemnité destinée à compenser leurs frais de déplacement, mais non le manque à gagner résultant de leur absence au travail. 433 À l’ouverture de la session, il est procédé à la révision de la liste du jury de session : le greffier procède à l’appel des jurés composant la liste de session; tout juré qui sans motif légitime n’a pas déféré à la citation est condamné par la cour à une amende; la cour ordonne, le cas échéant, la radiation de la liste de session des jurés qui sont décédés ou qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude. Si en raison des absences ou des radiations, il reste moins de 20 jurés (ou 23 en appel), ce nombre est complété par des jurés suppléants. 434 Pour chacune des affaires inscrites à la session de la cour d’assises il est procédé au tirage au sort, en audience publique, de 6 noms (9 en appel) sur la liste du jury de session. Ces personnes vont constituer le jury de jugement et vont siéger aux côtés des 3 magistrats de la cour, pour composer avec eux la cour d’assises. La cour doit également, par arrêt, ordon- 432 43 43 288 Les juridictions répressives et leur compétence Les jurés sont de véritables assesseurs, qui se prononcent avec les magistrats sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine à lui appliquer (cependant, seule la Cour, au sens strict, décide des questions juridiques qui peuvent se présenter et statue sur les dommagesintérêts dus à la victime). 435 435 – 436 437 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 ner avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment des 6 (ou 9) jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et participent à la délibération en cas de défaillance d’un ou plusieurs jurés titulaires (art. 296 C. pr. pén.). À mesure que le nom d’un juré est tiré de l’urne, l’accusé ou son avocat ou le ministère public peuvent le récuser dans les conditions prévues aux articles 297 et suivants du Code de procédure pénale. L’accusé ne peut pas récuser plus de 4 jurés et le ministère public plus de 3, ces chiffres étant de 5 et de 4 en appel. Ils n’ont aucun motif à donner de ces récusations qui sont discrétionnaires (art. 297 C. pr. pén.). En cas de pluralité d’accusés, la défense se partage les 4 ou 5 récusations. Lorsque les noms de 6 jurés (9 en appel) non récusés ont été tirés, le jury de jugement est constitué (sauf à avoir effectué, le cas échéant, le tirage de jurés supplémentaires) et le président fait prêter serment aux jurés dans les termes de l’article 304 du Code de procédure pénale. L’institution du jury a été très discutée. Il existait depuis longtemps en Angleterre, comme une forme du jugement par les pairs que comportait la procédure féodale introduite par les Normands dans les Îles Britanniques après la conquête au XIe siècle. Le droit révolutionnaire l’a adopté en 1791 et les auteurs du Code d’instruction criminelle avaient beaucoup hésité sur son maintien. Le jury fut alors chargé, comme en Angleterre, de se prononcer uniquement sur la culpabilité de l’accusé, en répondant par oui ou par non à des questions précises, c’est ce que l’on appelle le verdict; ensuite, la Cour proprement dite tirait du verdict les conséquences légales et prononçait la peine. Le jury ne devait pas se préoccuper des suites de son verdict; en fait, il ne s’en est jamais désintéressé, n’hésitant pas à affirmer une non-culpabilité contraire à l’évidence afin d’éviter l’application d’une peine trop forte. Diverses réformes ont été tentées dans le siècle et demi qui a suivi, sans parvenir à un résultat entièrement satisfaisant. Une loi de 1932 avait décidé d’associer le jury à la Cour pour la délibération sur la peine; un acte dit loi de 1941 a associé à son tour la Cour au jury (dont le nombre était réduit de moitié) pour le verdict. Une ordonnance de 1945 a fixé à 7 le nombre de jurés, lequel a été élevé à 9 par le Code de procédure pénale (qui est revenu en outre au système de la minorité de faveur (V. infra, no 964) qui avait été utilisé à certaines époques); ces textes ont maintenu le système inauguré en 1941, dit « échevinage ». Parmi les avantages que l’on reconnaît à l’institution du jury, il y a d’abord son indépendance, notamment à l’égard du gouvernement. D’autre part, on fait valoir le risque de déformation professionnelle que les magistrats peuvent présenter tandis que le jury juge avec un esprit neuf. Enfin, composé de simples citoyens, le jury est une juridiction populaire; il se rapproche ainsi du peuple en qui réside la souveraineté et au nom de qui la justice est rendue. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement avait décidé de faire entrer des jurés pour le jugement des délits graves (art. 399-1 C. pr. pén.). 436 Parmi les inconvénients, on a fait valoir que les jurés n’ont pas la formation technique nécessaire pour être juges, et cet inconvénient a pris d’autant plus de poids que le rôle du jury est devenu plus important. De plus, la fraîcheur d’esprit a pour contrepartie une sensibilité exagérée qui porte volontiers le jury à des solutions extrêmes dans un sens ou 437 289 438 > 440 Le procès pénal, étude de la procédure pénale dans l’autre. Enfin, le jury, parfaitement indépendant à l’égard du gouvernement, l’est beaucoup moins à l’égard de l’opinion publique et se laisse influencer par une presse plus ou moins bien informée. Sans doute le fonctionnement du jury s’est-il montré peu satisfaisant puisque le législateur a correctionnalisé les infractions qu’il voulait soustraire à l’indulgence traditionnelle de la cour d’assises (avortement, faux en écritures privées ou de commerce), ou en a confié parfois le jugement à des juridictions d’exception (notamment aux tribunaux militaires) ou à des cours sans jurés (ainsi en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants). La méfiance dont la juridiction criminelle fait l’objet se manifeste surtout par la pratique de la correctionnalisation judiciaire (V. supra, no 62) dont l’initiative est prise par le ministère public, mais qui ne peut se réaliser qu’avec le consentement tacite de la personne poursuivie et celui exprès de la victime. En correctionnalisant un certain nombre d’agissements qualifiés crimes (certains vols, en particulier) et en les réprimant de lourdes peines d’emprisonnement, le législateur du 2 février 1981 a manifesté, une fois encore, sa méfiance envers le jury (encore qu’il soit possible de soutenir qu’il a entendu aligner les textes sur la pratique de la correctionnalisation judiciaire). L’élévation de la durée de l’emprisonnement applicable par le tribunal correctionnel depuis l’application du nouveau Code pénal devrait rendre la correctionnalisation judiciaire moins fréquente. international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – 438 La loi no 86-1020 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme, dispose que pour le jugement des majeurs accusés de l’une des infractions visées par l’article 70616 du Code de procédure pénale (infractions relevant du « terrorisme »), la cour d’assises est composée « conformément aux dispositions de l’article 698-6 », c’est-à-dire d’un président et de quatre magistrats assesseurs (six en appel), sans jury (art. 698-6 et 706-25 C. pr. pén. – V. infra, no 475). C’est la solution déjà retenue par la loi du 21 juillet 1982 pour certaines infractions militaires (art. 698-6) et pour les crimes contre les intérêts fondamentaux de la nation (art. 702). L’article 706-26 du Code de procédure pénale (L. no 92-1336, 16 déc. 1992) dispose que les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du nouveau Code pénal (trafic de stupéfiants), ainsi que le « délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions » sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions dérogatoires au droit commun des articles 706-27 à 706-33. Dans chaque ressort de cour d’appel, une ou plusieurs cours d’assises sont désignées, par décret, pour juger les crimes considérés et les infractions qui leur sont connexes; ces cours d’assises se composent d’un président et de quatre assesseurs (six en appel), statuant sans jury. 439 Pratiquement, ne sont portés devant la cour d’assises que les crimes très graves ou ceux que des raisons techniques ou des raisons d’opportunité ont empêché de correctionnaliser. L’institution du jury est profondément ancrée dans les traditions françaises, elle y a pris une valeur politique et sociale telle que sa suppression serait inconcevable. 438 439 B. Siège 440 Il y a une cour d’assises par département, ou plus exactement la Cour tient ses assises successivement dans chacun des départements du ressort de la cour d’appel et généralement au chef-lieu. La réorganisation de la région parisienne a prévu des cours d’assises à Nanterre pour les Hauts-de-Seine, à Paris et à Versailles, ainsi que dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de l’Essonne (L. du 5 juill. 1972). 40 290 Les juridictions répressives et leur compétence Dans le département où siège la cour d’appel, la cour d’assises se tient dans la même ville, même si ce n’est pas le chef-lieu du département; même en dehors de ce cas, elle se tient parfois dans une sous-préfecture. D’ailleurs l’article 235 du Code de procédure pénale permet toujours de réunir la cour d’assises hors de son siège habituel. (V. art. R. 41 C. pr. pén., mod. par décr. 14 févr. 2011). C. Sessions international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – Normalement, la cour d’assises ne siégeait que tous les 3 mois (art. 236 C. pr. pén.); elle ne tenait qu’une seule session par trimestre. Mais la loi du 10 août 2011 a assoupli la règle et des sessions peuvent être organisées chaque fois qu’il est nécessaire par le premier président de la Cour d’appel. 441 41 – S’il apparaît nécessaire de tenir une ou plusieurs sessions supplémentaires au cours du même trimestre (c’est l’hypothèse normale à Paris où les sessions ont lieu tous les 15 jours), ce sont les mêmes magistrats de la Cour et les mêmes jurés de session qui sont appelés par le premier président de la cour d’appel à siéger dans les affaires jugées au cours des sessions supplémentaires. D. Compétence d’attribution La cour d’assises est compétente pour juger les crimes, ainsi que les infractions connexes à un crime. 442 42 – Mais elle ne juge pas tous les crimes. Ceux commis par des mineurs de 16 à 18 ans sont portés devant la cour d’assises des mineurs (V. infra, no 467) et ceux commis par des mineurs de moins de 16 ans sont jugés par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (Ord. 2 févr. 1945, art. 20). E. Compétence territoriale 443 La cour d’assises connaît des affaires qui ont été valablement instruites dans les tribunaux de son ressort. Elle est saisie par une ordonnance du juge d’instruction (ou éventuellement un arrêt de la chambre de l’instruction) et ne peut pas discuter sa compétence (les critiques formulées sur ce point doivent s’exprimer par un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction). Au second degré, est compétente la cour d’assises désignée par la Cour de cassation, ou par le premier président de la Cour d’appel. 444 La loi no 86-1020 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme, dispose que la cour d’assises de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui découle du droit commun à l’endroit des infractions spécifiées à l’article 706-16 du Code de procédure pénale (V. art. 706-17 et s. C. pr. pén.). 43 44 § 445 6 Le tribunal criminel départemental Afin de permettre le jugement d’un plus grand nombre d’affaires criminelles et de limiter les délais d’audiencement, le projet de loi Justice 2018 prévoit d’instituer, à titre 45 291 446 > 446 Le procès pénal, étude de la procédure pénale § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 expérimental pour 3 ans à compter du 1er janvier 2019, un tribunal criminel départemental. Ce tribunal criminel départemental qui siègera au même lieu que la cour d’assises aura compétence pour juger les majeurs accusés d’un crime puni de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle, non commis en état de récidive et uniquement en premier ressort. Il connaîtra aussi des délits connexes. Le tribunal criminel comprendra un président et quatre assesseurs. Le président sera choisi par le premier président de la cour d’appel parmi les présidents de chambre et les conseillers de la cour. Quant aux assesseurs, choisis par le premier président de la cour, ils peuvent être des conseillers de la cour ou des juges du ressort, deux d’entre eux peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires. Lorsqu’une personne est accusée d’un crime entrant dans la compétence du tribunal, le juge d’instruction la renvoie devant le tribunal. En ce cas, le délai de maintien en détention est de 6 mois (au lieu d’un an) susceptible d’une seule prolongation. L’audiencement est fixé par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République. Le tribunal criminel applique, en principe, les dispositions des art. 281 à 380-15 du Code de procédure pénale. Toutefois, il n’est pas tenu compte des textes faisant mention du jury ou des jurés. Les attributions du président de la cour d’assises sont exercées par le président du tribunal, et celles confiées à la cour d’assises ou à la cour le sont par le tribunal criminel. Les dispositions des art. 254 à 257, 288 à 292, 293 al. 2 et 3, et 295 à 305 ne sont pas applicables. Les décisions des art. 359, 360 et 362 sont prises à la majorité. Le tribunal criminel délibère en étant en possession de l’entier dossier. Si, à l’issue des débats, il apparaît que le crime est puni de 30 ans de réclusion ou de la réclusion à perpétuité, le tribunal renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Les décisions de condamnation ou d’acquittement sont susceptibles d’appel, aux conditions de l’appel d’une décision de la cour d’appel. Les personnes déjà renvoyées devant la cour d’assises peuvent être renvoyées, sur accord et décision du premier président, devant le tribunal criminel. 7 La Cour de cassation Depuis sa réorganisation par les lois du 3 juillet 1967, 12 juillet 1978, 6 août 1981 et 25 juin 2001, la Cour de cassation est formée de six chambres, dont une chambre criminelle et cinq chambres civiles. La chambre criminelle comprend des conseillers titulaires et des conseillers référendaires, les uns et les autres ayant voix délibérative; comme les autres chambres, elle ne peut rendre des arrêts que si cinq membres au moins sont présents (L. du 6 août 1981). Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour de cassation, le premier avocat général ou les avocats généraux affectés à la chambre criminelle. 446 46 – Une affaire peut être jugée par une formation restreinte de trois magistrats, à la demande du premier président ou du président de la chambre criminelle. Cette formation peut déclarer non admis les pouvoirs irrecevables ou non fondés sur des moyens sérieux ou lorsque la solution du pourvoi s’impose 292 Les juridictions répressives et leur compétence (art. L. 131-6 COJ, L. du 25 juin 2001). En cas de saisine de cette formation restreinte, le renvoi à l’examen de la chambre peut être demandé par l’une des parties, et il est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande (ibidem). international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 Depuis la loi du 25 juin 2001, la Cour de cassation peut être sollicitée de donner son avis, au profit des juridictions pénales (à l’exception des cours d’assises, et hors le cas d’affaires où des personnes sont en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire), (art. L. 151-1 COJ). Le juge doit solliciter l’avis des parties et du ministère public, et ensuite formuler la question de droit qu’il soumet à la Cour de cassation. Celle-ci rend son avis dans les 3 mois. Il est transmis au juge demandeur et notifié aux parties, ainsi qu’au premier président de la cour d’appel et au procureur général de la cour d’appel, dans le ressort duquel se trouve le juge demandeur. Celui-ci n’est pas lié par l’avis de la Cour de cassation. Le rôle général de la Cour de cassation est de veiller à l’application des lois, aussi bien des lois de fond que des lois de forme. Mais elle ne connaît que des questions de droit, et non des questions de fait (V. infra, nos 1016 et s.), sauf dans le cas des demandes en révision. 447 47 – Les faits sont appréciés souverainement par les juridictions du fond et on ne peut plus contester devant la Cour de cassation les constatations de celles-ci. La Cour de cassation doit simplement rechercher si la juridiction qui a rendu la décision attaquée a bien tiré des faits qu’elle a constatés les conséquences juridiques imposées par la loi, si elle n’a pas commis d’erreur dans les déductions juridiques qu’elle a tirées de ces faits réputés certains et établis. – Ainsi, elle sera amenée à dire si certains faits doivent être qualifiés escroquerie ou abus de confiance, si d’autres faits constituent un commencement d’exécution ou entrent dans la définition des faits légalement constitutifs de complicité, elle éclairera le sens d’un texte obscur, etc. Ne discutant pas de la réalité des faits mais appréciant leur portée juridique, la Cour de cassation est ainsi amenée à assurer l’unité d’interprétation de la loi. Elle intervient également dans les questions de compétence (règlements de juges et dérogation aux règles normales de compétence pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, art. 657 à 667 C. pr. pén. ou pour autres causes). 448 48 – Elle est amenée aussi, depuis la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité a posteriori, à statuer sur l’opportunité d’une saisine du Conseil constitutionnel. – Une commission de trois magistrats de la Cour de cassation statue sur les recours des OPJ contre les mesures de retrait ou de suspension de l’habilitation à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire (art. 16-2 C. pr. pén.). section 4 Les juridictions d’exception 449 On appelle de la sorte les juridictions ayant une compétence d’attribution délimitée par la loi, eu égard, soit à la nature de certaines infractions, soit à la qualité de certains délinquants. Cette définition juridique est beaucoup plus large que l’acception retenue dans le langage courant, visant péjorativement les juridictions sinon politiques du moins 49 293 450 > 452 Le procès pénal, étude de la procédure pénale § international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 contingentes, instituées pour faire face à une situation exceptionnelle (la Libération ou la « guerre d’Algérie », par exemple). Les juridictions d’exception peuvent être regroupées en quatre catégories : Les juridictions pour mineurs • § 1 – Les juridictions militaires • § 2 – Les juridictions spécialisées en matière économique et financière • § 3 – enfin, Les autres juridictions d’exception • § 4. 1 Les juridictions pour mineurs Les juridictions chargées de juger les infractions commises par des mineurs (c’est-àdire des personnes qui n’avaient pas encore 18 ans au moment de leur acte) sont des juridictions d’exception. Il en résulte que leur compétence ne s’applique que dans la limite des textes précis qui leur ont attribué compétence, et que ceux-ci doivent être interprétés strictement. Elles ont été organisées par l’Ordonnance du 2 février 1945 modifiée à diverses reprises. Une nouvelle réforme de certaines de ses dispositions a fait l’objet des lois du 8 avril 1995 et du 9 septembre 2002. La loi du 10 août 2011 avait institué un tribunal correctionnel pour mineurs (à compter du 1er janv. 2012) concernant les mineurs âgés de plus de 16 ans, mais la loi du 18 novembre 2016 a abrogé ce texte. 450 450 A. Le juge des enfants Le juge des enfants peut être chargé tout d’abord (et c’est ce qui se produit le plus souvent) de faire la lumière sur l’infraction commise par le mineur, au moyen d’une sorte d’instruction. Sa situation est donc comparable, à ce point de vue, à celle du juge d’instruction (V. infra, nos 799 et s.), et il dispose des mêmes pouvoirs que celui-ci. Mais d’autre part, la loi a également, et surtout, chargé le juge des enfants de fonctions de jugement. Il peut même constituer à lui seul une juridiction, c’est pourquoi nous l’examinons ici. Il peut participer au jugement des affaires qu’il a instruites, par exception au principe de la séparation des fonctions. C’est que la justice pénale des mineurs se préoccupe avant tout de la personnalité du délinquant qu’il s’agit d’éduquer ou de rééduquer plus que de le punir. Aussi serait-il fâcheux d’écarter le juge des enfants de la juridiction chargée de choisir la mesure opportune, alors que l’instruction à laquelle il a procédé et les contacts qu’il a eus avec le mineur et avec sa famille lui ont donné, sur la situation, des lumières que personne ne possède au même degré. 451 451 – La Cour de cassation a jugé que cette prérogative exceptionnelle n’était contraire ni au principe de la séparation des fonctions ni à la Convention européenne des droits de l’Homme (Crim. 7 avr. 1993, D. 1993. 1. 559, note Pradel; adde Mme Lazerges, RSC 1994, et Huyette, ibid., p. 67). – Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé que cette prérogative contrevenait à l’impartialité du juge de jugement (décis. du 11 juill. 2011), si bien qu’un autre juge des enfants présidera le tribunal (L. 24 déc. 2011). 1° Statut du juge des enfants 452 Le juge des enfants est choisi, compte tenu de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance, et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance où se trouve 452 294 Les juridictions répressives et leur compétence le siège du tribunal pour enfants. Il est nommé en la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège. C’est donc un magistrat du siège délégué dans les fonctions de juge des enfants; il reçoit une formation professionnelle spécifique. Au siège de chaque tribunal pour enfants (V. infra, nos 458 et s.), il existe un ou plusieurs juges des enfants. Le tribunal pour enfants de Paris comporte un président et un vice-président choisis parmi les vice-présidents du tribunal de grande instance de Paris. En tant que juridiction, le juge des enfants exerce son activité avec l’assistance d’un représentant du ministère public (lui-même spécialisé) et celle d’un greffier du tribunal de grande instance. 2° Siège international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – La circonscription du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants. Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par décret. Il y a en général un tribunal pour enfants par département. 453 453 – Il est possible que certains départements comportant plusieurs tribunaux de grande instance n’aient qu’un seul tribunal pour enfants et par suite un seul juge pour enfants, qui siège alors dans le même lieu qu’un de ces tribunaux, généralement au chef-lieu. Il est possible aussi qu’un département important comprenne plusieurs tribunaux pour enfants et plusieurs juges des enfants; le siège coïncide toujours avec celui d’un tribunal de grande instance, mais le ressort territorial peut excéder celui de ce dernier. 3° Compétence d’attribution Le juge des enfants peut juger seul les délits et contraventions de 5e classe commis par des enfants de moins de 18 ans, mais seulement à la condition qu’il envisage d’appliquer comme sanctions non des peines mais seulement des mesures de rééducation pouvant comporter le placement du mineur dans un internat approprié ou une institution ou établissement public ou privé d’éducation. Si une sanction plus forte lui paraît nécessaire, il doit renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants. 454 454 – Ainsi, le partage de compétence entre le juge des enfants et le tribunal pour enfants est déterminé non pas par la nature ou la gravité légale de l’infraction commise, comme en droit commun, mais par la gravité de la sanction envisagée en fait. C’est la conséquence de l’abandon presque complet du système des peines dans le domaine de la délinquance juvénile (Ord. 2 févr. 1945, art. 2) et de l’adoption d’un système de mesures de rééducation. – Le juge des enfants est compétent pour remettre l’enfant à sa famille ou à une tierce personne, au besoin sous le régime de la liberté surveillée. Il est également compétent pour réviser la décision comportant une mesure de rééducation, du moment que le régime qu’il va substituer au précédent aurait pu être prononcé directement par lui (ainsi il peut rendre à ses parents un enfant qui avait été placé dans un établissement correctif par le tribunal pour enfants, et dont la conduite s’est améliorée). 4° Compétence territoriale Les règles de la compétence territoriale sont inspirées de celles qui s’appliquent au tribunal correctionnel. Le juge des enfants compétent est, soit celui dans la circonscription duquel (en principe le département) l’infraction a été commise, soit celui où se trouve la résidence du mineur, soit celui où son arrestation a été opérée. 455 45 – Pour la révision des mesures de rééducation, c’est en principe le juge des enfants qui a pris la mesure initiale qui est compétent, mais lorsque l’enfant a été placé très loin du juge ou du tribunal 295 456 > 458 Le procès pénal, étude de la procédure pénale international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 qui a pris la mesure initiale, celui-ci donne généralement une délégation de compétence au tribunal pour enfants et au juge des enfants du lieu de placement. – Lorsqu’il y a lieu de prendre des mesures provisoires d’urgence au sujet d’enfants qui ont quitté les lieux où ils avaient été placés, et qui ont été trouvés dans la circonscription d’un juge quelconque, ce juge a compétence pour prendre les mesures nécessaires en attendant qu’il soit statué sur la révision éventuelle de la mesure initiale ou sur les nouvelles mesures à prendre à la suite des nouvelles infractions que cet enfant a pu commettre. 5° Autres attributions du juge des enfants Le juge des enfants est également compétent pour s’occuper d’un certain nombre d’affaires non pénales mais qui concernent des mineurs et qui posent à peu près les mêmes problèmes. Tel est le cas des mineurs dits vagabonds, c’est-à-dire qui ont quitté le domicile de leurs parents ou des personnes chez qui ils avaient été placés; il en est ainsi également des mineurs abandonnés et des mineurs qui donnent à leur famille des sujets de mécontentement grave. En outre, en ce qui concerne les mineurs vivant dans un milieu familial défavorable, le juge des enfants peut ordonner, en pareil cas, des mesures d’assistance éducative, voire de surveillance éducative, et même procéder au placement de l’enfant. 456 456 – Le juge des enfants ne s’occupe donc pas seulement de l’enfance délinquante mais, d’une façon générale, de l’enfance inadaptée, de l’enfance malheureuse, des enfants en danger moral, etc. L’ordonnance no 58-1274 du 22 décembre 1958 a confirmé la tendance à centraliser entre les mains du juge des enfants tous les problèmes que pose l’inadaptation de la jeunesse en lui donnant compétence en matière d’assistance éducative (art. L. 252-2 COJ). B. Le tribunal pour enfants 1° Composition Le tribunal pour enfants comprend trois membres. Son président n’est autre qu’un juge des enfants (en ce qui concerne le tribunal pour enfants de Paris, v. supra, no 452). Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de 30 ans, de nationalité française et s’étant signalées tant par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance que par leur compétence (art. L. 251-4 COJ). 457 457 – Ils sont nommés pour 4 ans par arrêté du ministre de la Justice (celui-ci nomme des assesseurs titulaires et des suppléants) et prêtent serment avant d’entrer en fonction; celles-ci sont gratuites. Ils sont renouvelables par moitié et peuvent être déchus de leurs fonctions en cas de faute grave, ou être déclarés démissionnaires d’office par la première chambre de la cour d’appel s’ils s’abstiennent de déférer à plusieurs convocations successives. – Le ministère public est représenté par un substitut du procureur de la République spécialisé dans ces fonctions; le greffe est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. 2° Siège 458 Le tribunal pour enfants et le juge des enfants ont leur siège au même endroit (V. supra, no 453). Dans les tribunaux importants, il peut y avoir plusieurs juges des enfants mais un seul tribunal pour enfants. 458 296 Les juridictions répressives et leur compétence 3° Compétence d’attribution Elle porte, comme celle du juge des enfants, sur les contraventions de 5e classe et les délits commis par des mineurs de 18 ans, ainsi que sur les crimes commis par les mineurs de 16 ans. Le tribunal pour enfants a seul qualité pour prononcer, à l’occasion de ces infractions, une peine proprement dite (les peines restent exceptionnellement possibles à l’encontre des mineurs de plus de 13 ans, Ord. 2 févr. 1945, art. 2); il peut aussi, pour les mineurs de 10 ans au moins, prononcer l’une des sanctions éducatives de l’article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945; il sera donc nécessaire de le saisir quand une telle sanction sera envisagée. Le tribunal pour enfants conserve néanmoins une entière liberté d’appréciation et peut se contenter de mesures plus modérées telles que celles que le juge des enfants aurait pu prononcer lui-même. 459 – Comme le juge des enfants, le tribunal pour enfants est également compétent pour réviser les mesures de rééducation (mais non les peines) prononcées précédemment, aussi bien celles qu’il a prises lui-même que celles qui ont été prises par le juge (et qui pourront alors être remplacées par des mesures plus rigoureuses). 4° Compétence territoriale 460 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 459 Les règles en cette matière sont les mêmes qu’en ce qui concerne le juge des enfants. La délégation de compétence en vue d’une révision possible a lieu dans les mêmes conditions qu’au profit du juge des enfants : en pratique elle est prévue à la fois pour l’un et pour l’autre dans la limite de leur compétence d’attribution respective. 460 C. Le tribunal correctionnel pour mineurs 461 La loi du 10 août 2011 avait institué une juridiction particulière, le tribunal correctionnel pour mineurs, qui avait compétence pour juger les mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans et commis en état de récidive légale (art. 24-1 nouveau de l’Ord. du 2 févr. 1945). Cette juridiction a été abrogée par la loi du 18 novembre 2016. 461 D. La chambre spéciale de la cour d’appel 462 Il existe au sein de chaque cour d’appel une chambre spéciale chargée de connaître en appel des décisions prises par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Dans chaque cour également, un conseiller à la cour d’appel est désigné pour une durée de 3 années renouvelable; il porte le titre de « délégué à la protection de l’enfance ». 462 1° Composition 463 La chambre spéciale de la cour d’appel comprend trois membres. Le conseiller délégué à la protection de l’enfance préside cette chambre ou y remplit les fonctions de rapporteur. Les autres membres sont des magistrats professionnels appartenant à la cour d’appel, président de chambre ou conseillers. 463 297 464 > 468 Le procès pénal, étude de la procédure pénale Un magistrat du parquet général, désigné par le procureur général, est spécialement chargé des affaires de mineurs et remplit dans ces affaires toutes les fonctions du ministère public au cours de la procédure devant le second degré de juridiction. Le greffe est assuré par un greffier de la cour d’appel. – Pour le jugement des appels concernant des affaires jugées par le tribunal correctionnel pour mineurs, des citoyens assesseurs devront être présents. 2° Siège 464 46 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – La chambre spéciale de la cour d’appel siège au même lieu que la cour d’appel. 3° Compétence d’attribution La chambre spéciale de la cour d’appel constitue le deuxième degré de juridiction pour les affaires jugées par les juges des enfants et par les tribunaux pour enfants. 465 465 – Sa compétence d’attribution est donc la même que celle de ces juridictions (contraventions de 5e classe et délits commis par les mineurs de 18 ans, crimes commis par les mineurs de 16 ans, révision des mesures de rééducation prononcées contre ces délinquants). Elle connaît aussi en appel des décisions non pénales de ces juridictions spéciales (enfance en danger moral). 4° Compétence territoriale La chambre spéciale connaît des appels dirigés contre les décisions des juges pour enfants ou tribunaux pour enfants dont le siège se trouve dans la circonscription territoriale de la cour d’appel. 466 46 E. La cour d’assises des mineurs 1° Composition La cour d’assises des mineurs comprend, comme la cour d’assises ordinaire, deux éléments : 3 magistrats professionnels composant la cour et 6 jurés au premier degré (9 en appel). 467 467 – Les jurés sont désignés de la même façon et sur la même liste que les jurés de la cour d’assises ordinaire. Il en est de même du président qui n’est autre d’ailleurs que celui qui préside la session de la cour d’assises à la suite de laquelle se réunit la cour d’assises des mineurs. Par contre, les deux assesseurs du président sont choisis, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel (Ord. 2 févr. 1945, art. 20, al. 2 modifié par Ord. no 58-1300 du 23 déc. 1958). – Les fonctions de ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs (art. 20, al. 4). C’est le greffier de la cour d’assises ordinaire qui exerce les fonctions de greffier (art. 20, al. 5). 2° Siège 468 La cour d’assises des mineurs siège, dans chaque département, au même lieu et à la même époque que la cour d’assises ordinaire. Elle siège dès que la session de la cour d’assises ordinaire a pris fin. 468 298 Les juridictions répressives et leur compétence 3° Compétence d’attribution La cour d’assises des mineurs juge les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que les infractions connexes. 469 469 Si un crime a réuni à la fois de tels mineurs et des majeurs, le cas du mineur est disjoint et il comparaît devant la cour d’assises des mineurs tandis que les coparticipants sont renvoyés devant la cour d’assises ordinaire. Cependant, s’il apparaît indispensable de ne pas diviser les poursuites et de faire comparaître tous les accusés devant la même juridiction, c’est la cour d’assises des mineurs qui devra être saisie et qui sera compétente à l’égard de tous (Ord. 2 févr. 1945, art. 9). – À la différence des juridictions précédentes, la cour d’assises des mineurs n’est pas compétente pour réviser les mesures de rééducation qu’elle a ordonnées, cette révision est du ressort du juge des enfants ou du tribunal pour enfants selon les modifications à apporter. 4° Compétence territoriale 470 La compétence territoriale est déterminée selon les mêmes règles que pour la cour d’assises ordinaire (V. supra, no 443). 470 § 2 Les juridictions militaires A. Vue d’ensemble 471 472 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 – La loi no 82-621 du 21 juillet 1982, relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’État, a modifié le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire, en supprimant les tribunaux permanents des forces armées compétents, en temps de paix, pour connaître des infractions purement militaires (refus d’obéissance, insoumission, abandon de poste, etc.), ainsi que des infractions de droit commun commises par des militaires soit dans le service, soit dans les établissements militaires, soit chez l’hôte. Désormais, dans le ressort de chaque cour, une formation spécialisée d’un tribunal de grande instance est chargée d’instruire et de juger les délits et une cour d’assises les crimes qui étaient de la compétence des tribunaux permanents des forces armées. Les tribunaux militaires sont immédiatement rétablis en temps de guerre. 471 On évoquera successivement : le tribunal correctionnel spécialisé en matière militaire (B) – la cour d’assises spécialisée en matière militaire (C) – les juridictions militaires proprement dites (D). 472 B. Le tribunal correctionnel spécialisé en matière militaire 473 L’article 697 du Code de procédure pénale (L. 21 juillet 1982) énonce : « Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l’article 697-1 ». Selon l’article 697-1, ce tribunal est compétent pour juger : les infractions militaires proprement dites (insoumission, désertion, insubordination, etc. : v. CJM) – les délits de droit 473 299 474 > 476 Le procès pénal, étude de la procédure pénale 474 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:889212088:88866209:196.200.176.177:1593001122 commun commis dans l’exécution du service par les militaires (le tribunal est compétent pour juger toutes personnes majeures coauteurs ou complices). Il est également compétent – en temps de paix – pour juger les auteurs de tous les délits réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal (atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, telles les atteintes à la défense nationale) ou les infractions connexes (art. 702 C. pr. pén., modif. L. 16 déc. 1992). Des magistrats sont affectés spécialement à cette « formation de jugement » spécialisée (art. 697 C. pr. pén.). Les infractions sont instruites et jugées selon les règles du droit commun sous les importantes réserves ci-après : 1° sans préjudice de l’application de l’article 36 du Code de procédure pénale (qui permet au procureur général d’enjoindre le procureur de la République d’engager des poursuites), l’action publique est « mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la Défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui » (art. 698-1 C. pr. pén.); 2° à défaut de cette dénonciation, le procureur « doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou délit flagrant, l’avis du ministre chargé de la Défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui » (ibid.); 3° la partie lésée peut désormais mettre en mouvement l’action publique (art. 698-2 C. pr. pén.); 4° lorsque les magistrats ou les officiers de police judiciaire sont amenés, soit pour faire des constatations, soit pour effectuer des perquisitions ou arrestations, à pénétrer dans les établissements militaires, ils doivent, à cet effet, adresser à l’autorité militaire une réquisition (art. 698-3 C. pr. pén.). 47 C. La cour d’assises spécialisée en matière militaire 475 L’article 697 du Code de procédure pénale (L. 21 juill. 1982) dispose que dans le ressort de chaque cour d’appel « une cour d’assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 697-1 ». En d’autres termes, cette juridiction connaît des crimes militaires proprement dits ainsi que des crimes de droit commun commis dans l’exécution du service par des militaires (la cour est compétente pour juger toutes personnes majeures, coauteurs ou complices). Elle est également compétente pour juger les auteurs de tous les crimes contre les intérêts fondamentaux de la nation commis en temps de paix, ainsi que les infractions connexes (art. 702 C. pr. pén.). On remarquera que cette cour d’assises est unique pour le ressort de la cour d’appel, il n’y en a pas une par département. 476 Ces crimes sont instruits et jugés selon les règles de droit commun, sous les importantes réserves ci-après : 1° l’action publique est mise en mouvement selon les modalités prévues par l’article 698-1 du Code de procédure pénale (dénonciation de l’autorité militaire ou, à défaut, avis de celle-ci, sollicité par le procureur, sauf cas de flagrance : v. supra, no 474); 2° la partie lésée peut mettre en mouvement l’action publique depuis la loi du 10 novembre 1999 (art. 698-2 C. pr. pén.); 3° lorsque les magistrats ou enquêteurs veulent pénétrer, aux fins de constatation de perquisition ou d’arrestation, dans un établissement militaire, ils 475 476 300 Les juridictions répressives et leur compétence international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1443000885:88866209:196.200.176.177:1593002003 doivent, à cet effet, adresser à l’autorité militaire une réquisition (art. 698-3 C. pr. pén.); 4° la cour d’assises est composée d’un président et de quatre assesseurs (tous magistrats civils) au premier degré et de six assesseurs en appel; elle ne comporte pas de jury (sauf pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires lorsqu’il n’existe pas de risque de divulgation d’un secret de la défense nationale : art. 698-7 C. pr. pén.). D. Les juridictions militaires proprement dites La justice militaire « est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation : en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République par le tribunal aux armées, et en cas d’appel, par la cour d’appel compétente, – en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées » (art. L. 1er CJM). En outre, « des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code » (ibid.). 477 47 478 – En temps de paix, ce sont les juridictions spécialisées en matière militaire qui sont compétentes. Depuis la loi du 14 décembre 2011, les juridictions spécialisées en matière militaire de Paris connaissent des infractions militaires commises hors du territoire de la République. 479 – En temps de guerre, des tribunaux territoriaux des forces armées sont établis sur le territoire de la République. Ils comportent alors des magistrats civils et militaires (art. L. 112-5 CJM). En outre, des « tribunaux militaires aux armées » peuvent être constitués lorsque les armées « stationnent ou opèrent hors le territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci » (art. L. 112-27 CJM). Ils sont composés, outre d’un magistrat, de « militaires blessés au feu ou appartenant aux forces combattantes » désignés conformément aux dispositions du Code de justice militaire (art. L. 112-30 et s. CJM). 480 – Les tribunaux prévôtaux (constitués par la gendarmerie en temps de paix, uniquement hors le territoire de la République et si des tribunaux militaires aux armées sont établis) connaissent des « infractions de police » mineures (art. L. 421-1 et s. CJM). 478 479 480 § 481 3 Les juridictions spécialisées en matière économique et financière La loi du 6 août 1975 a inséré dans le Code de procédure pénale les articles 704 à 706-2, qui traitent « De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière ». Le législateur a estimé que lorsque de telles affaires sont ou apparaissent d’une grande complexité, il est préférable que l’instruction et le jugement soient confiés à des magistrats spécialisés. Les dispositions actuelles sont les suivantes : 1° dans les affaires de grande complexité (en raison du nombre d’auteurs, de complices ou victimes) la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel, pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement. 2° la liste de ces infractions a été « étendue » (V. art. 704 C. pr. pén., modif. L. 1er févr. 1994, 481 301 482 > 484 Le procès pénal, étude de la procédure pénale – international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1443000885:88866209:196.200.176.177:1593002003 13 mai 1996, L. 30 juin 2000 et 6 déc. 2013); sont cités : l’escroquerie simple ou aggravée, le trafic d’influence, l’abus de confiance simple ou aggravé, le « blanchiment d’argent sale », les délits prévus par le Code de commerce, ceux définis par le Code monétaire et financier, par le Code de la construction et de l’habitation, par le Code de la propriété intellectuelle, par le Code des douanes, par le Code de l’urbanisme, par le Code de la consommation, délits prévus par la loi du 1er août 1986 sur le régime juridique de la presse, ou en matière de jeux de hasard, etc. 3° À l’endroit de ces infractions, le procureur de la République, le juge d’instruction ainsi que la formation correctionnelle spécialisée (pour cette dernière en ce qui concerne le jugement s’il s’agit de délits) exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des dispositions du droit commun; le procureur de la République et le juge d’instruction considérés exercent en l’occurrence leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel (art. 704-1). Le procureur de la République d’un tribunal autre que le tribunal spécialisé peut solliciter le juge d’instruction de se dessaisir (art. 704-2 C. pr. pén., un recours est possible). – La liste des tribunaux ainsi habilités résulte du décret du 16 sept. 2004, il n’y a qu’un seul tribunal compétent par cour d’appel. – La juridiction saisie reste compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. – La loi du 6 août 2003 de sécurité financière avait prévu que les délits d’initiés (art. L. 465-1 et 2 C. mon. et fin.) seraient de la compétence exclusive de la juridiction spécialisée de Paris (art. 704-1 C. pr. pén.). Depuis la loi du 6 décembre 2013, cette compétence (nationale) relève du procureur financier et des juridictions d’instruction et de jugement de Paris (art. 705-1 C. pr. pén.). – En matière de criminalité organisée, la loi du 9 mars 2004 a prévu des juridictions spécialisées dont la compétence pourrait excéder le ressort d’une cour d’appel (art. 706-75 C. pr. pén.). L’article D. 47-13 C. pr. pén. a retenu huit juridictions spécialisées. 482 En matière sanitaire, la loi du 4 mars 2002 a institué des juridictions spécialisées (art. 706-2 et D. 47-5 C. pr. pén.). La loi du 9 mars 2004 a également mis en place des juridictions spécialisées en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires (art. 706-107 C. pr. pén. et art. D. 47-13-1). 482 § 4 Les autres juridictions d’exception 483 Les juridictions examinées ci-dessus, quoiqu’ayant un caractère exceptionnel, fonctionnent de façon régulière et durable. Il en est de même de certaines autres qui ne seront pas étudiées ici, tels que les tribunaux maritimes commerciaux qui jugent les infractions prévues par la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Les juridictions, suite à une décision du Conseil constitutionnel du 2 juillet 2010 (JO du 3 juill. 2010) ont été composées comme les tribunaux correctionnels. Depuis le 1er janvier 2015, le tribunal maritime comprend 3 magistrats professionnels et 2 assesseurs maritimes (ord. 2 nov. 2012, art. 2). 484 D’autres juridictions d’exception, quoiqu’ayant en principe un caractère durable, n’ont l’occasion de fonctionner qu’en certaines circonstances. Tel était le cas de la Haute 483 48 302 Les juridictions répressives et leur compétence international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1443000885:88866209:196.200.176.177:1593002003 Cour de justice, à qui les articles 67 et 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 avaient confié le jugement du président de la République qui « n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison » (art. 68 V. Assemblée plénière du 10 octobre 2001, D. 2001, p. 3021, selon lequel la Haute Cour n’était compétente que pour les actes de haute trahison du président, et commis dans l’exercice de ses fonctions). La loi constitutionnelle du 23 février 2007 a substitué un régime de destitution à la responsabilité; une fois destitué, le président peut relever des juridictions de droit commun. Quant à la Cour de justice de la République, créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958, ajoutant à celle-ci un titre traitant « De la responsabilité pénale des membres du gouvernement », elle a compétence pour juger les actes accomplis par ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Une loi organique du 23 novembre 1993 précise l’organisation de cette juridiction ainsi que la procédure applicable en l’occurrence. 485 485 – Comprenant 15 juges dont 12 parlementaires (élus en leur sein et en nombre égal par l’Assemblée nationale et le Sénat) et 3 magistrats du siège de la Cour de cassation (l’un d’eux présidant la Cour de justice), le ministère public étant représenté par le procureur général près de la Cour de cassation (assisté du premier avocat général et de deux avocats généraux), cette juridiction d’exception, comporte une « commission d’instruction », composée de 3 titulaires et de 3 suppléants désignés parmi les magistrats de la Cour de cassation, ainsi qu’une « commission des requêtes ». La plainte devant viser nominativement un membre du gouvernement peut être déposée auprès de la commission des requêtes; aucune constitution de partie civile n’est recevable; l’action en réparation des dommages doit être portée devant la juridiction de droit commun. La commission des requêtes, qui peut faire procéder à toutes investigations utiles, apprécie la suite à donner; elle peut classer ou transmettre la procédure au procureur général près la Cour de cassation (en qualifiant pénalement les faits dénoncés). Dans cette seconde hypothèse, la commission d’instruction procède à une information et, s’il échet, saisit par arrêt la Cour de justice de la République. 486 – Enfin certaines juridictions d’exception étaient apparues comme doublement exceptionnelles car elles avaient été instituées de façon temporaire, pour faire face à une crise déterminée et avec l’intention non dissimulée d’obtenir une répression plus forte que si l’affaire était portée devant ses juges naturels. Tous les régimes ont connu de telles juridictions en période de crise grave : Second Empire et débuts de la IIIe République (tribunaux spéciaux), régime de Vichy, (tribunal d’État, Sections spéciales des tribunaux militaires ou des cours d’appel), gouvernement de la Libération (Cours de justice), Ve République (Haut tribunal militaire créé par décision présidentielle du 27 avril 1961 et dissous le 26 mai 1962; tribunal militaire spécial créé par décision présidentielle du 3 mai 1961; Cour de justice militaire instituée le 1er juin 1962, et dont l’illégalité a été affirmée par arrêt du Conseil d’État le 19 octobre 1962; Cour de sûreté de l’État enfin, créée par les lois no 63-22 et 63-23 du 15 janvier 1963 et supprimée par la loi du 4 août 1981). 486 303 Chapitre 2 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1443000885:88866209:196.200.176.177:1593002003 L’essentiel Les juridictions répressives Il existe des principes généraux relatifs à l’organisation judiciaire qu’il convient de mentionner, avant de procéder à la description des différentes juridictions. 1. Les principes généraux Cinq principes peuvent être dégagés. En premier lieu, il y a une unité entre la justice civile et la justice pénale. Les juges répressifs sont des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peuvent juger des affaires civiles ou des affaires pénales. Dans les grandes juridictions, il existe cependant des formations spécialisées (par exemple en matière économique ou financière, ou en matière sanitaire). En deuxième lieu, il existe une séparation des fonctions : poursuivre, instruire puis juger ne peut être confié à la même personne. En particulier, le jugement doit être le fait d’un magistrat impartial et indépendant. En troisième lieu, pour les affaires graves (jugement des délits et des crimes), la règle est la collégialité des juridictions. En matière d’instruction, la collégialité peut être réalisée par une cosaisine. En quatrième lieu, pour assurer une bonne justice, le principe est le double degré de juridiction, admis, tardivement (en juin 2000), en matière criminelle. Enfin, les juridictions sont permanentes, en ce sens qu’elles ne sont pas mises en place, en raison de tel événement. Les juridictions comportent des magistrats, fonctionnaires dotés d’un statut particulier. Toutefois, les cours d’assises et le tribunal pour enfants disposent de jurés ou d’assesseurs non professionnels. 2. Les différentes juridictions a) Les juridictions d’instruction sont chargées de l’enquête judiciaire et de trancher les incidents contentieux qui se présentent. Ce sont le juge d’instruction et la chambre de l’instruction. b) Les juridictions de jugement de droit commun pour les adultes sont le tribunal de police, comprenant un seul magistrat qui a compétence pour les contraventions, commises dans son ressort territorial ou dont le prévenu réside dans son ressort. – Le tribunal correctionnel peut être à juge unique (art. 398-1 C. pr. pén.) ou à formation collégiale de trois juges. C’est une formation du tribunal de grande instance qui connaît des délits (infractions 304 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1443000885:88866209:196.200.176.177:1593002003 punissables de 2 mois à 10 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende d’au moins 3 750 euros). Sa compétence territoriale dépend du lieu de commission de l’infraction, du lieu de résidence du prévenu ou du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier. – Pour le jugement des délits de violence de l’article 399-2 du Code de procédure pénale le tribunal devait comprendre, en outre, deux citoyens assesseurs. Cette expérience a pris fin. – La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel comprend trois magistrats. Elle connaît des appels des décisions des tribunaux de police, des juges de proximité et des tribunaux correctionnels, rendues dans le ressort de la Cour. – La cour d’assises connaît des crimes. Elle comprend trois magistrats (dont au moins un membre de la cour d’appel) et 6 citoyens (au 1er degré); 9 en appel. Ces citoyens sont tirés au sort à partir de la liste de session, elle-même issue de la liste annuelle établie à partir des listes électorales. Le jury est une institution populaire et indépendante qui décide au vu des éléments de preuve discutés contradictoirement devant la Cour. Toutefois, pour le jugement des infractions de terrorisme, de certaines infractions militaires et de certaines atteintes contre les intérêts fondamentaux de la Nation, la cour d’assises ne comprend que cinq magistrats (et sept en appel). La cour d’assises connaît des crimes et des délits connexes, qui ont donné lieu à une instruction dans le ressort territorial (département) de la cour d’assises. À titre expérimental, un tribunal criminel départemental jugera les crimes punissables de 15 ou 20 ans de réclusion, commis par des majeurs. – La cour de cassation veille à la bonne application des lois de fond et de forme. Elle statue uniquement en droit sur toutes les questions tranchées par les cours d’appel (chambre des appels correctionnels, cours d’assises d’appel, chambre de l’instruction). c) Les juridictions d’exception ont une compétence d’attribution délimitée pour connaître des infractions commises par certains délinquants, ou relevant de certaines matières. S’agissant des personnes, existent des juridictions pour mineurs : juges des enfants pouvant instruire et juger en prévoyant des mesures éducatives pour des délits commis par des mineurs de 18 ans; tribunal pour enfants comprenant outre un juge des enfants, président, deux assesseurs nommés pour 4 ans parmi les personnes s’intéressant aux questions de l’enfance. Cette formation connaît des délits commis par des mineurs de 18 ans, et des crimes commis par des mineurs de 16 ans. Quant à la cour d’assises des mineurs, elle connaît des crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans, elle comprend un président, 2 juges des enfants et 6 (ou 9, en appel) jurés. En ce qui concerne les militaires, un tribunal correctionnel par ressort de cour d’appel connaît de certaines infractions définies par le Code de justice militaire et certaines atteintes à la défense nationale. Pour les crimes, la cour d’assises est composée uniquement de magistrats (5 au premier degré et 7 en appel). Hors du territoire de la République, les infractions relèvent des juridictions spécialisées en matière militaire de Paris. Et, en temps de guerre seraient établis des tribunaux territoriaux des forces armées. Quant aux ministres, ils relèvent, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, de la compétence de la Cour de justice de la République. Pour le jugement de certaines affaires, le législateur a institué des juridictions spécialisées en matière économique et financière (art. 704 C. pr. pén.), des juridictions spécialisées en matière sanitaire ou de pollutions des eaux maritimes. 305 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1443000885:88866209:196.200.176.177:1593002003 Sujets de concours Chapitre 2 Officier de police, concours externe, 2015 À quel modèle la procédure pénale française se rattache-t-elle ? Greffier, 2001 (externe) Les cours d’assises Sous-directeur de l’Administration pénitentiaire, 1994 (externe et interne) La cour d’assises 306 3 international.scholarvox.com:ENCG Marrakech:1443000885:88866209:196.200.176.177:1593002003 chapitre La preuve dans le procès pénal 487 Tout le procès pénal est dominé par le problème de la preuve (V. supra, nos 11, 42). Il en est ainsi depuis la plus haute antiquité; toutes les civilisations ont été embarrassées par les dénégations de présumés coupables et se sont efforcées d’échapper au dilemme de l’erreur judiciaire éventuelle ou de l’impuissance de la justice. Pendant longtemps, elles n’ont eu d’autre issue que le recours à une manifestation surnaturelle (ordalies, jugement de Dieu); déjà le serment imposé aux parties et la présence de cojureurs s’expliquaient par l’idée que la crainte du sacrilège faciliterait la découverte de la vérité. D’autres législations s’en remettaient à la force, en souhaitant que la divinité vienne au secours du bon droit, et organisaient un duel judiciaire entre l’accusateur (ou son champion) et l’accusé; ce système était courant sous la procédure féodale et donna lieu à de no