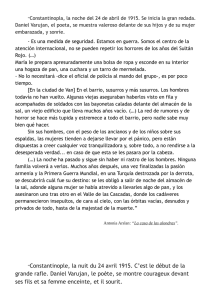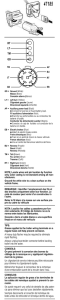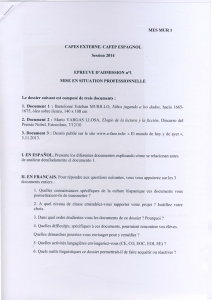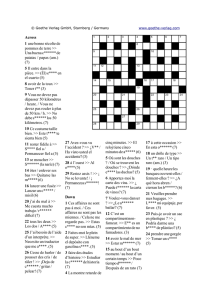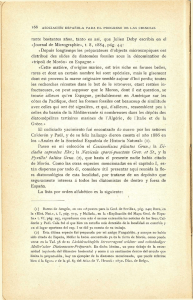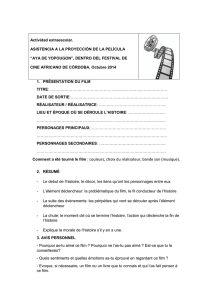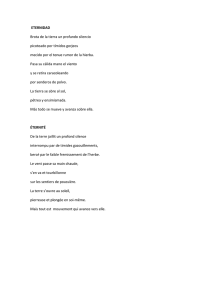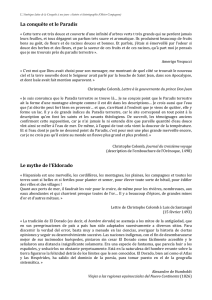Études sur le tragique
Anuncio

ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE Études sur le tragique dans le théâtre espagnol du XXe siècle (Valle-Inclán, Alberti, Lorca) Études coordonnées par Évelyne RICCI CREC (Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3) Centre Interlangues EA 4182 (Université de Bourgogne) ISSN 1773-0023 1 2 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Études sur le tragique dans le théâtre espagnol du XXe siècle (Valle-Inclán, Alberti, Lorca) Études coordonnées par Évelyne RICCI CREC (Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3) Centre Interlangues EA 4182 (Université de Bourgogne) Illustration de couverture : Desnudo surrealista, Maruja Mallo (1927) Mars 2009 ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 3 SOMMAIRE PRÉSENTATION ..................................................................................................................4 Serge SALAÜN, Vers une Poétique du théâtre (Valle-Inclán, Alberti, Lorca) ......................10 Évelyne RICCI, La poétique des seuils : vers un nouveau tragique (Analyse des espaces liminaires dans le théâtre de Valle-Inclán, Alberti et Lorca).................................................26 Jean-Marie LAVAUD, Luces de bohemia, la « tragedia nueva » de Ramón del Valle-Inclán .............................................................................................................................................45 Zoraida CARANDELL, La transcendance en question ou le tragique au croisement des genres dans El hombre deshabitado de Rafael Alberti. ........................................................58 Jacqueline SABBAH, Utilisation et subversion du triptyque dans El hombre deshabitado de Rafael Alberti .......................................................................................................................74 Emilio PERAL VEGA, Metamorfosis de lo trágico en García Lorca ...................................94 ISSN 1773-0023 4 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) PRESENTATION Le volume qui est présenté ici est né de la rencontre de chercheurs français et espagnols, réunis sous l'égide du Centre Interlangues EA 4182, de l'Université de Bourgogne, et du CREC, le Centre de Recherche sur l'Espagne Contemporaine, de l'Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Ces Etudes sur le tragique ont pour objet trois œuvres majeures du théâtre espagnol du XXe siècle, Luces de Bohemia de Ramón del Valle-Inclán, El hombre deshabitado de Rafael Alberti et La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, toutes trois au programme de l'Agrégation externe d'espagnol. Leurs analyses ne prétendent pas être d'énièmes contributions sur des textes qui sont depuis des années, à l'exception de la pièce albertienne qui n'a jamais bénéficié de la même attention, l'objet de fréquentes études de la part de la critique. La règle du jeu qui a été imposée à chacun était quelque peu différente : c'est sous un angle précis que ces pièces devaient être analysées, celui du tragique, question complexe s'il en est. Il était demandé à tous de réfléchir à la manière dont ces pièces revisitent le tragique, à la mise en scène originale qu'elles en proposent. Les stratégies d'adaptation et de réécriture du tragique sont différentes et propres à chacun des dramaturges ; elles témoignent, néanmoins, d'une préoccupation commune qui mêle deux exigences complémentaires, l'une métaphysique, la seconde esthétique. Si le tragique révèle d'abord une inquiétude de type philosophique (qu'estce que l'homme ?), il ne cesse pourtant jamais d'être un problème d'esthétique et de théâtre, qui a longtemps trouvé dans le modèle théâtral de la tragédie un réceptacle de choix. Que cette question du tragique réapparaisse à la fin du XIXe dans le théâtre européen après une éclipse de plusieurs siècles (ceux qui séparent la naissance de la tragédie shakespearienne sur les planches anglaises au XVIe siècle et son renouveau sur la scène racinienne, en France, au XVIIe, de Nietzsche et de l'éclosion du Symbolisme en Europe près de deux cents ans plus ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 5 tard), est le signe que de nouvelles inquiétudes naissent à cette période sur l'Homme, mais qu'elles ne peuvent plus désormais s'exprimer dans le cadre de la tragédie classique, impuissante à rendre compte des affres inédites dans lesquelles la modernité a plongé l'humain. Un nouveau tragique est, dès lors, à réinventer, un tragique qui s'inscrit dans la continuité d'un modèle philosophique et esthétique classique, tout en s'en démarquant. Parler de « retour du tragique », c'est rendre compte de ce double mouvement paradoxal de permanence et de rupture. (Ré)apparu dans le théâtre symboliste à la fin du XIXe siècle, avant d'être repris dans le théâtre espagnol au début des années 20, ce nouveau tragique trouve chez Valle-Inclán, chez Alberti et Lorca un cadre d'expression original, qui allie modernité et inventivité. Entre 1920, date de la première publication de Luces de Bohemia dans la revue España, et 1936, année où Lorca termine la composition de La casa de Bernarda Alba, les trois dramaturges revisitent le modèle de la tragédie, un genre désormais incapable de rendre compte de la crise de l'Homme, mais qui leur offre, pourtant, la possibilité de résoudre une autre crise, celle du théâtre. Monopolisé en Espagne, depuis des années, par le modèle du théâtre commercial et léger, il n'est plus qu'un simple objet de divertissement, plaisant et frivole, sans la moindre inquiétude ni esthétique, ni encore moins philosophique (il n'est, pour s'en convaincre, que de songer aux comédies affables des frères Álvarez Quintero, qui ne sont pourtant pas ce que la scène espagnole produit de plus inconsistant, même si Valle-Inclán proposait de les fusiller pour rénover le théâtre…) À trop tourner sur elle-même, la mécanique du théâtre s'est enrayée, d'autant qu'elle ne s'est pas davantage préoccupée de considérations esthétiques qui auraient pu lui permettre de trouver sur scène une nouveau souffle. La rénovation du théâtre ne peut se faire qu'au prix de cette double exigence : une réflexion sur son contenu — qui, seule, peut lui redonner la dignité et la consistance qui lui font défaut — et une préoccupation formelle — qui ne peut que passer par la redécouverte de la scène et par une rethéâtralisation indispensables à son renouveau. Le tragique répond à cette double nécessité : non seulement, il met l'Homme et ses angoisses au centre de ses inquiétudes (alors que le théâtre commercial ne s'intéresse plus qu'aux péripéties sans substance de ses personnages de carton-pâte), mais, inspiré du modèle de la tragédie, il ISSN 1773-0023 6 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) permet de doter cette réflexion d'un tremplin décisif, celui de la scène et de l'art. La quête métaphysique se double là d'une quête esthétique qui lui donne toute sa force. Les pièces de Valle-Inclán, d'Alberti et de Lorca répondent à cette double exigence, comme chacun des auteurs des six articles qui sont réunis ici en apporte la preuve. Dans les trois œuvres, la réflexion sur l'Homme est portée par un souffle esthétique d'une intense créativité qui est la grande valeur de ce théâtre. Le nouveau tragique qui jaillit sous leur plume est, pourtant, loin de présenter un visage unique : si l'aspiration des trois dramaturges est semblable, les stratégies de chacun et leurs réalisations sont différentes, preuve que le tragique qui renaît en Espagne dans les années 20 et 30 a plus à voir avec une quête, avec tout ce que cela implique de tâtonnements et de recherche, qu'avec un projet clairement défini ou définitif. C'est dire aussi combien cette aspiration est complexe et ardue pour ces auteurs, obligés de maintenir un équilibre, parfois instable, entre des modèles et des références contradictoires (le tragique, le grotesque, le drame, la farce, le modèle de l'auto sacré…). Mais c'est, surtout, le signe de la complexité d'une époque et d'un art qui refusent désormais les réponses dogmatiques et univoques, obligeant les créateurs à rendre compte avec des outils nouveaux de cette crise de l'Homme et du monde. L'art est leur réponse, la seule possible alors (dès juin 1931, date de la première de Fermín Galán, Alberti explorera une autre voie, celle de l'engagement politique, mais il n'en est pas encore là en 1929-1930). Cette quête tragique est aussi celle d'un nouveau théâtre à inventer, un théâtre d'avant-garde, qui se construit à la confluence des tendances les plus modernes de l'art européen, le Symbolisme (qui renaît à la fin des années 20 en Espagne, dans le théâtre de Lorca en particulier), l'Expressionnisme (dont Valle-Inclán et Alberti proposent, chacun à leur manière, des traductions différentes), sans oublier, bien sûr, les autres modèles artistiques dont ValleInclán, Alberti et Lorca ne cessent de s'inspirer (le cubisme, le surréalisme surtout…). Ces hommes de théâtre (auteurs, ils sont aussi à l'occasion metteurs en scène ou acteurs) sont des artistes complets : la poésie, le roman (Valle-Inclán surtout) les inspirent, mais aussi la peinture (Alberti et Lorca peignent et dessinent eux-mêmes, alors que Valle est un fin connaisseur de la peinture moderne), sans oublier ce genre nouveau qu'est le cinéma et qui ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 7 nourrit toute leur œuvre (on s'en convaincra facilement en analysant, par exemple, la superposition des différents plans qui structurent les scènes dans Luces de Bohemia, les jeux de caméra que l'on retrouve dans La casa de Bernarda Alba ou, encore, les mouvements du regard dans El hombre deshabitado, comme le montre Jacqueline Sabbah). Au cœur des tendances les plus modernes de l'avant-garde européenne, leur théâtre constitue ainsi une incroyable aventure artistique, où se mêle quête esthétique et métaphysique. Et c'est à l'étude de cette double aventure que nous convient les auteurs de ce volume. Les deux premières communications, celles de Serge Salaün et d'Evelyne Ricci, proposent une étude panoramique des trois œuvres, alors que les trois suivantes analysent plus précisément chacune des pièces. Jean-Marie Lavaud s'intéresse à l'esperpento de Valle-Inclán, dont il étudie la structure mathématique. Elle révèle, comme il le démontre, la nouvelle tension tragique et historique qui affecte la condition de l'homme. Pour leur part, Zoraida Carandell et Jacqueline Sabbah font porter leurs réflexions sur El hombre deshabitado, tandis qu'Emilio Peral Vega, de son côté, étudie la mise en scène du tragique et sa métamorphose dans l'ensemble de l'œuvre théâtrale de Lorca. Ce tragique prend la forme d'un conflit entre deux types d'amours, l'un pur et idéalisé, qui rappelle la pulsion apollinienne analysée par Nietzsche, et l'autre sauvage et dionysiaque qui est son exact envers. Dans chacun de ces articles, les auteurs font le même constat, la volonté de rupture instaurée par les dramaturges par rapport au modèle de la tragédie, certes, mais aussi, et plus généralement, par rapport à une conception du théâtre et de l'art dominante. Leur théâtre est d'abord un art du refus. Il rejette, en particulier, toute approche réaliste et mimétique de la représentation et du langage. Ce qu'ambitionnent Valle-Inclán, Alberti et Lorca, inspirés en cela par le Symbolisme, c'est de fonder de nouveaux instruments pour dire le monde, comme le montre Serge Salaün. Après avoir rappelé les fondements doctrinaux et théoriques du Symbolisme, qui aspire à créer une Poétique du signe qui « fabrique de la signification avec du sensible », il montre que cette utopie d'un langage nouveau est au cœur du projet théâtral des trois auteurs qui ambitionnent, à leur tour, de fonder une Poétique du théâtre, grâce à un langage qui « agisse » sur les sens des spectateurs. Cette conception sensorielle du langage ISSN 1773-0023 8 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) explique l'importance concédée à la matière physique du discours (le rythme, les sons, les accents, la vibration de la phrase, les silences…) et la présence, au sein de chaque réplique, de chaque didascalie, de séquences prosodiques et rythmiques et de mètres réguliers qui se conjuguent. La prose acquiert ainsi un relief sonore, à même de produire un impact sensoriel sur le public, secoué en permanence dans sa chair et dans sa peau, par ce langage qui dit autrement le monde, comme Artaud le montrera quelques années plus tard. S'il est une constance dans les trois œuvres, c'est bien d'obliger les spectateurs — et les lecteurs — à renoncer à leurs habitudes de réception et de les amener à remettre en cause leur compréhension du monde. Leur position face au spectacle de ce nouveau tragique est bien inconfortable, car l'accès au sens y est rendu difficile, il est sans cesse différé, ne se situant jamais là où on pourrait l'attendre. Ce théâtre repose, en effet, sur deux impératifs contradictoires, un effet de reconnaissance et un effet de surprise. Il en découle un sentiment de dissonance, « muy emotiva y muy moderna », pour reprendre les termes de Valle-Inclán. Les auteurs multiplient les références familières aux spectateurs, pour aussitôt s'en démarquer et prendre leurs distances avec des modèles identifiables. Il en est ainsi de la langue qui hésite entre prose et poésie, mais il est de même d'autres référents qui structurent les trois œuvres. L'importance concédée par les auteurs à la dimension picturale et plastique relève d'un même procédé : là encore, il s'agit pour eux d'interpeller le public, de s'adresser à ses sens — la vue, en particulier, qui redevient un élément de significations de première importance —, mais pour autant, le spectateur doit apprendre à regarder et à recevoir autrement. Jacqueline Sabbah montre, de manière on ne peut plus convaincante, qu'Alberti s'inspire, pour la composition de El hombre deshabitado, du modèle pictural du triptyque, dont il reprend les techniques de construction (comme la disposition en trois tableaux, la division en trois espaces symboliques, depuis le Paradis jusqu'aux Enfers, ou encore des jeux chromatiques précis), mais qu'il déconstruit systématiquement ces référents en inversant les perspectives. Le modèle pictural et théologique est ainsi subverti, obligeant le public à modifier son regard et sa lecture et à s'interroger sur le sens de ce nouveau tragique, comme le suggère le renversement du référent théologique et du concept de révélation. L'expérience est vertigineuse pour le public et sa compréhension du monde mise à mal. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 9 Il n'est plus désormais de réponse rassurante et définitive à la crise du monde et du sens que révèle le nouveau tragique. Pour les avant-gardes et pour Alberti notamment, la transcendance a cessé d'être un idéal, comme le souligne Zoraida Carandell, qui montre qu'avec sa disparition, c'est une nouvelle conception de la liberté qui jaillit, une liberté que l'homme se doit de (re)conquérir collectivement désormais. Ce qui se joue à travers le combat sans issue que semble mener l'Homme albertien contre son créateur, c'est bien une quête — impossible ? — de la liberté. Son déni est, cependant, racheté par la conquête d'une autre liberté, celle de l'auteur qui joue habilement avec les référents — textuels, picturaux, cinématographiques — qu'il combine et superpose, construisant une œuvre où le discontinu et la distorsion, nés de cette stratégie intertextuelle et des jeux sur le langage et sur la dimension métathéâtrale, deviennent les modes d'expression du nouveau tragique qui se bâtit sur une poétique du détournement et du renversement. Il n'est pas étonnant, dès lors, que les trois auteurs concèdent une telle importance dans leur théâtre aux espaces liminaires et aux seuils qui deviennent les lieux de gestation et de création du nouveau tragique, comme le montre Evelyne Ricci. Dans chacune des œuvres, ces espaces jouent un rôle essentiel dans l'organisation des intrigues, mais ils acquièrent aussi une fonction symbolique et métapoétique, puisque s'y projette la quête tragique et esthétique qui anime ce théâtre. Rejetant les limites métaphysiques et esthétiques de la tragédie classique, Valle-Inclán, Alberti et Lorca inventent les nouvelles frontières de ce tragique qui se construisent — c'est un paradoxe, mais c'est aussi le signe de l'extrême modernité de leur projet — à l'intersection de différents arts, de différentes tonalités ou registres et à la confluence de tous les sens. Le tragique devient un lieu interstitiel et incertain, à l'image d'un siècle mouvant et d'un théâtre en plein renouveau. Il est un espace d'exploration infini, où l'art et le monde sont à réinventer. ISSN 1773-0023 10 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) VERS UNE POETIQUE DU THEATRE (VALLE-INCLAN, ALBERTI, LORCA) Serge SALAÜN Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III Quand on s’intéresse au théâtre des années 20 et 30, il est souvent question de poétique (et les auteurs eux-mêmes emploient l’expression), ou plus exactement de Poétique, avec une majuscule, pour élever le mot vers une catégorie supérieure, car il est bien évident qu’il ne s’agit pas — ou pas seulement — du théâtre en vers ni même de l’utilisation du vers au théâtre, mais il est rare que la chose soit bien explicite, ni même bien claire. Par Poétique du théâtre, ce qu’on entendra ici, c’est une économie générale (ou une théorie et pratique) du langage et du signe, dont la poésie a, bien entendu, été la première bénéficiaire depuis le début du siècle, mais appliquée au théâtre, dans le cadre de cette rénovation ou de cette « rethéâtralisation » du théâtre que tout le monde réclame à cor et à cris depuis la fin du XIXe siècle. Pour mieux cerner le débat, il convient de revenir brièvement aux sources théoriques ou doctrinales qui conditionnent toute la production théâtrale qui prétend rompre avec le système dominant et, dans un deuxième temps, aux singularités hispaniques de cette volonté de rupture. En tout premier lieu, il est inévitable de revenir sur les fondements doctrinaux décisifs que suppose la « révolution symboliste » pour l’art, la littérature et le théâtre en particulier. Le Symbolisme européen, qui n’est ni un groupe, ni un « isme », ni une école et surtout pas une « génération », s’inscrit dans un mouvement général européen de remise en cause des savoirs, des méthodes et des pratiques, à la fin du XIXe, dans tous les domaines (l’histoire, la ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 11 médecine, avec Freud, la philosophie, avec Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, etc., la linguistique, avec Saussure, la science, avec Einstein et Planck dont la théorie des quanta est de 1900, etc.). Le Symbolisme et l’Expressionnisme sont en quelque sorte les manifestations artistiques et littéraires de cette mutation radicale qui bouleverse les sociétés occidentales autour de 1900 et qui se prolonge logiquement dans les décennies qui suivent. Le Symbolisme instaure une réaction définitivement anti-réaliste, anti-naturaliste, antimimétique, anti-psychologique, et s’élève contre une Raison jugée incapable d’appréhender la condition humaine dans toute sa complexité, incapable d’accéder aux grandes questions métaphysiques (la vie, la mort, l’amour, l’inconscient). On observe, bien sûr, que les écrivains symbolistes privilégient les atmosphères oniriques, irréalistes ou mythiques, dans leur rejet véhément d’une réel trop identifiable1. Mais c’est bien moins une question de « thèmes » ou d’objets (qui ne fondent jamais, à eux seuls, une révolution) qu’une question de langue, de forme. Ce que les symbolistes ambitionnent, c’est de forger de nouveaux instruments, de réformer le langage dans son ensemble, dans son économie générale même pour accéder à ces nouveaux territoires de l’imaginaire, de l’inconscient et du psychique que le langage « rationnel » est incapable d’explorer. Il ne s’agit pas de dire mieux ce qui a déjà été dit (ce qui a été considéré comme la condition du progrès et de la modernisation pendant des siècles « classiques »), mais de dire ce qui n’a jamais été dit, ce qui est indicible, ineffable, invisible, inouï (in-ouï, jamais entendu)2 ; les formulations des contemporains sur ce point sont multiples et éloquentes. L’utopie symboliste du langage nouveau est que l’on peut désormais tout dire, pour peu qu’on en ait le talent, évidemment. Pour les symbolistes les plus intransigeants (Mallarmé, par exemple), ce qui est en cause, c’est le langage lui-même, le signe et son aptitude à dire le monde, même (et surtout) ce qu’il y a de plus enfoui dans l’inconscient (ce qui incitera Mallarmé à prétendre qu’il n’y a plus de frontière entre la prose et la poésie), mais il est clair, à leurs yeux, que c’est le poème et lui seul qui, de par sa nature même, a véritablement vocation à réussir cet exploit. Le poème, le 1 Quelques exemples. Les Préraphaélites se passionnent pour Dante et La divine comédie. Un Moyen-Âge de convention sert très souvent de cadre (Wagner, Maeterlinck, Villiers de l’Isle-Adam). Les univers celtes plus mythifiés que réels abondent (Yeats, Synge, Valle-Inclán). Citons encore l’Italie hellénique de d’Annunzio ou tous les orientalismes à la mode à l’époque. 2 Sur cette question, voir mon introduction à Gregorio Martínez Sierra, Teatro de ensueño, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. ISSN 1773-0023 12 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) vers, parce que c’est le seul mode de discours qui — par définition — fabrique de la signification avec du sensible (le rythme, les sons, toute la gamme des procédés sonores et articulatoires, sans oublier le silence et la vue qui jouent aussi leur partition, précisément à partir du Symbolisme) et qu’il est seul capable de libérer des forces inconnues, des puissances suggestives (« suggérer voilà le rêve », cette sentence de Mallarmé a fait florès), des « énergies » (le mot est d’époque, il est déjà chez Keats), des tensions. En un mot (fréquent, lui aussi), le poème est seul capable « d’incarner », littéralement, de mettre en chair ce qu’il énonce. Cette utopie d’un langage nouveau, très cérébrale et, surtout, très sensualiste, en vient à considérer le poème comme le lieu de la totalité du sens et des sens. Et cette utopie ne sera plus jamais remise en cause en ce début de XXe siècle très expérimentaliste : on la retrouve au cœur de toutes les entreprises littéraires et c’est elle, en particulier, qui impulsera toute la poésie moderne au XXe, toutes les avant-gardes qui explorent, chacune à sa façon, ce continent nouveau. Ce substrat symboliste est essentiel chez Valle-Inclán, bien évidemment, mais aussi chez Alberti et Lorca ; ils sont tous les trois les héritiers plus ou moins directs (c’est-à-dire plus ou moins influencés par les avant-gardes esthétiques successives) de ce socle symboliste, d’autant plus que, dans les années 20 et 30, il semble bien que ces fondements symbolistes (et expressionnistes3) reviennent en force. Valéry, en France, dans les années 30, reconnaît sa dette envers le Symbolisme, tandis que les surréalistes, Breton en tête, redécouvrent Rimbaud, Lautréamont et Maeterlinck, en qui on croit voir le pionnier de la métaphore moderne. Quand Lorca proclame : « El poeta tiene que ser profesor de los cinco sentidos corporales […], en este orden : vista, tacto, oído, olfato y gusto. Para ser dueño de las más bellas metáforas tiene que abrir las puertas de comunicación entre ellos »4, il est bien clair qu’il formule, à sa 3 L’Expressionnisme et le Symbolisme sont tout à fait contemporains. Ils ont en commun les mêmes fondements doctrinaux (l’antiréalisme, l’anti-naturalisme, l’anti-mimétisme, etc.). Il est convenu de voir dans l’Expressionnisme un mouvement plus porté sur la révolte et l’expression d’une angoisse, mais la frontière — tout au moins dans les premiers temps — n’est pas toujours très nette selon les œuvres et les individus ; que l’on songe aux œuvres d’Ensor ou de Munch. Historiquement, il semble bien que l’Expressionnisme ait dominé dans les années 20 et 30, en peinture surtout, ainsi qu’au théâtre et au cinéma, mais cela n’implique en aucune façon un reniement des fondements symbolistes. 4 Dans sa conférence sur « La imagen poética de Luis de Góngora », in Obras Completas, t. III, Madrid, Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores, 1997, p. 58-59 ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 13 manière, les préceptes symbolistes des correspondances baudelairiennes ou de l’analogie (« le démon de l’analogie » dit Rodenbach), l’instrument par excellence de la modernité. Cette conception générale du langage qui préside à la création poétique depuis le début du siècle ne pouvait pas ne pas avoir de répercussions dans l’écriture théâtrale. Dans un premier temps, il est vrai, avant 1900, cette mystique du poème présenté comme une totalité qui ne serait vraiment accessible que dans l’intimité d’une lecture quasi religieuse semble s’opposer à une quelconque représentation dans un théâtre, car toute mise en scène d’un texte ne peut être que choix, parti pris, donc amputation. Mallarmé parle même d’acteur inutile et Maeterlinck, dans un premier temps, considère que les « beaux poèmes » tels que les tragédies de Shakespeare ne doivent pas être montés sur scène : « C’est dans les paroles que se trouvent la beauté et la grandeur des belles et grandes tragédies. Il n’y a guère que les paroles qui semblent inutiles qui comptent dans une œuvre. C’est en elles que se cache son âme »5. Il est vrai que le débat espagnol sur l’importance du mot (qui a toujours tenu une place prépondérante dans le théâtre national) est fort confus et qu’on y trouve des propos qui semblent aussi contradictoires que tranchés. Valle-Inclán, en 1928, assène de façon péremptoire, dans ce qui ressemble quand même beaucoup à une formulation très maeterlinckienne des années 1890 : « En el diálogo está la médula vital del verdadero teatro que no necesita de la representación para ser teatro ». En 1929, tout aussi péremptoire, il assène : « Nos mueve la plástica antes que el concepto ». Il faut se garder d’y voir une contradiction, parce que ces propos, tenus lors d’interviews avec des critiques ou des journalistes, ne sont que des propos rapportés (donc restitués de façon aléatoire) et, surtout, parce qu’ils émettent deux exigences nécessaires, simultanément, du théâtre moderne où la plastique et la poétique forment un tout qu’il faut toujours revendiquer, ensemble ou séparément, suivant les circonstances ou l’interlocuteur. Lorca et Alberti revendiqueront les mêmes choses avec la même insistance, aussi bien leur statut d’auteur, l’importance du texte 5 Maurice Maeterlinck, « Le tragique quotidien », in Le trésor des humbles, Bruxelles, Labor, 1986, p. 107. Dans son article sur « Le silence », qui aura un impact immense en Espagne, il dit autre chose : « La parole est grande, elle aussi, mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus grand ». (« Le silence » in Le trésor des humbles…, p. 15.). ISSN 1773-0023 14 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) et la place de la poétique que la présence de la « plastique ». Et ce n’est sans doute pas un hasard si le metteur en scène français qui les a tous les trois le plus influencés (par l’entremise de Rivas Cherif, admirateur de Copeau et ami aussi bien de Lorca que de Valle) soit Copeau et son théâtre du Vieux Colombier, lui qui prône une scène nue, dépouillée et le retour du mot. On en vient bien à cette définition du théâtre moderne de Meyerhold, pour qui « la plastique et les mots sont soumis chacun à leur rythme propre et divorcent à l’occasion ». Le théâtre obéit à cette pluralité de registres, langagiers et sensibles, qui peuvent, au besoin, jouer des partitions contrastées qui construisent simultanément le sens. Cette idée de « divorce » entre registres introduit l’émergence de la dissonance au sein même de l’œuvre et annonce en quelque sorte les esperpentos, l’alliance du tragique et du grotesque. Le théâtre moderne se définit donc désormais comme une polyphonie de moyens expressifs variés, une partition complexe où le langage (la Poétique telle qu’elle est posée depuis le Symbolisme) joue sa partie au même titre que le reste. Et la définition que donne Lorca (qui se veut « poeta dramático »), en 1935, du théâtre moderne, si souvent citée et souvent mal comprise, pourrait s’éclairer d’un jour nouveau : « Es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. […] El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y, al mismo tiempo, que se les vean los huesos, la sangre ». On peut y voir une formulation très personnelle, plus imagée que vraiment théorique, de l’exigence de Maeterlinck (« élever la scène jusqu’au poème »), c’està-dire un théâtre où le mot s’est enfin « incarné », s’est — littéralement, physiquement — humanisé et où la mise en scène réussit l’exploit de mettre en chair le langage dans toutes ses potentialités, à l’unisson avec tous les autres registres sensoriels et plastiques propres à la scène. C’est dans cette optique qu’il faut lire toutes ses expériences théâtrales, y compris La casa de Bernarda Alba. Dans ce même ordre d’idée, il n’est pas extravagant de considérer El hombre deshabitado, de Rafael Alberti, comme la mise en scène, ou la « mise en chair » des poèmes de Sobre los ángeles, deux textes que l’on a coutume de rapprocher, avec raison. La pièce pourrait bien être la version scénique, pour ainsi dire « totale », du recueil de poésies, avec, en plus, tout ce que la scène peut lui apporter. Alberti semble d’ailleurs le confirmer ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 15 quand il prétend, dans la pièce, « Crear sensualmente un mundo de sentidos, instintos y pasiones »6. Tout ce qui précède — un peu rapide, mais nécessaire — suppose ce patrimoine théorique, ou doctrinal, commun pour fonder ce que doit être ce théâtre moderne, « total », auquel tous aspirent. Bien évidemment, chacun mettra ce programme en pratique à sa façon, en fonction des divers héritages régionaux, culturels, langagiers qui le caractérisent, en fonction aussi de l’impact des courants avant-gardistes sur chacun, de la trace laissée par les expériences de rupture auxquelles ils se sont livrés dans leur période de formation. Ainsi, Valle-Inclán, imbibé, imprégné de Symbolisme depuis la fin du XIXe siècle, s’est visiblement rapproché de l’Expressionnisme qui prend une place de plus en plus grande, dans les esperpentos surtout (ce qui ne veut en aucune façon dire, encore une fois, que les bases symbolistes ont disparu de ses œuvres, bien au contraire) ; en revanche, si l’on voit en Max Estrella un porte-parole de Valle, on peut supposer qu’il n’a guère été sensible aux sirènes ultraïstes7 et créationnistes du début des années 20, mais ce n’est pas si certain et Valle n’a peut-être pas été sourd aux théories cubistes (rappelons que Cara de plata, où certains critiques croient déceler des traces cubistes, la troisième des Comedias bárbaras, est écrite entre les deux versions de Luces de Bohemia). En ce qui concerne la poésie d’Alberti et de Lorca, plus jeunes, le socle symboliste a été abondamment fertilisé par toutes les expériences des avant-gardes esthétiques et, en particulier, à partir de la fin des années 20, par le Surréalisme dont ils ont su tirer l’essentiel. En passant de la poésie au théâtre, en appliquant à la scène cette Poétique du langage qu’ils se sont forgée, la première évidence est la priorité du sensible accordée au texte, à la pluralité des signifiants. Dans tout texte théâtral, il faut partir du principe que chaque mot, chaque phrase, chaque réplique, chaque didascalie même, doit acquérir une intensité physique, une tension et une énergie qui sont censées agir directement sur les sens des spectateurs (ou des lecteurs). Dans le théâtre moderne, il n’y a plus d’action au sens classique : au contraire, l’action (l’intrigue, les péripéties, les épisodes qui monopolisent l’attente du spectateur) ne 6 Cité par José Monleón, in Tiempo y teatro de Rafael Alberti, Madrid, Primer Acto, 1990, p. 75. « Los ultraístas son unos farsantes » proclame Max (XII, p. 168), une condamnation qui mériterait une explication, en pleine période Ultra et Créationniste (1919-1923). Ce que dénonce Max chez les ultraïstes, c’est vraisemblablement leur conception ludique ou « pure » de l’art, exclusivement préoccupés qu’ils sont par la forme et la dimension expérimentale, et refusant toute dimension humaine ou sociale de l’art que Valle-Inclán réclame dès 1920. 7 ISSN 1773-0023 16 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) peut que nous détourner de l’essentiel qui est la perception immédiate de ce qui se passe sur scène. Dans le théâtre moderne, c’est le langage et la scène qui agissent pour que le spectateur soit « agi » en permanence. Chaque mot, réplique ou dialogue doit produire des impacts sensoriels et le « sens » de l’œuvre est la résultante complexe de la somme de tous les impacts, y compris tous ceux qu’on ne peut formuler, verbaliser ni même comprendre raisonnablement. Comme le dit très tôt Kandinsky, et bien d’autres après lui8, le mot a une « résonance intérieure », qui doit provoquer une vibration dans le spectateur : le son des mots « exerce une pression directe sur l’âme. L’âme en vient à une vibration sans objet encore plus complexe, je dirais presque plus “surnaturelle” que l’émotion ressentie par l’âme à l’audition d’une cloche, d’une corde pincée, de la chute d’une planche, etc. »9. Ce concept de vibration, qu’on retrouve chez Antonin Artaud10, est une des clés du théâtre de Valle-Inclán, chez qui tout vibre, tremble, tremblote, même l’air, la lumière et le silence et, bien sûr, le langage qui résonne et vibre en permanence. À cet effet, les dramaturges puisent dans l’arsenal poétique les ingrédients qui sont le mieux à même de provoquer ces états psychiques. En tout premier lieu, les mécanismes du rythme, de la mesure, de la scansion sur lesquels repose toute poésie, même dans le vers (prétendument) libre que les Espagnols, à quelques exceptions près, ne pratiquent guère. Une lecture attentive de Luces de Bohemia, de El hombre deshabitado et de La casa de Bernarda Alba, permet de retrouver une étonnante quantité d’unités ou de séquences rythmiques familières, indiscutablement issues de leur pratique poétique, aussi bien dans les dialogues que dans les didascalies. Ce qui ne saurait étonner ; dialogues et didascalies obéissent logiquement aux mêmes conceptions du langage « total », ce sont les deux volets complémentaires de l’entreprise de sensibilisation, c’est la même langue soumise aux mêmes exigences, à la même Poétique générale, même si les uns sont faits pour être mis en voix et les 8 Antonin Artaud : « Les mots seront pris dans un sens incantatoire, vraiment magique, pour leur forme, leurs émanations sensibles et non plus seulement pour leur sens ». « Le théâtre de la cruauté (Second Manifeste) », in Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, Folio-Essais, 1964, p. 193. 9 Wassily Kandinsky Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, Paris, Gallimard, Folio-Essais, 1989, p. 83. 10 Artaud demande au théâtre une « atmosphère de suggestion hypnotique où l’esprit est atteint par une pression directe sur les sens ». Il parle aussi de « paroxysme » qui permet de dépasser les limites afin de susciter des chocs et des révélations. Voir « Le théâtre de la cruauté (Second Manifeste) »…, p. 193. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 17 autres pour être lues par le lecteur, le metteur en scène, l’acteur préparant son rôle, etc., tous devant s’imprégner physiquement de l’œuvre, sans réserve. Les quantités classiques de la métrique espagnole sont omniprésentes : d’un côté, les séquences ternaires et « savantes » (heptasyllabes, alexandrins et hendécasyllabes surtout, associés depuis des siècles, sans oublier l’ennéasyllabe, fort prisé depuis le Modernisme et le pentasyllabe, souvent combiné, depuis les modernistes, à l’heptasyllabe pour créer une forme de rupture) et, de l’autre, les séquences binaires (octosyllabes, hexasyllabes, le « pie quebrado »). Quelques exemples parmi des centaines, dans les didascalies et dans le dialogue : Valle-Inclán : « Media cara en reflejo y media en sombra » (II, p. 55)11 : un hendécasyllabe tout à fait classique avec parallélisme de construction. Don « Latino de Hispalis//, grotesco personaje//, te inmortalizaré en una novela » (XII, p. 167) : deux heptasyllabes et un hendécasyllabe, canoniques. Alberti : « Enciende la linterna//, la enfoca hacia abajo// y con el pie golpea// la tierra por tres veces//. Se abre un escotillón// y asciende una figura// enrollada como las momias// en una cinta blanca » (p. 215)12 : difficile de ne pas y percevoir une rafale d’heptasyllabes (et un ennéasyllabe avec les « momias »). Sombras, « sombras, sombras, por todas partes » (p. 206) : un hendécasyllabe trochaïque pour cette première réplique de l’œuvre. Lorca : « Un gran silencio umbroso// se extiende por la escena.// Al levantarse el telón//, está la escena sola//. Se oyen doblar las campanas » (I, p. 139)13 : un majestueux alexandrin ïambique, un octosyllabe, un heptasyllabe et un octosyllabe. « La Poncia : Yo no puedo hacer nada//. Quise atajar las cosas//, pero ya// me asustan demasiado//. ¿Tú ves este silencio ?// Pues hay una tormenta en cada cuarto » (III, p. 260) : une série de quatre heptasyllabes (avec la coupure brutale de « pero ya ») 11 Pour Valle-Inclán, les références sont tirées de Luces de Bohemia, Madrid, Austral, 2006. L’édition utilisée est la suivante : Rafael Alberti, El hombre deshabitado, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003. 13 L’édition utilisée est la suivante : Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, Madrid, Cátedra, 2005. 12 ISSN 1773-0023 18 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) qui se clôt par un superbe hendécasyllabe héroïque. La Poncia, la servante, participe, elle aussi, par son souffle et sa diction, à la dimension tragique. On pourrait sans doute affiner l’analyse de cette mécanique rythmique, en fonction des situations et des personnages. Par exemple, Max Estrella, le poète, l’homme du savoir et du langage, celui qui s’attribue le droit à l’alphabet (VI, p. 103), semble bien doté par Valle d’une rythmique bien à lui, avec les cris abrupts de l’impuissance quand le langage fait défaut (« Canallas », « Majadero ») et des « périodes » rythmiques pleines d’emphase et de majesté, où dominent l’heptasyllabe et l’hendécasyllabe. La définition qu’il donne de lui-même, « Cesante de hombre libre y pájaro cantor » (V, p. 94) est un très bel alexandrin ïambique ronflant, où l’on pourra percevoir toute la dualité du personnage : autorité et grandiloquence d’un côté, dérision de l’autre, de par le déphasage entre réalité et discours. Et quand il ajoute, quelques répliques plus loin : « Donde yo vivo siempre es un palacio », l’hendécasyllabe canonique superpose encore une fois l’emphase et le dérisoire. Comme en poésie moderne, mais avec une plus grande liberté puisqu’il n’est plus question d’obéir à un schéma contraignant horizontal ou vertical, le dramaturge peut jouer sur le souffle et sur la voix, alterner les séries qui donnent une certaine emphase et les ruptures brutales qui prennent ainsi un relief majeur, alterner le long et le court, le binaire et le ternaire, le cri et l’intime. On ne peut évidemment pas parler de vers strictu senso, mais d’une prose rigoureusement rythmée qui participe directement aux effets de sens. Ce rythme, à la fois libre et contraignant, entre la prose et la séquence métrique aisément repérable, est vraisemblablement une des trouvailles du théâtre contemporain qui veut rompre avec toutes les routines. Maeterlinck, déjà (encore lui !), avait « inventé » ce type de prose rythmée, alternant octosyllabes, alexandrins et vers courts de rupture, de façon tout à fait délibérée. Chez les poètes, sans doute, la tendance à produire des séquences rythmiques est à ce point spontanée, presque inconsciente, que le vers pointe partout. Maeterlinck raconte que quand il écrivait La Princesse Maleine, il s’est aperçu, après coup, qu’il avait écrit des vers, « mais, ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 19 savez-vous que ce sont des vers libres, mais typographiquement en prose »14. Qu’il s’agisse de réflexes respiratoires de poètes « de métier » ou d’une volonté de créer un « tempo », le fait est que Valle, Lorca et Alberti saturent rythmiquement tout leur texte, Alberti plus que tout autre (tant El hombre deshabitado enchaîne les séquences reconnaissables) et même dans les didascalies de Lorca où la mécanique fonctionnelle est pourtant visiblement dominante. Très complémentairement, et conformément aux lois de la langue espagnole qui est syllabique et accentuée, le rythme prosodique (la distribution des reliefs accentuels dans la séquence) intervient en permanence, sans contraintes préétablies (par la strophe ou un schéma dominant), mais bien perceptible. Dans les années 20 et 30, rythme métrique et prosodie font toujours partie des outils indispensables du poète ; c’est aussi l’époque où Navarro Tomás, le dernier grand rhétoricien espagnol, l’ami de tous les poètes de la période et le grand prêtre des lois du vers (avec son monumental Arte del verso) explique doctement que les différentes modalités prosodiques de chaque mètre possèdent ou suggèrent une capacité « expressive » spécifique. Par exemple, une succession d’hendécasyllabes mélodiques (accents sur la 3e, 6e et 10e syllabes), héroïques (2-6-10) ou saphiques (4-8-10) ne produisent, en effet, pas le même impact sensoriel. En tout cas, les poètes que sont Valle, Alberti et Lorca maîtrisent la chose et ne sauraient s’en priver sur scène, précisément parce qu’ils en perçoivent les effets. La première réplique de El hombre deshabitado (« Sombras, sombras, sombras, por todas partes ») combine tous les effets oratoires et gestuels, dont une évidente sensation binaire, trochaïque et/ou iambique. La réplique de Bernarda, « A fuerza de dinero y sinsabores » (III, p. 244) puise sa densité et sa grandeur dans un hendécasyllabe dit héroïque, justement. La scène offre une certaine liberté par rapport au poème. L’auteur (ou l’acteur) peut « jouer » plus librement avec les synalèphes et les hiatus, pour une meilleure diction. Cette liberté permet aussi de construire une réplique sans trop tenir compte de la quantité métrique, en privilégiant un rythme accentuel particulièrement tendu et spectaculaire. Quand Magdalena lâche : « Sé que yo no me voy a casar » (I, p. 157), le décasyllabe n’est pas « parlant », ni même sans doute très perceptible à l’oreille, sauf pour les initiés ; par contre, la construction en trois sous-ensembles de trois syllabes, avec accent sur la troisième (1-2-3/ 1-2-3/1-2-3), est 14 Réponse de Maurice Maeterlinck à Jules Huret, in Enquête sur l’évolution littéraire, Paris, Charpentier, 1892, p. 127. ISSN 1773-0023 20 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) singulièrement brutale, composée avec essentiellement des monosyllabes et des sonorités agressives, pas un seul mot « llano ». Lorca avait sans doute d’autres possibilités de construire cette phrase, avec d’autres effets ; la formulation choisie est la plus « expressive », la plus dramatique parce qu’elle exige de l’acteur une gestuelle, une voix et une tension qui rendent le drame immédiatement perceptible. Parmi les moyens dont dispose le discours poétique, il paraît naturel que les aspects sonores soient privilégiés, puisqu’ils sont destinés à la parole vivante, sur scène. Les trois dramaturges font un usage systématique de tout ce qui peut représenter un relief sonore, « faire du bruit », sonner aux oreilles et aux sens du spectateur. Tout particulièrement, ils font grand cas des esdrújulos qui obligent la voix et le corps à gesticuler et qui offrent un maximum de rendement sémantique. Valle-Inclán, en bon symboliste qu’il est, les a toujours prisés (« bárbaro », « lívido », « lánguido », « Válgame Dios »). Alberti les emploie en rafale : « Míralas bien. ¡Levántate! […] ¡Llámala! ¡Grítale! ¡Suplícale! » (p. 210), ou « Contémplela. Mírela y apréndasela de memoria » (p. 212). En fait, le texte d’Alberti est d’une sonorité intense, combinant tous les reliefs possibles, esdrújulos, mots oxytons, cascades de sons agressifs : « Mírale, aquél eres tú » (p. 223). Il ne fait aucun doute que les répliques finales de El Hombre parviennent à cette violence nihiliste du refus de Dieu, jusqu’à l’anathème et l’insulte, parce que la voix rebondit de seuil en seuil sonore ; la fureur déchaînée des sons au bord du cri devient la mesure exacte des enjeux tragiques de la condition humaine : « Arderé, odiándote, Señor », « Te aborreceré siempre » « Y yo a ti, por toda la eternidad » (p. 260-261) (un heptasyllabe et un hendécasyllabe, pour ces deux dernières répliques). On a bien observé la fréquence et l’importance du cri dans ce théâtre, du langage devenu pur geste agressif ou défensif : les insultes, les apostrophes houleuses, l’abondance des interjections, exclamations, interrogations qui apportent leur poids de chair vivante au discours. Valle adore les insultes pittoresques et tonitruantes : « majadero », « mamarracho », « calla bocón », « soleche », « pelmazo »... On en a plein la bouche et plein les oreilles et les personnages sont bien plus discrédités par la violence sonore que par le sens précis des mots. Dans Lorca, où tout se joue apparemment sur un mode plus retenu, on note la brièveté de très nombreuses répliques, ponctuées par des plages de silence, comme à l’Acte II, dans ce ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 21 dialogue des non-dits entre Amelia et Martirio, où chaque réplique, d’une extrême brièveté, est suivie par une « pausa » (p. 217) : ici aussi, c’est une question de tension extrême. L’inventaire des signifiants pourrait se prolonger, dans les jeux d’allitérations, de paronomases, de « rimes internes » que l’oreille capte immédiatement. Il se prolonge également dans le choix de certaines structures ou constructions de phrases qui contribuent à donner du rythme au discours. C’est le cas des sentences, maximes, proverbes ou autres formulations qui se construisent toujours à partir d’un rythme, d’une prosodie ou d’un jeu de correspondances : Valle-Inclán et Lorca en sont plutôt friands. On peut d’ailleurs généraliser cette mécanique associative qui repose sur des constructions binaires ou parfois tertiaires, car il existe aussi, bien évidemment, un rythme syntaxique. Les trois auteurs y ont fréquemment recours et la réplique ou la didascalie s’en trouvent singulièrement scandées, donc sensibles. Valle-Inclán a toujours eu un penchant marqué pour les constructions binaires: « Zaratustra, abichado y giboso — la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente — promueve […] una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y muy moderna » (II, p. 50). Dans ce dernier membre de phrase, les adjectifs s’ordonnent par deux, de part et d’autre d’un mot nodal (« disonancia ») et l’ensemble en vient à exprimer, intellectuellement, métaphoriquement et physiquement, les principes esthétiques de l’esperpento moderne, entre équilibre et déséquilibre, harmonie et dissonance, émotion et douleur, dans une rigoureuse « géométrie » ; une didascalie tout à fait exceptionnelle et révélatrice de la « méthode » de Valle, qui associe toujours pratique et métadiscours. Chez Lorca aussi, les répliques acquièrent tout leur poids (littéralement, poids de voix et de corps) par leur scansion, leur construction : « ¡Mi sangre no se junta con la de los Humanes, mientras yo viva! » (Bernarda, II, p. 229), deux heptasyllabes ïambiques éclatants (ou un alexandrin) et un pentasyllabe péremptoire et brutal qui met en relief ce « yo » tonitruant. Auparavant, Magdalena avait formulé son destin et celui des femmes de sa condition : « Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón » (I, p. 158), une sentence qui associe une série régulière de quatre pentasyllabes (sans doute plus perceptibles que deux décasyllabes) et un rigoureux parallélisme de construction ; il est clair que cette formulation très structurée et très « physique » possède une dimension tragique infiniment plus intense que toute autre formulation plus « prosaïque ». ISSN 1773-0023 22 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Pour élaborer une Poétique théâtrale, chacun choisira les instruments qui lui conviennent. Valle-Inclán préfère les mots pittoresques, rutilants, pleins de bruit et de fureur, comme pour amener le langage à son point de rupture, vers la gesticulation grotesque : même le langage lui-même se marionnettise (et, donc, toute la communication verbale et, par extension, toute la mécanique sociale et humaine). Alberti reste attaché au rythme, toujours très près du vers et de l’explosion sonore et sensuelle. Lorca recherche la tension maximum dans la retenue, la contention crispante, jusqu’au point de rupture qui permettrait enfin l’explosion et la détente, mais que même la mort d’Adela ne provoque pas, ce qui rend cette tension si tragique, précisément, parce qu’elle ne disparaîtra pas. Tout ceci pose évidemment un problème majeur. Comment doit-on lire, dire ou « recitar », suivant le terme espagnol consacré, ces pièces ? Comment la voix doit-elle se poser ? Lecteurs et acteurs se trouvent bien devant la question essentielle de la diction, comme élément décisif d’une nouvelle esthétique théâtrale. Cette question agite le monde du théâtre symboliste depuis la fin du XIXe siècle, chacun s’évertuant à définir une nouvelle diction qui liquiderait la diction « naturelle » ou « vériste » où l’on a cru voir l’idéal du bon acteur depuis des décennies. Claudel, influencé par le théâtre japonais, recommandait une forme de « psalmodie » inspirée du Nô. Lugné-Poe a essayé d’imposer dans son Théâtre de l’Œuvre une sorte de mélopée, mécanique et hiératique. Meyerhold recommandait pour les œuvres de Maeterlinck « une froide ciselure des mots ». Un autre courant du théâtre moderne sera précisément de revenir aux marionnettes et au guignol, qui interdisent la diction « naturelle » : Valle-Inclán s’en est visiblement inspiré, surtout dans les esperpentos. En Espagne, le débat ne semble pas se poser ; il est vrai que les expériences de théâtre vraiment modernes sont tellement rares et confidentielles, avec des acteurs le plus souvent non professionnels (on aimerait bien savoir comment Valle-Inclán, quand il jouait, disait ses rôles), qu’il est difficile d’imposer des modèles qui, de toutes façons, ne plaisent pas au public (les tournées françaises, comme celle de Georgette Leblanc, la compagne de Maeterlinck, au début du siècle, ne sont pas des succès et le public s’y ennuie souverainement), ni même à la critique, même la mieux disposée, qui s’accroche désespérément à une diction naturelle. Dans les années 20 et 30, on ne voit pas que le débat ait progressé, malgré les efforts de Rivas Cherif et, sans vouloir être irrévérent envers les actrices encensées et considérées comme les ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 23 plus modernes et les plus professionnelles, comme la Bárcena chez Martínez Sierra ou la Xirgu qui jouera Lorca, par exemple, il semble qu’on soit assez loin de l’acteur moderne à la Stanislavski ou à la Meyerhold ; et la critique se plaint depuis des décennies que les acteurs espagnols ne savent pas dire les vers. C’est peut-être ce qui explique aussi cette volonté, de la part de dramaturges de rupture comme Valle, Lorca, Alberti et tous les autres, d’instaurer une vraie Poétique fondée sur la mécanique du rythme et des signifiants qui, par principe, n’autorise pas une diction naturaliste15. Leur connaissance profonde des mécanismes de la poésie et la très grande confiance qu’ils ont dans leur langue, pour ses qualités rythmiques, prosodiques et accentuelles, les ont sans doute incité à privilégier ses composantes sensibles. Dire ces pièces sur scène impose nécessairement un « tempo » particulier, une attention exigeante à tout ce que la langue « fait », une certaine lenteur peut-être aussi, une mise en bouche impeccable et sonore, une adéquation entre le corps, le geste et la voix. Pour Valle, Alberti et Lorca, comme pour tous les dramaturges européens de l’époque, il s’agit avant tout de « peser » sur la réception, de réinventer même une attente et une perception, de « déréaliser » définitivement le théâtre, afin de réveiller le spectateur (comme dit Artaud) et de le mener vers d’autres sensations et émotions. Trouver les acteurs qui y parviennent est une autre affaire, mais l’invention d’une Poétique était sans doute (à défaut d’autres voies impossibles, comme l’apparition de nouvelles salles et de nouvelles techniques) la voie la plus appropriée, à la fois résolument nouvelle et solidement ancrée dans la langue et la culture espagnoles. Encore une fois, cette singularité espagnole, autour de la langue et par la langue, offre une possible solution qui articule tradition et rénovation, continuité et rupture. Pour être tout à fait complet, il reste un dernier point qui n’appartient pas aux mécanismes du rythme et du son, mais qui, surtout dans les années 20 et 30, constitue un des ingrédients majeurs de toute Poétique ; il s’agit de l’image. À l’époque qui nous intéresse, l’image et, plus concrètement, les trois figures de base que sont la métaphore, l’oxymore et la synesthésie16, 15 On peut appliquer aux trois auteurs ce que Fernández Cifuentes dit très justement de Lorca : « El teatro de Lorca proponía fundamentalmente una desfamiliarización de los signos teatrales de la época » (Luis Fernández Cifuentes, « García Lorca y el teatro convencional », Iberomania, n° 17, 1983, p. 74). 16 La métonymie n’est pas tout à fait absente (Lorca s’en sert de temps en temps), mais elle appartient davantage à l’âge classique. Enracinée dans le rapport au même, à l’identique, elle n’offre pas ces échappées vers la surprise, l’imprévu, l’arbitraire irrationnel (non plus le même mais l’autre) que peuvent provoquer la métaphore, l’oxymore et la synesthésie. ISSN 1773-0023 24 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) représentent les instruments modernes par excellence des avant-gardes (esthétiques et idéologiques), parce qu’elles permettent l’accès à l’imaginaire, l’inconscient, l’impensé et l’impensable. C’est l’ouverture psychique, le royaume de l’analogie (« la reine des facultés », pour Baudelaire, déjà) et l’image deviendra, après Maeterlinck et dans toute la poésie espagnole (et européenne) des années 20 et 30, le grand outil de la conquête expressive. Valle-Inclán, peut-être plus que de l’image proprement dite, est un adepte frénétique de la combinaison de mots surprenante. Il est sans doute un des premiers, en Espagne, à s’en faire une doctrine, dès 1903, par exemple, quand il vitupère contre « esos jóvenes que nunca supieron ayuntar dos palabras por primera vez »17. Pas une seule réplique, pas une seule didascalie qui ne soient régies par des mécanismes associatifs débridés qui ne permettent aucun repos, aucune relation d’évidence confortable. Cela donne au texte une densité et une effervescence sans doute uniques dans le théâtre européen de l’époque, qui va de l’image onirique (« Una ráfaga de silencio », dans les Comedias bárbaras ou « una ráfaga de emoción », (III, p. 71), « la bufanda de verde serpiente », (II, p. 50))18, à la fantaisie burlesque et grotesque (« De repente, el grillo del teléfono se orina en el gran regazo burocrático », (VIII, p. 122)) et même parfois à la joyeuse cacophonie : « Un golfo largo y astroso […] como perro que se espulga, se sacude con jaleo de hombros, la cara en una gran risa de viruelas » (III, p. 66-67). En fait, la figure proprement valle-inclanienne est l’oxymore qui, bien plus qu’une simple figure de rhétorique, en vient à mettre en scène, de façon spectaculaire, le fonctionnement absurde et dégradé du monde espagnol ; c’est en quelque sorte l’instrument verbal de l’esperpento, comme l’a fort bien décrit Manuel Aznar. Chez Alberti, sous l’influence des avant-gardes et du Surréalisme qui privilégie le rêve et la sensualité, l’image est omniprésente, envahissante : « Un hombre deshabitado es como un saco vacío, como la funda vacía de una espada que necesita llenarse de carbón o de acero » (p. 207). Les allégories des cinq sens déchaînés (p. 227, en particulier) fonctionnent comme une intense frénésie synesthésique. 17 Prologue à Melchor Almagro, Sombras de vida , Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1903, p. IX-X. Qui n’est pas sans rappeler ces vers de Maeterlinck: « La lune est verte de serpents » ou « Les serpents violets des rêves », deux octosyllabes de Serres chaudes (avec la diérèse tout à fait symboliste sur « vi-o-lets », évidemment). 18 ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 25 Quant à Lorca, qui, dans toute sa poésie, a fait de l’image (la métaphore, surtout, mais la synesthésie est très présente pour tout ce qui implique la mécanique du désir et des sens) un de ses instruments privilégiés, on peut observer que La casa de Bernarda Alba n’en fait pas un usage très important, mais les éléments symboliques ne manquent pas (les symboles érotiques du poisson, de la mer, du jardin) et on trouve quand même quelques occurrences (« Un gran silencio umbroso », p. 139, un très bel heptasyllabe ïambique, par ailleurs). On le voit, ce concept de Poétique recouvre une gamme variée de procédés et de mécanismes, qui peuvent se combiner, s’imbriquer à l’infini, pour que le texte instaure une densité, une intensité, sur tous les mots, sans exception. Conformément à la tradition poétique espagnole, tous ces dramaturges donnent aux signifiants une évidente priorité, autour du rythme, des sons, du sensoriel, tout ce qui donne littéralement corps au mot et que le corps de l’acteur doit pouvoir produire. L’imaginaire, le psychique, l’inconscient ne sont pas absents, sous l’influence de Freud et du Surréalisme, mais passent d’abord par la chair des mots et des phrases. La réception, par le spectateur, doit, elle aussi, passer d’abord par tous les rouages de cette poétique, elle doit s’en imprégner, se laisser envahir, jusqu’à atteindre un état proche de l’hypnose, dira Artaud. L’intensité tragique et la profondeur métaphysique seront d’autant plus présentes qu’elles viendront des sens : « C’est par la peau qu’on fera rentrer la métaphysique dans les esprits »19. 19 Antonin Artaud, « Le théâtre de la cruauté. (Premier manifeste) », in Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, Folio-Essais, 1964, p. 153. ISSN 1773-0023 26 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) LA POETIQUE DES SEUILS : VERS UN NOUVEAU TRAGIQUE (ANALYSE DES ESPACES LIMINAIRES DANS LE THEATRE DE VALLEINCLAN, ALBERTI ET LORCA) Évelyne RICCI Université de Bourgogne La problématique du seuil fonctionne pour une part à l'envers : elle n'est pas seulement la frontière baroque, mettant en mouvement un « grotesque » du réel, mais la place même du tragique, le lieu où la confrontation bascule dans l'irrémédiable. Anne Ubersfeld S'interroger sur le retour du tragique dans le théâtre espagnol des années 20 et 30 doit amener à réfléchir sur le concept de genre — celui du théâtre et celui du tragique — et à poser ce problème dans une perspective historique, induite par la référence à cette notion temporelle de retour. Dans l'un et l'autre cas, la réflexion (celle sur le concept de tragique et celle sur le principe de retour) doit se confronter à une notion essentielle, celle de limite, limite tout à la fois épistémologique (comment comprendre le concept de tragique ?), philosophique (qu'estce que le tragique ?), esthétique (qu'est-ce que le théâtre ?, qu’est-ce que la tragédie ?) et, bien sûr, chronologique (pourquoi parler de retour ?). Dit autrement, il s'agit de circonscrire le concept de tragique, d'en délimiter les contours, pour savoir ce qui, dans les trois œuvres proposées à notre étude, Luces de Bohemia de Valle-Inclán, El hombre deshabitado d'Alberti ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 27 et La casa de Bernarda Alba de Lorca, relève du phénomène tragique. Cerner le concept de tragique est peu aisé et définir le théâtre tragique l'est encore moins, d'autant que ces œuvres de Valle-Inclán, d'Alberti et de Lorca en offrent des traitements différents, difficiles à enserrer dans un cadre définitif et étanche qui marquerait les limites claires du phénomène tragique. Alors que l'on est parvenu à proposer une définition assez consensuelle de la tragédie classique (celle d'Eschyle, de Sophocle ou d'Euripide ou, plus tard, celle de Sénèque) et de celle qui renaît avec le théâtre de Shakespeare ou de Racine, par exemple, définir ce qu'il est convenu d'appeler ce « nouveau tragique » présente bien plus de difficultés, tant les limites du phénomène sont confuses et contradictoires. En ce début de XXe siècle, le tragique a cessé d'obéir à un schéma unique, il se déploie dans des directions diverses, redessinant sans cesse ses limites et ses contours, désormais aussi incertains que l'est ce nouveau siècle trouble et indécis qui commence à peine. Comment alors appréhender ce phénomène qui semble refuser toute approche dogmatique et qui échappe à toute définition exclusive, récusant les limites philosophiques et esthétiques dans lesquelles on cherche à l'enfermer ? C'est, paradoxalement, en s'intéressant à ce concept de limite qu'il est sans doute possible de mieux comprendre ce concept de tragique apparemment insaisissable. L'idée de limite n'est pas seulement extérieure au phénomène, elle est, au contraire, au cœur de la poétique tragique que façonnent Luces de Bohemia, El hombre deshabitado et La casa de Bernarda Alba. Chacune des trois œuvres invente un nouveau tragique qui ne se superpose plus à celui de la tragédie classique, mais qui se déploie, au contraire, dans de nouveaux territoires. La volonté (ou la nécessité) d'inventer un nouveau théâtre tragique amène les dramaturges à accorder une importance essentielle aux limites de ce tragique : ils en explorent les contours et les frontières, construisant des intrigues où simultanément l'homme, le langage et le théâtre se heurtent aux limites de leurs propres conditions, les repoussent et les réinventent. Cela explique l'intérêt qu'accordent les dramaturges aux espaces liminaires, ces lieux qui marquent le passage d'un point à un autre. C'est dans ces espaces charnières et intermédiaires que surgit la tension tragique, c'est sur ces seuils que se construit ce nouveau tragique, qui ne pouvait, sans doute, pas apparaître ailleurs que dans ces lieux transitionnels où se forgent de nouveaux repères et d'où on entre vers de ISSN 1773-0023 28 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) nouveaux espaces qui sont encore à inventer. Le tragique contemporain naît sur ces seuils qui sont autant d'espaces de transition et de gestation, où un nouveau théâtre est en train d'être créé, un théâtre qui refuse désormais les limites génériques, philosophiques et esthétiques trop strictes, comme si le XXe siècle était trop incertain pour offrir des réponses définitives aux nouveaux enjeux de l'art et du monde. L'exploration de ces territoires liminaires, ceux des espaces où les intrigues se nouent et où le monde se met se met en scène, apporte la preuve qu'un nouveau tragique est en train de naître dans le théâtre de Valle-Inclán, d'Alberti et de Lorca, donnant raison à Anne Ubersfeld qui affirme, en effet, que « l'espace devient ce vide sans frontières où tout peut survenir »1. Les structures spatiales des trois œuvres sont très différentes : Luces de Bohemia repose sur une multiplicité de lieux (cette pièce de 15 scènes compte 13 lieux différents), alors que l'action de El hombre deshabitado ne se déroule que dans deux lieux, le chantier de construction du prologue et de l'épilogue et le jardin de l'acte central (lui-même divisé, cependant, en trois espaces distincts) et que, pour sa part, l'intrigue de La casa de Bernarda Alba se passe, comme l'indique le titre, dans les pièces intérieures de la maison de Bernarda. Malgré leur apparente diversité, on trouve, pourtant, dans l'architecture spatiale des trois œuvres des points communs très significatifs, qui tiennent à l'importance que les trois dramaturges accordent aux espaces liminaires dans l'intrigue générale des pièces, où ils constituent des éléments essentiels de l'action, mais aussi du sens. Tous ces espaces intermédiaires que sont les issues (les portes, les fenêtres, les ouvertures…), les seuils et les entrées qui marquent les limites et les points de passage entre deux lieux différents (l'un étant souvent intérieur et l'autre extérieur) deviennent des lieux privilégiés de l'action, acquérant une importance matérielle dans l'organisation de l'espace, certes, mais aussi et surtout une fonction symbolique. Pour preuve de l'intérêt porté par les trois auteurs à ces lieux de passage, les premières didascalies de chacune des œuvres (et, de manière générale, de chacun des actes ou, chez 1 Anne Ubersfled, « Les Comédies barbares ou l'espace du désordre » in Lire Valle-Inclán, Les Comédies barbares, Dijon, Hispanistica XX, 1996, p. 185. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 29 Valle-Inclán, des scènes) y font toutes références. Les indications scéniques du premier acte de La casa de Bernarda Alba, conçues avec une technique toute photographique, voire cinématographique, le montrent clairement. Après le plan général sur la « habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda »2, l'œil du spectateur, guidé par les didascalies, se fixe d'abord sur les murs (« muros gruesos »), puis immédiatement sur les portes, décrites avec détails : « Puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes ». Dans l'espace très dépouillé de la première scène, la référence aux rideaux est loin d'être fortuite, puisque cet élément de décor constitue un écran supplémentaire entre cette pièce intérieure et l'extérieur. C'est une protection, un obstacle de plus que Bernarda dresse face au monde extérieur, rendant son accès plus difficile encore pour ses filles. On remarquera d'ailleurs que cette pièce (comme les suivantes) ne compte nulle fenêtre et qu'il est, dès lors, impossible pour les habitantes de la maison de voir ce qui se passe à l'extérieur de la pièce, le droit de voir qui leur est refusé dès le début de la pièce constituant la première atteinte à leur liberté. Avant même que l'action ne commence, ce déni est ainsi suggéré matériellement et symboliquement par les éléments du décor et par l'importance accordée aux issues qui, toutes, sont condamnées, comme l'est la liberté des habitantes de la maison. Certes, il est question à d'autres moments de l'œuvre des fenêtres de la maison qui jouent même un rôle important dans l'intrigue, puisque c'est à travers elles que s'établissent les contacts avec l'extérieur, en particulier avec Pepe el Romano. Ces fenêtres, pourtant, ne sont jamais montrées, elles demeurent toujours cachées et ne sont évoquées que dans les conversations, comme nous le verrons. Leur invisibilité contribue bien évidemment à renforcer le sentiment d’enfermement qui domine toute l’œuvre et qui est partie intégrante du tragique. Les premières paroles qu’échangent la Criada et la Poncia dès le lever du rideau insistent, d’ailleurs, sur cette opposition structurelle qui s’établit entre l’intérieur et l’extérieur. La musique insistante des cloches dont se plaint la domestique (« Yo tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes », dit-elle à la Poncia, (I, p. 139)) constitue une intrusion sonore dans l’espace silencieux de la maison instauré par les premières didascalies (« Un gran silencio umbroso se extiende por la escena », précisent les premières indications scéniques (I, 2 Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, Madrid, Cátedra, 2005, p. 139. C'est à cette édition que renvoient toutes les citations suivantes, dont les références seront désormais indiquées dans le corps du texte. ISSN 1773-0023 30 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) p. 139)). Les murs qui séparent l’enceinte de la maison du dehors n’empêchent pas les bruits de pénétrer jusqu’en son sein, mais ils n’en constituent pas moins une limite nette entre ces deux espaces qui renforce la tension tragique. Les rumeurs du monde extérieur qui s’infiltrent à l’intérieur de la maison ne constituent-elles pas une invitation à franchir ces murs, une tentation fatale pour qui, comme Adela, s’y soumet ? Ce jeu d’opposition sonore entre ces deux espaces antagoniques se répète à plusieurs reprises tout au long de la pièce. Il est particulièrement net au début du deuxième acte (une fois de plus, nous nous situons dans un moment transitionnel), alors que l’intrigue fait pénétrer les spectateurs plus profondément à l’intérieur de la maison3. À nouveau, les rumeurs des cloches s’immiscent dans la tranquillité de la maison, mais elles se font maintenant plus timides, comme si pénétrer jusqu’au cœur de la demeure devenait de plus en plus difficile : « Se oyen unos campanillos lejanos como a través de varios muros » (II, p. 210). Ce bruit qui interrompt les conversations des habitantes de la maison annonce le retour des hommes du travail. « Son los hombres, que vuelven del trabajo » (II, p. 210), explique Magdalena, avant qu’Adela n’exprime son désir de pouvoir, elle aussi, sortir librement : « ¡Ay, quién pudiera también salir a los campos! » (II, p. 211). L’impossibilité qui lui est faite, comme à ses sœurs, de franchir les murs de la maison et de rejoindre ces hommes est renforcée par une nouvelle série de bruits extérieurs qui, presque immédiatement, se font entendre dans le silence pesant de la maison. Il s’agit, cette fois, du chant des moissonneurs qui semble envoûter les quatre filles de Bernarda et leur rappeler leur condition de prisonnières : « Se oye un canto lejano que se va acercando. […] Se oyen panderos y carrañacas. Pausa. Todas oyen en un silencio traspasado por el sol » (II, p. 212213). Bien qu'il demeure encore lointain, le chant des hommes s'immisce jusqu’au cœur de la maison, cherchant à en forcer l’accès, avant de s’éloigner tout à fait. Il n'est pas fortuit d'ailleurs, que, dans cette chanson, les hommes prient pour qu'on leur ouvre les portes et les fenêtres de ces maisons qui semblent comme emmurées. 3 Voir p. 189 : « Habitación blanca del interior de la casa de BERNARDA. Las puertas de la izquierda dan a los dormitorios ». La mention aux portes des chambres indique que l’action s’est déplacée plus en avant au cœur de la maison, c'est-à-dire plus à l’écart encore du monde extérieur. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 31 CORO (muy lejano.) : Abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo; el segador pide rosas para adornar su sombrero. […] MARTIRIO (con nostalgia) : Abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo… ADELA (con pasión) : El segador pide rosas para adornar su sombrero. (Se va alejando el canto). (II, p. 213-214) Le jeu sonore et spatial instauré par ce chœur viril invisible et, pourtant, si présent, suggère toute la tension qui entoure le désir féminin, violent et impossible à satisfaire. Il en est de même de la liberté, à portée de mains, apparemment, derrière ces murs et, cependant, elle aussi inaccessible. Là encore, le dramaturge instaure un jeu subtil entre l’intérieur et l’extérieur, conférant aux espaces liminaires une fonction essentielle dans la construction de la tension tragique qui semble ainsi se concentrer dans ce lieu intermédiaire, où tout semble possible et impossible à la fois. Quoique, dans le drame albertien, la présence des seuils ne soit pas aussi prégnante que dans la pièce de Lorca, comme dans cette dernière, cependant, les premières indications scéniques de l'auto s'ouvrent, elles aussi, sur la référence spatiale à un seuil, celui de la bouche d'égout d'où va surgir l'homme « deshabité ». Elle est encore fermée au moment où le rideau se lève, comme les didascalies le précisent : « En el centro de la escena, y en primer término la gran boca cerrada de una alcantarilla »4. Elle ne s'ouvre que quelques instants plus tard, sur la vision très surprenante des pavés qui en jaillissent, avant que deux scaphandriers ne fassent leur apparition, au milieu d'un silence total : « Sola, se abre la boca de hierro de la alcantarilla y, de uno en uno, escupe cuatro o cinco adoquines. A continuación sube un buzo del subsuelo, coge una piqueta, un cubo y se va. Luego, otro que hace lo mismo, y se va 4 Rafael Alberti, El hombre deshabitado, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, p. 205. ISSN 1773-0023 32 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) también » (p. 206). Ce n'est qu'ensuite que l'Homme « deshabité » sort à son tour de cette bouche d'égout inhospitalière : « Y, tras el resplandor mortecino de una luz de acetileno, asciende, torpe, inflada hasta la exageración su máscara de buzo EL HOMBRE DESHABITADO. Se sienta junto al pozo, al lado de la luz ». C'est sur le défilé de ces trois personnages grotesques qui jaillissent de cette improbable bouche d'égout que s'ouvre l'auto, comme si, dès les premiers instants de l'action, Alberti avait choisi de proposer la vision d'une humanité problématique et inquiétante. Ces personnages, mi humains, mi mécaniques, qui se cachent derrière un surprenant costume de scaphandrier, pourraient être à l'image d'un monde en pleine mutation, dont la bouche d'égout qui leur donne vie pourrait être la métaphore. Cette dernière constitue un espace de seuil entre le chantier de reconstruction qui apparaît sur scène et les égouts eux-mêmes, qui demeurent invisibles. Ils n'en ont pas moins une importance essentielle, puisqu'ils ont tout d'un mystérieux espace utérin qui donne naissance, sous les yeux du public, aux deux scaphandriers et à l'Homme « deshabité ». Surgis de nulle part, ces derniers apparaissent sur scène en ces premiers instants de l'action, dans une mise en scène très expressionniste qui cherche peut-être à suggérer la difficulté qu'il y a à être au monde, en cette époque troublée qui semble avoir perdu tous repères. L'apparition de ces trois hommes ne peut manquer de déconcerter et d'incommoder le public qui, dès le lever du rideau, doit faire face à cette image de sa propre condition humaine. Comme les pavés qui les précèdent, ces personnages semblent jetés sur terre sans raison. L'Homme « deshabité » en fait l'expérience tout au long de l'œuvre, comme s'il semblait ne jamais devoir comprendre véritablement ce qui lui arrive, comme le montrent, par exemple, les changements de costume auxquels le soumet le Veilleur de Nuit quelques instants plus tard5. Ce n'est qu'à l'extrême fin de l'œuvre, alors même que la bouche d'égout va de nouveau s'ouvrir pour l'engloutir cette fois, qu'il comprendra que Dieu l'a trahi et qu'il n'y a rien à attendre de ce monde. Il disparaît alors dans ces bas fonds mystérieux que l'on peut considérer comme des enfers modernes auxquels l'homme ne saurait échapper, quels que soient les efforts qu'il entreprend pour s'y soustraire. C'est sans doute ainsi qu'il faut interpréter la disparition finale de l'Homme « deshabité » qui, au seuil de sa 5 Voir p. 211. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 33 vie, s'enfonce sous terre, alors que la bouche d'égout se referme inexorablement sur lui, lui refusant tout espoir de salut : EL VIGILANTE NOCTURNO : (Cogiéndole por el cuello de la chaqueta y haciendo ademán de levantarlo para arrojarlo por la boca de la alcantarilla). Ya no eres de este mundo. Tu alma ya es desprecio de las llamas. Ahora va a arder también tu cuerpo (Despacio, lo hace desaparecer). […] EL VIGILANTE NOCTURNO : (Desaparece EL HOMBRE. La boca arroja una espesa columna de humo negro. EL VIGILANTE NOCTURNO lo ahoga, echándole la tapa. Luego la cierra, dándole varias vueltas a su llave). Así. Mis juicios son un abismo profundo. (A oscuras, en silencio, desaparece por el fondo). TELÓN (p. 261). Cette bouche d'égout qui voit l’Homme surgir dans le prologue, avant de le voir disparaître à tout jamais dans l’épilogue, symbolise donc simultanément deux espaces opposés, celui de la naissance et celui de la mort, suggérant, dès lors, un effet de dualité antagonique et inconciliable, qui est à l'image de la personnalité contradictoire du Veilleur de Nuit. Incarnant de prime abord un espoir de salvation, il mène finalement l'Homme à sa perte, soulignant par là même l’impossibilité de jamais être sauvé dans ce monde moderne. À la fois démiurge et dieu vengeur, il démontre également la distance que prend Alberti par rapport au modèle de l'auto sacramental dont, pourtant, il s'inspire. L'auto célèbre traditionnellement, on le sait, l'Eucharistie, c'est-à-dire l'action de grâce6 par laquelle l'Homme exprime sa reconnaissance à Dieu pour l'œuvre de la Création et pour l'amour qu'il lui porte. Dans l'auto albertien, le Créateur, qui apparaît désormais sous les traits grotesques d'un improbable veilleur de nuit7, n'a plus rien du Dieu aimant. Il s'est détourné des hommes qu'il laisse se débattre dans les incertitudes où il les a pourtant plongés. Il n'est donc plus d'espoir de salvation, ni de rédemption sur la scène albertienne et c'est en vain que l'homme « deshabité » cherche à comprendre ce qui lui arrive. C'est la grande leçon de cette œuvre qui ne revisite le modèle de l'auto que pour mieux s'en éloigner, une dimension subversive suggérée, dès le prologue, par la présence de cette bouche 6 En grec ancien, le mot « eucharistie » signifie « action de grâce ». Voir la description qui en est faite dans le prologue : « Por el fondo, tiznada la careta, bajo una capirucha de hule, entra EL VIGILANTE NOCTURNO » [p. 207]. 7 ISSN 1773-0023 34 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) d'égout mystérieuse, dans laquelle on peut lire la volonté de transgression que le dramaturge instaure par rapport aux références chrétiennes présentes en creux. Il en dépasse les limites, pour créer un monde où le seul espoir de salut repose désormais sur l'homme et sur lui seul. C'est le sens des dernières paroles que l'homme « deshabité » adresse au Veilleur de nuit avant de s'enfoncer dans cette bouche d'égout : « Te aborreceré siempre » (p. 261). En ce début du XXe siècle, l'Homme abhorrera à tout jamais la promesse d'un monde d'espoir et de salvation qu'incarnerait une divinité. Abandonné de Dieu, il a maintenant la certitude que c'est à lui dorénavant de donner un sens à sa vie, et à lui seul. On comprend mieux, dès lors, pourquoi l'action du prologue et de l'épilogue se situe sur ce chantier de re/construction, lieu improbable où les limites du nouveau tragique et de l'homme moderne sont à réinventer. C'est sans nul doute dans Luces de Bohemia, l'œuvre la plus originale des trois, que cette problématique des seuils prend le plus d'ampleur. Elle est une des clefs fondamentales de la pièce tout entière construite sur cette tension permanente que les espaces liminaires, réels et symboliques, instaurent. Dès les premières didascalies, comme dans les deux autres œuvres, il est fait référence à l'issue qui sépare l'espace fermé de la mansarde, où se trouvent Max Estrella et sa femme, et le monde extérieur, la fenêtre étroite qui laisse entrer les dernières lueurs du jour : « Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto lleno de sol »8. Est déjà suggéré ainsi un contraste entre le monde extérieur, lumineux, et l'ambiance intime et plus sombre qui se dégage de cette scène familiale, ce même contraste qui est réaffirmé par le décor de la pièce. Les portraits, les gravures et les autographes accrochés au mur suggèrent que les habitants de cette pièce sont liés, d'une manière ou une autre au monde des arts et de la culture, ce que la modestie de l'habitat et la pauvreté du couple ne laissent pas deviner, bien au contraire. La relation oxymorique suggérée par le titre entre ces deux entités opposés, ces « Lumières de Bohème », est ainsi mise en scène plastiquement dès le lever du rideau et ce, en partie, grâce à la présence de la fenêtre, seul élément du décor qui permet d'unir l'intérieur et l'extérieur (il ne sera fait allusion à la porte — qui n'est d'ailleurs pas mentionnée dans les didascalies — que plus tard). Apparaît là un trait que l’on retrouve tout au long de l’œuvre, la 8 Ramón del Valle-Inclán, Luces de Bohemia, Madrid, Austral, 2006, p. 39. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 35 fonction plastique jouée par ces ouvertures qui constituent presque toujours une source de lumière qui vient éclairer la partie centrale des décors. Elles contribuent à former ces ambiances de clairs-obscurs et, par ces effets de lumière, elles donnent une profondeur supplémentaire aux scènes. Le jeu d’ombre et de lumière, suggéré dès le titre, devient ainsi réel sur scène, l’idée est traduite plastiquement et visuellement, ce qui révèle le soin pictural avec lequel Valle-Inclán construit les décors qui sont des éléments très signifiants de l’œuvre et ce, grâce en partie à toutes les issues qui sont bien plus que de simples éléments décoratifs. Ces espaces liminaires jouent, en effet, un rôle très dynamique dans l’œuvre. C’est, en particulier, sur ces seuils que se produisent certains des événements les plus importants de l’intrigue, comme dans cette première scène. L'arrivée du compère de Max Estrella, Don Latino, qui sera amené à jouer un rôle si important dans l'intrigue, d'abord annoncée par le bruit de la cloche qui interrompt la lecture de Madama Collet9, est immédiatement précédée par un long grincement provoqué par l'ouverture de la porte poussée par sa main, sur laquelle s'attardent, à la manière d'une caméra cinématographique, les didascalies : « Una mano cautelosa empuja la puerta, que se abre con un largo chirrido. Entra un vejete asmático, quepis, anteojos, un perrillo y una cartera con revistas ilustradas. Es DON LATINO DE HISPALIS » (I, p. 44)). C'est la première irruption sur scène d'un personnage extérieur et son apparition interrompt brutalement la tranquillité qui règne à l'intérieur (Max somnole dans son fauteuil, alors que sa femme, Madama Collet, est assise silencieusement à ses côtés : « El ciego se adormece y la mujer, sombra triste, se sienta en una silleta, haciendo pliegues a la carta del Buey Apis » (I, p. 44). Après la réception de la lettre du directeur du journal qui constitue la première menace extérieure qui s'abat sur Max Estrella (lettre que l'on pourrait fort bien considérer, au même titre que les portes et les fenêtres, comme un objet transitionnel qui fait le lien entre ces deux mondes), l'arrivée de Don Latino représente un second danger pour Max, fatal celui-ci. C'est parce qu'il accepte de le suivre que Max ne reviendra pas vivant chez lui et que sa mort entraînera à son tour celles de sa femme et de sa fille, comme cette dernière le rappelle douze scènes plus tard, devant le cadavre de son père : « ¡Si papá no sale ayer tarde, está vivo! » (XIII, p. 182). 9 Voir p. 42 « Suena la campanilla de la escalera. […] MADAMA COLLET : Claudinita, deja quieta la escoba y mira quién ha llamado. LA VOZ DE CLAUDINITA : Siempre será Don Latino ». ISSN 1773-0023 36 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) En tant qu'espace liminaire, la porte constitue donc ce lieu tragique où la vie de Max bascule vers une issue irrémédiable, la mort. Dès cette première scène, le présage en a été annoncé par ces deux augures maléfiques, la lettre du Buey Apis et Don Latino en personne, qui ont tous deux franchi cette porte, avant que le deuxième n'entraîne avec lui Max vers l'autre rive, celle du monde. Le grincement qui accompagnait l'ouverture de la porte fonctionne bien comme un signe prémonitoire, comme l'annonce de la difficulté qu'il y a pour ce poète de trouver désormais sa place dans une société en crise. L'incompatibilité entre l'univers des lettres, dont Max est le représentant brillant, et celui de la politique et de l'autorité, dont le poète est tout à la fois victime et spectateur10, est ainsi suggérée sur le pas de cette porte où le destin de Max se joue. Dès cette première scène, les seuils acquièrent donc une importance fondamentale dans la mise en scène d'un nouveau tragique dissonant et grinçant, à l'image du monde moderne, un tragique qui ne se reconnaît plus dans le modèle de la tragédie classique et en invente une nouvelle expression, l'esperpento. C'est dans la scène 12 de l'œuvre que cet esperpento voit le jour, après que Max et les siens ont franchi les seuils de lieux aussi différents qu'une librairie, une taverne, un commerce de beignets, un ministère, une cellule de prison, la rédaction d'un journal, le bureau d'un ministre, un café ou un jardin public, des lieux dont chacune des portes s'est refermée sur le spectacle d'un univers grotesque et tragique, où la médiocrité et la bassesse l'emportent toujours sur l'intelligence et la solidarité. Après ce chemin de croix qui l’a mené de station en station dans les rues de Madrid, Max s’éteint dans cette scène 12, sur le pas de la porte de sa maison, après avoir tout juste terminé d’exposer la théorie de l’esperpento. Cette scène est conçue, tout à la fois, comme un aboutissement et comme un avènement. Ce double mouvement paradoxal et dialogique — à l'image de l'esperpento — se traduit par des effets de mise en scène très précis, qui jouent à la fois sur la spatialité et la temporalité. Dans l’un et l’autre cas, on retrouve un jeu sur les seuils tout à fait significatif, qu’il s’agisse de seuils réels — les portes, devant lesquelles la totalité de la scène se déroule — ou du seuil auroral produit par le recul de l’obscurité et l’arrivée progressive du jour. Ainsi, la scène se déroule dans une ambiance 10 Il en est aussi le complice, si l'on songe qu'il accepte l'argent du Ministre, celui-là même qui, du fait de sa position, est le responsable de la mort du prisonnier catalan, ce qui montre bien toute l'ambiguïté que peut parfois incarner le personnage de Max. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 37 très particulière ni nocturne, ni diurne, ni tout à fait extérieure, ni tout à fait intérieure, dans un entre-deux presque improbable où se joue, certes, le destin de Max qui va bientôt mourir, mais surtout celui de la tragédie et de l’esperpento. L’affirmation de Max selon laquelle « la tragedia nuestra no es tragedia » (XII, p. 167), c’est-à-dire l’affirmation simultanée de l’existence de la tragédie et de son impossibilité ne traduit-elle pas une tension identique à celle que les seuils spatiaux et temporels suggèrent ? Être ou ne pas être tragique, c’est en somme toute la question de l’esperpento. Dès les didascalies initiales, cette tension liminaire est suggérée, comme le montre la mention aux portes qui est faite à plusieurs reprises, celle devant laquelle Max et Don Latino sont assis, mais celles aussi que les veilleurs de nuit ne surveillent plus, mais que les concierges ne gardent pas encore : DON LATINO y MAX ESTRELLA filosofan sentados en el quicio de una puerta. […] Ya se han ido los serenos, pero aún están las puertas cerradas. Despiertan las porteras. (XII, p. 165) Quelques instants plus tard, à peine terminé l’exposé de l’esperpento, Max fait allusion à une nouvelle porte, la sienne, où il veut aller mourir : « Idiota, llévame a la puerta de mi casa y déjame morir en paz » (XII, p. 171). C'est là, en effet, qu’il va mourir presque à la fin de la scène, comme il l’avait annoncé : « MÁXIMO ESTRELLA se tiende en el umbral de su puerta » (XII, p. 173). C’est là également que son corps va être découvert (« El cuerpo del bohemio resbala y queda acostado sobre el umbral, al abrirse la puerta » (XII, p. 176)), après que les première rumeurs du jour se seront élevées derrière les portes encore fermées (« Finalmente se eleva tras de la puerta la voz achulada de una vecina. Resuenan pasos dentro del zaguán » (XII, p. 175)). Les derniers instants de sa vie sont ainsi simultanément associés à l’esperpento, auquel il donne naissance, et à cette porte qui ne s’ouvre que lorsqu’il meurt. Les limites entre fin et commencement s’estompent donc et ne demeure désormais plus, après la disparition de Max, que l’esperpento, cette structure oxymorique où les contraires s’unissent et où l’antithèse est revisitée, comme tous les espaces liminaires de cette scène et des précédentes le suggéraient déjà. ISSN 1773-0023 38 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Cette fusion des contraires est visible aussi, on l’a dit, à un autre niveau, celui du temps, puisque l’ensemble de la scène se déroule alors que l’obscurité de la nuit recule, mais que l’aube point à peine et que les premiers oiseaux commencent timidement à chanter sur la corniche de l’église (un nouveau lieu excentrique et liminaire) : « A lo largo de su coloquio, se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos albores de amanecida » (XII, p. 165). Au fur et à mesure que la scène se déroule, l’aurore se lève et Valle-Inclán fait coïncider très exactement la mort de Max Estrella avec l’extinction de la dernière étoile dans le ciel : « El ojo legañoso, como un poeta, levantado al azul de la última estrella ». (XII, p. 173). L’apparition de l’esperpento s’accompagne ainsi de la disparition, sur terre comme au ciel, de ces deux astres, condamnés à s’éteindre pour que ce nouveau genre puisse voir le jour. Cela ne signifie-t-il pas que l’esperpento est invité à occuper la place laissée vacante par la tragédie, comme si lui seul pouvait désormais refléter une réalité à ce point dégradée qu’elle refuse le secours de la tragédie ? « El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada», explique, en effet, Max, avant de mourir sur le pas de chez lui. Cette esthétique de la déformation ne se confondrait-elle pas alors avec cette poétique des seuils, comme si ces espaces liminaires et ces lieux de passage étaient les seuls lieux où pouvait maintenant s’exprimer ce sentiment tragique qui a abandonné le centre de la scène pour se réfugier sur de nouveaux territoires excentrés, à la frontière de différentes tonalités — le tragique, le comique, le grotesque… —, de différents genres et de différents arts — le théâtre, la peinture, le cinéma…? L’étude des seuils dans Luces de Bohemia le laisse penser, comme a pu en apporter la preuve l'analyse de la scène 1 et de la scène 12. De nombreux autres passages de l'œuvre confirmeraient ces conclusions. L'on pourrait songer, par exemple, aux différents espaces que Max se voit obligé de franchir avant que ne s'ouvre, enfin, la porte du bureau du ministre dans la scène 8 et que la figure grotesque et caricaturale de ce dernier n'apparaisse, sans que l'huissier, celui qui pourtant doit veiller sur les issues, n'ait pu empêcher Max d'arriver jusquelà : « Su Excelencia abre la puerta de su despacho y asoma en mangas de camisa, la bragueta desabrochada, el chaleco suelto y los quevedos pendientes de un cordón, como dos ojos absurdos bailándole sobre la panza » (VIII, p. 126). La tension tragique qui a grandi au fur et ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 39 à mesure des épreuves que Max a dû affronter dans les scènes précédentes (son arrestation, son incarcération qui l'a amené à rencontrer le prisonnier, l'impossibilité de se faire entendre…) et des espaces qu'il a franchis s'évanouit brutalement à la vue de Son Excellence. Son apparition sur le seuil de cette porte est comique, mais elle a un goût pourtant bien amer, surtout si l'on songe que cet homme difforme est l'un des plus hauts représentants de l'État et que Max s'apprête à accepter son argent et à devenir complice de l'assassinat du prisonnier catalan. La scène n'en est, en définitive, que plus grinçante, comme l'est l'esperpento luimême, que l'on pourrait considérer, Manuel Aznar Soler nous y invite, comme « une harmonie des contraires »11 qui se joue sur le seuil du tragique et du grotesque. La preuve en est donnée tout au long de l'œuvre qui accorde à tous les espaces liminaires une importance si grande. C'est sur ces seuils donc que prend forme l'esperpento, sur ces lieux intermédiaires qui marquent la frontière — symbolique et plastique — entre deux lieux ou deux plans distincts. On ne peut qu'être frappé, en effet, par l'importance qu'accorde Valle-Inclán à la confrontation entre ces espaces antagoniques. La tension tragique y jaillit toujours, avant d'être supplantée par le grotesque de l'esperpento. Ainsi, dès le début de l'œuvre, il s'établit une tension entre les différents plans où se déroule l'intrigue, comme le révèle une analyse attentive des premières scènes. Alors que Max et Don Latino sont réunis dans la librairie de Zaratustra en compagnie de Don Gay et qu'ils discutent avec ce dernier, le spectateur voit passer au second plan, derrière la vitrine de la librairie, un groupe de policiers tenant un homme menotté, sans doute le prisonnier catalan : « Un retén de polizontes pasa con un hombre maniatado. Sale alborotando el barrio un chico pelón montado en una caña, con una bandera » (II, p. 55). La référence aux forces de police est fugace, comme l'est celle aux manifestations de rues, les unes et les autres étant encore à peine visibles et audibles. Très vite, cependant, leur présence acquiert une importance croissante, au point d'envahir progressivement le premier plan de l'action. Le garçon de café est le premier, à la fin de la scène 3, à porter les stigmates de la violence de l'extérieur à l'intérieur. Son entrée interrompt les discussions des clients, rattrapés 11 Voir, en particulier, l'analyse qu'il propose de Luces de Bohemia dans l'article « Luces de Bohemia : teoría y práctica del esperpento », in Margarita Santos Zas et alii (eds.), Valle-Inclán (1898- 1998) : Escenarios, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2000, p. 339-360. ISSN 1773-0023 40 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) soudain, comme Max, par ce qui se passe au-delà des murs de la taverne de Pica Lagartos et qu'ils ne pourront bientôt plus ignorer : « EL CHICO DE LA TABERNA entra con azorado sofoco, atado a la frente un pañuelo con roeles de sangre. Una ráfaga de emoción mueve caras y actitudes, todas las figuras, en su diversidad, pautan una misma norma » (III, p. 71). Quelques instants plus tard, ce sont des manifestants qui entrent à leur tour dans le café : « Entran en la taberna obreros golfantes —blusa, bufanda y alpargata— y mujeronas encendidas, de arañada greña » (III, p. 72). L'on a beau se dépêcher de fermer portes et fenêtres, comme les didascalies l'indiquent dans cette scène et dans la suivante (« Resuena el golpe de muchos cierres metálicos » (III, p. 73), « se cierra con golpe pronto la puerta de la Buñolería » (IV, p. 84)), cela ne saurait suffire. La violence se fait de plus en plus présente, visuellement et auditivement, à travers, par exemple, les morceaux de verre que Max foule au début de la scène 4 (« Yo voy pisando vidrios rotos », remarque-t-il (IV, p. 75)), à travers la patrouille de soldats qui vont l'arrêter (« ¡Por borrachín, a la Delega! » ordonne le Capitaine Pitito (IV, p. 85)) ou à travers encore les coups portés aux prisonniers derrière les portes closes des cellules (« Se oyen estallar las bofetadas y las voces tras la puerta del calabozo » (V, p. 98)). Tout au long des scènes suivantes, Max sera confronté de plus en plus directement au spectacle de ce monde autoritaire et violent qui envahit progressivement le devant de la scène, jusque dans la scène 11, où la tension tragique culmine, avec le spectacle de la mort de l'enfant. Les deux mondes, qui étaient jusqu'alors séparés par une porte ou une vitrine, se font face désormais. Quoique encore quelque peu en retrait sur les trottoirs (« Un grupo consternado de vecinas, en la acera » précisent les indications scéniques (XI, p. 159)), les femmes qui entourent la mère qui tient son enfant mort dans ses bras doivent affronter l'indifférence, le mépris et la bassesse de leurs adversaires, ces représentants de l'ordre et du commerce que sont l'Usurier, le Garde ou le Tavernier. Aux cris de détresse de la mère répond la brutalité du cafetier et de ses compères (« Son desgracias inevitables para el restablecimiento del orden » (XI, p. 160)), contrepoint abject de la douleur tragique. Max ne s'y trompe pas :« ¡Me ha estremecido esa voz trágica! » s'écrie-t-il devant ce spectacle (XI, p. 160). Il est ému par l'intensité de cette voix tragique qui ne parvient pourtant pas à se faire ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 41 entendre, au milieu de ces répliques pleines de vilenie et de bassesse. Car il n'est plus de place pour la tragédie, supplantée désormais par cette mascarade tragique, cette « trágica mojiganga » (XI, p. 164), que l'esperpento met en scène. C'est pour cela que Max quitte ce « cercle infernal » où la tragédie ne parvient plus à s'exprimer, pour se réfugier sur le pas de la porte de sa maison, cet ultime lieu liminaire où seul l'esperpento a sa place. Ce qui se joue dans ces espaces frontaliers, c’est bien le reflet de la quête tragique qui anime cette œuvre, comme celles d’Alberti et de Lorca, mais c’est aussi, tout à la fois, le signe des difficultés qu’il y a à la combler, une difficulté à l'image de celle que rencontre l'homme pour trouver sa place dans le monde, les seuils devenant désormais les seuls lieux où la nouvelle condition de l'homme et du monde peut être mise en scène. Cette tension irréconciliable apparaît nettement dans La casa de Bernarda Alba, quoiqu'elle se manifeste sous une forme distincte de l'esperpento de Luces de Bohemia. Dans cette œuvre, qui est la dernière écrite par Lorca, les seuils constituent moins des lieux de passage que des séparations entre deux espaces et l'impossibilité — ou, du moins, la difficulté — qu'il y a à franchir ces passages symbolise les nouvelles limites tragiques auxquelles se heurte l'homme. L'œuvre met en scène un huis clos tragique, qui se joue entre les murs de la maison de Bernarda Alba, un lieu entièrement fermé sur lui-même et ceint de murs, où Bernarda fait régner une discipline de fer et tient ses filles enfermées. Toute la tension de l'œuvre repose sur la volonté de ces jeunes filles de franchir les limites de la maison et sur les stratégies qu'elles inventent pour y parvenir, des manœuvres qui se heurtent sans cesse à l'autorité implacable de leur mère. Dans cet affrontement spatial et filial, les portes et les fenêtres revêtent une importance primordiale. Au cœur de l'action tragique, elles ont pourtant chacune une fonction différente qui tient au type de limite qu'elles instaurent entre la maison et le monde extérieur. La fenêtre n'est, en effet, qu'une semi ouverture sur l'extérieur, alors que la porte constitue une espace qui peut être entièrement franchi. La première ne représente qu'une échappée auditive et visuelle vers l'espace du dehors, alors que la seconde est un véritable lieu de passage. En cela, la fenêtre constitue un seuil trompeur, qui ne donne que l'illusion de la liberté. Angustias a ISSN 1773-0023 42 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) beau retrouver chaque soir Pepe el Romano devant sa fenêtre, ce n'est pas pour autant que cette rencontre rend possible l'épanouissement d'un amour sincère entre les deux. Pour preuve, la froideur et le détachement qui affectent Pepe, lorsqu'il se retrouve face à elle, comme Angustias le confesse. « Yo le encuentro distraído. Me habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta: « Los hombres tenemos nuestras preocupaciones » (III, p. 250), explique-t-elle à sa mère, avant de reprendre : « Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños » (III, p. 251). Les grilles de fer apposées aux fenêtres et le nuage de poussière, qu'Angustias croit déceler sur le visage de son fiancé, renforcent la distance spatiale et affective qui sépare les deux personnages. La nue toute symbolique qui semble entourer le visage de Pepe représente métaphoriquement — et, sans doute, psychanalytiquement aussi — la trahison du personnage qui, à Angustias, sa fiancée officielle, préfère sa sœur cadette, Adela. Elle marque également la frustration du désir qui étreint Angustias, condamnée derrière sa fenêtre à ne jamais être aimée de Pepe. À l'inverse, Adela en est aimée, elle qui, contrairement à sa sœur aînée, a franchi une double limite, celle de la fenêtre d'abord, derrière laquelle elle retrouve, quelques heures après Angustias, Pepe, cette fenêtre derrière laquelle elle commence par se montrer nue, alors que Pepe passe dans la rue, de l'autre côté (« ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana? », lui demande la Poncia à l'acte 2 (II, p. 204)) et dont elle a fini très vite par se rapprocher pour lui parler. Elle ne se contente pas de ce premier acte transgressif, puisqu'elle franchit une seconde limite, celle de la porte d'entrée de la maison, comme le spectateur le soupçonne très vite et comme Adela elle-même finit par le dire à Martirio. Alors que cette dernière demeure, quant à elle, emmurée dans l'amour impossible qu'elle ressent pour Pepe, Adela confesse qu'ils sont amants et qu'ils se retrouvent loin de la maison, près de la rivière : « Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla » (III, p. 272). L'espace de liberté qu'Adela est parvenue à conquérir se situe loin des murs de la maison, bien au-delà de ce double seuil que constituent les fenêtres et les portes. Seuls ceux qui sont capables, comme elle, de franchir cette double ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 43 frontière peuvent accéder à l'amour. La réalisation du désir passe donc nécessairement par la transgression. Cette double frontière que franchit Adela marque aussi la limite du nouveau tragique, puisque, comme le veut la tragédie moderne, quiconque franchit les limites qui lui sont imposées est puni. Croyant à tort que Pepe a été tué, Adela se suicide à la fin de l'œuvre, sa mort marquant l'impossibilité de jamais être tout à fait libre, comme elle en fait l'expérience tragique. En définitive, dans ce nouveau tragique, l'individu n'est jamais aussi peu libre que lorsqu'il croit avoir atteint cette véritable liberté qui passe par la conquête de l'espace du désir. Les seuils qu'Adela a franchis successivement sont trompeurs, ils n'ouvrent pas sur la liberté, mais sur son déni, ce qui constitue le véritable tragique. Ils deviennent ainsi les lieux privilégiés de la tension tragique, qu'ils soient réels, comme les portes et les fenêtres que l'on vient d'analyser, ou plus symboliques, comme la censure qui s'exerce sans cesse sur le langage et qui constitue, avec les issues précédentes, les nouvelles limites du tragique. Ce qui se joue, en effet, au niveau du langage est à l'image de ce qui se passe au niveau des portes et des fenêtres. On y retrouve cette même tension inconciliable entre deux positions antagoniques, la parole et le silence, comme de nombreux critiques l'ont montré, définissant à juste titre La casa de Bernarda Alba comme une tragédie du silence. Dire ou ne pas dire, franchir ou ne pas franchir ne sont jamais que la déclinaison de ce nouveau tragique qui s'exprime dans cette limite ténue et, pourtant, si dense, entre deux attitudes définitivement incompatibles. Le tragique qui renaît dans le théâtre espagnol au début du XXe siècle trouve, donc, dans ces espaces liminaires et dans ces seuils un lieu d'expression privilégié. Le nouveau tragique dépasse les limites de la tragédie classique et en invente de nouvelles, à la charnière de toutes les contradictions et de toutes les discordances. Le tragique devient ce lieu interstitiel, plein des incertitudes où ce nouveau siècle a plongé l'homme qui se débat dans un monde où il peine à trouver sa place. C'est là que s'expriment, désormais, toutes les difficultés qu'il y a pour l'homme de se construire et pour l'art de mettre en scène un monde si complexe. Mais ISSN 1773-0023 44 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) c'est là aussi, dans ce nouveau tragique, que le théâtre trouve un espace où il peut se réinventer et créer de nouveaux modèles, à la confluence de limites inédites, philosophiques et esthétiques. ISSN 1773-0023 45 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE LUCES DE BOHEMIA, LA «TRAGEDIA NUEVA» DE RAMON DEL VALLEINCLAN Jean-Marie LAVAUD Université de Bourgogne Hace muy poco, escribí que para una justa apreciación de una obra tan emblemática eran necesarios unos hitos y mencionaba la Historia y el compromiso ideológico de Valle-Inclán1. Ahora, quiero puntualizar el entorno literario y artístico del que surge Luces de bohemia2. Centrando su atención «en la atmósfera teatral en la que Valle estaba siempre metido, ya actor, ya autor», Alonso Zamora Vicente3 recalca la importancia del género chico y de la parodia para entender el uso de procedimientos como la muñequización de los personajes, el lenguaje que usan, un lenguaje «que es una difícil síntesis de elaborada lengua literaria salpicada de citas con expresiones de jerga y género chico o lo grotesco utilizado en el periodismo para realizar crueles sátiras políticas en revistas como Gedeón, o, ya en los 1 Jean-Marie Lavaud, « Luces de bohemia, expression d’une position idéologique et esthétique » in Begoña Riesgo (coord), Le retour du tragique. Le théâtre espagnol aux prises avec l’histoire et la rénovation esthétique, Paris, Éditions du Temps, 2007, p. 16-33. 2 Ramón del Valle-Inclán, Luces de bohemia, esperpento, Madrid, Renacimiento, 1924. Luces de bohemia (Esperpento) había aparecido primero como folletín de la revista madrileña España, del 31 de julio al 7 de agosto de 1920. Constaba entonces de 12 escenas, siendo las escenas 2, 6 y 11 escenas añadidas en la obra editada. 3 Alonso Zamora Vicente, La realidad esperpéntica, Madrid, Gredos, 1974, p. 57. ISSN 1773-0023 46 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) aledaños de Luces de bohemia, en España»4 prosigue Jesús Rubio, quien muestra «la importancia en la configuración de Luces de bohemia de un género híbrido, fruto de los entrecruzamientos entre teatro y prensa y que, además, compartió para su difusión escenarios y publicaciones periodísticas: la revista teatral política»5: Es curioso que habiéndosele otorgado al esperpento una dimensión de teatro político, sin embargo se ignore su inserción en la tradición del teatro político coetáneo, que se manifiesta en subgéneros como la revista teatral política. […] No creo que sea inoportuno carear los esperpentos con estas piezas de teatro político español, cuestión distinta es que Valle-Inclán lo lleve a una categoría superior, no utilizando mecánicamente los recursos de la revista teatral política sino para construir una moderna tragedia6. La revista teatral política se sitúa pues al final de una serie que empieza con las revisiones de acontecimientos en los almanaques y en publicaciones periódicas, donde «el desarrollo del periodismo de opinión y de la literatura costumbrista» hicieron común «el termino revista en las cabeceras y en secciones, como “la revista de la semana”»7, aludiendo así a su carácter de repaso de acontecimientos de actualidad. Jesús Rubio propone pues una matriz para Luces de bohemia: la revista teatral como una sucesión de escenas repasando acontecimientos, en ocasiones con la inclusión de caricaturas de personas reales. El autor crea un espacio alegórico-simbólico con suficiente funcionalidad teatral o sencillamente representa sobre la escena espacios conocidos por los espectadores en los que hace moverse a sus personajes8. Se impone el paralelismo con La Gran Vía, la revista de 1886, un paralelismo que hace aparecer la similitud de los procedimientos. En ella, se realiza un primer recorrido por las calles madrileñas gracias a unos recursos alegóricos personificadores que hacen desfilar por la 4 Jesús Rubio, «Luces de bohemia: la revista teatral política en el callejón del Gato», in Margarita Santos Zas et alii (eds.), Valle-Inclán (1898-1998), Escenarios, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2000, p. 389. 5 id., p. 390. 6 id., p. 403. 7 id., p. 393-394. 8 id, p. 398. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 47 escena determinadas calles, mientras que El Caballero de Gracia y El Paseante en Corte recorren otras, permitiendo tal procedimiento organizar oposiciones y conflictos entre el viejo Madrid y el Madrid moderno personificado por la Gran Vía. No están ausentes las afueras donde «se encuentran los barrios bajos en estado cruel»9. Jesús Rubio hace observar cómo desfilan ante los ojos de la pareja de personajes «tipos populares: la criada Menegilda, los Ratas y el falso Paleto… Se realiza una sátira de los Diputados…»10. Las revistas ofrecen pues a Valle-Inclán un molde y unos recursos teatrales: la introducción de un diálogo entre dos personajes da unidad a unas escenas aparentemente sueltas, es un elemento estructurador, como lo es el motivo del viaje de un provinciano a la capital, un recurso costumbrista que hace descubrir la capital por unos ojos inocentes. Lo fundamental y común a muchas obras es la idea de «pasar revista» y ofrecer los comentarios y reflexiones de una pareja. La versión definitiva de Luces de bohemia es una sucesión de quince escenas en las que se pasa revista a un periodo de la historia española, concretándolo en el recorrido que realizan por distintos lugares de Madrid […] el poeta ciego Max Estrella y Don Latino hasta la muerte y el enterramiento del primero en las últimas escenas. Lugares y personajes se van sucediendo y el resultado es una descarnada sátira de la vida política y social de la Restauración11. Estas pocas frases de presentación de Jesús Rubio, aisladas de su contexto, inscriben Luces de bohemia, esperpento en el subgénero de la revista teatral política. La palabra esperpento funciona como subtítulo o comentario del título, lo que es la norma en los títulos de ValleInclán: por ejemplo, Águila de blasón, comedia bárbara, Voces de gesta, tragedia pastoril, La marquesa Rosalinda, farsa sentimental y grotesca, Divinas palabras, tragicomedia de aldea12. Quedemos, de momento, con que la revista política marca la forma teatral matriz de Luces de bohemia. Por otra parte, Jesús Rubio observa también que 9 Felipe Pérez y González (libreto) y Federico Chueca (música), La Gran Vía, Revista madrileña cómico-líricofantástico-callejera en un acto y cinco cuadros, (Estudio, análisis musical y comentarios de Roger Alier), Barcelona, Daimón, 1986. 10 Jesús Rubio, «Luces de bohemia: la revista teatral política …», p. 400. 11 id., p. 403. 12 Jean-Marie Lavaud, «Valle-Inclán y la comedia», in Margarita Santos Zas et alii (eds.), Valle-Inclán (18981998), Escenarios…, p. 241-269. ISSN 1773-0023 48 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) las revisiones de acontecimientos eran comunes en almanaques […] y en otras publicaciones periódicas donde el desarrollo del periodismo de opinión y la literatura costumbrista hicieron en pocos años habitual el término revista en las cabeceras y dentro de ellas en secciones como la «revista de la semana»13. La literatura costumbrista, en su afán de catalogar las costumbres y luego juzgarlas, generó artículos que pretendían «pasar revista» a la ajetreada vida urbana, introduciendo valoraciones morales, por lo general satíricas. Los escritores costumbristas se afanaron en pintar las costumbres particulares del día, dándole al término un alcance tanto moral como plástico y la imaginería pictórica se hizo habitual de tal forma que se identificó el pincel con la pluma y surgieron elocuentes variaciones —pintura, bocetos, cuadros, copia, original, bosquejos, linterna mágica, daguerrotipos, fotografías—, todas ellas tendentes a la visualización del ejercicio imitativo que se efectúa en las páginas costumbristas14. Así convergen las nociones de escena teatral y de cuadro de costumbres. «Las escenas “sueltas” del esperpento, su relativa autonomía en la economía total de la obra a la que pertenecen, tienen que ver con este carácter de cuadro»15. Por allí puede entrar Luces de bohemia en la gran tradición de la literatura de costumbres. Jesús Rubio apunta que, luego, se hizo habitual la convivencia de textos e imágenes en las revistas, alcanzando singular desarrollo la prensa ilustrada entre la cual tiene éxito la revista ilustrada satírica donde aparecen las caricaturas. Concluye: «en la prensa satírica ilustrada, en la revista teatral política y en el esperpento pintura y literatura se dan la mano para representar la vida contemporánea»16. En la perspectiva de la pintura de las costumbres madrileñas, mientras la capital entra en la modernidad, Luces de bohemia es un momento fuerte, «una de las primeras manifestaciones literarias de Madrid como ciudad moderna y cosmopolita» según Dru Dougherty17. 13 Jesús Rubio, «Luces de bohemia: la revista teatral política…», p. 393-94. Leonardo Romero Tobar, Panorama crítico del romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994, p. 416-417. 15 Jesús Rubio, «Luces de bohemia: la revista teatral política …», p. 394. 16 id., p. 403. 17 Dru Dougherty, «La ciudad moderna y los esperpentos de Valle-Inclán», ALEC, 22, 1997, p. 131-147. Citado por Jesús Rubio, «Luces de bohemia: la revista teatral política …», p. 403. 14 ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 49 Llama la atención la división de la obra entre quince escenas, cuando no se trata de una estructura en actos de los que las escenas son los segmentos naturales cortados en función de las entradas y salidas de los personajes. En realidad, Valle-Inclán ofrece una serie de cuadros y el cuadro, según Patrice Pavis, es «una unidad espacial de ambiente; caracteriza un medio o una época; es una unidad temática y no actancial». Además, la «escena» de Luces de bohemia corresponde a lo que escribe Pavis a propósito del cuadro: La aparición del cuadro está ligada a la de los elementos épicos en el drama: el dramaturgo no centra su foco en una crisis, descompone una duración, propone fragmentos de un tiempo discontinuo. No se interesa por el desarrollo lento, sino por las rupturas de la acción. El cuadro le proporciona el marco para una encuesta sociológica o una pintura de género18. Tanto la filiación literaria como la semiología dramática convergen para decir que la obra consta de cuadros, elementos de la literatura de costumbres y que asoman otros elementos de lo que vino a conocerse más tarde como teatro épico, una dimensión que sólo menciono aquí. Desde luego, hasta ahora, no aparecieron elementos relacionados a priori con lo trágico. La fuerte y compleja estructura y organización de Luces de bohemia corrige esta perspectiva: Luces de bohemia es más. Primero, se puede afirmar la rigurosa circularidad de una obra cuya acción consta de doce secuencias. Max aprende en la escena I que el periódico que le encargaba colaboraciones se las quita y ve abrirse «la puerta de la muerte»19; morirá delante de la puerta de su casa en la escena XII. También en la primera escena, Madama Colette rechaza el suicidio colectivo propuesto por Max; se aprende en la última «la muerte misteriosa de dos señoras en la calle de Bastardillos» (XV, p. 211), de «el tufo de un brasero» (XV, p. 212). Siempre en la primera escena, Don Latino trae a Max el dinero de la venta de libros y, escena siguiente, le descubrimos cómplice del librero para robar a Max; en la última escena, Don Latino se hace rico con el billete de lotería robado en la cartera de Max. Otro elemento de esta circularidad es la alucinación de Max que evoca un París brillante en la 18 Patrice Pavis, Diccionario del teatro, Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós, 1998, p. 104b105a. 19 Ramón del Valle-Inclán, Luces de Bohemia, Madrid, Austral, 2006, p. 40. ISSN 1773-0023 50 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) primera secuencia, que reaparecerá en la postrera alucinación de la escena XII, cuando presencia su propio entierro confundido con el de Victor Hugo. Por fin, en la última réplica de la primera escena, Claudinita avisa que todo va a acabar «en la taberna de Pica Lagartos» (I, p. 49), y es la escena siguiente, la escena segunda; pero el telón final vuelve a caer sobre la decoración de la misma taberna. Refuerzan esta circularidad las escenas añadidas, II, VI, XI, cuyo elemento conector es el preso catalán, testimonio de la represión policial contra el obrerismo y el anarquismo con la denuncia de la «ley de fugas». Ahora bien, Gregorio Torres Nebrera señala que «tal circularidad… genera una red de correspondencias, de simetrías que es el otro principio modelador en el que se sustenta la estructura formal de Luces de bohemia»20. Añade: Pienso que todas y cada una de las quince secuencias en las que, finalmente, fragmentó Valle su esperpento se reflejan en otra u otras del resto del conjunto, estableciendo parejas o haces de tres unidades que, caso a caso y en la suma total, patentizan sobradamente ese diseño de fatal circularidad21. Para él, la organización de la obra responde a una fórmula matemática, resultado de una combinación de cifras mágicas, la 3 y la 5 (3 por 5 = 15). Es decir, las quince escenas que articulan el esperpento en su versión definitiva se distribuyen en cinco bloques de tres escenas cada uno, funcionando como bloque central, eje divisorio de esa composición, el bloque tercero, y procediéndose a una correspondencia simétrica de los cuatro bloques de tres secuencias que se distribuyen a un lado y otro de ese bloque central22. Apoyándose en la teoría esperpéntica expuesta por Max, el crítico da la interpretación siguiente: «los bloques de escenas 4 y 5 son la imagen resultante de los dos primeros bloques tras proyectarse en el espejo cóncavo del bloque tercero (escenas VII, VIII y IX) y en la conciencia progresivamente crítica de Max Estrella»23. En el esquema dibujado y glosado de 20 Gregorio Torres Nebrera, «La matemática perfecta del espejo cóncavo: acerca de la composición de Luces de bohemia», Anthropos, 158-159, julio-agosto 1994, p. 82. 21 ibid. 22 ibid. 23 id., p. 83. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 51 los cinco bloques de tres escenas, el tercer bloque de tres escenas (VII-VIII-IX) tiene de cada lado dos grupos I-II-III, IV-V-VI por una parte, y X-XI-XII, XIII-XIV-XV por otra parte, analizados de esta forma por el crítico: I/XIII, II/XIV, III/XV, IV/X, V/XI, VI/XII, VII/IX. Tanto el análisis de Torres Nebrera como el de Muriel Lazzarini-Dossin se concentran en la estructura en cinco bloques con las correspondencias antes citadas. Torres Nebrera señala otra distribución, complementaria de la anterior, que introduce ahora el elemento matemático y mágico del número 7 […]. Dos bloques homogéneos de siete secuencias cada uno, y que se corresponden entre sí escena a escena, están separados por una escena central, la número ocho, que sería la escena que actuaría de verdadera lente convergente, pues a partir de ella […] las escenas siguientes serán la deformación de las caras y de “toda la vida miserable de España”; pero una deformación hecha “con matemática de espejo cóncavo”, es decir, presidida por la simetría24. Torres Nebrera señala pues una doble especularidad, pero no da concretamente el segundo esquema, lo que se puede hacer modificando la dirección de las flechas desde la escena VIII hacia las escenas IX-XV. Propongo abajo un cuadro sencillo que pone la escena VIII en el 24 ibid. ISSN 1773-0023 52 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) centro, con los bloques I a VII y IX a XV de cada lado, lo que recalca los paralelismos entre las escenas I/XV (y no I/XIII), II/XIV, etc., I <--> XV II <--> XIV III <--> XIII IV <--> XII V <--> XI VI <--> X VII <--> IX VIII Desde luego esta estructura, con sus paralelismos, no impide que las escenas tengan más simetrías y más ecos. Por ejemplo, esta estructura pone de relieve la función del billete de lotería con su número capicúa, con las cifras que eran unas cifras mágicas para el propio Valle-Inclán —desde mucho atrás y él mismo lo declara en varias ocasiones y en especial a propósito de Tirano Banderas. El billete con sus números viene a ser algo como el resumen de la estructura de la obra. Esta organización matemática de Luces de bohemia, esperpento, invita a analizar la obra respetando simetrías y correspondencias, y evidencia el rigor de la escritura de don Ramón, rigor muy alejado de la facilidad malabarista de la revista teatral política. ¿Cómo se puede pasar del molde de la revista, de unos cuadros de costumbres, de la sorna alegre del género chico a Luces de bohemia? ¿Por qué? ¿Para qué? Sólo podré contestar después de analizar las correspondencias que señalo en el último cuadro. Primero, las escenas I-XV. Ya con la escena I, la extrema pobreza que padece Max y su familia es el elemento trágico axial de la construcción del personaje. De ella se deriva la acción, es decir la salida de Max por las calles de Madrid. Esta pobreza tiene un origen humano: la engendra el director del periódico cuando rechaza las colaboraciones de Max Estrella quien llega a proponer un suicidio colectivo a su mujer. Aparece entonces una fatalidad de la pobreza en el sentido más estricto de la palabra; esta fatalidad mata, y el suicidio de las dos mujeres acaece en la última escena XV, cuando los periódicos preguntan: ¿crimen o suicidio? Es indudable el suicidio, ya que se realiza tal como lo propuso Max en la ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 53 primera escena, pero, al mismo tiempo, es un auténtico crimen por parte de don Latino quien robó el billete de lotería que hubiera salvado las dos mujeres. La escena XV trata del estrepitoso y escandaloso enriquecimiento de don Latino: recalca más aún el sistema de oposiciones isotópicas de la pareja dramática Max/Don Latino que se instaura desde la primera escena y en la que la figura del protagonista se enfrenta a su contrafigura, y sus valores a unos contra-valores en una unión de contrarios que, a veces, y de forma tragi-grotesca, se confunden en un perverso y trágico juego de dobles con la pérdida consiguiente de personalidad del protagonista trágico. Esta escena XV muestra que, aunque esencial, la muerte del héroe trágico, del protagonista trágico, no es el momento cumbre, el justo anterior a la bajada del telón. Aquí rige un trágico de la continuidad, de la fatalidad de la pobreza, que ha destruido la totalidad del núcleo familiar presentado en la escena 1. Segunda pareja de escenas, las II y XIV acentúan la presión de la pobreza. En vano intenta Max recuperar algo de dinero de Zaratustra, el librero cómplice de don Latino para aprovechar su ceguera y robarle. Aquí, en medio de una discusión literaria, y más allá del ser personal y su miseria, unas réplicas de Max evidencian cómo la condición trágica alcanza al ser cultural cuyos valores ya no rigen en la sociedad en que vive: «la miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte […] Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras» (II, p. 57-58). Sintomáticamente, la réplica termina aludiendo a los novelones por entregas, repartidos por don Latino, alimento por excelencia de aquella sensibilidad chabacana. A partir de este momento, lo trágico, primero concentrado en el microcosmos familiar, se va ensanchando en las siguientes escenas hasta alcanzar, en la escena VIII, el macrocosmos nacional con el Ministerio de la Gobernación. A la escena II corresponde la XIV, a la librería-cueva corresponde la fosa del cementerio que cierran los sepultureros. Las paredes están cubiertas de placas como las de la cueva de Zaratustra están cubiertas de «rimeros de libros». En boca de un hombre del pueblo (un sepulturero), se oye como un eco del pesimismo de Max en la escena II: «En España, el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo» (XIV, p. 191). De la misma forma, el diálogo literario entre Bradomín y Rubén Darío ISSN 1773-0023 54 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) hace eco al de la escena II: el jornal de tres pesetas de los sepultureros corresponde a la cantidad que cobró Max para la venta de los libros, sólo que, al revés de Zaratustra, y aunque arruinado él también, Bradomín les regala un dinerito. Las escenas III y XIII se desarrollan bajo el signo del dinero y de la fatalidad. La primera se verifica en la Taberna de Pica Lagartos donde Max le devuelve a La Pisa bien el billete de lotería que no le había pagado todavía. Es cuando aprende que el billete tiene un número capicúa con cincos y sietes, unos números mágicos; empeña su capa pero, cuando le traen el dinero, La Pisa bien se ha ido. Fuera se oyen gritos y manifestaciones a los que Max no hace caso, únicamente preocupado por el billete de lotería, el sueño del pobre. Recordemos una réplica de don Latino a Max : «No has tenido el talento de saber vivir» (III, p. 65), que tiene eco en la escena XIII con una doble reflexión de Mme Collet: «Max, pobre amigo, tú solo te mataste» (XIII, p. 184), y a su hija: «sólo fue malo para sí» (XIII, p. 185). Las dos reflexiones condensan un aspecto de lo trágico en el teatro contemporáneo: si un destino infeliz lleva al personaje a la desgracia última, también lo lleva a la infelicidad y a la muerte el propio dinamismo. Las escenas IV y XII, la nueva pareja que estudio ahora, tienen la particularidad de que Max anuncia en la primera su muerte que acaece en la segunda. Escena IV, Max pide que le acompañen a su casa, pero don Latino lo lleva a la Buñolería modernista para recuperar el billete. Este detalle, de poco interés en sí, muestra la ausencia de libertad del protagonista trágico, ausencia de libertad materializada por su ceguera. Conforme toma conciencia de lo que pasa por las calles de Madrid —un ensanchamiento hacia el macrocosmos al que aludía antes—, Max discrepa tajantemente de las teorías elitistas del cotarro modernista y, al declarar que se siente pueblo, afirma uno de los cometidos del protagonista trágico: luchar contra la injusticia y la ley inicua que domina el mundo. Es decir: interrumpir el curso de la Historia. Así se manifiesta el ser social o sociocultural en el protagonista trágico. Pero, es para reconocer su fracaso: «Yo me siento pueblo. Yo había nacido para ser el tribuno de la plebe y me acanallé perpetrando traducciones y haciendo versos» (IV, p. 81). Venció pues la mediocridad y la escena termina en un arranque verbal compensativo, con frases ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 55 yuxtapuestas, anhelosas, poco favorables al diálogo, un arranque que linda a veces con la locura, expresión dolorosa de la impotencia trágica: «¡Yo soy el primer poeta de España! ¡El primero! ¡El primero! ¡Y ayuno! Y no me humillo pidiendo limosna! ¡Y no me parte un rayo!» (IV, p. 81). El arresto del protagonista a raíz de sus gritos marca la victoria de la ley y la impotencia de quien quiso cambiarla. La escena XII es la escena de la muerte de Max, tal como la había anunciado en la escena IV cuando se quejaba ya del frío y se negaba don Latino a prestarle el Macferlán, como ahora le niega su carrik. Es también la escena donde tenemos la definición del esperpento como tragedia moderna. En 1981, John Orr, en su ensayo sobre el drama en la sociedad moderna de 1870 a nuestros días, propone distinguir los tres grandes momentos de la tragedia: «el modo griego es divino, el del Renacimiento es sobre todo noble, mientras que el modo moderno fundamentalmente es social. La literatura será la recta expresión de la deformación social que enajena al hombre»25. Pues bien, lo trágico construido por Valle-Inclán, lo trágico esperpéntico saca su poder de la lengua que lo expresa —y merecería un estudio específico— al mismo tiempo que aparece en tensión con los acontecimientos históricos, políticos y sociales coetáneos. El paralelismo de las escenas V y XI lo marca la violencia, tanto en el vestíbulo del Ministerio de la Gobernación como en la calle aunque de distinta forma. Frente a los representantes del orden, don Serafín y unos guardias, Max da sus señas de identidad con mucho humorismo, es decir jugando y, de cierta forma, desempeñando un papel. Mientras lo llevan a la cárcel grita: «¡que me asesinan! ¡que me asesinan!» (V, p. 98), un verbo que, por cierto, anuncia los gritos de la escena XI, pero que aquí, sólo es una violencia verbal. Cuando la madre del niño muerto grita : «¡Asesinos de criatura!» (XI, p. 160), «¡Asesinos, veros es ver al verdugo!» (XI, p. 162), expresa su dolor y su rabia porque una bala perdida acaba de quitarle la vida a su hijo: es cuando Max se da cuenta del valor verdadero de las palabras, de que es un asesinato real y que ha muerto una víctima inocente. Poco después, al oír el disparo que señala la muerte del preso catalán, víctima de la tristemente conocida ley de fugas, Max se siente vencido. La tensión entre lo que es y lo que hubiera querido ser se resuelve en un 25 John Orr, Tragic drama and modern society. Studies in the social and literary theory of drama from 1870 to the present, Totowa, New Jersey, Barnes & Noble Books, 1981, p. XII. ISSN 1773-0023 56 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) nítido y trágico sentimiento de fracaso que desemboca en el deseo de suicidarse desde el viaducto, típico lugar de los suicidios en Madrid. Parece haber recorrido todas las estaciones de su vía crucis y sólo le queda la muerte. Viene ahora la pareja VI y X. La escena VI, una escena añadida, es la del encuentro en el calabozo entre Max y Mateo, entre el intelectual y el obrero. Max usa de su poder sobre la palabra para bautizar a Mateo como Saulo, evidente alusión al «Libro de Samuel» de la Biblia donde Saulo es el elegido por Dios como rey de Israel, encargado por Dios de conducir su pueblo a la victoria. En el calabozo, pues, se reúnen y discuten dos seres, el obrero y el intelectual, cuyo anhelo común abre un campo de expectativa, dos seres cuyos proyectos pudieran redimir, cada uno en su terreno, la comunidad humana. Pero la misma desmesura de sus proyectos deja presentir un trágico fracaso: «van a matarme» dice Mateo/Saulo (VI, p. 106). La escena X, con las dos prostitutas, la vieja y la joven, es una manifestación de la vida mísera, de los sufrimientos del pueblo tanto en el ayer como en el hoy y en el mañana. Es decir que esta escena constituye una pintura de la sociedad tal como se evoca en la escena VI. Las escenas VII-VIII-IX desempeñan un papel particular: Valle-Inclán instala a los modernistas, modernistas rezagados por supuesto y ya fuera de lugar, en el centro de Luces de bohemia, reflejándose las escenas 7 y 9 cada una en la otra a través de la especular escena central. Excesos verbales, burdos anagramas, vacuidad, egoísmo, así aparecen ; apenas se salva Rubén por su condición de verdadero poeta aunque olvida sus versos y, la verdad sea dicha, los que declama al final tampoco merecen mucho más que un piadoso olvido. La escena VIII, escena central, merece una atención especial. Entrado «gran poeta» en el despacho del ministro de gobernación, Max saldrá cliente del «fondo de reptiles», es decir del fondo que sirve para pagar a los que van a fusilar al preso catalán y matar al niño. Entra pobre y sale con un poco de dinero y la promesa de una pensión, pero ya vendida el alma, definitivamente enajenado, sin identidad. Alcanza la cumbre de la inadecuación consigo mismo, con quien anhelaba ser. Esta inadecuación con uno mismo es una de los más desgarradores y más trágicos desengaños del protagonista trágico en el teatro moderno. Perdido todo sentimiento de dignidad, de responsabilidad, gasta este dinero en la locura de un banquete por todo lo grande. En la escena VIII, caen las máscaras. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 57 La estructura de Luces de bohemia, tan alejada de la forma libre de la revista política, tan estudiada y tan matemática, tiene una función: está construida para expresar una tensión y una contradicción trágicas entre el hombre —la condición humana— y unas circunstancias exteriores, históricas, un sistema implacable que lo destruye todo y no deja ninguna esperanza, una estructura en la que aparece una tensión continua y progresiva hasta el final. El año en que aparece Luces de bohemia en su primera versión contestaba Valle-Inclán a la pregunta de Tolstoï: «No debemos hacer arte ahora porque jugar en los tiempos que corren es inmoral, es una canallada. Hay que lograr primero una justicia social»26. Esta dimensión, esencial en Luces de bohemia, señala como eje de lectura el oficio de escribir y la función del escritor. Pero no creo que no haya arte en Luces de bohemia. Max Estrella, cuya ceguera limita y hasta anula la libertad, es un prototipo del teatro trágico contemporáneo que tiene poco que ver con la tradición trágica. Ahora lo trágico ha hecho de Max un hombre de carne y hueso, con el perverso juego del doble, y lo hace mover en unas líneas donde la frontera entre la sensatez y la locura no tiene nítido límite. Uno de los terrenos privilegiados de este trágico, lo constituye lo tremendamente patético que radica en el desfase entre el proyecto de vida de Max y la realidad, entre lo que piensa y cree que tiene que ser frente a toda la comunidad humana, y su fracaso a todos los niveles, incluido el más íntimo ya que voló el microcosmos familiar. En Luces de bohemia, el fracaso trágico afecta no sólo al ser personal, sino también, y sobre todo, al ser socio-cultural quien, a pesar de su lucha trágica, ve con una total impotencia sus valores fundadores derribados. En este sentido, Luces de bohemia, esperpento, es una de las muchas caras del nuevo trágico, del trágico moderno, es «la tragedia nueva» de Valle-Inclán. 26 Cipriano Rivas Cherif, «¿Qué es el arte? ¿Qué debemos hacer? Respuestas de Valle-Inclán a las preguntas de Tolstoï», La Internacional, Madrid, 3-IX-1920. ISSN 1773-0023 58 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) LA TRANSCENDANCE EN QUESTION OU LE TRAGIQUE AU CROISEMENT DES GENRES DANS EL HOMBRE DESHABITADO DE RAFAEL ALBERTI. Zoraida CARANDELL Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III La période qui va de la fin de la première guerre mondiale au début de la guerre civile est marquée, en Espagne, par l’essor de l’art et de la littérature d’avant-garde. Si pour les formalistes russes, l’histoire de la littérature enseigne que chaque nouveau courant surgit de l’épuisement d’un modèle ancien1, les avant-gardes mettent tout particulièrement en avant la notion de rupture, au point de faire de cette dernière un principe d’écriture et un mode de fonctionnement. Ce ne sont pas des affinités thématiques qui lient Luces de Bohemia, La casa de Bernarda Alba et El Hombre deshabitado, mais bien la prise en compte d’une crise du sens héritière du romantisme et la recherche d’un renouvellement esthétique. Crise du sens, notamment dans la remise en question de deux thématiques traditionnelles du tragique, la transcendance et la liberté ; renouvellement esthétique, car il n’y a, pour le spectacle, d’autre achèvement qu’artistique. 1 Voir Iouri Tynianov, Formalisme et histoire littéraire, Lausanne, L’Age d’Homme, 1991. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 59 L’exploration de nouveaux champs du tragique met en lumière l’épuisement des thématiques traditionnellement associées à ce dernier. Nous avons exploré ailleurs trois de ces champs à travers l’exemple de El Hombre deshabitado : le tragique intérieur, la tendance vers l’abstraction et la montée de l’irrationnel2. La présente étude tentera de montrer comment s’opère, dans El Hombre deshabitado, une remise en question de la transcendance, dont la conséquence est une crise du tragique. Loin de la tragédie pure, la pièce d’Alberti se situe au croisement de genres différents — comedia, farce —, et se rapproche, bien au-delà du théâtral, d’autres formes de spectacle — cinéma, cirque, ballet. Parce que la cohérence métaphysique et/ou idéologique incarnée dans l’idéal de transcendance se perd, comme nous le verrons en replaçant la pièce dans son contexte esthétique et en étudiant comment elle prend position vis-à-vis de l’héritage tragique, une signification artistique se construit. Partir d’une définition du tragique pour en évaluer la pertinence à un moment donné pose un problème de méthode, notamment quand les principes qui sous-tendent cette définition sont remis en cause. C’est toute la contradiction d’une critique normative qui cherche dans l’histoire de la littérature une légitimité des cadres génériques. Henri Gouhier conclut, à l’issue d’un important colloque dont les contributions portent sur des périodes et des traditions littéraires très différentes, que deux notions sont indispensables au tragique, la transcendance et la liberté : « Le théâtre étant action, c’est une transcendance active et agissant dans l’action qui correspondrait à […] la dimension tragique »3. Le tragique fait ressentir, selon lui, « la présence d’une réalité invisible qui ne peut être donnée sous nos yeux, ni exprimée en concepts, et qui pourtant est là »4. Dans le sillage de la conception nietzschéenne de l’art, qui voit dans l’art et non plus dans la morale, le fondement des exigences humaines, et dont le retentissement en Espagne a été très bien étudié par les 2 Zoraida Carandell, « El Hombre deshabitado de Rafael Alberti : vers un tragique d’avant-garde? », Les Langues néo-latines, n° 343, décembre 2007, p. 109-123. 3 Henri Gouhier, « Tragique et transcendance », in Jean Jacquot, Le théâtre tragique, Paris, Éditions du CNRS, 1960, p. 481. 4 ibid. ISSN 1773-0023 60 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) critiques5, les avant-gardes espagnoles remettent en question la notion de transcendance dans l’art sous toutes ses formes. Ortega le signale clairement en 1925, dans un des chapitres de La deshumanización del arte, « Intrascendencia del arte » : « el artista mismo ve su arte como una labor intrascendente »6. Ortega relie ce phénomène au culte de la jeunesse et du sport. La critique a bien mis en évidence la volonté des avant-gardes de s’écarter de la transcendance par le biais de l’humour. Ainsi, Ludus, un ouvrage coordonné par Gabriele Morelli7, montre les visages multiples de ce retournement de perspective : l’importance du sport, qui gagne, avec « Oda a Platko », de Cal y canto, ses lettres de noblesse littéraires, le culte de l’énergie et de la rapidité, etc. Le cinéma joue un rôle essentiel dans le renouvellement esthétique de la littérature et du théâtre. Cet art illustre mieux que tout autre l’angoisse de l’homme moderne face à l’impossible liberté. L’absence de transcendance n’est pas toujours synonyme de légèreté ludique. Quand Alberti donne à El Hombre deshabitado le sous-titre « auto sacramental sin sacramento », et quand il décrit ainsi son projet : « libre de toda preocupación teológica, pero no poética »8, il dénonce la mainmise de l’Église sur l’État. De cette absence de transcendance revendiquée découle un tragique de la négativité — terme utilisé par Ana Gómez Torres dans un article sur la pièce9 — qui se nourrit de l’attitude de révolte caractéristique des avant-gardes. Or, un monde sans transcendance est aussi un monde sans liberté dans le sens que lui donne Henri Gouhier, quand il s’interroge : « il n’y a dimension tragique que dans un monde d’êtres libres ou qui se croient libres. Y aurait-il tragique dans un monde d’automates, ou dans un monde d’animaux qui ne sont pas pourvus de liberté ? »10. La réponse implicite est non. La liberté, présentée par Henri Gouhier comme un don, apparaît chez Alberti comme une conquête. Plutôt que d’une liberté métaphysique, il s’agit d’une liberté politique. 5 Voir l’ouvrage de référence de Gonzalo Sobejano, Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967. Et, tout récemment, les travaux d’Encarna Alonso Valero, Sólo locos, sólo poetas (sobre Nietzsche en la joven literatura), Granada, Universidad de Granada, 2003. 6 José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, Madrid, Revista de Occidente, 1933, p. 49. 7 Gabriele Morelli (éd), Ludus. (Cine, arte y deporte en la literatura española de vanguardia), Valencia, PreTextos, 2000. 8 « María Teresa Montoya y el auto de la creación del mundo de Rafael Alberti » in Rafael Alberti, Prosas encontradas, Madrid, Ayuso, 1970, p. 177-179. 9 Ana Gómez Torres, « La metafísica del vacío: el teatro mental de Rafael Alberti (El Hombre deshabitado) », in Serge Salaün et Zoraida Carandell (éds), Rafael Alberti et les avant-gardes, Paris, PSN, 2004, p. 211-244. 10 Henri Gouhier, « Tragique et transcendance… », p. 481. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 61 Le cinéma et le théâtre des années vingt et trente illustrent les contradictions de la liberté individuelle à l’épreuve du collectif. Le fait que le cinéma renouvelle la conception du tragique est inscrit dans la nature même du film : au cinéma, le personnage se confond avec l’acteur, véritable individu, qui ne peut incarner une figure exemplaire. Le statut du personnage, élément clé du renouvellement du tragique, est totalement différent au théâtre (une pièce peut naturellement être jouée par différents acteurs). Cette distinction entre cinéma et théâtre est même la raison de l’impossibilité de la catharsis au cinéma selon les formalistes russes11. Déjouer le piège de l’individuel, voilà le pari de nombreux films qui traitent de l’angoisse de l’homme face au mirage de la liberté et de la beauté moderne du mécanique. La fascination de l’automate se veut souvent ludique et artistique (comme dans Ballet mécanique de Fernand Léger (1924)) et, plus tard, dénonciatrice (comme dans Les temps modernes, de Charlie Chaplin (1936)). Tandis que la fin de la première guerre mondiale met le destin des nations au premier plan des préoccupations des écrivains et philosophes de diverses tendances politiques (La décadence de l’Occident de Spengler est traduite, en Espagne, en 1923), la révolution bolchevique change durablement la perception de la liberté. Les libertés individuelles sont considérées comme des libertés bourgeoises, formelles, et les libertés collectives sont mises en avant. Dans Le cuirassé Potemkine, par exemple, le peuple est investi d’un rôle libérateur. Alberti commente ainsi le film d’Eisenstein : « La rebelión, la protesta contra el letargo y el sueño, contra la monotonía y angustia desesperadas de los días y las cárceles; la exaltación de la justa violencia y necesaria venganza; la balumba, el tumulto, la muerte a quemarropa, el odio, la ira »12. Cette description s’applique en partie à El Hombre deshabitado. Alberti décrit l’année 1928 en des termes très semblables: « Amor. Ira. Cólera. Rabia. Fracaso. Desconcierto. Sobre los ángeles. »13 Alberti fait sienne la figure du réprouvé. Ce lecteur féru de Dostoïevski et de Lautréamont — traduit par Julio de la Serna14 — est 11 Voir François Albera (éd), Les formalistes russes et le cinéma : poétique du film, Paris, Nathan, 1996. « El Potemkin en Brujas », in Rafael Alberti, Prosas…, p. 75-77. 13 Rafael Alberti, « Resumen autobiográfico », in Poesía 1920-1938, Madrid, Aguilar, 1988, p. CXLI. 14 Sur l’influence de Lautréamont, voir Théodore BEARDSLEY, « El sacramento desautorizado : El Hombre deshabitado y los autos sacramentales de Calderón », Studia Ibérica, Munich, Francke Verlag, 1973, p. 93-103 et Andrés Soria Olmedo, « De la lírica al teatro : El Hombre deshabitado de Rafael Alberti en su entorno », in Estudios dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz, Granada, Universidad de Granada, 1979, p. 389-400. 12 ISSN 1773-0023 62 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) fasciné par la violence du film d’Eisenstein et trouve également dans Metropolis une source d’inspiration. Dans Metropolis, de Fritz Lang (1927), l’angoisse de la liberté va de pair avec la fascination du mécanique. La visée est, à la fois, esthétisante et politique. Dans une perspective marxiste, la prise de conscience collective défendue par Maria dans Metropolis peut enrayer l’aliénation de la classe ouvrière. Que le personnage principal, Freder, ne puisse atteindre la liberté qu’à travers le groupe, voilà qui va à l’encontre de l’héroïsme tragique, plus volontiers associé à une révolte face au groupe et à l’exception face à la loi. De façon générale, l’influence du marxisme sur les avant-gardes permet une nouvelle conception de l’héroïsme, en mettant l’accent sur la liberté collective. Une pièce d’Alberti, De un momento a otro, reproduit l’histoire de Metropolis. Le fils d’une famille bourgeoise se retourne contre sa caste pour embrasser la cause du peuple. On retrouve dans la pièce un thème cher à Alberti, celui du reniement du fils (présent dans Sobre los ángeles et El Hombre deshabitado), qui est à double sens : le fils renie ceux qui le renient. Ce thème récurrent chez Alberti contribue à la dénonciation des idéaux individuels de bonheur, ordre et survie dans la lignée. Le bâtard est une métaphore du révolté et le Veilleur de nuit peut être interprété comme une figure de père honni. Ne refuse-t-il pas, comme l’auteur à ses créatures dans Six personnages en quête d’auteur, le droit à l’existence, en renvoyant l’homme au sous-sol dont il l’a tiré ? Et ce rapport tendu entre père et fils n’est-il pas le symbole d’une création théâtrale sans complaisance, en quête du « plaisir aristocratique de déplaire » ? Loin des connivences d’intérêt que le théâtre à succès des années vingt établit avec son public, le théâtre d’Alberti cherche à éveiller le spectateur. « Sacudir un poco la escena », tel est son objectif, déclare l’auteur au moment de la création de la pièce à El Heraldo de Madrid15. Le Veilleur de nuit toujours alerte et l’Homme somnolent incarnent deux aspects indispensables à la création, l’état de veille et le sommeil. Si le premier est « un ave nocturna con un solo ojo luminoso para turbar el sueño de un hombre » (p. 207)16, le deuxième tâtonne dans l’obscurité à la recherche de son rêve : « has poblado mi sueño de fantasmas incomprensibles » (p. 209). Dans « Miedo y vigilia de Gustavo Adolfo Bécquer », Alberti définit la poésie comme un état 15 16 « María Teresa Montoya… », p. 178. Rafael Alberti, El Hombre deshabitado, Madrid, Biblioteca nueva, 2003, p. 207. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 63 intermédiaire entre veille et sommeil17. Cet état hallucinatoire caractérise aussi le dérèglement des sens de El Hombre deshabitado. Il s’apparente à la déréalisation surréaliste, mais renoue surtout avec le romantisme, les objets perdent leur structure interne. Ceci participe à la fois d’une crise du sens et d’une volonté de renouveau esthétique. Le personnage collectif auquel s’intéressent l’art et la littérature des années vingt n’est pas toujours l’acteur d’une révolte. Il peut, au contraire, exprimer le renoncement ou le néant, comme dans The Hollow men (1925), de T. S. Eliot. Ce texte a certainement influencé El Hombre deshabitado et le poème « El cuerpo deshabitado » de Sobre los ángeles. Non seulement parce que la métaphore utilisée par Eliot revient sous la plume d’Alberti, mais parce que cette œuvre exprime le désarroi des hommes qui ne sont pas libres. Ce poème, cité ci-dessous dans une traduction espagnole, donne la parole à des hommes remplis de sciure, des épouvantails urbains semblables à l’humanité lasse évoquée par le Veilleur de nuit dans El hombre deshabitado. Somos los hombres huecos Los hombres llenos de aserrín Que se apoyan unos a otros Con cabezas embutidas de paja. L’image de la sciure sera reprise par Alberti dans Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos de manière humoristique : « Madame, voici la poésie : serrín »18. Le thème du corps vide est un motif récurrent dans la poésie espagnole postérieure à The Hollow men. Ainsi, Un río, un amor (1928), de Luis Cernuda, s’ouvre sur l’énigmatique « Remordimiento en traje de noche » : « un hombre gris avanza por la calle de niebla ;/no lo sospecha nadie. Es un cuerpo vacío ». Les hommes de Poeta en Nueva York (1929-1930), de García Lorca, déambulent, insomniaques, sous un ciel désert et se vident de leurs tripes dans « Paisaje de la multitud que vomita », marqué par l’esthétique expressionniste. Chez Alberti lui-même, on trouve, parallèlement à la métaphore du vide, celle du trop-plein, comme dans « Espantapájaros », un poème de Sermones y moradas. Les épouvantails sont aussi 17 « Miedo y vigilia de Gustavo Adolfo Bécquer » in Rafael Alberti, Prosas…, .p. 59-62. Rafael Alberti, « Charles Bower, inventor » in Sobre los ángeles. Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, Madrid, Cátedra, 1981, p. 193. 18 ISSN 1773-0023 64 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) insignifiants que les hommes creux. A l’instar de Maruja Mallo, sa compagne en 1929 et 1930 et auteur d’une série de tableaux intitulée « Espantapájaros », Alberti métaphorise dans ces figures statiques la quête tragique de l’homme vidé de sa substance. L’immense ronde de figures urbaines privées d’intériorité que le Veilleur de nuit montre à l’Homme dans le prologue s’inscrit dans le droit fil de l’esthétique expressionniste. Elle renoue également avec le motif de la danse macabre, qui anéantit les différences entre les êtres, mettant fin à toute velléité d’individualité: « Sin pisar, pasan pendientes de un alambre, trajes vacíos, fláccidos, de señoras, de caballeros, militares, curas, jóvenes, niños, colgados de caretas horribles, pintadas con ojos y sin ellos. Carrusel triste, silencioso, sin orden. » (p. 208). Comme dans le genre médiéval, le cortège comprend des membres du clergé et des personnages issus de différentes classes sociales. Contrairement à la danse macabre traditionnelle, ce défilé sans tambours ni musique n’annonce aucune vie éternelle, car il n’y a pas d’espoir chez Alberti : « No hay entrada en el cielo para nadie », lit-on dans Sobre los ángeles19. La file monotone des hommes inhabités renoue avec une des fonctions du tragique qui est, selon Michel Meyer, de sacrifier la différence. « La tragédie est en réalité un sacrifice symbolique de la différence, son expiation au regard de cette loi d’airain du groupe qui veut que rien ne contrevienne à l’identité de ses membres, donc de l’ensemble »20. Ce sacrifice ne connaît pas de récompense. L’Homme retourne à l’indifférence, point de départ de la pièce. Il ne cherche à se distinguer que parce que le Veilleur de nuit l’incite à le faire, le précipitant dans une quête illusoire du sens de sa vie, qui se jette dans le néant, car toute recherche du bonheur est vouée à l’échec. La didascalie d’Alberti joue sur la marionnettisation des personnages, suspendus à un fil: « sin pisar, pasan pendientes de un alambre » (p. 208). Les personnages d’Alberti sont aussi légers que l’ange et la marionnette, hérauts du théâtre selon Kleist : ils ne pèsent pas sur le sol ; mais contrairement à eux, ils ne sont pas doués de grâce. Leur légèreté aérienne évoque l’esthétique cinématographique. Les personnages défilent sur l’écran sans peser, sans être autre chose que des images, insaisissables et légères. 19 20 « El alma en pena», in Rafael Alberti, Sobre los ángeles. Yo era un tonto…, p.117. Michel Meyer, Le comique et le tragique, Paris, PUF, 2003, p. 19. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 65 Cela conduit-il à l’anéantissement total du sens ? Rien n’est moins sûr. Tous ces personnages charrient au contraire un lourd héritage, précisément celui de la danse macabre. Le vide constitue une invitation à réfléchir sur le genre qui l’a vu naître, tragédie ou danse macabre, pour en questionner la pertinence dans une esthétique d’avant-garde. L’intertextualité est, à la fois, un mode de création et un contenu porté par le texte, qui permet à la pièce de se situer vis-à-vis de l’héritage tragique. Une analyse des modèles littéraires sur lesquelles prend appui El Hombre deshabitado permet de comprendre comment la pièce met en œuvre ce déni de toute transcendance, et comment elle tire parti de l’héritage de la tragédie et du théâtre en général. Nous laissons volontairement de côté la référence majeure à l’auto sacramental, car les liens de la pièce avec ce genre, reconnus et voulus par Alberti, ont fait l’objet de nombreuses études21, d’autant plus justifiées que l’auto sacramental a connu en Espagne un essor important durant les années vingt et trente22. De nombreuses références intertextuelles émaillent la pièce, et il n’est pas question ici de les rechercher une par une. Nous nous arrêterons sur deux exemples particulièrement représentatifs de la remise en question de la transcendance; une tragédie, Œdipe roi, de Sophocle, où les oracles se jouent du héros, et une comedia, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina, dont le personnage principal défie le créateur jusqu’à sa mort. L’œuvre d’Alberti met en scène un personnage trompé par ses sens et par ce qu’il croit être réel. Comme Jean Cocteau dans La machine infernale (1932), Alberti réinterprète la pièce de Sophocle comme la mise en œuvre d’une transcendance malfaisante, et il prête au Veilleur de nuit les plus noirs desseins : la définition que Cocteau donne de sa pièce, « une des plus parfaites machines construite par les dieux infernaux pour l’anéantissement mathématique 21 Voir, entre autres, Théodore Beardsley, « El sacramento desautorizado … » ; Andrés Soria Olmedo, « De la lírica al teatro: El Hombre deshabitado de Rafael Alberti…» ; René Cotrait, « La vida es sueño de Calderón, source possible de El Hombre deshabitado de Rafael Alberti », Bulletin d’information du service de documentation, n° 20-21, 1969, p. 15-32 ; Florence Léglise, « El Hombre deshabitado entre tradition et avantgarde : la subversion de l’auto sacramental, la double rébellion de l’homme et du dramaturge », in Serge Salaün, Zoraida Carandell (éds), Rafael Alberti et les avant-gardes…, p. 193-210. 22 Voir Mariano de Paco, « El auto sacramental en los años 30 » in Dru Dougherty et M. Francisca Vilches de Frutos (éds), El teatro en España. Entre la tradición y la vanguardia. 1918-1939, Madrid, CSIC, Fundación García Lorca y Tabacalera SA, 1992, p. 265-273. ISSN 1773-0023 66 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) d’un mortel »23, conviendrait à El Hombre deshabitado. La perfection en moins. Alberti nous convie dans un monde dégradé, le Veilleur de nuit lui-même exerce un métier commun. Comme Œdipe, l’Homme cherche en permanence son identité, l’identité de la Tentation, ce qui le conduira à se punir lui-même après avoir démasqué son ennemie. Une fois le crime commis, l’homme cherche son châtiment : EL HOMBRE (Mirándose las manos): ¡Oh sangre, sangre, sangre, su sangre! (Llevándoselas a los ojos) LA TENTACION (Deteniéndoselas): ¡No, no! ¡No te toques los ojos, te quedarías ciego! (p. 247) Le héros, après sa faute, se retire du monde. La cécité illustre cette coupure sans retour et le désigne comme victime expiatoire. Vénus a ôté la vue à Max Estrella et Dieu entoure Adela de pénombre24. Pour avoir aimé, ces trois personnages sont maudits et emmurés dans leur solitude, une véritable mort avant l’heure. La référence appuyée à Sophocle, répétée dans l’œuvre d’Alberti, inscrit la pièce dans la continuité de la tragédie. Le passage cité évoque aussi les mains souillées de sang de Lady Macbeth. Sa surdétermination, en termes d’intertextualité, indique que la pièce doit aussi prendre position par rapport à son héritage, le théâtre tragique qui conditionne son déroulement. L’Homme est coupable, parce que Œdipe et Lady Macbeth le sont, et leur culpabilité vit en lui. On peut parler d’ironie tragique dans la mesure où le personnage porte, à son insu, la culpabilité dont la pièce est l’héritière. L’intertextualité insuffle à l’homme l’éternité de damnation promise par le Veilleur de nuit dans l’épilogue. L’Homme se trouve face à un choix de dupe qui résume sa condition tragique : vivre comme un automate ou céder à une passion qui entraîne sa perdition. Chercher à se connaître, reculer d’effroi et se crever les yeux ne font qu’un. L’impossible liberté est la source du tragique albertien et d’une révolte qui se sait sans issue. 23 Cité dans Jacqueline de Romilly, La tragédie grecque, Paris, PUF, 1970, p.108. Le « regalo de Venus » évoqué par Max Estrella est une allusion aux maladies vénériennes, l’orgueil perceptible dans l’allusion mythologique coexiste avec l’autodérision du discours burlesque. (Ramón del ValleInclán, Luces de Bohemia, Madrid, Austral, 2006, p. 127). Adela dit à Martirio à la fin de la pièce « Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca » (Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, Madrid, Cátedra, 2005, p. 274). 24 ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 67 Si l’Homme assume sa culpabilité en suivant les traces d’Œdipe, une autre figure mythique du théâtre guide ses pas vers la révolte. La remise en question de l’au-delà et le défi au destin caractérisent le personnage principal de El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Tandis que la pièce de Tirso est ancrée dans les perspectives morales de son époque, Don Juan ne se sent guère coupable. Deux moments de El burlador de Sevilla sont évoqués dans la pièce d’Alberti ; la « résurrection » de Don Juan dans les bras de Tisbea après le naufrage et la scène finale de la damnation. Ces deux passages mettent l’accent sur le rôle de la mort dans la pièce, dont ils questionnent la portée métaphysique. Quand il reprend ses esprits, Don Juan dit à Tisbea : Vivo en vos, si en el mar muero. […] Y en vuestro divino oriente Renazco, y no hay que espantar, Pues veis que hay de amar a mar Una letra solamente. La mort, si proche, fournit un prétexte au jeu verbal. Le sens n’est pour Don Juan que la surface sonore des mots ; « de amar a mar ». Il n’y a point d’au-delà. Contrairement à Œdipe, Don Juan passe sur la mort, qu’il donne souvent et qu’il frôle parfois, avec légèreté. La mort n’est rien d’autre que la surface éclatante de la mer, dans a-mar, le a privatif souligne que l’amour est une négation de la mort. Le jeu de mots de Don Juan prête à sourire. La tentative de séduction est comique, car le personnage est féminisé dans les bras de Tisbea, et parce qu’aussitôt sauvé, il tente de séduire. Dans El Hombre deshabitado, on assiste à une nouvelle inversion du masculin et du féminin, qui souligne l’absence de liberté de l’Homme, véritable jouet dans les mains manipulatrices de la Tentation. Elle arrive de la plage, poursuivie par des hommes, appelant à l’aide, assoiffée et défaillante. Mais elle reconnaît avoir menti — « era mentira » (p. 231) — et tente de séduire l’Homme à l’instant où elle se retrouve seule avec lui. Après la mort des époux, la Tentation conquérante s’éloigne, comme le Don Juan de Molière qui voudrait qu’il y ait d’autres mondes pour y poursuivre ses conquêtes amoureuses : « El hombre ha muerto. Amanece. Sigamos adelante » (p. 249). Le mythe de ISSN 1773-0023 68 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Dom Juan, dont Jean Rousset a montré qu’il relève surtout d’un affrontement avec la mort25, est un exemple de réflexion sur l’absence de transcendance. Don Juan ne vit que dans le présent et il renie toute forme de métaphysique. Chez Zorrilla, comme chez Molière, c’est le spectre de la femme aimée qui viendra hanter l’imagination de Don Juan. Dans la pièce d’Alberti, le spectre de la Femme assassine l’Homme sur l’ordre du Veilleur de nuit. La pièce se termine sur la scène de la damnation, celle qui offre le plus de similitudes avec le modèle de Tirso. El Hombre: Te aborreceré siempre. El Vigilante Nocturno: Y yo a ti, por toda la eternidad. (Desaparece el Hombre. La boca arroja una espesa columna de humo negro. El Vigilante nocturno lo ahoga echándole la tapa. Luego la cierra, dándole varias vueltas a su llave.) (p. 261) L’Homme défie son bourreau tandis qu’il s’enfonce dans les abîmes, comme un écho de la descente initiale du Veilleur de nuit à la fin du prologue. Les références aux figures d’Œdipe et Don Juan tendent à montrer l’inutilité d’une quête individuelle, le caractère mensonger de la liberté accordée à l’homme, et l’absence ou la malveillance de toutes les figures transcendantes ; elles contribuent aussi à abstraire, à déjouer l’attente d’un public confronté à des perspectives propres à la tragédie et à la comédie. La variété des registres, dont Lope de Vega vantait les mérites dans son Arte nuevo de hacer comedias, profite au tragique qui, par contraste, est mis en relief. Du reste, l’ambivalence comique-tragique est présente dans la structure même de l’œuvre. En effet, dans le prologue, le Veilleur de nuit et l’Homme se tutoient jusqu’au moment où ce dernier est paré de son rôle de Caballero. Le « tu » à valeur générale et à portée métaphysique du début devient alors un « vous » à valeur sociale et mondaine. La mise en œuvre d’un théâtre dans le théâtre se solde par le passage d’un « tu » tragique à « vous » comique. La conscience qu’ont les deux personnages de jouer un rôle éloigne le tragique, indissociable d’une critique du théâtre et différé jusqu’au dénouement. Au début de l’épilogue, le vouvoiement et le ton moqueur du Veilleur de nuit se situent, contre toute attente, sur un registre comique qui arrive à 25 Jean Rousset, Le mythe de Dom Juan, Paris, Armand Colin, 1976, chapitre I. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 69 contretemps, une fois le crime commis. L’hypocrisie du Veilleur de nuit est ainsi dénoncée. Le retour du tutoiement recentre la fin de pièce sur sa dimension tragique. Si la dualité comique-tragique est inscrite dans la structure de l’œuvre, cette dernière se caractérise plus généralement par une esthétique des contrastes. Différents jeux d’opposition parcourent l’œuvre du début à la fin. D’une part, il en résulte une ambivalence qui exprime très bien les incertitudes de ce théâtre expérimental, loin des convictions politiques du « teatro de urgencia » postérieur. D’autre part, l’écartèlement de l’Homme en ses cinq sens, que nous avons eu l’occasion d’étudier ailleurs26, l’utilisation du discontinu ou de la dissonance pour exprimer le tragique permet une distorsion du langage proche de celle que Ionesco appelle de ses vœux vingt ans plus tard, en recommandant de « Pousser tout au paroxysme, là où sont les sources du tragique. Faire un théâtre de violence: violemment comique, violemment dramatique. Éviter la psychologie, ou plutôt lui donner une dimension métaphysique »27. La présence de ces réseaux d’opposition se substitue à la cohérence de la transcendance et fournit à l’œuvre un fil conducteur, indissociable d’un questionnement du genre tragique et plus largement théâtral. La manière dont l’œuvre oscille entre différents genres est perceptible non seulement dans l’économie générale de l’œuvre, mais dans de brefs passages, qui acquièrent à ce moment-là une signification ambivalente. Par exemple, la danse ludique des cinq sens autour du bassin oppose la mélodie du vers et la violence de la mise à mort du poisson, qui s’accomplit de manière rituelle et constitue un intermède préfigurant la mort de la femme. El GUSTO: Yo gusto en las púas finas de sus dientes, Ni miel, ni salitre, sino sangre y muerte (Lo aprieta, ahogándolo.) (A EL TACTO) Muerto te devuelvo el pez. (Se lo da). EL TACTO: ¿Para qué ? EL GUSTO: Para que des en el agua con él. (p. 228) Les sens dansent tour à tour avant de rejoindre la place qui leur est assignée, au pied d’un des arbres du jardin. Ils évoluent harmonieusement dans l’espace qui est le leur ; quand ils 26 27 Zoraida Carandell, « El Hombre deshabitado de Rafael Alberti : vers un tragique d’avant-garde… ? ». Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, Paris, Gallimard, 1966, p. 60. ISSN 1773-0023 70 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) s’immobilisent à l’endroit prévu, cela rassure le spectateur et répond à ses attentes. Bien entendu, la danse des sens, qui peut être simultanée dans le ballet, apparaît dans le texte de manière successive, tout le parallélisme est dans les jeux de répétition. Alberti connaissait parfaitement les contraintes du ballet, puisqu’il écrivit, en 1926, un ballet mis en musique par Elizalde, créé à Gaveau en 1932 et intitulé La pájara pinta, guirigay lírico bufo bailable28. La rupture entre la danse, l’harmonie des vers employés — surtout l’heptasyllabe et l’octosyllabe — et la violence inouïe du sens — mise à mort d’une victime innocente — est donc hautement significative. L’espace symbolique du bassin contribue au caractère funeste de la scène. Comme dans Six personnages en quête d’auteur, le bassin est au centre du décor de l’acte et il est l’espace où doit se produire la mort : celle du poisson rouge, et pour Pirandello celle de la fillette, maintes fois annoncée, toujours différée, jamais effective. La dimension métathéâtrale de cette scène, perceptible dans sa clôture narrative et métrique — événement singulier, isolé du reste de l’acte par l’emploi des vers — et dans le déroulement d’une action violente renforce le contraste entre le signifiant verbal et artistique et le signifié. De surcroît, les sens jouissent de cette mise à mort, ce que souligne la construction exceptionnelle des verbes de perception : « para que veas en él » (p. 228). Le pronom n’est pas ici objet de l’action (« lo veas… »). Le poisson, doublement sacrifié, n’est qu’un prétexte pour que chacun des sens exerce ses facultés. Parfois, les contrastes exacerbés relèvent de la déformation farcesque et mettent en œuvre une rhétorique de l’ambiguïté, qui mélange les structures esthétiques et les renvois référentiels. La dimension paroxystique du théâtre d’Alberti se rattache à la volonté de faire une distorsion du langage, en le menant jusqu’à la contradiction. Ainsi, la scène de la rencontre entre la Tentation et l’Homme est sous le signe des contrastes ; contraste entre l’eau et le feu, qui caractérise la Tentation dès qu’elle se rapproche du bassin : « Calor… Muerta... Agua… Calor » (p. 230), et qui va se poursuivre par la suite. Si la Femme remarque que la Tentation est gelée (« está helada y llena de arañazos » (p. 234)), l’Homme éponge son front pour la rafraîchir. Le lieu commun pétrarquiste de l’opposition entre le chaud et le froid, habituel pour désigner la passion amoureuse, est au service d’une esthétique des contrastes. 28 Voir l’introduction et l’édition d'Eladio Mateos Miera et Ismael Ramos Jiménez in Federico Elizalde et Rafael Alberti, La pájara pinta, Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2004. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 71 Dans cette même scène, les nombreuses didascalies mettent l’accent sur le jeu exacerbé et illogique des personnages. L’homme vacille entre l’impassibilité, (« contenido » ; « impasible ») et l’étonnement (« extrañado » ; « asombrado » ; « desconcertado »), la brusquerie (« bruscamente ») et la douceur (« más tierno »). La Tentation s’emporte (« seca » ; « colérica ») ou bien défaille (« casi llorando » ; « se desvanece ») (p. 231-232). Ces hauts et bas expriment les contradictions de l’irrationnel et renouent avec le paroxysme, une des sources du tragique selon Ionesco. Le farcesque a ici un rôle tellement important — marionnettisation des personnages, mécanique des passions, surenchère des cris et des attitudes — qu’il semble effacer le tragique. Mais le caractère décisif de cette scène dans la formation du triangle tragique et dans la préparation du dénouement ne permet pas de parler de suspension du tragique au profit du farcesque. Le tragique est parfois contenu dans le comique. La dérision est mise au service d’une nouvelle esthétique du tragique, notamment dans une scène qui oppose le Veilleur de nuit à l’Homme, dans le rôle d’un clown ignorant, semblable aux personnages de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos : EL CABALLERO: ¿Qué es lo que ha caído de las estrellas ? EL VIGILANTE NOCTURNO: Aspírelo. EL CABALLERO (Aspirando profundamente): ¡Oh! EL VIGILANTE NOCTURNO: Es una flor. Se llama rosa. EL CABALLERO (Tomándola y respirándola ansioso): ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una rosa, una rosa! EL VIGILANTE NOCTURNO: Una rosa blanca. EL CABALLERO: ¡Una rosa blanca, una rosa blanca! La quiero. Démela. (Subrayando las palabras como un niño). Yo quie-ro u-na ro-sa blan-ca. (p. 213-214) L’Homme fait songer à Harold Lloyd, qui tente vainement d’étudier dans The Freshman (1925). Parce qu’il ignore des choses élémentaires, il exprime des désirs aussi ridicules qu’essentiels. La bêtise apparaît comme un des aspects du personnage tragique29. Le désir de la rose blanche est un désir d’absolu, une volonté tragique d’embrasser la beauté, distancée 29 Voir aussi dans l’acte central une scène ludique entre l’Homme et la Femme : « LA MUJER: ¿Eres un tonto? / EL HOMBRE: ¿Y tú una tonta ? / LA MUJER: No. / EL HOMBRE: Sí. / LA MUJER (Sacándole la lengua): ¡Tonto! / EL HOMBRE (Lo mismo): ¡Tonta ! ». (p. 227). ISSN 1773-0023 72 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) par la dimension comique de la scène. Le Veilleur de nuit prend à part le public comme dans un cirque : « Ni ve, ni oye, ni entiende. (Al público). Claro, señoras y señores, está muy claro » (p. 211), et comme au cinéma, il joue le rôle du bonimenteur. De même que le bonimenteur institue la faille entre l’univers cinématographique et la présence théâtrale, le Veilleur de nuit, en s’adressant au public, crée une rupture dans la communication : l’Homme se parle à lui-même et ignore totalement l’existence des autres, le Veilleur de nuit permet une mise à distance de la situation comique qu’il transcende en s’adressant au public. En jouant sur plusieurs registres — cirque, film — le passage questionne le sens du spectacle, la scène est en quelque sorte extraite de son contexte pour renvoyer au monde extérieur. Ce n’est pas la première fois qu’Alberti s’exerce à ce jeu. Comme le montre C.B. Morris, Alberti, coiffé d’un chapeau melon, avait imité son idole Charlot en tirant six coups de revolver à la fin de sa conférence au Lycaeum Club « Palomita y Galápago. No mas artríticos »30. Le fait de théâtraliser un acteur de cinéma est significatif de la volonté d’importer ce qui apparaît, face au théâtre commercial des années vingt, comme une véritable source de renouvellement. Somme toute, El hombre deshabitado ne se détourne pas entièrement de toute forme de transcendance, puisque la cohérence de l’œuvre est fournie par quelque chose qui dépasse le théâtral, un projet artistique global. Au-delà du théâtre, c’est le spectacle au sens large qui est convoqué dans cette pièce. Le projet d’un art total, hérité du symbolisme et actualisé par les avant-gardes, semble bien indiquer que la transcendance artistique se substitue à la transcendance métaphysique, dont nous avons évoqué la dimension idéologique. Un déplacement du tragique du moral vers l’esthétique n’est cependant pas exempt de portée idéologique. Entre la crise métaphysique du symbolisme et le théâtre politique des années trente, El Hombre deshabitado exprime le tiraillement d’une conscience minée par l’incertitude, ce que les jeux d’opposition montrés plus haut mettent en évidence. Ce qui est 30 Voir C. Brian Morris, La acogedora oscuridad: el cine y los escritores españoles (1920-1936), Córdoba, Filmoteca de Andalucía, 1993, p.108. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 73 universel dans le tragique selon Peter Szondi et Muriel Lazzarini31, c’est justement la loi de l’opposition, la transformation d’une chose en son contraire que Lazzarini considère comme la véritable matrice de fonctionnement du tragique. Dans le cas de El Hombre deshabitado, la synthèse de cette contradiction se trouve au-delà du théâtral, dans l’appropriation de codes artistiques venant du cinéma, de la peinture, du cirque ou du ballet. 31 Voir Muriel Lazzarini Dossin, L'impasse du tragique : Pirandello, Valle-Inclán et le « nouveau théâtre », Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002 et Peter Szondi, Essai sur le tragique, Belval, Circé, 2003. ISSN 1773-0023 74 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) UTILISATION ET SUBVERSION DU TRIPTYQUE DANS EL HOMBRE DESHABITADO DE RAFAEL ALBERTI Jacqueline SABBAH Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III Le point de départ de cette analyse est la parenté de l’œuvre d’Alberti avec un système particulier de composition picturale, le triptyque. La construction de la pièce en trois tableaux, sa référence au modèle d’art sacré qu’est l’Auto, la reprise d’éléments iconographiques qui ont nourri l’art du triptyque, à savoir la représentation des trois espaces symboliques que sont le Paradis, aux temps de la Création, la vie terrestre, puis les Enfers, sans parler des emprunts à la peinture renaissante et flamande qui alimentent l’imagination théâtrale d’Alberti, autorisent une telle mise en relation. Notre projet est de nous interroger sur les techniques qui, dans El hombre deshabitado1, offrent tout à la fois une utilisation et un questionnement de l’esthétique du triptyque. Visuellement, dans la succession et dans la simultanéité des tableaux — le déroulement des trois moments dramatiques, les trois aires de jeu du panneau central qui coexistent sur scène —, la mise en scène de la pièce emprunte à l’architecture du polyptyque à trois volets. Nous tâcherons donc d’analyser le mode de fonctionnement de l’œuvre, considérée comme un triptyque. En quoi suit-elle son modèle ou s’en éloigne-t-elle ? Si subversion il y a, à quel 1 Rafael Alberti, El hombre deshabitado, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 75 moment et comment s’affirme-t-elle ? Dans l’espace scénique et dans le temps de la lecture, c’est-à-dire dans le spectacle ainsi créé par Alberti, s’inscrit le sens de la pièce : à partir de l’architecture logique — théologique — et picturale qui lui sert de toile de fond, quel parcours notre œil comme notre esprit sont-ils invités à suivre ? Comment le système d’appréhension, donc de compréhension qui structure l’œuvre, se construit-il, dans le temps et l’espace de la représentation ? Plus précisément, El hombre deshabitado, si on le conçoit comme un tableau articulé, propose un mode de lecture où entrent en jeu, comme entre les trois panneaux du triptyque, les notions d’ouverture, de repli, de charnière. Nous étudierons donc l’œuvre comme un polyptyque se déployant sous nos yeux, proposant au regard des modes de circulation multiples : parcours linéaire au fur et à mesure que, suivant la progression des actes, s’ouvrent les volets, évolution renversée ou contrariée dans le panneau central, dans la mesure où l’action s’y lit de droite à gauche, contrairement à notre mode de lecture habituel, télescopage ou confusion des espaces, enfin, dans le dernier volet, qui nous ramène à la première aire de jeu, l’enjeu de ces stratégies étant peut-être d’interroger un des concepts majeurs du triptyque s’ouvrant face au fidèle, celui de révélation. Ces modes de lecture pluriels traduisent non seulement la désarticulation de l’itinéraire classique du triptyque, mais ils permettent à Alberti de faire se côtoyer différents langages artistiques : théâtre, peinture et architecture, certes, mais aussi les genres littéraires (parce que progression chronologique et simultanéité ici se conjuguent et que le chevauchement poétique des images renverse le récit théologique), mais, encore (parce que le triptyque d’Alberti est mobile, puisque déployé dans le temps) le cinéma, en ce qu’il peut offrir comme liberté de montage des images, en ce qu’il questionne aussi, les mêlant au plus près, réalité et illusion. C’est cette richesse que souligne Isabelle Monod-Fontaine, analysant quelques-uns des apports du polyptyque à l’art pictural du XXe siècle : Construire une œuvre à plusieurs plis — ou à plusieurs feuillets — implique un temps de parcours différent : ne pas regarder une seule image, mais en absorber plusieurs entraîne nécessairement un balayage du regard qui n’est pas celui qu’induit la vision d’un seul tableau, si complexe et fourmillant soit-il par ailleurs. Guidé en général par une structure quasi architecturale, ou tout au moins par le quadrillage des châssis ISSN 1773-0023 76 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) qui déterminent des compartiments juxtaposés ou non, le regard peut à sa guise s’arrêter successivement (arrêt sur image) ou balayer l’ensemble (travelling). De toute façon, il est invité à construire une manière d’itinéraire, un « sens de la visite » : parfois sous la forme d’un véritable récit, avec sa chronologie et ses épisodes ; parfois l’exploration simultanée de différents points de vue sur un même objet ; parfois la simple mise à nu d’un procédé d’assemblage2. Les possibilités qu’offre ce recours au polyptyque enfin, comme structure à la fois revendiquée et déconstruite, nous conduira à nous interroger sur la notion de tragique : une fois réfutée la vision théologique, foncièrement anti-tragique, tout rapport à la transcendance est-il caduc ? Dans ce cas, pourquoi avoir écrit un Auto, fût-il sans sacrement ? Ne demeure-til pas comme une nostalgie, sinon de la solution chrétienne, tout au moins d’une réponse ? Autrement dit, la question sans réponse ne serait-elle pas un des fondements du tragique ? Une lecture contraignante Tout d’abord, définissons succinctement le polyptyque, par rapport au retable : dans celuici, les personnages entrent en rapport réciproque au sein d’un décor architectural ou d’un paysage qui les contient et fixe leur emplacement dans un même espace. Celui-là, en revanche, présente une série de panneaux accolés au sein d’un même encadrement : c’est donc une composition qui juxtapose les scènes ou les figures. L’un est unitaire, l’autre est pluriel. Soulignons également que le polyptyque, qui étymologiquement signifie « plusieurs plis », se compose, dans sa forme la plus primitive ou essentiellement chez les Flamands, et c’est là le modèle que suit Alberti, de plusieurs volets pouvant s’ouvrir et se refermer comme des portes sur le panneau central. Par opposition, enfin, au tableau de chevalet, qui ne se répand qu’à la Renaissance et s’inscrit dans un usage de plus en plus privé de la peinture, le polyptyque est une œuvre conçue pour être exposée publiquement, face à la communauté des fidèles ; qui plus est, il obéit à un cérémonial, l’ouverture des volets à des moments particuliers de l’année liturgique permettant d’accéder à la scène religieuse centrale, à la 2 Isabelle Monod-Fontaine, « 1905-1955 : l’exploration des plis du polyptyque », in Polyptyques. Le tableau multiple du Moyen-Age au XXè siècle, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1990, p. 210. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 77 Vérité révélée. C’est dire que la structure du polyptyque suppose une certaine mise en scène, une certaine façon d’encadrer et de montrer des histoires, en somme une certaine théâtralité. Le pluripartisme du champ pictural et l’articulation des panneaux autorisent ainsi le déploiement d’un discours en plusieurs temps, que nous retrouvons dans la succession des trois moments de la pièce : Prologue, Acte, Épilogue. Ce sont ici les lever et tomber de rideau qui font office de cadre et de charnière : ils indiquent le début et la fin de la représentation et signalent le passage à chaque nouveau panneau. Ceci visuellement, mais, bien sûr, la structure culturelle et idéologique qui contient et scande à la fois la pièce est la référence à l’Auto caldéronien. C’est dire qu’il existe chez le spectateur une attente, informée par ses références théâtrales, picturales, religieuses, dans laquelle et contre laquelle s’inscrit El hombre deshabitado. Ainsi, si l’on s’en tient aux lieux scéniques, une fois identifié l’espace du Prologue comme étant celui d’une moderne Genèse, le public reconnaît le panneau central comme espace de la vie humaine et, donc, nécessairement de la faute et il sait que le dernier volet conduira au Jugement divin et aux Enfers. La succession des trois « actes », inscrivant cette progression dans le temps de la représentation (une temporalité rendue plus dense par le travail tout à la fois de mémoire et d’anticipation à l’œuvre chez le spectateur), est alors la traduction théâtrale de l’ouverture progressive des panneaux du triptyque. À l’intérieur de l’Acte, les différentes aires de jeu, fortement symboliques, coexistent cette fois au sein du même espace scénique : le jardin clos, l’espace de la plage ouvert à tous les dangers, le grenier enfin, lieu par excellence de l’abandon et de l’obscurité. Le spectateur les découvre dès le lever de rideau : comme autant de compartiments dans un unique volet de polyptyque, ils rythment la circulation du regard et orientent la narration, distribuant, par étapes, l’action humaine dans une histoire, pour ainsi dire, déjà écrite. Les solutions scéniques imaginées par Alberti conjuguent donc, comme le fait le polyptyque, lecture progressive et lecture simultanée, tenant compte à la fois de la temporalité de la représentation et des stratégies picturales qu’offre le tableau pluriel. Le modèle de l’Auto est utilisé par Alberti pour mieux être déconstruit, comme de l’intérieur. En effet, en lieu et place de la rédemption, s’affirme la damnation, à la contrition ISSN 1773-0023 78 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) s’oppose la révolte. Mais, suivant notre axe d’analyse, nous pouvons nous demander comment les mécanismes du triptyque sont à même de traduire la possibilité de rédemption, par l’existence du libre arbitre, et comment Alberti les retourne, non plus de façon strictement littéraire ou théologique, mais théâtralement. Tout d’abord, notons que, traditionnellement, la grande majorité des triptyques offrent, au centre, une scène principale, plus grande et statique, réservée à la figure sacrée, sujet de la dévotion, et, sur les côtés, des petites scènes narratives multiples et animées, réservées à des personnages de l’histoire sainte, puis profane, ainsi des donateurs eux-mêmes, images du spectateur, présentés en adoration. Le modèle suivi par Alberti est à l’inverse : ici, le centre est occupé par l’action humaine, les latéraux consacrés à l’espace et à la figure de la transcendance. La référence, comme cela a été tant de fois souligné, peut parfaitement se trouver chez Jérôme Bosch, dont les triptyques comme Le jardin des délices ou Le chariot de foin centrent précisément l’attention, puisque c’est là le sujet du panneau central, sur les agissements de l’Homme dans le monde, une humanité qui se perd dans le désordre et la profusion des vices, alors que les volets présentent la Création, à gauche, les Enfers à droite. Cependant, ce programme iconographique a pour but, tout aussi bien, le salut de l’Homme. Lorsque le triptyque est ouvert, offert à une vision d’ensemble, le regard suit, en effet, un cheminement particulier : c’est le centre, plus coloré, si inventif, qui nous attire. Les deux volets sont déployés et nos yeux, allant de l’un à l’autre, sont invités à choisir : d’un côté, et selon nos agissements, le Paradis, de l’autre, la damnation. C’est ce choix, fait à partir du panneau représentant la vie humaine, qui exprime le concept de libre arbitre : le spectateur est renvoyé à lui-même, mis en garde et invité à orienter son regard et sa vie en fonction des deux cheminements, des deux sens de lecture possibles qui s’offrent à lui. Chez Alberti, au contraire, notre vision et, partant, la destinée humaine, est contrainte. La succession chronologique des trois lieux scéniques, qui ne coexistent jamais, nous interdit tout choix ; il en va de même lorsque les trois espaces, ou compartiments scéniques, dans l’Acte, sont offerts simultanément au regard : la situation de l’Homme lorsque se lève le rideau, à l’extrême droite, l’activation des deux autres espaces par le système des voix (en particulier, et avant la faute, les lamentations des voix du jardin, puis de la mer, enfin des ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 79 gerbes de blé et objets du grenier) dessinent un seul sens d’évolution possible, un seul espace vers lequel l’Homme pourra se mouvoir, orientant ainsi son action et guidant notre regard le long d’un chemin tout tracé. Qui plus est, une fois la représentation terminée (c'est-à-dire une fois le triptyque ouvert dans sa totalité), l’architecture d’ensemble de la pièce — Prologue, Acte, Épilogue — ne nous invite pas, à partir du tableau central, à un mouvement de va-etvient vers les latéraux, ouverts comme autant de possibles. Au contraire, le mouvement qui s’affirme est celui d’une convergence vers le centre : les deux volets préparent et annoncent pour l’un, reprennent et clôturent, pour l’autre, les événements représentés dans l’Acte. De par leur fonction de paratexte, de par leur caractère plus discursif, ils enserrent le panneau central qu’ils commentent, conditionnent et sanctionnent. Il y a donc un renversement du sens de lecture et de fonctionnement du triptyque. Au lieu de se déployer, les volets semblent bien plutôt se replier. Une telle structure a bien sûr beaucoup à voir avec le concept de « theatrum mundi ». Dieu est ici un régisseur ; on a souvent souligné comment il distribuait les rôles, disposait l’éclairage, le décor, attribuait les costumes, signalait le début de la représentation interne qui se déroule dans l’Acte, la désignant ainsi comme un fragment de théâtre dans le théâtre. Il assume le rôle de l’Auctor de El gran teatro del mundo. Toutefois, si El Hombre, acteur ou plutôt pantin entre les mains de Dieu, finit par comprendre qu’il a été dupe d’un artifice et prisonnier d’une illusion, son constat est trop tardif ou, dit en termes d’espace, il intervient dans un volet qui interdit toute circulation, toute communication active avec le centre. Le rideau de son action dans le monde est tombé, il ne peut y revenir, de même que nous, spectateurs, n’avons plus sous les yeux cette scène centrale à partir de laquelle, dans le triptyque, s’ouvraient des parcours visuels, donc des choix divergents. Pour prolonger la référence caldéronienne, ni El Hombre, ni nous-mêmes ne sommes conviés à cette dynamique à l’œuvre dans La vida es sueño, où alternent, dans un mouvement de va-et-vient, la passion et la distance, le réel et l’illusion, la folie et la conscience, l’action et la réflexion. Lecture contraignante, donc, qu’offre le triptyque d’Alberti pour signifier la fatalité, le déterminisme ou la prédestination, les termes variant selon les philosophies, et ceci à plusieurs niveaux. Tout d’abord, par rapport à la narration qui y est mise en scène : car, ISSN 1773-0023 80 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) malgré le changement de décor, le spectateur ne sait pas très clairement si la pièce illustre les errements de l’Homme dans le monde ou si nous demeurons à l’intérieur du récit du péché originel, étant donné que El Hombre n’est jamais chassé du Paradis, l’espace de sa création, mais semble rejouer, en quelque sorte, dans son espace propre, le panneau central, les trois actes qui jalonnent son passage de l’innocence à la faute, puis au châtiment. Le déroulement de l’action obéit donc, et ce de façon redondante, à une structure prédéterminée : création, péché, damnation. Damnation, en effet, et non pas seulement Jugement, car ici les références picturales, quoique puisant à plusieurs sources, sont, encore une fois, convergentes, et ne laissent envisager d’autre issue que la représentation dernière de l’Enfer. Que l’on pense aux triptyques mentionnés de Jérôme Bosch ou à un autre type de représentation dont le souvenir hante l’espace de El hombre deshabitado, à savoir le Jugement Dernier, le dernier volet, le dernier lieu qu’habitera l’Homme, selon une projection spatiale qui fait figurer à notre droite l’épisode qui clôt chronologiquement la représentation, ne peut être que l’Enfer. Autrement dit, la progression des tableaux, dans le temps du spectacle, se déroule sur la toile de fond qu’est l’architecture tripartite du Jugement : suivant un sens de lecture qui nous est familier, propre à l’Occident, l’action est perçue comme évoluant de gauche à droite, et la droite, dans la tradition iconographique du triptyque, est l’espace des damnés. Une telle connotation symbolique de l’espace ne peut se comprendre, et c’est ce que mettent parfaitement en scène les représentations du Jugement Dernier, que du point de vue de Dieu. Si l’action ou la destinée de l’Homme, progressant vers notre droite, tendent vers le mal, c’est que l’image est perçue du point de vue de Dieu, et c’est là ce qui fonde le système de valeurs associé à l’espace dans le triptyque. Ce qui pour nous, sur scène, est à gauche, doit être compris comme étant à la droite de Dieu qui, au centre, nous fait face : c’est le Paradis, l’espace du Bien. A l’opposé, le Mal est situé à la gauche du Créateur, donc dans le volet qui se trouve, pour nous, à droite. C’est dire qu’en réalité, notre vision, humaine, est faussée : notre mouvement naturel, de gauche à droite, se révèle être un parcours qui nous éloigne du Bien, puisque moralement, pris dans une perspective théologique, c’est un cheminement inversé que nous suivons. Nous allons, aveuglément, de droite à gauche, tournant le dos au ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 81 Bien et au dessein divin. C’est là une des stratégies du triptyque pour montrer les errements de l’Homme. Plus radicalement que le grouillement désordonné des figures du panneau central, dans une œuvre comme Le jardin des délices, qui illustre la folie du monde, ou que l’incapacité de plus en plus marquée de El Hombre deshabitado, un personnage qui s’avoue lui-même fou, pour accéder à la connaissance, à l’identité, à la sagesse, c’est ce renversement des perspectives qui traduit le caractère à proprement parler insensé des actions humaines. Au niveau de l’agencement du récit, au niveau du cheminement visuel, la pièce propose donc une mise en scène où le libre arbitre et la possibilité de rédemption sont déniés. Il en va de même au niveau de la construction, strictement symétrique, de l’œuvre. Le schéma tripartite auquel obéit la division en Prologue, Acte, Épilogue se retrouve, comme l’a montré Gregorio Torres Nebrera, à l’intérieur de chacune de ces parties3. Ceci est particulièrement sensible dans l’Acte, qui traduit scéniquement ces trois étapes internes par la triple division de l’espace. Dans cet Acte, le point d’équilibre, le centre exact à partir duquel tout bascule est le jeu des cinq sens avec le poisson, ce que Torres Nebrera appelle « secuencia interseccional » : annonçant et précédant immédiatement l’apparition de la Tentation, elle marque le passage de l’état d’innocence à celui de péché. Les cinq sens changent alors de maître, à l’harmonie et à la confiance envers la parole, comme l’a montré Marie-Claire Zimmermann4, succèdent leur exact contraire, le désordre, la perte de la maîtrise du langage et la déroute identitaire. Dans la distribution de l’espace comme dans l’évolution de l’action et du système de communication verbale, cette construction autour d’un axe de symétrie inscrit, après l’éveil, l’attribution de dons et le « peuplement », pourrait-on dire, de El Hombre deshabitado, l’avènement de la chute, de la perte et du vide dans une rigoureuse logique de la nécessité. Un déplacement du tragique vers l'Histoire ? Jusqu’à présent, c’est donc essentiellement à une progression linéaire, fortement contrainte, qu’échoit le rôle de signaler la nécessité de la chute. Cependant, la mécanique 3 Gregorio Torres Nebrera, « Introducción », in Rafael Alberti, El hombre deshabitado…, p. 69-70 et p. 82. Marie-Claire Zimmermann, « Entre théâtre et poésie ; le pouvoir du langage dans El hombre deshabitado de Rafael Alberti », in Begoña Riesgo (coord), Le retour du tragique. Le théâtre aux prises avec l’histoire et la rénovation esthétique (1920-1936), Nantes, Éditions du Temps, 2007. 4 ISSN 1773-0023 82 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) interne de la pièce est plus complexe, tirant en cela profit de la lecture plurielle qu’offre le tableau multiple. Ainsi, à y regarder de plus près, le panneau central, consacré à l’action de l’Homme, propose une évolution spatiale qui conduit le personnage à une progression à rebours, vers la gauche. Ce panneau est inséré à l’intérieur du triptyque, c’est-à-dire que, loin de proposer un chemin différent, il ne fait, vu à la lumière de l’ensemble, que reprendre ou plutôt anticiper le troisième volet, la damnation de l’Homme. Là où le triptyque classique offre une mise en perspective, comme un espace feuilleté par le regard dans les deux sens, et conduit le spectateur à s’interroger sur la valeur que prend, sous le regard de Dieu, le sens dans lequel il croit orienter son action, nous avons ici affaire à une structure répétitive, à un système clos et plus précisément cyclique. L’Homme ne progresse aucunement vers le salut, le spectateur n’a pas même l’illusion qu’il puisse le faire, puisque, ici, il recule résolument vers la gauche. Ce retournement du sens de la lecture somme toute n’en est pas un, mais bien plutôt piétinement et redondance. Il traduit, dans une perspective humaine, le déterminisme dont le personnage est prisonnier. Sous l’œil de Dieu ou sous celui du spectateur, avec ou sans transcendance, le cheminement et le destin de El Hombre sont identiques et univoques. Pas de mise en perspective donc, mais bien plutôt mise en abyme, dans le sens où nous avons le sentiment qu’à l’intérieur du triptyque que forme l’ensemble de la pièce s’ouvre un second triptyque en miniature, qui reproduit le même espace tripartite, qui traduit le même mouvement vers le Mal, mais à échelle humaine, dans le sens aussi où tous les signes de théâtralité exprimés dans le Prologue désignent le tableau central, comme nous l’avons évoqué, comme un exercice de théâtre dans le théâtre. La prétendue liberté de l’Homme, insérée dans une structure première qui la régit, l’informe et l’encercle, ne possède aucun espace, pas plus que de chronologie propres où s’inventer. Cette mise en abyme, en effet, crée une temporalité particulière, ou une atemporalité, dans laquelle tout est joué d’avance. Le panneau central est anticipation, les signes prémonitoires de la chute, d’ailleurs, n’y manquent pas ou, ce qui revient au même, la répétition à l’infini du même scénario. Quoi qu’il en soit, la durée propre au triptyque classique, qui suppose la contemplation d’une origine (la Création), d’un présent (la vie dans le monde) dans lequel l’Homme, en connaissance de cause, choisit sa destinée, et des Enfers à venir où il se ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 83 précipitera s’il n’agit pas dans les délais, ce temps en somme laissé à la vie humaine pour s’affirmer, se perdre ou se ressaisir, qui informe la fameuse formule du « tan largo me lo fiáis », est ici désamorcée. L’absence de libre arbitre, c’est-à-dire de liberté de mouvement pour l’Homme, se donne à lire également par un autre procédé propre au polyptyque : le jeu des charnières, cet axe qui sépare et relie à la fois les tableaux, cet intervalle entre des scènes juxtaposées et cependant prises dans une dynamique, espace seuil propice à la réflexion du spectateur, qui ne peut que s’y arrêter, questionner la mise en relation des images, moment de suspens où il est renvoyé à lui-même. Dans le polyptyque, comme l’affirme Catherine Donnefort5, « à l’harmonie des tableaux, à leur polyphonie, coexiste cependant le bruit visuel créé par l’intervention des cadres, des jointures, des charnières, bref de la discontinuité dans la représentation ». Nous pouvons ainsi nous demander ce qui, signifié par le tomber de rideau et rythmé par l’évolution de la lumière, « a lo divino » (de la Genèse à la malédiction) ou « a lo humano » (une journée symbolique sur terre), commande aux changements de tableaux. Où se trouve, ici, l’interstice où pourrait se loger l’action de l’Homme, justifiant la succession des étapes, cet espace liminaire, agissant comme la charnière du polyptyque articulé, où pourrait s’épanouir la réflexion du spectateur, le renvoyant à la question essentielle du choix ? Dans l’œuvre d’Alberti, force est de constater que c’est l’action de Dieu — l’Acte même de Création de l’Homme qui reçoit dans le Prologue le monde en héritage, puis sa mort aux mains de la Femme, mort commanditée par le Démiurge — qui justifie le passage d’un panneau à l’autre et jamais, à proprement parler, l’action de l’Homme : péché originel qui provoquerait son expulsion du Paradis, faute qui légitimerait son entrée dans l’espace des Enfers. La Tentation, qui prononce les derniers mots dans l’Acte, souligne expressément que c’est la mort du personnage qui constitue la dynamique du changement de tableau (« El hombre ha muerto »,) et justifie l’avènement, tant spatial (« Amanece ») que temporel (« Sigamos adelante ») du dernier volet (p. 249). Partant, le coup de feu ne constitue-t-il pas l’exacte expression sonore de cette « intervention des jointures, des charnières », dont nous 5 Catherine Donnefort, « Polyptyques » (www.ac-versailles.fr/pedagogi/arts plastiques/beta/polyt/index.htm). ISSN 1773-0023 84 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) parlions ? Ne fait-il pas radicalement intervenir ce « principe de discontinuité dans la représentation » à partir du moment où, précisément, il est répété au début de l’Épilogue ? Arrivés à ce point de l’analyse, nous pouvons dire que la structure que présente la pièce est celle d’une action humaine retournée, contrariée, puisqu'évoluant en sens contraire, placée sous l’injonction de la parole divine, au sein d’une architecture contraignante qui dicte ce renversement. Mais n’est-ce pas là le schéma tragique par excellence ? Ne pourrait-on en effet le résumer en disant que la tragédie met en scène l’action de l’Homme, alors même qu’il cherche à se soustraire à la Fatalité et, plus radicalement, du fait même qu’il agisse, se retournant contre lui et le condamnant ? Ici, cependant, plusieurs réflexions s’imposent, qui invalident un tel parallélisme. Certes, El Hombre ne fait, en agissant, qu’obéir à sa prédestination, certes, nous le voyons reculer au fur et à mesure qu’il progresse et évoluer irrémédiablement vers sa damnation, mais ce qui manque ici c’est, pourrait-on dire, le contresens propre à la tragédie, où le héros tragique commet la faute et se perd par le geste même par lequel il pensait y échapper. Il y a, dans la tragédie, cette « malignité de la bonté » dont parle Jean-Marie Domenach6 qui fait que le héros est aveuglé et piégé, il y a cet instant précis où le sens de son action se retourne, où s’affirme une contradiction : ce que le héros pensait être le Bien s’inverse en son contraire. Il faut pour cela qu’il y ait liberté : sans liberté, pas de tragique, car alors, cette perversité du Bien, se révélant être le Mal et s’affirmant dans ce même mouvement, est annulée. Dans El hombre deshabitado, nulle trace de ce double sens des valeurs. Le cheminement inversé de l’Homme, nous l’avons vu, est redondance plus que retournement tragique, il est d’emblée visualisé, non perverti. Pas d’anagnorisis, donc, car, ici, nulle liberté surprise et retournée contre elle-même. En lieu et place de cette liberté, Alberti affirme un déterminisme absolu. El Hombre sait commettre la faute : « ¡Oh, crimen sin castigo! » (p. 247). Il s’abandonne, conscient de le faire, aux cinq Sens (« Haced de mí lo que queráis. Me abandono a vosotros » (p. 239)), à la Tentation (« Llévame adonde quieras. Me abandono a ti » (p. 248)). Celle-ci, par ailleurs, ne peut être tout à fait associée à une figure de la 6 Jean-Marie Domenach, « Résurrection de la tragédie », in Esprit, n° 338, mai 1965, p. 1014 et sq. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 85 tromperie. Affirmant son mensonge (« Era mentira » répète-t-elle d’emblée, une fois seule avec El Hombre (p. 231)), ne se présente-t-elle pas significativement dans toute sa nudité ? S’il y a reconnaissance finale, c’est dans le sens, non de l’ambivalence d’un Dieu bon et méchant à la fois, mais dans l’opposition, face à une divinité miséricordieuse, d’un Dieu définitivement criminel. Le constat final de El hombre deshabitado n’est pas tant la négation de Dieu que le refus de la solution conciliatrice de l’Auto et de celle, sacrificielle, de la tragédie. Car le héros chrétien comme le héros tragique, l’un par sa contrition, l’autre par l’acceptation de sa fonction de bouc émissaire, reconnaissent leur faute à l’intérieur d’un certain système de valeurs et permettent donc leur continuité, même si celles-ci, le temps de la représentation, ont été questionnées dans la tragédie — et c’est ce qui fonde sa fonction cathartique. Dans la pièce d’Alberti, nous assistons plutôt à une sorte de mise à égalité de l’Homme et de Dieu. El Hombre commence par récuser sa culpabilité, employant des arguments qui le situent dans un débat théologique : Porque tú, Señor, puesto que ya lo sabías todo, lo manejabas todo, conocías todos los resortes y secretos nublados de mi alma en el mundo, bien pudiste evitar estas catástrofes, mandándome una luz, un aviso celeste, o habiéndome creado de otro modo. Yo no tengo la culpa, yo… (p. 256). Mais il finit par l’accepter et même la revendiquer, maudissant par trois fois son Créateur qui le lui rend bien : « Arderé odiándote, Señor » (p. 260), « Yo también te maldigo » (p. 261), « Te aborreceré siempre » (p. 261). L’ambiguïté tragique d’une culpabilité de l’innocence se déplace pour faire place au face à face de deux coupables qui, en quelque sorte, s’annihilent l’un l’autre. La critique a souligné l’anoblissement, voire la sacralisation qu’apportait à l’Homme cette révolte. Ainsi, Ana María Gómez Torres affirme : El personaje adquiere una grandeza en su autodestrucción. El exceso de su padecimiento y su castigo son sus títulos para aspirar a la dignidad. Expulsado del falso ISSN 1773-0023 86 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) paraíso, alcanza una nueva nobleza enaltecido por el rencor vengativo y la injusticia divina. No resulta inocente, pero queda purificado, convertido en víctima sacralizada7. On peut même dire qu’il se substitue à la figure du Christ rédempteur, significativement absente de cet Auto : El paralelismo del Hombre sacrificado con […] Cristo en el Epílogo no constituye una parodia, sino una reescritura « a lo humano » del mensaje evangélico. […] La sacralización de la víctima a través del sacrificio lo convierte en un igual de Dios. El Hombre resulta deificado al ingresar en su infierno. La tragedia glorifica su condena y le confiere su verdadero valor humano, reverso del ideal de trascendencia8. A ceci près que le terme de tragédie, ici, doit être compris dans une dimension exclusivement humaine. Qu’est-ce à dire ? Un Dieu résolument mauvais, un Homme résolument coupable, c’est dans cette équation que El Hombre se définit. Car nous pouvons affirmer que c’est dans sa liberté d’être coupable qu’il trouve sa grandeur et sa place, mais non coupable devant Dieu, puisqu’il refuse le rachat et dénonce l’imposture dont il a été victime, non, plutôt humainement coupable, une fois faite l’économie de Dieu. Ana María Gómez Torres a raison de dire que « adquiere la función mítica de portador de la verdad, historiador de la caída y habitante del infierno. Como víctima sacrificial, abre el camino de una révolte basada en el conocimiento de la trascendencia vacía »9. En acceptant d’être puni sans se repentir, l’Homme, paradoxalement, se sauve, mais il ne s’agit pas du salut chrétien, ou du rachat de la communauté, comme dans la tragédie classique. Par son sacrifice, c’est lui-même qu’il sauve, en tant qu’être dans le monde et dans l’Histoire, non la Loi. Il s’autodétruit, quoi de plus blasphématoire pour une Créature, pour pouvoir exister dans un espace résolument immanent. Il nous invite ainsi à interpréter quelque peu différemment le retable central. En assumant sa liberté, son existence sans Dieu, l’Homme nous conduit à relire les trois espaces qui s’y déploient dans une perspective non plus théologique, mais purement temporelle. C’est, dès 7 Ana Gómez Torres, « La metafísica del vacío : el teatro mental de Rafael Alberti (El Hombre deshabitado) », in Serge Salaün, Zoraida Carandell (éds), Rafael Alberti et les avant-gardes, Paris, PSN, 2004, p. 221 8 id., p. 233 9 id., p. 213. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 87 lors, le monde intérieur du personnage qui s’y exprimerait et l’on peut parler de « psicomaquia », dans la mesure où El Hombre, démultiplié, donc aliéné, se cherche et se bat contre lui-même. Ce ne serait plus un système de valeurs transcendant, mais l’Homme luimême qui serait questionné, au travers d’une mise en scène des grands thèmes philosophiques que sont la connaissance, la morale, l’action, l’identité, le langage. El espacio dramático se convierte en un escenario mental, proyección de la conciencia escindida de un único personaje sometido al infierno de su ser en el mundo. […] Para materializar en estructuras dramáticas esta cosmovisión, el autor se vale de las técnicas desrealizadoras del simbolismo y de la abstracción alegórica del auto sacramental, unidas a la deformación y la violencia del expresionismo y a la imaginería de la irracionalidad surrealista, con la irrupción de procedimientos del sueño […] »10. Les techniques de représentation et l’agencement des décors, qui empruntent largement aux langages picturaux des avant-gardes, peuvent être compris comme la traduction des incertitudes de l’Homme moderne, « sometido a un proceso de descomposición cubista y fragmentaria »11, aux prises avec le drame d’une connaissance et d’une unité impossibles. Dans cette optique, le jardin intérieur renvoie, non plus à l’Eden, mais à la conscience morale, la plage — d’où, telle Vénus, surgit la Tentation, porteuse de désordre — symbolise, plus que la mise à l’épreuve de l’Homme sur terre, la cacophonie de son propre monde sensoriel, le grenier obscur et rempli de toiles d’araignée est une métaphore spatiale, non plus des Enfers, mais du vide de la Raison. Cependant, on peut se demander si une pensée qui fait l’économie de la transcendance peut encore être qualifiée de tragique. On peut évoquer le drame de l’impossible accès à la connaissance, une vision nihiliste, le constat d’un vide existentiel, mais, pour désespérées qu’elles soient, ces philosophies ne sont pas d’essence tragique. Il semble plutôt que ce soit dans la coexistence des deux systèmes, ce qu’offre précisément le triptyque de El hombre deshabitado, dans la permanence d’une architecture sacrée à laquelle se heurte le personnage, dans cette question sans réponse qu’il ne cesse, en somme, de poser à Dieu, que puise le sentiment tragique. 10 11 id., p. 212. ibid. ISSN 1773-0023 88 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Le refus de la révélation Pour approfondir cet axe de réflexion, nous nous demanderons quelle ultime contemplation nous offre, une fois déployés les trois volets, El hombre deshabitado. Nous pouvons dire que l’absurdité ou, en termes spatiaux, le non-sens de la destinée humaine s’expriment tout à la fois, si l’on considère l’existence de l’Homme sans Dieu ou avec Dieu, et qu’ils naissent, plus précisément, de la conjonction des deux structures qui s’alimentent l’une l’autre, jouent l’une contre l’autre. Il est, en effet, un moment particulièrement « déplacé », en termes de temps comme d’espace, où immanence et transcendance se chevauchent. Il s’agit du coup de feu, auquel nous assistons à la fin de l’Acte, puis, de nouveau, au début de l’Épilogue. Ici, toute lecture linéaire est abolie. Il y a, temporellement, comme un piétinement et, visuellement, lorsque nous découvrons un décor identique à celui du Prologue, confusion entre origines et fins dernières, Paradis et Enfers. De ce fait, les deux volets latéraux semblent se superposer, signant l’équivalence absolument blasphématoire entre deux valeurs, le Bien et le Mal, spatialement irréconciliables. La vie humaine, en tant que projet divin, s’en trouve vidée de substance. La vision théologique, et avant même que ne s’affirme le rejet réciproque de l’Homme et du Créateur, se voit donc désarticulée. La symbolique spatiale du triptyque est ainsi déconstruite, des valeurs opposées se télescopent, s’annulant. Par rapport à l’Homme, la répétition du coup de feu révèle l’illusion que constitue la chronologie, c’est-à-dire le temps de l’humain. Notons que nous avons affaire ici, comme dans le polyptyque, à deux images, deux espaces, dans le même temps (celui du coup de revolver). Mais le parcours qui va de sa première à sa seconde occurrence, précisément parce qu’il intègre la durée — fin de l’Acte, tomber de rideau, début de l’Épilogue — rend cette simultanéité incompréhensible, scandaleuse. Par ce retour au coup de feu, la progression temporelle se trouve annulée et, partant, toute la vie de l’Homme. Vision ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 89 théologique, dans la perspective de Dieu, vision chronologique, dans la perspective de l’Homme, semblent aussi vides de sens l’une que l’autre. C’est précisément cette vacuité qui est interrogée et qui fait que la pièce est plus qu’un simple constat nihiliste. L’interrogation de l’Homme face à Dieu traverse, en effet, toute l’œuvre. Il peut s’agir, comme l’a montré Marie-Claire Zimmermann, de la question récurrente posée par le personnage dans le Prologue : « Qué es eso ? » (p. 210) à laquelle Dieu répond en employant des signifiants qui ne possèdent pour l’Homme aucun signifié et conduisent au déploiement d’un langage vide, « deshabitado » pourrait-on dire, scéniquement traduit par l’emploi de formes sans consistance : « trajes vacíos, fláccidos » (p. 208), « blancos moldes de escayola […] mudos y oscilantes » (p. 210), images qui apparaissent comme autant de projections créées par la lanterne magique de Dieu. Ou bien, nous pouvons avoir affaire à l’impossibilité de nommer l’autre, puisque ici personne ne possède de nom et que cette révélation, lorsque la question est posée — face à Dieu, puis à la Tentation — est toujours repoussée et, au bout du compte, jamais concédée. Ou, enfin, il peut s’agir du silence qui s’impose dans l’Épilogue, puisque l’Homme refuse d’abord de confesser son crime, ce qui peut signifier son rejet de l’acte de contrition, mais aussi l’inanité de toute parole, puisque Dieu sait déjà, puis se trouve, malgré ses supplications (« Permíteme una sola palabra, un grito » (p.255)), dans l’incapacité de parler face à la Femme qui ne peut l’entendre et disparaît avant qu’il ait pu proférer le moindre son, signant par là le vide absolu d’une parole tendue vers un destinataire absent. L’Homme cherchera malgré tout jusqu’au bout une explication, un « pourquoi » auquel Dieu répond par le secret, le silence, le refus de la révélation : « En mí todo es secreto. ¿ Por qué voy a revelártelo a tí ? » (p. 260). Le personnage est ainsi confronté au néant, mais n’a de cesse de l’interroger et l’Homme se heurte à cette transcendance qu’il interpelle et fait exister du fait même de son questionnement, même si c’est pour la maudire. Rappelons, avec Ana María Gómez Torres qui cite Camus, que « Le révolté métaphysique n’est donc pas sûrement athée, comme on pourrait le croire, mais il est forcément blasphémateur »12. 12 id., p. 225 ISSN 1773-0023 90 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Se crée ainsi une tension tragique dans la mesure où, pour reprendre les mots de MarieClaire Zimmermann, l’œuvre « pose […] sur scène l’éternelle question du destin de l’homme, sans la résoudre, ce qui est le propre de la tragédie »13. Dans la mesure où, de façon plus précise, l’Homme ne peut faire l’économie, si ce n’est du Dieu de la religion, tout au moins d’une transcendance. Car il ne se résout pas à l’absurde et sa quête de sens s’exprime parfaitement, dans l’Acte, par cette exclamation : « ¡Oh crimen sin castigo! » (p. 247). C’est dire que deux solutions sont ici renvoyées dos à dos. D’un côté, l’Homme entre les mains — entre les deux volets — de Dieu conduirait soit à la conciliation chrétienne, formule réfutée, soit à la tragédie, situation où l’Homme se soumet à un système de valeurs qu’il ne comprend plus — cette contradiction d’un Dieu bon et mauvais à la fois —, mais dont il assure la survie par son sacrifice. L’injustice d’une telle solution est rendue, sous la plume de Jean-Marie Domenach, par la formule du « coupable sans faute ». El Hombre, ici, endosse la faute et refuse de se plier à une métaphysique absurde. Mais, d’un autre côté, l’Homme sans Dieu est confronté à une absurdité et à une injustice encore plus grandes qui seraient celles, pour inverser la formule, de la faute sans coupable, du « crimen sin castigo », tout aussi inacceptable. L’œuvre expose les deux solutions, mais ne propose aucune résolution. On peut dire, avec Jean-Marie Domenach, que la question n’est plus ici celle de la tragédie classique (comment Dieu peut-il être bon et mauvais à la fois ?), mais celle d’un nouveau sentiment tragique : comment Dieu peut-il à la fois exister et ne pas exister ? C’est en cela que la pièce déconstruit radicalement la mécanique du triptyque qui, on s’en souvient, met en scène, par son déploiement, une révélation. Car ici, à y regarder de plus près, la seule dynamique possible entre les volets, à partir du moment où le dernier tableau rejoint le premier, est celle non d’une ouverture, mais d’un repli, les deux volets se rabattant l’un sur l’autre. En somme, l’œuvre refuse de répondre et invalide les deux formules, l’Homme sans Dieu, l’Homme avec Dieu, qui se referment l’une sur l’autre. Le caractère illusoire de chacune de ces solutions est mis en évidence : déconstruction onirique, « somnámbula », de l’unité d’un homme en prise avec son monde intérieur, mise en scène de la vie humaine, sur le grand théâtre du monde, comme étant « una sombra, una ficción », dénonciation de la 13 Marie-Claire Zimmermann, « Entre théâtre et poésie ; le pouvoir du langage dans El hombre deshabitado de Rafael Alberti… », p. 145. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 91 « ilusión metafísica ». Mais, plus encore, ce qui est présenté comme une véritable illusion, est celle d’un théâtre à même d’apporter, à la date où la pièce est écrite, eu égard au moment historique que connaît l’Espagne ou à la crise personnelle d’Alberti, une réponse univoque. La problématique du rêve est particulièrement active et nous invite à nous demander qui, en définitive, songe qui. Est-ce Dieu qui songe l’Homme ? Est-ce l’Homme qui songe Dieu ? La continuité spatiale entre les deux volets latéraux, ainsi que la discontinuité chronologique — le retour sur le coup de feu — ont pour conséquence de mettre le panneau central comme entre parenthèses. La liberté, le temps et l’espace de l’Homme y étaient illusoires ; Dieu, situé exclusivement dans les panneaux latéraux, est, tel le public, aux balcons. La vie du personnage alors a-t-elle jamais existé autrement que comme rêve de ce Dieu qui a tout orchestré, créateur et spectateur de son propre songe ? Lorsque la pièce se referme s’affirme aussi une opposition entre deux systèmes chromatiques qui, une fois encore, puise à la symbolique du triptyque. En effet, autant l’espace central est coloré et lumineux (il n’est que de mentionner les références faites dans la didascalie au jardin, au printemps, aux arbres, fleurs et fruits, à la mer et au ciel, ou encore au moment choisi : « es mediodía » (p. 222)), autant les deux volets déclinent essentiellement des tonalités de gris. Les matières évoquées (« hierro », « acero », « carbón », « cal » (p. 205)), les adjectifs utilisés (« fondo negro » (p. 205), « trapajo blanquecino », « tiznada la careta » (p. 207)), mais surtout l’obscurité dans laquelle baignent ces scènes (« silencio nocturno » (p. 206) dans le Prologue, « está oscureciendo » dans l’Épilogue (p. 251)) étouffent toutes couleurs. Ces dernières ne sont pas absentes du Prologue, elles naissent de la lampe torche du Créateur, mais elles sont éphémères, « parpadeantes » et sans doute doiventelles être conçues comme noyées dans les ombres environnantes. Nous sommes, picturalement, dans un nocturne. Siegfried Bürmann ne s’y est pas trompé, dans ses esquisses pour ces deux volets, lui qui les peint, même pour ce qui est de l’arc-en-ciel, exclusivement dans une gamme grisâtre. Cette opposition entre un panneau central coloré et des latéraux qui utilisent ce qu’en peinture on nomme la grisaille, est un procédé fréquent et significatif dans le triptyque. La grisaille, fondée sur l’utilisation des deux non couleurs que sont le blanc et le noir, est ISSN 1773-0023 92 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) employée pour différencier deux espaces, deux ordres : l’humain, coloré, c’est-à-dire correspondant à ce que la vision humaine perçoit dans la réalité, et le divin, associé à la lumière blanche, c’est-à-dire la lumière non créée, à laquelle l’œil humain n’atteint pas. Il s’agit là de la lumière originelle, celle qui se voit séparée des ténèbres dans la Genèse, avant la création de Luminaires. C’est bien, dans un sens, ce à quoi nous avons ici affaire : un espace d’avant la vie, qui peu à peu se colore, au fur et à mesure que Dieu crée, précisément, les luminaires, les sens, en somme le monde, ou un espace d’après la mort, un royaume des ombres. Cependant, dans le triptyque, cette utilisation de la grisaille est réservée au revers, à l’extérieur. Elle revêt le verso des volets, peints, on le sait, des deux côtés. Elle est le signe, pour le spectateur, avant que ne s’ouvre le triptyque, qu’il va devoir déchiffrer un espace symbolique, c’est un seuil qui nous indique qu’il nous faut nous détacher d’une vision immédiate, qui nous invite et nous prépare à pénétrer dans l’abstraction, dans une contemplation métaphysique. L’utilisation de la grisaille dans les deux volets de El hombre deshabitado signale donc bien la fermeture du triptyque. Si l’on peut dire que l’emploi du triptyque est, à proprement parler, retourné, transgressé, c’est parce que celui-ci nous offre, en dernière instance, son revers. Alberti exploite donc cette autre « facette » du polyptyque qui, fondé sur la planéité du panneau de bois et cependant articulé, introduit fatalement, en faisant jouer ses charnières, et contrairement au retable, dont on ne saisit qu’une face, les notions de recto et de verso. En effet, nous avons le sentiment, à cet instant, de pénétrer comme dans l’envers du décor, puisque la lumière qui s’allume pour éclairer la scène lorsque l’Acte va commencer, tout comme les étoiles qui s’éteignent à la fin, ont désigné cet espace comme celui d’une représentation théâtrale. Dieu est alors appréhendé comme un personnage en coulisses, et faisant lui-même partie du spectacle. De plus, à l’époque moderne, cette grisaille n’est pas sans rappeler un autre langage artistique : celui du cinéma en noir et blanc, l’art suprême, sans doute, de l’illusion. Les parentés avec le cinéma sont multiples. Contentons-nous de mentionner ici la fonction de « flash-back » que joue la répétition du coup de feu, opérant un véritable montage des images. Ainsi, nous pouvons dire, avec Catherine Donnefort, que « cette circulation du sens à travers les parois pourtant opaques du polyptyque témoigne d’une ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 93 circulation à travers les arts »14. À travers les arts et aussi, dans le domaine du littéraire, à travers les genres. Rappelons la belle formule d’Abel Gance qui, utilisant une division tripartite de l’écran pour son Napoléon (1917), affirmait : « La partie centrale du triptyque, c’est de la prose, les deux parties latérales sont de la poésie, le tout s’appelant du cinéma »15. Le dernier volet qui se referme ne clôt pas seulement l’Acte, mais l’ensemble de la pièce, où Dieu a joué, lui aussi, son rôle. Il a été, somme toute, pour nous spectateurs, une projection, une illusion, du cinéma. Cette analyse de El hombre deshabitado comme triptyque moderne en démontre la complexité et la polyphonie et permet, il me semble, d’analyser la déconstruction de l’Auto sacramental qui y est mise en œuvre à travers une approche plus théâtrale ou artistique que littéraire. Ce qui s’y joue, peut-être, est une redéfinition du théâtre ou de la représentation par rapport à l’écrit. Car ici l’art du polyptyque — peinture, mise en espace, mise en action, un art, autrement dit, profondément théâtral — est repensé dans ses rapports avec l’écriture, à savoir, bien sûr le Livre, la Bible, mais aussi l’écrit comme système de pensée narrative, que le théâtre ne ferait qu’illustrer. C’est dire qu’en refusant la structure du récit, la linéarité, la planéité, Alberti tâche peut-être de faire du théâtre un lieu de subversion des codes de communication et de compréhension du monde en vigueur et, de la scène, le fer de lance d’une rénovation des langages artistiques, non plus un lieu second — une image illustrant un texte —, mais premier, sorte de laboratoire des arts précédant l’expression d’une philosophie verbalisée et devant conduire le spectateur à un questionnement plus complexe et peut-être aussi à plus de lucidité. Car il manque encore une étape à ce jeu des couleurs et de la grisaille : pour finir, lorsque s’éteignent les étoiles de cette réalité illusoire qu’a été la représentation de El hombre deshabitado, s’allument les lumières bien réelles de la salle, nous renvoyant à un monde non créé, non écrit, un espace proprement humain, historique, ou nous pouvons peut-être, plus conscients, agir plus librement. 14 15 Catherine Donnefort, « Polyptyques »… Cité par Catherine Donnefort. ISSN 1773-0023 94 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) METAMORFOSIS DE LO TRÁGICO EN GARCÍA LORCA Emilio PERAL VEGA Universidad Complutense de Madrid La publicación, en 1871, de El nacimiento de la tragedia, el colosal ensayo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, marca un hito fundamental en la configuración del canon trágico en el período de entresiglos y, claro está, durante todo el siglo XX. Resulta determinante —y no decimos nada nuevo en este aspecto— la consideración de la tragedia griega como un recipiente armónico en el que litigan las fuerzas opuestas de lo apolíneo —tanto vale decir lo ortodoxo, lo reglado, lo bello y, también, lo amansado por la palabra— y de lo dionisíaco —o, si se prefiere, lo grotesco, lo heterodoxo y manejado por las pulsiones más íntimas, elementales y silenciosas del hombre. En Lorca, dicha tensión adquiere tintes agónicos cuando se trata de enfrentar amor puro —o con apariencia de tal— y deseo sexual exacerbado, extremos ambos de expresión de una y otra tendencia. Dicha confrontación llena los dos modos trágicos que el poeta granadino desarrolla desde el punto de vista dramático: uno más apegado al canon clásico del género, y representado por la trilogía rural, y otro más atento a los elementos grotescos que irrumpen en la tragedia contemporánea, con Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín como texto paradigmático. Que la tragedia de aire clasicista encuentre expresión en el ámbito rural no es asunto arbitrario: en primer lugar, porque es allí donde los arquetipos, en la desnudez del medio que ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 95 los rodea, resultan más realzados. En segunda instancia, como modo de continuación de una línea de fuerte raigambre entre nuestros dramaturgos modernistas, con Jacinto Benavente y su tríada compuesta por Señora ama (1908), La malquerida (1913) y la muy tardía La Infanzona (1945) a la cabeza, pero también con representantes tales como Valle-Inclán y su drama rural en clave grotesca encarnado en las Comedias bárbaras, y Eduardo Marquina, cuya pieza La ermita, la fuente y el río (1926) dibuja ya una de la obsesiones temáticas del universo lorquiano, potenciada, obviamente, por la restricción ética que la atmósfera rural impone, y que no es otra que el poder determinante y opresor del entorno sobre el amor vivido en libertad. Sin embargo, la lucha entre el deseo y su apariencia adquiere en Lorca diversos matices que se resisten a una caracterización global. Como regla general, la desmesura del deseo, tan genuinamente dionisíaca, se resiste a su expresión mediante la palabra. Y lo hace por cuanto es ésta, de acuerdo a las tesis de Nietzsche, expresión del equilibrio apolíneo contrario a la palpitación íntima que dicho deseo encierra. Por el contrario, encuentra vía natural en el silencio evocador [Dougherty, 1998] o, en su defecto, en su verbalización poética y musical, por cuanto —y continúo con Nietzsche— poesía y música constituyen ámbitos de evocación simbólica que abren las puertas de la liberación. No de otra forma hemos de entender el deseo silente que, al término del primer cuadro de Yerma (1934), llena la acotación: «YERMA […] acude al sitio donde ha estado VÍCTOR y respira fuertemente, como si aspirara aire de montaña…» [2001, 52], ni, claro está, las imágenes eróticas que, como proyecciones subconscientes de la protagonista, se agolpan en los cantos de las lavanderas: LAVANDERA 2ª : Por el monte ya llega mi marido a comer. Él me trae una rosa y yo le doy tres. LAVANDERA 5ª : Por el llano ya vino mi marido a cenar. Las brisas que me entrega cubro con arrayán. [72] ISSN 1773-0023 96 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Brasa encendida, la del deseo, que se hace canto en Yerma, como respuesta a la Voz de Víctor que irrumpe, casi sin querer, en su interior insatisfecho: ¿Por qué duermes solo, pastor? En mi colcha de lana dormirías mejor. Tu colcha de oscura piedra, pastor, y tu camisa de escarcha, pastor, juncos grises del invierno, en la noche de tu cama… [61]. Sin embargo, es la propia Yerma quien acalla la llamada de Dionisos, un dios hecho forma en las máscaras que aparecen en la romería del tercer acto; máscaras de Hembra y Macho cabrío —con «un cuerno de toro en la mano»— que, al son de la música liberadora, esgrimen los deseos íntimos de la heroína lorquiana: «Vete sola detrás de los muros / donde están las higueras cerradas / y soporta mi cuerpo de tierra / hasta el blanco gemido del alba» [104]. Sobre sus cantos salmódicos prevalece, como queda dicho, el rechazo de Yerma al concepto dionisíaco de la existencia, empeñada en un amor que sólo existe como medio de acceso a la maternidad y que, inserto siempre en el matrimonio, claudica bajo el peso de la honra. Así las cosas, el ajusticiamiento de su esposo Juan no cabe ser entendido como un proceso de liberación sino, bien al contrario, de resignación total respecto de sus anhelos. Algo similar cabe señalar en Bodas de sangre (1933), tragedia en la que el deseo verdadero aborrece la expresión verbal y se parapeta, de continuo, tras un silencio elocuente. Con todo, el rasgo distintivo de esta pieza respecto de sus dos tragedias hermanas es que también la negación de ese deseo — y, por tanto, el peso de la norma frente a la liberación — adquiere colores simbólicos y antirrealistas, representados por la Luna que, bajo forma de «leñador joven con la cara blanca», irrumpe en el bosque para llamar, con su luz, a la recomposición del orden: « No quiero sombras. Mis rayos / han de entrar en todas partes, / y haya en los troncos oscuros / un rumor de claridades, / para que esta noche tengan / mis mejillas dulce sangre, / y los juncos agrupados / en los anchos pies del aire » [OC, II, 458], y por la ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 97 Mendiga, de sabor maeterlinckiano, que anticipa la muerte de los litigantes. Como Yerma, es la Novia quien silencia la fuerza del dios báquico, pues reniega de su transitoria enajenación —«Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud…» [472]— y asume los preceptos de la norma: «Que quiero que sepa que soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos» [472]. Caso distinto es el representado por una de las piezas que es aquí objeto de nuestra atención: La casa de Bernarda Alba (1936), quizás el único canto a la liberación plena pergeñado por la pluma de Lorca. De forma pareja a los dos casos anteriores, las pasiones se cobijan en un silencio todavía más desgarrador, puesto que actúa como marco de la acción trágica: la acotación inicial perfila ese «silencio umbroso» que se hace palabra en la primera y última intervención de Bernarda. Un silencio que sólo rompe María Josefa, ajena, en su locura, al campo de restricciones impuesto por su hija, con referencia explícita al deseo — «varón hermoso», «mar» y «alegría» son términos que se agolpan en su discurso inconexo. Y roto también en la apelación reincidente que Adela hace a su cuerpo como elemento liberador respecto del horizonte negro que se cierne ante sus hermanas: «Yo hago con mi cuerpo lo que me parece» [1984, 77]; «Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca» [79]. Sin embargo, y a diferencia de Yerma y de la Novia, heroínas trágicas que se autocensuran en su pasión, Adela vive con intensidad el flujo del deseo, y lo experimenta con el silencio como aliado. Así, y mientras sus hermanas hilan y escuchan palabras estériles sobre amores pasados —aquellas referidas por la Poncia sobre ella misma y su esposo Evaristo el Colorín—, Adela, ausente y muda para la acción dramática, dibuja en su interior el cúmulo de pasiones que las sombras nocturnas podrán satisfacerle. Y es que incluso la falsedad de la unión entre Pepe el Romano y Angustias queda perfilada en virtud de la palabra. Si en el primer encuentro entre la mayor de las Alba y su prometido todo fueron palabras del hombre —«Siempre habló él», sentencia Angustias con melancolía reprimida—, en las citas furtivas con Adela todo es entrega salvaje y silente, como bien sentencia la Poncia dotando de entidad palpable el mutismo artificial de la casa: «¿Tú ves este silencio?» [102]. En el rito orgiástico que protagonizan Adela y Pepe, queda proscrita la ISSN 1773-0023 98 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) palabra —de Pepe tan sólo nos llega un silbido—, pues es la comunicación bestial de los cuerpos la única posible. Momentáneamente apartada de la fuente del deseo por la aparición de Martirio, Adela se exhibe como una bacante, investida de fuerza irreprimible contra el corsé de la norma: «A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique» [108]. El suicidio de Adela no puede entenderse, en este sentido, como la censura del deseo vivido en libertad, sino más bien como el triunfo de la voluntad de un ser que, al modo de la Melibea medieval y habiendo conocido la entrega sexual plena, queda inhabilitado para regresar al cauce de lo ortodoxo y elige, en consecuencia, su propio destino. Un deseo en cuya configuración cobra enorme importancia la disposición espacial de la tragedia. La necesidad del hombre resulta angustiosa cuando su presencia se intuye al otro lado de los muros blanqueados de la casa; su olor y su fortaleza los traspasan, una vez más, al son de los cantos de los segadores, todos llenos de alusiones eróticas: «Ya salen los segadores / en busca de las espigas. / Se llevan los corazones de las muchachas que miran. […] / Abrir puertas y ventanas / las que vivís en el pueblo; / el segador pide rosas / para adornar su sombrero» [82]. Con todo, la desmesura dionisíaca palpita todavía fuera y, haciendo nuestras las palabras de Bachelard [La poética del espacio], no rebasa el espacio de protección que la casa representa; tampoco la traspasa cuando Pepe acude, siempre tras la reja, a sus normativas citas con Angustias. Sin embargo, y continuando con el símil nietzscheano, el coro báquico encuentra muy pronto un reflejo en escena, encarnado en la heroína trágica. La confrontación agónica entre deber y pulsión cae de este último extremo precisamente cuando el impulso dionisíaco que Pepe el Romano representa invade los dominios domésticos e irrumpe como «tormenta» —es palabra de Poncia— capaz de «barrernos a todas». Otros hitos fundamentales en el desarrollo de la tragedia contemporánea —e iniciamos así la segunda de las vías trágicas en Lorca— son Casa de muñecas (1879), la inmortal pieza de Ibsen, y la «tragedia naturalista» de Strinberg, La señorita Julia (1888), a partir de las cuales el discurso del género adquiere tintes urbanos encarnados, de ordinario, en personajes de existencia anodina, más propios de registros teatrales más amables al auditorio. Aun cuando con diferencias sustanciales en cuanto a los modelos referenciales, García Lorca tañe también ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 99 los acordes de esta tragedia remozada. Para ello, privilegia los resortes grotescos, a partir de un antihéroe que personifica la oposición de lo farsesco y lo puramente trágico, y que se atavía de máscara carnavalesca. Y es en esta segunda línea donde encontramos una de las paradojas de la concepción trágica lorquiana. Admitiendo su atracción por lo grotesco—ahí está su faceta como dibujante en la que abundan los tipos de la commedia dell´arte italiana—, y hasta optando por dicha estética como motor dramático —de ello es prueba el personaje de Perlimplín, entre otros muchos—, el poeta granadino evidencia un rechazo hacia la máscara, por cuanto metonimia de la mentira, y una búsqueda incesante del amor puro, o si se quiere, del ideal apolíneo frente a la deformación dionisíaca. Cuando la necesidad de la máscara se impone, elige a Pierrot, la más apolínea de todas ellas, pues que el payaso blanco se deleita en un amor puro, carente de carnalidad, y proyectado en los rayos de su única confidente: la luna [Peral Vega, 2007]. Así, el Lorca joven, aún incapaz de romper con la careta postiza, encuentra vía de expresión a su definición amorosa en el Pierrot decadente, bien representado en el poema «Carnaval. Visión interior» (1918) y el texto misceláneo «Pierrot. Poema íntimo» (1918). A medida que la voz interior del poeta vaya imponiéndose, la negación de las máscaras se hará más rotunda, sobre todo cuando su lira acoja el imaginario surrealista como referente. Prueba de ello es el guión cinematográfico Viaje a la luna (1929-1930), en que el disfraz de Arlequín, plagado de colores —no olvidemos que el guión se apoya en un contraste cromático blanco-negro, siendo el primer color símbolo de lo masculino y el segundo de lo femenino— representa la ocultación y la represión más o menos consciente de la sexualidad. En el fragmento 25 —de evidente desmesura gestual mímica—, el traje de Arlequín con que el hombre de la bata tapa, de forma violenta, la boca del muchacho no admite otra lectura que la imposición de una sexualidad castradora y, desde luego, no compartida: «El hombre de bata le ofrece un traje de arlequín pero el muchacho rehúsa. Entonces el hombre de la bata lo coge por el cuello, el otro grita, pero el hombre de la bata le tapa la boca con el traje de arlequín» [1994, 65]. Por su parte, en El público (1930), se produce un juego escénico, soportado en las máscaras italianas, que parece responder, al menos en apariencia, a un error en el planteamiento de la obra. En el cuadro I, cuando los Hombres 2 y 3 empujan al Director detrás del biombo, presenciamos su ISSN 1773-0023 100 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) transformación en una especie de Pierrot clownesco «vestido de blanco con una gola blanca al cuello», cuya ambigüedad sexual se ve potenciada por la acotación: «Debe ser una actriz. Lleva una pequeña guitarrita negra» [2006, 115]. Paradójicamente, sin embargo, en el Cuadro Tercero, leemos «Por detrás de la columna aparece el traje de Enrique. Este personaje es el mismo ARLEQUÍN blanco con una careta amarillo pálido» [160]. Parece incongruente pensar, y más aún si consideramos el dominio de la imaginería de la commedia por parte del poeta granadino, en una confusión. Si la máscara implica, de ordinario, falsedad, hemos de preguntarnos por qué la transformación del Director en un Arlequín blanco es percibida de manera positiva por el resto de los personajes pertenecientes al «teatro bajo la arena». No se trata aquí de un Arlequín burlador —de una máscara connotada heterosexualmente, si establecemos conexión con Viaje a la luna—, sabio manipulador de viejas convenciones teatrales, sino de un remozado Arlequín que renuncia a sus alegres vestimentas para convertirse en estandarte —vestido completamente de blanco, como blanco es Pierrot y como blancos son los caballos que irrumpen en escena— de ese nuevo teatro esencial que se busca con ahínco, de ese, en definitiva, «teatro de la verdad íntima», donde cualquier pulsión puede gritarse sin miedo. Un verdadero canto, en definitiva, al amor puro, por cuanto opuesto a la máscara que oculta y castra, y que se traduce en dos textos que, amén de una inspiración paralela, destilan por igual una visión trágica de la existencia: Poeta en Nueva York (1929) y el ya citado El público. El poeta, lejos de rendirse a la multiplicidad de referentes que descubre al otro lado del Atlántico, se retrae sobre sí mismo y tiende a la definición de su ideal, corporeizado en el dios griego de la armonía y ajeno a las máscaras fáciles de la superficialidad: Pero yo he de buscar por los rincones tu alma tibia sin ti que no te entiende, con el dolor de Apolo detenido con que he roto la máscara que llevas. [«Tu infancia en Menton», PNY, 115] Unas máscaras que el poeta se considera capaz de derribar en este proceso de desvelamiento trágico y doloroso, pero a la vez catártico y esperanzado: ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 101 Para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. [«Cielo vivo», PNY, 168-169] Un poeta que ansía un «amor sin alba», esto es, un amor sin separaciones repetidas, hecho forma en persona y alma concretas, únicas y no cambiantes, como así expresa en «Fábula y rueda de los tres amigos», en la que el recuerdo de los tres amantes se perfila en la imagen de uno solo, pues que el uno es, en atinadas palabras de Martínez Cuitiño, «el ideal Amado, lejano e inalcanzable, en tanto que el amante (el dos) es la conciencia de estar incompleto, el saber que se formó parte de un Todo y el deseo de reintegración de esa unidad» [2002, 7071]. Uno y uno y uno. […] Tres y dos y uno. [PNY, 118] Pero la expresión de esta paradoja, según la cual un inmenso haz de referentes dionisíacos16 —máscaras, escatología, pasiones desinhibidas— entra en colisión con la búsqueda del ideal apolíneo, encuentra su más acabada expresión en la «Oda a Walt Whitman»; el poeta norteamericano, uno de los paradigmas de nuestro autor, es calificado como «Apolo virginal», y de él se dice que es «enemigo del sátiro» y «enemigo de la vid», pues no busca «los ojos arañados, / ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños, / ni la saliva helada, / ni las curvas heridas como panza de sapo / que llevan los maricas en coches y en terrazas / mientras la luna los azota por las esquinas del terror» [221]. La voz de Lorca se levanta contra el hedonismo superficial de los «maricas de las ciudades» por destruir, en su infinita proyección de un placer sin trascendencia, ese amor puro «que reparte coronas de Cabe la pena mencionar el poema “El macho cabrío” (Libro de poemas, 1919), caracterizado por un tono descriptivo, que, si no implica visión negativa respecto de esta criatura, sí la hace heredera de mitológicas criaturas dionisíacas: «¡Machos cabríos! Sois metamorfosis / de viejos sátiros / perdidos ya. / Vais derramando lujuria virgen / como no tuvo otro animal». 16 ISSN 1773-0023 102 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) alegría» [223]. La entrega sin decoro a un placer fácil es sentida, entonces, como «muerte que mana de vuestros ojos», y ante la cual no cabe otra salida que la pureza apolínea con la que cerrar «las puertas de la bacanal». Un ideal apolíneo —y platónico— este que encuentra encarnación dramática en el Hombre 1 de El público, dispuesto a luchar por el «teatro bajo la arena» como vehículo de la verdad íntima y, a su vez, como medio para censurar el deseo oculto, callado y sucio entre los hombres. Así se demuestra en los comentarios de este personaje respecto del combate que Pámpanos y Cascabeles mantienen en el cuadro segundo: HOMBRE 3 : (Entrando.) Debieron morir los dos. No he presenciado nunca un festín más sangriento. HOMBRE 1 : Dos leones. Dos semidioses. HOMBRE 2 : Dos semidioses si no tuvieran ano. HOMBRE 1 : Pero el ano es el castigo del hombre. El ano es el fracaso del hombre, es su vergüenza y su muerte. Los dos tenían ano y ninguno de los dos podía luchar con la belleza pura de los mármoles que brillaban conservando deseos íntimos defendidos por una superficie intachable. [2006, 138] La inviabilidad del «teatro bajo la arena» queda emparentada, íntimamente, con la imposibilidad para el amor puro, ese «amor visible» del que hablaba el poeta en «Cielo vivo», de Poeta en Nueva York, y en ambas recae la dimensión trágica del drama. No de otro modo hemos de entender la crucifixión de Desnudo Rojo —una de las múltiples proyecciones escénicas de Hombre 1— en el cuadro cuarto, y su consecuente sufrimiento ante el triunfo de la mentira, una vez más teatral y vital a un tiempo, pues tan falso es el «teatro al aire libre» que al fin prevalece en las palabras postreras del Director, permitiendo la entrada del público, como falsa es la pasión oscura que, impedida en su pureza, sigue latiendo escondida tras biombos artificiales. Un procedimiento similar es el que utiliza Lorca en la que considero una de sus obras mayores, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín que, aunque tradicionalmente considerada entre su producción farsesca, rebasa los límites de este subgénero en virtud de un proceso de humanización y dignificación trágicas de los tipos aprendidos en nuestra tradición dramática. El arranque de esta «aleluya erótica» se inscribe a la perfección en los cauces ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 103 propios del entremés clásico, y en este sentido no le duelen prendas al poeta en someter a sus criaturas a un proceso de degradación grotesca que tiene mucho de mascarada carnavalesca. Perlimplín aparece en escena con una «casaca verde y peluca blanca llena de bucles» [1996, 253] y empleando un lenguaje de cuño infantil que prefigura su indefensión e ignorancia en asuntos de amores. Algo similar ocurre con la madre de Belisa, coronada con «una gran peluca dieciochesca llena de pájaros, cintas y abalorios» [256], en claro contraste con la desnudez límpida de una Belisa que se muestra al público en todo su esplendor juvenil, por mucho que, una vez consumado su matrimonio con el vejete, aparezca con un excesivo traje de dormir «lleno de encajes» y con «un cofia inmensa» que le «cubre la cabeza y lanza una cascada de puntillas y entredoses hasta sus pies», expresión simbólica de la dificultad infranqueable de Perlimplín para alcanzar el cuerpo de su esposa, como él mismo refiere al verla: «Belisa… con tantos encajes pareces una ola y me das el mismo miedo que de niño tuve al mar» [261]. Sin embargo, los resortes grotescos muy pronto acallan sus voces para dejar camino expedito a la tragedia, marcada por la infidelidad de Belisa con otras tantas máscaras furtivas —cinco en total— en su primera noche de bodas, y el conocimiento súbito del dolor que el amor implica: Me casé… ¡por lo que fuera!, pero no te quería. Yo no había podido imaginarme tu cuerpo hasta que lo vi por el ojo de la cerradura cuando te vestían de novia. Y entonces fue cuando sentí el amor, ¡entonces!, como un hondo corte de lanceta en mi garganta [263]. Una cerradura que, de modo parejo a los balcones enfrentados del primer cuadro, simboliza la imposibilidad rotunda para Perlimplín de conocer el deseo de manera directa y su necesaria claudicación ante la vitalidad desaforada de Belisa. Así las cosas, la aparición, al final del cuadro segundo, de dos duendecillos para impedir que el espectador presencie el engaño supone el inicio del proceso de humanización que Lorca lleva a cabo sobre el pelele, con el fin de levantar sobre las tablas la lucha agónica entre dos concepciones diversas del amor: de un lado, Perlimplín, soñador con resabios del Pierrot finisecular, que busca la culminación de un amor puro y tranquilo. De ahí que, conocedor ya de su condición de cornudo, apele poéticamente a ese ideal apolíneo, atravesado por el dolor trágico del deseo: ISSN 1773-0023 104 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Amor, amor que estoy herido. Herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido el ruiseñor. Bisturí de cuatro filos garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, ¡herido! ¡Muerto de amor! [272] De otro, Belisa que, apolínea en su belleza limpia, representa el hedonismo dionisíaco más puro, ajena a la culpa y dispuesta a disfrutar siempre de su cuerpo. En un acercamiento superficial al texto, pudiera parecer que la creación, por parte de Perlimplín, de un alter ego de condición donjuanesca para atraer a Belisa conlleva su renuncia al amor puro y su claudicación consecuente a un sentimiento de condición unívocamente sexual. Una interpretación ésta que pudiera verse cimentada por el suicidio de Perlimplín —escindido en un ritual de máscaras intercambiables— en presencia de su esposa, en lo que cabría ser considerado —de acuerdo al poso entremesil de la pieza— como el triunfo del hedonismo juvenil frente a la vejez estéril. Sin embargo, y una vez más en el teatro de García Lorca, es la dimensión dionisíaca del deseo la que resulta censurada a la postre. El sacrificio de Perlimplín, investido de connotaciones cristológicas evidentes, no sólo redime de culpa a su díscola esposa —«Estás vestida por la sangre gloriosísima de mi señor» dice Marcolfa a Belisa ante el cuerpo difunto del vejete— sino que le enseña la otra cara de la entrega amorosa y le otorga un alma pura para enfrentar su nueva existencia. ISSN 1773-0023 ÉTUDES SUR LE TRAGIQUE E DANS LE THEATRE ESPAGNOL DU XX SIECLE 105 Como puede verse, en este necesariamente breve repaso, el registro trágico de Lorca adquiere muchos y diversos matices, de filiación clásica y contemporánea, en todos los cuales se perfila la lucha entre la norma y la diferencia —un marbete este que sirviera de título a la monografía de Luis Fernández Cifuentes—, entre el amor puro y su reverso salvaje y sexual; un combate este que, aun cuando expresado con resortes grotescos, más propios del imaginario carnavalesco y dionisíaco, esconde, casi siempre —con la única salvedad de La casa de Bernarda Alba— ya una asunción de lo reglado —así el caso de Yerma y Bodas de sangre—, ya una decantación por el amor en su dimensión más idealista y pura, ajeno a las máscaras de toda condición —así en El público y Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín. Bibliografía A) Ediciones García Lorca, Federico, La casa de Bernarda Alba, ed. Miguel García Posada, Madrid, Castalia Didáctica, 1984. ____, Poeta en Nueva York, ed. María Clementa Millán, Madrid, Cátedra, 1990. ____, Viaje a la luna, ed. Antonio Monegal, Valencia, Pre-Textos, 1994. ____, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, ed. Margarita Ucelay, Madrid, Cátedra, 1996. ____, Prosa inédita de juventud, ed. Christopher Maurer, Madrid, Cátedra, 1996. ____, Bodas de sangre, en Obras completas II. Teatro, ed. Miguel García Posada, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1997, p. 413-475. ____, Yerma, ed. Ildefonso-Manuel Gil, Madrid, Cátedra, 2001. ____, El público, ed. Javier Huerta Calvo, Madrid, Espasa, col. Austral, 2006. B) Estudios Bachelard, Gaston, La poética del espacio, trad. Ernestina de Champourcin, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2ª ed., 1975. Carmona Vázquez, Antonia, Coincidencias de lo trágico entre Eurípides y Federico García Lorca, Madrid, Alcañiz, 2003. Dougherty, Dru, «El lenguaje del silencio en Federico García Lorca», Anales de Literatura Española Contemporánea, 11 /1-2, 1986, p. 91-110. Fernández Cifuentes, Luis, García Lorca en el teatro: la norma y la diferencia, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1986. ISSN 1773-0023 106 CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ESPAGNE CONTEMPORAINE / CENTRE INTERLANGUES EA 4182 (UNIVERSITE DE BOURGOGNE) Jerez-Farrán, Carlos, «García Lorca, el espectáculo de la inversión sexual y la reconstitución del yo», Bulletin of Spanish Studies, LXXXIII/ 5, 2006, p. 669-693. Martínez Cuitiño, Luis, El mito del andrógino en Federico García Lorca: un «Viaje a la luna», Buenos Aires, Corregidor, 2002. McDermid, Paul, Love, Desire and Identity in the Theatre of Federico García Lorca, Woodbrige, Tamesis, 2007. Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 2000. Peral Vega, Emilio, «Burla clásica-burla moderna: el personaje de Perlimplín», in Tiempo de burlas. En torno a la literatura burlesca del Siglo de Oro, Madrid, Verbum, 2001, p. 223244. _____, La vuelta de Pierrot. Poética moderna para una máscara antigua, Málaga, Edinexus, 2007. Phocas Sabbah, Jacqueline, «Parole et silence dans La casa de Bernarda Alba», in Begoña Riesgo (coord), Le retour du tragique. Le théâtre aux prises avec l’histoire et la rénovation esthétique (1920-1936), Nantes, Éditions du Temps, 2007, p. 186-209. ISSN 1773-0023