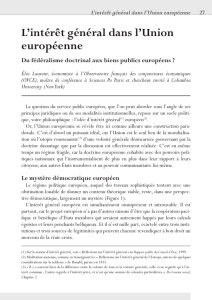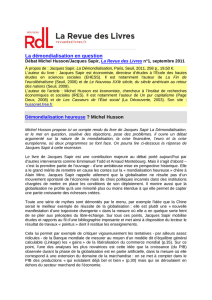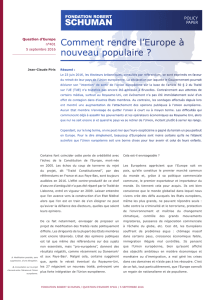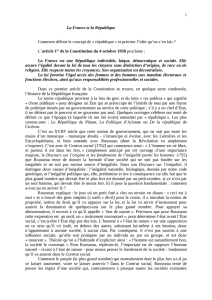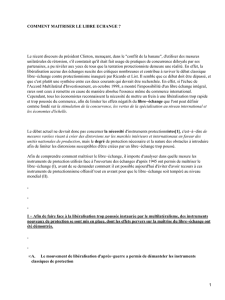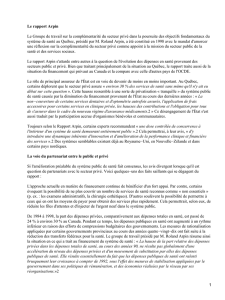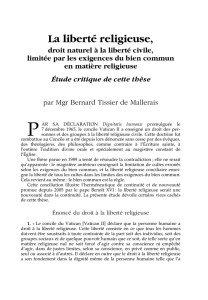Le libéralisme
Anuncio
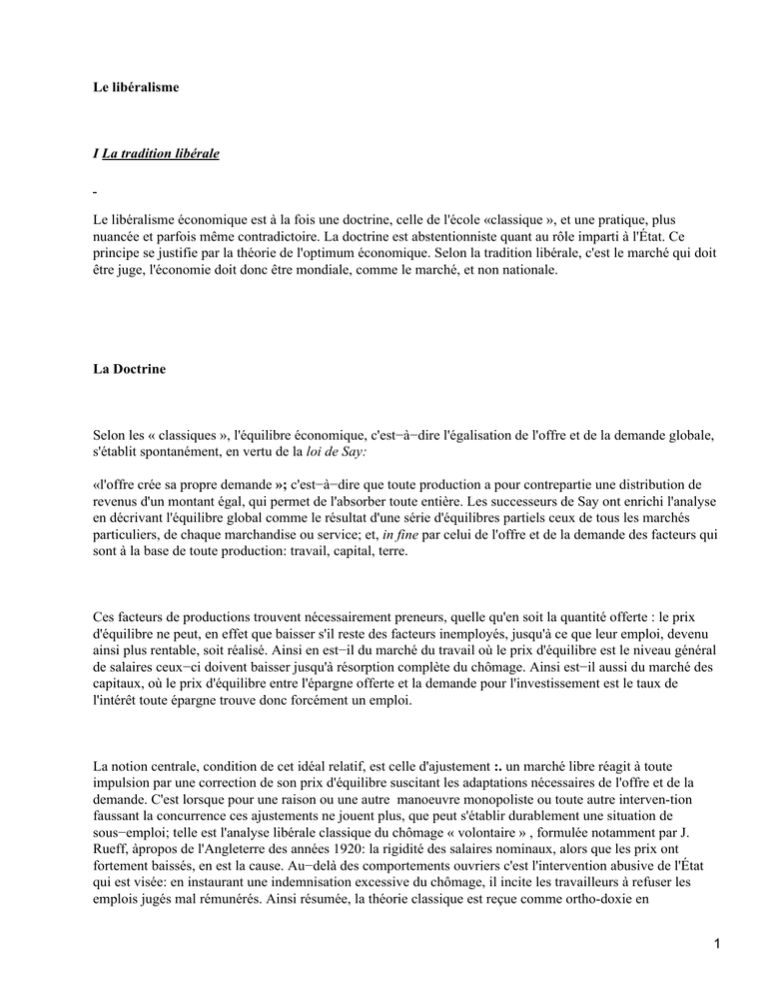
Le libéralisme I La tradition libérale Le libéralisme économique est à la fois une doctrine, celle de l'école «classique », et une pratique, plus nuancée et parfois même contradictoire. La doctrine est abstentionniste quant au rôle imparti à l'État. Ce principe se justifie par la théorie de l'optimum économique. Selon la tradition libérale, c'est le marché qui doit être juge, l'économie doit donc être mondiale, comme le marché, et non nationale. La Doctrine Selon les « classiques », l'équilibre économique, c'est−à−dire l'égalisation de l'offre et de la demande globale, s'établit spontanément, en vertu de la loi de Say: «l'offre crée sa propre demande »; c'est−à−dire que toute production a pour contrepartie une distribution de revenus d'un montant égal, qui permet de l'absorber toute entière. Les successeurs de Say ont enrichi l'analyse en décrivant l'équilibre global comme le résultat d'une série d'équilibres partiels ceux de tous les marchés particuliers, de chaque marchandise ou service; et, in fine par celui de l'offre et de la demande des facteurs qui sont à la base de toute production: travail, capital, terre. Ces facteurs de productions trouvent nécessairement preneurs, quelle qu'en soit la quantité offerte : le prix d'équilibre ne peut, en effet que baisser s'il reste des facteurs inemployés, jusqu'à ce que leur emploi, devenu ainsi plus rentable, soit réalisé. Ainsi en est−il du marché du travail où le prix d'équilibre est le niveau général de salaires ceux−ci doivent baisser jusqu'à résorption complète du chômage. Ainsi est−il aussi du marché des capitaux, où le prix d'équilibre entre l'épargne offerte et la demande pour l'investissement est le taux de l'intérêt toute épargne trouve donc forcément un emploi. La notion centrale, condition de cet idéal relatif, est celle d'ajustement :. un marché libre réagit à toute impulsion par une correction de son prix d'équilibre suscitant les adaptations nécessaires de l'offre et de la demande. C'est lorsque pour une raison ou une autre manoeuvre monopoliste ou toute autre interven-tion faussant la concurrence ces ajustements ne jouent plus, que peut s'établir durablement une situation de sous−emploi; telle est l'analyse libérale classique du chômage « volontaire » , formulée notamment par J. Rueff, àpropos de l'Angleterre des années 1920: la rigidité des salaires nominaux, alors que les prix ont fortement baissés, en est la cause. Au−delà des comportements ouvriers c'est l'intervention abusive de l'État qui est visée: en instaurant une indemnisation excessive du chômage, il incite les travailleurs à refuser les emplois jugés mal rémunérés. Ainsi résumée, la théorie classique est reçue comme ortho-doxie en 1 Grande−Bretagne, en France, aux États−Unis. Seule enseignée dans les facultés elle est aussi le fondement, plus ou moins vague, de la vision économique des gouvernants. Une intervention strictement limitée Politiquement, la tradition libérale limite la souveraineté par sa finalité utilitariste: le pouvoir est légitime dans la mesure où il assure l'ordre intérieur et la sécurité extérieure de la collectivité nationale. Dans le domaine économique, ces critères sont incertains, en dehors des attributions strictes de l'État−gendarme, dont relève par exemple la législation protégeant la libre concurrence. Pour le reste, l'inter-vention de l'Etat obéit à des préoccupations indépendantes, dénuées le plus souvent de cette cohérence d'ensemble qui permettrait sans restriction de parler d'une véritable politique économique. Au début du XXe siècle, on peut la circons-crire à trois domaines, dont deux ont connu un développement récent entaché de quelques traces d'hétérodoxie: la monnaie, la protection de certains intérêts reconnus, la prise en charge d'un service public minimal. La monnaie L'intervention de l'État dans ce domaine remonte aux plus anciennes origines du pouvoir régalien. À l'ère libérale, elle est la plus éloignée de toute politique et relève de l'ordre public: garantir la valeur stable de la monnaie tout en assurant l'émission de liquidités en quantité suffisante pour les besoins de l'économie. Ces deux exigences peuvent être parfois contradictoires. La première a été assurée par l'étalon−or, définissant l'unité monétaire par un poids, ce qui impose que les billets soient convertibles à tout moment et sans limite dans ce métal précieux: en pratique, cette règle suppose une émission monétaire prudente, n'excédant pas exagérément la masse métallique qui la garantit. Au contraire, la seconde peut conduire à la multiplication de ces mêmes billets, par exemple par l'escompte des effets de commerce jusqu'à un montant sans rapport avec leur couverture−or. La juste mesure a été trouvée partout dans un même dosage entre l'indépen-dance de l'Institut d'émission et l'intervention gouvernementale : ainsi, en France l'équilibre entre les régents élus par les deux cents plus gros actionnaires de la Banque de France, en principe seuls à décider quel papier est admissible à l'escompte, et le gouverneur, nommé et révocable à discrétion. En fait l'interven-tion est surtout tacite, sans passer par des procédures institutionnelles : il s'agit le plus souvent pour le ministre de solliciter, au nom de l'intérêt public, une politique monétaire expansive lors d'une conjoncture difficile où menacent les faillites. L'intervention légale, en sens inverse, se borne à l'édiction de règles disciplinaires telles qu'un taux de couverture minimale des billets par l'encaisse métallique (l'Angleterre, plus rigoureuse, a fixé un plafond légal chiffré à l'émission, par le Peel Act de 1844); cette législation est bien inutile alors que la Banque, privilégiée mais de statut privé, est soumise aux obligations d'un banquier ordinaire: être capable de rembourser immédiatement ses déposants en l'occurrence les déten-teurs de billets convertibles en or. En bref, des deux 2 exigences contradictoires évoquées plus haut, c'est la seconde qui l'emporte : la monnaie est soumise à la loi de l'étalon−or et non aux exigences de la politique gouvernementale. La seule véritable nouveauté des années 1920 est en définitive fortuite: la suspension de la convertibilité par tous les belligérants à l'exception des Etats-Unis remet au premier plan la décision souveraine de l'État en matière de défini-tion monétaire, nécessairement consacrée par la loi. Le retour à l'étalon−or et la définition de la parité en Grande−Bretagne et en France sont au coeur des choix politiques de l'époque. Encore le déplacement institutionnel apparent ne modifie−t−il guère l'équilibre tacite entre le gouvernement et la Banque centrale, et les gouverneurs, Moreau et Montagu Norman, ont−ils une influence décisive sur la parité choisie autant que sur la gestion quotidienne de la politique monétaire. La protection d'intérêts reconnus légitimes Le deuxième terrain de l'intervention publique est à la fois le plus éloigné des principes libéraux généralement proclamés au début du siècle et le moins suscep-tible, par son inspiration très hétérogène, de former une politique économique cohérente: il s'agit de l'ensemble des mesures tendant à protéger certains intérêts parce que nationaux, ou justifiés par des considérations d'équilibre social, ou par un intérêt économique général supposé. La plus importante de ces entorses au libéralisme est le protectionnisme doua-nier, généralement vigoureux dans les pays industrialisés avant 1914 et encore renforcé face aux marchés internatio-naux perturbés des années 1920. La justification de cette politique est clairement énoncée comme la protection de certains intérêts particuliers mais reconnus légi-times. En France comme en Allemagne, les lois protectionnistes de la fin du siècle sont imposées par la coalition des intérêts agraires, étrillés par la concurrence des blés américains ou russes, et de certains groupes de pression industriels. Ces lois s'appuient sur des considérations d'équilibre social. Aux États−Unis, le protection-nisme atteint des sommets avec le tarif MacKinley de 1890, et l'assouplissement ultérieur ne dure guère au−delà de la première guerre mondiale; seule la volonté de permettre des profits et des salaires élevés, à une industrie qui ne craint guère les compétiteurs étrangers, explique ces droits prohibitifs. Dans ces décisions, le rôle de l'État se résume à un arbitrage, cherchant le plus large compromis possible entre les groupes en présence. Telle est la politique de Méline en France. Ses lois de 1892 modulent la protection douanière, qui est loin d'être un principe général: les droits sont modérés sur les produits de base pour répdndre au voeu majoritaire de l'industrie et du commerce, contre l'intérêt des producteurs de charbon dont l'influence n'était pourtant pas négligeable; par contre le protectionnisme agricole est prohibitif, en vertu d'une volonté de freiner l'exode rural et de maintenir la paysannerie dans son rôle supposé de contrepoids conservateur. Si en Grande−Bretagne, la politique libre−échangiste, maintenue malgré les efforts de Joseph Chamberlain, est plus unilatérale, c'est tout simplement que les intérêts opposés sont trop minoritaires : on sait que tout l'équilibre social du pays repose sur le libre−échange. Le protectionnisme doua-nier n'est qu'un aspect de la protection des intérêts admis. Sur le plan intérieur se multiplient, depuis la fin du XIXe siècle, les initiatives 3 tendant à soustraire certains secteurs de la production ou certains aspects de la vie sociale à la loi du marché. Cette tendance a un protectionnisme déguisé n'est donc pas nouvelle, et nous verrons plus loin comment elle peut−être appliquée à certains pays asiatiques aujourd'hui . La prise en charge d'un service public minimal De longue date, l'État libéral a été en charge d'activités industrielles ou commerciales: directement, par des entreprises publiques de forme variable, ou indirectement, en déléguant la gestion à un concessionnaire privé ou aux collecti-vités locales. Ces dernières du reste, usant de la liberté qui leur est laissée, notamment dans le monde anglo−saxon, prennent elles−mêmes l'initiative de la création de services nouveaux; les plus actives sont souvent les grandes municipa-lités socialistes qui se sont multipliées au début du xxc siècle, surtout les plus réformistes : «le socialisme municipal» est le pilier principal de la doctrine fabienne en Angleterre. Ces initiatives, critiquées par certains, ne sont pas pour autant considérées comme attentatoires au principe même de l'État libéral, puisque décentralisées. Si l'État français les contrôle plus étroitement, il s'agit plutôt d'un héritage autoritaire napoléonien, qui confie au préfet, plus qu'aux citoyens, la tutelle budgétaire des communes. Ces activités destinées à assurer les conditions ou le fonctionnement même de services publics relèvent d'une notion plus large que les simples fonctions de la souveraineté. Elles définissent le concept d'Etat minimal, dont la limite des attri-butions est, d'ailleurs, matière à controverse doctrinale. Quelle que soit leur étendue, leur liste aux détails variables est, dans ses grands chapitres, exhaustive. Elle inclut d'abord les activités découlant de la souveraineté même: arsenaux, monopoles fiscaux; ceux−ci ne sont bien entendu admis que dans la mesure où leur objet est manifestement dénué de toute importance suscep-tible d'en faire un instrument d'orientation de l'activité économique ainsi en est−il du monopole français du tabac et des allumettes. Le cas des services publics à proprement parler est plus complexe. L'État a la responsabilité générale d'assurer leur existence et leur continuité.Souvent le service est concédé à un entrepreneur privé bénéficiant de certains privilèges, en échange des obligations particulières que lui impose la continuité du service public: les chemins de fer en sont un modèle; ou bien ce sont les collectivités locales, déléga-taires de certaines fonctions, qui en concèdent la gestion: ainsi en est−il ordinairement des transports, du gaz et de l'éclairage urbains. Mais ces attribu-tions de principe souffrent des exceptions, justifiées par la responsabilité, qui incombe aux pouvoirs, d'assurer la continuité du service public en cas de carence de l'entreprise privée: c'est ce qui a conduit la IIIe République à nationaliser, en 1908, les chemins de fer de l'Ouest en faillite, non sans susciter, du reste, les criti-ques doctrinales. Quant à l'instruction minimale obligatoire, prise en charge directement ou non par l'État, et en tout cas réglée et financée par lui partout en Europe, son inclusion dans les compétences de l'État minimal est rarement Contestée. Si nous avons vu que la doctrine libérale donne un rôle minimal à l'Etat, dans la réalité, son action sur l'économie est loin d'être négligeable. Nous allons voir que par différents moyens, l'Etat influe sur le monde économique, dans son orientation intérieure, mais également vis à vis de l'extérieur. 4 II L'action de l'Etat La dépense publique et l'orientation de l'économie À la différence de l'impôt, qui agit surtout par incitation, la dépense est le moyen pour l'État d'une action plus directe. Pour cette raison, elle a eu souvent, comme instrument de politique économique, la préférence des keynésiens européens d'après−guerre, de tempérament dirigiste. Elle est une composante mesurable de la demande, dont les répercussions sont appréhendées à travers les modèles économétriques. Au−delà de son effet global sur la conjoncture, elle imprime sa direction à des activités qu'elle prend en charge, en influence d'autres par ses transferts, crée des comporte-nents, assume des décisions dont certaines relèvent de choix stratégiques. La dépense peut être analysée selon les fonctions de l'État, ou selon les fonc-tions économiques qui ne sont pas les mêmes. Les premières regroupent les postes budgétaires par grandes catégories les domaines de la souveraineté et ce qui relève de l'action économique et sociale. Les secondes permettent de distinguer les dépenses de fonctionnement, principalement en personnel, les dépenses d'équi-pement et les dépenses d'intervention. Les fluctuations des unes et des autres ont un important impact conjoncturel. Les variations de l'emploi public peuvent porter en quelques années sur des centaines de milliers de postes dans les grands pays. Quel que soit le critère de classement, nous rencontrons un fond incompressible de la dépense publique, qui en représente le plus gros, et qui correspond à l'exis-tence même de l'État. Par ailleurs, sa montée universelle au XXe siècle, est née non seulement de l'interventionnisme économique et social, dont l'ampleur est contin-gente à certaines philosophies et sujette à réexamen, mais aussi du besoin croissant de biens collectifs, non marchands par nature ou par fait de civilisation: enseigne-ment, santé, culture, infrastructures, au moins au niveau d'une dotation minimale. Leur importance est responsable de la part, aujourd'hui majoritaire, des dépenses des collectivités territoriales et locales et des organismes sociaux décentralisés. Au−delà de son effet conjoncturel, le budget de l'État influence fortement les struètures de l'économie et leur évolution. Les dépenses d'équipement en repré-sentent une part très minoritaire, mais une composante stratégique de l'investissement de la nation. Leur importance est au premier chef imputable aux commandes militaires, dont le coût est très élevé dans le monde contemporain. Aux Etats−Unis, les seules dépenses de recherche et d'équipement du Département de la Défense représentaient en 1985 une masse sensiblement équivalente au budget total de 1' Etat français. S'adressant principalement à des secteurs de pointe, elles ne 5 pouvaient être vierges de toute orientation industrielle. Une telle politique structurelle est par ailleurs explicite dans les différentes dépenses d'intervention économiques: soutien aux secteurs en difficultés, aides àl'agriculture, à la construction, aux régions, subventions accompagnant les efforts de modernisation, prise en charge de la recherche, promotion et assurance des exporta-tions, La multiplicité et l'ambiguïté des pressions qui les imposent en limitent l'efficacité: il s'agit autant du maintien de situations protégées que d'une politique clairement conduite. Protections, monopoles et prérogatives Le droit unilatéral de l'État n'est évidemment pas appliqué à la seule édiction de règles neutres comme le Code de la route. Il lui permet d'exercer une contrainte au profit des priorités économiques et sociales qui lui paraissent souhaitables. La forme la plus multiple en est représentée par les mesures restreignant la concur-rence, dans un but supposé de service public. Des professions sont protégées, avec un accès réglementé : en France, elles vont des pharmaciens aux notaires en passant par les chauffeurs de taxi. Leur rémunération est éventuellement fixée administrativement. Il est vrai qu'il s'agit souvent de la contrepartie d'une prestation financière de l'État ou d'organismes para publics et non d'un pur acte d'autorité; les exemples les plus classiques en sont la fixation des honoraires médicaux par les organismes de sécurité sociale et le soutien des prix agricoles. L'incidence de ces derniers sur l'équilibre écono-mique général n'est pas négligeable. Dfférents monopoles à finalité directement économique résultent de la volonté expresse de la puissance publique. C'était paradoxalement courant aux États−Unis malgré la tradition anti−trust, avant la déréglementation récente. En dehors des télécommunications, où il s'agissait d'une tolérance au profit d'AIT, le cas le plus connu est celui des transports intérieurs, notamment aériens. Ceux−ci étaient régis par une Agence fédérale, le CAB (Civil Aeronautic Board) délégataire, au nom du Congrès, d'un pouvoir de réglementation. Le CAB était seul habilité à autoriser l'ouverture d'une ligne, répartissait le marché entre quelques compagnies et fixait les tarifs. La justification officielle était que le monopole de quelques gros trans-porteurs assurait une importante économie d'échelle. Les enquêtes du Sénat ont montré le caractère partial de cette argumentation. Son inanité a été prouvée a posteriori par l'application de la loi de déréglementation votée en 1978, qui s'est traduite par une intensification de la desserte, accompagnée d'une spectaculaire baisse des prix. Cet exemple négatif ne doit pas faire oublier que ces privilèges ont toujours des justifications, qui doivent être mises en balance avec leurs inconvénients. Parmi les moins contestés est celui qui résultait en France de la répartition par l'État du marché pétrolier monopole du reste assoupli par l'entrée libre, depuis 1984, de produits raffinés provenant de la CEE. Le caractère stratégique de cet approvision-nement énergétique, pour un pays totalement dépourvu, entraîne en général la conviction. 6 LE SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC Les moyens qui précèdent découlent des pouvoirs du souverain: celui de lever l'impôt, de battre monnaie, d'édicter unilatéralement des règles s'imposant à tous. L'existence d'un secteur public donne les moyens d'une autre intervention par la seule voie des mécanismes économiques et financiers. Depuis un siècle, sans qu'aucune époque ni aucune cause aient été décisives, l'État est devenu entrepreneur. Les origines multiples des entreprises publiques leur confèrent une grande hétérogénéité. Cet ensemble foisonnant offre toutes ressources pour orienter l'économie. Au−delà du secteur nationalisé, notion étroite, s'étend par ailleurs tout un domaine public et parapublic dont la définition et les liens sont incertains mais le poids financier considérable. Le secteur public d'État Une approche familière du secteur public en France, et dans d'autres pays, est fournie par la notion de nationalisation. Au sens strict, il s'agit de la soustraction du secteur privé d'entreprises ou d'activités préexistantes. En fait, certaines entre-prises nationales ont été créés de toutes pièces pour prendre en charge des activités nouvelles : c'est le cas de la TVA américaine, chargée non seulement de l'aména-gement de la vallée du Tennessee mais de la gestion de ce potentiel hydraulique et électrique, ou, dans le même pays, de la NASA; ou de l'ONIA français, Office national industriel de l'azote, fondé en 1924 pour mettre en exploitation les brevets Bayer transférés à la France par le traité de Versailles. On peut donc, dans un sens large, définir le secteur nationalisé comme l'ensemble des entreprises dont la possession par l'État, quelle qu'en soit la forme juridique, découle d'un statut légal. Mais elles n'épuisent pas la notion de secteur public. Rien n'est plus hétérogène de toute façon que ce secteur, dont l'histoire est dépourvue de quelque unité que ce soit. La strate la plus ancienne a été constituée par l'érection de services publics en établissements autonomes: ainsi, en France, les PTT ou le Crédit agricole. Le hasard a une grande importance: faillites des années trente, à l'origine de l'empire industriel et financier de l'IRI italien; poli-tique autarcique de l'Allemagne nazie; nationalisations−sanctions françaises de la Libération, avec Renault et la SNECMA. La grande crise n'est pas négligeable, sans constituer une étape décisive. Plus importantes sont les vagues de nationalisa-tion qu'ont connu depuis la guerre la France et la Grande−Bretagne, les premières à découler d'un plan global. Encore la conception n'en est−elle pas la même. Au Royaume−Uni, les nationalisations de 1945−1950 s'appuyaient sur le programme travailliste qui prévoyait une large socialisation de l'industrie, ainsi que de la distribution des produits de première nécessité. Leur extension dans les années 1960 et 1970 par le même Labour était curieusement justifiées par des considéra-tions plus strictement économiques de reconstruction industrielle. En France, les nationalisations de la libération furent d'abord, au−delà des discours, le moyen d'un investissement massif dans le secteur de base de l'énergie et de direction de l'économie par le contrôle des institutions financières : les quatre premières banques de dépôts et les assurances. Celles de 1981−82, d'une ampleur sans précé-dent, obéissaient à des 7 principes confus dans leur formulation, hésitant entre les considérations idéologiques et les justifications économiques. Cette genèse discontinue se traduit par l'extrême diversité des secteurs écono− −miques où interviennent les entreprises publiques, de leur statut juridique, de leur mode de gestion. Aucune doctrine officielle cohérente n'a du reste jamais été −définie, dans aucun pays, quant aux finalités qui leur étaient assignées. L'éventail des statuts rend particulièrement délicate la délimitation du secteur public. Certains services publics industriels et commercÏaux n'ont même pas de personnalité juridique distincte de celle de l'Etat: c'est souvent le cas des Postes et Télécommunications, qui étaient, en France jusqu'en 1991, un ministère, simplement doté de l'autonomie financière. D'autres établissements ont une personnalité morale et une grande latitude commerciale, tout en étant soumis à des règles administratives : notre Caisse des dépôts et consignations a même un personnel placé majoritairement sous le statut de la fonction publique. Les entre-prises nationalisées le sont, en France comme au Royaume−Uni, par la loi, mais la propriété qui en découle est de forme variable: l'État peut être statutairement propriétaire unique ou détenteur d'une part du capital, définie expressément ou par un simple minimum légal. Cette échelle décroissante du contrôle de l'Etat rend en apparence formelle la distinction entre les entreprises nationalisées et les filiales privées d'entreprises publiques. La nature économique des entreprises publiques est tout aussi hétérogène. La distinction la plus évidente oppose celles qui assurent un service de base et celles qui ont une activité concurrentielle. La première catégorie, plus large que la seule notion de service public, est assez bien recouverte par la définition officielle fran-çaise des grandes entreprises nationales (EDF, GDF, Charbonnages de France, SNCF, La Poste, France Télécom, RATP, Air France, Air Inter): des monopoles de base dans le secteur de l'énergie, des transports et des télécommunications et des services publics plus ou moins naturels ou traditionnels. Encore cette branche est−elle loin d'être homogène notamment par le caractère diversement concurren-tiel ou «substituable» des productions ou des services. Elle est la composante majoritaire du secteur public dans la plupart des pays, y compris aux Etats−unis, où il est globalement modeste: on peut y rattacher la TVA, la NASA, le réseau ferroviaire Amtrak. Les relations extérieures La souveraineté de l'État est a priori illimitée à l'égard de l'extérieur. Seules les bornes qu'il a lui−même acceptées, par les traités internationaux, supérieurs en droit à la loi nationale, peuvent lui être opposées. L'arme douanière, principale manifestation de ce droit souverain, était à l'ori-gine surtout un instrument fiscal. Elle rentrait par là dans un dilemme son succès comme protection commerciale risquait de tarir le 8 courant alimentant les caisses de l'Etat. Depuis 1945 les conceptions anciennes, d'un protectionnisme défensif ou d'un fiscalisme archaique, ont cédé la place à une appréhension à la fois plus nuancée et plus ambitieuse des échanges. La politique douanière s'inscrit dans un arsenal plus large de mesures tendant àmaîtriser et à utiliser les partenaires extérieurs elles vont des contrôles sanitaires et techniques pas nécessairement hypocrites! aux rétorsions anti−dumping, en passant par l'éventuelle réglementation des investissements étrangers. Leur finalité peut être indifféremment, ou simultanément, de protectionnisme, d'ordre public intérieur ou de négociation. Le champ ne se limite plus à une politique commerciale mais à l'ensemble des flux qui relient la nation à l'étranger. Les mouvements de capitaux ont été de longue date soumis à tutelle, mais la politique des services prend une place croissante à l'heure de l'explosion tertiaire; à côté des communications extérieures, traditionnellement contrôlées en vertu de la souveraineté sur l'espace terrestre, aérien et maritime national, se sont multipliés des domaines nouveaux soumis à la concurrence extérieure. Les mouvements migratoires tombent également sous la puissance de l'État, ce qui n'est pas nouveau; mais on sait que les décisions dans ce domaine sont loin d'être dictées principalement par des considérations économiques. L'horizon d'une telle politique des relations extérieures n'est pas une simple exten-sion de la politique commerciale à de nouveaux domaines. Il relève d'une stratégie. Une protection modulée favorise l'évolution sectorielle de l'économie vers les créneaux d'avenir, tout en fournissant un argument de négociation avec les parte-naires−concurrents menaçant des produits sensibles. En revanche d'autres importations sont encouragées par l'aplanissement de la contrainte que représente la frontière, même en dehors de toute protection. L'ouverture met l'extérieur à contribu-tion comme appoint des forces nationales: exemplaire est le statut douanier américain des maquiladoras, entreprises frontalières mexicaines dont la sous-traitance est préciedse face à la concurrence asiatique. Bien entendu, cette conception stratégique des relations extérieures fait sa part au protectionnisme pur et simple, là où les exigences sociales, la cohésion nationale ou l'opportunité politique l'imposent. Le contrôle des mouvements de capitaux relève de différents registres. Il comporte un volet traditionnel, où la souveraineté est une fin en soi : l'autorisation des émissions et emprunts étrangers fut une arme diplomatique de la France avant 1914. Le contrôle des investissements demeure un instrument dont l'usage est variable : s'il exprimait une volonté d'indépendance dans la France gaullienne, il a été plus souvent appliqué à des fins d'orientation dans le cadre d'une politique industrielle. Les mêmes voies d'autorité peuvent être appliquées à l'orientation de l'épargne nationale; notre pays en a fait grand usage, sous une forme assez cons-tamment dirigiste, mais aussi l'Amérique keynésienne des années 1960, sous une forme plus subtile : une taxe d'égalisation y corrigeait les intérêts trop avantageux des emprunts extérieurs, au profit de l'investissement national. 9 Le contrôle des changes subordonne toute opération impliquant une conversion en monnaie étrangère à un monopole ou une autorisation. Le monopole d'achat et de vente de devises au profit de différents offices de clearing dans certains pays exprimait dans les années 1930 une politique structurelle tendant à l'autarcie. Aujourd'hui le contrôle administratif des changes appartient surtout au passé; pour autant qu'il a encore été utilisé en France en 1982 ce fut comme un instrument très provisoire de politique conjoncturelle. Il permet de maîtriser àcourt terme un déséquilibre, mais il n'est pas un moyen de correction durable. Il ne constitue, au regard des engagements internationaux consentis dans le cadre du FMI et du GATT, qu'une mesure de sauvegarde exceptionnelle, normalement prohibée pour les opérations courantes, c'est−à−dire les paiements liés au commerce des biens et des services non financiers. Un exemple, le cas du Japon : Ce pays illustre l'inadéquation des schémas d'un libre−échange abstrait: son marché est difficilement pénétrable pour des raisons qui échappent aux critères classiques du protectionnisme. On comprend mal dans des termes ricardiens les obstacles retors opposés, entre autres exemples, aux ventes de produits informatiques américains au Japon : c'est dans un pays dont les exportations, entièrement composées de produits manu-facturés et surtout de haut niveau technologique excèdent d'un tiers les importations; celles−ci sont faites à 70% de produits bruts et de biens intermé-diaires comme si ce pays entendait n'acheter aux autres que les ressources premières indispensables à sa machine industrielle unilatéralement exportatrice. La réalité japonaise est sans doute plus complexe que les soupçons qu'elle fait naître; mais les partenaires sont naturellement enclins à ne se contenter ni d'explications dilatoires ni des apparences institutionnelles et douanières et à ne considérer que les résultats chiffrés : le Japon a un déficit d'importation . L'exception japonaise relève de l'anthropologie. Le modèle individualiste occi-dental est le fondement implicite des logiques économiques décrites dans la seconde partie de ce livre, qu'elles soient classique ou keynésienne. Le Japon peut−il les mettre en oeuvre par une politique de stimulation de sa demande interne, comme l'en ont souvent et fermement prié ses partenaires? Le rapport Maekawa de 1986 annonçait un remodelage dépensier de la société, appuyé sur des mesures fiscales appropriées. Le bilan en est incertain : la demande intérieure et certaines importations manufacturées ont fortement augmenté dans les cinq années suivantes; mais il semble que ce soit plus au profit de l'investis-sement que de la consommation privée. 10