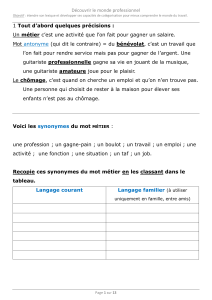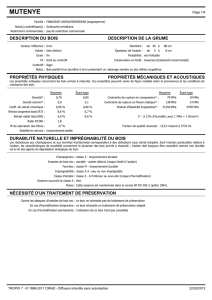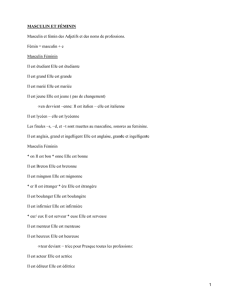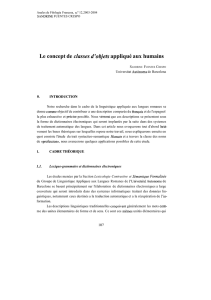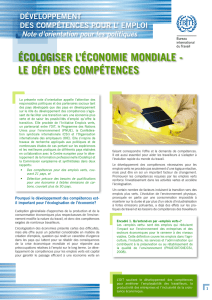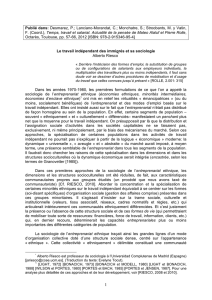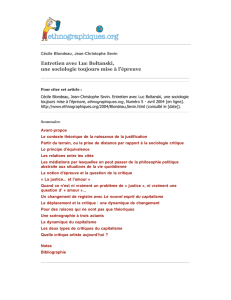categorisation professionnelle et classements sociaux : un ou deux
Anuncio

CAHIER N° 1 CATÉGORISATIONS DANS LE LANGAGE Langage et Travail – UFR de Linguistique – Université Paris 7 – Tour Centrale – 9ème Etage 2 place Jussieu – Paris Cedex 05 Tél. : 01 44 27 56 84 – Fax : 01 44 27 79 19 SOMMAIRE EXPOSE I Activité de catégorisation sociale dans la parole ordinaire Josiane BOUTET REACTIONS Bernard GARDIN Jacques GIRIN Jacques THEUREAU EXPOSE II Catégorisations professionnelles et classements sociaux Bernard CONEIN REACTIONS Patrick PHARO Michel de FORNEL INTRODUCTION Michèle LACOSTE Cette séance de travail est cette fois-ci consacrée aux questions de la catégorisation dans la parole quotidienne, avec deux demi-journées, organisées autour de textes, comme on a déjà rôdé la formule. Nous trouvons qu'elle permet des discussions assez riches, organisées à partir d'un texte qui circule plus ou moins bien, je dois le dire, ou dont certaines versions circulent. Des réactants sont plus spécialement chargés de donner leurs réactions sur ce texte, ce qui permet d'ouvrir une discussion plus large à tous ceux qui sont ici. Ce matin c'est autour d'un exposé de Josiane Boutet, "Activité de catégorisation sociale dans la parole ordinaire". Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont eu accès à sa thèse – en petit nombre comme toutes les thèses – et, d'autre part aussi, peut-être à un texte beaucoup plus bref qui a en partie circulé et qui était une communication aux journées de Sociologie du Travail de Toulouse en mai 1990. Les interventions seront celles de Bernard Gardin, Jacques Girin et Jacques Theureau. Activité de catégorisation sociale dans la parole ordinaire Josiane Boutet UFR Linguistique, Université Paris 7 GDR-CNRS Langage et Travail. Quand on parle de catégorisation en ethnologie ou en psycho-sociologie, par exemple, on fait souvent référence à des systèmes de classement ; soit les systèmes de classement des experts, soit les systèmes de classement des indigènes ou des autochtones qui prennent souvent la forme de taxinomies de désignations. On va travailler mettons en ethno-botanique sur les systèmes de classifications des plantes dans telle ou telle civilisation ou tel ou tel groupe social, ce qui amène généralement à établir des listes de classement-désignations ; comment avec un seul nom on désigne cinquante plantes qui, ailleurs, seraient désignées avec plus de noms. Il s'agit là d'un aspect important de l'activité ordinaire de catégorisation, entendue dans ses rapports avec la dénomination ou le lexique des langues considérées. Il est indéniable que la désignation ou la dénomination renvoient en effet à des opérations de catégorisation du monde, du monde perceptuel ou du monde extra-linguistique. Cependant, dans la mesure où je suis ni ethnologue, ni psychologue, ni sociologue, encore moins cognitiviste, je voudrais essayer de montrer qu'il peut y avoir une autre entrée possible dans les phénomènes de catégorisation. Celle-ci se caractérise par trois traits. D'une part on tentera d'observer ou de reconstruire l'activité de catégorisation dans les verbalisations effectives. Ceci ne signifie pas une négation des processus sous-jacents. On ne parle pas sans qu'il y ait des processus mentaux en œuvre, mais, en tant que spécialiste de linguistique, je n'ai pas les procédures ou les dispositifs méthodologiques pour les mettre en évidence. D'autre part, ce que je voudrais soumettre à l'analyse dans les productions langagières, ce n'est pas seulement le lexique, les mots, mais ce qu'on appeler soit l'énonciation des mots soit, comme dit Frédéric François, "la mise en mots" : comment, avec des mots, les gens, les locuteurs ordinaires se débrouillent pour les agencer, pour les mettre ensemble et faire en sorte que ce travail de syntagmatisation des mots fonctionne aussi comme l'un des procédés de catégorisation du monde. Enfin, dernier trait, c'est l'interaction qui m'intéresse ; autrement dit la mise en mots en situation. Avant de donner des exemples de catégorisation sociale dans le langage ou dans la parole, je présenterai deux points de vue théoriques. Premier point de vue théorique : l'approche socio- linguistique classique, si j'ose dire, de la catégorisation ; second point de vue, celui de A. Culioli sur la notion de domaine notionnel et de notion. 1. L'approche sociolinguistique de la catégorisation Il est devenu relativement courant, après les travaux des sociolinguistes, en particulier des variationnistes, de dire que le langage est classant. C'est une espèce de stéréotype dans nos travaux. Dans l'approche sociolinguistique classique, interactionniste par exemple, on va dire que dans l'interaction verbale on catégorise en permanence par exemple autrui, l'interlocuteur ; et l'inverse, l'interlocuteur catégorise la personne présente, le locuteur, à partir d'un certain nombre d'indices linguistiques, ce que Ducrot appelle dans un vocabulaire plus moderne, les instructions pour l'interprétation. On parle aussi d'indices, de marqueurs, voire de stéréotypes. Lorsqu'on parle, on envoie en effet à autrui, outre un référent – ce dont je parle – un certain nombre d'indicateurs sur l'âge, sur le sexe (à supposer que vous ne voyez rien de l'interlocuteur, comme au téléphone), sur l'humeur, sur l'appartenance sociale, l'appartenance ethnique. Ces marqueurs socio-linguistiques constituent des éléments du langage qui vont servir à l'interlocuteur à classer. Je prends un exemple qui est celui de Gumperz. Il montre comment dans la communication inter groupe social ou inter-culturelle on peut être amené à n'absolument pas comprendre certains stéréotypes ou certains usages linguistiques qui ont un sens particulier dans la culture du locuteur et qui ont un sens éventuellement totalement autre dans la culture de l'interlocuteur ; d'où les malentendus, les agressions verbales dans la communication urbaine. Il parle là des « indices de contextualisation ». On y reviendra. Toutes les langues font un usage de ce que nous, les sociolinguistes, nous appelons la variation. Le parler, enfin la façon de parler n'est jamais uniforme. Il y a toujours de la variation liée à l'âge, liée au groupe social, liée à la région d'origine, liée à la situation d’énonciation, liée au sexe. C'est ce que P. Wald, dans un article de notre ouvrage collectif, "France, pays multilingue", soulignait en parlant « d’activité de catégorisation et d'attributs catégoriels ». Il montrait comment dans les différentes cultures et dans les différentes langues, les cultures, les groupes, les ethnies s'emparent de traits linguistiques qui a priori sont absolument neutres et non contraints par les variations sociales ; ils s'en emparent pour en faire des marqueurs identitaires ou des marqueurs ethniques. Prenons des traits comme la prononciation : le "r" roulé en France. C'est un son qui est conventionnellement associé à des traits sociaux comme la ruralité, le terroir. Si je prononce : "alorrs, le parrrler n'est pas uniforrme", vous allez penser "centrre de la Frrance", vous allez penser terroir, etc. Si je fais la même chose en italien, vous ne penserez rien du tout parce que le "r" roulé est standard. On ne peut pas faire autrement. Si je prononce le "r » italien autrement, vous penseriez : "elle est bizarre, celle-là, elle ne sait pas parler l'italien". Donc un trait comme le fait de rouler le "r", en soi ce n'est rien. En France il se trouve, pour des raisons historiques, qu'il est lié à la ruralité. Voilà un trait stéréotypique. Mais si on change de pays, le même trait linguistique n'a plus la même signification sociale ; les attributs catégoriels qui lui sont associés seront différents. Ce type de raisonnement constitue l'un des acquis de base de la sociolinguistique. D'un côté il y a la langue qui est arbitraire, donnée de l'extérieur, mais de l'autre, les groupes sociaux, les cultures, les ethnies vont prendre certains de ces traits (pour des raisons complexes et qui ne sont pas de notre ressort ici) pour en faire des marqueurs identitaires ou des attributs catégoriels. C'est dans ce sens que je reprendrai la perspective de J.J. Gumperz (en particulier "Language and social identity" 1982, Cambridge University Press, dont un article a été traduit dans "Engager la conversation", Minuit, et d'autres dans "Sociolinguistique interactionnelle", 1989, L'Harmattan). Gumperz montre comment la communication urbaine, la communication dans les mégapoles, se caractérise par le fait qu'il y a des multitudes d'occasions et de rencontres inter-ethniques, inter-groupe sociaux, contrairement à la communication dans des groupes de moindre échange à la fois langagiers et sociaux, où la communication est plutôt intra-groupe social et intra-ethnie. De ce fait, les occasions de malentendus linguistiques ou de non-repérage de la signification des signes linguistiques émis se trouvent multipliés. Prenons un exemple qui arrive tous les jours dans la vie courante. Vous demandez quelque chose à quelqu'un dans la rue ou dans un commerce et il vous répond : "eh bien t'as qu'à monter" ou "eh bien tu dois mettre un timbre dessus". La personne qui répond de la sorte par le tutoiement à un inconnu est vraisemblablement arabophone. Si son interlocuteur ne sait pas que ça va de soi dans ce type de culture socio-linguistique de répondre en "tu" à un inconnu, il peut être surpris, voire choqué. Il peut y avoir des réactions d'agression, des problèmes dans les relations de travail. C'est l'exemple des contrôleurs de bus londoniens analysé par Gumperz (1982). Il y avait des problèmes graves dans la gestion des bus londoniens, qui étaient dus au fait que les contrôleurs de bus antillais, lorsqu'ils s'adressaient aux passagers, avaient des schémas prosodiques particuliers ; en particulier lorsqu'ils demandaient "exact change, please". Leur comportement verbal était interprété par les londoniens comme agressif. Leur schéma prosodique signifiait la politesse et la courtoisie dans les usages culturels des Antillais, mais prenait le sens de la rudesse et de l'impolitesse pour un londonien. Pour terminer sur ce point, on peut dire qu'il y a dans les langues des zones de marqueurs identitaires comme par exemple la prosodie, les expressions stéréotypées, le lexique bien entendu (certaines désignations lexicales nous font repérer et classer par autrui) qui font qu'il y a du classement social à l'œuvre en permanence dans la langue. La question qu'on peut alors se poser est : est-ce que ce sont les seuls niveaux ? Est-ce que la prosodie, le lexique, les expressions stéréotypées sont les seuls lieux d'observation pour le linguiste des phénomènes de classement et de catégorisation sociale dans et par le langage ? La réponse que je souhaite argumenter dans ce qui suit est que non et qu'il y a d'autres observables possibles pour un linguiste des phénomènes de catégorisation dans la langue. On peut aussi, me semble-t-il, examiner comment du lexique, des occurrences lexicales sont manipulées, retravaillées par les locuteurs dans la mise en mots, dans l'énonciation, dans les organisations syntaxiques mêmes. On a vu que les dénominations dans les langues fonctionnent comme une pré-catégorisation qui est imposée de l'extérieur et donnée comme arbitraire aux sujets. Cependant l'activité langagière ne consiste pas seulement, on le sait, en l'expression de désignations. L'activité langagière c'est aussi et de façon conjointe la mise en relation entre ces mots et l'énonciation de chaînes discursives. L'hypothèse que je défendrai dans ces lignes c'est qu'une des formes de l'activité de catégorisation dans la parole se joue précisément dans cette mise en mots, dans cette énonciation de la langue. Pour le dire autrement, la modulation syntaxique, ce jeu complexe entre le lexique et la syntaxe, permet aux sujets d'effectuer tout un travail sémiotique sur le lexique, considéré comme un pré-encodage du monde naturel et social. Cette activité sur les désignations conventionnelles peut avoir différentes issues langagières. Elle peut aboutir à une re-catégorisation effective et à une création lexicale. Ainsi tout un travail linguistique et social a abouti à ce que des expressions catégorielles comme "femme de ménage" ou "manœuvre" soient remplacées par "employée de maison" et "O.S.". Ce type d'activité se caractérise par l'opposition entre deux termes ou deux expressions, l'un visant à remplacer ou à concurrencer l'autre jugé moins adéquat ou trop brutal. Ceci renvoie à l'une des propriétés du lexique : son organisation selon un ensemble de traits distinctifs ou oppositifs, binaires. Quelqu'un sera dénommé et catégorisé comme "ouvrier" ou "artisan", "femelle" ou "mâle" ; quelque chose est "un volatile" ou "un reptile"… Cependant l'organisation sémantique d'une langue ne se réduit pas à des ensembles de traits. On peut dire, et plus encore on dit couramment que quelqu'un "n'est plus tout à fait ouvrier mais pas non plus vraiment un artisan" ; le "poulet" est certes catégorisable comme un volatile, mais en même temps il n'est pas "autant volatile" qu'une mésange. Même la catégorisation apparemment très nette de "mâle/femelle" pose question dès qu'on a affaire, par exemple, à des bébés ou à des adolescents. Et on peut alors entendre des énoncés où la catégorisation conventionnelle est interrogée par les locuteurs : "pour une fille, elle a une drôle d'allure". Autrement dit les créations lexicales ne constituent pas l'unique issue linguistique possible au travail sur les catégorisations. Les catégorisations du monde social et naturel que proposent les dénominations peuvent être travaillées, remises en question par les locuteurs au moyen de la mise en mots, des agencements syntaxiques. Activité de catégorisation et domaine notionnel Je vais me référer dans ce qui suit à un texte de 1981 de A. Culioli, "Sur le concept de notion" (Bulag, Université de Franche-Comté, à Besançon). En premier lieu, disons qu'en accord avec les cognitivistes, Culioli pose l'existence de propriétés physico-culturelles qui, à l'évidence, préexistent aux langues et qu'on va retrouver comme des espèces de primitives, ou de relations primitives dans les langues. Par exemple la quantité. Il n'y a pas de langue qui, d'une façon ou d'une autre, ne s'empare pas de la quantité pour dire qu'il y a du plus, du moins, du dénombrable. Il y a ainsi des primitives, qu'on peut dire être des primitives de pré-catégorisation du monde physico-culturel. Le genre, ce n'est pas une primitive parce que, par contre, il y a des langues qui ne retiennent pas cette propriété, qui n'ont pas d'opposition selon le genre (comme en hongrois), ou des oppositions plus complexes, qu'on appelle précisement des langues à classes ou classificatoires. On peut dire qu'il y a des propriétés physico-culturelles du monde qui sont de toute façon saisies par l'ensemble des langues du monde et qu’elles en font quelque chose. Ce "quelque chose" est variable et ça ne nous intéresse pas directement ici. La "notion" dans le dispositif théorique de Culioli renvoie à des objets du monde non encore différenciés du point de vue de leur existence comme objets linguistiques : aussi bien des objets que des évènements, car à ce niveau-là on ne distingue pas les deux. En ce sens des objets linguistiques respectivement nominaux et verbaux comme "travail et travailler" renvoient à une même notion ou appartiennent à un même domaine notionnel. A ce niveau de représentation abstraite, les notions constituent des objets préalables aux opérations d'assertion, de détermination ; elles ne sont repérées ni spatialement ni temporellement. Parler en termes de notion – et c'est ce qui m'intéresse dans ce que dit Culioli – implique qu'on ne travaille pas seulement avec des propriétés ou des traits binaires. Dans cette conception, on ne passe pas seulement "d'ouvrier à non-ouvrier". Bien entendu on reconnaît l'existence nécessaire d'un complémentaire de la notion, c'est-à-dire que la notion "p" est vraie jusqu'à ce qu'elle soit fausse, jusqu'à ce que se délimite un "non P". Il y a de l'ouvrier jusqu'à ce qu'il y ait du non-ouvrier, du non P. Donc il y a un complémentaire de la notion. Mais l'intérêt de la notion de notion chez Culioli, c'est qu'entre P et non P, il y a de l'espace, le domaine notionnel. Il y a des possibilités d'énoncer beaucoup de choses entre "ouvrier et non-ouvrier". Donc ce n'est pas une sémantique d'oppositions binaires, en termes de "cassable/non cassable". Le domaine de la notion peut-être représenté comme un espace entre P et non P, avec des frontières le délimitant, espace à l'intérieur duquel on peut travailler. Pour reprendre notre exemple sur les désignations de métier, le travail sur la notion peut envisager les bornes de celle-ci, "ce n'est pas encore un ouvrier, pas tout à fait, pas vraiment". Mais on peut aussi se placer au cœur ou au centre du domaine de la notion, et énoncer de quelqu'un qu'il en constitue un représentant typique ou proto-typique : "lui c'est vraiment un ouvrier", … Ce type d'énoncés et ce type d'éléments linguistiques –"c'est tout à fait, c'est vraiment, c'est exactement, c'est parfaitement, c'est un ouvrier typique" – nous place au cœur de l'espace notionnel, c'est-à-dire qu'on est au plus près de ce qui serait le cœur des propriétés "d'être ouvrier". Mais on peut aussi examiner les bornes de la notion comme dans : "il n'est pas tout à fait, il n'est plus vraiment", "il n'est pas tout à fait ouvrier, c'est presque un artisan". Dans le domaine notionnel d'ouvrier, on peut dire : "il n'est plus tout à fait un ouvrier", sans dire pour autant d'ailleurs qu'il n'est plus ouvrier, mais on peut dire aussi : "c'est presque déjà un artisan". D'une autre façon, F. François parle de ces phénomènes quand il parle de l'importance des conduites d'approximation dans la construction de la référence, en particulier chez les jeunes enfants. Par un autre chemin, il arrive à l'idée qu'on ne peut pas seulement travailler avec une organisation binaire du lexique. On ne peut pas travailler avec : "une chèvre, c'est de l'animé non humain", parce que justement dans l'acquisition on va voir se fabriquer des constructions où à un moment la chèvre c'est de l'animé-humain, par exemple. C'est-à-dire que les propriétés des objets, enfin les propriétés d'objets, en particulier dans l'acquisition ne sont pas des propriétés essentialistes. Ce sont des propriétés qui peuvent évoluer, qui peuvent se feuilleter en quelque sorte. La créativité de l'activité des locuteurs sur la catégorisation se joue aussi dans cette modulation syntaxique, dans ce jeu sur l'espace de la notion ; entre le "presque", le "vraiment" et le "pas tout à fait". En conséquence il me semble que si on veut traiter des catégorisations qui sont effectivement à l'œuvre dans la parole, de cette activité permanente des locuteurs sur les désignations conventionnelles, on est amené à chercher à avoir des modèles du sémantique qui ne soient pas seulement organisés selon des oppositions binaires, ou des traits oppositifs. Par ailleurs, deuxième conséquence, on doit souligner l’intrication dans l’analyse, du lexique et de la syntaxe. Si on accepte ce type de modèle ou de système de représentation du sémantique, alors le sémantique n’est ni dans le lexique ni dans la syntaxe, il est dans une intrication entre les relations syntaxiques et les propriétés lexicales. Là, on retrouve aussi ce que par un autre chemin le logicien J.B. Grize a été amené à avancer (voir par exemple l’ouvrage collectif "Les salariés, face aux nouvelles technologies", Editions du CNRS) sur la construction des objets du discours. On aurait ainsi trois voies possibles dans une réflexion sur la catégorisation dans la parole : celle de F. François centrée sur les conduites d'approximation dans la mise en mots ; celle de A. Culioli avec la notion de notion, et la voie de J.B. Grize sur la construction des objets dans le discours. J'ai principalement évoqué la perspective ouverte par A. Culioli, mais ces trois auteurs convergent assez bien dans l'exploration du travail de catégorisation des locuteurs. Il resterait à en apporter la démonstration, ce que je ne ferai pas dans ces lignes (suit dans l’exposé oral la présentation de deux exemples de catégorisation dans la parole). REACTIONS Bernard GARDIN : Si je reprends un peu le travail que tu as fait avec Danièle Kergoat sur l'ensemble de cette enquête, il faut d'abord partir du départ, c'est-à-dire du questionnement, en posant que ce questionnement a d'abord été un questionnement identitaire. C'est sur le travail, mais on peut globalement l'appeler questionnement identitaire au sens où parmi les deux grandes questions que vous avez posées, il y a celle que tu n'as pas exposée ici sur la qualification, c'est-à-dire "qu'est-ce que vous avez comme qualification ?" On verra que ça renvoie à un discours sur l'identité. Maintenant, sur la forme même du questionnement. Tu as dit tout à l'heure que la forme des questions, la variation des questions, n'entraînait pas de variation dans les réponses. Je ne suis pas sûr que tu puisses le vérifier, que la vérification puisse être faite. Mais je ne peux pas t'entraîner là-dedans. Cela amène forcément les gens à se catégoriser d'une certaine manière, puisque nous avons une expression comme le "COMME-TRAVAIL", qui serait intéressante à travailler. Un des effets d'une enquête comme celle-là, c'est de questionner des évidences. Il y a des évidences pour les sujets. Eux savent évidemment où ils sont, ce qu'ils font et généralement ils ne produisent pas un grand discours làdessus. Ici, néanmoins, il faut qu'ils produisent un discours, c'est-à-dire que les locuteurs en question deviennent des locuteurs qui doivent se classer, s'auto-classer, tenir un discours sur eux-mêmes. Dans l'introduction que tu faisais au texte de Toulouse1, tu opposais effectivement – et ça anticipe un peu sur les chose de cet après-midi – en disant : "on peut, en première approximation distinguer un premier producteur savant et expert, que sont par exemple les sociologues, les ergonomes, les ingénieurs du bureau des méthodes, les responsables syndicaux et les producteurs qu'on peut appeler ordinaires, que sont les agents sociaux engagés dans l'action quotidienne, et en particulier dans les activités de travail". Tu as fait tout à l'heure une critique du binarisme, à laquelle je souscris tout à fait. Maintenant, est-ce que dans ce papier de Toulouse, en admettent cette classification entre ordinaires et savants, est-ce que tu ne reviens pas à assumer le binarisme ? 1 Texte présenté par Josiane Boutet aux IVème Journées de Sociologie du Travail, organisées par le PIRTTEM, à Toulouse, Mai 1991. Le binarisme pose bien sûr de gros problèmes. D'un point de vue proprement empirique, je me suis dit immédiatement : pourquoi les responsables syndicaux et les gens du bureau des méthodes sont classés du côté des savants et pas des ordinaires, et notamment les responsables syndicaux ? Ce classement binaire, j'y opposerai deux autres types de classement : un que tu connais bien et un qui est moins caractéristique. D'abord Pascal. Quand Blaise Pascal fait trois catégories : le peuple, les habiles en haut, et les semi-habiles du milieu, il montre que sur les questions métaphysiques d'une manière générale il y a un profond accord entre le peuple et les savants ou habiles ; et puis, par contre, il fait une critique très sauvage des demi-habiles, c'est-à-dire ceux qui veulent se prendre pour des intellectuels, ces catégories intermédiaires qui échappent au peuple et qui veulent penser par euxmêmes. Cette dialectique pascalienne réactionnaire, parce qu'elle est fondamentalement une critique de l'activité intellectuelle de ceux qui ne soient pas nés pour ça, qui n'appartiennent pas a priori à la catégorie. Et j'opposerai à cela la même catégorisation qui se trouve chez Volochinov au fond, la même organisation. Lorsqu'il fait son étage, son organisation en trois niveaux, c'est-à-dire qu niveau idéologique, les idéologies du quotidien, de la vie quotidienne ; les idéologies constituées en haut, et un niveau intermédiaires qu'il appelle donc les niveaux supérieurs de l'idéologie de quotidien, où justement on trouve ici des activités conceptuelles qui ne sont pas encore dans les systèmes et idéologies constituées, qui ne sont pas le fait d'agents complètement reconnus, mais d'agents peut-être intellectuels, donc pas toujours légitimes ou légitimés. Et il se situe à un niveau extrêmement intéressant où ils sont à la fois sous la pression de la vie quotidienne et de ses transformations, de ce qui se passe en bas et sous la pression de ce qui arrive du haut, c'est-à-dire des catégorisations du haut. Et il me semble que dans la situation où vous vous êtes trouvées, vous vous êtes trouvées dans cette situation-là justement, c'est-à-dire qu'en faisant produire des discours aux gens, eh bien ils ont eu à contester des classements du haut en quelque chose, et puis à faire apparaître des choses qu'ils vivaient, trouver ce niveau intermédiaire disons sous une double pression. Il y a ceux qui imposent légitimement un classement et ceux qui le reçoivent, et puis les activités de classement qui sont liées à un savoir ; ceux qui classent, mettons les sociologues ou des choses comme ça, et ceux qui utilisent les classements. Les locuteurs populaires, entre guillemets, classent aussi, ont des classements autochtones qui fonctionnent. Lorsque par exemple on désigne des gens par "les gros ou les riches ou les blouses" ou "ceux qui se lavent les mains avant d'aller aux toilettes" par opposition à "ceux qui se lavent après", on classe la société en deux morceaux. Ces classements sont donc non légitimes. Ici, dans la situation où vous vous êtes trouvées, il me semble que cette situation montre que peut-être il ne faut pas opposer en termes de catégories de locuteurs mais d'activités. Lorsque les sociologues utilisent des classements tout faits, il ne font qu'obéir à des systèmes de classements. Ils font un travail qu'on pourrait appeler, d'un point de vue marxiste, un travail abstrait dans ce domaine-là. Par contre, lorsqu'ils critiquent les modèles de classement, ils font un autre type de travail. C'est-à-dire qu’il ne s'agit pas exactement d'un classement de personnes, il me semble, entre des savants et des ordinaires, mais les savants sont parfois amenés à travailler comme des ordinaires, lorsqu'ils ne font qu'utiliser des choses et se soumettre à des théories. Et ceux qu'on appelle les ordinaires sont parfois amenés à avoir une activité savante, lorsqu'ils constatent, discutent, modifient les catégories. L'opposition serait plutôt à voir à chaque fois en termes de ce qui se passe au niveau des activités en question. Ici, je crois que tes locuteurs sont des intellectuels, parce qu'ils discourent et discutent sur leur travail. Je sais que ce que je dis est fortement orienté par la question concernant la qualification. Peut-être que je vais la résumer un petit peu. Dans l'enquête, lorsque la question a été posée aux ouvriers, ouvrières : "quelle est votre qualification ? Qu'est-ce que vous avez comme qualification ?", dans le cours de l'enquête des gens ont été amenés à tenir un gros des discours ramenables à deux propositions. Première proposition : "Je ne suis pas qualifié au sens de ma qualification n'est pas reconnue. Je n'ai pas la paye de… mais, en gros, j'ai la qualité. J'ai les attributs en quelque sorte de la classification". Et, seconde proposition : "je suis qualifié, mais cette qualification n'est pas reconnue". Le référent global est le même mais les formulations sont différentes. Là, je regrette que tu ne l'aies pas exposé un petit peu pour tout le monde. Tu as des choses très intéressantes sur la qualification en tant que propriété aliénable ou inaliénable. Je rappelle un peu la notion d'aliénable et d'inaliénable. Il y a une contrainte linguistique qui fait qu'on considère non normal, non correct le fait de dire : "j'ai mal à ma tête ou mon bras" ou des choses de ce genre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en gros, mon chapeau est aliénable, je peux le retirer et je peux dire que mon chapeau est joli mais, par contre, d'autres parties du corps sont considérées comme inaliénables. Ceci est d'ailleurs historiquement variable. Lorsque les greffes d'organes amènent sans doute des gens à tenir des discours sur : "mon cœur me fait mal, après tout si j'en changeais ?", ou des choses de ce genre. Là j'anticipe un petit peu, mais on sait bien que de toute façon chez les enfants il y a des corrections qui interviennent sous la forme : "il ne faut pas dire : j'ai mal à ma tête, mais j'ai mal à la tête". Cela signifie donc que ces catégories ne sont pas définies une fois pour toutes, l'aliénable et l'inaliénable. Concernant la qualification, cette question ici est extrêmement intéressante puisque, au fond, la qualification de quelqu'un en termes de savoir-faire, savoir qu'il a intégré, est l'objet d'une polémique sur son côté aliénable ou inaliénable. C'est-à-dire quelque chose qui tient à la personne, comme semblent le revendiquer les ouvriers ici, ou bien quelque chose que la direction peut leur attribuer ou leur retirer ? C'est elle qui, à ce moment-là, décide du fait qu'ils sont qualifiés ou pas qualifiés, selon un arbitraire ou des propriétés, des critères qui lui sont propres. A noter, de ce point de vue-là, qu'il y a ici une division sociale extrême importante parce que, comme on sait, être ministre, député, président, agrégé est une catégorie qui est inaliénable parce qu'il suffit de l'avoir été une fois pour l'être toute sa vie. Même si on n'est plus président ou ministre, on peut continuer à se faire appele Monsieur. le Président ou Monsieur le Ministre. Donc il s'agit là de choses qui ont été intégrées dans la personne et font partie de ses attributs, même lorsqu'elle n'occupe plus la fonction. Ce qui n'est pas vrai pour les ouvriers, en quelque sorte. Avec justement une exception intéressante, notamment ce qui se passe au Parti communiste, lorsque des élus communistes disent : "je suis tourneur ou je suis quelque chose comme". Ceci dit ils sont dans une contradiction intéressante puisqu'ils veulent poser comme titre quasiment une propriété qui correspond à un métier qu'ils n'exercent plus depuis longtemps puisqu'ils sont devenus en fait des intellectuels. Ils ont une autre activité, mais on pourrait dire qu'il y a là dans ce domaine un renversement en quelque sorte de la symbolique. Sur ces deux propositions maintenant, à savoir la première que tu analyses en termes de restrictions, c'est-à-dire : "on n'est pas qualifié", c'est-à-dire : "on n'a pas la qualification, mais néanmoins on a les qualités pour être, on a les attributs" ; et la seconde qui est la proposition de revendications, à savoir : "on est qualifié mais on n'a pas le titre". Je suis d'accord avec ton analyse. Je modifierais un petit peu les termes. Il me semble que, là, on a vraiment deux niveaux qui sont hiérarchiquement différents et qui occupent justement dans l'activité intellectuelle, dans la prise de conscience des places différentes. Je serais d'accord avec toi mais j'insisterais un petit peu. Le premier terme, c'est celui que tu appelles de la restriction. J'y verrais plutôt la demande de reconnaissance. Au fond, c'est une proposition qui dit : "reconnaissez nos mérites", et c'est ce qu'on pourrait appeler une demande, à savoir : "certes, nous n'avons pas le titre, mais nous avons les qualités". La seconde est une revendication, au sens où elle est la dénonciation d'une spoliation, c'est-à-dire en fait : "nous sommes qualifiés, mais vous nous enlevez ce qui doit aller avec le fait d'être qualifié". C'est la dénonciation d'une sorte de spoliation, de vol, et c'est en cela qu'elle est puissante. Dans la seconde, le point de vue du locuteur c'est de faire reconnaître une injustice et, du coup, de rétablir la justice. Dans la première, c'est de demander au fond que ces mérites soient reconnus, ce qui n'est pas effectivement la même chose dans la prise de conscience et l'activité revendicative qui est interne à cela, à ces questions de reconnaissance. Et notamment, dans la seconde, par le fait que dire : "nous sommes qualifiés mais cette qualification n'est pas reconnue", c'est poser comme faisant partie de la réalité le fait d'être qualifié. Pour conclure sur ce sujet-là, il me semble qu'on pourrait réinterpréter ce que tu fais ici en termes de sémiotique. Finalement, que font ces gens qui parlent ? Ici, sur la qualification, plus que sur autre chose, ce qu'ils dénoncent, c'est un mauvais usage de la langue, parce que dans le fonctionnement ordinaire de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent que ceux qui ont le signifiant "qualification ou qualifié" n'ont pas forcément le signifié, c'est-à-dire que le signifié consiste à savoir faire telle ou telle chose. A côté de cela, ceux qui ont un certain signifié, non pas le signifiant, c'est-àdire ceux qui ont les propriétés, qui devraient aller à la classification, ne sont pas appelés, ne sont pas désignés par le terme de "ouvrier qualifié". Le travail, il me semble, de revendication dans ces discours, c'est un travail de critique linguistique, de critique des discours qui sont non adéquats parce qu'ils ne mettent pas en rapport en quelque sorte de la bonne manière signifiant et signifié. C'est comme si la vie quotidienne de l'entreprise fonctionnait mal sur une mauvaise économie du signe. Ce qu'ils demandent, c'est de mettre en rapport effectivement, de faire un signe qui serait correct, mettant en rapport les bons signifiants et les bons signifiés. J'évoquerai une autre stratégie que l'on trouve aussi dans des discours, qui ne sont pas les tiens ici, mais qui concerne aussi les dénominations. Concernant le titre de O.S., au départ on peut penser que ce socionyme a été peut-être un peu valorisant, je ne sais pas. Mais enfin, de toute façon, il s'était dévalorisé au cours de l'histoire, si bien que pas mal d'entreprises avaient remplacé le terme O.S. par A.P., notamment chez Renault, agent de production, pour éviter toutes les connotations s'attachant à O.S. Au cours d'interviews que j'avais faites, et cela a été corroboré par d'autres enquêtes qui avaient été faites par d'autres, on constate que des gens ont accepté de s'appeler A.P. et ainsi de suite, mais d'autres ont continué à se revendiquer O.S. C'est-à-dire de ce point de vue-là de revendiquer une désignation dont ils savaient qu'elle était effectivement devenue péjorative, mais pour refuser l'opération qui consistait à changer le signifiant, alors que signifié et référent n'avaient pas changé. Juste une petite citation là-dessus. Dans l'interview que j'avais effectuée, je suis tombé sur un ouvrier qui me dit : "moi je dis que je suis O.S., il n'y a rien de changé dans ce domaine. La Régie a beau me dire : t'es P.l, P.2. T'es O.S. Tu pars de là. T'es O.S. Ca change de mot, mais le résultat reste quand même". C'est-à-dire un refus d'entrer dans une autre catégorisation, de manière à montrer en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler les stigmates du groupe, à montrer que la réalité n'avait pas changé. Je reviens à tes ouvriers. Il me semble qu'un terme, au niveau du métalangage qui est employé, que tu emploies, que j'emploie, c'est celui de polysémie. Tu as évoqué au début la variation sociolinguistique. La variation socio-linguistique, c'est ce que l'on constate lorsqu'on met côte à côte des objets qui présentent des différences, notamment le même mot mais, en gros, des sens différents. Mais ici, dans les corpus que tu analyses, il me semble qu'on arrive à un niveau supérieur de la polysémie, c'est le moment où des gens prennent conscience de cette polysémie, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent de quelque chose qu'il faut appeler, je crois, la contradiction. Il ne s'agit plus de mettre côte à côte, de constater de la variation. Ceux qui disent : "nous sommes qualifiés mais on n'a pas les avantages ou bien nous ne sommes pas qualifiés, alors qu'on en a les attributs", et tu cites Brecht ici. Je crois qu'il faut aller peut-être plus loin.Ce qu'ils font, c'est justement cette activité intellectuelle qui consiste à regarder la variation et à la constituer justement en contradiction. Et c'est là qu'il y a un autre niveau, c'est-à-dire qu'on ne passe pas seulement à la description des variétés, des usages, mais que l'on montre les oppositions qu'il y a entre ces usages et que, du coup, on prend conscience du phénomène, même si derrière cela il y le leurre d'une langue qui pourrait être unique et magnifique, dans laquelle il n'y aurait plus de contradictions. Ce qui m'a, non pas dans l'ensemble de ton travail, mais notamment le plus intéressé dans le papier que tu nous as envoyé, c'est en quoi l'activité critique est une activité langagière. Comment effectivement c'est sur les mots eux-mêmes, la prise de conscience de ces aspects de polysémie donc érigés en contradictions, en quoi cela est une activité de langage. Josiane BOUTET : Je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la fin, mais il y a un truc sur lequel je ne te suivrai pas. J'ai à chaque fois énormément pris garde de ne pas parler des intentions, des stratégies ou des buts ou tout ça. Je crois avoir soigneusement évité ce mot, faute de savoir ce que à peut bien vouloir dire, à moins d'en faire un modèle, mais sinon je ne vois pas. Quand tu dis par exemple : "la restriction, moi, Bernard Gardin, je l'ai interprétée comme une demande de reconnaissance", là je dois dire que tu fais une interprétation forte. J'ai dit restriction parce qu'il y a "mais". Ils disent : "on n'est pas qualifiés, mais on enfin quand même mon chef ne sait pas faire ça et moi je sais le faire, alors…". C'est parce qu'il y a "mais » que c'est une restriction. Je ne me suis autorisée à dire mouvement de restriction, que parce que tu avais "mais enfin, quoi que,. enfin quoi, mais enfin »… C'est au plan linguistique que je me suis autorisée à dire ça. Il me semble que tu fais un pas de plus et je ne suis pas sûre de pouvoir te suivre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de l'intentionnalité là-dedans. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Est-ce on peut y voir de l'intentionnalité, des choix, une activité réflexive ? Ce sont des phénomènes d'argumentation, "parce que bien, alors mais, enfin", ce sont des faits d'articulation de discours. Je n'ai pas le sentiment qu'on puisse… Si, on peut dire ce que tu dis, mais je pense que c'est de la sur-interprétation. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment raison. Je ne sais pas. En tout cas, je n'oserais pas. Bernard GARDIN : Tu as osé parce que tu as quand même appelé la seconde forme la « revendication ». Josiane BOUTET : "Par contre ça devrait être un boulot", à chaque fois qu'il y a le conditionnel, oui, je l'ai mis en tant que revendication. C'est le conditionnel qui projette dans du volitif, du « à venir ». Bernard GARDIN : Je suis d'accord que je ne peux pas parler de l'intentionnalité. Enfin ça ne suppose rien sur leur intentionnalité. Ce que je veux souligner, c'est effectivement dans le second cas quand on dit : "je suis qualifié". C'est-à-dire que je me catégorise comme qualifié, c'est-à-dire que je prends le terme et la restriction qui est faite, elle est à partir d'une qualification que je me reconnais – je me reconnais le terme -, mais cette qualification est grignotée par le fait qu'on ne me donne pas la paie. Alors que dans l'autre proposition c'est : "je ne suis pas qualifié", qui est le point de départ et le parcours notionnel va dans l'autre sens. Il y a deux sens tout à fait différents. L'un part de la qualification, l'autre est pour arriver à la qualification. (Débat sur la question de l'interprétation avec Françoise Madray et Pierre Achard). Josiane BOUTET : Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a deux univers catégoriels qui sont là-dedans et que la difficulté pour les gens c’est de se situer dans un univers catégoriel où on peut être O.S. tout en étant qualifié et qu’il n’y a pas de mot pour dire ça. S’il y avait des mots qui disaient : un O.S. qualifié s’appelle « X » , et un OP, mais non qualifié, s’appelle « Y » , ça irait. On dirait : "je suis X, ou Y". Mais il y a pas de mot, il n'y a pas de désignation. J'ai cherché et je n'ai rien trouvé là-dessus. Donc apparemment il n'y a pas de désignation. Du coup, il faut dire ça avec de la syntaxe, de l'approximation. On n'est "pas tout à fait, un peu, mais quand même"… Effectivement le seul énoncé qui exprimerait les choses brutalement, ce serait : "on n'est pas qualifié, mais on a des qualifications" et, ça, on ne l'a jamais. On a des approximations, des paraphrases pour arriver à dire cette chose, mais elle n'est pas dite, dans cet univers de référence-là. Jacques GIRIN : Je dirais que le premier sentiment que j’ai eu en lisant la thèse, c’est de me dire : c’est quand même génial d’avoir trouvé la bonne question, enfin des bonnes questions parce qu’il y en a plusieurs. D’avoir trouvé le fil qui consiste à dire : " je m'intéresse aux réponses à la question sur la qualification et sur ce que vous faites" ; et puis le deuxième fil qui consiste à prendre le bon niveau, c'est-à-dire de dire : "qu'est-ce qui es pertinent ? Est-ce que c'est le lexique ? Est-ce que c'est la phonologie ? Est-ce que c'est la syntaxe ? etc." Je crois que dans le travail de Josiane c'est assez extraordinaire de se dire qu'enfin, on découvre un niveau d'analyse linguistique qui permet effectivement de connecter ça à une préoccupation d'ordre sociologique mettons, au sens large. Donc, ça, c'est la première remarque sur le fond. Maintenant, je vais me limiter vraiment à une seule question, mais qu'il faut peut-être argumenter un tout petit peu. On voit bien (mais là je vais faire du dichotomique et du binaire et en reprenant des catégories que j'utilise un peu par ailleurs) qu'il y a, en termes de catégorisation, deux types de réponses. Je ne parle pas du tout en termes linguistiques, là, je me situe plutôt au niveau de l'interprétation. Deux types de réponses : il y a le fait de répondre par rapport à un schéma d'action, une activité, par rapport à ce qu'on fait dans le cadre d'un processus de production, par exemple, et puis il y a un type de réponse par rapport non plus au processus mais par rapport à l'ordre social disons, pour parler bref. C'est-à-dire, dans le deuxième cas, en gros : "je suis qualifié, j'ai telle position dans l'échelle de l'ordre social de l'entreprise", et peut-être même au-delà, et dans le premier type de réponse : "je fais cela et ceci à tel statut par rapport aux autres activités et au processus". Ma question est simple, c'est : quid du processus même de l'entretien ? C'est-à-dire du processus et de l'ordre social de l'entretien. Autrement dit, dans la thèse tu évoques beaucoup et bien je dirais la question posée par l'enquête, que tu résumes en reprenant Lévi-Strauss, à savoir que l'observateur fait partie de l'observation. D'un point de vue théorique, épistémologique ou méthodologique, je trouve que tu la poses très bien. En revanche, mais je pense que çà tient tout à fait au contexte universitaire, type de jury que tu avais, etc., tu n'évoques pas du tout la situation même dans laquelle les données ont été recueillies : qui interrogeait ? Quand ? Où ? On ne sait pas si c'est dans l'usine ou si c'est à domicile. A un certain moment on a l'impression que c'est à domicile parce qu'il y a madame qui intervient. Plus généralement, tout ceci peut être rapporté dans ma dichotomie, soit en termes d'ordre social, c'està-dire comment le locuteur enquêté tente de se positionner par rapport à l'enquêteur, et donc qui est cet enquêteur ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un noir ou un blanc et comment il cause ? Deuxièmement, comment l'enquête tente de se positionner par rapport à ce qui doit être le schéma d'action de l'enquête elle-même. Autrement dit, est-ce que ses réponses n'auraient pas un sens par rapport à ce qu'au moins lui pense devoir être l'aboutissement de l'enquête ? Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je le dis. Mais je pense que tous ceux qui ont fait un peu de terrain connaissent ce problème. C'est que les enquêtés supputent la signification, enfin attribuent une signification à une enquête. Ils se disent que, par exemple, çà va déboucher sur des restructurations, des changements de qualification, que le patron va en tirer parti, et que si ce n'est pas le patron ce sera quelqu'un d'autre. Donc je veux dire qu'une enquête c'est évidemment un processus auquel on attribue une signification. Ce que j'aurais aimé, je ne pense pas que tu veuilles répondre, mais j'aurais aimé que tu répondes un peu quand même, c'est que tue nous décrives un peu plus ce processus lui-même, comment vous avez procédé, comment vous avez tenté de vous positionner par rapport aux enquêtés et comment vous avez tenté ou pas tenté de contrôler les interprétations qui pouvaient être données de la signification même du processus d'enquête. C'est mon unique question. Je voudrais terminer par une remarque. Dans les matériaux qu'on recueille à EDF en ce moment, qui sont issus non d'une enquête mais de situations d'interaction "naturelle", avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, et bien qu'on soit là avec nos vidéos, on observe effectivement des phénomènes de catégorisation je dirais spontanés et non élicités ou non provoqués par l'enquête elle-même, et qui sont orientés dans plusieurs directions. Pour reprendre mon schéma simple, quand un client d'EDF dit :"je suis célibataire" – il se catégorise comme célibataire -, c'est un argument à l'appui du processus qui doit conduire à dire quelle puissance on va donner à son compteur. Il ajoute qu'il y a une teinturerie en bas -, donc il ne va pas acheter une machine à laver et donc on peut rester à une puissance faible, etc. Je veux dire que c'est la catégorisation qui a une signification par rapport au processus de l'interaction. Quand un autre dit : "je suis étranger" ou "je suis Espagnol, Portugais", etc., ça peut être éventuellement pour se positionner par rapport à l'interaction elle-même, pour dire : "je ne comprends pas bien, mais ce n'est pas parce qui je suis analphabète. C'est parce que je suis étranger. Donc ne me prenez pas pour un idiot, mais essayez de me parler clairement". Dans le type d'analyse que tu développes, je crois que tu as tout à fait raison de dire : "les sociologues ne pouvaient pas voir ça", et c'est vrai que les sociologues, parmi lesquels je me mets, disons grossièrement, ont l'habitude de négliger ce niveau-là, d'aller directement à une interprétation, sans voir que ce que tu appelles la matérialité de la langue, c'est-à-dire le fait que dire ça de telle manière au lieu de le dire de telle autre, ce n'est pas la même chose. Je pense que d'essayer d'appliquer ce type d'outil à ce que tu évoques au début de la thèse sur la situation d'observation, ça serait un progrès fantastique, par rapport à ce que raconte précisément Levi-Strauss sur la place de l'observateur dans l'observation. Ce serait probablement un outil pour mieux cerner ce que se passe dans la situation même de l'enquête. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé. Josiane BOUTET : Le point de méthode que tu soulèves et qui est réel, c'est que les façons de parler ou même le référent ou les catégorisations qu'on va mettre en œuvre, sont dépendantes des situations. La seule réponse que j'aurais envie de te faire c'est qu'il se trouve que là la façon dont on a travaillé a fait qu'il y avait un invariant qui était précisément la situation. On a traité la situation comme un invariant. On peut faire parfaitement des enquêtes socio-linguistiques où la situation soit une variable. Ca a été fait aux Etats-Unis où tu prends une même personne, tu lui mets un micro-cravate et il s'enregistre dans toutes les situations de sa vie quotidienne et professionnelle. C'est à partir de ce genre de choses qu'ils ont mis en évidence la variation stylistique. On voit effectivement à la fois la façon de parler, la façon de se catégoriser, de se présenter, le rapport à ta face et tout ça, comme ils disent, se modifie selon les situations sociales dans lesquelles on est. Peut-être que moi ça m'aurait intéressée, mais en tout cas pas les sociologues avec lesquels je travaillais. Ils avaient un intérêt à un certain terrain, une certaine manière de construire et d'ouvrir le terrain, une certaine façon de faire qui était extrêmement propre, très méthodique. C'était hors de leur problématique de se dire : "que diraient les mêmes gens si on les saisissait ailleurs et autrement ?" Il n'empêche que la situation était grosso modo invariante, parce que c'était toujours dans une situation d'entretien. On n'a pas donné le bain aux enfants de nos enquêtés pour voir ce qui se passait quand ils causaient avec leurs enfants dans le bain. On n'a pas modifié la situation parce que le but n'était pas de mettre en évidence les différentes façons de parler ou les différentes façon de se catégoriser ou de catégoriser autrui par les même personnes. (Débat sur la nécessité de parler du terrain, de l'enquête, des enquêteurs ; le type de collaboration avec les sociologues, les méthodes d'enquête avec Françoise Madray, Michele Lacoste). Elisabeth BAUTIER : Sans même se poser la question de savoir si ce sont les représentations que les enquêtés se font de l'enquêteur, qui sont déterminantes, est-ce que ce qu'on a obtenu dans ce genre de situation, c'est une catégorisation qui serait de l'ordre du socio-cognitif, qui serait une manière de penser le monde ? Estce que c'est quelque chose qui serait beaucoup plus conjoncturel ? Josiane BOUTET : Ce qui m'intéresse, c'est la variation à l'intérieur d'une population a priori dans les mêmes conditions. Donc bien entendu que si on change les conditions, tout le monde va changer. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien qu'on soit dans une même situation, on est dans un certain type d'interaction qui a des caractéristiques depuis longtemps analysées par les sociologues, les psychosociologues. Ce n'est pas comme une interaction conversationnelle et encore moins comme un cours magistral. Mais avec ces caractéristiques-là, tous les gens sont dans la même situation. La situation de Jacques est une situation d'interaction qui a ses caractéristiques. Ce qui est en question, c'est qu'il y ait de la variation là-dedans. Elisabeth BAUTIER : Je suis dans la même situation de recueil, et en plus j'avais toujours le même intervieweur-enquêteur. Mais j'ai l'impression que ce qui varie, c'est la manière dont l'enquêté vit la situation. C'est très psychologique, mais c'est non négligeable quant aux conclusions qu'ont peut en tirer. Des gens ne font pas la même chose dans la même situation, y compris dans leur manière de se catégoriser. J'observe les mêmes variations, elles m'intéressent, mais je me demandais si tu pouvais nous éclairer sur les conclusions qu'on peut tirer de ces variations. Elles ne sont pas seulement en termes d'O.P., d'O.S., hommes et femmes… Quelle catégorisation des enquêtés pourrait-on essayer d'affiner pour savoir ? Michel de FORNEL : C'est une question intéressante à l'évidence de se demander en quoi le processus d'entretien peut avoir une influence. Mais je trouve que, par ailleurs, c'est un faux procès qui est fait à Josiane. La question n'est pas exactement celle-là, parce que sur cette question il y a énormément de littérature. La sociolinguistique s'est constituée justement en faisant varier les situations et en étudiant les variations que ça pouvait entraîner. Mais la question n'est jamais là d'un point de vue conceptuel. La question c'est : est-ce que le fait de faire varier des situations va nous apporter quelque chose par rapport au problème théorique précis qu'on est en train de traiter. Et la question se pose bien de savoir si, quand on étudie les phénomènes de catégorisation, une étude des différentes situations dans lesquelles l'interviewé peut être amené à s'auto-catégoriser ou à catégoriser les autres, peut apporter quelque chose ? Est-ce qu'on a un argument pour dire que ça peut apporter quelque chose sur la façon de traiter la catégorisation ? Tant qu'on n'a pas d'arguments, on n'a rien dit. Je prends la situation d'un ouvrier devant un technicien de l'EDF qui ne dirait plus : "je suis soudeur, câbleur, soudeuse", il dirait : "je suis ouvrier", par exemple. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur la catégorisation ? Peut-être. Mais, là, il faut avoir des propositions théoriques. Or, Josiane s'est intéressée à un type de situation, elle a fait des propositions théoriques et je trouve que c'est celles-là qu'on doit discuter. Elle a proposé un certain nombre de choses sur la catégorisation dans ce type de situation. Jacques THEUREAU : Je n'ai pas le luxe de pouvoir dire :"grossièrement je suis sociologue", parce qu'il y a là une catégorie avec laquelle tu dialogues directement. Je ne suis pas ça non plus. De quel point de vue je peux me placer ? De quelqu'un qui s'intéresse à l'activité en situation, donc en situation en particulier de travail. L'activité étant à la fois d'action, de communication, d'interprétation. Je cherche aussi à pouvoir décrire et expliquer suffisamment cette activité pour produire des aménagements ergonomiques des situations en question. Mon problème c'est de décrire, expliquer suffisamment cette activité, ses aspects intrinsèques et extrinsèques, de savoir dans la situation la culture générale des acteurs. Dans cette activité, il y a une part importante de l'activité langagière. Ça communique, ça interprète beaucoup, si on veut savoir quelque chose des interprétations, on fait appel à des verbalisations. Si j'ai un linguiste sous la main pour m'aider à traiter ça, c'est bien. Sinon, je suis obligé de faire l'autodidacte en linguistique, ou bien de laisser la chose reposer. Je me trouve toujours dans la position – dont parlait Gardin à propos de Pascal - des gens qui sont les semi habiles. Face à ce problème de l'activité, on est vite semi habiles par exemple, en cognition, en linguistique, etc. La question est : en quoi ce que nous dit Josiane est utile à l'analyse de l'activité ? Deuxièmement, a quelle condition cet apport n'est pas simplement un emprunt sauvage de ma part, dans un malentendu total. C'est sur la place des systèmes de connaissance et de la situation dans l'analyse, ce que Josiane dans sa thèse appelle la construction sociale du sens que je voudrais insister. Qu'est-ce que c'est cette construction sociale du sens ? Si je le prenais en tant qu'activité, pas en tant que produit, mais en tant qu'activité cette construction sociale, la question pour moi est : est-ce qu'il est suffisant de considérer le système de connaissances et la situation ? C'est toutes ces questions que Josiane dans sa thèse baptise "source du sens, ancrage du sens, support du sens, lieu d'élaboration du sens". Ce que Josiane baptise "matérialité du langage", effectivement si on s'intéresse à l'activité, eh bien là on est obligé de s'intéresser à cette matérialité du langage. Source, ancrage, élaboration, support, très bien, mais pas que seulement. Il me semble que si on pense toujours en termes d'activité, de production sociale de sens, et bien ce n'est pas que cela. Il faut relier cela intrinsèquement dans l'analyse même, à la fois de ce qui est et des actions qui sont faites avec. Intrinsèquement y a-t-il vraiment une place pour des notions qui correspondent à cette question de système de connaissances, qui classe tout ça. C'est la question que je me pose. Je peux retrouver dans la thèse de Josiane plein de points où il me semble qu'il y a une gêne sur cette question-là. Où par exemple elle s'appuie sur Bakhtine pour faire cette différence que fait Bakhtine entre signification et thème je ne le vois plus bien après. C'est vrai que Bakhtine n'offre rien pour s'intéresser à cette affaire-là. Le thème à voir avec la contextualisation. Mais ces aspects de système de connaissances et de situation sont finalement essentiellement extrinsèques, en tout cas dans la dynamique des analyses qu'elle produit. Cela m'apporte quelque chose à condition de le joindre à autre chose, à d'autres sources du sens. Question : est-ce qu'il ne faudrait pas le faire d'emblée ? Cela pose des problèmes d'épistémologie ; la fameuse question de l'interdisciplinarité. Oui, il y a des disciplines, mais il faut les réinsérer dans ce lieu dont parle Pascal, celui où les gens pensent par eux-mêmes, c'est-à-dire fabriquer des programmes qui, éventuellement, ne sont ni linguistiques, ni sociologiques, ni ergonomiques, ni cognitifs, ni rien de tout, des programmes définis avec des hypothèses, des notions, une heuristique pour mouliner tout ça, etc. Michel de FORNEL : Je me recentre sur le problème des catégorisations. Disons que la thèse qui est proposé de façon générale, telle que du moins je l'ai comprise, me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une intrication entre lexique et syntaxe, au sens où visiblement, dans ces phénomènes de catégorisation, le fait d'utiliser ou non un équivalent lexical ou une possibilité d'utiliser ou non un équivalent lexical ou une possibilité d'utiliser un type de construction, etc., est important et l'absence entraîne des formulations verbales. Disons qu'il y a en ce sens-là, pas au niveau théorique, une intrication entre lexique/syntaxe et c'est vrai que c'est très intéressant à étudier dans les entretiens puisqu'on peut voir une émergence et effectivement une forme de créativité. En ce sens là, je suis assez d'accord avec l'analyse générale qui est proposée, enfin sur cet aspect-là. Par contre, là où j'aurais des questions c'est sur les conséquences théoriques en retour, parce qu'il faut que ça fasse avancer quelques concepts que l'on a, de les manipuler pour les faire avancer. Le premier c'est évidemment l'idée énoncée d'entrée de jeu, qu'il y a un domaine notionnel et qu'il faut plutôt penser en termes de continuité et de discontinuité. On sait déjà qu'il existe des domaines notionnels où on a tous les éléments pour penser qu'il y a du continu. Il y a aussi des domaines contestés, comme le domaine temporel. On peut proposer une logique des intervalles ou alors une logique discrète. Donc il y a des lieux problématiques et puis il y a des lieux où on a des phénomènes de masse et qu'il vaut mieux avoir par exemple une sémantique qu'éventuellement on a des arguments pour dire qu'on est plutôt dans le domaine notionnel ? Je crois que, ça, c'est une question empirique. C'est une question extrêmement précise. Là-dessus, je n'ai pas vu où étaient les arguments. Dans la littérature il est montré depuis quelque temps qu'on retrouve ce phénomène avec les prototypes. On peut avoir des effets de continu avec par ailleurs un modèle lexical, qui est un modèle discret. Je n'ai pas vu là d'argument pour véritablement justifier le fait qu'on aurait un domaine notionnel continu. Pierre FIALA : Il y a des points qui ne sont pas réglés dans le modèle linguistique, et en particulier cette espèce de rapport dichotomique que tu présentes entre lexique et syntaxe. Il n'est pas sûr dans l'état actuel de travail en linguistique qu'il se présente exactement dans les mêmes termes. Est-ce que le lexique s'instancie dans les schémas syntaxiques sur lequel on ajouterait des modulations syntaxiques, voire en termes de modulations de type sémantique avec les catégories aristotéliciennes qui viennent supporter tout ça ? Ce n'est pas absolument certain qu'on ne puisse pas avoir des modèles peut-être plus simples, discrets sur le plan lexical, en particulier, qui ne seraient par inutilisables pour traiter ce que tu fais. Au lieu de dévaloriser la part du lexique pour remonter la part de la syntaxe, il y aurait peut-être à introduire dans la description lexicale des données syntaxiques précises et y compris les moduler en termes sémantiques. Bernard CONEIN : Sur la contribution de l'activité cognitive des locuteurs au sens, j'ai une question qui a un rapport avec la question de la catégorisation. Dans les deux cas la notion de sens n'est pas tout à fait la même. Dans le premier cas il y a effectivement une contribution de la syntaxe et du lexique au sens. Par contre, lorsqu'on parle de l'activité des locuteurs, de leur contribution au sens, de la construction sociale du sens, je crois qu'on parle d'une autre notion de sens. Est-ce que tu maintiens que c'est du même sens dont on parle ? Pourquoi est-ce que ceci a un rapport avec la catégorisation ? Si on prend une définition très stricte de la catégorisation, il y a beaucoup de tes exemples qui ne sont pas des catégorisations, enfin on pourrait tout au moins discuter le fait que ce soit de la catégorisation. Qu'est-ce qui fait que tu choisis de dire que c'est de la catégorisation ? Tu es obligée à ce moment-là d'avoir une notion plus cognitive de la catégorisation, qui consisterait à dire qu'il y a des processus de catégorisation implicites, en quelque sorte, qui n'impliquent pas par exemple des formulations de type : "je suis…", etc. A ce moment-là on passe à deux acceptions de catégorisation : dans l'une, le lexique et la syntaxe contribuent directement à la catégorisation ; dans l'autre, on aurait des phénomènes de catégorisation implicites. Cela m'amène à ma deuxième question. Quand tu parles de recatégorisation, dans quelle mesure les exemples que tu donnes sont des phénomènes de recatégorisation ? A mon avis on peut l'interpréter dans ce sens-là, mais la question pour moi est ouverte. Lorsque tu dis par exemple : "je suis maître de conférence mais je fais un travail de prof parce que je dirige des thèses", ça revient au même que de dire : "je suis O.S. mais je suis qualifié", est-ce que tu te recatégorises ? Tu peux tout à fait dire que tu changes de prototype sans considérer que tu changes de catégorie. Par contre, si tu as une conception en termes définitionnels de la catégorie, tu peux dire qu'effectivement dans la propriété essentielle il y a une condition nécessaire et suffisante pour être O.S., c'est de ne pas être qualifié. C'est-à-dire que la question de ne pas être qualifié fait partie de la définition de O.S. Et à partir du moment où tu changes une propriété définie – cela s'applique à une certaine théorie sémantique - il y a quelque chose qui fait que la catégorie serait effectivement atteinte. Josiane BOUTET : On voit des verbalisations qui sont des activités qui portent sur des propriétés, des attributs et des frontières de quelque chose – des frontières de notions, de catégories, de classes, je ne sais pas très bien – or ça, ça ne se joue pas nécessairement en termes de : « je suis maître de conférence mais je devrais être prof". Ca peut effectivement jouer en termes de : "je suis maître de conférences, pourtant qu'est-ce que j'ai comme boulot ! Je fais le boulot d'un prof", donc qui n'est pas la même façon de le dire. Et puis on pourrait imaginer qu'on invente une catégorie qui soit les maîtres de conférences qui dirigent les thèses et, dans ce cas-là, je ne dirai plus : "je suis maître de conférence, je dirige des thèses, : "je suis Z" et Z serait le nom de la catégorie. Si cette catégorie était inventée en terme savant, d'experts, en termes de codification extérieure, le locuteur ne ferait plus ce travail compliqué de mise en mots. Il y a des pré-codifications, des pré-catégorisations qui nous sont imposées par l'ordre social, pour aller vite, et puis il y a tout un espace où ces codifications sont travaillées par les gens. Peut-être faudrait-il dire un travail de la catégorisation plutôt qu'une recatégorisation, si on considère que seul aura droit au mot de recatégorisation si on invente "Z". J'avais l'impression qu'on pouvait quand même se permettre de dire que cet espace entre être maître de conférences, être prof, cet espace-là d'approximation où on a les attributs de, mais on ne l'est pas, il me semble que, ça, c'est un travail sur la catégorisation. Peutêtre qu'il y aurait recatégorisation quand on a franchi la frontière et seulement là. N'empêche que ce qui m'intéresse tout de même, c'est cet entre-deux, ce travail de l'approximation qui peut amener sociologiquement un jour à ce que justement il y ait une désignation ou un mot d'argot ou un vocabulaire de métier qui se saisisse de cet entre-deux pour en faire quelque chose, une désignation. Il me semble, à tort ou à raison, que je n'avais pas envie de faire une relation bi-univoque entre désignation et catégorisation. Je ne peux pas dire : "je suis Z", c'est-à-dire ni prof ni maître de conférences, je ne peux pas le dire à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas la désignation pour, mais il me semble pourtant qu'il y a un travail sémiotique. C'est aussi une des raisons de fabrication de nouveaux mots ou de dérivations. Ce n'est peut-être pas convaincant. Si tu penses que c'est trop choquant de dire recatégorisation, moi je n'y tiens pas particulièrement. Bernard CONEIN : Si tu l'emploies, tu donnes un argument. Ce qui m'apparaît paradoxal d'une certaine façon, c'est que dans un modèle de grammaticalité, c'est plutôt un modèle classique qui te conduira à parler des catégorisations. Tu peux tout à fait admettre qu'il y a des propriétés ; pour ton O.S. par exemple, que tu n'aies pas le même prototype d'O.S., si tu es O.S. et si tu es du côté des experts. Par contre, dans un modèle classique, effectivement si tu as des définitions, des conditions nécessaires et suffisantes, tu peux dire : "on a enlevé leur (?). Si tu veux c'est ça le paradoxe que je trouve. Josiane BOUTET : J'ai été trop loin en disant que c'était du non-discret ou du continu. Je crois que c'est vrai, avec le langage on ne peut pas le dire. Le continu dans la langue peut aussi se discrétiser. Donc, de fait, je pense qu'il faudrait plutôt parler de la possibilité d'avoir un espace scalaire, mais qui est effectivement discrétisé, mais en tout cas pas binaire. Tu as complètement raison, Jacques (Theureau), de dire que, quand je parle de système de connaissances, c'est complètement extrinsèque à l'analyse. C'est plus qu'extrinsèque. Ce que je saisis, c'est des verbalisations, des mises en mots que je peux analyser de façon impérative, de façon différente, cela dépend du modèle que je veux appliquer. Mais je peux juste dire que par des processus dont je ne sais rien, que d'autres connaissent effectivement, il faut postuler comme un axiome pour que quelque chose marche dans le langage, il faut effectivement postuler qu'il y a des processus mentaux et il faut postuler – parce que cela m'intéresse mieux – qu'il y a des systèmes de connaissances qui sont variables. Mais c'est vrai que c'est extrinsèque. Je le postule parce que sinon la machine ne tourne pas, mais je n'ai aucun moyen de le vérifier. Et c'est à d'autres de vérifier dans leur système et dans leur logique et leur discipline, parce que pour eux ce n'est pas un axiome, c'est des données, c'est de l'empirique. C'est ça, le travail interdisciplinaire. Jacques THEUREAU : Quand tu annonces construction sociale du sens, il me semble que si tu restes là où tu es, ce n'est pas tout à fait vrai, construction sociale du sens, mais construction en tant que processus de construction, pas produit. Si j'avais un reproche ce serait, 1) quand tu dis "construction sociale de sens", tu ne te donnes pas tout à fait les moyens d'arriver là et, 2) comment donner une extension de l'intérêt des études de la parole vivante que tu as faite ? En quoi ça peut s'étendre ? Prenons un exemple. On parle de catégorisation. Avec le recensement INSEE on est en situation quasi-expérimentale. Vous avez un questionnaire, où on vous dit : quelle est votre profession, vos fonctions ? Si vous êtes cadre, vous avez un peu plus à remplir ; fonctionnaire, vous en avez encore plus etc. Le recensement varie les questions en fonction des gens auxquels il s'adresse. On a fait une étude ergonomique sur la saisie du chiffrement. On peut le prendre comme la fabrication de la qualité du recensement par les opératrices qui font ça sur leur système informatique. Mais on avait un petit problème. Les opératrices ramassaient des bulletins déjà remplis par les gens et il y avait une espèce de dialogue avec les gens qui avaient rempli le bulletin. Si on veut s'intéresser à la qualité du recensement, on est obligé de mettre bout à tout la fabrication des nomenclatures, des questions du questionnaire, l'activité des gens qui remplissent ce machin-là, l'activité des gens qui remplissent ce machin-là, l'activité des filles qui font la saisie chiffrement, et après des nomenclaturistes qui fabriquent leurs statistiques. On a tout un processus de construction. Au bout du compte, il y a quelque chose qui sort et puis ça reboucle pour le recensement d'après, et ça reboucle dans tout un tas d'enquêtes, etc. C'est utilisé socialement, manipulé socialement dans tous les sens. Décrire de manière suffisante cette activité de remplissage du questionnaire pour transformer, améliorer la qualité de l'obtention… Au fond, il y a les questions, le remplissage, et entre les deux il y a l'actualisation du système de connaissances dans ce jeu-là avec le questionnaire. Tu es obligée de passer par là par exemple si tu veux avoir suffisamment pour pouvoir agir dessus. On commence par remplir ça et puis on passe à autre chose, etc. On a été marqué par ce qu'on a mis sur la profession quand on attaque la fonction. Là-dedans tu es obligée de savoir quelque chose du système de connaissances actualisées à chaque étape par le bonhomme. Pour améliorer le recensement, et bien il faudra peut-être donner un mode d'emploi, un mode d'emploi un peu plus développé par question. Il faudra peut-être faire une formation des recensés, je ne sais pas, faire des contrôles. Si on en reste à une analyse de : "au bout du compte, ils ont rempli ça", alors qu'éventuellement on peut vérifier que ce n'était pas ça : "ils ont dit qu'ils étaient ceci et puis en fait ils ne sont pas ça". L'accent que tu mets sur : "prenons au sérieux la matérialité du langage", c'est absolument nécessaire pour justement rendre compte de cette activité et j'aurais tendance à dire que pour ça, il manque quelque chose. A savoir comment le système de connaissance s'actualise dans le processus. Et ceci nécessite des notions qui sont extra-linguistiques. CATEGORISATION PROFESSIONNELLE ET CLASSEMENTS SOCIAUX : UN OU DEUX SAVOIRS ? Bernard CONEIN MCI – GDR Communication CENT-CNRS Université Paris VIII "Chacun possède de façon essentielle une capacité identique à développer des concepts" (Jackendoff, 1983) Résumé L'idée de concevoir la conceptualisation courante à partir de domaines conceptuels spécialisés est devenue une hypothèse de recherche courante en sciences cognitives. Nous nous proposons, en nous inspirant de la démarche de l'ethno-science concernant les classements conceptuels des espèces naturelles, d'examiner s'il existe des principes ordinaires de conceptualisation en ce qui concerne les groupes sociaux. L'une des premières questions concerne la représentation taxinomique. Un des acquis de l'ethnoscience pour les espèces naturelles a été d'établir un lien entre le placement dans une taxinomie et la perception d'une forme stable. Or il semble que tous les classements ne soient pas de type taxinomique. Pour les artefacts (meuble, véhicule), le principe courant de conceptualisation donnerait une primauté aux propriétés fonctionnelles (Atran, 1986 ; Keil, 1987). A première vue, le classement social selon la profession se prêterait au classement taxinomique par inclusion de classe. En fait nous sommes ici piégés par un fait culturel : les rôles professionnels étant dans notre société les plus institutionnalisés, ils sont l'objet de classement de second ordre (traitement statistique, enregistrement administratif, recensement démographique) : Dans quelle mesure ces classements de type taxinomique reflètent ils les modes courants de conceptualisation des catégories sociales ? Quels sont les critères permettant de distinguer les différents modes de conceptualisation des groupes sociaux ? La classification professionnelle appartient-elle à "la connaissance courante du monde social" ? Introduction L'interrogation sur la nature d'une connaissance de sens commun concernant les classements professionnels ouvre des questions nouvelles à la sociologie. L'analyse des catégories sociales peut devenir un domaine privilégié du lien entre les sciences de la cognition et les sciences sociales. L'approche cognitive conduit à mettre en question une analyse de la stratification sociale d'une société qui se ferait indépendamment des représentations conceptuelles, des jugements et des raisonnements des sujets classés : de ce point de vue elle présente des affinités avec l'interactionisme et l'ethnométhodologie. Pourtant la reconnaissance de l'importance des classements indigènes et de la capacité commune à l'espèce humaine à conceptualiser est insuffisante, si n'est pas prise en compte la structure du savoir attribué. De ce point de vue, l'utilisation par les sociologues, et en particulier par les interactionnistes, de la notion de connaissance de sens commun est ambiguë car elle recoupe trop souvent des conceptualisations de nature différente(1). Cette spécification de la nature du savoir est particulièrement cruciale lorsqu'on cherche à analyser les propriétés propres à la connaissance ordinaire des placements sociaux, ce qui distingue celle-ci d'un classement institutionnalisé, comme le code des professions de l'INSEE. Les capacités conceptuelles liées à la représentation des individus selon leur occupation économique ne sont peut être pas directement dérivées du classement professionnel taxinomique mais peuvent provenir de principes plus généraux de la catégorisation sociale. La classification professionnelle serait peut être construite à partir de processus de conceptualisation plus élémentaires des groupes sociaux. Si l'approche cognitive semble utile heuristiquement, c'est qu'elle propose des critères explicites pour décider si tel type de conceptualisation peut être considéré comme basique et donc relève de la "connaissance ordinaire du monde social". On peut en effet considérer que le classement social intuitif se ferait à un niveau plus bas et moins spécifié, selon le statut et le genre de vie. Par exemple sous une forme binaire et ancrée perceptuellement assez proche des taxinomies par genre de vie, présentées par Pierre Bourdieu (1979) dans La Distinction. Nous proposons de montrer comment des interrogations récentes provenant de l'anthropologie et de la psychologie cognitive seraient susceptibles d'apporter un éclairage nouveau à une analyse des rapports entre placement professionnel et classements sociaux. La mise à jour par les sciences cognitives des mécanismes de la conceptualisation courante ont, selon nous, des conséquences importantes sur notre façon de concevoir la connaissance sociale. Des propriétés sont introduites pour caractériser les processus de la connaissance courante : traitement obligatoire et non réflexif permettant la catégorisation perceptuelle, processus spécialisé de conceptualisation, processus d'acquisition lié au développement de capacités conceptuelles communes à l'espèce humaine. Quelles conséquences peut-on tirer de ces faits en ce qui concerne la conceptualisation courante des groupes sociaux ? Peut-on analyser la conceptualisation des groupes professionnels uniquement en référence avec les systèmes de classements de second ordre comme ceux élaborés et diffusés par l'INSEE ? De ce point de vue, les deux modèles sociologiques de la catégorisation, ceux proposés, par Pierre Bourdieu (1979) puis par Boltanski (1982), Derosières et Thévenot (1988), peuvent être vus comme deux façons de concevoir l'interaction entre connaissance sociale ordinaire et connaissance sociale élaborée. La critique d'un protocole expérimental d'analyse des concepts concernant les professions nous servira à indiquer quelles contraintes devraient, selon nous, se donner une analyse empirique des classements sociaux courants. Il faut souligner cependant que les problèmes posés par l'analyse de la cognition sociale n'ont pas reçu de réponses satisfaisantes, les propositions en ce domaine ne peuvent que prendre une forme très schématique étant donné les recherches empiriques peu nombreuses sur les concepts sociaux. Dans l'état actuel de la connaissance que nous avons de la cognition sociale, il est pratiquement impossible de se référer à une solution satisfaisante. 1. Cognition sociale et spécialisation conceptuelle Une des façons de penser la conceptualisation sociale courante est de tenter d'identifier le domaine conceptuel : est-ce que, en ce qui concerne les catégories sociales, on peut trouver des processus de conceptualisation spécifiques du même ordre de ceux qu'on a trouvés en ethno-science en ce qui concerne les espèces naturelles ? Cet abord de la connaissance sociale comme processus cognitif spécialisé est original, elle provient de travaux très récents en anthropologie et en psychologie du développement (Hirschfeld, 1988 et Turiel, 1983). Il suppose une façon différente de raisonner sur la spécificité du social, qui sans contredire le souci durkheimien de la recherche d'une autonomie du social, mettrait en cause un des principes classiques de l'autonomisation : l'idée d'une spécificité ontologique du social (Sperber, 1987 : 108). Ce principe devient un obstacle à une analyse de la conceptualisation sociale car il tend à faire de l'individu un récepteur passif des contenus culturels imposés par une communauté. Aussi, un psychologue du développement, Eliott Turiel a-t-il récemment représenté ces deux conceptions de la spécificité du social comme des manières concurrentes d'interpréter l'acquisition, la source et la nature de la connaissance : "La connaissance portant sur le monde social est, dans une large mesure, socialement dérivée. Mais cette proposition peut être interprétée de deux façons différentes. On peut concevoir que cette connaissance est transmise à un individu par d'autres personnes de telle sorte que la connaissance acquise est dépendante du contenu qui est transmis, ou on peut concevoir que cette connaissance acquise est dépendante du contenu qui est transmis, ou on peut concevoir que cette connaissance est construite par des individus de façon spécifique à propos des phénomènes sociaux" (Turiel, 1983 : 1). La spécificité du social n'est plus pensée de façon externe à travers un processus d'apprentissage par instruction, mais à partir de certaines capacités conceptuelles spécialisées communes à l'être humain concernant la représentation des groupes sociaux ou des institutions. La conceptualisation liée aux classements sociaux n'est plus alors pensée comme effet d'une construction sociale de la réalité mais comme résultant d'une capacité identique à conceptualiser. Cette démarche peut servir à poser des questions nouvelles concernant l'analyse de la connaissance ordinaire des placements sociaux : 1) Une question sur la nature de la connaissance sociale courante : cette "connaissance ordinaire" est-elle le produit de mécanismes généraux de la catégorisation humaine (ce qui ôterait toute particularité à la cognition sociale), ou a-t-elle des propriétés spécifiques au mode de conceptualisation sur le monde social ? En effet s'il existe une conceptualisation propre à la représentation des groupes sociaux, comment se manifeste-t-elle ? Peut-on la concevoir sous forme d'aptitudes conceptuelles intuitives ou doit-on la concevoir sous forme de connaissances spéculatives de second ordre, produites par la communication sociale et les institutions ("codification savante") ? 2) Une question sur l'unité des domaines de la catégorisation sociale : doit-on supposer une aptitude unique quelle que soit la nature du groupe (sexuel, générationnel, parental, ethnique, professionnel) ou des capacités et des accès selon les niveaux et les modes de conceptualisation liés à la manière dont on interagit avec ces groupes ? La reconnaissance de groupes professionnels n'est pas fondée sur un contact direct avec les personnes et sur la perception visuelle contrairement au sexe, l'âge et la race. La conceptualisation des groupes sociaux non fondés sur des identifications à ancrage perceptuel est-elle très différente de celles concernant des catégories de nature conventionnel, comme les professions, dont l'accès est de type critériel ou nominal (Keil, 1989) ? L'absence d'ancrage perceptuel et le rôle d'éléments critériels ou conventionnels spécifient-ils la catégorisation sociale proprement dite et la différencient-ils des processus de catégorisations initiales de bas niveau fondées sur l'apparence (sexe, âge et race), ou doit-on considérer qu'il existe plusieurs domaines de conceptualisation des groupements sociaux (reconnaissance des personnes, catégorisation par le sexe, l'âge et la race, catégorisation selon les statuts) ? 3) Une question qui concerne la taxinomie comme mode de représentation des groupes sociaux : le système de groupement des catégories professionnelles de l'INSEE se présente sous forme d'une taxinomie comportant des niveaux de catégorisation avec des groupes dominants (ouvriers, employés, etc.). Cette taxinomie porte sur une projection nationale. Le système de classement qui a l'apparence d'une taxinomie linéenne est fondé, selon les groupes dominants, sur des critères sémantiques différents. Quelles conséquence doit-on tirer de cette hérérogénéité des critères, soulignés par les sociologues (Desrosières et Thévenot, 1988) ? Par ailleurs, plusieurs expériences sur les classements sociaux ont montré l'importance des chevauchements entre les domaines catégoriels (sexe, profession, âge) et les niveaux de catégorisation. Il semble donc nécessaire de distinguer catégorisation (appartenance d'une instance à une catégorie type) taxinomie (inclusion hiérarchique des catégories avec héritage des propriétés) et codification (corrélation entre catégorie d'usage et catégorie "savante") en ce qui concerne les modes de placements sociaux. 2. Taxinomie et catégorisation dans classement professionnel Une des particularités du système de catégorisation professionnelle de l'INSEE est de ranger les catégories socio-professionnelles par rang hiérarchique de telle façon que chaque catégorie professionnelle se trouve à l'intérieur d'une catégorie dominante2. Il fonctionne selon le principe d'une taxinomie par inclusion hiérarchique sous le modèle identique aux taxinomies des espèces basiques qui est logiquement subordonné à un rang supérieur (forme de vie ou niveau super-ordonné) (Berlin, 1976). Ce modèle suppose que les catégories, désignant les espèces naturelles, soient ordonnées hiérarchiquement autour d'un niveau fondamental de conceptualisation (générique ou niveau basique) qui est logiquement subordonné à un rang supérieur (forme de vie ou niveau super-ordonné). L'application d'un modèle taxinomique a des justifications à des fins d'expertise pour obtenir une projection nationale des professions en France qui correspond à des niveaux différents de regroupement de population. Cependant la construction d'une représentation taxinomique des professions et des métiers présente une série de difficultés. Les professions ne sont pas institutionnalisées de la même façon, ainsi les critères se combinent mal (statut, catégorie, secteur d'activité) : "Cette coexistence (des modes de construction des catégories), qui suscite l'irritation des théoriciens…, est le reflet de ce que l'espace professionnel lui-même s'est historiquement construit sur la double base de la tradition des métiers (liée à une forme encore familiale et artisanale de la production), et des grilles d'emplois qualifiés, induites par une mise en relation logique entre des compétences codifiées par des diplômes et des postes résultant de l'organisation rationnelle du travail dans les grandes entreprises industrielles" (Desrosières, 1989). L'application d'une nomenclature fondée sur une projection nationale se heurte à des contraintes écologiques (démographique, organisation sociale des professions) qui ont été très bien analysées par Desrosières et Thévenot (1988). Soient deux exemples : Les critères du premier regroupement AGRICULTEURS EXPLOITANTS ne correspondent pas du tout aux critères du second regroupement ARTISANS. COMMERCANTS. CHEFS D'ENTREPRISE : Les critères de taille de la propriété gouvernent la répartition des trois groupes de la première catégorie alors que les critères du métier et de la profession liés à l'entreprise gouvernent le second regroupement. D'autre part, comme le remarquent les anthropologues cognitifs, les catégories fondamentales ont tendance à être mono-lexicales, or parmi les catégories de tête de la nomenclature INSEE (3), seules deux catégories OUVRIER (groupe 6) et EMPLOYE (groupe 5) sont monolexicales, deux sont bi-lexicales (groupe 1 et groupe 4). Les catégories mono-lexicales semblent être les plus saillantes socialement. Les catégories de tête composés de deux catégories (3 : CADRES et PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES) ou de trois catégories (groupe 2) sont explicitement des regroupements composites dus au rapprochement d'un critère commun qui est privilégié. La catégorie PROFESSIONS LIBERALES, ancien candidat à un rang supérieur, devient, dans la nouvelle nomenclature, une sous-catégorie du groupe 3. La notion de "profession détaillée" qui correspond à 455 postes dans la nomenclature de l'INSEE regroupe à la fois des professions qui correspondent à des niveaux beaucoup plus spécifiques : ARTISTE DE VARIETE. La catégorie ARTISTE qui semble correspondre à un regroupement pertinent du point de vue du sens commun, ne l'est pas, du point de vue de l'INSEE, car elle est taxinomiquement trop spécifique pour être une catégorie dominante de tête de la nomenclature et trop peu pour être une catégorie spécifique (4). Maintenant si on interroge la pertinence cognitive du classement : le mode de classement taxinomique peut-il être considéré comme la forme naturelle des liens inter-catégories ? En quoi s'accorde t-il avec le mode courant de conceptualisation des groupes sociaux. Certains psychologues, comme Eleanor Rosch (1978), ont proposé de considérer l'inclusion de classe et le niveau d'abstraction comme un principe général de conceptualisation des objets. Beaucoup de psychologues ont ainsi tenté alors d'appliquer la distinction entre niveau d'abstraction (super-ordonné, basique ou sous-ordonné) aux artefacts, puis aux catégories sociales (cf. Dahigren, 1987). 2 On peut considérer qu'il existe trois niveaux essentiels : le niveau de tête (6 groupes), un niveau intermédiaire (32 postes) et un niveau spécifique concernant les professions "détaillée" (455 postes). Le principe d'inclusion de classe gouverne l'appartenance au niveau supérieur (cf : Desrosières et Thévenot, 1988). Mais peut-on généraliser et transférer les résultats des expériences portant sur l'accès perceptuel aux catégories concernant les formes vivantes à d'autres concepts, incluant les artefacts ou les concepts sociaux, sans justifier la légitimité d'un tel transfert (Atran, 1987, Keil, 1989) ? En effet, ce qui fonde la forme taxinomique, ce sont des contraintes cognitives comme : l'existence d'un ancrage perceptuel (similitude d'une forme physique), la disjonction des taxons ou l'attribution d'une nature intrinsèque à l'objet, Carey, 1983). L'attribution d'une structure interne stable comporte plusieurs autres implications : la capacité d'atteindre une certaine taille, d'avoir une certaine couleur et de comprendre certaines parties. Lorsqu'on interroge des sujets sur les professions, ne faut-t-il pas éviter de présupposer une structure taxinomique par le choix des questions (est ce que X est un EMPLOYE). En effet, on s'aperçoit que la tête de la taxinomie est le plus souvent placée au même rang que des sous-catégories qu'elle prétend inclure (5). Soit la catégorie CADRE n'est pas la catégorie adéquate pour le regroupement des professions, soit c'est la distinction taxinomique elle-même qui est à mettre en cause en ce qui concerne les concepts sociaux, c'est-à-dire que la densité d'une catégorie n'est pas liée à sa position par rapport à un regroupement supérieur. La violation du principe taxinomique en ce qui concerne les professions se porte également sur les propriétés. Un des critères cognitifs d'une organisation taxinomique est que le niveau de classement fondamental est un pic d'information qui regroupe le maximum de propriétés. Ce qui devrait impliquer que la catégorie EMPLOYE devrait regrouper moins de propriétés que SECRETAIRE, or ce n'est pas le cas. Deaux et al. (1985) ont montré que le même phénomène est à l'œuvre en ce qui concerne les groupements sexuels, que FEMME et HOMME attiraient autant de propriétés que des sous-catégories : "En utilisant le nombre d'attributs produits comme un critère de la densité de la catégorie, aucune de nos recherches ne fournit une preuve que HOMME et FEMME soient des super-ordonnés par rapport à des sous-types plus basiques… En d'autres termes, il n'existe aucune évidence que les termes généraux FEMME et HOMME soient plus pauvres que des sous-types sexuels spécifiques" (Deaux et al., 1985 : 164). Selon Lingle et al. (1984), les catégories sociales se distinguent des concepts naturels par au moins trois aspects : La dépendance contextuelle de la conceptualisation. Le fait que le membre d'une catégorie appartient en même temps à d'autres regroupements sociaux (générationnels, sexuels, parentaux, ethniques). L'importance des propriétés fondées sur des inférences et le rôle secondaire des propriétés perceptuelles. Selon Keil (1987), 1989) les termes qui désignent les artefacts et les groupes sociaux sont liés à des interactions sociales standardisées, à des propriétés fonctionnelles plutôt qu'à des propriétés intrinsèques. Les catégories sociales sont aussi dépendantes de leurs conditions d'emploi et des tâches. Selon que le but recherché est l'assignation d'une compétence, la fixation d'une position hiérarchique, ou l'insertion écologique dans une activité. Cela signifie que par exemple, les quatre critères utilisés pour la fixation d'une profession par l'INSEE : la profession, le statut, la fonction et la qualification ouvrière, peuvent être pragmatiquement séparés, selon le contexte de la tâche, dans la catégorisation courante. 3. Rapport classement professionnel et expertise sociale : un ou deux savoirs ? L'existence d'un système standardisé par des experts de classement professionnel pose donc un problème particulier pour l'analyse des classements sociaux courants. En se diffusant, ce système peut jouer un rôle de point de référence pour la catégorisation sociale en créant un classement de second ordre superposé à la catégorisation courante. Se pose alors un problème cognitif particulier : comment ajuster les deux modes de catégorisation ? (6) Le problème change cependant de nature, on passe d'un problème de catégorisation à un problème de codification (remplacement d'une catégorie par une autre). Cette situation est par excellence ambiguë puisqu'elle relève de l'expertise sociale (comment élaborer un système formalisé de classement social à partir des réponses d'une population donnée à un protocole d'enquête ?) et aussi d'une écologie des représentations culturelles (comment, dans une population, se diffuse par la communication sociale un mode de représentation formelle ? Sperber, 1985). Le travail de Boltanski et Thévenot (1983) reconnaît l'existence de ce problème posé par la superposition des niveaux de représentation des groupes sociaux. Leur analyse a consisté à mettre en rapport la catégorisation naturelle et les processus de "représentation officielle et publique" de classification à travers des exercices de classement et de catégorisation. La recherche porte donc sur « l'analyse de la relation entre les catégories ordinaires, employées de façon pratique pour placer les gens socialement, et les classifications officielles comme le code des catégories socio-professionnelles de l'INSEE ». Ces derniers seraient, selon eux, liés au travail symbolique de représentation des groupes sociaux. Le facteur cognitif est pris en considération puisqu'on s'intéresse à la façon courante de conceptualiser sur les groupes sociaux mais la construction de la situation expérimentale n'est pas adaptée à l'objectif de l'enquête. En effet la tâche, telle qu'elle est construite, met les participants en situation de semi-expertise puisqu'il leur est demandé de manipuler des informations sociales portant sur des individus (profession, diplôme, âge, habitat, etc.) : en groupant en tas des fiches qui correspondent à ces individus ("répartir ces fiches en tas selon les milieux auxquels appartiennent les personnes considérées"), en plaçant ensuite la fiche la plus représentative en haut du tas et enfin en demandant une catégorie pour désigner les piles. Ce test pose donc un problème lorsqu'il prétend donner accès à la connaissance ordinaire du classement. Il utilise en effet un test d'expérimentation employé pour tester les catégorisations des espèces naturelles sans s'interroger sur le transfert aux catégories sociales d'un tel test (7). De plus, ce test de nécessite, pour être appliqué aux professions, une modification importante : au lieu de manipuler des dessins représentant l'exemplaire, on manipule des propriétés complexes ; ce qui met en jeu un tout autre type de raisonnement (un mode de raisonnement explicite et non plus une catégorisation perceptuelle). Les sujets sont mis dans une situation réflexive de type apprentissage et non de catégorisation intuitive à partir de traits perceptuels. Or l'un des apports de l'approche cognitive consiste à ne plus concevoir l'intelligence sous le modèle d'une théorisation réflexive (Keil, 1989). La conséquence est qu'on ne peut pas concevoir une expérimentation sur "la connaissance courante du monde social" comme une épreuve scientifique de rassemblement de données, visant à inférer des hypothèses sur la base d'un traitement de l'information. Cependant cette étude garde son intérêt si elle n'est plus conçue comme une analyse de la catégorisation courante des professions. Comme le notent les auteurs, l'expérimentation fait apparaître "l'émergence et la popularisation d'un système officiel pour désigner les groupes sociaux". L'étude met en valeur un facteur intéressant : comment des "catégories sociales", élaborées par des experts, se diffusent parmi une population ? Elle manifeste aussi la compétence des personnes à utiliser des représentations et des concepts sociaux dans des situations de communication écrite (réponse à un questionnaire) et d'élaboration réflexive (formulation d'hypothèses). La logique de l'expérimentation proposée conduit plutôt à mettre l'accent, en ce qui concerne les professions, non pas sur la connaissance "ordinaire" mais plutôt sur la mise en œuvre d'une connaissance réflexive, de second ordre, sur les groupes sociaux. Elle se limite à mesurer l'écart entre la connaissance des experts et celle des "novices". L'analyse du processus de diffusion des représentations culturelles sur les classements sociaux est un sujet de recherche en soi (Sperber, 1987). Il requiert de trouver des critères pour distinguer les types de savoir concernant les groupes sociaux : ceux qui ont trait au traitement interprétatif et réflexif de l'information sociale et ceux qui portent sur la connaissance intuitive. Putnam (1975) propose une hypothèse séduisante : il existerait une division linguistique du travail qui sépare l'usage courant des catégories et l'usage spécialisé. A côté de la détermination sémantique et lexicale d'un mot, on doit distinguer deux niveaux de connaissance pour déterminer la référence d'un concept : - La description du stéréotype qui concerne les propriétés caractéristiques associées, par les individus, au concept. Une théorie de sens commun est associée au mot, elle le simplifie en proposant un stéréotype de l'objet-exemplaire qui permet de reconnaître celui-ci dans l'environnement. - La description de la référence qui serait fixée par des experts, par des scientifiques pour les espèces naturelles. La fixation de la référence serait H2 O pour l'eau. Cette description n'est connue que par un petit groupe d'experts et non par la majorité de ceux qui emploient le concept. La référence (ou l'extension du concept) serait déterminée socialement par une communauté de locuteurs. Il y aurait une division linguistique du travail entre les locuteurs : par exemple ceux pour lesquels la catégorie est importante, pour différentes raisons, doivent connaître le mot, ceux qui doivent acquérir une méthode ou une technique pour reconnaître si tel exemplaire relève de la catégorie (par exemple les techniciens des ateliers de saisie-chiffrement étudiés par Pinsky et Theureau, 1982) (8). Seule cette seconde catégorie de personnes a besoin d'avoir des critères conventionnels communs pour décider de l'appartenance. Les autres peuvent s'appuyer sur ce que Putnam appelle une "sous-classe de locuteurs" dont ils savent qu'ils possèdent des critères techniques pour reconnaître les exemplaires d'une catégorie et auxquels ils peuvent se fier en cas de doute (Putnam, 1975 : 228). La communauté sociale divise donc le travail de connaissance des classements avec les formes particulières de communication sociale impliquées par cette division. L'analyse de Putnam, pour intéressante qu'elle soit, se limite cependant à une analyse sémantique de la référence des termes. Elle laisse de côté la question des modes de connaissance. Dan Sperber (1985) propose des critères proprement cognitifs pour distinguer les niveaux de connaissance : La connaise "ordinaire" serait de nature empirique. Elle se manifeste dans les aptitudes conceptuelles étudiées par l'anthropologie cognitive (couleur, faune et flore) : "le savoir empirique quotidien se développe sous de fortes contraintes conceptuelles, logiques et perceptuelles. Il en résulte qu'un tel savoir tend à être empiriquement adéquat et cohérent. En revanche, il ne s'applique qu'à certains domaines cognitifs et le fait de manière assez rigide" (Sperber, 1985 : 83). La connaissance "savante" serait de type méta-cognitive. Elle suppose la mise en œuvre d'élaborations conceptuelles secondaires, ouvertes à des réinterprétations. Elle porte plus directement sur des objets mais sur des représentations. Elle constitue un type particulier de croyances : "A la différence des croyances intuitives, les croyances élaborées ne forment pas un ensemble bien délimité. Elle ont en commun, c'est leur mode d'apparition : elles se manifestent enchassées à l'intérieur de croyances intuitives" (Sperber, 1990 : 21). Sont impliqués "d'autres aptitudes cognitives, en particulier celle qui consiste à former des représentations de représentations". Les représentations culturelles relèveraient selon Sperber de cet ordre, elles sont élaborées, modifiées et diffusées à travers des réseaux de communication sociale, incluant l'intervention des institutions. Que doit-on en conclure en ce qui concerne les classifications professionnelles ? Les concepts portant sur les professions paraissent bien relever d'une connaissance de second ordre, liée à la communication sociale et à l'existence des professions. On peut difficilement considérer que les catégories professionnelles soient des concepts simples de la même manière que les concepts naturels. Cela ne règle pas pour autant l'intéressante question de savoir s'il existe une connaissance intuitive des placements sociaux. 4. Y a t-il une connaissance commune des placements sociaux ? L'approche cognitive de la catégorisation implique la prise en compte de contraintes sur la nature de la connaissance sociale. La notion de connaissance courante, c'est-à-dire de la connaissance sociale utilisée par des non-experts, recouvre donc deux types différents d'aptitude conceptuelle : la capacité intuitive à conceptualiser les groupes sociaux sur la base de la perception de traits saillants et la capacité méta-cognitive à symboliser ou a spéculer sur les groupes sociaux. Les principes qui président aux classements professionnels type nomenclature INSEE ne peuvent que relever du second type d'aptitude. Quand à l'idée qu'il existe une connaissance élémentaire intuitive des placements sociaux, on doit la considérer comme une hypothèse de recherche ouverte. Les mécanismes élémentaires de catégorisation sociale porteraient sur la perception de traits saillants liés à la différenciation des modes de vie ou des positions statutaires. Les sociologues quantitatifs n'aiment pas les classements binaires ou ternaires (populaire, moyen, supérieur) bien qu'ils soient constamment utilisés comme catégorie interprétative. Ils correspondent pourtant à des intuitions sur la stratification sociale qui s'ajustent mieux à la connaissance intuitive des regroupements sociaux. L'hypothèse d'une connaissance sociale basique n'est pas à rejeter a-priori. Elle recoupe en fait plusieurs remarques récentes qui proviennent à la fois de l'éthologie des primates (Cheney et Seyfarth), de la théorie de l'évolution (Tooby et Cosmides) et de l'anthropologie (Hirschfeld) ou de la micro-sociologie (Goffman) sur l'existence de principes de différenciation sociale des groupes entre apparenté et non apparenté, famillier et étranger, supérieur et subordonné. Ces principes répondent assez bien aux critères que donnent les sciences cognitives pour décrire les mécanismes spécialisés de traitement de l'information : traitement obligatoire, rapidité du traitement, acquisition précoce, ancrage perceptuel, etc...3 On peut donner, à titre d'exemple, deux hypothèses récentes sur la cognition sociale : Un anthropologue. Lawrence Hirschfeld (1988) montre qu'il existe des processus liés à l'identification et à la connaissance des groupes qui se distinguent des processus liés à l'auto-identification et à la connaissance des groupes qui se distinguent des processus liés à l'auto-identification personnelle des individus. Il fait l'hypothèse que l'identification d'autrui diffère de l'auto-identification, la première étant liée au développement de la connaissance sociale chez l'enfant. Cette connaissance sociale se manifesterait en particulier dans les catégorisations ethniques à partir d'observation sur l'acquisition précoce par les enfants de classements sociaux à partir des traits saillants. Des psychologues, John Tooby et Leda Cosmides (1989) font l'hypothèse que l'évolution de l'espèce humaine vers la culture suppose un programme cognitif comportant non seulement l'acquisition de classifications sociales (parent proche/parent éloigné) mais de processus complexes d'attitudes, dont la prohibition de l'inceste. Le fait que des modes de représentions conceptuelles des groupes sociaux soient en interaction avec des systèmes politiques, juridiques et religieux qui proposent des interprétations doctrinales ou de forme scientifique de la stratification sociale n'implique pas que l'on doive assimiler les deux modes de savoir. L'argument historiciste de Boltanski (1982) à propos de la catégorie CADRE, comme étant le produit d'un processus de représentation politique réussie d'un groupe social, n'est pas incompatible avec une hypothèse cognition sociale. Il ne conduit pas explicitement à réduire les principes cognitifs qui sont à l'œuvre dans les placements sociaux courants au symbolisme social. En un mot, l'acquisition des principes élémentaires des classements ne peut être assimilée au processus historique de construction et de diffusion culturelle des catégories. L'argument d'une construction historique des catégories sociales porte lorsqu'il est appliqué justement à une analyse de la distribution et de la diffusion des représentations culturelles concernant les catégories professionnelles. C'est semble-t-il d'ailleurs l'enseignement principal que Desrosières et Thévenot tirent du test du tri : "Quels sont les enseignements principaux de cette expérimentation ? On peut d'abord conclure des résultats que la diffusion des CS est aujourd'hui assez large (comme celle des "socioprofessionnels", au sens de représentants de groupes divers) pour que les gens les emploient, les retrouvent ou encore engendrent de nouvelles catégories sur le même modèle" Desrosières et Thévenot, 1988 : 58). 3 Ces critères ne recoupent pas cependant tous les critères que donne Fodor concernant la modularité : spécificité du domaine, traitement obligatoire, accès limité au système central, rapidité du système, cloisonnement informationnel, caractère superficiel de la sortie, base neuronale, défaillances caractéristiques, séquentialité et rythme de l'ontogénèse. Il semble donc nécessaire d'intégrer l'analyse des catégories professionnelles à l'intérieur d'une théorie plus générale de la conceptualisation des groupes sociaux. L'idée d'une construction sociale historique des groupes sociaux qui se ferait uniquement à travers des institutions et des mouvements sociaux est trop simpliste. Elle fait l'impasse sur les micro-processus liés au traitement de l'information sur les personnes (cf. les exemples de Goffman dans Stigmate) en traitant tous les concepts sociaux sous le même mode. L'impossibilité de se contenter d'un modèle simple de la connaissance sociale suggère l'existence d'une pluralité des domaines cognitifs concernant les groupes sociaux et les individus. En conclusion, si on l'applique aux catégories sociales les critères que se donnent les anthropologues et les psychologues cognitifs concernant les processus cognitifs élémentaire, les classements professionnels ne semblent pas appartenir au domaine de la connaissance ordinaire du social : l'emploi des catégories professionnelles comme mode de classification sociale suppose des efforts cognitifs particuliers et la diffusion d'informations spécifiques dans certains lieux sociaux. BIBLIOGRAPHIE Atran S. (1986) Fondements de l'histoire naturelle : pour une anthropologie de la science, Coll. Le Genre Humain, Editions Complexe. Berlin B. (1976) "The Concept of Rank in Ethnobiological Classification", American Ethnologist, n°3, 381-399. Boltanski L. (1982) Les cadres : la formation d'un groupe social, Editions de Minuit. Boltanski L. et Thevenot L. (1983) "Finding one's way in Social Space : a Study Based on Games", Social Science Information, Vol. 22, n° 4/5, 631-680. Bourdieu P. (1979) La distinction, Paris, Editions de Minuit. Carey S. (1983) Conceptual Change in Childhood, Cambridge, Mass., MIT Press. Dahlgren K. (1987) "The Cognitive Structure of Social Categories", Cognitive Science, 379-398. Deaux K. W., Winton M., Crowley, L. Lewis, (1985) "Level of Categorization and Content of Gender Stereotypes", Social Cognition, Vol. 3, n° 2, 145-167. Derosieres A. et Thevenot L. (1988) Les Catégories socioprofessionnelles, Paris, La Découverte. Goffman E. (1975) "Contrôle de l'information et identité personnelle", Stigmate, Paris, Editions de Minuit, 57-126. Hirschfeld L. (1988) "On Acquiring Social Knowledge : Cognitive Development and Anthropological Wisdom", American Anthropologist, Vol. 23, n° 24, 611-638. Keil F. (1987) "Conceptual Development and Categories Structure", Concept and Conceptual Development, U. Neisser ed., London-New York, Cambridge University Press. Keil F. (1989) Concepts, Kinds, and Cognitive Development, Cambridge, Mass., MIT Press. Lingle J., M. Altom et D. Medin (1984) "of Cabagges and Kings : Assessing the Extendibility of Natural Objects Concept Models to Social Things", In R. Wyer et T. Sruil ed., Handbook of Social Cognition, Vol. 1, Erlbaum, NJ, Hillsdale, 72-117. Pinsky L. et Theureau J. (1982) Activité cognitive et action dans le travail, Coll. Physiologie du travail et Ergonomie, CNAM, n° 73. Putnam H. (1975) "The meaning of 'meaning of 'meaning'", Philosophical Papers, Vol. 2, London, New-York, Cambridge University Press, 215-271. Rosch E. (1978) "Principles of Categorization", Cognition and Categorization, ed. E. Rosch et B. Llyod, Hillsdale, NJ, Erlbaum. Sperber D. (1985) "Anthropology and Psychology : Towards an Epidemiology of Representations", Man, 20, 73-89. Sperber D. (1987) "Les sciences cognitives, les sciences socials et le matérialisme", Le Débat, n° 47, 103-115. Sperber D. (1990) "The Epidemiology of Beliefs", à paraître dans Gaskell & Frazer, ed., Widespread Beliefs, Cambridge University Press. Tooby J. et L. Cosmides (1989) "Evolutionary Psychology and the Generation of Culture", Ethology and Sociobiology, Vol. 10, n° 1-3, 29-49. Turiel D. (1983) The Development of Social Knowledge : Morality and Convention, London-New York, Cambridge University Press. REACTIONS Patrick PHARO Ce qui est tout à fait remarquable dans ce que tu nous présentes oralement et dans ton texte, c'est la façon de montrer comment des problématiques avec lesquelles on est assez familiers en sociologie peuvent être relayées, non seulement relayées, mais complètement reprises à partir d'une autre discipline qui est, en gros, la psychologie cognitive. Tu fais ça sans le dire, sans mettre un discours là-dessus, mais tu le fais. Ca fait réfléchir évidemment parce que les sociologues, en particulier, n'aiment pas tellement la psychologie en général. On n'aime pas la psychologie parce que les faits sociaux s'expriment par les faits sociaux et pas par la psychologie. Du moins, ça fait partie de la théorie standard, on pourrait dire. Donc ça amène à réfléchir et ça peut susciter des objections qui peuvent être inutilement renforcées par d'autres objections qui tiennent à ta façon de procéder; dans ton texte il y a à un moment une surcharge de références à des théories cognitives qu'on ne connaît pas, enfin que moi je ne connais pas. Finalement on se sent bête de ne pas savoir ce qu'est un "traitement obligatoire et non réflexif permettant la catégorisation perceptuelle", ce que c'est qu'une "disjonction des taxons", ce qu'est même un "critère cognitif", un "pic d'information", un "ancrage perceptuel". Là, on ne veut pas rester bête et on veut comprendre. La notion d'ancrage perceptuel, dans le texte tu l'annonces page 3 sans la définir. Il faut vraiment faire l'effort de la comprendre parce que c'est très essentiel dans ton argumentation et je te demanderai si je l'ai bien comprise. Il y a donc un problème d'acclimatation, qui tient aussi à nous, enfin à moi en tout cas du fait que je ne lis pas ce qu'il faudrait lire ou je ne sais pas quoi. L'autre remarque que je voulais faire aussi à propos du texte, tu l'as faite toi-même, tu t'en es justifié, c'est-à-dire qu'évidemment tu poses à des travaux de sociologie en particulier des questions dont ils n'avaient pas idée et tu les discutes à partir de cette problématique cognitive que tu avances. Je pense que c'est tout à fait pertinent, de même que les philosophes analytiques traitent un passage de l'Ethique à Nicomaque comme le dernier article qui vient de paraître dans une revue de Philosophie. Je pense qu'en effet c'est une façon de faire. Simplement, on peut se demander, par exemple à propos de Boltanski et Thévenot, s'ils utilisent vraiment les tests cognitifs créés pour Ides espèces naturelles. Donc finalement la discussion là-dessus paraît un peu problématique. Ce texte qui s'appelle "catégorisation professionnelle et classements sociaux", est un texte difficile, je l'ai dit, mais qui me paraît suivre une stratégie que j'ai mis du temps à comprendre. Il part en fait d'une thèse que tu attribues à l'interactionnisme et à l'ethno-méthodologie, qui est aussi quand même peut-être essentiellement la thèse de la sociologie compréhensive. C'est la prise en compte des raisonnements et des représentations des sujets dans tout le travail d'analyse du social. Tu pars de ça comme d'un acquis d'un certain courant de la sociologie, et tu vas en trouver la parenté dans les travaux de science cognitive. En particulier il y a une notion que tu avances tout de sui te, qui est l'idée que la cognition sociale est structurée, et l'hypothèse aussi qu'il y a ce que tu appelles des spécialisations conceptuelles, ce que tu as repris aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne connaîtrait pas les arbres de la même façon qu'on connaît les ouvriers ou les actions éventuellement. Ton premier pas c'est donc de nous dire: par rapport à la thèse interactionniste ou la sociologie compréhensive qu'on peut avoir en commun, il y a des pas supplémentaires à faire qui consistent à aller voir comment ce savoir est structuré par rapport à ces objets. Ton deuxième pas, c'est l'idée que dans le cas de la spécialisation sociale, donc la cognition sociale -c'est à celle-là que tu t'intéresses- on trouve un paradigme qui est en gros l'idée qu'il y a deux types de connaissance. En fait, tu fais plusieurs distinctions, mais tu as d'un côté l'idée d'une connaissance sociale basique. Je suppose que c'est de cette connaissance sociale basique là qu'on peut dire qu'elle est soumise à ce que tu appelles, en reprenant Fodor, un traitement obligatoire et non réflexif; dans ces cas là on ne peut pas ne pas connaître, car on est guidé par la perception. Ce point va nous emmener bien au-delà des thèses interactionnistes. Donc il y aurait ça d'un côté et, d'autre part, il y aurait des constructions de second ordre. Cette distinction va jouer sur différents plans. Dans le texte il y a trois distinctions, enfin trois jeux de distinction qu'on aperçoit: d'une part méta-connaissance et connaissance intuitive. Cette distinction semble se recouper avec une autre distinction qui serait celle de classement et conceptualisation; par exemple les opérations de classement dans une nomenclature, et la conceptualisation, ce serait autre chose. Mais est-ce que ça se recoupe vraiment ? Je pense que justement ça ne se recoupe pas tout à fait parce qu'il peut y avoir de la conceptualisation dans une méta-connaissance comme dans une connaissance intuitive. Cela serait donc un des problèmes que je poserais. Enfin il y a une autre idée qui est assez importante, c'est cette disjonction entre taxinomie et propriété fonctionnelle. Les propriétés fonctionnelles - je pense que c'est les caractéristiques de ce que font les gens, de la façon dont ils s'organisent entrent mal dans des taxinomies. Il faut donc les traiter autrement. Bernard CONEIN Le point de départ de la discussion dans les sciences cognitives sur la spécialisation conceptuelle concerne le point suivant: peut-on traiter la catégorisation des objets fonctionnels (les artefacts) de la même façon que l'on a analysé la catégorisation des espèces naturelles ? Et c'est la suite de la critique qu'ont fait un certain nombre de psychologues ou d'anthropologues aux travaux de Eleanor Rosch, en montrant que Rosch avait assimilé à tort dans le domaine des "objets naturels", espèces naturelles et artefacts4. Ils ont montré qu'en /ce qui concerne les artefacts, on pouvait avoir des phénomènes des treillis : "piano" peut être à la fois instrument de musique ou meuble, selon le contexte, alors que pour les espèces naturelles tu ne peux pas être" chien et chat" en même temps ou "chien et oiseau", etc. Michel de FORNEL Il est évident qu'il y a une énorme littérature sur la distinction entre espèces naturelles et artefacts. C'est simplement que pendant longtemps on a assimilé les espèces naturelles aux artefacts et depuis il y a une série de travaux qui essaient de montrer qu'il y a des distinctions et c'est encore un débat ouvert. Patrick PHARO Sur ce point, l'enjeu est assez important. Par exemple, dans la construction de Boltanski et Thévenot sur les économies de la grandeur, un des points par exemple, c'est leur histoire de "natures". Ils disent que les personnes peuvent appartenir à plusieurs natures mais que les objets appartiennent à une seule nature. Pourquoi disent-ils ça ? C'est à mon avis qu'ils ont besoin d'ancrer quelque part les interactions et les principes de justification. Parce qu'ils pensent, à juste titre du reste, qu'il n'y a pas cet ancrage par exemple dans l'ethno-méthodologie, ils cherchent à le constituer par une théorie des objets. Donc ça les amène à avoir une hypothèse assez forte sur l'uninaturalité des objets, par exemple qu'un objet c'est un objet industriel, ce n'est pas un objet domestique ou des choses comme ça. Il y a effectivement des problèmes de noyau, des problèmes de déformation là-dedans, mais ce n'est pas vrai simplement des objets matériels. Ca peut être vrai aussi des objets intentionnels, par exemple. En fait, je voudrais simplement essayer de t'interroger sur le sens de ton argumentation. A partir de ces distinctions, tu arrives à l'idée qu'il y a une structure spécialisée du savoir social, que tu vas donc distinguer des autres savoirs. Tu envisages deux aspects: d'un côté un savoir ordinaire empirique qui lui, est perceptuellement ancré, qui est donc lié à une certaine objectivité, à une certaine stabilité de ce qu'il envisage; et, de l'autre, un savoir qui, lui, est beaucoup plus soumis à interprétation, beaucoup plus constructiviste. Ce qui t'amène à ta conclusion, si je t'ai bien compris - tu me diras si je comprends ou si je fais un contresens -, qui est une conclusion nuancée à l'intérieur du papier, puisque tu rejettes en fait la théorie de la construction sociale pour ce qui concerne la connaissance basique, parce que précisément elle est contrainte, elle est perceptuellement ancrée, il y a traitement obligatoire, etc. Mais tu l'admettrais, semble-t-il, sur le plan des représentations de second ordre, donc des constructions, des taxinomies, etc. Est-ce que c'est ça, ta démarche ? Et, si c'est ça, est-ce que tu admettrais un pas supplémentaire au sujet duquel je voudrais t'interroger ? Ce serait de se demander s'il y a ancrage perceptuel de la cognition sociale, de même qu'il peut y avoir ancrage perceptuel par rapport à une couleur. Prenons en effet l'exemple d'une couleur. Si on a une théorie de la couleur comme quoi la couleur serait un sensible propre ou, comme on dit aussi, une propriété ou une qualité seconde de la chose, qui appartient donc à la chose. Une telle théorie explique pourquoi je peux demander à quelqu'un de regarder un objet que je ne vois pas et lui dire: de quelle couleur c'est ? S'il me dit que c'est rouge, je sais que c'est rouge parce qu'il y a des sensibles propres, des qualités secondes de l'objet. Si on pense les choses comme ça, ça a énormément de conséquences du point de vue de la théorie de la cognition sociale, et notamment qu'il existe des objectivités 4 On fait référence surtout aux travaux de Frank Keil et Susan Gelman en psychologie du développement, de Ann Wierzbicka en sémantique et de Scott Atran en anthrolopogie cognitive. sociales. Il y a des propriétés sensibles des objets sociaux, dont il faudrait dire ce qu'elles sont. Ta démarche pose des problèmes intéressants à l'intérieur des courants sociologiques tels qu'on les voit autour de nous. Pour préciser cela, je suis obligé de dire comment je vois les sociologies. C'est extrêmement grossier et c'est vraiment pour les besoins de la cause et pour te titiller et lancer un débat. Je sais qu'en parlant des "sociologies de Bourdieu" et des" sociologies interactionnistes", je les déforme et ce que j'en dis est très gros. Mais cette clause étant admise il y aurait à mon avis en fait deux types de théories. D'un côté, je pense essentiellement à la sociologie du type, comme dit Boltanski, durkheimo-marxiste, c'est-à-dire Bourdieu. Moi je dirais plutôt structuraliste. Ca me paraît essentiellement structuraliste, Bourdieu. Car l'idée importante de Bourdieu est quand même qu'il y a des structures de représentation qui sont systématiquement déformées, tu l'as du reste rappelé en disant qu'il ne fait pas de distinction entre catégorisation et jugement. Le point essentiel est qu'il y a dans la représentation du social une déformation basique fondamentale qui vient des déterminations sociales qui passent par les structures incorporées venant du dépôt dans les organismes des structures objectives et permettant de générer de nouvelles actions (qui font qu'en définitive les cadets du Béarn restent célibataires, alors qu'ils ne le veulent pas !). C'est très complexe comme théorie. Mais on est dans une déformation constante et la notion-clé dans ce genre de théorie c'est l'illusion. L'illusion au sens latin que nous rappelle Bourdieu est la croyance douteuse. On est tous dans la croyance, mais pas dans le savoir au sens de Socrate, c'est-à-dire la croyance vraie. Le savoir, on peut le produire. On peut produire des conditions objectives du savoir et Bourdieu, je pense, a produit des savoirs objectifs. Il y a toutes sortes de choses que Bourdieu a produites que je crois vraies sur, par exemple, l'école technique, et même sur les Béarnais. Je crois qu'il y a bien là un savoir objectif. Et, ayant ce savoir objectif, eh bien on peut corriger l'illusion, c'est-à-dire la croyance douteuse. A mon avis, c'est tout à fait raisonnable de vouloir corriger l'illusion. Si quelqu'un croit par exemple qu'il y a des licornes, licornes n'existent pas". Mais il faut lui dire :"les licornes n'existent pas". Mais il faut aussi se demander comment il se fait qu'il peut croire aux licornes, alors que les licornes n'existent pas. Et c'est là le problème psychologique de savoir pourquoi quelqu'un croit quelque chose de faux. Ce qu'on objecter à ce genre de théorie, c'est qu'on ne se trompe pas toujours. Je veux dire que la connaissance ordinaire ne se trompe pas toujours. C'est précisément une des objections de l'autre théorie, et c'est plutôt dans celle-là que moi-même j'ai été pendant un certain temps. Ces théories me paraissent assez fortes actuellement, Boltanski y est aussi, je pense que beaucoup de gens y sont, parce qu'il y a de forts arguments pour elles. Quant à toi tu pars de ces théories pour t'en séparer un peu. L'idée est que les représentations sont formées par l'interaction. Dans ce genre de théorie un appendice a disparu, ce sont les structures objectives accessibles ; il n'yen a plus tellement, et même dans les positions très extrêmes, il n'y a plus de structures objectives du tout. Il y a toutes sortes de formes d'interactionnisme, toutes sortes de formes d'ethno-méthodologies, mais dans ces théories-là on pourrait dire que la notion-clé c'est l'indexicalité ou l'indexicalité généralisée. Effectivement, dans les cas extrêmes de ce genre de théories, on pourrait voir le monde social comme volonté et représentation indexicale. Ceci est vraiment un problème, qui fait dire à Latour cité par Boltanski, que les mondes sociaux ethno-méthodologiques sont des mondes de macaques où les gens n'arrêtent pas de changer. Il y a là une objection très sérieuse. Ou est la stabilité ? Le problème c'est que dans les positions extrêmes ethnométhodologiques et interactionnistes, on n'a plus rien à corriger car il n' y a plus de réalité stable. Si quelqu'un croit aux licornes, il n'y a rien à dire. Ainsi, le sens commun ou bien est amené à se tromper tout le temps par structure: l'illusion est constitutive parce qu'elle permet de ne pas voir la nécessité ; ou bien on n'a pas la possibilité de ne pas se tromper, parce que toute croyance est douteuse et que le savoir social n'existe pas. d'une certaine façon. Le savoir social des interactionnistes n'est pas le savoir au sens de Socrate, le savoir au sens fort qui permet de dire: c'est vrai, ce n'est pas vrai, quelqu'un a telle intention ou il a tel motif. Pour les interactionnistes on ne pourrait décider de rien et par conséquent, on ne serait pas dans l'illusion, mais ce serait encore pire car on serait dans l'indécidable en permanence dès qu'il s'agit du social. Il semble au contraire que dans ta démarche il y a la possibilité de restituer une certaine objectivité de la connaissance ordinaire. Mais à partir du moment où on a cette démarche, est-ce qu'on peut, par exemple comme tu le fais, organiser le champ en disant: il y a une connaissance basique intuitive qui est ancrée et une connaissance construite qui est interprétante, construite et construisante, donc qui est beaucoup moins ancrée, qu'on peut beaucoup plus déformer, etc. Est-ce qu'on peut dire cela ? L'objection que je vois à une position comme celle-là, c'est que les activités sociales entretiennent toujours des rapports, avec la connaissance théorique, même si la connaissance intuitive est différente d'une méta-connaissance. On peut dire que même la connaissance intuitive incorpore quelque chose d'une connaissance formulée ou d'une méta-connaissance. D'une certaine façon le problème est de savoir si on peut connaître des objets sociaux sans supposer qu'à l'intérieur même de leur accomplissement ils ont déjà la conceptualité qu'on va leur accorder. Cette connaissance empirique dont tu parles, a des liens avec des structures de classement. On pourrait te donner des contre-exemples de connaissances intuitives qui ne sont pas des connaissances réfléchies, qui sont simplement des connaissances à l'oeuvre, mais qui font appel à des structures de classement. Je prends cet exemple parce que ça m'est arrivé. Je suis rentré dans un café qui n'est pas loin de l' IRESCO et je pensais que c'était un café arabe parce que les gens avaient un type méditerranéen, c'étaient des célibataires. Bon, je ne me suis pas dit tout ça, je me le suis dit après coup. Ils étaient habillés avec ces vêtements un peu "bien mis" mais pauvres et pas neufs, donc je croyais être dans un café arabe. Et puis à un moment j'ai entendu parler yougoslave. Mais on peut avoir la même expérience à Marseille, quand on va se baigner sur les plages qui sont près de Marseille et qu'on est au milieu des gamins qui parlent marseillais et, sauf à être un expert du Front national, et donc avoir une taxinomie bien organisée, ce n'est pas évident de distinguer un petit beur d'un petit marseillais. Est-ce que la connaissance intuitive qu'on met en oeuvre pour reconnaître des situations n'inclut pas quelque chose de l'ordre de la taxinomie, même si elle ne s'y identifie pas ? Bernard CONEIN Je me suis mal exprimé parce que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas suffisamment développé ce point concernant la forme de classification taxinomique, il était présent dans le texte sans être central dans l'argumentation. A savoir qu'un des acquis, me semble-t-il, de l'ethno-science, et disons des études sur la classification des espèces naturelles, a été de montrer que la catégorisation, pour les classements biologiques, est organisée en rangs hiérarchiques. Donc, l'idée qu'il existe des niveaux de catégorisation a été reprise par Rosch avec sa théorie des trois niveaux d'abstraction (sous-ordonné, basique, super-ordonné). Ceci veut dire une chose précise, lorsque l'on a affaire à une conceptualisation concernant ce type d'objet (les espèces naturelles), on a affaire un système d'inclusion de classe, basé sur un jugement d'identité. Seule cette structure là est de type taxinomique. Dans ce cas là, il s'agit d'une connaissance intuitive, les jugements "un chien est un animal" ou "ceci est un chien" sont des jugements de sens commun, basés sur la perception d'une forme physique. Cependant, l'ethno-science a proposé une autre distinction entre taxon et catégorie : la catégorie doit être distinguée du groupement taxinomique lui-même, car la catégorie réfère essentiellement à un rang ethno-biologique (origine unique, forme de vie, générique, spécifique, variétal). La notion de catégorie doit être aussi distinguée du terme lexical. Les idées de savoir intuitif et taxinomie populaire impliquent tout cela. On peut cri tiquer tout ceci mais c'est cela la démarche de l'ethno-science. C'est le projet de faire une enquête dans différentes langues et de trouver, quelles que soient les sociétés, même ayant un lexique différent et beaucoup de variations culturelles, un système conceptuel commun. Il existe des variations dans les termes, mais on peut trouver une structure conceptuelle commune. Comme à propos des couleurs, il y a beaucoup de variations, mais on a bien trouvé une structure cognitive commune. Maintenant la question qui se pose : peut-on étendre et appliquer ce modèle taxinomique, de classement par rangs hiérarchiques à d'autres catégories ? C'est là que surgit le problème des artefacts et des professions. Patrick PHARO Tu pourrais quand même préciser simplement tes critères de distinction entre la méta-connaissance et puis la connaissance… Bernard CONEIN Ce n'est pas moi qui fait cette distinction. J'utilise une distinction que Dan Sperber a faite déjà il y a 18 ans dans "Le symbolisme en général" entre classification encyclopédique et classification symbolique. C'est disponible pour le grand public, si on peut dire; cette distinction est reprise dans le travail de Scott Atran sur l'ethno-science. Elle n'est, par contre, pas souvent faite dans les travaux anglo-saxons. Quant à l'idée d'une connaissance factuelle basique, on la trouve dans différentes disciplines, en intelligence artificielle avec Patrick Hayes qui pense qu'il existe une physique naïve. C'est le fait qu'on aurait tous des distinctions comme haut, bas, gauche, droite, etc. La physique naïve, c'est quelque chose qui n'est pas théorique dans un certain sens. Des psychologues et des philosophes du langage ont montré qu'il y aurait peut-être une psychologie naïve, une psychologie du sens commun qui seraient liées aux attitudes propositionnelles, le fait qu'on dit: "X croit que, X pense que". En ethno-science on cherche quelque chose comme une ethno-biologie. La question qui se pose à propos de la sociologie, c'est: est-ce qu'il y aurait une folk sociologie ? S'il y a une folk sociologie, c'est-à-dire si on a une conceptualisation propre aux groupes sociaux, si on applique ça à la catégorisation sociale en général, la question se pose de savoir où placer cette folk sociologie ? Est-ce qu'on va la trouver dans l'identification des personnes par des stéréotypes, les classements sexuels ou générationnels, dans les classements selon les rangs sociaux ? Est-ce qu' il existe une sociologie populaire ("une connaissance ordinaire du monde social") au sens où l'entendent Boltanski, Desrosières et Thévenot, quand on conceptualise les groupes sociaux. Selon eux, les traditions et les mouvements sociaux historiques déterminent la définition des termes sociaux, par exemple le concept de cadre est en fait surdéterminé socialement par l'existence de la communication sociale et de l'histoire politique des mouvements sociaux. Je n'ai plus en tête leur formulation mais ils disent quelque chose comme : " il n' y a pas de catégorisation sociale indépendamment de la représentation publique et politique que les groupes sociaux se donnent d'eux-mêmes. C'est une thèse constructiviste. J'utilise la distinction que propose Sperber, mais elle est liée à cette autre discussion concernant la psychologie populaire et la physique naïve, sur la nature de savoirs conceptuels simples. Poser la même question sur le social, est-ce que cela a un sens ? Il n'existe peut-être qu'une psychologie naïve car quels peuvent être les plausibles au niveau de la sociologie populaire ? - Dans toutes les sociétés ? Bernard CONEIN Pourquoi pas ? Pourquoi être relativiste immédiatement ? En ce qui concerne Garfinkel, on ne sait pas car il parle du sens commun, effectivement il ne spécifie pas; peut-être s'agit-il uniquement de la société occidentale. Mais son interrogation va dans le sens de l'existence d'une" folk sociology", d'une ethno-sociologie. Est-ce que le fait d'attribuer des intentions à des groupes sociaux, c'est de la folk sociologie ? Le fait qu'on dise : " la classe ouvrière pense que..." ou "elle veut que...", etc., alors qu'on sait que du point de vue description ces phrases posent un problème. Il existe des types d'explications sur le monde social qui présupposent que celui-ci soit fait de collectif. Cette idée implique une hypothèse sur la spécialisation du savoir social. Patrick PHARO Ça pose un problème logique de dire par exemple : "les ouvriers veulent que ou les ouvriers sont ceci". Il y a des conditions de vérité qui sont effectivement très particulières. Ca ne veut pas dire que ce n'est pas une description. (Débat avec Pierre Achard, Josiane Boutet, Michel de Fornel). Bernard GARDIN Je reprendrai un peu ce qu'avait fait Pharo tout à l'heure, c'est-à-dire distinguer trois attitudes. Une première qui pose le social comme une extériorité et on peut construire un savoir sur le social. Cette sociologie-là a été quand même fortement attaquée. Il. y a une deuxième position qui met le social au niveau de l'interaction, avec tout ce 'qui a été dit tout à l'heure. Ta position, Bernard, semblerait être la troisième qui, pour sauver le social, essayerait de le constituer comme une sorte de donnée primitive, c'est-à-dire antérieure à l'interaction, comme une expérience fondamentale. Ca ressemble un petit peu à un schéma philosophique qui me semble être celui du XVIIIe. Dans ces expériences que tu appelais des connaissances empiriques, fondamentales, de base, premières, primaires, ça m'a fait penser à la statue de Condillac. C'est-à-dire qu'on essaie de reconstituer le mode de connaissance et on image cette table rase, cette statue qui n'a encore rien et on lui amène un pétale de rose et elle va fabriquer le concept, donc l'odeur de rose, peu à peu ses connaissances vont se fabriquer. Le problème avec ce qui se passe dans le domaine humain, c'est malgré tout que les expériences sont toujours impures, c'est-à-dire comprennent plein de choses et notamment effectivement que les objets qui sont l'objet d'expériences se présentent toujours d'une part dans des interactions, d'autre part dans une certaine fonctionnalité. C'est-à-dire que le mouton arrive soi t pour qu'on joue avec, soit pour qu'on le mange, ou bien il arrive en peluche aussi. Il y a des expériences qui sont toujours complexes et qui comprennent toujours notamment de l'interaction, de l'énonciation et des mots, des catégorisations, c'est-à-dire du langage. Donc c'est très mêlé et, concernant - le langage le fait qu'il y a toujours du métalangage dans le langage, on n' y peut rien. C'est-à-dire que la réflexivité est toujours présente. Certes, on peut par la suite être plus réflexif, avoir des pratiques intellectuelles plus réflexives que d'autres, mais je ne sais pas si on peut séparer, notamment les catégories ou les notions, des mots qu'on emploie et les mots que l'on emploie, des horizons conceptuels de valeur auxquels ils sont liés. Je crois l'hypothèse extrêmement intéressante à travailler, essayer de trouver des éléments les plus primitifs possibles, mais je crois que dans le primitif il faut intégrer justement ces aspects mêlés. Bernard CONEIN Je crois que tu as tout à fait raison, je n'ai presque rien à rajouter. Le social comme objectivité, effectivement ce n'est pas ce que je cherche. Sperber a montré que ce qu'il appelle la présupposition d'une spécificité ontologique du social chez Durkheim implique une ontologie beaucoup trop forte. On retrouve cette présupposition dans la tradition sociologique. La critique de Garfinkel consiste à dire que cette présupposition ontologique est en fait une théorie sociale de sens commun et, pas du tout une théorie scientifique. Quant à l'interaction, il faudrait distinguer deux choses. Le social comme interaction au sens purement réduit à des rapports inter-sujets et de communication: non. Mais l'interaction au sens de Mead, comme interaction entre des organismes et l'environnement: oui. Le problème de l'interaction avec l'environnement, je crois que c'est très important, c'est effectivement le point de départ pour poser le problème des différentes formes de conceptualisation. Mettre au premier plan le social comme condition, c'est d'une certaine façon le retour à Durkheim. Ce que je mets au premier plan, c'est la conceptualisation du social. Il existe un argument d'Elliot Turiel dans "The development of social knowledge" qui me paraît très riche. Il dit à peu près la chose sui vante : "La proposition que la connaissance du monde social est, dans une large mesure, socialement dérivée peut être.. interprétée de deux façons. On peut concevoir que cette connaissance est transmise à un individu par d'autres personnes, de telle sorte que la connaissance acquise est dépendante du contenu de ce qui est transmis". Cette position est une approche empiriste de l'acquisition de la connaissance, mais on peut, dit-il, aussi "concevoir que cette connaissance est construite par des individus d'une façon spécifique à propos du monde social". C'est ça une hypothèse de cognition sociale. En un sens, il existe un lien entre le point de départ de la sociologie : rechercher une certaine objectivité conceptuelle du social, simplement on construit cette objectivité d'une autre façon. Maintenant je me heurte effectivement à deux grands problèmes avec cette démarche. C'est le relativisme culturel, un argument qui est à chaque fois présenté. Et un autre argument qui est l'idée que le langage est premier par rapport à la connaissance. C'est pour ça que je crois qu'il y a peut-être un malentendu par rapport à ce matin: quand je parle de catégorisation, je n'en parle pas au sens de Josiane. Je ne parle pas d'une catégorisation linguistique, mais je présuppose, et je ne l'ai peut-être pas assez dit clairement, la distinction entre catégorie et terminologie lexicale. Donc je ne mets pas sur le même plan l'usage d'une catégorie ou l'usage d'un processus lexico-syntaxique qui impliquerait une catégorisation implicite, avec le phénomène de la catégorisation perceptuelle, qui est un phénomène beaucoup plus large et qui n'est pas en soi un phénomène linguistique. L'identification, la reconnaissance des objets n'est pas en soi un phénomène linguistique. Michel de FORNEL Je trouve que tu ne réponds pas aux objections qui viennent d'être formulées alors qu'il existe pourtant des arguments dans le domaine de la cognition sociale qui permettent d'y répondre. Au fond, l'intervention précédente présente deux arguments: le premier est que les jugements au niveau catégoriel sont de nature hétérogène. Un objet se présente toujours sous différentes facettes, il peut être à la fois un objet naturel et un artefact (par exemple une pierre qui sert de presse-papier), un objet culturel, etc. Le deuxième est qu'il y a toujours du méta-langage dans le langage, et plus généralement de la méta-connaissance dans la connaissance. Une perspective de cognition sociale doit être capable de prendre en compte ces deux objections. A l'évidence, une telle théorie doit être capable d'expliquer pourquoi les jugements sur les professions sont hétérogènes ainsi que la façon dont s'articulent une connaissance de second ordre et une connaissance de premier ordre. Ce qui me paraît contestable dans ton argumentation, c'est l'idée que le critère d'hétérogénéité pour les professions constitue un argument suffisant pour dire qu'il n'existe pas de domaine de base. En effet, on peut très bien avoir des domaines conceptuels homogènes avec cependant des jugements hétérogènes, étant donné que les jugements peuvent mobiliser plusieurs domaines. Cette hypothèse est d'autant plus plausible qu'elle est développée dans d'autres domaines par exemple en linguistique. Je vais prendre un exemple très simple en syntaxe. En syntaxe, c'est un mode de raisonnement courant, tellement courant même, qu'on peut le contester, comme tu l'as fait. Mais enfin il existe, il a fait ses preuves. Par exemple, il est clair que quand on traite le syntagme nominal, on a évidemment quelque chose de très complet, dans lequel on a aussi quelque chose qui a été projeté par le nom. Le nom joue un rôle dans le syntagme nominal, mais il y a bien quelque chose qui vient de la détermination. Il y a des phénomènes d'accord. Donc on voit bien quelque chose de complet. Doit-on dire que la théorie qu'on veut formuler, ses principes, son modèle, va être un modèle hétérogène qui va tout mélanger à la fois ? Non, on va sans doute avoir à la fois une théorie de l'accord, une théorie de la projection lexicale et en fait, en prenant ces modules, qui eux sont différents, on arrivera à quelque chose qui sera une bonne théorie du syntagme lui-même. Donc on peut tout à fait avoir une théorie des domaines homogènes, une théorie des modules, qui amène par ailleurs à un résultat, par exemple à un jugement qui, lui, est hétérogène. Donc ce que tu as dit, c'est vrai, il faut en tenir compte. De même que dans le langage on arrive à du fonctionnement grossier, mais il n'empêche que ça n'a pas les implications théoriques que tu prétends. Josiane BOUTET Question sur l'organisation, les niveaux, la structuration en cognition sociale. Bernard CONEIN . Le premier volant de ta question, c'est quels sont les principes d'organisation de ces domaines de spécialisation conceptuelle. En quoi ça a une particularité et en quoi l'hypothèse de spécification conceptuelle ou spécialisation conceptuelle se justifie pour le social ? A part le travail d'Elliot Türiel, qui ne porte pas sur la catégorisation sociale mais sur l'acquisition des jugements moraux et des conventions, il y a très peu de choses, seulement quelques tentatives. Les conséquences qu'aurait une hypothèse de cognition sociale sur la catégorisation sociale portent sur deux questions. La première : quelles sont les catégories qui entrent dans le savoir-noyau à propos du social et, en ce qui concerne les professions, est-ce que ça a un sens de les mettre dans le savoir-noyau ? Je ne pense pas, mais ça ne veut pas dire que par exemple le sexe, la parenté ou l'âge ne rentreraient pas dans le savoir noyau. La question est: quels sont les arguments qui justifient l'existence de ce savoir-noyau ? Là, il y a des arguments généraux qui ont été avancés aussi bien sur la psychologie des humains que sur la conceptualisation des espèces naturelles. Je n'ai proposé que deux arguments, mais il y en ad' autres encore. C'est la comportementalisation, l'acquisition précoce, le traitement rapide obligatoire. Un autre, évoqué par Jean Vidmer tout à l'heure, est l'ancrage éventuel dans l'évolution, lié à des comportements adaptatifs. Il y a aussi les hypothèses de Leda Cosmides : sur l'aptitude conceptuelle à la culture propre à l'espèce humaine, qui se traduirait par un certain nombre de processus, de résolution de problèmes d'un type particulier. La deuxième question est: quelle interaction doit être posée entre les domaines, s'il y a des domaines ? La comporte-mentalisation ne suppose pas que ces domaines ne communiquent pas entre eux. La troisième question discutée en ce moment est: quelle est l'interaction entre le savoir-noyau et le savoir culturel ? Quel que soit ce qu'on met dans le savoir noyau. (Intervention de J. Boutet sur la validation des hypothèses théoriques). Bernard CONEIN Il faut à la fois des analyses d'études naturalistes, écologiques, type ethno-méthodo1ogie, sur les contextes naturels. Pour les catégories sociales on a besoin d'analyses de ce type-là et des expérimentations éventuellement. Lesquelles ? Sous quelle forme ? Doivent-elles être du type de celles qu'on trouve en psychologie du développement ou en anthropologie cognitive ? D'une certaine façon je quitte un peu l'ethno-méthodologie, la règle disons de l'ethno-méthodologie qui consiste à dire : on accepte de considérer que des données de contexte naturel. Je dis : on accepte des données de contexte naturel plus des données de type expérimental. Question de J. GIRIN sur la notion de savoir-noyau: qu'est-ce qu'on met dedans ? Quelles frontières avec le savoir culturel ? Quelles relations établir entre les connaissances ordinaires et les connaissances savantes ? Comment intégrer l'épistémologie ? Bernard CONEIN Scott Atran a publié un Iivre sur ce sujet (Fondements de l'histoire naturelle), sur le rapport entre l'ethna-science et l'histoire de la classification 1inéenne. Un des grands problèmes, c'est le rapport entre la nature de ce savoirnoyau et en particulier éventuellement de ses "erreurs", de ses naïvetés, et la biologie scientifique, le rapport entre la zoologie naïve et la véritable zoologie. Scott Atran défend l'idée que l'entho-science n'a pas fait cette distinction, et qu'elle a souvent confondu ce qu'il appelle connaissance du sens commun et connaissance de second ordre, connaissance scientifique. Simplement ce qu'il dit - mais enfin ça fait partie du problème - c'est qu'il faudrait à la fois pouvoir mettre ensemble l'idée que le sens commun ne correspond pas à la science, qu'il est plein de naïvetés, et donc qu'il y a des contradictions entre les propositions du sens commun et celles de la science et qu'en même temps, sur l'essentiel, la science ne contrarie pas complètement la structure du savoir, du sens commun. En tout cas, c'est ce qu'il dit sur l'ethno-zoologie, quelle que soit la sophistication du nouveau classement en zoologie actuellement, néanmoins le savoir intuitif n'est pas complètement perdu. Le savoir intuitif est heuristique. On peut avoir une position pragmatique et dire : heuristiquement, ça marche. On a besoin que la terre soit plate, même si elle n'est pas plate, pour marcher. Ce que dit Atran, c'est que la physique naïve est une physique qui est essentiellement pragmatique, qu'elle est faite pour s'adapter à l'environnement. Et puis il y a une position qui consisterait à dire que malgré tout, pour l'essentiel, un grand nombre de ces propositions ne sont pas absurdes, c'est-à-dire que scientifiquement la science ne les contrarie pas complètement. Il y a d'autres propositions intermédiaires. Ceci dit, c'est le seul qui a fait ce rapprochement et le problème reste complètement ouvert. Ce livre s'appelle" Fondement de l' histoire naturelle pour une anthropologie de la science". Débat rapide avec J. Theureau à propos de Bachelard. Intervention de Jean WIDMER sur la distinction entre le savoir-noyau, en relation avec "sexe, âge et ethnie" et le savoir culturel, en relation avec "professions, systèmes de parenté". Le premier ensemble correspond, selon lui, à des percepts, immédiatement accessibles, transculturels. Mais c'est une base de structures sociales. Les sociétés utiliseraient ces percepts pour asseoir des distinctions sociales. Patrick PHARO : demande des précisions sur cette notion de percept. Michel de FORNEL Je me place dans le cadre de l'hypothèse que tu as présentée et j'examine les problèmes qu'elle me semble poser. Le problème principal me semble être que tu n'as pas donné d'argument en faveur de ta position finale. Je la résume rapidement, au risque de la caricaturer: tu adoptes plus ou moins l'idée qu'il y a des domaines conceptuels spécialisés, mais tu contestes l'idée que ces domaines se présenteraient sous forme taxinomique, Essentiellement parce qu'il n' y a pas ancrage perceptuel et parce que la densité d'une catégorie n'est pas liée à sa position par rapport à un groupement supérieur. On ne pourrait attribuer aux catégories professionnelles une structure interne stable. Tu n'as pas donné d'argument empirique qui montrerait qu'il n'y a pas ancrage perceptuel pour les professions. Mais, si je comprends bien, il y en aurait deux: un qui se déduit de ce que tu viens de dire, qui est très simple, qui est le fait qu'un boulanger, eh bien ce n'est pas évident de savoir que quelqu'un est boulanger. Donc ce n'est pas perceptuellement ancré. Et le deuxième argument, qui serait un argument lié aux classifications, qui est sousjacent à ce que tu as dit, qui est sans doute le fait que dans les taxinomies, pour les termes d'espèces naturelles, pour les artefacts, il est facile de concevoir - l'ethna-science l'a très bien fait, il y a énormément de travaux làdessus -, on a pu construire les classifications indigènes, donc les classifications des gens, avec les différents niveaux. On a pu montrer que ça ne correspondait pas à la taxinomie scientifique, c'est-à-dire que le niveau de référence pour les gens c' étai t un niveau intermédiaire, donc les termes basiques, et pas le niveau spécifié, le niveau des espèces, et donc que le niveau cognitif était différent du niveau scientifique, en quelque sorte. A priori, on aurait pu penser que ça serait le ni veau des espèces, que la perception se ferait au niveau des espèces. En fait, ce que les. travaux de l' ethno-science montrent, c'est qu'en fait notre niveau cognitif est un niveau intermédiaire à ce niveau, qu'on appelle niveau de base. Or, apparemment ton argument sur les professions serait que, là, ce n'est pas clair, parce que par exemple très souvent on catégorise immédiatement non pas quelqu'un comme boulanger, mais comme ouvrier. Donc on utilise une catégorie, qui est une catégorie au ni veau supérieur, ce qu'on appellerait en ethno-botanique arbre par exemple et pas pommier, alors que naturellement on dira plutôt pommier, poirier, cerisier, etc. qu'arbre. Donc, en gros, ton argument serait, si j'ai bien compris, qu'il y a hétérogénéité et s'il y a hétérogénéité dans les termes, on le voit bien dans les tests, c'est qu'il y a quelque chose déjà de second ordre. Il y a du réflexif, etc. Argument qui peut être tout à fait défendu. Pour les professions, il vaut mieux penser que, là, on se situe déjà à un niveau de second ordre. Donc ton argument serait, si je l'ai bien compris, qu'il faut remettre en cause pour les professions la distinction taxinomique. Ce que je défendrais, c'est l'idée au contraire que les professions présentent une structure primaire. Par voie de conséquence, il y a une sociologie naïve. Le fait qu'il y ait des jugements hétérogènes est le produit de l'application à la fois d'une psychologie naïve et d'une sociologie naïve. L'existence d'aspects taxinomiques ne me semble donc pas réductible à l'application d'une connaissance de second ordre sur une connaissance de sens commun qui serait elle, structurée selon de tous autres principes. Je vais proposer quelques arguments pour tenter de justifier cette position. Le premier argument, c'est qu'il me semble que dans la notion de catégorie que tu emploies, la notion de catégorie de base, tu mets seulement en avant le critère je dirais perceptuel. Or, dans la tradition ethno-science, on le met bien en avant, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a d'autres et, pour moi, il y en a plusieurs qui seraient importants. Le fait qu'on a une perception hôlistique en termes de globalité, qu'on perçoit la chose comme un tout, comme quelque chose qui a une uni té, des critères de mémoire, des critères liés au rappel, etc. Il me semble que c'est quelque chose qu'on doit faire intervenir aussi. Or, il me semble que pour les professions on est dans ce cas. En particulier pour un boulanger : On peut percevoir un boulanger dans son activité, on va avoir une perception globale. Il y a une perception hôlistique qui peut jouer et qui fait que cette catégorie s'impose et non pas disons la catégorie supérieure. Evidemment reste le problème de l'hétérogénéité. Comment traite-t-on ce fait que dans certains cas les gens vont le classer comme ouvrier et dans d'autres cas on va le classer comme boulanger. Il semble que,. là, il y a une hétérogénéité qui conduit à dire que c'est déjà du second ordre. Pour ma part, j'aurais tendance à défendre une hypothèse, défendue d'ailleurs par l'ethno-science, c'est le fait qu'en gros l'hétérogénéité serait une hétérogénéité dans les compétences. C'est-à-dire qu'on aurait bien une capacité humaine générale qui serait cognitive, universelle pour une catégorisation ou un niveau de base. Ce serait universel et dépendrait de facteurs physiologiques et psychologiques, mais ceci n'empêcherait pas qu'on ait deux possibilités et ce sont ces deux possibilités qui rendraient compte de l'hétérogénéité. L'une est le fait qu'on peut pour un sous-domaine, dans le domaine conceptuel "professions", sous-utiliser cette capacité. Je vais prendre un exemple dans l'ethno-science. Dans un milieu urbain, il est possible que la catégorie de base, au lieu d'être pommier, poirier, etc., devienne arbre. Donc il y a un "schift" vers le haut. On change de catégorie de base pour ce domaine conceptuel. Il est très. possible que dans un domaine professionnel qu'on ne connaît pas bien on change la catégorie de base. Alors là où on aurait dit "menuisier", on va dire "ouvrier" et on aura une catégorie de base différente de la catégorie de base qui, elle, par contre, sera la catégorie de base de toute une autre partie de la population. Donc je dirais qu'il y a cette possibilité de sous-utiliser la capacité, mais qui ne remet pas en cause la capacité. L'autre solution, c'est par l'acquisition culturelle. Là, par contre, on "schift" vers le bas ; c'est-à-dire que la catégorie de base descend vers le bas, et que maintenant les catégories de base sont des catégories qui se trouvent au ni veau de l'espèce et non plus au niveau du genus. Donc à mon avis, avec une théorie de ce type, on rend très bien compte de l'hétérogénéité des catégories socio-professionnelles et des variations que l'on constate qui pourraient la remettre en cause. - Quel est ton argument pour dire que les professions sont au niveau noyau ? Michel de FORNEL L'argument, c'est que pour moi il est évident, enfin évident entre guillemets, qu'il existe bien un niveau de base, et qu'ensuite il existe un niveau super-ordonné et un niveau sous-ordonné. Or, s'il existe bien un niveau de base, alors on est commis à dire qu'on souscrit à une forme de monde primaire, puisque c'est le domaine de la catégorisation. On n'est pas dans un processus méta-cognitif. - Où est la spécialisation pour les professions ? Michel de FORNEL Disons que c'est l'argument que je te proposerais, mais il s'articule quand même à un deuxième. Qui est, qu'il me semble qu'on peut remettre en cause, en tout cas se poser un certain nombre de questions sur l'hypothèse selon laquelle il y aurait une différence entre - et ça rejoint un peu ce que dit Patrick là-dessus - un niveau primaire ou intuitif et puis un niveau méta-cognitif. Non pas au sens où il n'y aurait pas un niveau de second ordre, et un niveau primaire, mais effectivement" un peu comme le disait Patrick, au sens où je ne vois pas en quoi il est contradictoire d'avoir un ni veau primaire et que ce niveau primaire soit déjà disons informé par de la théorie de second ordre. Et je trouve qu'il y a déjà dans la littérature de très bons arguments pour ça. Je vais juste t'en donner un parce que ce serait un peu long. Prenons les enfants avec les termes d'espèces naturelles. Beaucoup de tests ont été faits, où on leur montre des espèces naturelles vivantes et on fait des changements, en particulier des changements dans l'apparence. Donc on commence à enlever un certain nombre d'attributs, et on veut savoir à quel moment l'enfant transforme petit à petit le tigre en un lion. Ou on l'habille différemment. On enlève les plumes à la dinde, etc. Et l'idée c'est que si l'enfant avait une vision catégorielle binaire reposant sur des attributs prototypiques, il devrait "schifter" immédiatement. Il devait dire: "ce n'est plus une dinde, c'est un poulet. Ce n'est plus un zèbre, c'est un cheval", etc. Mais on s'aperçoit que non, parce qu'en fait les enfants appliquent aussi une sorte de théorie naïve biologique, qui est que ce n'est pas seulement l'apparence qui compte, mais en quelque sorte il y a une espèce d'évolution curieusement ils ont déjà une sorte de théorie naïve. L'argument sur l'existence d'une théorie naïve biologique demande à .être discuté. Mais en tout cas elle n'est pas si improbable que ça. Je ferais exactement la même argumentation pour une sociologie naïve. Le fait qu'on ait des catégories professionnelles à un niveau primaire doit être lié au fait qu'on a aussi des éléments de théorie sociale à un niveau peut-être je dirais naïf, sans que ce soit un terme péjoratif, ceci n'implique pas en fait une thèse sur le méta-cognitif, que je ne trouve pas du tout évidente. Je ne développe pas ce point et je me contente de conclure sur ce qu'a dit mon voisin, qui a donné un argument tout à fait classique dans la littérature. En gros un argument cri tique sur la folk psychologie et qui peut être assez proche aussi de l'argument cri tique sur l'existence d'une sociologie naïve. Soit on voit la folk psychologie comme étant une théorie spéculative, primitive, qui a existé à un moment donné, mais qui s'est révélée fausse parce qu'il y a eu des théories scientifiques qui se sont développées. Et en fait, depuis longtemps, les gens devraient les avoir abandonnées, mais on les garde pour des raisons bizarres. Si on développe ça, une folk psychologie n'a pas réellement de statut, de même pour une sociologie naïve. Mais le lien avec une physique naïve me semble tout à fait justifié. C'est-à-dire qu'il y aurait une sociologie naïve, comme une physique naïve, qui nous permettrait d'avoir, en termes de compétences, une intervention sur le milieu, même si ça doit être modifié, même si c'est plein d'erreurs, même si c'est incomplet. En définitive, ça reste vital pour l'organisme physique et pour l'organisme social. Donc, en fait, une physique naïve n'est pas une fausse physique et, une sociologie naïve n'est pas une fausse sociologie, mais ce n'est par pour autant la même chose. Bernard CONEIN Je vais juste répondre sur le fond de l'argument de Michel, qui m'intéresse évidemment beaucoup, puisqu'il est au coeur du problème. Il Y a une chose que je ne comprends pas dans ton argument. J'accepte tout à fait tes deux objections parce qu'elles portent sur ma démonstration. Tu dis que les constats qu'on peut faire sur l'hétérogénéité des jugements en ce qui concerne les taxinomies professionnelles n'impliquent pas qu'il n'existerait un niveau basique. C'est ta première remarque. Et puis tu fais une deuxième remarque sur le fait qu'il peut y avoir des processus méta-cognitifs qui interviennent sur le niveau fondamental. Il y a d'ailleurs un bon argument, celui qui concerne la psychologie folk, la psychologie du sens commun puisque la psychologie du sens commun par excellence est méta-cognitive dans la mesure où elle porte sur les croyances et les intentions. Donc effectivement c'est un bon argument. Il peut y avoir des processus méta-cognitifs, d'ailleurs même chez Sperber ce point est essentiel, puisqu'il dit que la faculté de communication dépend de l'existence de cette psychologie naïve. Si on ne pouvait pas faire des opérations méta-cognitives on ne pourrait pas communiquer verbalement. Seulement ces deux objections, que je trouve tout à fait valables, ne suffisent pas pour prétendre qu'il existe, à propos des professions, un domaine de spécialisations particulières. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des niveaux hiérarchiques pour les professions n'implique pas que les professions constituent un domaine conceptuel spécialisé comme la parenté, par exemple. Le fait que la méta-cognition peut intervenir ou même qu'il n'existe pas de distinction nette entre connaissance empirique et méta-cognition, ce ne sont pas des arguments suffisants. Ce qui me manquerait pour les professions, c'est de trouver des choses, pour l'ethnie ou la parenté, ou pour les artefacts: un principe conceptuel qui serait propre au sémantisme des professions ou à la conceptualisation des professions. A propos de la perception, tu dis qu'il Y a une différence entre voir un être humain, un organisme humain dans l'environnement, isolé, et voir que c'est un homme ou une femme, qu'il est jeune ou qu'il est vieux ou qu'il appartient à telle ethnie, et la possibilité de faire une catégorisation professionnelle, s'il est isolé dans l'environnement. Cet organisme humain, s'il se trouve en train de travailler dans une boulangerie, et en train soit de vendre une baguette ou de pétrir de la pâte, je peux dire que c'est un boulanger. Tu vois que dans les deux cas la catégorisation perceptuelle n'est pas du tout la même. Dans le premier cas, tu fais une identification directement par interaction avec l'objet. Dans le deuxième cas, tu fais tout à fait autre chose. Tu fais des raisonnements perceptuels à base de concepts fonctionnels, de propriétés fonctionnelles et relationnelles. Evidemment tu peux tirer des raisonnements perceptuels sur la base de ton boulanger s'il est dans sa boulangerie. Ça, c'est évident. Mais tu ne peux pas en conclure qu'il y a sémantisme des professions. Michel de FORNEL Je n' aime pas l'idée de noyau. Parlons simplement de savoir primaire. Dans le savoir primaire, tu peux avoir ton niveau de base, tes catégories super-ordonnées et sous-ordonnées, tout ça doit faire partie de ton savoir primaire. (Débat sur les professions, dans la cognition sociale). Pierre ACHARD La discussion me semble appeler une séparation de deux problèmes. Le premier c'est de dire qu'il y a une démarche catégorisante qui a un certain nombre de propriétés formelles qu'on peut dégager et qui sont générales. A savoir si elles sont universelles, valables pour toutes les sociétés, c'est un autre problème, mais ça pourrait se défendre. Par contre, il semble qu'il reste une différence quand on fait intervenir des contenus et la différence ce n'est peutêtre pas tellement de savoir si les choses sont perceptibles ou non, parce que ça ne me paraît pas très important. Mais c'est plutôt quand on oppose la sociologie naïve et la physique naïve et qu'on se demande à quoi elles servent. Dans les deux cas, les savoirs naïfs sont peut-être vrais, peut-être faux, peut-être approximatifs, peut-être vrais compte tenu d'une finalisation particulière et d'une organisation sociale, mais en tout cas ils interviennent dans la gestion du monde. Ils servent, d'un certain point de vue, à appréhender des objets, à les gérer, à se débrouiller avec. La différence, me semble-t-il, entre la sociologie naïve et la physique naïve, c'est que la gestion des objets physiques ne fait pas partie de la physique, même naïve. Par contre, la gestion des rapports sociaux, ce à quoi sert la sociologie naïve, s'intègre bien aux rapports sociaux et en fait partie de façon essentielle. Je pense que c'est là qu'on a une différence assez essentielle entre les domaines cognitifs de type sociaux et les domaines cognitifs de type naturels. La physique naïve intègre la connaissance et l'expérience que j'ai du monde physique qui m'entoure, c'est-à-dire que si j'ai une idée de haut ou de bas c'est parce qu'il y a la pesanteur, c'est parce que c'est plus difficile de monter un objet que de le redescendre. Si je pense que la terre est plate, c'est parce que je sais bien que si je fais un certain nombre d'opérations je pourrai construire en équilibre, sinon ça se cassera la figure. Et puis je peux savoir à la fois qu'elle est plate et qu'elle ronde : je peux savoir qu'elle est plate mais que l'horizon est rond. C'est lié à des pratiques, à des opérations de perception sensuelle, de perception technique, socialisée également. La physique reste un extérieur et la conception que j'ai de la physique ne change pas la réalité des objets physiques. Patrick PHARO La conception que tu aurais des objets sociaux en changerait la réalité ? Pierre ACHARD Bien sûr. Si je considère que les nègres sont des imbéciles et que je les traite comme des imbéciles, j'établis un rapport social. Patrick PHARO Si tu considères que les nègres sont des imbéciles, tu es toi-même un imbécile, mais tu ne changes rien à la réalité des nègres. Il y a des réalités sociales. Un viol, c'est un viol ; un suicide, c'est un suicide ; un lynchage, c'est un lynchage. On ne peut pas le traiter au ni veau des sensibles physiques, c'est évident, mais il y a bien une sensibilité propre de l'objet. Est-ce que tu n'as pas une résistance de l' objet social à ton travail d'interprétation ? - Dans la mesure où il y a une certaine conception du social qui catégorise les agents du social, les agents du social doivent d'une certaine façon se conformer. Et de cette façon de s'y conformer, il y a un caractère auto-vérificateur des classifications sociales. Quelqu'un est ouvrier. Il y a peut-être des critères objectifs, mais il l'est surtout, parce qu'il existe, un phénomène social de classement. - Tu as ces mêmes auto-vérifications complètement fausses avec les croyances physiques, à savoir que tu peux vérifier dans une société que la terre plate, que tu as une coupole au dessus de la tête. - L'essentiel entre la sociologie naïve et la physique naïve, c'est que la physique naïve est quand même contrainte par la réalité. - Ce n'est pas du tout ça. J'ai dit que la physique naïve n'était pas en tant que discours une partie de son objet. Par contre, la sociologie naïve est bien une partie de l'objet que sont des rapports sociaux. - Une question de compréhension. Quand tu parles de perceptuel, de quelle perception s'agit-il ? De celui qui perçoit, de l'observateur ? J'ai évolué dans ma façon de comprendre ce qui était dit de ces percepts primitifs, au gré de la discussion, et maintenant je ne sais plus de quoi on parle. Bernard CONEIN Par exemple, quand je disais tout à l'heure que la catégorisation n'est pas seulement un phénomène linguistique, ça impliquait que ce soit en particulier un phénomène lié à la perception. Mais pas à la perception en général. C'est à une perception de haut niveau, parce qu'il y a les phénomènes de perception de bas niveau qui ne sont pas liés à la catégorisation. C'est donc l'idée qu'un des ancrages de la catégorisation, c'est la possibilité d'identifier, de reconnaître un objet et, ça, quelle que soit la position de l'observateur. Je reprends une distinction a Don Zimmerman quand il critique le texte de Goffman à propos des stéréotypes sexuels dans l'image publicitaire, entre le fait de catégoriser quelqu'un comme une femme et de construire un stéréotype sexuel de femme. Kaufman a une position à peu près analogue à celle de Bourdieu: je vois une femme et il y a un stéréotype immédiatement. La question est d'ailleurs tout à fait discutable. Je ne veux pas dire qu'elle est réglée. Hirchsfeld, sur la race, a l'air de dire qu'à partir du moment où je passe de noir comme nègre à blanc comme européen, je passe automatiquement à l'attitude raciale. L'acquisition du passage de la couleur à l'ethnie se ferait en même temps que l'attitude raciale. Mais dans un cas comme dans l'autre, la perception est liée au jugement. C'est la connaissance ordinaire du social. Il n'y a pas de distinction entre l'expert et le novice. Ceci dit, ces phénomènes sont compliqués. L'exemple de Michel de Fornel n'est pas un exemple de catégorisation perceptuelle, mais un exemple de catégorisation à base de raisonnements référentiels à partir de la perception. Effectivement, à partir de la perception, on peut faire des raisonnements, identifier quelque chose parce que tel élément dans l'environnement me permet de dire: "cet objet qui est là", sans voir la personne, par exemple, au vu de son chandail. Bernard GARDIN C'est une question de vocabulaire que vous posez là. Je suis gêné par savoir naïf et savoir scientifique. Pour moi, de savoir que la terre est ronde ou la terre est plate, ce n'est pas plus scientifique d'un côté que de l'autre. D'ailleurs "la terre est plate", est un pléonasme. Qu'est-ce' qu'on appelle plat ? C'est bien ce qui est comme ça par terre. Il me semble qu'il y a une différence entre savoir et activité scientifique, ce qui n'est pas pareil. Si je dois aller quelque part, je mobilise un certain nombre de savoirs. Je ne fais pas de la science. Par contre, quand je fais de la science supposons qu'on en fasse, là - . Qu'est-ce qu'on fait ? On discute sur les concepts, on a des attitudes méta, on a une activité. On mobilise par ailleurs certains autres savoirs, mais on n'a aucune activité sur ces autres savoirs. La distinction savoir scientifique, savoir naïf, me gêne. C'est plutôt une question du mode, du rapport que l'on a à ces savoirs. Ou on les utilise pour quelque chose ou on réfléchit dessus. Jean WIDMER Je voudrais demander à Michel s'il répondait à la question de Josiane lorsqu'elle demandait quelle était la forme de structuration des catégories. Il me semble que tu l'as abordé par "genre et espèce". Michel de FORNEL Le fait que l'on n'ait pas encore développé des choses très détaillées dans ce domaine ne signifie pas qu'a priori ce n'est pas faisable. Je voudrais conclure sur le percept. Il ne faudrait pas qu'on parte avec l'idée que le niveau primaire est un niveau associé au percept, et que le niveau de second ordre qui fait intervenir le raisonnement n'est pas lié au percept. Quand on passe à un ni veau sous-ordonné, donc à un niveau des espèces, des variétés, il est clair qu'au contraire il y a un travail perceptuel. Pour savoir que c'est une pomme reinette du Canada, etc., il est clair que le raisonnement doit se faire en utilisant des propriétés perceptuelles beaucoup plus fines. Donc il ne faudrait pas croire que parce qu 1 on raisonne à un niveau différent dans lequel apparaît un cognitif beaucoup plus complexe, qu'on a quitté le domaine de la perception. Le domaine de la perception est un critère qui joue à un certain niveau dans la théorie, mais ce n'est pas, par ailleurs, un critère général.