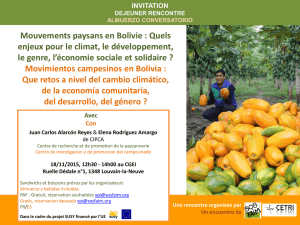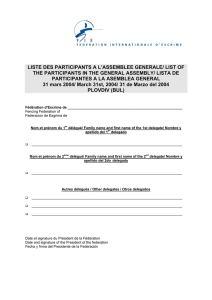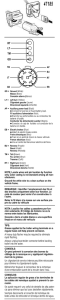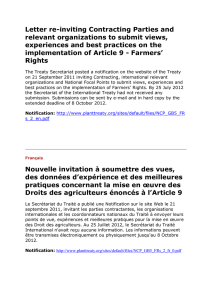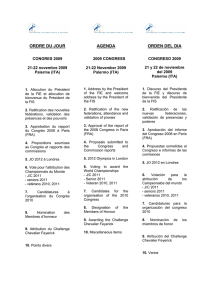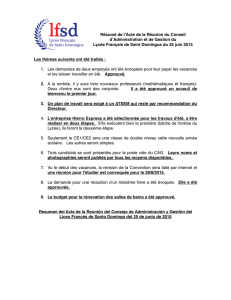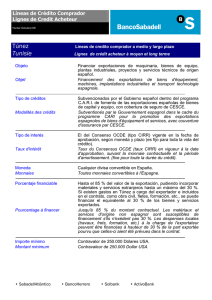Beatriz GOMEZ GUTIERREZ - Université Paris
Anuncio
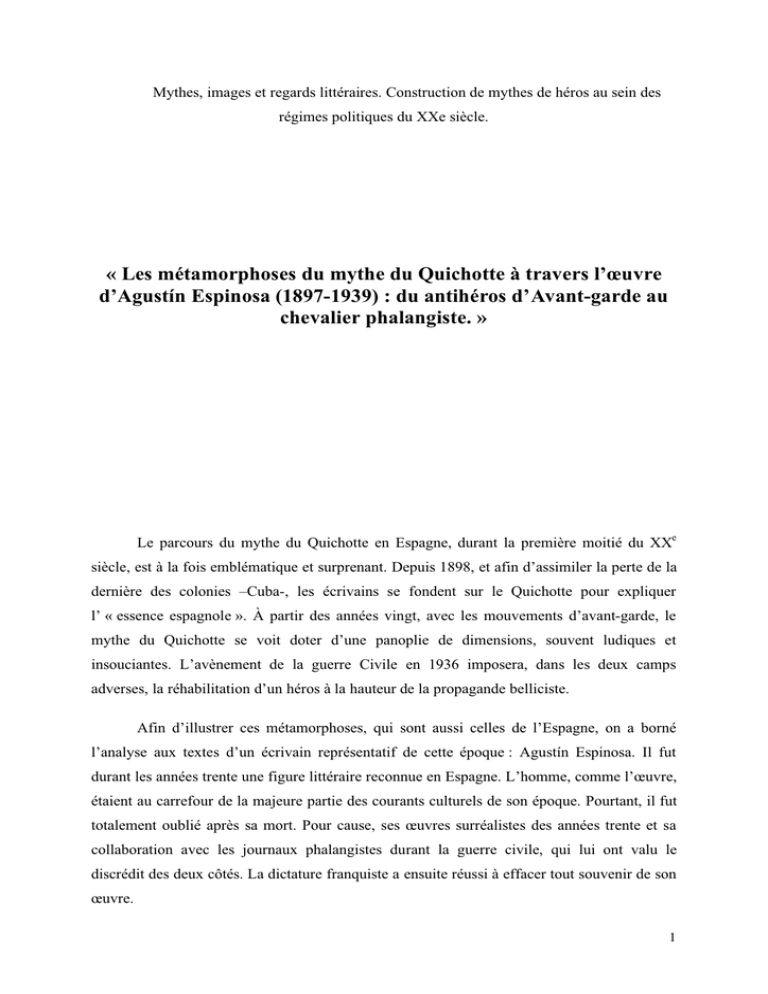
Mythes, images et regards littéraires. Construction de mythes de héros au sein des régimes politiques du XXe siècle. « Les métamorphoses du mythe du Quichotte à travers l’œuvre d’Agustín Espinosa (1897-1939) : du antihéros d’Avant-garde au chevalier phalangiste. » Le parcours du mythe du Quichotte en Espagne, durant la première moitié du XXe siècle, est à la fois emblématique et surprenant. Depuis 1898, et afin d’assimiler la perte de la dernière des colonies –Cuba-, les écrivains se fondent sur le Quichotte pour expliquer l’ « essence espagnole ». À partir des années vingt, avec les mouvements d’avant-garde, le mythe du Quichotte se voit doter d’une panoplie de dimensions, souvent ludiques et insouciantes. L’avènement de la guerre Civile en 1936 imposera, dans les deux camps adverses, la réhabilitation d’un héros à la hauteur de la propagande belliciste. Afin d’illustrer ces métamorphoses, qui sont aussi celles de l’Espagne, on a borné l’analyse aux textes d’un écrivain représentatif de cette époque : Agustín Espinosa. Il fut durant les années trente une figure littéraire reconnue en Espagne. L’homme, comme l’œuvre, étaient au carrefour de la majeure partie des courants culturels de son époque. Pourtant, il fut totalement oublié après sa mort. Pour cause, ses œuvres surréalistes des années trente et sa collaboration avec les journaux phalangistes durant la guerre civile, qui lui ont valu le discrédit des deux côtés. La dictature franquiste a ensuite réussi à effacer tout souvenir de son œuvre. 1 Agustín Espinosa. Agustín Espinosa est né aux Îles Canaries en 1897, au sein d’une famille bourgeoise. À vingt ans, il quitte les îles pour faire des études de Lettres à Grenade et à Madrid. Après avoir obtenu son doctorat en 1924, il séjourne en France, en Angleterre et en Roumanie. C’est à Paris qu’il fait la connaissance du groupe surréaliste, probablement introduit par son ami, le peintre Óscar Domínguez, baptisé par André Breton : « le dragonnier des Canaries ». Devenu Professeur agrégé de Littérature Espagnole aux Îles Canaries, il y mènera une infatigable activité culturelle. Outre ses collaborations journalistiques, il publie notamment deux œuvres : en 1929 et sous l’influence des Avant-gardes, Lancelot 27º-8º1-titre relatif aux coordonnées de l’île de Lanzarote, où il a été muté pendant un an- et Crimen, 2 en 1934, qui devient un texte essentiel du mouvement surréaliste, traduit en français par Gérard de Cortanze en 1989. Par ailleurs, de 1932 à 1936, Espinosa participe à l’un des événements les plus importants de l’Histoire culturelle des Avant-gardes : la publication aux Canaries de Gaceta de arte, revue à l’origine de la deuxième Exposition Internationale Surréaliste, qui eut lieu à Ténériffe en 1935. La guerre civile éclate en 1936 et Espinosa se voit relevé de son poste d’enseignant à cause de son roman Crimen, qui avait déjà été dénoncé par l’extrême droite sous la Seconde République, du fait de son « obscénité sacrilège ». Sans travail, Espinosa décide de collaborer avec les journaux phalangistes. Ses articles seront publiés jusqu’à sa mort, en 1939, peu avant la fin de la Guerre Civile. Le mythe « épineux » d’Espinosa. Il est désormais nécessaire de préciser un terme que l’utilisation abusive a pratiquement vidé de son sens. Comme il arrive souvent aux termes clefs qui configurent une civilisation, lorsque l’on se propose de définir le « mythe », on est confronté à un vaste panorama d’acceptions à travers les époques. Or, on traitera ici du mythe d’après les théories 1 2 A. ESPINOSA, Lancelot 28°-7° [Guía integral de una isla atlántica], éd. ALFA, Madrid, 1929. A. ESPINOSA, éd. de Gaceta de Arte, Las Palmas de Gran Canaria, 1934. 2 de la Mythocritique. Celle-ci s’occupe de l’analyse littéraire des mythes, afin de distinguer leur pouvoir symbolique, autre que sa véracité ou son caractère sacré. La mythocritique fait la différence entre deux catégories de mythes: les « mythes littérarisés » –repris par des textes littéraires- et les « mythes littéraires » –qui relèvent uniquement de la littérature- comme c’est le cas pour Don Quichotte.3 Le Quichotte d’avant-garde. La génération de 98 s’était focalisée sur la figure du Quichotte pour retrouver l’identité espagnole après la perte de l’empire. Or, la croissance économique des années vingt permet aux intellectuels de s’approprier la figure du Quichotte depuis une perspective plus universelle et moins dramatique. À l’époque, les deux représentations du mythe coexistent encore. Miguel de Unamuno, par exemple, exilé en 1924 aux Îles Canaries,4 projette un livre intitulé Don Quichotte à Fuerteventura.5 Les articles qu’Unamuno publie dans les journaux argentins pendant son exil expriment ses visions du Quichotte : 3 Par ailleurs, l’acception du terme « mythe » dans les dictionnaires publiés par P. BRUNEL a évolué considérablement au cours des années. Le Dictionnaire des mythes littéraires, dont la première édition remonte à 1988 (« Préface », éd. du Rocher, Paris, 1988), contredit la théorie de R. BARTHES selon laquelle le mythe est partout dans nos sociétés bourgeoises. Une décennie plus tard, dans le Dictionnaire des mythes d’aujourd’hui (« Avant-propos, éd. du Rocher, Paris, 1989), P. BRUNEL élargit de manière évidente la dimension qu’il avait précédemment attribuée au terme « mythe » et il s’oriente vers une conception du « mythe » en accord avec BARTHES. Enfin, le Dictionnaire des mythes féminins (« Avant-propos », éd. du Rocher, Paris, 2002) se veut asystématique, sans étiquette et sans idéologie et tente de réaliser la synthèse entre les mythes anciens du premier dictionnaire et les mythes d’aujourd’hui du second. 4 Du fait de sa dissidence avec la dictature de Miguel Primo de Rivera, 5 M. DE UNAMUNO, De Fuerteventura a París. Diario íntimo de confinamiento y destierro vertido en sonetos, « A don Ramón Castañeyra, de Puerto Cabras, en la isla canaria de Fuerteventura », éd. Excelsior, Paris, 1925, pp. 7-11. Toutes les traductions sont désormais de mon fait : « Y haré aquel libro de que le hablé y que se titulará Don Quijote en Fuerteventura, Don Quijote en camello a modo de Clavileño. ». 3 Platon a inventé, créé, mais non pas découvert l’Atlantide, et Don Quichotte a inventé, créé, il n’a pas découvert pour Sancho, l’île de Barataria. Et j’espère […] inventer, créer et non pas découvrir l’île de Fuerteventura. […] Et j’entends le rire, le terrible rire inquisitorial, le sarcasme tragique de l’envie, de pure souche, qui persécuta Don Quichotte durant sa pérégrination.6 Espinosa réinvente les mythes espagnols en les incluant, comme Unamuno, dans des nouveaux scénarios : Unamuno avait projeté d’inventer le Quichotte à l’île de Fuerteventura, Espinosa accomplira ce dessein en le transposant sur l’île de Lanzarote. En 1927,7 date symbolique des avant-gardes espagnoles, Espinosa aborde le mythe du Quichotte dans Lancelot. Cette œuvre se veut d’un genre nouveau qui tiendrait du guide touristique, réinventant l’île de Lanzarote à travers Lancelot. Ce dernier est accompagné d’autres personnages littéraires, qui deviennent des mythes de ce nouvel olympe insulaire : Lancelot, héros de la grande chevalerie bretonne ; […] maître d’Amadís et de Don Quichotte. […] Le Moyen Âge, époque d’exaltation du héros terrien, ressent Alexandre et oublie Ulysse. (Don Quichotte est probablement un héros de la mer. De là ses défaites d’aventurier dans les terres d’Espagne. Il part à Barcelone à la recherche de la mer […] qu’il n’atteindra jamais).8 Ce texte illustre l’une des méthodes les plus chères à Espinosa : une catégorisation des héros en deux tipes : le héros marin et le héros terrien.9 Pénétré de l’esprit de l’absurde des avant-gardes, Espinosa parvient à justifier à travers cette classification, l’inattendu : Don Quichotte, héros du plateau Castillan, serait en réalité un héros marin. C’est une manière subtile de constater l’échec vital d’un héros de la mer, mais qui ne la voit pourtant qu’à 6 M. DE UNAMUNO, Opus cit, article « Atlántida », pp. 61-63, publié dans Caras y caretas, Buenos Aires, le 7 mai 1924. Il fut à l’origine publié sous le titre « Divagaciones de un confinado ». Citation extraite de la p. 62 : « Platón inventó, creó, no descubrió, la Atlántida, y Don Quijote inventó, creó, no descubrió, para Sancho, la Ínsula Barataria. Y yo espero por la intercesión de Platón y de Don Quijote, o con la ayuda de ambos, inventar, crear y no descubrir la isla de Fuerteventura.[…] Y oigo la risa, la terrible risa inquisitorial, la burla trágica de la envidia, castiza, que persiguió a Don Quijote durante su peregrinación […]. » 7 Dans l’œuvre d’Espinosa, la première allusion au Quichotte apparaît en 1923 dans un sonnet intitulé « Du Retour ». Dès le premier vers, Espinosa compare Don Quichotte à la figure du poète : il croit fermement à une princesse Dulcinée et il voit des géants au lieu de moulins. 8 A. ESPINOSA, Lancelot 28º-7º, quatrième édition, editorial Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1988, pp. 10 (« Lancelot y Lanzarote ») et 35 (« Biología del viento de Lanzarote »): « Lancelot: héroe de la gran caballeresca bretona; […] maestro de Amadís y de Don Quijote. […] La Edad Media, época de exaltación del héroe térrico, siente a Alexandre y olvida a Odiseo. (Don Quijote es probablemente un héroe de mar. De aquí sus derrotas de aventurero por tierras de España. Va a Barcelona a la busca del mar […] que nunca alcanza.) » 9 Probablement influencé par l’œuvre de son mentor A. VALBUENA PRAT, Historia de la poesía canaria, Universidad de Barcelona, Seminario de Estudios Hispánicos, Barcelona, 1937. Selon ce dernier il y aurait aux Canaries une poésie marine et une autre terrestre. 4 l’approche de sa mort.10 Cinq ans plus tard, Espinosa se montre moins rêveur. À partir de son installation définitive aux Canaries en 1932, ses chroniques journalistiques deviennent plus sombres et radicales. En ce qui concerne le mythe du Quichotte, décrit en 1927 comme un tendre héros marin, Espinosa l’utilise désormais pour justifier ses propos bellicistes : Elle n’est pas laide, la guerre, chez Napoléon. […] Chez César. […] Chez Alexandre. […] Réjouissons-nous aujourd’hui […] avec Amadís de rêves héroïques dans des Bretagnes dorées. Il adviendra le temps de pleurer, avec Don Quichotte, veilles de défaites, à la Manche.11 Ces propos relèvent du contexte troublé de la Seconde République, dont Espinosa n’est pas un ardent défenseur. Certes, l’idéologie belliciste attirait à l’époque certains intellectuels vers la puissance des fascismes, en opposition à l’attitude « faible », selon eux, des démocraties. Cette idélogie annonce les textes phalangistes d’Espinosa. Le Quichotte phalangiste. Le mythe de la droite est, comme le définit Roland Barthes, l’essence même de sa nature, fondée systématiquement sur une immobilité qui vise à éterniser sa hiérarchie : « […] le mythe est à droite. Là, il est essentiel : bien nourri, luisant, expansif, bavard, il s’invente sans cesse ».12 Chez Espinosa, les avant-gardes et le phalangisme ont une même expression basée sur le recours aux mythes. D’après Barthes, ces deux mouvements sont issus d’un fragment de la bourgeoisie pour lutter contre la bourgeoisie. Ensuite, ils sont récupérés par cette même 10 Depuis la Renaissance, la mort est représentée dans la tradition littéraire espagnole par la mer à partir les Strophes à la mort de mon père de Jorge Manrique. Ce dernier est d’ailleurs décrit par Espinosa comme un « triste chevalier espagnol » « Yo veo en Jorge Manrique el arquetipo del caballero triste español, representado a medias por Calisto –La Celestina-, y que no acaban de cumplir ni Garcilaso, ni Béquer ni Juan Ramón Jiménez ». A. ESPINOSA, « Jorge Manrique », mai, 1931. Textos inéditos y no recogidos en volumen, p. 688 : 11 A. ESPINOSA, « Carta semanal a Lolina. Estética de lo bélico : la fea película Sin novedad en el frente » La Provincia, 13 mars, 1932. Textos, pp. 137-139 : « No es fea la guerra en Napoleón. […]en César […] en Alejandro […] Regocijémonos hoy […] con Amadís de sueños heroicos en áureas Bretañas. Que tiempo habrá mañana de llorar, con don Quijote, vigilias de fracaso, en La Mancha. ». 12 R, BARTHES, Mythologies, « Le mythe, à droite », éd. du Seuil, Paris, 1957, p. 223. 5 bourgeoisie, qui les utilise pour arriver à ses fins.13 À ce propos, le mouvement de « Falange Española » représente, selon José Carlos Mainer et au-delà d’un jugement politique, la plus puissante formulation d’avant-garde en Espagne de 1930 à 1940 : Phalange Espagnole fût […] la formulation la plus attirante et la plus violente d’une révolte latente depuis longue date ; ce fut en grande partie une vocation juvénile très pure qui, malgré la dette bourgeoise qui l’a opprimé et qui a finit par la dissoudre, proposa une contestation primordiale contre l’aspect le plus caduque de la droite contemporaine.14 Le mouvement phalangiste15 débute officiellement en Espagne en 1933 sous l’égide de José Antonio Primo de Rivera.16 Aristocrate raffiné, il a développé une idéologie élitiste, conservatrice et catholique. Son style, idéaliste et romantique. Les caractéristiques qui distinguent le phalangisme des autres fascismes sont dues en partie au contexte économique. Alors que le krach de 1929 a fait gagner des adeptes aux mouvements nationalistes et autoritaires, le phalangisme surgit en Espagne à contre-courant : le pays est à l’époque au sommet de la démocratie grâce à la Seconde République.17 En ce qui concerne le rapport du phalangisme au franquisme, il faut signaler le schisme qui se produit entre eux à partir du Décret du 19 avril 1937, qui assignait le pouvoir absolu au Général Franco. Tous les généraux qui s’étaient soulevés avaient trouvé la mort dans des conditions suspectes. Ensuite, les phalangistes qui ont refusé d’être assimilés au 13 Idem, p. 213 : « Il y a sans doute des révoltes contre l’idéologie bourgeoise. C’est ce qu’on appelle en général l’avant-garde. Mais ces révoltes sont socialement limitées, elles restent récupérables. D’abord parce qu’elles proviennent d’un fragment même de la bourgeoisie […]. Et puis, ces révoltes s’inspirent toujours d’une distinction très forte entre le bourgeois étique et le bourgeois politique : ce que l’avant-garde conteste, c’est le bourgeois en art, en morale […]. Ce que l’avant-garde ne tolère pas dans la bourgeoisie, c’est son langage, non son statut. » 14 J. C. MAINER, Falange y literatura, éd. Labor, Barcelona, 1971, p. 13. La traduction est de mon fait : “Falange Española fue en los años que repasaremos la formulación más atractiva y violenta de una rebeldía que se venía larvando de tiempo atrás; en gran medida, fue una vocación juvenil muy pura que, pese a la hipoteca burguesa que lastró y acabó por disolverla, planteó una primordial protesta contra lo más caduco del derechismo contemporáneo.” 15 Quatre particularités distinguent le mouvement espagnol du national-socialisme allemand et du fascio italien : son caractère aristocratique et élitiste, le rapport à l’université de ses idéologues, le conservatisme de ses idées et son catholicisme, vecteur idéologique essentiel. 16 S. G. PAYNE, Franco y José Antonio, el extraño caso del fascismo español : historia de la Falange y del movimiento nacional (1923-1977), éd. Planeta, Barcelona, 1998, p. 160: « José Antonio publicó sus primeros artículos políticos durante los años 1931-1932 en el diario La Nación. » Le premier meeting politique a lieu au Théâtre de la Comédie le 29 octobre 1933 à Madrid. Dans un style rhétorique, idéaliste et romantique, ce discours, émis par la radio à l’échelle nationale, marquera le ton phalangiste des premiers temps. Voir S. G. PAYNE, p. 174. 17 S. G. PAYNE, Franco y José Antonio, el extraño caso del fascismo español : historia de la Falange y del movimiento nacional (1923-1977), éd. Planeta, Barcelona, 1998, p. 113, Payne précise que la récession européenne atteint son paroxysme en 1931. 6 franquisme ont été pourchassées et condamnés à l’exil ou, pire, à la mort.18 Agustín Espinosa consacrera au mythe du Quichotte une critique littéraire en 1938. Il le fait à l’occasion de la journée du livre, qui a lieu en Espagne le 23 avril, date de la mort de Miguel de Cervantes.19 Ce texte, resté inédit à l’époque, a été retrouvé parmi ces brouillons après la mort de Franco, lors des premières recherches sur Espinosa. On pourrait attribuer sa non publication au fait qu’il décrit le Quichotte comme un national-syndicaliste de la « Falange », sans ajouter le nouveau adjectif « Traditionaliste », exigé par le franquisme. Ce petit essai d’une douzaine de pages, entreprend la critique acerbe d’un livre qu’Américo Castro, républicain exilé qui fut professeur d’Espinosa,20 avait consacré à la figure de Cervantes. Espinosa prétend que l’essai de son ancien professeur est un manifeste politique de gauche, et se propose avec son article de gagner la figure du Quichotte à la cause phalangiste. Même si l’on peut difficilement imaginer que ce personnage, maladroit et vaincu, 18 Le phalangiste Manuel Hedilla par exemple, celui qui aurait pu être désigné à la place de Franco et qui refuse de signer le Décret, fut exilé aux Îles Baléares après avoir passé plusieurs années dans une prison des Canaries., Il faut également rappeler que l’un des mouvements étudiants opposés au régime de Franco à la fin de sa dictature fut le FES –« Frente de Estudiantes Sindicalistas »- devenu par la suite le FE(I) –« Falange Española Independiente »-, dont l’un des plus importants activistes, qui se réclamaient les héritiers directs de José Antonio, fût José María Aznar. 19 La rédaction de l’article correspondrait à une date précédant le 23 avril 1937 ou 1938. Mais il faut aussi tenir compte du fait que le 23 avril 1938, Espinosa écrit –même s’il ne le signe pas- un autre article dans Falange intitulé “La Fiesta del Libro”. 20 A. CASTRO Y QUESADA, 1885-1972, coordinateur du Centre d’Études Hispaniques en 1910 où Espinosa prépare sa thèse de doctorat de 1923 à 1924. Espinosa fait probablement allusion à l’œuvre d’A. CASTRO El pensamiento de Cervantes, publiée en 1925 : « Este problema ha sido planteado ya por el citado Profesor Castro en su “Pensamiento de Cervantes” y por Legendre en su “Litterature espagnole”[sic] », A. ESPINOSA, opus cit., « Fiesta del libro ». M. LEGENDRE, (1878-1955) intellectuel catholique et hispaniste français, directeur de la « Casa de Velázquez » à Madrid de 1949 à 1955. Castro fut professeur d’Espinosa au Centre d’Études Historiques, institution née en 1910 sous le gouvernement de Canalejas. Le Centre est devenu une école puissante destinée aux élites intellectuelles du pays. Parmi elles, le charismatique Ernesto Giménez Caballero, fondateur de la revue La Gaceta literaria, demeure sans doute l’un des esprits les plus dynamiques et extravagants de la génération de 27. Giménez Caballero, futur adepte de la Phalange espagnole, influencera la pensée d’Espinosa à cette époque de manière définitive. Or, la première approche de Giménez Caballero20 au mythe du Quichotte ne laisse pas songer au futur Quichotte phalangiste. De même qu’Ortega y Gasset avait exprimé dans Espagne invertébrée (publiée périodiquement dans le journal El Sol en 1921). son pessimisme, Caballero se résigne à l’époque au fatalisme sur la situation insoluble de l’Espagne. Selon lui, par exemple, du fait de l’expulsion des juifs en 1492 ou de leur situation périphérique en Europe, les espagnols ne pourront jamais atteindre la suprématie du fascio de Mussolini. Il signale d’ailleurs la divergence essentielle entre les littératures italienne et espagnole : tandis que Dante crée un idéal, une Divine comédie, pour son peuple, Cervantes prépare son pays à l’échec à travers l’ironie et l’amertume du Quichotte. Pourtant, Don Quichotte, comme le Cid, deviendra, sous l’influence des positionnements phalangistes, un symbole de la nouvelle Espagne impériale. Icône des avant-gardes dix ans plus tôt, antihéros polyédrique d’un style dont l’esthétique était la seule finalité, il incarnera pendant la guerre l’unité absolue de l’empire –Espagnol- et de la foi –catholique. Les phalangistes se sont inspirés de l’imaginaire littéraire de Castille pour se fabriquer une mythologie sur mesure: « La literatura falangista repetía los temas y la imaginería castellanos de la historiografía y el nacionalismo español modernos, lo que ofrecía al movimiento un vocabulario de exaltación mística, sacrificio y violencia, misión nacional y revolución, una mezcla que en ocasiones resultó realmente embriagadora para la juventud », S. G. PAYNE, Franco y José Antonio, el extraño caso del fascismo español : historia de la Falange y del movimiento nacional (1923-1977), éd. Planeta, Barcelona, 1998, p. 241. 7 puisse représenter convenablement un symbole guerrier espagnol, Espinosa transforme Don Quichotte en modèle phalangiste à l’aide d’un topos de la renaissance : armes + lettres = chevalier espagnol : Quelles ont été toutes nos meilleures épopées, nos gloires les plus larges, sinon des aventures –des géniales aventures- d’Alonso Quijano le Bon ? […] et son désir d’amour, de pain et de justice, […] n’est-il pas aussi ce désir intense qui est le nôtre, ce grand désir d’une Espagne sous le signe du National-Syndicalisme ?21 Espinosa explique ensuite22 comment Goya avait fait du Quichotte le protagoniste d’un de ses géniaux cauchemars,23 et le Quichotte du XIXe siècle devient une figure tragique et sans espoir. Loin de ces prototypes, il transforme le Quichotte en héros phalangiste. Il s’inspire d’abord de son héros marin de 192724 et le situe dans une Castille « dévertébrée », comme l’Espagne qu’avait décrit Ortega y Gasset en 1921 :25 En Don Quichotte […] il faut surtout voir ce destin impérial, brisé au XVIIe siècle […]. Don Quichotte lutte contre la mesquinerie, contre la bassesse et le manque de foi de ces Espagnols qui durant le XVIe précipitèrent notre « dévertébration »,26 comme luttait et continue de lutter la Phalange. […] Don Quichotte cherche la mer à travers Castille ; la mer de l’empire espagnol, la mer des destins hispaniques –l’Espagne est une île- […].27 Dans le texte d’Espinosa, transparaît une réalité inavouable : l’Espagne est une île, un paradoxe gênant après l’exaltation marine du début. Comment savoir si Espinosa évoque l’Espagne de la guerre civile comme une île paradisiaque ou comme une île « maudite » ? Certes, les deux imaginaires sont inscrits dans la mythologie occidentale, mais il semblerait que les îles merveilleuses de 1927, comme Lancelot, ne le soient plus en 1938. Castro avait voulu démontrer la pensée contre-réformiste de Cervantes, Espinosa, lui, 21 Idem. : «¿Qué han sido todas nuestras mejores epopeyas, nuestras glorias más anchas, sino aventuras – geniales aventuras- de Alonso Quijano el Bueno? […] ¿Y aquel su afán de amor, de pan y de justicia, por los [sic] sufrió y luchó, no es también este fuerte afán nuestro, este gran afán de España bajo el signo del NacionalSindicalismo?» 22 D’après l’oeuvre de F. A. de ICAZA, El Quijote durante tres siglos, éd. Fontanet, Madrid, 1918. 23 F. de GOYA, « El Quijote y sus monstruos » sans date, autour de 1780, Bibliothèque Nationale d’Espagne, inventorié sous le numéro 33.146. « El sueño de la razón produce monstruos » fait partie de la série Los caprichos, de 1799. 24 A. ESPINOSA, Lancelot 28º-7º, quatrième édition, editorial Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1988, pp. 10 (« Lancelot y Lanzarote ») et 35 (« Biología del viento de Lanzarote »). 25 Ibid . supra, note 21. 26 Néologisme d’Espinosa qui ajoute au terme la notion d’« involution », qui n’est pas concevable dans le monde zoologique. 27 A. ESPINOSA, opus cit., « Fiesta del libro »: « En don Quijote […] hay que ver, sobre todo, este destino imperial, quebrado en el siglo 17 […] Lucha Don Quijote contra la mezquindad, contra la ruindad y contra la falta de fe de aquellos españoles del seiscientos que precipitaron nuestra desvertebración, como luchó y sigue luchando la Falange. […] Busca Don Quijote a través de Castilla el mar; el mar del Imperio Español, el mar de los destinos hispanos –España es una isla. […] » 8 cherche à rebaptiser Cervantes dans la foi catholique. Pour ce faire,28 Espinosa développe son analyse à partir des hypothèses de Castro sur l’honneur et l’hypocrisie chez Cervantes et son indulgence envers la femme adultère. Le plus étonnant survient quand Espinosa contredit ce dernier point. Castro affirme que Cervantes est trop indulgent dans son œuvre à l’égard des femmes mariées de force qui commettent l’adultère. Ceci irait à l’encontre de sa pensée humaniste, qui dénonce l’hypocrisie du mariage de convenance. Espinosa affirme que, pire que l’adultère, il y a la violence de ceux qui obligent une femme à se marier contre son gré. Or, il ajoute que le péché le plus grave est, sans doute, celui de la femme qui ment à Dieu sur l’autel. À cette misogynie, s’ajoute à la fin de l’essai, l’antisémitisme. En effet, Castro justifie dans son livre l’intolérance du Quichotte envers les Juifs en la considérant comme une représentation du sentiment de l’époque et non comme la pensée de Cervantes. Selon Espinosa l’antisémitisme du Quichotte est, au contraire, une manifestation de sa profonde catholicité : Au fond, le Quichotte est, sans en arriver à des exagérations ultra fanatiques, l’expression fidèle de la croyance du catholique moyen du Siècle d’Or. Dans le Quichotte il y a non seulement une morale robuste, une joie saine, un culte du bon sens et de la raison, qui est l’un des postulats du catholicisme, mais aussi, et surtout, une source vivante de méditation sur la réalité.29 Espinosa affirme que le Quichotte n’est pas uniquement le portrait de l’Espagnol moyen du Siècle d’Or, mais qu’il est aussi le symbole d’un sens moral sans failles où l’antisémitisme relèverait du postulat. Après cela Espinosa termine son essai sans sur un ton mystérieux qui laisse le lecteur perplexe : 28 Le procédé d’analyse religieuse avait déjà été employé auparavant dans le conflit du « problème espagnol » ou l’« être de l’Espagne », débat intellectuel sur l’identité espagnole qui s’amorce avec le mouvement Régénérateur à la fin du XIXe siècle en même temps que l’éclosion des nationalismes périphériques et la perte des derniers territoires de l’Empire. Ce débat avait opposé depuis la fin du XIXe siècle krausistes et réactionnaires. Parmi ces derniers, Marcelino Menéndez y Pelayo publie de 1880 à 1882, une étude colossale intitulée Historia de los heterodoxos españoles, où il identifie sans ambiguïté l’essence espagnole au catholicisme orthodoxe. Américo Castro, krausiste convaincu, avait refusé cette thèse à l’époque. Espinosa adhère dans cet essai aux méthodes de Menéndez y Pelayo pour démontrer « l’être phalangiste », essentiellement espagnol, du Quichotte et de son auteur. 29 Idem. : « En el fondo, el Quijote es, sin llevarlo a exageraciones ultrafanáticas, la expresión fiel de la creencia del católico medio del siglo de oro. No solamente hay en el Quijote una robusta moral, una sana alegría, una culto del buen sentido y de la razón, que es uno de los postulados del catolicismo, sino que hay también, y sobre todo, una fuente viva de meditación sobre la realidad. » 9 Don Quichotte n’est pas simplement […] un personnage burlesque, il fait montre d’un haut niveau critique : la critique des apparences, et il pose […] ce problème fondamental de la philosophie : où est la Vérité ?30 Conclusion. L’analyse de ces textes permet le constat de deux phénomènes intéressants liés à la représentation du Quichotte chez Espinosa. Au début de sa carrière, Espinosa s’intéresse davantage au mythe de Lancelot qu’à celui du Quichotte. Certes, le héros d’avant-garde est moins présent que le phalangiste. Pourtant, on constate une continuité esthétique entre les avant-gardes et le phalangisme dans la représentation des mythes, comme dans les fascismes allemand et italien.31 En effet, on a vu comment Espinosa approfondit dans son essai phalangiste l’image du Quichotte marin des avant-gardes. Par ailleurs, Espinosa, qui n’est pas enclin dans ses articles phalangistes à la désignation de boucs émissaires, critique de manière exceptionnelle l’idéologie de Castro. Si, depuis ses débuts, Espinosa revendiquait dans ces articles une culture nationale au service de la patrie, il essaie de démontrer ici que Don Quichotte, au-delà du phalangisme ou du catholicisme, est surtout un héros espagnol. Héritier de la génération de 98, Espinosa se propose juste de révéler une de ces « Vérités » qu’il évoquait à la fin de son article : une « Vérité » cette fois mythologique. 30 Idem.: « Don Quijote, que no es simplemente […] un personaje burlesco, nos enseña una alta clase de crítica: la Crítica de las apariencias, y plantea […] este problema fundamental de la Filosofía, ¿Dónde está la Verdad?» 31 Les appareils d’État fascistes s’inspirent ainsi des héros du Moyen-âge, le Cid en Espagne ou Siegfried en Allemagne, pour reconstruire un idéal mythique d’honneur patriotique. M. ALBERT, Vanguardistas de camisa azul, éd. Visor, Madrid, 2003, p. 340: « De modo parecido a los románticos en los tiempos de los Estados nacionales, se busca el renacer de Europa, esta vez bajo el signo del fascismo, en la Edad Media, aquella época en que la confraternidad de los dos pueblos había encontrado expresión en sus héroes épicos Sigfredo y el Cid.» 10