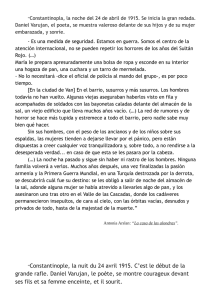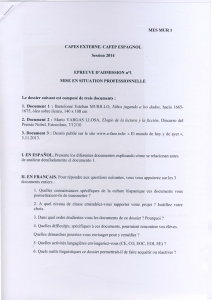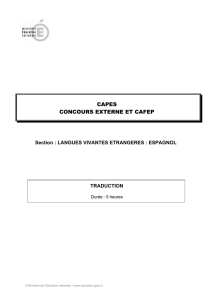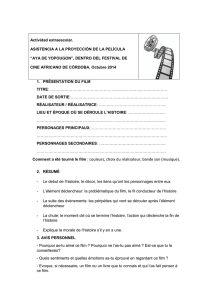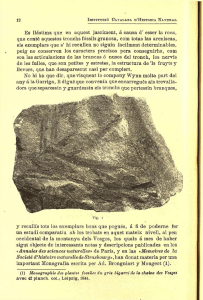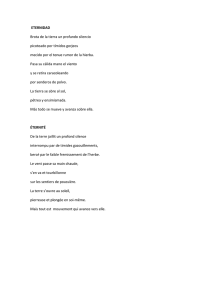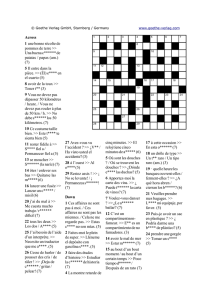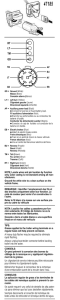(D)écrire La Havane : les représentations de la ville dans
Anuncio
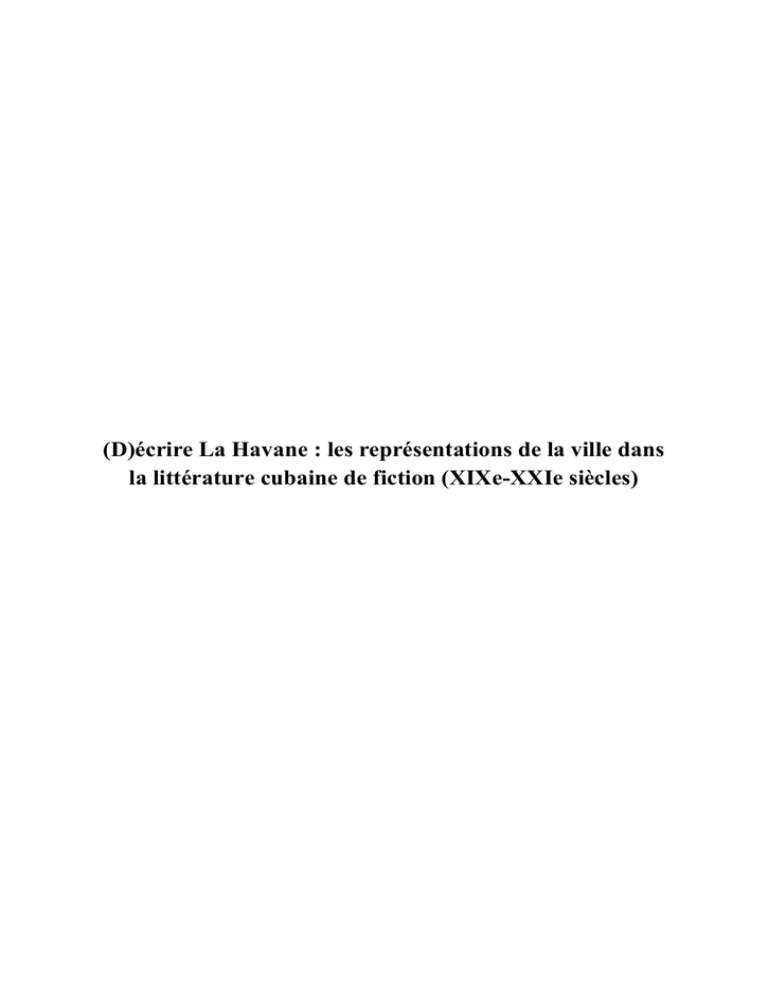
(D)écrire La Havane : les représentations de la ville dans la littérature cubaine de fiction (XIXe-XXIe siècles) (D)ÉCRIRE LA HAVANE : LES REPRÉSENTATIONS DE LA VILLE DANS LA LITTÉRATURE CUBAINE DE FICTION (XIXe-XXIe SIÈCLES) Cette étude a pour ambition d‟analyser les descriptions littéraires de La Havane dans la diachronie. Il s‟agit d‟appréhender la ville comme une entité narrative à part entière, dans les nouvelles et les romans cubains du XIXème siècle à nos jours. Occupant une place privilégiée dans la littérature nationale, la capitale cubaine s‟est chargée de représentations et de fonctions multiples qui ont évolué au fil des décennies, variant selon les points de vue esthétiques ou les partis pris descriptifs. Notre projet consiste à mettre en évidence les différentes manières d‟appréhender l‟espace urbain dans notre corpus mais aussi d‟établir des ponts entre les époques pour ainsi faire dialoguer les œuvres entre elles. En étudiant les caractéristiques de La Havane littérarisée, nous prétendons assembler les différentes pièces d‟un puzzle encore en construction afin de dresser le portrait kaléidoscopique d‟une ville devenue espace littéraire. Envisagée comme un cadre référentiel renvoyant à une réalité géographique et socio-historique précise, la cité mise en fiction est aussi un espace symbolique fortement connoté. En tant qu‟objet d‟écriture, elle est également un espace poétique qui, en se détachant complètement de son référent réel, fait naître de multiples imaginaires urbains. Mots-clés : Ville, La Havane, espace urbain, littérature cubaine, représentations littéraires, descriptions, fictions, Cuba. WRITING HAVANA : REPRESENTATIONS OF THE CITY IN CUBAN FICTION Ŕ 19th TO 21st CENTURIES The object of this study is to present a diachronic analysis of the descriptions of Havana in Cuban literature. We have defined the city‟s status as a narrative object among Cuban novels and short stories from the 19th century to the present day. Central to the national literature, the Cuban capital city had gradually been endowed with multiple functions and representations, which vary depending on the aesthetic viewpoints or descriptive stances adopted by different authors. Our project consists not only in analysing the ever-changing physiognomy of this particular urban landscape within the scope of our corpus, but also in drawing bridges between different eras in order to outline the dialectic dynamics which exist between these stories. By paying close attention to the characteristics of literary Havana, we have begun assembling the pieces of a puzzle that is still in the making, thus reflecting the kaleidoscopic image of a city which has become a literary landscape. Used as the frame of reference for a precise geographical and socio-historical reality, the Havana of Cuban fictions also bears a strong and complex symbolic quality. As the object of these writings, it is also a poetic space which, by detaching itself from its actual referent, creates a multiplicity of imaginary urban landscapes. Keywords : town/city, Havana, urban landscapes, Cuban literature, literary representations, descriptions, fiction, Cuba . Remerciements En premier lieu, je tiens à dire toute ma gratitude à ma directrice de thèse, Madame le Professeur Françoise Moulin Civil, grâce à qui j‟ai pu mener à bien ce travail. Ses conseils éclairés, sa patience, ses encouragements et la confiance qu‟elle m‟a accordée ont été d‟une aide précieuse. Je souhaite également la remercier pour son entière disponibilité malgré ses fonctions de Présidente d‟Université puis de Rectrice d‟Académie. J‟aimerais remercier les membres du jury, Gustavo Guerrero, Michèle Guicharnaud-Tollis, Sandra Hernández et Renée Clémentine Lucien qui ont accepté d‟évaluer ce travail. Je remercie également l‟Université de Cergy-Pontoise, l‟École Doctorale de Droit et Sciences Humaines, le Laboratoire de recherche « Civilisations et Identités Culturelles Comparées des sociétés européennes et occidentales » (CICC) ainsi que la Société des Hispanistes Français (SHF) pour leur soutien financier qui m‟a permis d‟approfondir mes recherches à Cuba. J‟ai beaucoup appris des séminaires du GRIAHAL et je souhaiterais témoigner ici ma gratitude aux membres de ce groupe de recherche qui, grâce à leurs conseils stimulants et à leur bienveillance permanente, m‟ont ouvert de nombreuses perspectives d‟étude. Lors de mes séjours à Cuba, j‟ai reçu l‟aide décisive de plusieurs professeurs, chercheurs, intellectuels et écrivains. Je remercie particulièrement Luisa Campuzano sans qui je n‟aurais jamais eu accès à certains ouvrages. Son dévouement et sa générosité ont grandement facilité mes recherches à La Havane. Je remercie également, pour leur disponibilité et leurs conseils avisés, Ambrosio Fornet, Emmanuel Tornés, Zaida Capote Cruz, Jorge Fornet et Ariel Camejo. Mes remerciements vont aussi au personnel dévoué de la Bibliothèque Nationale José Martí et à celui de la Bibliothèque de la Casa de las Américas car ils m‟ont accueillie chaleureusement et ont tout fait pour rendre mon travail plus aisé. Tout au long de ces années de recherche, de nombreuses personnes m‟ont soutenue, encouragée et aidée. Pour leurs conseils, leur bienveillance et le temps qu‟ils ont consacré à la 5 relecture de ce travail, je tiens à remercier tout particulièrement Janice Argaillot, Caroline Bertrand, Joséphine Marie et Luis Pérez. Enfin, je ne saurais exclure de cette liste mes amis proches, ma famille et Fabrice, qui ont toujours été à mes côtés. 6 Sommaire REMERCIEMENTS____________________________________________________ 5 SOMMAIRE__________________________________________________________ 7 INTRODUCTION_____________________________________________________ 9 CHAPITRE LIMINAIRE________________________________________________ 22 PREMIÈRE PARTIE. UN ESPACE RÉFÉRENTIEL________________________ 28 Chapitre 1 Réalisme et réalité___________________________________________ 28 1. Chroniques, articles costumbristas et littérature au XIXème siècle____________ 28 2. « Novelas de costumbres » et fiction littéraire____________________________ 32 Chapitre 2 Une référentialité topographique fluctuante_____________________ 37 1. Traitement de l‟espace dans les romans du XIXème siècle_________________ 37 2. Les descriptions urbaines au XXème siècle_____________________________ 44 Chapitre 3 Des lieux et des espaces ______________________________________ 64 1. De quels quartiers parle-t-on ?________________________________________ 64 2. Des microcosmes__________________________________________________ 71 3. Des « allégories du territoire »________________________________________ 84 4. L‟espace ou la création d‟un territoire__________________________________ 112 Chapitre 4 L’espace-temps_____________________________________________ 125 1. Le théâtre de l‟Histoire______________________________________________ 125 2. L‟espace social____________________________________________________ 152 3. Du symbole collectif aux particularismes________________________________167 DEUXIÈME PARTIE. L’ESPACE URBAIN : UNE UNITÉ SYMBOLIQUE_____ 178 Chapitre 1 Le paradis urbain___________________________________________ 178 1. Espace de vie_____________________________________________________ 178 2. La construction du paradis___________________________________________ 199 Chapitre 2 Le purgatoire_______________________________________________ 242 1. La scène des péchés________________________________________________ 242 2. Le châtiment______________________________________________________ 269 Chapitre 3 1. L’enfer havanais____________________________________________ 279 Composition de l‟enfer______________________________________________ 279 7 2. Un univers sans foi ni loi____________________________________________ 290 3. Un espace aliénant_________________________________________________ 296 4. Des dérives aux hétérotopies : autres pratiques spatiales : __________________ 315 TROISIÈME PARTIE. DE L’ESPACE AU PAYSAGE : POÉTIQUES DE LA VILLE________________________________________________________________ 330 Chapitre 1 Des paysages urbains________________________________________ 330 1. De l‟espace au paysage _____________________________________________ 330 2. La ville comme paysage de l‟âme_____________________________________ 332 3. Un espace affectif__________________________________________________ 338 Chapitre 2 Les écritures du paysage_____________________________________ 341 1. La ville représentée_________________________________________________ 341 2. Une ville faite de mots______________________________________________ 355 Chapitre 3 Transfiguration et évanescence de la ville_______________________ 414 1. La ville remémorée : un espace transfiguré______________________________ 414 2. Inventions et évanescence de la ville___________________________________ 420 CONCLUSION_________________________________________________________ 439 ANNEXES_____________________________________________________________ 448 BIBLIOGRAPHIE______________________________________________________ 464 INDEX DES AUTEURS CITÉS___________________________________________ 487 INDEX DES ŒUVRES CITÉES _________________________________________ 493 TABLE DES MATIÈRES________________________________________________ 498 8 Introduction L‟espace urbain est une thématique de premier ordre dans la littérature actuelle, à telle enseigne que la ville apparaît souvent comme un personnage de plus au sein de la fiction. S‟il est vrai que de nombreux récits contemporains ont fait, et font toujours, la part belle aux représentations du monde citadin, force est de constater que ce phénomène n‟est pas nouveau. Il apparaissait déjà dans des œuvres antérieures, de facture plus classique1. Le terme « roman urbain » est, d‟ailleurs, utilisé depuis le XIXème siècle (1830) pour distinguer les récits de la ville de ceux qui thématisent le monde rural. Une opposition nette entre les deux univers Ŕ l‟urbain et le non-urbain Ŕ se fait alors jour. Qu‟elle soulève une certaine répulsion ou, au contraire, qu‟elle inspire de la fascination, la ville s‟inscrit toujours dans un rapport antagonique vis-à-vis de la campagne. Cela semble d‟ailleurs s‟accentuer durant la première moitié du XXème siècle, lorsque les écrivains observent la croissance des villes et les changements qui s‟ensuivent. La littérature met effectivement en mots les bouleversements socio-économiques qui modifient la physionomie des cités (expansion du territoire citadin, accroissement démographique dû à l‟exode rural, modernité des infrastructures, essor de l‟urbanisme, ségrégation spatiale, fragmentation qui oppose le centre à la périphérie, etc.). A cet égard, les villes latino-américaines ne font pas exception. Elles connaissent un processus de transformation et de modernisation aussi rapide qu‟irréversible : Desde 1880 muchas ciudades latinoamericanas comenzaron a experimentar nuevos cambios, esta vez no sólo en su estructura social sino también en su fisonomía. Creció y se diversificó su población, se multiplicó su actividad, se modificó el paisaje urbano y se alteraron las tradicionales costumbres y las maneras de pensar de los distintos grupos de las sociedades urbanas. Ellas mismas tuvieron la sensación de la magnitud del cambio que promovían, embriagadas por el vértigo de lo que se llamaba el progreso, y los viajeros europeos se sorprendían de esas transformaciones que hacían irreconocible una ciudad en veinte años.2 Les habitants des métropoles observent les changements économiques, physiques et sociaux qui transforment le monde urbain. Il n‟est donc pas étonnant de voir que la ville fait irruption dans les récits de fiction latino-américains, surtout à partir des années vingt. En témoins de 1 Nous pensons, par exemple, au Londres de Dickens ou encore au Paris de Balzac ou Zola. José Luis Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas (1976), Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2008, p. 247. 2 9 leur époque, certains écrivains vont placer l‟univers citadin au cœur de leurs textes, à une époque où le roman rural (« la novela de la tierra ») fait toujours florès3. Citons, à titre d‟exemple, les œuvres de Roberto Arlt qui marquent le début du roman urbain en Argentine : El juguete rabioso (1926), Los siete locos (1929) ou encore Los lanzallamas (1931). A la même époque, la ville de Mexico apparaît aussi en littérature, dans la prose de Mariano Azuela. L‟auteur de Los de abajo a effectivement placé la capitale mexicaine au cœur de certaines de ses fictions (La Malhora [1923], El desquite [1925], La luciérnaga [1932], El camarada Pantoja [1937], Nueva burguesía [1940] et La marchanta [1944]). A partir des années cinquante, soixante, les récits urbains se développent très largement en Amérique latine. Fernando Aínsa explique ainsi : De México a Argentina, la « espiral abierta » de la narrativa hispanoamericana encuentra en las grandes urbes Ŕ el Distrito Federal, Bogotá, Caracas, Lima, La Habana, Santiago o Buenos Aires Ŕ un escenario propicio para hacer de la complejidad que reivindica su mejor expresión. Una serie de autores que irrumpen en los años sesenta lo hace con un regodeo que se solaza en la creatividad, sin olvidar las tensiones sociales y la violencia que cubre el asfalto ciudadano […]. 4 Parmi ces auteurs, le critique cite, entre autres, Manuel Mejía Vallejo, qui décrit Bogota dans Al pie de la ciudad (1958) ; Salvador Garmendia qui évoque Caracas (Los pequeños seres [1959], Los habitantes [1961], Día de ceniza [1963], La mala vida [1968]) ; le Péruvien Julio Ramón Ribeyro qui dépeint la ville de Lima (Los gallinazos sin pluma [1955], Las botellas y los hombres [1964]) ou encore Jorge Edwards qui traite de la capitale chilienne (Gente de la ciudad [1962], Las máscaras [1967]). Cette liste non exhaustive montre que la mise en fiction du monde citadin s‟inscrit dans une aire géographique large et qu‟elle recouvre des réalités très diverses. Qu‟ont à voir la métropole mexicaine de La región más transparente (1958), de Carlos Fuentes, et La Havane de El acoso (1956), d‟Alejo Carpentier, ou celle de Lezama Lima, dans Paradiso (1966) ? Même si elle renvoie à des référents bien distincts, la littérature urbaine qui se développe tout au long du XXème siècle participe, très souvent, au processus d‟identification nationale. A l‟instar des romans ruraux latino-américains, qui se développèrent à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, les récits de la ville 3 Alejo Carpentier explique ainsi le succès de ces récits ruraux : « Acaso, por lo difícil de la tarea, prefirieron nuestros novelistas, durante años, pintar montañas y llanos. Pero pintar montañas o llanos es más fácil que revelar una ciudad y establecer sus relaciones posibles […] », Alejo Carpentier, Tientos y diferencias (1964), Barcelone, Plaza & Janés Editores, 1987, p. 14. 4 Fernando Aínsa, Narrativa hispanoamericana del siglo XX Ŕ Del espacio vivido al espacio del texto, Zaragosse, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, p. 81. 10 vont eux aussi caractériser un pays puisque, par synecdoque, la cité représentée illustre fréquemment la nation tout entière. De ce point de vue, le traitement littéraire de la capitale cubaine est éloquent. Nous verrons que La Havane a très tôt symbolisé l‟Île tout entière. De plus, bien avant l‟indépendance de Cuba, la ville, en tant qu‟élément fictionnel déterminant, a participé, d‟une certaine manière, à la construction d‟une identité cubaine. Les figures de Cirilo Villaverde et Ramñn Meza, qui ont amplement décrit la ville caribéenne dans leurs romans, en témoignent. Ces deux écrivains majeurs du XIXème siècle sont effectivement les représentants d‟une littérature nationale. Rappelons au passage que les publications de Cecilia Valdés o La Loma del Ángel (1882), de Villaverde, et celle de Carmela (1887), Mi tío el empleado (1887) ou encore Don Aniceto el tendero (1889), de Ramón Meza, se produisent entre 1868 et 1898, c‟est-à-dire, pendant les Guerres d‟Indépendance, quand Cuba souhaite s‟émanciper de la couronne espagnole. Ainsi peut-on envisager la prégnance de la capitale, dans ces romans, comme l‟affirmation d‟une certaine conscience patriotique. L‟importance de La Havane dans la littérature à partir du XIXème siècle s‟explique par des raisons historiques qu‟il convient de rappeler. La situation géographique de l‟Île fait qu‟elle joua un rôle majeur, dès le début de la conquête. Découverte par Colomb lors de son premier voyage, elle constitua une véritable « porte d‟entrée »5 pour les Espagnols qui souhaitaient coloniser le sous-continent et devint un lieu de passage obligé entre les colonies et la métropole. Comme l‟expliquent Anke Birkenmaier et Roberto González Echevarría, « Cuba era el centro del mundo conocido por el occidente, lo cual le confirió a la cultura cubana, y a los cubanos […] la sensaciñn de que eran el centro del universo »6. Tout ce qui arrivait d‟Europe passait par Cuba et par La Havane, en particulier. Tout d‟abord fondée en 1514, sur la côte sud, San Cristóbal de La Habana fut finalement édifiée au nord de l‟île, le 16 novembre 1519. Pendant près de trente ans, elle ne fut qu‟un misérable hameau mais lorsqu‟on se rendit compte que le courant du Golfe (Gulf Stream) raccourcissait considérablement la durée des traversées, le port de La Havane devint le point de ralliement de la flotte espagnole chargée de transporter les richesses des Indes jusqu‟à la péninsule ibérique. C‟est à partir de cette époque que l‟activité économique de la ville se développa. Il 5 Nous reprenons une formule de José Carlos Rovira. Voir : José Carlos Rovira, Ciudad y literatura en América latina, Madrid, Editorial Síntesis, « Géneros y temas », 2005, p. 116. 6 Anke Birkenmaier, Roberto González Echevarría, Cuba : Un siglo de literatura (1902-2002), Madrid, Editorial Colibrí, 2004, p. 10. 11 fallait accueillir et loger les marins, les fonctionnaires et tous les autres passagers venant d‟Espagne. La population augmenta de manière significative : on passa de 700 habitants en 1554, à 4000 en 1590, à environ 10 000 en 16607. La Havane devint progressivement la citéforteresse militaire et portuaire la plus importante de l‟Amérique : elle possédait le plus grand chantier naval, le plus grand arsenal et un système de défense majeur. Ces deux aspects (villeport et ville-caserne) marquèrent profondément et durablement la ville qui devint officiellement la capitale de l‟Île en 1607. Longtemps convoitée par les autres puissances européennes, les Anglais parvinrent à s‟en emparer en 1762 et l‟occupèrent pendant onze mois. Avec ses 50 000 habitants, elle était alors la troisième plus grande ville de toutes les colonies espagnoles. Elle poursuivit un développement spectaculaire tout au long du XVIIIème et du XIXème siècle, grâce, notamment, à une industrie sucrière en pleine expansion. C‟est à cette époque que la nouvelle bourgeoisie fit construire de magnifiques villas entourées de jardins, dans le quartier excentré du Cerro, et qu‟apparurent de nouvelles institutions calquées sur le modèle européen (académies, bibliothèques, théâtres, etc.). Comme de nombreuses grandes villes latino-américaines, La Havane connut un processus de modernisation sans précédent durant la première moitié du XIXème siècle : elle s‟agrandit considérablement et bénéficia d‟une véritable politique urbanistique menée par le Général Tacón, qui dota la cité de nouveaux bâtiments importants et de nouvelles infrastructures (construction de grands axes de circulation, revêtement des routes, édification de théâtres et d‟éléments décoratifs Ŕ fontaines, statues, obélisques Ŕ, etc.). En outre, en 1837, une première ligne de chemin de fer, reliant la capitale à Bejucal, fut inaugurée, avant qu‟un réseau plus dense de lignes ne sillonne le pays. Durant la première moitié du XXème siècle, les changements se poursuivirent car, après les Guerres d‟Indépendance et l‟avènement de la République (1902), La Havane subit l‟influence des Etats-Unis. Elle continua d‟être le centre politique, financier et culturel du pays mais devint parallèlement le « Las Vegas des Caraïbes », un grand casino où fleurissaient prostitution et trafics en tout genre. Le centre historique fut laissé à l‟abandon au profit des quartiers situés plus à l‟ouest, le Vedado et Miramar, où prévalait un style de vie plus anglo-saxon. D‟ailleurs, Batista transféra les bâtiments gouvernementaux dans le Vedado. Lorsque Fidel Castro et les Barbudos8 entrèrent dans la capitale, le 8 janvier 1959, la ville était à cette époque l‟une des cités les plus 7 Nous nous appuyons sur l‟étude faite par Luisa Campuzano. Voir : Luisa Campuzano, « La Habana de los 60 », in Cristina Giorcelli, Camilla Cattarulla, Anna Scacchi (éd.), Città reali e immaginarie del continente americano, Rome, Edizioni Associate Editrice Internazionale, 1998, p. 662. 8 On appelait ainsi les révolutionnaires qui luttaient aux côtés de Fidel Castro, dans la Sierra Maestra, car ils n‟avaient pas l‟occasion de se raser. 12 modernisées de l‟Amérique latine. Un très grand nombre de voitures (dès 1898) et un tramway (depuis 1901) y circulaient et la ville comptait quelques grands buildings modernes parmi les plus hauts du sous-continent (les hôtels Habana Hilton, le Someillán, le Riviera et le Capri ; l‟immeuble Focsa). Avec la Révolution, de nombreux changements survinrent et modifièrent l‟aspect de la ville. C‟est à ce moment-là que La Havane commença à se distinguer des autres grandes villes latino-américaines. Jusqu‟alors, la capitale cubaine avait connu un développement similaire aux autres métropoles du sous-continent. A partir de 1959, elle va suivre une tout autre évolution9. La nationalisation des entreprises et des banques, la fermeture des casinos et des maisons closes, la construction de nombreux logements et la diversification sociale dans certains quartiers (due, en partie, à l‟exil de la bourgeoisie havanaise qui abandonna ses belles demeures cossues) furent quelques-unes des manifestations les plus visibles de ce processus de transformation. De plus, la volonté délibérée de Fidel Castro de réduire l‟hégémonie de La Havane, en développant d‟autres villes, eut pour conséquence la quasi interruption du développement citadin qui avait été jusqu‟alors continu dans la capitale. De sorte que, durant la Révolution, la politique urbanistique se réduisit à quelques constructions, dont certaines d‟influence soviétique, mais guère plus. Malgré le développement des autres villes, la capitale continua d‟attirer un grand nombre de Cubains. Cette forte émigration interne fit que la démographie de La Havane ne cessa d‟augmenter et devint même problématique, notamment lorsqu‟éclata la période spéciale. Au tout début des années quatre-vingt-dix, avec l‟effondrement du bloc soviétique, Cuba perdit son seul allié économique. S‟ensuivit une longue période de crise marquée par un appauvrissement sans précédent et des pénuries généralisées. Pour reprendre une comparaison d‟Ángel Esteban, disons que « la reine des Caraïbes » devint alors un enfer10. La période spéciale en temps de paix laissa des empreintes indélébiles sur la ville et sur la façon d‟appréhender l‟univers urbain en littérature. Toutes ces étapes historiques, à dessein schématiqument brossées, ont ponctué les XIXème et XXème siècles et eurent une incidence indéniable sur la manière de percevoir et d‟écrire la ville. 9 Ángel Esteban explique à ce propos : « […] con la llegada de la Revoluciñn la ciudad inicia una andadura en solitario. Desaparecen los dñlares […], los grandes edificios calculados para el lujo norteamericano se convierten en centros aprovechados por la revolución popular, el mobiliario urbano y los carteles de propaganda sólo exhiben imágenes de los líderes de la revolución y sus consignas […] y la estratificación social adquiere un rumbo uniformador […] », Ángel Esteban, « A las duras y a las paduras : La Habana, cielo e infierno », in Literatura cubana entre el Viejo y el mar, Séville, Editorial Renacimiento, 2006, p. 308. 10 « […] la falta de capital privado […], la lentitud y escasez de las ayudas estatales en la conservaciñn de la arquitectura de la ciudad y el hundimiento del bloque del Este convierten a la reina del Caribe en una antítesis del paraíso que siempre significó », loc. cit. 13 Ainsi, pour en revenir à la littérature, rappelons que l‟irruption de La Havane dans les lettres cubaines devient manifeste avec la publication, en 1882, de ce que l‟on pourrait considérer comme le premier roman urbain cubain : Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, de Villaverde11. Le narrateur y décrit la capitale en pleine mutation du début du XIXème siècle que l‟on vient d‟évoquer (le temps de la narration s‟étend de 1812 à 1831). Avant lui, peu d‟auteurs avaient fait cas de la ville avec autant d‟acuité. Notons à ce propos que la capitale est quasiment absente des écrits littéraires, journalistiques ou scientifiques avant le XIXème siècle. De fait, le naturaliste allemand, Alexander von Humboldt, est le premier à offrir une description détaillée de la ville, dans son Essai politique sur l’île de Cuba (1826)12. Cela dit, il serait faux de dire qu‟aucun écrivain, avant Cirilo Villaverde, n‟a considéré La Havane comme un objet d‟écriture. En témoignent certaines œuvres de Ramñn de Palma (« El cólera en La Habana », 1838), de la Comtesse Merlin (La Havane, 1844) ou encore de Tristán de Jesús Medina (« La nochebuena de 1853 », « El doctor In-Fausto », 1854). Durant la seconde moitié du siècle, cette tendance s‟accentue grâce, notamment, aux récits de Meza et de Villaverde ou encore aux chroniques de Julián del Casal. Au cours du XXème siècle, La Havane occupe une place privilégiée dans la littérature cubaine. Elle devient petit à petit quasiment incontournable. Alejo Carpentier, Lezama Lima et Guillermo Cabrera Infante sont sans doute les figures les plus paradigmatiques de cette littérarisation de la cité caribéenne qui commence dès 1956, avec la publication de El acoso, de Carpentier. C‟est pourquoi, ils occuperont une place de choix dans notre travail. A ce propos, n‟oublions pas que Carpentier considérait qu‟il était du devoir des écrivains latino-américains « d‟inscrire la physionomie de leur ville dans la littérature universelle »13. Il pensait, en effet, que l‟attention portée au monde urbain manquait cruellement dans la littérature hispano-américaine. Plus récemment, à la fin du XXème siècle, les œuvres d‟Abilio Estévez, Antonio José Ponte ou Pedro Juan Gutiérrez, pour ne citer qu‟eux, se sont aussi illustrées par leur richesse descriptive. Car à partir des années quatre-vingt, quatre-vingt-dix, la littérature cubaine est essentiellement urbaine. Comme nous l‟avons dit, la période spéciale marque une rupture dans la façon d‟appréhender l‟univers citadin. Celui-ci devient l‟espace idoine pour mettre en scène la crise économique, 11 Alessandra Riccio envisage cette œuvre comme : « […] un primer y completo acercamiento al espacio urbano como marco de una ficción literaria », Alessandra Riccio, « Palabras para decir La Habana », in Rosalba Campra (corrd.), La selva en el damero. Espacio literario y espacio urbano en América Latina, Pise, Giardini Editori, 1989, p. 63. 12 Notons que les premières descriptions de la plupart des villes latino-américaines viennent des chroniques de voyage d‟auteurs étrangers. 13 Alejo Carpentier, Tientos y diferencias, op. cit., p. 11. C‟est nous qui traduisons. 14 sociale, politique et ontologique qui secoue l‟Île et ses habitants. C‟est d‟ailleurs ainsi que l‟écrivain Luis Manuel García définit la production de cette époque : Una literatura que discurre en el ahora, por momentos el hoy, una literatura urbana, de ambiente básicamente habanero, ciudad donde por nacimiento o adopción reside el grueso de los narradores, y que opera por interferencias, a través de conflictos soterrados bajo la aparente inocuidad de lo cotidiano.14 La ville est donc un espace de choix pour cette littérature du quotidien qui scrute les difficultés journalières des Cubains. En se chargeant de fonctions et de représentations différentes au fil des décennies Ŕ variant selon les points de vue esthétiques ou les partis pris descriptifs Ŕ la ville est donc devenue au fil du temps un élément focalisateur pour de nombreux récits de fiction. Or il nous a semblé que peu de fois elle avait été envisagée, dans les travaux critiques, comme une entité narrative à part entière et que peu de fois elle avait été l‟objet d‟une étude littéraire diachronique. La Havane ne bénéficie effectivement pas d‟études circonstanciées analysant sur plus de deux siècles l‟évolution de ses représentations littéraires. Emma Álvarez-Tabío Albo y a remédié en partie en étudiant les écritures de la ville, de Cirilo Villaverde aux figures de proue du baroque cubain (Carpentier, Lezama Lima et Sarduy). Dans Invención de La Habana15, l‟architecte et essayiste cubaine conjugue une analyse chronologique et thématique afin d‟appréhender la capitale comme un sujet littéraire (une ville-texte). Elle éclaire ses remarques de considérations historiques et architecturales pour expliquer les évolutions du traitement de l‟espace. Cet ouvrage extrêmement riche viendra souvent éclairer nos propos même s‟il n‟embrasse que partiellement notre période d‟étude. Emma Álvarez-Tabío Albo n‟évoque quasiment pas les deux dernières décennies du XXème siècle16. De surcroît, elle se concentre sur les auteurs les plus emblématiques qui ont marqué ces écritures de La Havane. Elle pose, en quelque sorte, les jalons de l‟histoire des représentations urbaines. Notre travail diffère car il recouvre une période plus longue (XIXème-XXIème siècles) en cherchant à multiplier les points de vue sur la cité. Sans prétendre atteindre une exhaustivité qui serait impossible à tenir, nous avons cependant souhaité élargir au maximum notre corpus afin 14 Luis Manuel García, « Crónica de la inocencia perdida. La cuentística cubana contemporánea », in Encuentro de la cultura cubana, n°1, été 1996, Madrid, p. 124. 15 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, Barcelone, Editorial Casiopea, 2000. 16 Elle analyse rapidement El color del verano (1991), de Reinaldo Arenas. 15 d‟évoquer aussi des auteurs ou des textes moins connus mais tout aussi probants pour notre étude. Un ouvrage antérieur à celui d‟Emma Álvarez-Tabío Albo, traitant de la « mise en mots » de la ville caribéenne, mérite également d‟être cité : Novelando La Habana (1990), d‟Ineke Phaf17. Dans cette étude très rigoureuse, l‟universitaire allemande compare trente-sept romans publiés durant la Révolution, de 1959 à 1980, et montre comment La Havane devient un espace politique et idéologique. La trame narrative, les personnages, les quartiers et les lieux décrits, dans chacune des œuvres, sont minutieusement répertoriés. A partir de cet inventaire, Ineke Phaf analyse les changements politiques et sociaux qui transforment la ville. La capitale apparaît donc comme un témoin de l‟Histoire et la littérature comme le prisme rendant compte de ces bouleversements. Notre approche se veut très différente, tout d‟abord, parce qu‟elle traite de l‟évolution de la ville sur une échelle temporelle bien plus large, mais aussi parce qu‟elle ne considère pas uniquement le monde urbain comme le reflet d‟une réalité socio-historique déterminée. Bien sûr, nous envisagerons, nous aussi, les empreintes laissées par l‟Histoire sur les représentations citadines. Il est impossible d‟éluder le temps narré (le fameux « chronotope » de Bakhtine) dès lors que l‟on s‟intéresse à l‟espace, surtout sur une période aussi longue. Nous consacrerons donc une partie de notre travail à l‟histoire tumultueuse du pays qui a marqué ces deux siècles (colonisation espagnole, Guerres d‟Indépendance, République, dictatures, Révolution et, enfin, période spéciale) en envisageant La Havane comme une scène historique et un espace social. Mais les descriptions spatiales donneront lieu aussi à des analyses plus littéraires, tantôt narratologiques, tantôt esthétiques, tantôt philosophiques. Elles seront analysées en tant que signifiants mais aussi en tant que signifiés. Notre appareil théorique variera donc selon les approches choisies. Outre ces deux ouvrages, on dénombre également une série d‟études portant sur les descriptions de La Havane chez des auteurs particuliers. Plusieurs critiques se sont penchés, par exemple, sur les représentations urbaines chez Alejo Carpentier ou Guillermo Cabrera Infante. Les travaux de Yolanda Izquierdo18 sont, de ce point de vue, éclairants et nous y ferons référence à plusieurs reprises. Mais là encore, notre entreprise est différente car elle a pour objectif de confronter les points de vue sur un même objet décrit. En étudiant ces diverses facettes, nous prétendons dresser le portrait kaléidoscopique d‟une ville devenue espace littéraire. 17 Ineke Phaf, Novelando La Habana, Madrid, Editorial Orígenes, 1990. Yolanda Izquierdo, Acoso y ocaso de una ciudad. La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, San Juan, Editorial Isla Negra, 2002. 18 16 Aussi ambitieux soit-il, le projet de travailler sur les représentations de la capitale cubaine en littérature, sur une longue période, s‟est rapidement imposé parce qu‟il nous semblait qu‟une étude aussi large manquait. Pour ce faire, il nous a fallu circonscrire une période bien précise. Pour les raisons précédemment évoquées, le XIXème siècle est apparu comme un point de départ évident : c‟est à ce moment-là que naît une véritable littérature nationale, c‟est une période de grande fertilité littéraire puisqu‟on constate un essor des publications (essai, poésie, prose, théâtre) et, enfin, c‟est au cours de ce siècle que La Havane apparaît comme une scène romanesque, un espace narratif, qui gagne progressivement en importance. Nous avons souhaité étudier les représentations de l‟espace urbain dans la diachronie afin de mettre au jour des évolutions et des ruptures évidentes mais aussi des similitudes. Il nous a donc semblé nécessaire d‟aller jusqu‟à la période spéciale et au-delà des années deux mille19 puisque la ville devient alors, plus que jamais, un objet d‟écriture privilégié tant pour les écrivains vivant à Cuba que pour les exilés. Nous l‟avons dit, à partir des années quatre-vingtdix, les récits sont majoritairement urbains. Notre travail a ainsi pour objet de dégager certaines spécificités descriptives propres à une époque ou à un courant littéraire mais aussi de mettre en lumière certaines constances. Les manières d‟appréhender le monde urbain ne sont parfois pas si différentes au XIXème et au XXème siècle. Mais tendre des ponts entre les époques imposait de délimiter un corpus car, pour des raisons évidentes, nous ne pouvions prétendre à l‟exhaustivité sur plus de deux siècles. Ce fut une des premières difficultés, et non des moindres, liées à notre travail. Quels romans choisir ? Quels récits éliminer ? Comment appréhender un ensemble d‟œuvres aussi vaste qu‟hétérogène ? Comment rassembler des textes forcément disparates, écrits dans des contextes historiques particuliers et dont les intentions idéologiques et esthétiques diffèrent ? Puisqu‟il était impossible d‟envisager toute la production littéraire traitant de La Havane, du XIXème siècle à nos jours, il fallait opérer un choix. Toute œuvre n‟est pas nécessairement bonne à garder dans un corpus déjà très dense et dont la finalité est de dégager certaines grandes tendances. Il n‟était pas pour autant question de se centrer sur une poignée d‟œuvres et de réduire notre analyse à celles-ci car, comme nous l‟avons souligné, il nous semblait important de diversifier les points de vue sur la ville. Dès le début, nous avons écarté la poésie, qui exige une 19 Les romans les plus récents de notre corpus évoquent la ville de la première décennie du XXIème siècle : El todo cotidiano (2011), de Zoé Valdés ; Sangra por la herida (2010), de Mirta Yáñez ; El bailarín ruso de Montecarlo (2010), d‟Abilio Estévez. Notons, par ailleurs, que le dernier récit que nous avons inclus dans notre corpus est un récit de Cabrera Infante, publié à titre posthume en 2013 (Mapa dibujado por un espía). 17 méthodologie propre, pour nous concentrer sur les œuvres en prose, et plus particulièrement sur les récits de fiction (romans et nouvelles essentiellement)20. Nous avons, tout d‟abord, décidé de sélectionner des récits où La Havane était clairement identifiable et qui décrivaient la ville du XIXème siècle à nos jours21. Par ailleurs, nous avons choisi de ne garder que les écrivains cubains (sans distinguer ceux qui s‟étaient exilés de ceux qui sont restés dans l‟Île) car inclure les auteurs étrangers nous aurait conduite sur d‟autres pistes thématiques qui auraient pu nous éloigner de notre propos. Cela étant, analyser la perception qu‟ont les écrivains cubains de leur capitale ne nous empêchera pas d‟évoquer, de temps à autre, ces regards « extérieurs ». Passée cette première difficulté liée à la délimitation du corpus, il restait une autre pierre d‟achoppement : quels extraits choisir parmi la masse de textes réunis ? Notre souci a toujours été de citer des extraits probants qui permettent de faire ressortir les thématiques les plus saillantes, tout en diversifiant nos exemples. Nous nous sommes donc efforcée de ne pas renvoyer toujours aux mêmes œuvres ou aux mêmes auteurs afin de ne pas perdre l‟objectif qui était le nôtre : multiplier les regards sur La Havane. Certains noms et certains romans reviennent, bien sûr, plus que d‟autres et il pouvait difficilement en être autrement puisque tous les récits de notre corpus ne traitent pas de La Havane avec la même intensité et tous ne présentent pas non plus le même intérêt. Dans cette approche globale et diachronique, nous devions aussi envisager divers courants littéraires (costumbrismo, réalisme, naturalisme, baroque) et des genres très différents (récits classiques, policiers, plus ou moins fantastiques, autofiction, autobiographie, etc.). On l‟aura compris, nous avons tâché de donner une vision de la cité cubaine aussi complète que possible tout en essayant d‟éviter l‟effet « catalogue » qu‟une telle étude pouvait générer. En étudiant des extraits isolés, nous nous sommes livrée à une microlecture ou une microanalyse des œuvres. Notre parti pris impliquait forcément une lecture biaisée puisque nous nous centrions uniquement sur les descriptions spatiales. Malgré tout, pour éviter que nos observations ne soient trop parcellaires et pour ne pas perdre la vision globale des récits, 20 Nous avons décidé d‟inclure dans notre corpus le récit épistolaire de la Comtesse Merlin, La Havane, car c‟est un récit de voyage qui se trouve à mi-chemin entre l‟autobiographie, la chronique et le roman. C‟est la seule œuvre du corpus écrite en français puisque l‟auteur était Cubano-Française. Par ailleurs, il nous arrivera aussi de citer quelques extraits tirés d‟essais qui pourront éclairer nos propos. 21 El siglo de las luces, d‟Alejo Carpentier, fait partie de notre corpus même si, dans ce roman, il est question de La Havane du XVIIIème siècle (1789-1808). Dans la mesure, où l‟œuvre illustre le baroque carpentérien et se rapproche d‟autres récits du même auteur, nous ne pouvions en faire l‟économie. 18 nous nous sommes attachée, autant que faire se peut, à contextualiser les passages cités, tout en évitant les digressions inutiles. Quant au corpus critique, il soulevait les mêmes difficultés que le corpus d‟étude. L‟ampleur des œuvres traitées imposait nécessairement une sélection stricte de la littérature secondaire. Nous avons gardé les ouvrages ou les articles portant sur l‟espace mis en fiction, ceux abordant le traitement littéraire de La Havane chez tel ou tel auteur et, enfin, des textes plus généraux de spécialistes de la littérature cubaine qui pouvaient éclairer notre étude. Analyser les descriptions de La Havane dans les fictions écrites entre le XIXème et le XXIème siècle nous a conduite à nous interroger sur les multiples rôles joués par la ville au sein de la diégèse. Nous avons axé notre travail autour de deux grandes lignes : l‟étude de la nature et des fonctions de l‟espace urbain et leur mise en perspective dans la diachronie. Tout au long de ces deux siècles, la représentation de la ville évolue car c‟est l‟histoire même de la littérature qui change. Tantôt décor, tantôt personnage, la cité se charge d‟une fonction énonciatrice et dénonciatrice au sein des œuvres. Les descriptions spatiales désignent autant qu‟elles suggèrent ; elles n‟ont donc pas la même importance narrative. Par ailleurs, nous avons envisagé l‟univers citadin à travers une série de dialectiques : espace fermé/espace ouvert ; espace collectif/espace individuel ; espace social/espace intime ; lieux/territoire22 ; espace contemplé/espace pratiqué (ou vécu) car il s‟agissait de concevoir la ville à travers toutes ses significations et de l‟appréhender comme une unité polyvalente. Nous avons ainsi analysé La Havane mise en fiction selon trois approches distinctes. Nous l‟avons, tout d‟abord, considérée comme un espace référentiel, c‟est-à-dire, un espace repérable, identifiable qui renvoie à une réalité précise et déterminée. Il ne s‟agira pas ici de comparer la cité décrite et le réel car, depuis Aristote, cette question a été évacuée : la description du réel n‟est pas la réalité. En suivant un fil chronologique, nous verrons comment l‟univers urbain est traité au XIXème siècle, depuis les premières descriptions parues dans les chroniques et les journaux de l‟époque, jusqu‟à son apparition dans les romans. Nous constaterons qu‟au XXème siècle, la référentialité topographique est tout aussi fluctuante et qu‟elle ne gagne en densité qu‟à partir de la seconde moitié du siècle. Après avoir envisagé 22 Michel de Certeau établit une distinction entre le lieu, qui se caractérise par son immobilité, et l‟espace (ce que nous appelons le territoire), qui se distingue, au contraire, par le mouvement. Voir : Michel de Certeau, L’invention du quotidien. Tome 1. Arts de faire (1980), 2e éd., Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1990, 2 t.. 19 l‟évolution du traitement spatial en littérature, nous nous centrerons sur les quartiers et les lieux décrits. De quelle Havane parle-t-on dans les récits ? Quels sont les espaces récurrents ? Comment sont traitées les périphéries ? Cette partie mettra au jour certaines constantes entre les siècles et permettra de dégager quelques lieux emblématiques qui symbolisent la capitale cubaine. La ville sera ensuite examinée comme un territoire plus vaste, un espace vécu, parcouru et parfois dominé par le flâneur, car ce sont aussi les pratiques urbaines qui fondent la ville. Enfin, nous considérerons La Havane, en tant que scène historique et carte sociale. Théâtre de l‟Histoire, la cité porte les marques des bouleversements qui ponctuent les deux siècles de notre étude. Elle est aussi un vecteur de discriminations sociales puisqu‟elle sépare géographiquement les classes. Puis, en tant que capitale, elle est un lieu de pouvoir et d‟identification nationale. Elle symbolise le pays tout entier mais a su conserver ses particularismes (langue et mœurs) qui en font un microcosme. Après avoir vu de quel espace nous parlions, il conviendra de voir de quelle façon les écrivains le décrivent. La deuxième approche, plus interprétative, envisagera La Havane comme un espace symbolique. Cette lecture s‟est imposée car l‟espace est fortement connoté et la dichotomie entre le paradis et l‟enfer apparaît très nettement dans notre corpus. Nous nous appuierons donc sur certaines paraboles bibliques pour décrypter ce paysage urbain qui se charge de valeurs morales. Selon le point de vue adopté, la cité peut être tout et son contraire. Elle est tantôt un Eldorado retrouvé ou un paradis perdu, notamment pour les écrivains de l‟exil ; tantôt une nouvelle Babylone, c‟est-à-dire un lieu de débauche et de perversion, qui mérite le châtiment divin, à l‟image de Sodome et Gomorrhe ; tantôt un espace proprement infernal et apocalyptique qui n‟est plus régi par aucune règle morale. La ville devient alors un espace aliénant qui requiert de nouvelles pratiques spatiales (l‟errance, l‟isolement, l‟évasion hétérotopique23). On notera que cette vision pessimiste du monde urbain constitue un cliché littéraire assez répandu. En Amérique latine comme ailleurs, la ville a souvent été décrite comme un lieu hostile et violent, qui pervertit ses habitants. Enfin, dans une troisième partie, nous aborderons les écritures de la ville, autrement dit, les descriptions spatiales en tant qu‟objets poétiques. Il s‟agira de voir, tout d‟abord, comment l‟espace devient paysage, comment il devient un texte littéraire qui s‟affranchit des contraintes réalistes. Contrairement à l‟espace, le paysage est une recréation assumée. Parce qu‟elle est envisagée à travers le prisme de l‟émotion, des sentiments et de l‟expérience 23 Nous nous appuyons sur le concept d‟hétérotopie, de Michel Foucault, que nous définirons plus avant. 20 personnelle, la ville devient le lieu de la subjectivité. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur les manières d‟écrire ce paysage, sur les moyens narratifs employés pour sa construction. La figure stylistique de l‟ekphrasis24 nous permettra de montrer que certaines descriptions transforment la capitale en œuvre d‟art ; l‟hyperbole servira, quant à elle, à souligner la beauté de la ville et à en faire une estampe parfaite. Nous consacrerons ensuite une partie à la « mise en mots » de la ville, c‟est-à-dire aux différentes options d‟écriture qui ont véritablement fondé une Havane littérarisée au XXème siècle. Le baroque cubain de Carpentier et de Lezama occupera ici une place de premier choix car, pour la première fois, deux écrivains transcendent le réel, dans leurs descriptions spatiales. Ils conçoivent, tous deux, une nouvelle manière d‟appréhender l‟espace urbain en dépassant la simple description factuelle. Après eux, Severo Sarduy puis Guillermo Cabrera Infante, qui s‟inscriront comme les représentants du néobaroque cubain, rénoveront à leur tour le traitement descriptif du monde citadin. Qu‟elle soit baroque ou néobaroque, La Havane n‟est en tout cas plus une simple scène au service de la fiction. Elle est un objet d‟écriture à part entière qui, en n‟obéissant plus au principe d‟« effet de réel », devient une pure reconstruction littéraire. Après avoir relevé les spécificités stylistiques de chacun des auteurs mentionnés, nous aborderons une étude thématique qui permettra de dégager certains motifs baroques récurrents au fil des siècles. Nous achèverons cette partie sur la « textualisation » de la cité en étudiant la littérature du désenchantement qui apparaît avec la période spéciale. Quasiment omniprésente dans la littérature cubaine de cette fin de siècle, La Havane en crise est une cité exsangue, à l‟image de sa société. Les ruines urbaines, véritable leitmotiv littéraire, sont décrites à l‟envi pour marquer la déliquescence physique et morale et la fin de l‟utopie. Enfin, notre dernier chapitre approfondira la destruction matérielle de la cité puisque nous aborderons les transfigurations et la disparition progressive de la ville, au profit d‟un espace imaginaire. La littérature réinvente parfois un territoire qui se détache presque complètement de son référent réel. La ville remémorée, imaginée ou rêvée est un paysage fictif qui se substitue à la réalité. Chez certains écrivains, La Havane disparaît même physiquement. Elle se délite petit à petit jusqu‟à être réduite à néant. Elle n‟a plus d‟espace « réel » si ce n‟est celui que lui offre le roman. Autrement dit, la cité n‟est plus qu‟un espace littéraire. Et c‟est sur cette idée que nous terminerons notre travail, en démontrant que la capitale recréée en littérature est le lieu de l‟utopie, un espace sans géographie concrète, qui n‟existe que sous la plume des écrivains. 24 Trope qui consiste à décrire une œuvre d‟art ou à décrire quelque chose à la manière d‟une œuvre d‟art. 21 Chapitre liminaire Les deux siècles que couvre notre corpus nous obligent à considérer des œuvres de style et de genre bien différents. Plusieurs courants littéraires se succèdent, voire se superposent, au fil des décennies qui nous occupent et ont une incidence directe sur les descriptions spatiales. Aussi, pour contextualiser les récits que nous étudions et les inscrire dans une histoire littéraire plus générale, il nous a semblé indispensable de revenir sur les grandes étapes qui ont marqué l‟histoire du roman cubain25. Nous ne prétendons pas dresser ici un panorama historique complet mais simplement poser quelques jalons qui pourront éclairer nos analyses ultérieures. Comme toutes les sociétés coloniales, Cuba n‟a connu une tradition littéraire propre qu‟assez tardivement. La littérature européenne a largement dominé le panorama culturel et son influence a longtemps marqué la production interne. Plusieurs historiens s‟accordent à dater le début de l‟histoire des lettres cubaines à partir de 1790, quand une vie culturelle et intellectuelle commence à voir le jour à Cuba26. Cette année-là, apparaît l‟une des premières publications périodiques de Cuba qui témoigne d‟un processus de formation de conscience nationale et qui fait montre d‟un intérêt certain pour la littérature (Papel Periódico de La Havana). Parallèlement, les activités éducatives, scientifiques et littéraires augmentent à mesure que Cuba cesse d‟être un comptoir et devient une colonie27. A l‟époque, les écrits littéraires sont essentiellement de style néo-classique et pré-romantique et sont des imitations des modèles métropolitains. Le roman cubain apparaît, non sans un franc retard, avec le courant romantique (1830-1840) qui s‟imposera jusqu‟en 1868 environ (date de la première guerre d‟Indépendance)28. Nous en trouvons les prémices dans les récits en prose de Domingo del Monte (« Ella y el mendigo » et « Clementina, o los recuerdos de un gentil hombre »), dans certaines narrations peu connues du poète José María Heredia ou dans les écrits de Betancourt (« Cuadro romántico »). Notons, au passage, qu‟aucune de ces fictions ne se 25 Nous n‟évoquerons pas ici les écrits politiques, les essais ni la production théâtrale et poétique. Avant, 1790, certains soulignent l‟importance de l‟écrivain José Martìn Félix de Arrate (1701-1765) dans la vie intellectuelle et littéraire du pays. 27 D‟après Raimundo Lazo, cette étape a lieu entre 1790 et 1834. Voir : Raimundo Lazo, Historia de la literatura hispanoamericana, El siglo XIX (1780-1914), México, Editorial Porrua, 1970, p. 262. 28 Nous nous appuyons sur la périodisation faite dans José Antonio Portuondo, Historia de la literatura cubana. Tomo I. La Colonia : desde los orígenes hasta 1898 (2002), La Havane, Instituto de Literatura y Lingüística, Editorial Letras cubanas, 2005, p. 99. 26 22 déroule à Cuba, les écrivains préférant garder les descriptions du pays et des mœurs de ses habitants pour des écrits considérés comme moins nobles. Sans être des romanciers, Heredia, José Victoriano Betancourt mais aussi Antonio Bachiller y Morales marquent ainsi les débuts de la narration à Cuba, dès 1830. L‟apparition d‟un certain nombre de revues littéraires 29, à partir de 1837, qui s‟ajoutent aux journaux déjà existants30, permet de renforcer la présence de la narration dans les publications. A la fin des années trente et au début des années quarante, les articles costumbristas31 se multiplient et gagnent en qualité. Citons, à titre d‟exemple, ceux de José Victoriano Betancourt, d‟Antonio Bachiller y Morales, de Cirilo Villaverde ou encore de Ramón de Palma. Quant au romantisme cubain, qui connaîtra diverses évolutions, il s‟illustre à travers les figures de Plácido (Gabriel de la Concepción Valdés), José Jacinto Milanés y Fuentes, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Joaquín Lorenzo Luaces, Juan Clemente Zenea ou encore Luisa Pérez de Zambrana. Les récits narratifs se multiplient entre 1868 et 1898 et c‟est à cette époque qu‟apparaissent les romans les plus significatifs du XIXème siècle : Cecilia Valdés o La Loma del Ángel (1882), de Villaverde, Mi tío el empleado (1887), de Ramón Meza, Amistad funesta ou Lucía Jerez (1885), de José Martí, ou encore Leonela (1893), de Nicolás Heredia. Le romantisme, le réalisme et le naturalisme sont les trois courants qui caractérisent la prose à partir de cette période. Nous ne saurions évoquer la deuxième moitié du XIXème siècle sans nous arrêter un instant sur la figure de l‟écrivain, intellectuel et homme politique, José Martí, tant son œuvre protéiforme va profondément et durablement marquer la vie politique et culturelle du pays. Martí, qui mourra au combat en 1895 au début de la dernière Guerre d‟Indépendance, se distingue par des essais et des écrits poétiques et narratifs (de veine moderniste) novateurs d‟une grande qualité. Moins enclin aux récits de fiction qu‟aux chroniques journalistiques, l‟écriture lui permet, entre autres choses, de véhiculer ses idées sociopolitiques sur Cuba, bien entendu, mais aussi sur ce qu‟il a appelle « Notre Amérique ». Figure majeure des lettres cubaines et véritable héros national, José Martí se caractérise à la fois par une conscience politique aiguë et par un talent littéraire indéniable. 29 Miscelánea de útil y agradable recreo (1837), El Álbum (1838-1839), La Cartera Cubana (1838-1840), El Plantel (1838-1839) et La Siempreviva (1838-1840). 30 Diario de La Habana, Noticioso y Lucero de La Habana (1832-1844) et La Aurora de Matanzas (dès 1828). 31 Salvador Bueno définit ainsi les récits costumbristas : « El costumbrismo constituye una peculiar manifestación literaria que resalta en las letras españolas e hispanoamericanas del siglo XIX. Los cuadros de costumbres que a lo largo de dicha centuria aparecen en periódicos, revistas, folletos y libros de los países de lengua castellana, expresan los modos de vida y la psicología social de estos pueblos », Salvador Bueno, « Prólogo », in Costumbristas cubanos del siglo XIX, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1985, p. 9. 23 Comme nous l‟avons suggéré auparavant, tout au long de la seconde moitié du XIXème siècle, une partie de la production littéraire participe à l‟éveil d‟une conscience nationale qui mûrira progressivement et débouchera sur l‟indépendance de l‟Île en 1898. Avec la fin de la domination espagnole, une nouvelle étape littéraire s‟ouvre à Cuba. Le réalisme et le naturalisme vont prévaloir jusqu‟en 192332 grâce, notamment aux romans de Miguel de Carrión, Jesús Castellanos, Carlos Loveira ou encore José Antonio Ramos. Ces récits se nourrissent des problèmes politiques et sociaux de l‟époque et permettent de témoigner des maux de la jeune République. Ils font la part belle à la perte des valeurs morales et à la corruption de la société. Parallèlement, se développent des écrits historiques qui sont des récits de guerres souvent écrits par des généraux ayant combattu (citons, par exemple, les généraux Enrique Collazo et Bernabé Boza). Notons qu‟en 1923, la vie culturelle du pays est marquée par la naissance du « Grupo Minorista », qui réunit des intellectuels, des artistes, des écrivains, des musiciens, des médecins, etc. On compte parmi eux Alejo Carpentier, Jorge Mañach, Rubén Martínez Villena ou encore Enrique Serpa. Ce groupe d‟avant-garde intellectuelle est la cible de nombreuses persécutions dès lors que le dictateur Machado prend le pouvoir en 1925. D‟ailleurs, le « Grupo Minorista » se dissoudra trois ans plus tard, en 1928. A partir de ces années-là, cinq types de romans se dégagent assez nettement33 : « la novela campesina », qui marque une redécouverte du monde rural (Luis Felipe Rodríguez et Carlos Enríquez) ; « la novela histórica », qui traite principalement de la République (Raimundo Cabrera, Emilio Bacardí et Carlos Loveira) ; « la novela negrista », qui met en lumière la culture afro-cubaine (Jesús Masdeu, Alejo Carpentier, Irma Pedroso, Federico de Ibarzábal et Jorge Mañach) ; « la novela urbana », qui, comme son nom l‟indique, se déroule en milieu urbain (Arturo Montori, Carlos Loveira, Rubén Martínez Villena, Enrique Serpa, José Antonio Ramos), et enfin, un type de romans dont la portée est plus universelle (Lino Novás Calvo, Enrique Labrador Ruiz, Pablo de la Torriente Brau, Alejo Carpentier, Dulce María Loynaz, Virgilio Piñera). Parmi tous ces auteurs, le plus remarquable est sans doute Alejo Carpentier qui a su universaliser le roman cubain, avec, par exemple, El reino de este mundo (1949) puis avec ses romans postérieurs (Los pasos perdidos (1953), El acoso (1956), El siglo de las luces (1962), etc.). L‟autre grande figure qui va s‟imposer dans le panorama littéraire de l‟époque est José 32 Là encore nous nous appuyons sur la périodisation faite par José Antonio Portuondo, dans Historia de la literatura cubana. Tomo II. La literatura cubana entre 1899 y 1958. La República, La Havane, Instituto de Literatura y Lingüística, Editorial Letras cubanas, 2003. 33 Voir : ibid., p. 515, 516. 24 Lezama Lima. La publication de ses deux premiers recueils de poésie (Muerte de Narciso [1937] et Enemigo rumor [1941]) constitue une véritable révélation et témoigne d‟une écriture poétique résolument nouvelle. Paradiso (1966), son unique roman34, portera également les marques de cette écriture poétique si singulière, souvent énigmatique, que l‟auteur résumait en ces termes : « L‟image est la réalité du monde invisible ». Soulignons, qu‟avant Paradiso, il fonde, en 1944, avec José Rodríguez Feo, une revue d‟art et de littérature, Orígenes, qui durera jusqu‟en 1956. Le groupe des « origenistas », composé, entre autres, de Lezama, Carpentier, Lydia Cabrera, Virgilio Piñera, auxquels s‟ajoutent un certain nombre de collaborateurs étrangers, a une grande influence dans le monde des lettres cubaines. Les années quarante et cinquante sont, d‟un point de vue littéraire, d‟une grande richesse. Ceux qui seront les grands noms de la littérature cubaine commencent, en effet, à publier certaines de leurs œuvres. Outre Alejo Carpentier et Lezama Lima, citons également le romancier, poète et dramaturge Virgilio Piñera, les poètes Nicolás Guillén35 et Eliseo Diego ou encore la poétesse et essayiste Fina García Marruz. Avec l‟arrivée de la Révolution, en 1959, s‟ouvre une nouvelle étape. La politique culturelle révolutionnaire, d‟orientation marxiste, bouleverse le panorama des lettres cubaines, comme en témoigne le discours prononcé par Fidel Castro en 1961, « Palabras a los intelectuales », où il est clairement dit que tout ce qui ne sera pas conforme aux principes révolutionnaires sera banni. Des modifications formelles et substantielles s‟imposent alors pour que littérature et idéologie soient en adéquation. La diffusion de la culture est aussi l‟une des priorités du nouveau régime qui va œuvrer activement pour développer la vie intellectuelle du pays et la mettre à la portée de tous. Concrètement, cela se traduit par la création, en 1959, de la Casa de las Américas, par celle de l‟UNEAC (la Unión de Escritores y Artistas de Cuba), en 1961, qui va avoir pour mission de diffuser des textes littéraires nationaux, par la parution de plusieurs revues culturelles, dont La Unión (1962), La Gaceta de Cuba (1962) et El Caimán Barbudo (1966), par une augmentation des publications36 et des productions cinématographiques37. Sur le fond, de nombreux écrivains vont se pencher sur le passé récent du pays (la dictature de Batista), dans un exercice d‟exorcisme, selon la formule de José Rodríguez Feo : « gran parte 34 Oppiano Licario est un récit en prose inachevé, publié à titre posthume en 1977. Il avait déjà publié plusieurs recueils dans les années trente. 36 C‟est en 1966, par exemple, que sont publiés Paradiso, de Lezama Lima, et Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet. Notons qu‟entre 1959 et 1989, plus de trois cents récits nationaux seront publiés. 37 Le film Muerte de un burócrata sort en 1966 et Lucía et Memorias del subdesarrollo en 1968. 35 25 de nuestra literatura es un exorcismo de ese pasado terrible que a muchos nos tocó vivir »38. Deux tendances se distinguent à partir des années soixante : d‟un côté des récits réalistes au contenu sociohistorique (Soler, Desnoes, Otero), auxquels on pourrait ajouter les romans de témoignage (Miguel Barnet), et de l‟autre des textes plus expérimentaux (Sarduy, Cabrera Infante, Ezequiel Vieta)39. Avec la Révolution, la littérature cubaine connaît une scission qui oppose les écrivains de l‟Île aux artistes exilés qui publient leurs œuvres à l‟étranger (Cabrera Infante, Sarduy, Arenas, entre autres). Certains écrivains de « l‟extérieur » ne publieront jamais à Cuba et ne seront jamais reconnus Ŕ ou alors très tardivement Ŕ par les institutions cubaines. Pour en revenir à notre chronologie, rappelons que les années soixante sont aussi les années du fameux « boom » de la littérature hispano-américaine qui mit un certain nombre d‟écrivains latino-américains sur le devant de la scène littéraire internationale. A Cuba, Carpentier, avec El siglo de las luces (1962), et Lezama Lima, avec Paradiso (1966), participent à ce renouvellement du récit latino-américain et à sa diffusion mondiale. A la toute fin des années soixante, le roman policier cubain apparaît grâce à l‟écrivain Ignacio Cárdenas Acuña, qui est considéré comme l‟un des fondateurs du genre. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, le roman policier prospèrera à Cuba, à travers les figures de Luis Rogelio Nogueras, Guillermo Rodríguez Rivera ou encore Daniel Chavarría, qui sera plus novateur. Mais ces années se caractérisent surtout par la suprématie de l‟idéologie, au détriment de la qualité littéraire. Ce que l‟intellectuel cubain, Ambrosio Fornet, a qualifié de « Quinquenio Gris » (1971-1976), est une période où la censure s‟accentue au nom de la « pureté idéologique ». Les grands noms de la littérature cubaine cessent alors de publier et, à de rares exceptions près, prédominent des récits assez pauvres et souvent stéréotypés. A partir de la deuxième moitié de cette décennie et au début des années quatre-vingt, des écrivains qui ont quasiment grandi avec la Révolution font leur entrée dans le monde des lettres cubaines. Miguel Mejides, Mirta Yáñez, Senel Paz, pour ne citer que les plus connus, commencent à publier leurs œuvres et vont participer au renouvellement des lettres cubaines. Ce renouveau se prolongera avec les Novísimos (Rolando Sánchez Mejías, Ernesto Santana, Alberto Garrandés, …) puis, ensuite, avec les Posnovísimos (Ena Lucía Portela, Ronaldo Menéndez, Juan Ramón de la Portilla, …). Ces deux générations d‟écrivains, ainsi qualifiés 38 José Rodríguez Feo cité dans : José Antonio Portuondo, Historia de la literatura cubana. Tomo III, La Revolución (1959-1988), La Havane, Instituto de Literatura y Lingüística, Editorial Letras cubanas, 2008, p. 162. 39 Certains de ces récits seront tout d‟abord publiés à l‟étranger. 26 par Salvador Redonet40, regroupent de jeunes auteurs nés après la Révolution, qui vont bouleverser les codes littéraires. Il s‟agit d‟une nouvelle manière de concevoir l‟écriture littéraire en la désacralisant grâce au pastiche, à la parodie, à l‟intertextualité ou encore à l‟humour. Les thèmes abordés sont aussi novateurs : l‟homosexualité, la marginalité, l‟érotisme, sont assumés sans tabou. L‟accent est mis sur la quotidienneté de personnages qui n‟ont en rien l‟étoffe de héros. De plus, l‟absence de tout discours idéologique ou moral fait de ces récits souvent iconoclastes des « antinovela[s] de la construcción del socialismo »41. Car il faut dire que la période spéciale ébranle la société cubaine à tous les niveaux. La littérature des années quatre-vingt-dix ne peut que se faire l‟écho de cette crise multiple qui remet les principes socialistes en question. Notons, par ailleurs, que la crise économique n‟a pas pour conséquence une paralysie de la production littéraire. Au contraire, la fameuse crise du papier, en 1990, qui se traduit par une réduction drastique de l‟activité éditoriale dans l‟Île, oblige nombre d‟écrivains cubains à se tourner vers des éditeurs étrangers. Ces derniers publient et diffusent largement une littérature cubaine « fin de siècle » empreinte de pessimisme et de désillusion dont les représentants les plus connus sont Leonardo Padura Fuentes, Pedro Juan Gutiérrez ou encore Abilio Estévez. Malgré un essoufflement certain, cette littérature perdure encore aujourd‟hui. 40 Les Novísimos, nés entre 1959 et 1972, commencent à se faire connaître à partir de 1985. Ils sont présentés dans l‟introduction d‟une anthologie de nouvelles qui date de 1993 : Salvador Redonet, Los últimos serán los primeros. Antología de los novísimos cuentistas cubanos, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 1993, p. 5-31. Les Posnovísimos, nés entre 1962 et 1975, publient plus tardivement, dans les années quatre-vingt-dix. Ils sont évoqués dans une autre anthologie : Salvador Redonet, Para el siglo que viene : (Post)novísimos narradores cubanos, Saragosse, Prensa Universitaria de Zaragoza, 1999, p. 9-23. 41 Ambrosio Fornet cité dans José Antonio Portuondo, Historia de la literatura cubana. Tomo III, La Revolución (1959-1988), ibid., p. 617. 27 PREMIÈRE PARTIE UN ESPACE RÉFÉRENTIEL Chapitre 1 : Réalisme et réalité 1- Chroniques, articles costumbristas et littérature au XIXème siècle a- Réalité et effet de réel Même lorsqu‟il est mis en fiction, l‟espace urbain renvoie à une réalité précise qu‟il convient de caractériser. On ne saurait, en effet, envisager une étude des représentations littéraires d‟une ville sans définir le référent réel qui est décrit. Quels sont les quartiers et les lieux de La Havane qui figurent dans les romans ? Avec quelle fréquence et quelle intensité le paysage urbain apparaît-il ? Quelles sont les fonctions de celui-ci au sein de la diégèse ? Répondre à ces questions nous semble être une étape primordiale avant d‟appréhender l‟espace comme un objet littéraire à la fois symbolique et poétique. Afin de déterminer le cadre référentiel des romans de notre corpus, nous nous interrogerons, d‟une part, sur le réalisme littéraire en distinguant la réalité de l‟effet de réel. Quelques principes narratologiques permettront d‟éclairer les descriptions de La Havane dans les chroniques puis dans les récits de fiction. D‟autre part, une étude diachronique mettra au jour les différences de traitement : les fonctions de l‟espace sont, en effet, très fluctuantes d‟une œuvre à l‟autre et elles évoluent au fil des siècles. Ensuite, nous analyserons plus précisément les lieux décrits permettant de rendre le paysage recréé identifiable. Il s‟agira, en somme, de dédager les éléments qui composent La Havane littérarisée. Enfin, nous terminerons en étudiant l‟espace fictionnel en tant que référent socio-historique. Analyser les représentations de La Havane dans des œuvres de fiction requiert au préalable de rappeler un certain nombre de principes théoriques qui nous permettront de mieux appréhender le traitement littéraire de l‟espace urbain dans le corpus qui nous occupe. Longtemps parent pauvre des études littéraires, l‟espace a progressivement cessé d‟être perçu comme un élément mineur n‟étant qu‟au service d‟autres catégories comme la narration, les personnages ou le temps. Les principes narratologiques que les théoriciens de la littérature ont 28 établis au XXème siècle ont bien sûr permis de reconsidérer les valeurs et les fonctions de l‟espace fictionnel. Incontournable dès lors qu‟il s‟agit de décrire le réel, l‟espace est convoqué à renfort de descriptions plus ou moins précises dans les récits réalistes. En effet, inscrire la fiction littéraire dans une réalité concrète implique nécessairement d‟évoquer l‟espace. On le sait, les références topographiques qui jalonnent les récits obéissent souvent à un souci de réalisme : on nomme les lieux pour rendre le récit vraisemblable, pour authentifier la réalité fictionnelle et préserver « l‟illusion référentielle » ou « l‟effet de réel », pour reprendre les formules de Roland Barthes. C‟est bien pourquoi Henri Mitterand a pu écrire : « Le nom du lieu proclame l‟authenticité de l‟aventure par une sorte de reflet métonymique qui court-circuite la suspicion du lecteur : puisque le lieu est vrai, tout ce qui lui est contigu, associé, est vrai »42. L‟auteur-narrateur, en reprenant le précepte aristotélicien de mimèsis, se doit donc de fournir à son lecteur des détails concernant l‟espace-temps du récit afin de le rendre authentique mais aussi d‟individualiser les personnages, comme l‟explique Ian Watt : « les personnages du roman ne peuvent être individualisés que si on les situe dans un arrière-fond d‟espace et de temps déterminés »43. L‟espace, qui permet de fonder le récit, occupe donc une fonction narrative de premier ordre et devient véritable signifiant comme l‟ont démontré, entre autres, Gaston Bachelard dans La Poétique de l’espace44, Mikhaïl Bakhtine lorsqu‟il parle du « chronotope » des œuvres45, Henri Mitterand, dans Le discours du roman, et Roland Barthes dans « L‟effet de réel »46 ou dans son « Introduction à l‟analyse structurale des récits »47. Si l‟importance de l‟espace dans la littérature n‟est plus à démontrer, la question entre le réel et la recréation de ce réel se pose ici puisque nous travaillons sur les représentations littéraires d‟une ville. Aristote avait déjà montré que la poésie n‟était pas un calque de la réalité mais une imitation (mimèsis), une reconstruction de l‟energeia. Avec Ian Watt, nous pouvons ajouter que « le réalisme du roman ne réside pas dans le genre de vie qu‟il représente, mais dans la manière dont il le fait »48. Bien qu‟il s‟agisse de « faire vrai » et non d‟ « être vrai », la question de la correspondance entre l‟œuvre littéraire et la réalité décrite reste entière car c‟est sur elle, en 42 Henri Mitterand, Le discours du roman, Paris, P.U.F., 1980, p. 194. Ian Watt, « Réalisme et forme romanesque », in Littérature et réalité, Paris, Editions du Seuil, « Points », 1982, p. 27. 44 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace (1957), Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2007. 45 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, « Tel », 1978, p. 237-398. 46 Roland Barthes, « L‟effet de réel », in Littérature et réalité, op. cit., p. 81-90. 47 Id., « Introduction à l‟analyse structurale des récits », in Poétique du récit, Paris, Seuil, « Points », 1977, p. 757. 48 Ian Watt, « Réalisme et forme romanesque », in Littérature et réalité, op. cit., p. 14. 43 29 partie, que repose le pacte littéraire tacite entre auteur et lecteur et que Michael Riffaterre redéfinit en ces termes : Tout comme l‟illusion intentionnelle substitue à tort l‟auteur au texte, l’illusion référentielle substitue à tort la réalité à sa représentation, et a à tort tendance à substituer la représentation à l‟interprétation que nous sommes censés en faire. […] cette illusion fait partie du phénomène littéraire, comme illusion du lecteur. L‟illusion est ainsi un processus qui a sa place dans l‟expérience que nous faisons de la littérature.49 La littérature transforme donc l‟espace fictionnel en espace réel pour le lecteur, même si ce dernier doit savoir qu‟il ne s‟agit que d‟un simulacre de réalité, d‟une illusion. Peu importe alors la fidélité des descriptions ou au contraire le degré d‟éloignement entre l‟espace littérarisé et la réalité décrite dès lors qu‟il s‟agit d‟une représentation. La représentation en tant que réécriture du réel repose effectivement, en partie, sur une interprétation, et, en littérature, c‟est grâce à la description que se fait cette représentation de l‟espace. La description, qu‟elle soit littéraire ou non d‟ailleurs, porte ainsi souvent les marques d‟une certaine hybridité. Composée d‟éléments de nature différente (réalité, représentation, impressions), elle est rarement neutre. Et lorsque les chroniqueurs et journalistes du XIXème siècle, notamment, s‟appuient sur elle pour dépeindre le réel le plus fidèlement possible, à Cuba comme ailleurs, ils réinterprètent la réalité, à la manière des écrivains. b- Les chroniqueurs du XIXème siècle et la littérature Au XIXème siècle, chroniqueurs, journalistes et bien sûr écrivains vont s‟attacher à décrire la capitale cubaine mais sans nécessairement cloisonner les genres. Puisqu‟un même auteur pouvait passer de la chronique plus ou moins journalistique à la littérature, il n‟est pas étonnant de voir ces différents types d‟écriture se confondre et de voir s‟effacer la frontière, sans doute trop artificielle quand il s‟agit de décrire la ville, entre réalité et fiction. Et même s‟ils ne sont pas toujours polyvalents, ces auteurs vont malgré tout s‟influencer les uns et les autres. De sorte que l‟empreinte laissée par les chroniqueurs et les journalistes sur la littérature cubaine de l‟époque est frappante. De la même manière, les chroniques et les articles se sont eux aussi nourris des écrits littéraires. Cette interaction s‟explique sans doute, 49 Michael Riffaterre, « L‟illusion référentielle », in Littérature et réalité, op. cit., p. 93. C‟est nous qui soulignons. 30 en partie, par le rôle joué par la presse au tout début du XIXème siècle. Celle-ci publiait pêlemêle des articles littéraires, sociaux, économiques, politiques, etc. : Se debe precisar que el periódico […] no tendrá nunca una proyección esencialmente literaria, pues, por un lado, entonces se le llamaba literatura a cualquier texto impreso y, por otro, padecerá de un intenso sincretismo genérico. […] la crítica a veces confundirá su sentido entre lo literario, lo costumbrista o lo social.50 Les articles costumbristas qui décrivent des scènes de la vie courante de la société cubaine et dont la publication dans la presse se développe surtout à partir de 1830-1840, participent à ce « syncrétisme générique ». Observons au passage que ces écrits hybrides constituent à bien des égards une des premières manifestations littéraires « nationales » (avant l‟heure), voire patriotiques, et qu‟ils influenceront les œuvres littéraires futures. Durant les deux dernières décennies du XIXème siècle, les récits de Ramón Meza et de Julián del Casal sont caractéristiques car ils vont au-delà du simple tableau costumbrista et se font plus littéraires. Nous évoquerons ultérieurement, bien entendu, le roman Mi tío el empleado (1887), de Ramón Meza. Pour le moment, c‟est la figure de Julián del Casal et ses écrits sur La Havane qui nous intéressent. A la fois poète et chroniqueur, il incarne parfaitement ce mélange des genres. Il s‟est plongé dans la vie havanaise de son époque pour rédiger une série d‟articles intitulés « La sociedad de La Habana », publiés en 1888 dans la revue hebdomadaire La Habana Elegante51. A travers ses articles, il nous présente les us et coutumes de la noblesse havanaise, les soirées mondaines, les bals, les événements culturels ; il décrit aussi parfois la ville et dresse ainsi le portrait d‟une partie de la société coloniale. Ce panorama qui se veut fidèle à la réalité, puisqu‟il s‟agit de chroniques mondaines, dépasse le journalisme et le simple récit descriptif. Sa prose, non dénuée d‟ironie, qui constitue parfois une véritable critique sociale, pourrait s‟apparenter à la satire littéraire, comme en témoigne, par exemple, sa chronique tirée de « Bocetos habaneros » intitulée « Un café » dans laquelle il dépeint l‟agitation nocturne dans un café de la capitale. Le portrait qu‟il dresse de la clientèle est cinglant : […] se encuentran burócratas que hablan de sus protectores que les han prometido enviarles el ascenso por el primer vapor [...] ; imbéciles que comentan los últimos discursos pronunciados en las cortes, alcoholistas que 50 José Antonio Portuondo, Historia de la literatura cubana. Tomo I. La colonia: desde los orígenes hasta 1898, op. cit., p. 62. 51 Julián del Casal, Crónicas habaneras, compilación e introducción por Ángel Augier, Las Villas, Universidad Central de Las Villas, 1963. 31 se extasían ante el vaso de cognac ; y padres de familia que están hartos de la mujer, de los hijos y hasta de ellos mismos. 52 Doté d‟un sens de l‟observation sociale aigu, Julián del Casal dissèque en la raillant la clientèle masculine qui peuple ce café. A travers la description de ces habitués, c‟est toute la société havanaise du XIXème siècle que l‟auteur paraît juger, s‟érigeant ainsi en censeur. Ni les sphères publiques ni les sphères privées ne trouvent grâce aux yeux du chroniqueur : le favoritisme, l‟ineptie et le désenchantement caractérisent tour à tour la société, dont les clients du café ne sont ici que les représentants. Ces quelques lignes, non dénuées d‟un certain pessimisme, oscillent entre la satire et la sentence et se rapprochent des écrits littéraires des moralistes français des XVIIème et XVIIIème siècles. A l‟instar d‟un La Bruyère, Julián del Casal décrit « les mœurs de [son] siècle »53 et dénonce les comportements ridicules de ses contemporains dans des chroniques tant sociales que littéraires, qui rendent la frontière entre le journalisme et la littérature extrêmement ténue. 2- « Novelas de costumbres » et fiction littéraire a- « Cecilia Valdés » de Cirilo Villaverde : le mélange des genres Si la réalité est très proche de la fiction littéraire chez certains chroniqueurs comme Julián del Casal, c‟est aussi le contraire qui se produit quand la littérature utilise comme matière première des passages costumbristas. A cet égard, deux exemples retiennent particulièrement notre attention : le roman de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o la Loma del Ángel, et le récit épistolaire de la Comtesse Merlin, La Havane. Les deux œuvres s‟inspirent, voire se nourrissent directement, des chroniques urbaines publiées au XIXème siècle. Comme le remarque Salvador Bueno, Cecilia Valdés o la Loma del Ángel, qui a d‟ailleurs pour sous-titre « Novela de costumbres cubanas », compte de nombreuses scènes costumbristas car son auteur en publiait fréquemment dans la presse54. La genèse de l‟œuvre est à ce propos intéressante car, on le sait, la première version de Cecilia Valdés fut publiée en 1839, sous forme de nouvelle, dans la revue littéraire La Siempreviva. Cette version sera étoffée la même année par l‟auteur qui envisageait déjà d‟en faire un roman. L‟influence costumbrista est majeure dans les premières versions de Cecilia Valdés car l‟auteur faisait la 52 Julián del Casal, Bocetos habaneros, « Un café » (1890), in Salvador Bueno, Costumbristas cubanos del siglo XIX, op. cit., p. 493, 494. 53 Nous renvoyons ici au célèbre ouvrage de La Bruyère intitulé Les caractères ou les mœurs de ce siècle (1688). 54 Salvador Bueno, « Prólogo », in Costumbristas cubanos del siglo XIX, op.cit., p. 23. 32 part belle aux fêtes populaires qui se célébraient chaque année pour la San Rafael 55. La dénonciation anti-esclavagiste n‟était pas encore présente et le roman de 1839 se résumait à « fundamentalmente anécdotas amorosas „ambientadas‟ en forma costumbrista »56. La version de 1882, plus complexe du point de vue littéraire et plus engagée politiquement, n‟a néanmoins pas abandonné les descriptions « ambientadas » comme en témoigne ce passage situé au début du quatrième chapitre où le narrateur explique le déroulement des fêtes religieuses : […] a fines del mes de Setiembre, había dado principio el convento de la Merced a la serie de ferias con que hasta el año 1832 acostumbraban a solemnizar en Cuba las fiestas titulares religiosas, consagradas a los santos patrones de las iglesias y conventos ; novenarios coincidentes a veces con el circular del Sacramento, introducido en el culto de Cuba desde los primeros años del siglo por el Señor Obispo Espada y Landa. El novenario, de paso diremos, comenzaba nueve días anteriores a aquel en que caía el del santo patrono, prolongándose hasta otros nueve, con lo que se completaban dos novenas seguidas. Es decir diez y ocho días de fiesta, religiosas y profanas, que tenían más de grotescas y de irreverentes que de devotas y de edificantes. En ese tiempo se decía misa mayor con sermón por la mañana y se cantaba salve a prima noche dentro de la iglesia, con procesión por calle el día del santo. Fuera del templo había lo que se entendía por feria en Cuba, que se reducía a la acumulación en la plazuela o en las calles inmediatas, de innumerables puestos ambulantes, consistentes en mesa o tablero de tijeras, cubiertos con un toldo [...]57. Et le narrateur de poursuivre en décrivant précisément ce qui se vend dans les échoppes, ce que font les Noirs et les Blancs et comment se déroulent les bals. Dans l‟extrait cité, le narrateur insiste sur le mélange entre le profane et le sacré qui semble caractériser ces fêtes où cérémonies religieuses et baraques foraines se partagent un même espace pendant dix-huit jours. Il s‟agit là de dresser un véritable décor et de contextualiser précisément les scènes du roman, en l‟occurrence, le bal de « cuna ». Pour ne pas donner à cette description une fonction purement ornementale, le narrateur ajoute plus loin un commentaire méta-narratif qui sert (et servira) de justification à toute ces parenthèses descriptives : « Pero esta digresión, por más necesaria que fuese, nos ha desviado un tanto del punto objetivo de la presente historia »58. Car nombre d‟incursions dans le registre de la chronique, indispensables pour construire le roman si l‟on en croit le narrateur, vont émailler le récit que ce soit pour évoquer les fêtes religieuses, les coutumes des Havanais ou encore pour décrire l‟espace urbain. Pour rendre 55 Ces descriptions ont été rédigées par Villaverde à la demande d‟un de ses amis qui souhaitait publier un article costumbrista sur les fêtes de l‟Ángel. 56 Jean Lamore, « Introduction », in Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel (1882), Madrid, Cátedra, 2004, p. 17. 57 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 90, 91. 58 Ibid., p. 93. C‟est nous qui soulignons. 33 son récit authentique, Villaverde s‟inspire donc de La Havane des costumbristas et des chroniqueurs. C‟est d‟ailleurs avec le même souci du détail qu‟il décrit, par exemple, le Paseo del Prado : Ocupaba éste, y ocupa en el día, el espacio de terreno que se dilataba desde la calzada del Monte hasta el arrecife de la Punta al norte, al morir el glacis de los fosos de la ciudad por el lado del oeste. Cienfuegos extendió el paseo de la calzada del Monte hasta el Arsenal hacia el sur ; pero jamás se ha usado como tal esa parte sino como calle Ancha, cuyo nombre lleva. Entre las obras de adorno que tuvieron origen en el gobierno de D. Luis de Casas, se encuentra el nuevo Prado. [...] El conde de Santa Clara concluyó la primera fuente que dejó en proyecto las Casas, y construyó otra más al norte : nos referimos a la de Neptuno en el promedio del Prado, y la de los Leones al extremo. Ambas se surtían de agua de la Zanja real, que atravesaba el paseo [...] por el frente del Jardín Botánico, […] y por la orilla del foso iba a verter sus turbias aguas en el fondo del puerto, al costado del Arsenal. Mucho después, al extremo meridional del Prado, donde estuvo originalmente la estatua en mármol de Carlos III, [...] hizo construir a su costa en 1837 el Conde de Villanueva la bella fuente de la India o de la Habana. El nuevo Prado constaba de una milla de extensión, poco más o menos, formando un ángulo casi imperceptible de 80 grados, frente a la plazoleta donde se elevaba 59 la fuente rústica de Neptuno. Dans une longue et minutieuse énumération, le narrateur rappelle l‟histoire de la promenade et de ses fontaines, il évoque le nom de certains gouverneurs et situe tout précisément pour que le lecteur se figure exactement l‟espace décrit. L‟abondance d‟indications géographiques (points cardinaux, locutions adverbiales et prépositions localisatrices) atteste le besoin de spatialiser la description. Nous pourrions multiplier à l‟envi les exemples qui témoignent de cet intérêt pour les détails architecturaux, les précisions topographiques et les explications historiques, qui permettent, entre autres, d‟accentuer le caractère réaliste du roman, puisque cette « hypertrophie du détail du vrai », pour reprendre la formule de Zola60, imprègne toute l‟œuvre. Qu‟il s‟agisse d‟évoquer le Paseo del Prado, la ruelle « San juan de Dios » 61, le Colegio de San Carlos62, l‟hôpital de Paula63, les murailles de la ville64, les places (la Plaza Vieja et la Plaza de Armas) ou bien les maisons particulières, Cirilo Villaverde se livre à des descriptions détaillées qui se veulent les plus exactes possibles et qui font de Cecilia Valdés un roman de costumbrismo urbano, même si, comme le rappelle Jean Lamore, l‟auteur va 59 Ibid.., p. 214, 215. Emile Zola cité dans Philippe Hamon, Du descriptif (1981), 4e éd., Paris, Hachette Supérieur, 1993, p. 18. 61 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 62, 63. 62 Ibid., p. 145, 146. 63 Ibid., p. 314, 315. 64 Ibid., p. 217. 60 34 bien au-delà de la simple description65. Ces passages descriptifs, pour ainsi dire neutres, qui donnent à voir au lecteur la capitale de l‟époque, ne sont pas sans rappeler, mutatis mutandis, les descriptions scientifiques que le naturaliste et géographe Alexander von Humboldt fit de La Havane lors de ses deux séjours à Cuba en 1800 et 180466. Cette comparaison se justifie d‟autant plus que le savoir encyclopédique dont le narrateur fait montre à plusieurs reprises dans le roman, donne à la description littéraire un statut particulier : celle-ci, n‟étant plus un moyen, devient une fin en soi et fait du narrateur « un descripteur […] savant »67. Cecilia Valdés est donc un roman quasiment polygénérique dans la mesure où les passages descriptifs sont l‟occasion d‟ouvrir des parenthèses costumbristas très marquées, sortes de récits dans le récit, qui sans faire avancer la fiction, servent indubitablement d‟adjuvants pour la construction d‟un décor réaliste. Loin d‟être accessoires, les descriptions spatiales dans l‟œuvre de Villaverde correspondent en tous points aux propos d‟Henri Mitterand qui disait : « C‟est le lieu qui fonde le récit, parce que l‟événement a besoin d‟un ubi autant que d‟un quid ou d‟un quando ; c‟est le lieu qui donne à la fiction l‟apparence de la vérité »68. b- « La Havane » de la Comtesse Merlin : un récit hybride L‟espace fictionnel au XIXème siècle prétend donc être le reflet fidèle de la réalité, comme nous l‟observons également dans La Havane de la Comtesse Merlin qui constitue un autre exemple significatif de ce mélange entre illusion référentielle et espace réel. Nombreux sont les critiques qui ont recensé tous les plagiats ou « emprunts » que María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo avait faits sans citer ses sources, mêlant récit littéraire fictionnel Ŕ même s‟il s‟agit d‟une autobiographie Ŕ et chroniques costumbristas de l‟époque. Les écrits de Domingo del Monte, José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero, José Victoriano Betancourt et Ramón de Palma, entre autres, ont largement inspiré la Comtesse Merlin dans Souvenirs et mémoires de Madame la Comtesse Merlin. Souvenirs d’une Créole (1836) et La Havane (1844). Sans entrer dans la polémique qui opposent ceux qui considèrent que l‟écrivain a plagié les chroniqueurs à ceux qui pensent qu‟elle s‟en est inspirée, signalons simplement que dans le cas de la littérature de voyage le texte littéraire ne peut être qu‟hybride et mélanger les genres. Le récit de voyage est effectivement tout à la fois une 65 « Cecilia Valdés va mucho más allá de ese costumbrismo al no conformarse con describir, para enmendarlos, algunos rasgos sociales [...] », Jean Lamore, « Introducción », in Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 35. 66 Alexander von Humboldt, Essai politique sur l’île de Cuba (1826), Nanterre, Editions Erasme, 1989, p. 4-6. 67 Nous reprenons l‟appellation de Philippe Hamon, Du descriptif, op. cit., p. 38. 68 Henri Mitterand, Le discours du roman, op. cit., p. 194. 35 chronique descriptive et une narration littéraire empreinte d‟impressions subjectives. Aussi la Comtesse Merlin s‟appuie sur les chroniques de l‟époque pour décrire la capitale cubaine, les scènes rurales du pays à la manière là encore d‟un Humboldt qui livrerait une description affective, amusée et ethnocentrée de ce qu‟il découvre. L‟exposé qu‟elle fait de l‟enterrement d‟un notable de la ville est en cela assez probant : L‟enterrement d‟une personne de haut rang, à La Havane, est entouré de pompe, comme s‟il devait payer la dette entière du souvenir. Le corps est déposé sur une voiture à quatre roues, la seule peut-être qui existe dans la ville. Des prêtres priant à haute voix suivent immédiatement ; puis un grand nombre de nègres, habillés en grande livrée, ornés de galons à armoiries sur toutes les coutures et en culotte courte, marchent sur deux rangs [...]. Les quitrins de luxe arrivent ensuite [...]. Un nègre en livrée, mon cher marquis est un spectacle curieux, divertissant et fort peu en harmonie avec la gravité d‟un convoi ; et c‟est à grand regret que je suis obligée, pour satisfaire à la vérité historique, de mêler aux tristes images qu‟offre ce récit la peinture fidèle de ce costume brillant et grotesque, porté seulement dans les enterrements. Des cohortes africaines, ainsi accoutrées, se prêtent mutuellement dans les familles pour augmenter l‟éclat des enterrements69. L‟auteur poursuit en décrivant le costume en question et les difficultés qu‟éprouvent les Noirs à le porter. L‟incise descriptive se justifie ici, d‟après l‟auteur, par un souci de « vérité historique » qui confère à son récit un caractère véridique. Cette précision qu‟apporte la narratrice sur ses intentions, tend à l‟apparenter bien plus au scientifique (à l‟historien en l‟occurrence) qu‟à l‟écrivain réaliste. Mais l‟expression « peinture fidèle » la ramène à son statut d‟écrivain qui réinterprète la réalité et rend ainsi ses efforts pour être plus proche de l‟Histoire que du roman tout à fait vains. Ces lignes témoignent donc de la volonté de l‟écrivain de coller à la réalité sans pour autant se distancier de son propre discours. La Comtesse s‟implique dans son récit et souhaite faire partager ses impressions d‟« étrangère » : elle veut donner son avis et expliquer son étonnement. La Havane joyeuse et lumineuse de María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo mêle donc tout à la fois le réalisme des chroniques et la subjectivité des récits littéraires. Les emprunts faits aux chroniqueurs ou costumbristas de l‟époque marquent la volonté délibérée de la part de certains auteurs du XIXème siècle de recréer l‟espace réel sans le dénaturer et le déformer. Mais ce premier chapitre aura permis de montrer qu‟il s‟agit d‟un 69 La Comtesse Merlin, La Havane (1844), Tome II, Paris, Indigo et Côté-femmes, 2002, p. 89. Nous la citons en français, dans ce travail, car c‟est dans cette langue que l‟écrivain rédigea les lettres qui composent ce récit de voyage. De plus, la version espagnole (Viaje a La Habana), qui est une traduction, est incomplète : elle ne compte que dix lettres sur trente-six. 36 vœu pieux puisque les chroniqueurs eux-mêmes réinterprètent le réel en le réécrivant. Quoi qu‟il en soit, ce souci de la correspondance entre écriture et réalité cessera progressivement d‟être la préoccupation des auteurs à venir qui, tout en souhaitant rester dans la veine réaliste, offriront des descriptions plus personnelles et subjectives de l‟espace urbain. Ces descriptions, qu‟elles soient conformes à la réalité ou non, varient d‟un siècle à l‟autre et d‟une œuvre à l‟autre et font que le traitement littéraire de l‟espace urbain est inégal. Chapitre 2 : Une référentialité topographique fluctuante 1- Traitement de l‟espace dans les romans du XIXème siècle a- La Havane comme arrière-plan Si l‟espace fonde en partie le récit, s‟il n‟occupe plus uniquement une fonction ancillaire et s‟il n‟est plus seulement un élément circonstant, il n‟en reste pas moins que, selon les récits, l‟ancrage dans le réel et la fonction de l‟espace sont très variables. En nous livrant à une étude diachronique nous allons tâcher de mettre au jour une évolution dans le traitement de l‟espace urbain dans les romans de notre corpus. On constate, en effet, qu‟aux XIXème et XXème siècles, les fonctions des descriptions spatiales varient et que la place de la ville est irrégulière d‟une œuvre à l‟autre : elle peut se résumer à quelques indications topographiques, ne constituant alors qu‟un simple décor, ou, au contraire, elle peut se situer au cœur de la fiction, devenant de la sorte un élément déterminant du récit. Il est vrai qu‟avant la première moitié du XXème siècle, pour des raisons que nous expliquerons un peu plus loin, La Havane est surtout un point d‟ancrage mis au service de la fiction. C‟est, par exemple, ainsi qu‟elle apparaît dans Historia de un bribón dichoso (1860), de Ramón Piña70, où les descriptions de la ville sont limitées et concises : il est fait allusion aux quartiers de « El Horcón » et de « El Cerro » et l‟auteur décrit l‟intérieur de quelques riches demeures. Toute l‟attention du narrateur se porte sur don Eustaquio Barullo, un homme sans scrupules dont les agissements ne sont motivés que par l‟appât du gain. Les très rares allusions à l‟espace ne servent en rien le propos moralisateur de l‟œuvre qui dénonce la prolifération des crapules, ou pícaros modernes, à l‟époque des Capitaines Généraux Miguel Tacón et Jerónimo Valdés. Les descriptions spatiales sont encore plus pauvres dans le roman Luisa 70 Ramón Piña, Historia de un bribón dichoso (1860), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 1981. 37 (1892), de José González del Valle, qui n‟évoque que de manière très vague les rues de la ville. Seule la promenade extra-muros où se croisent les calèches mérite un peu plus d‟attention de la part du narrateur : La tarde destinada al paseo fue serena y bellísima, como las tardes de primavera en Cuba lo son siempre. Hermoseaba la alameda estramuros, hoy desierta, una concurrencia extraordinaria, así de volantes y quitrines donde las damas lucían sus vestidos y adornos, como de hombres de a pie puestos en fila a lo largo de las pequeñas paredes de la zanja que limitan el trecho destinado a los carruajes.71 Le narrateur, qui s‟attache à décrire les personnages qui circulent habituellement sur la promenade, ne prête que peu d‟attention au décor urbain. S‟il montre que les femmes aristocratiques et les hommes ordinaires n‟occupent pas le même espace (les femmes restent à l‟intérieur de leur calèche qui circulent au milieu de l‟avenue tandis que les hommes occupent les bas-côtés), il ne fait, en revanche, aucune description précise de l‟avenue car il s‟agit simplement de situer l‟histoire à La Havane. Une fois le décor planté, la ville n‟a plus d‟importance et toutes précisions seraient superflues puisqu‟elles ne serviraient en rien le récit. De même, les nouvelles de l‟époque n‟offrent généralement que de vagues références topographiques en guise d‟évocations spatiales car il faut dire que le format du récit n‟est guère propice aux digressions descriptives. Il est effectivement difficile de traiter précisément et abondamment de la ville quand l‟intention de l‟auteur est de construire une fiction brève. Néanmoins, certaines nouvelles se distinguent des autres par la volonté qu‟ont leurs auteurs d‟accorder de l‟importance à l‟espace urbain. Citons, par exemple, la nouvelle « El doctor inFausto » de Tristán de Jesús y Medina dans laquelle La Habana Vieja et la maison d‟un des personnages, don Fernando, bénéficient d‟une approche assez détaillée : [don Fernando se mudó] a una casa hermosísima que acababa de edificar en un barrio inmediato a la bahía de La Habana. La casa podía llamarse hermosa sin temor de parecer poco entendido en las reglas de arquitectura perfecta : era de orden corintio, mejor dicho, paranínfico, porque en lugar de columnas tenía en la fachada doce grupos de estatuas sumamente bellas como traídas de Italia. Una escalinata muy cómoda separaba de la calle la galería exterior, desde donde se veía más bella la Alameda de Paula. El patio era un jardín cultivado [...]. Puede disculpársenos el que nos detengamos en la pintura de una casa, porque las casas perfectas escasean por desgracia en nuestra capital, y no puede menos que llamar la atención de cualquiera, el edificio que se eleve con todo primor del arte entre la multitud de caserones, casuchas, covachas y gazaperas. La arquitectura no solamente entre nosotros, 71 José González del Valle, Luisa, La Havane, biblioteca selecta habanera, Imprenta « El Pilar », 1892, p. 25. 38 ha hecho enemistad con el buen gusto. [...] Los arquitectos pues, han degenerado en obreros [...].72 Le narrateur s‟intéresse à la maison de don Fernando car elle contraste vivement avec les autres demeures de la ville, caractérisées ici par une gradation dépréciative (« caserones, casuchas, covachas y gazaperas »). Le commentaire méta-narratif justifie à la fois cette parenthèse descriptive et lui confère une fonction dénonciatrice : c‟est parce que le narrateur a décrit précisément la beauté de la maison de Fernando qu‟il peut critiquer ensuite les constructions actuelles, certes fonctionnelles mais qui enlaidissent La Havane. Les architectes, dépourvus à présent de toute préoccupation esthétique, ne sont plus que des bâtisseurs (« obreros », dit le narrateur) qui défigurent le paysage urbain. L‟évocation de la ville et de ses maisons insinue donc, dans ces lignes, un discours critique à l‟égard de l‟évolution urbanistique. Cela étant, au sein de cette nouvelle et d‟autres récits du même auteur, comme « Una notabilidad en La Habana », « Día de difuntos » ou « La nochebuena de 1853 », les références spatiales, bien qu‟épisodiques, donnent un peu plus d‟épaisseur au décor urbain et marquent les prémices de La Havane littérarisée. Une nouvelle de Ramón de Palma est en cela caractéristique : « El cólera en La Habana ». Rappelons simplement qu‟il s‟agit d‟une nouvelle ou d‟un roman court d‟une soixantaine de pages dont l‟action se déroule à La Havane, en 1833, durant une épidémie de choléra. Le récit s‟ouvre sur les festivités du carnaval, juste avant que ne commence la tragique pandémie qui va ravager la ville en se propageant dans un mouvement centripète. Le quartier de San Lázaro (où habitent la jeune protagoniste Angélica et sa mère) et le centre de la ville sont rapidement touchés et deviennent des quartiers fantômes. Voici ce que voient la fille et sa mère lorsqu‟elles sortent à nouveau de chez elles : No habían salido de su casa desde el carnaval en que La Habana estaba tan llena de estrépito y de vida. ¡ Qué espectáculo tan distinto el que ahora presentaba ! En medio del silencio y soledad de las calles, retumbaba el ruido del carruaje, así como retumban los pasos en los salones de un palacio abandonado. Causaba una impresión extraña y pavorosa atravesar por en medio de los apiñados edificios, todos pintados de blanco, como entonces estaban, que parecían cubiertos de un paño funerario. Si penetraba aquel silencio sepulcral alguna voz, era el lastimero grito de un colérico que pedía agua [...] y lidiaba desesperado con las últimas angustias de la muerte ; y si animaba aquella espantosa soledad algún viviente, era un hombre pálido y presuroso que recorría las calles como un fantasma [...]. La media luz del crepúsculo, indecisa y melancólica, le daba a las cosas un aspecto fantástico y 72 Tristán de Jesús Medina, « El doctor In-Fausto » (1854), in Narraciones, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 1990, p. 293, 294. C‟est nous qui soulignons. 39 sepulcral, lo que unido al silencio que reinaba, hacía parecer los objetos a la manera de visiones.73 Le triste « spectacle » que les deux femmes découvrent depuis leur calèche est marqué par la mort qui envahit tout l‟espace urbain. Les nombreux adjectifs qualificatifs et les comparaisons (« parecían cubiertos de un paño funerario », « como un fantasma ») concourent à créer un décor funèbre inquiétant. La ville n‟est plus qu‟un espace vide, désert et silencieux qui semble paralysé par une torpeur effrayante. Au début du fragment, seul le bruit de l‟attelage, qu‟une alitération en « r » permet d‟ailleurs d‟accentuer (« retumbaba el ruido del carruaje, así como retumban los pasos »), brise le silence mortuaire qui s‟est abattu sur La Havane. Progressivement, cette léthargie dématérialise la capitale puisque tout devient irréel à la fin de cet extrait (« fantasma », « aspecto fantástico », « visiones »). D‟autres allusions à cette Havane ravagée et fantasmagorique vont ponctuer le récit et faire de la ville une scène quasi apocalyptique. La mère mourra du choléra, Angélica tombera également malade mais ressuscitera miraculeusement à l‟image de la capitale qui retournera, elle aussi, à la normalité à la fin du récit. Sans en analyser la portée dès à présent, nous pouvons dire que les descriptions détaillées de La Havane sont non seulement nécessaires, puisqu‟elles servent le propos de l‟écrivain qui est de décrire une ville paralysée et moribonde, mais aussi structurantes car c‟est autour et à partir de la ville mourante que se construit toute la fiction. Le traitement spatial est d‟autant plus original dans cette œuvre qu‟il s‟agit, rappelons-le, d‟une nouvelle. b- Le premier roman de La Havane Contrairement aux œuvres de Piða et González del Valle, des romans de la même époque vont mettre en avant la ville. L‟espace devient alors actant et la description devient narration, pour reprendre la distinction que Gérard Genette établit entre narration et description74. Le roman Cecilia Valdés o La Loma del Ángel (1882), de Cirilo Villaverde, marque en cela une étape importante dans l‟histoire de la littérature cubaine du XIXème siècle car il va placer l‟espace 73 Ramón de Palma, « El cólera en La Habana » (1838), in Cuentos Cubanos, La Havane, Colección de libros cubanos, 1928, p. 137, 138. 74 « Il faut observer enfin que toutes les différences qui séparent description et narration sont des différences de contenu [...] : la narration s‟attache à des actions ou des événements considérés comme purs procès, et par là même elle met l‟accent sur l‟aspect temporel et dramatique du récit ; la description au contraire, parce qu‟elle s‟attarde sur des objets et des êtres considérés dans leur simultanéité, et qu‟elle envisage les procès eux-mêmes comme des spectacles, semble suspendre le cours du temps et contribue à étaler le récit dans l‟espace », Gérard Genette, Figures II, Paris, Editions du Seuil, collection « Points Essais », 1969, p. 59. 40 urbain au cœur de l‟intrigue et lui octroyer un rôle décisif. D‟ailleurs, Emma Álvarez-Tabío Albo, dans son ouvrage critique sur les représentations littéraires de La Havane, intitule le chapitre correspondant au roman de Villaverde : « Cecilia Valdés y la inauguración de la novela de La Habana »75 et qualifie le roman d‟hommage que rend Villaverde depuis l‟exil à cette ville qu‟il connaît parfaitement et où il s‟est formé76. L‟une des singularités de ce roman est effectivement que les descriptions des rues, des places, des bâtiments et des maisons sont très précises et qu‟elles ont une certaine importance dans l‟économie du roman puisqu‟elles construisent bien plus qu‟un simple décor. Les maisons des personnages principaux, Cecilia Valdés et Leonardo Gamboa, bénéficient, par exemple, de descriptions minutieuses. Dans un souci de rigueur et d‟exhaustivité, le narrateur s‟attache à évoquer tout ce qui compose ces demeures. Le lecteur pénètre ainsi à l‟intérieur, progresse dans les pièces, se figure le mobilier grâce à une importante adjectivation, à des précisions chromatiques et à de nombreuses énumérations : Había sido de bermellón la pintura de dicha puerta, pero lavada por las lluvias, el sol y el tiempo, no le quedaban sino manchas rojas oscuras en torno de la cabeza de los clavos y en las molduras profundas de los tableros. La ventanilla, que era de espejo y alta, sólo tenía tres o cuatro balaústres, había perdido la pintura primitiva, quedándole un baño ligero de plomo. Por lo que toca al interior, su apariencia era más ruin, si cabe, que el exterior. Se componía de una salita, dividida por un biombo para formar una alcoba, cuya puerta daba precisamente hacia la de la calle, y otra a la derecha con salida al patio angosto y no más largo que el fondo de la casita. [...] Reducíase a bien poco el mueblaje, aunque en su poquedad y ruina se conocía que había visto mejores tiempos cuando nuevo. El más apetecible de la casa era una butaca de Campeche, ya coja, sin orejas grandes y desvencijada. [...] En realidad aquella no era casa sino en cuanto daba abrigo a dos personas, porque, fuera de dos piezas mencionadas, no tenía comodidad ni más desahogo que el patio dicho, donde estaba la cocina, mejor, fogón, cajoncito de madera lleno de ceniza, montado sobre cuatro pies derechos [...].77 La description extérieure et intérieure de la maison de Cecilia Valdés et de sa grand-mère dénonce leur pauvreté et les difficultés actuelles. Les nombreuses négations (« no », « ni »), l‟adverbe de restriction « sólo », la préposition « sin », les adjectifs tels que « ruin », « angosto » ou, enfin, les substantifs « poquedad » et « ruina » concourent à créer, dès le début du roman, un décor décati et modeste. A l‟inverse, l‟opulence et le luxe sont palpables dans les moindres détails chez les Gamboa : 75 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 53. Ibid., p. 59. 77 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 78, 79. 76 41 En el barrio de San Francisco […] había, entre otras, una casa de azotea que se distinguía por el piso alto sobre el arco de la puerta, y el balconcito al poniente. La entrada general, como casi las de todas las casas del país, para los dueños, criados, bestias y carruajes, dos de los cuales había comúnmente de plantón, era por el zaguán ; especie de casa-puerta o cochera que conducía al comedor, patio y cuartos escritorios. Llamaban bajo este último nombre los que se veían a la derecha, a continuación del zaguán, ocupados, el primero por una carpeta doble de comerciante, con dos banquillos altos de madera, uno a cada frente, y debajo una caja pequeña de hierro, cuadrada [...]. En el lado opuesto de la casa se veía la hilera de cuartos bajos para la familia, con entrada común por la sala, puerta y ventana al comedor y al patio. [...] Entre el zaguán y los cuartos llamados escritorios descendía al comedor, apoyada a la pared divisoria, una escalera de piedra tosca con pasamanos de cedro [...]. Esa escalera comunicaba con las habitaciones altas, compuestas de dos piezas [...]. Con efecto, los muebles principales que la llenaban casi, eran una cama o catre de armadura de caoba [...].78 Le souci du détail et de l‟exhaustivité de Villaverde permet au lecteur de se représenter précisément la maison des Gamboa, de pénétrer à l‟intérieur, et d‟en découvrir tous les recoins. Les deux descriptions d‟intérieurs semblent se faire écho : aux deux misérables pièces décrites précédemment s‟oppose cette spacieuse demeure ; à la vétusté et pauvreté antérieures correspondent la fonctionnalité de cette maison et la noblesse des matériaux (« cedro », « caoba »). Aussi asymétriques soient-elles, ces deux descriptions constituent de véritables visites guidées à l‟intérieur des logis qui, loin d‟être gratuites et ornementales, suggèrent et orientent la lecture. Nous avons là une mise en corrélation de deux espaces qui s‟opposent en tous points : d‟un côté la maison de pauvres gens qui vivent très simplement et de l‟autre, une demeure typique des notables de La Havane. Ces descriptions spatiales détaillées sont d‟autant plus significatives qu‟elles viennent compléter le portrait des deux personnages principaux, les révélant un peu plus au lecteur. Elles prennent sens car elles permettent une caractérisation sociale immédiate et efficace qui participe à la construction de « l‟effet de personnage », pour reprendre la formule de Philippe Hamon79. L‟opposition entre les deux familles, qui naît ici de la description des intérieurs, permet aussi à l‟auteur de brosser un portrait global de la société coloniale havanaise et des différentes couches sociales qui la composent80. Elle est également un élément majeur du récit dans la mesure où elle 78 Ibid., p. 122, 123. Philippe Hamon, Du descriptif, op. cit., p. 104. 80 Salvador Bueno explique à ce propos : « […] en Cecilia Valdés lo que importa no es el relato de los amores incestuosos entre Cecilia y Leonardo, sino la pintura total de la sociedad cubana en la primera mitad del siglo XIX, con la multitud de esclavos de la ciudad y del campo, los jóvenes pudientes de la época, la burguesía enriquecida, las fiestas y hábitos de aquellos tiempos », Salvador Bueno, Historia de la literatura cubana (1954), La Havane, Editora del Ministerio de Educación, Editorial Nacional de Cuba, 1963, p. 176. 79 42 souligne un argument fondamental de l‟œuvre : l‟impossibilité pour quiconque de franchir les barrières sociales et raciales dans cette Havane du XIXème siècle81. A ces descriptions suggestives, qui constituent une analyse sociale fine et donnent au roman une dimension dénonciatrice, s‟ajoutent de nombreuses transcriptions des parcours des personnages au cœur de La Habana Vieja, comme en témoigne, par exemple, cette promenade de Leonardo : Pero apenas bajó a la calle por el lado de la Compostela, y se vio una vez más en medio del bullicio popular [...] al llegar a las Cinco esquinas, alcanzó un caballero de mediana edad [...]. Adelante, la calle del Tejadillo corta la de Compostela en ángulo recto y luego se encuentra la del Empedrado, dicha así por haber sido la primera en que se empezó a ensayar el sistema de pavimento de las calles de la Habana con chinas rodadas y arroyo en medio. Por ella torció Leonardo a la derecha [...] se encontró en la esquina de la calle del Aguacate, y arrimado a las alterosas paredes del Convento de Santa Catalina, no hizo alto hasta cerca de la esquina en que la calle O‟Reilly corta la que llevaba a la sazón.82 Nous aurons l‟occasion de revenir sur ces déplacements dans notre troisième chapitre mais nous pouvons avancer d‟ores et déjà que les promenades des personnages, qui permettent au narrateur d‟apporter quelques précisions historiques et topographiques, sont décrites avec tellement de détails que l‟on pourrait dire que Villaverde cartographie la ville et dresse un tableau rigoureux de La Havane coloniale de 1812 à 183183. Cette carte littéraire de La Havane permet de construire une identité urbaine et sociale car sur les quatre parties que compte le roman, trois font la part belle à l‟espace citadin et dépeignent une capitale raciste et esclavagiste, pétrie de contradictions, coupable d‟injustices et d‟interdits. L‟importance de la ville ne se dément pas jusqu‟à la dernière ligne du roman. Comme le rappelle Emma ÁlvarezTabío Albo84, Villaverde donne une fois de plus la parole à la ville pour clôturer son livre : « El tribunal le condenó [a Dionisio] a diez años de cadena, y el célebre D. Miguel Tacón le destinó al presidio de La Habana para la composición de las calles »85. Le roman s‟achève 81 Nous retrouverons cette même problématique dans le roman de Ramón Meza, Carmela (1887), La Havane, Editorial Arte y Literatura, 1978. 82 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 158, 159. 83 Emma Álvarez-Tabío Albo écrit à ce sujet : « La evocación que hace Vilaverde de La Habana es tan detallada, que las localizaciones de la novela pueden constituir un tejido urbano capaz de sustentar la ciudad entera. Igualmente minuciosa es la manera en que pobló esos lugares, sin olvidar prácticamente ninguno de los estratos sociales que se superponìan sobre esa trama […] », Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 79. 84 Ibid., p. 60, 61. 85 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 638. 43 ainsi sur l‟image d‟une ville qui se rénove et se modernise grâce à la politique urbaniste de Tacón. L‟hyper-référentialité spatiale fait de Cecilia Valdés o La Loma del Ángel le grand roman de La Havane du XIXème siècle. La densité, la précision, la variété ainsi que la fonction des descriptions participent à la construction d‟une Havane mythique que certains romans du XXème siècle renforceront. 2- Les descriptions urbaines au XXème siècle a- L’espace urbain : un point d’ancrage plus ou moins éloigné Le XXème siècle voit se multiplier les œuvres littéraires qui placent La Havane au centre de la diégèse, surtout à partir des années cinquante et soixante. A travers une étude diachronique, nous allons voir, dans un premier temps, comment les représentations du monde urbain restent fluctuantes et souvent superficielles alors que la ville constitue le décor privilégié de nombreux récits littéraires. Effectivement, quels que soient les courants littéraires, la ville perçue comme simple point d‟ancrage mis au service d‟une fiction reste souvent la norme. Ce qui nous intéresse ici ce n‟est pas tant d‟étudier l‟évolution de la fonction ancillaire de la ville que de voir que, pour des motivations littéraires diverses, ce statut de décor apparaît dans des romans de facture tout aussi classique que moderne. D‟autre part, cette partie ne prétend pas retracer l‟histoire complète des représentations de La Havane dans la littérature cubaine mais simplement poser quelques jalons qui nous obligeront parfois à progresser par bonds dans la chronologie. Notre objectif n‟étant pas l‟exhaustivité, nous avons préféré sélectionner quelques exemples cohérents et révélateurs qui nous permettront de construire, dans un deuxième temps, une analyse contrastive. Rappelons tout d‟abord qu‟au cours des vingt premières années du siècle fleurissent surtout des romans historiques, psychologiques, sociologiques ou costumbristas, quasiment tous de veine réaliste ou naturaliste. Ces derniers situent assez souvent leur intrigue à La Havane car, contrairement à la littérature latino-américaine de l‟époque, la littérature cubaine ne place pas au centre de ses préoccupations les relations entre l‟homme et la nature86, tout au moins au cours des deux premières décennies. Si « la novela del campo » ou « de la tierra » se 86 Naturellement, les romans historiques traitant des Guerres d‟Indépendance ne feront quasiment aucun cas de la ville. 44 développe un peu partout en Amérique latine, à Cuba, les romans sont plutôt urbains, même s‟ils ne s‟attachent pas forcément à décrire la ville87. Des récits situés à la campagne, qui offrent souvent une vision idyllique du monde rural, sont aussi publiés à l‟époque, bien évidemment, mais ils ne constituent pas un courant majeur. Les écrivains de la toute jeune République (1899-192388) sont surtout des « juges de leur temps »89 car ils dénoncent les maux de leur société en inscrivant leurs fictions dans un décor généralement urbain. Mais dans nombre de ces romans réalistes Ŕ mouvement littéraire dominant à l‟époque Ŕ la ville n‟est qu‟un simple référent topographique fictionnel. Les allusions à la capitale restent, en effet, fréquemment superficielles et anodines dans l‟économie générale des œuvres. Chez Jesús Castellanos et Alfonso Hernández Catá, La Havane est nommée mais peu ou pas décrite. Elle passe au second plan dans La manigua sentimental, de Castellanos, car le narrateur, le capitaine Juan Agüero, évoque surtout ses souvenirs de guerre parmi les mambises90. La seule description de la capitale représente l‟impact des Guerres d‟Indépendance sur la ville. Ainsi, c‟est un monde en putréfaction où les soldats loqueteux offrent un spectacle affligeant que le narrateur présente : La Habana era un gran vientre abierto que hedía al sol. Por las calles lodosas rondaban procesiones de soldados con vendas y astrosos reconcentrados cuya mano imploraba en las ventanas de los restaurants hasta que los barría con un terno la escoba del camarero. Sobre el empedrado, en que las basuras se podrían, pululaban los perros y su barahúnda se abría para el paso de un convoy resonante de heridos y enfermos que vomitaban la borra negra sobre el hombre de su compañero. En los parques, en los alrededores de Palacio, reía no obstante, una dorada población. Pero era una alegría teatral y enfermiza que no curaba la pátina verdosa de la piel y la fatiga de los ojos bajo las viseras. De vez en cuando se adornaba la ciudad con la vieja percalina, abriendo sus calles angostas a un batallón peninsular que avanzaba candoroso, todavía sonrosado, entre el escándalo de un pasa-calle. Después, tornaba a su vida emponzoñada, bajo el velo denso de las moscas. 91 L‟état de décomposition de la ville et de ses habitants constitue le fil conducteur de cette description. Le narrateur dépeint tout d‟abord une Havane qui se putréfie tel un corps malade (« un gran vientre abierto que hedía al sol »), puis des soldats déguenillés et miséreux, puis 87 « […] a diferencia del resto de las literaturas latinoamericanas coetáneas, que tuvieron un marcado carácter telurista, no se establece en la novelística cubana de este período una relación de identidad entre el hombre y la naturaleza, pues nuestra novelística de esos años es esencialmente urbana, aunque se cultivaron algunas novelas de ambiente rural », José Antonio Portuondo, Historia de la literatura cubana. Tomo II. La literatura cubana entre 1899 y 1958. La República, op. cit., p. 131. 88 Nous nous appuyons sur la périodisation littéraire faite par José Antonio Portuondo, in ibid., p. 127-150. 89 Ibid., p. 132. C‟est nous qui traduisons. 90 Rebelles séparatistes durant les Guerres d‟Indépendance. 91 Jesús Castellanos, Obras. Tomo II, « La manigua sentimental » (1910), Colección Póstuma publicada por la Academia Nacional de Artes y Letras, La Havane, Imprenta « El Siglo XX » de Aurelio Miranda, 1916, 2 t., p. 130, 131. 45 des déchets qui jonchent le sol, des chiens errants et enfin, des malades et des blessés qui, pourris de l‟intérieur, vomissent une boue noire. L‟évocation des nantis de la capitale (« una dorada población ») ne parvient pas à nuancer ce spectacle sinistre et abject puisque leur légèreté et insouciance est artificielle (« no curaba la pátina verdosa de la piel y la fatiga de los ojos »). Même les troupes espagnoles qui paradent encore triomphantes dans les rues de la ville sont gagnées par cette décomposition qui corrompt leurs mœurs (« su vida emponzoñada »). La métaphore filée de la putréfaction se clôt sur une image finale saisissante et explicite, celle d‟un essaim de mouches qui accompagne les soldats espagnols. C‟est donc à travers le prisme de la guerre et de ses ravages que Castellanos envisage La Havane dans cette description expressive et symbolique. Dans son récit inachevé, Los Argonautas, Castellanos développe davantage les descriptions urbaines puisque l‟intention de l‟auteur était de rendre compte de la société cubaine de la première décennie. A travers le personnage de Camilo Jordán, Cubain qui rentre au pays après avoir vécu quatre ans en Europe, le lecteur découvre la capitale de façon panoramique, depuis le transatlantique où Jordán se trouve : Camilo Jordán había identificado los repliegues de la orilla amable […]. El Vedado se fundía en una platabanda de suave verdura, con masas plenas en los montículos de las fortificaciones y motas claras de chalets, desgranados sin acuerdo, hasta resolverse débilmente entre los pinos del cementerio. Sobre su curvo balcón de lisa arcilla señorial, se asomaban en extraña tropa desnivelada los nuevos edificios de la Avenida del Golfo […] encimándose en tres manzanas, pintados de fresco algunos, otros todavía enmascarados de andamios : todo alzando a la envidia del vecino una loca presunción de maravilla arquitectónica. […] La lámina metálica del Frontón, bañaba en luz, hacía base a las discretas, cortesanas colinas de la Universidad, encrestadas de crema, y de gris. Una gran mancha de hollín, la planta eléctrica, afeaba el rubio panorama con seis dedos negros […] y dos columnas de humo que de ellos ascendía dominaban soberanas delante de una cadena de humos distantes que alentaban en las brechas del caserío, cual por Atarés, cual por Infanta, cual por el nimbo de Puentes Grandes… Dos tranvìas pequeðos como insectos, se perseguían cerca del Torreón ; y más próximo, ya neto y determinado, resbalaba sobre la cinta del Malecón un automóvil de gran lujo… Jordán comprobaba […] el desenvolvimiento rápido de la joven ciudad.92 La ville apparaît comme un immense tableau que le narrateur omniscient décrit en utilisant le procédé de l‟ekphrasis93. En effet, dans une énumération de phrases descriptives où les adjectifs occupent une place prépondérante (« amable », « suave », « plenas », « claras », « desgranados », « curvo », « lisa », « enmascarados », etc.), le narrateur expose en détail ce 92 Jesús Castellanos, « Los Argonautas », in Obras. Tomo II, Colección Póstuma publicada por la Academia Nacional de Artes y Letras, La Havane, Imprenta « El Siglo XX » de Aurelio Miranda, 1916, 2 t., p.19, 20. 93 L‟ekphrasis, en tant que description minutieuse et complète d‟une œuvre d‟art, réelle ou fictive, sera amplement étudiée dans notre troisième partie. 46 que le personnage a sous les yeux. Ainsi, le vaste panorama urbain est balayé par l‟œil du descripteur qui se pose tout d‟abord sur le quartier du Vedado en pleine extension qui voit se multiplier les constructions prétentieuses de l‟arrogante bourgeoisie de l‟époque. Puis il va s‟attarder sur la colline de l‟université et sur la centrale électrique d‟Atarés (située à l‟opposé du Vedado) pour enfin se poser sur le Malecón. Mais ce tableau n‟est pas figé et, à mesure que le narrateur scrute la ville, il s‟anime grâce aux tramways qui prennent vie quand ils sont comparés à des insectes ou encore grâce à une voiture qui circule sur le Malecón. L‟intérêt de cette pause descriptive est, d‟un point de vue narratif, de construire un cadre topographique global qui se précisera quand le personnage pénétrera dans la ville mais surtout, sur un plan romanesque, il est de mettre en lumière les changements qui ont transformé la ville depuis le départ de Camilo Jordán. Le personnage redécouvre donc la capitale cubaine avec le regard neuf et étonné de l‟étranger. Ce roman est certes inachevé et nous ne pouvons juger que des deux premiers chapitres écrits, mais l‟on constate cependant qu‟au fil des pages, les descriptions précises de la ville s‟estompent car elles servent avant tout à situer et à planter un décor au début du roman. Avec Philippe Hamon, nous pouvons dire qu‟ici, la description a une fonction d‟exposition car « elle inaugure le récit en le précédant et en le préparant »94. C‟est généralement avec plus d‟acuité et de régularité que Miguel de Carrión et Carlos Loveira représenteront, dans des récits ancrés dans le courant naturaliste, La Havane de la fin du XIXème siècle et La Havane républicaine et conféreront à la mise en mots de la ville une autre portée. Au sein des œuvres de Loveira, les références topographiques sont inégales : sporadiques et superficielles dans Generales y Doctores (1920), elles deviennent plus denses et surtout moins anodines dans Juan Criollo (1927), que d‟aucuns considèrent comme le meilleur roman de l‟auteur. En effet, tandis que dans Generales y Doctores, les descriptions de La Havane ne servent en rien la critique que l‟auteur fait de la République cubaine, où la corruption et le clientélisme règnent en maîtres, dans Juan Criollo, les allusions à la ville ne sont pas gratuites car elles viennent étayer la dénonciation sociale de l‟auteur et illustrent la force implacable de « l‟aveugle et puissante machine sociale »95, formule qui pourrait quasiment servir d‟exergue au roman. Même si à la toute fin du récit, Juan Cabrera finit par se hisser dans les hautes sphères de la société cubaine (il devient un homme politique fortuné mais profondément cynique), l‟auteur s‟applique surtout à décrire la misérable existence de 94 Philippe Hamon, La description littéraire. De l’Antiquité à Roland Barthes : une anthologie, Paris, Macula, 1991, p. 11. 95 Carlos Loveira, Juan Criollo (1927), La Havane, Consejo Nacional de Cultura, 1962, p. 46. C‟est nous qui traduisons. 47 cet orphelin et le déterminisme social dont il est victime. L‟enfance, l‟adolescence et le début de l‟âge adulte du personnage sont marqués du sceau de l‟inégalité sociale, comme l‟attestent les nombreuses descriptions des différents endroits où il a vécu avec sa mère, avant que celleci ne meure : « Habitaba con su madre una casucha de madera y zinc, en lo que era entonces una orilla de La Habana : la pina calle del Príncipe, cerca del litoral, en aquellas fechas huérfano de asfaltado, malecón y palacetes ; abundante de charcos, basuras y construcciones como la tal casucha »96. Juan et sa mère, Josefa, vivent dans un taudis, situé dans un quartier excentré de la ville, pauvre et dépourvu de tout confort. Mais la spirale infernale de la pauvreté les obligera à s‟installer dans des zones encore plus difficiles : « De una casita de ocho pesos al mes, en Vives, pasaron a una accesoria de seis en un solar de Jesús y María, y del solar fueron a caer, de mal en peor, a un tugurio de madera del miserable arrabal de la Víbora »97. Cette descente progressive vers l‟indigence, qui les mène d‟une petite maison de Centro Habana, située tout près de la gare ferroviaire, à un galetas des faubourgs s‟accompagnera parallèlement d‟une certaine déchéance morale : Josefa Valdés sera obligée de se prostituer pour subvenir à leurs besoins. Après la mort de sa mère, Juan sera recueilli par une famille bourgeoise (la famille de Don Roberto qui fut l‟amant de Josefa), certes appauvrie, mais qui, par contraste, représente l‟opulence. Leur demeure spacieuse se trouve dans le quartier aristocratique de El Cerro : La quinta del Cerro estaba a una cuadra de la Calzada, y era acabado tipo de las mansiones señoriales de la época, situadas en los barrios extremos de la ciudades cubanas : sólidas y espaciosas, pero sin verdadero confort ni mayores complacencias arquitectónicas. Media manzana, con una casona de dos pisos en medio y, en torno, la tosca verja de hierro […].98 Et le narrateur de poursuivre en décrivant l‟intérieur de la villa : La casona tenìa […] un gabinete de estudio, con diez estantes de libros de medicina, y una sala en que holgadamente se empolvaban las veinte y pico de piezas de un juego Luis XIV, recio y monumental. Después, saleta y comedor inmensos. En seguida, divididas por un patio de losas “isleðas”, dos hileras de cuartos de proporcionales dimensiones. […]. Al lado estaba el baðo, con descomunal bañera de cemento, dos duchas, cuatro llaves laterales y amplio desagüe. […] Luego, la cocina, grande como la de una fonda, con friso de azulejos, chimenea de ladrillos y media locería […].99 96 Ibid., p. 5. Ibid., p. 34. 98 Ibid., p. 53. 99 Ibid., p. 53-55. 97 48 Cette longue et minutieuse description, qui s‟étend sur plusieurs pages, prend des allures d‟inventaire exhaustif : le narrateur pénètre dans chacune des pièces, décrit le patio intérieur et ses plantes, s‟attarde sur les dépendances des domestiques ou examine encore les murs, les fenêtres et les vitres de la propriété. Cette longue parenthèse n‟est pas sans rappeler la description de la maison des Gamboa, dans Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, évoquée précédemment. Dans les deux cas, le narrateur décrit précisément les habitats pour mieux souligner les contrastes sociaux entre deux groupes d‟individus. Chez Carlos Loveira, ce passage descriptif, nettement isolé du reste de l‟œuvre, permet au lecteur de se figurer le milieu dans lequel Juan va s‟introduire. Dans un effet d‟anticipation, elle présente aussi, grâce à l‟évocation de leur chambre ou de leur bureau, les différents acteurs de cette grande famille au sein de laquelle Juan connaîtra, certes, un peu de répit mais aussi l‟injustice, l‟humiliation et l‟exil. A l‟image de Loveira, Miguel de Carrión va lui aussi s‟appuyer sur les descriptions de la ville pour renforcer sa critique de la société cubaine. L‟hypocrisie des valeurs morales de la petite bourgeoisie de l‟époque est vilipendée dans des romans naturalistes plus psychologisants que ceux de Loveira : Las honradas (1918) et Las impuras (1919). Dans Las honradas, La Havane devient le lieu de la tentation et du péché car Victoria y trompe son mari, tandis que la fabrique de sucre de canne, située à la campagne, est au contraire le lieu de la raison et du devoir conjugal. Les premières descriptions de la capitale cubaine orientent d‟ailleurs cette lecture symbolique car elles font de la ville un lieu désagréable et hostile : « No olvidaré nunca la desagradable impresión que me produjo La Habana […] : las casas bajas, las calles estrechas, las aceras ilusorias y la cara demacrada de sus habitantes »100. C‟est à travers le regard de Victoria, narratrice du roman, que le lecteur perçoit la ville ; nous avons donc une vision partiale et partielle de La Havane alors que dans Las impuras, la narration omnisciente permet des descriptions tout aussi subjectives mais plus nombreuses et plus fouillées. Dans ce roman, la ville reste le lieu de la faute mais elle est aussi celui de la ruine puisqu‟elle marque la perdition du protagoniste Rogelio. Personnage influençable et inconstant, il va succomber aux nombreuses tentations qu‟offre la cité : Pero los últimos seis meses que habìa vivido en La Habana […] ocasionaron un profundo cambio en la dirección de sus ideas. Adquirió nuevas amistades de hombres y de mujeres, que influyeron mucho en su espíritu. Tomó parte en la vida sensual y fácil de la ciudad, llena de aventureros […] dispuestos a gozar sin escrúpulos de todos los placeres […].101 100 101 Miguel de Carrión, Las honradas (1918), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2001, p. 47. Id., Las impuras (1919), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2001, p. 57. 49 L‟influence de la ville sur Rogelio est manifeste : il change radicalement à son contact et ses fréquentations évoluent elles aussi. Synonyme de plaisirs débridés, de prostitution et de jeu, La Havane l‟étourdit et le happe mais elle ne l‟amusera qu‟un temps car, très vite, Rogelio va se perdre, entraînant au passage la perte de sa maîtresse, Teresa. Représentant tout d‟abord la liberté, la frivolité et l‟inconscience, la ville va rapidement le dégoûter car elle ne sera plus qu‟un piège infâme : « […] y La Habana misma se le ofreciñ a la manera de un cubil infecto, donde los hombres de su mérito se sumergían hasta el cuello en el cieno o morían tristes y arrinconados en algún agujero desconocido »102. Pour Rogelio, la ville n‟est plus qu‟un marécage où l‟on s‟enlise inéluctablement dans la débauche. Incapable d‟abandonner sa vie dissolue et de mener à bien ses projets, ce personnage est le paradigme du jeune petitbourgeois désargenté, oisif et dépourvu de morale, corrompu par la ville. Les deux extraits cités montrent bien que la capitale est associée à la dissolution des mœurs car, même si elle n‟en est pas responsable, elle accélère incontestablement le processus de dépravation ; nous y reviendrons dans notre deuxième partie. Sans doute parce qu‟il est plus sociologique que Las honradas, ce roman fait la part belle à La Havane, qui se charge ainsi d‟une fonction explicative et symbolique : c‟est le lieu du vice, des mœurs légères (des femmes impures, comme le suggère le titre), des turpitudes et de la corruption politique. Chez Loveira et chez Carrión, évoquer ou décrire La Havane permet de critiquer la société cubaine de la fin du XIXème siècle et de la jeune République. Puisqu‟il semble naturel de choisir la ville pour mettre en lumière tous les travers d‟un pays, la perception du monde urbain est assez négative dans les romans du début du XXème siècle. Quelques années plus tard (1923-1935), alors que de nouvelles thématiques émergent dans les romans à mesure que se développe l‟avant-garde littéraire, le traitement de La Havane en littérature n‟évolue guère. A côté des romans ruraux, qui mettent au jour les conflits et les préoccupations du monde paysan, des romans historiques et de la littérature negrista103, qui gagne en importance dans les années trente, le roman urbain peine à doter la ville d‟autres fonctions que celles de simple référent spatial. De plus, c‟est souvent avec une perception pessimiste et négative que la capitale cubaine est, une fois de plus, convoquée. Dans son 102 Ibid., p. 115. C‟est nous qui soulignons. Littérature qui évoque la culture des Noirs cubains et ses racines africaines. Nicolás Guillén, Lydia Cabrera et le Carpentier de Écue-Yamba-Ó (1933) en sont les représentants les plus éminents. 103 50 recueil de nouvelles Felisa y yo (1937)104 et dans son roman Contrabando (1938), Enrique Serpa ne fait que sporadiquement allusion à La Havane. Comme son titre l‟indique, ce roman met en scène des marins contrebandiers d‟alcool pendant l‟époque de la Prohibition aux EtatsUnis. La ville n‟est donc qu‟un lointain point d‟ancrage qui bénéficie néanmoins de quelques descriptions précises et réalistes, mais non dénuées d‟une certaine poésie, comme lorsqu‟il s‟agit de rendre compte du tumulte de la zone portuaire : Entre Santa Clara y el muelle de Luz se abría, cual una pupila legañosa, un trozo de mar calmo y sucio, de tono verde y apagado. A la izquierda se alineaban mugrientas goletas de dos palos, abarrotadas de madera o de sacos de carbón vegetal. Y a la derecha, entre gritos, pitazos y paf-paf de motores, varias lanchas de pasajeros disponían a zarpar hacia Regla y Casa Blanca. 105 L‟auteur évoque assez crûment la réalité urbaine, en témoigne cet extrait qui se concentre sur la saleté des abords du port (« sucio », « mugrientas »). Même le caractère poétique de la comparaison, qui assimile les quais du port à une pupille qui s‟ouvrirait, se trouve annulé par l‟adjectif « legañosa », qui renvoie à la crasse ambiante. Aucun quartier ne trouve grâce aux yeux du narrateur : La Habana Vieja, Centro Habana, les quartiers excentrés et pauvres de la ville ou les abords du port sont tous traités avec le même vérisme implacable. Mais aussi répugnante soit-elle, La Havane ne sert que d‟arrière-plan aux activités des trafiquants car l‟essentiel de l‟action se déroule sur le navire interlope « La Buena Ventura », en mer. De plus, tout au long du roman, l‟accent est mis sur les personnages, leurs préoccupations et leur complexité, qui apparaissent clairement grâce à la narration homodiégétique et aux monologues intérieurs du protagoniste, El Almirante. Cet intérêt pour les personnages, qui constitue l‟une des caractéristiques de cette œuvre de l‟avant-garde cubaine, explique aussi, mais en partie seulement, que l‟espace passe au second plan. Chez Serpa, la ville est donc uniquement « désignée » ou « signalée » de manière épisodique, pourrait-on dire, au profit d‟autres catégories narratives. Beaucoup plus tard, Canción de Rachel (1969), roman-témoignage de Miguel Barnet, constitue un autre exemple probant de ces romans qui se déroulent entièrement ou partiellement à La Havane mais qui assujettissent l‟espace urbain à des fonctions secondaires. Dans Canción de Rachel, le narrateur évoque lui aussi assez succinctement La Havane de la République (de 1901 à la présidence de Machado) avec ses théâtres (El Tívoli, El Molino Rojo, El Albizu, La Comedia, El Alhambra, El teatro Tacón) car la protagoniste est actrice et 104 105 Enrique Serpa, Felisa y yo, La Havane, Ediciones Álvarez-Pita, 1937. Id., Contrabando (1938), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2007, p. 21. 51 danseuse. La ville effervescente et joyeuse sert donc de toile de fond au récit autobiographique de Rachel : La Habana era muy linda, más linda que hoy, porque había placidez. El mar frente a mi casa, las olas, el Morro cerca, el muro del malecón, los vendedores de maní, chinos casi siempre ; mi Habana de noche era una feria. Caminar, caminar era lo mío, mi hobby, nada de coleccionar sellitos, ni muñequitas de biscuit [...]. Caminar hasta el agotamiento.106 C‟est essentiellement la ville du spectacle que nous livre la narratrice protagoniste en évoquant ses souvenirs. Elle fait également allusion à quelques événements marquants de la jeune république qui constituent la toile de fond historico-sociale du roman. D‟autres interventions de différents personnages-narrateurs complèteront les propos de la vedette mais les descriptions de la ville resteront sommaires et superficielles car il s‟agit, pour l‟auteur, de montrer la futilité et superficialité de la société havanaise prérévolutionnaire. Certains verront d‟ailleurs dans ce roman une profonde dénonciation de toute la société cubaine : La novela es una denuncia de la relajación de las costumbres y de la corrupción moral que imperaron en la vida cubana desde la instauración de la república hasta el triunfo de la revolución castrista [...]. Raquel es el símbolo de lo que fue Cuba por más de cincuenta años de vida republicana. La ausencia de valores morales que puedan edificar la personalidad es el detalle que hace resaltar Barnet en la caracterización de este personaje. El autor la presenta como rumbera, artista de circo, prostituta profesional, actriz de teatro, matrona de prostíbulo, al mismo tiempo que destaca el espíritu alegre y despreocupado del cubano que no toma la vida muy en serio. 107 Que la ville serve ou non ce propos dénonciateur, elle est, en tout cas, uniquement au service de l‟intrigue romanesque et n‟a qu‟une fonction décorative. Si l‟on fait un bond dans le temps pour nous pencher sur la littérature contemporaine, nous remarquons tout d‟abord que celle-ci accorde généralement une place importante à la ville. Le concept même de roman urbain est de fait assez moderne. Cela dit, là encore le traitement descriptif de La Havane est très inégal d‟une œuvre à l‟autre et l‟on ne saurait s‟étonner que la ville soit quasiment absente d‟un récit même quand ce dernier s‟y déroule entièrement. La capitale cubaine n‟est en effet qu‟un cadre ou un décor dans le roman d‟Antón Arrufat, La noche del Aguafiestas (2000), où l‟absence de descriptions précises est à la fois déroutante et révélatrice. Alors que les quatre personnages ne cessent de déambuler dans une Havane 106 Miguel Barnet, Canción de Rachel (1969), Madrid, Ediciones Alfaguara, 1987, p. 97. Ernesto Méndez y Soto, Panorama de la novela cubana de la Revolución (1959-1970), Miami, Ediciones Universal, 1977, p. 112, 113. 107 52 nocturne et silencieuse où le temps est comme suspendu, la ville n‟est qu‟un lointain décor. La cité est omniprésente dans l‟intrigue romanesque puisque c‟est toute l‟histoire qui s‟y déroule : le narrateur évoque en effet la promenade que font quatre amis dans les rues de La Havane. Mais elle brille par son absence dans le texte littéraire où nous ne trouvons quasiment aucune description spatiale. Même lorsque les amis de l‟évanescent Aguafiestas partent à sa recherche, les références topographiques sont minces car la parole et les digressions du personnage sont au centre du récit. La prolixité de El Aguafiestas anéantit en quelque sorte la ville qui se retrouve quasiment niée alors qu‟elle constitue l‟unique espace du roman, car c‟est la parole qui fait exister El Aguafiestas et qui fonde le récit : « El aguafiestas [...] no podía existir sin la compañía, sin la conversación entre amigos [...] »108. La suprématie du verbe et l‟omniprésence de la parole dans ce roman109, qui ne sont pas sans rappeler la dialectique platonicienne, éclipsent l‟espace urbain car Arrufat semblerait vouloir situer son récit hors de l‟espace-temps. A l‟opposé de ces romans qui se déroulent en totalité ou en partie dans la capitale et qui n‟exploitent que très peu le référent urbain, nous trouvons à la même époque des œuvres qui créent une véritable ville littéraire et fondent une Havane mythifiée. b- Les architectes de la ville littérarisée Si les relations entre ville et littérature ne sont pas nouvelles, force est de constater qu‟à partir de la deuxième moitié du XXème siècle, elles vont s‟intensifier et se complexifier. A Cuba, et en Amérique latine de façon générale, nombre d‟écrivains vont faire des espaces urbains leurs décors littéraires de prédilection, voyant dans ces derniers des scènes plus propices aux nouveaux intérêts et aux nouvelles inquiétudes du roman moderne110. Tensions sociales, violence, quêtes ontologiques s‟écrivent à mesure que la ville littérarisée gagne en densité. Pour expliquer l‟émergence du roman urbain dans la littérature, ajoutons qu‟à Cuba le nombre de publications va augmenter considérablement, surtout à partir de l‟impulsion éditoriale des années soixante, qui est l‟un des résultats des politiques culturelles de la Révolution. Il est donc naturel de voir la ville occuper une importance croissante et des fonctions différentes 108 Antón Arrufat, La noche del Aguafiestas, (2000), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2002, p. 7. En cela (et uniquement en cela), La noche del Aguafiestas pourrait rappeler la prolixité de Tres tristes tigres. 110 Pour une étude plus approfondie de l‟émergence de la littéreature urbaine en Amérique latine, voir : Fernando Aínsa, Narrativa hispanoamericana del siglo XX Ŕ Del espacio vivido al espacio del texto, op. cit., p. 81-84. 109 53 dans des romans de genre et de facture très variés 111. Nous allons voir à présent quels sont les grands noms de la littérature cubaine qui ont bouleversé la perception de l‟espace urbain en construisant une ville faite de mots. Là encore, nous ne prétendons pas être exhaustive, au contraire, nous souhaitons établir un panorama diachronique capable de faire émerger quelques écrivains et quelques œuvres qui nous semblent être de véritables jalons pour la thématique qui nous occupe. La figure de Guillermo Cabrera Infante, qui publie Tres tristes tigres en 1967, est incontournable dès lors que l‟on évoque La Havane littérarisée. Il est, en effet, l‟un des tout premiers écrivains à placer la ville au cœur de sa fiction, jusqu‟à en faire le cinquième protagoniste de son roman112. Cette œuvre expérimentale, que l‟auteur refusait de qualifier de roman, marque une rupture profonde à bien des égards. En accordant une place prépondérante au langage (celui-ci est finalement plus important que la trame), depuis le titre même et à travers un luxe de jeux de mots, de calembours, de répétitions, d‟allitérations ou encore de paronomases, l‟auteur crée une littérature nouvelle, ludique et inventive qui abolit les genres. Littérature, essai, théâtre, cinéma et chanson populaire se mêlent dans cette œuvre foisonnante qui s‟est imposée comme l‟un des grands romans du boom latino-américain. Mais, comme nous l‟avons dit, Tres tristes tigres marque aussi un changement quant à la fonction de l‟espace urbain car La Havane structure le récit littéraire. Les descriptions extrêmement détaillées des pérégrinations des quatre personnages (Cué, Silvestre, Códac et Eribó) à travers la capitale permettent de recréer la vie nocturne de La Havane des années cinquante et offrent au lecteur une vision globale, voire panoramique, de la ville. Comme l‟avait fait Cirilo Villaverde au XIXème siècle à l‟échelle de La Habana Vieja, Cabrera Infante cartographie la ville mais cette fois à une échelle beaucoup plus grande. En effet, Le Vedado et le Malecón, essentiellement, mais aussi Centro Habana, La Habana Vieja et le port sont les quartiers de prédilection des quatre artistes et sont, à ce titre, décrits à de nombreuses reprises. Le lecteur peut suivre à la trace les nombreux déplacements des compères qui, au volant de leur voiture, voient défiler le paysage urbain. Citons, à titre d‟exemple, un passage parmi tant d‟autres qui montre la précision presque étourdissante de la description des trajets qu‟ils effectuent : 111 Pour une analyse plus détaillée du nombre de publications mettant en scène La Havane entre 1959 et 1981, voir Ineke Phaf, Novelando La Habana, op. cit., p. 73-77. 112 Fernando Aìnsa dit à son sujet : « […] las „voces‟ de La Habana tienen a Guillermo Cabrera Infante como su mejor „polìgrafo‟ », Fernando Aìnsa, Narrativa hispanoamericana del siglo XX Ŕ Del espacio vivido al espacio del texto, op. cit., p. 83. 54 Dimos la vuelta por Paseo y subimos por estas terrazas naturales hechas parque por la historia, que siempre me confunde con su avenida gemela de los Presidentes, y bajamos por Veintitrés hasta La Rampa, torcimos por la calle M y dimos la vuelta al Habana Hilton, subiendo por Veinticinco a coger la calle L hasta Veintiuno [...]. Aprovechó que doblaba por Veintiuno y enfiló hacia el Nacional, a todo trapo. Entramos en el ámbito, en el lobby vegetal del hotel113. Toutes les rues et les avenues traversées sont énumérées dans une sorte de liste topographique vertigineuse comme si l‟essentiel était de reconstruire précisément tous les parcours réalisés. On remarque d‟ailleurs que le narrateur ne s‟appesantit pas sur la description de ces rues. Un lieu chassant l‟autre, seul le mouvement parvient à s‟imposer, comme le suggère, de surcroît, l‟accumulation de verbes d‟action (« Dimos la vuelta », « subimos », « bajamos », « torcimos », « doblara », « enfiló », « entramos »). Lorsqu‟il s‟agit de faire allusion à l‟espace festif et nocturne dans lequel le quatuor évolue, le narrateur procède également par énumération, en dressant des listes quasi taxinomiques de bars, de cabarets, de clubs, de cinémas et d‟hôtels. Cités et inventoriés constamment, ces hauts lieux de la nuit havanaise ne sont pas pour autant décrits : Bar San Juan y Club Tikoa y La Zorra y El Cuervo y el Eden Rock [...], y La Gruta donde todos los ojos son fosforescentes porque las criaturas que habitan este bar y club y cama son pejes abisales y Pigal o Pigalle o Pigale que de todas maneras se dice y Wakamba Self Service y Marakas y su menú en inglés y su menú afuera y sus letras chinas en neón para confundir a Confucio, y La Cibeles y el Colmao y el Hotel Flamingo o el Flamingo Club [...].114 Ces « listes », qui sembleraient extensibles à l‟infini et qui se succèdent dans le roman, font dire à Emma Álvarez-Tabío Albo que Cabrera Infante transforme la ville en « un catálogo, una guía de las posibilidades del ocio y el placer »115. En abondant dans son sens, nous pouvons ajouter qu‟en les citant tous, l‟auteur cherche une exhaustivité qui n‟a plus simplement pour objet de « faire vrai » mais de reconstruire, par le biais de la littérature, cette Havane des années cinquante qui a marqué sa jeunesse. Tres tristes tigres, à la manière de Cecilia Valdés pour le XIXème siècle, est une œuvre originale et décisive dans notre corpus car pour la première fois la ville est le moteur de l‟intrigue, à l‟instar des personnages. Nous retrouvons cette omniprésence de La Havane en 1979, dans La Habana para un infante difunto, roman plus intimiste où la ville est étroitement liée à la trajectoire personnelle du 113 Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres (1967), Barcelone, Seix Barral, Booket, 2007, p. 445, 446. Ibid., p. 85. 115 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 344. Elle évoque ici La Habana para un infante difunto mais cette remarque vaut aussi pour Tres tristes tigres. 114 55 protagoniste (et de l‟auteur lui-même) puisqu‟elle participe à l‟initiation qu‟il va connaître. Le roman retrace, en effet, son passage de l‟enfance à l‟adolescence puis à l‟âge adulte ; il décrit son arrivée à la capitale, ses premières impressions et émotions amoureuses. Là encore, la ville est l‟un des fils conducteurs du récit car les descriptions sont abondantes et les parcours effectués sont retracés avec précision. L‟extrait qui suit devrait suffire à le prouver : [...] vamos a subir hasta el final de esta calle, del paseo [...] y luego doblamos a la derecha por la calle dos [...]. Ella quería conocer la exacta topografía de los alrededores. [...] Reanudamos el paseo por Paseo [...] la interné en el terreno escabroso que conducía a la calle 31. Yo podía haberla llevado por la calle Zapata [...] hasta la calle 2 y por allí bajar hasta 31, pero vi un bar abierto en la esquina [...] y decidí tomar el camino más difícil, desde el punto de vista físico, pero a la vez más fácil, desde el punto de vista social. [...] Dulce seguía dejándose llevar por mí [...] sin saberlo Dulce estaba en medio de la selva habanera) nos acercábamos fatalmente al edificio erótico de la posada, guardado por su muro alto abierto por dos lados, brechas que no eran puertas sino accesos para autos y taxis y la posible pareja peatona Ŕ es decir, nosotros dos.116 Absolument tous les lieux évoqués ont un lien direct avec l‟histoire personnelle et sentimentale du protagoniste puisque, à la manière de Giacomo Casanova, dans Histoire de ma vie, Guillermo Cabrera Infante passe en revue les divers épisodes érotiques qui ont marqué la jeunesse du narrateur (et la sienne). Ainsi, les bars, les cabarets, les hôtels de passe, les rues, renvoient à une histoire d‟amour et à une fille en particulier car pour l‟auteur, la ville sert de scène, de décor et de point de repère géographique aux aventures de son personnage et devient aussi un espace à conquérir. L‟écrivain assume ce parti pris : « Pero ésas eran excursiones y yo quiero hablar de incursiones íntimas y hacer un mapa de los cines en que vivía, describir la topografía de mi paraíso encontrado y a veces de mi patio de luneta »117. L‟auteur décrit en détail une Havane personnelle et intime pour recréer, depuis l‟exil, une ville liée à son passé118, comme l‟atteste l‟évocation du premier appartement familial à La Havane, dans la rue Zulueta : « La etapa Zulueta 408, más que un tiempo vivido, fue toda una vida y debió quedar detrás como la noche, pero en realidad era un cordón umbilical que, cortado de una vez, es siempre recordado en el ombligo »119. Nous analyserons ultérieurement ce lien unique et quasi viscéral qui unit Cabrera Infante à La Havane mais nous pouvons avancer dès à présent qu‟il existe un parallélisme étroit entre la réécriture de la ville et la quête identitaire de l‟auteur : il tente de posséder à nouveau une ville perdue et donne un 116 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto (1979), Barcelone, Seix Barral, 2006, p. 322, 323. 117 Ibid., p. 147. C‟est nous qui soulignons. 118 Nous consacrerons une partie à la ville recréée et idéalisée à cause de l‟exil dans notre deuxième partie. 119 Ibid., p. 122. C‟est nous qui soulignons. 56 territoire au souvenir. Isabel Álvarez-Borland qualifie d‟ailleurs Cabrera Infante d‟ « architecte d‟une ville de mots érigée dans le temps »120. Le XXème siècle compte bien d‟autres « architectes » de La Havane qui construisent une ville faite de mots et nous ne saurions poursuivre cette rapide étude chronologique sans évoquer Alejo Carpentier qui a aussi grandement participé au renouveau de la littérature cubaine en lui conférant, notamment, une portée plus universelle. Le créateur de « la ciudad de las columnas »121 accorde une place prépondérante à la ville dans ses écrits, comme en témoigne l‟essai qui vient d‟être cité. Signalons au passage que le terme « architecte » lui convient d‟autant mieux qu‟il a reçu l‟influence directe de son père architecte, Jorge Julián Carpentier, et qu‟il a lui-même suivi des études d‟architecture à l‟université de La Havane. Nous aurons l‟occasion de voir que ce substrat marquera profondément sa prose. Comme le dit Emma Álvarez-Tabío Albo, avec Carpentier la ville cesse véritablement d‟être paysage pour devenir texte122 car, aussi bien dans ses essais que dans ses romans, il reconstruit la ville avec des mots. C‟est en l‟occurrence une langue baroque et chatoyante qui sert de support à cette Havane qui est littérarisée dans Écue-Yamba-Ó (1933), El acoso (1956) 123, El siglo de las luces (1962), La consagración de la primavera (1978)124 et El recurso del método (1974). A cette liste s‟ajoute, bien sûr, l‟essai cité précédemment, La ciudad de las columnas (1970), où l‟auteur se livre à une description précise de certains éléments architecturaux propres à la capitale (patios, colonnes, balcons, grilles en fer forgé, mamparas125, fenêtre en medio punto126, etc.). Là encore, La Havane va bien au-delà du simple référent spatial car, chez Carpentier, écrire la ville constitue une fin en soi. Sans déflorer notre troisième chapitre, nous pouvons dire qu‟il ne s‟agit plus d‟obéir au principe d‟ « illusion référentielle », en décrivant le plus fidèlement possible un espace réel, mais de recréer La Havane par le truchement d‟une 120 Isabel Álvarez-Borland, « Viaje verbal a La Habana, ¡ Ah Vana ! Entrevista de Isabel Álvarez-Borland con Guillermo Cabrera Infante, arquitecto de una ciudad de palabras erigida en el tiempo », in Hispamérica II, n°31, Avril 1982, p. 63. 121 Alejo Carpentier, La ciudad de las columnas (1970), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 1982. 122 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 345. 123 Yolanda Izquierdo considère El acoso comme une œuvre majeure dans l‟histoire des représentations littéraires de la ville : « [...] en El acoso, se funda literariamente la ciudad de La Habana [...] Alejo Carpentier en El Acoso se propone la fundación del mito de La Habana de la modernidad a partir de sus constantes estilísticas, de su barroquismo, en un intento de superar la visión costumbrista de la novelística [...] », Yolanda Izquierdo, Acoso y ocaso de una ciudad. La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, op. cit., p. 13. 124 Pour souligner l‟importance de La Havane dans ce roman, citons Julio Rodrìguez Puértolas : « [...] la ciudad de La Habana, cuya presencia en La consagración de la primavera es de tal importancia, que llega a adquirir relevancia de personaje. Está prácticamente humanizada, y se hace sentir como algo vivo, palpitante », Julio Rodríguez Puértolas, « Introducción », in Alejo Carpentier, La consagración de la primavera (1978), Madrid, Castalia, 1998, p. 55. 125 Portes situées à l‟intérieur des maisons qui, comme des paravents, divisent l‟espace. 126 Fenêtres en arc de cercle situées au-dessus des portes. 57 écriture baroque. Citons simplement un extrait de la toute première page du roman El siglo de las luces, véritable fresque historique et épique qui relate l‟impact de la Révolution française dans les Caraïbes de 1789 à 1808 et dont de nombreux passages illustrent la théorie du « réel merveilleux », si chère à l‟auteur127. Ces quelques lignes qui suivent l‟incipit sont caractéristiques du style de Carpentier et de sa volonté de suggérer tout en décrivant : El adolescente miraba la ciudad, extrañamente parecida, a esta hora de reverberaciones y sombras largas, a un gigantesco lampadario barroco, cuyas cristalerías verdes, rojas, anaranjadas, colorearan una confusa rocalla de balcones, arcadas, cimborrios, belvederes y galerías de persianas Ŕ siempre erizada de andamios, maderas aspadas, horcas y cucañas de albañilería, desde que la fiebre de la construcción se había apoderado de sus habitantes enriquecidos por la última guerra de Europa.128 Cette scène inaugurale consacrée au jeune Carlos qui contemple La Havane constitue un exemple révélateur de l‟écriture baroque de l‟auteur. L‟intérêt pour les détails chromatiques (« verdes », « rojas », « anaranjadas »), la lumière (« reverberaciones », « sombras ») ainsi que pour les constructions architecturales, les comparaisons (ici, la ville ressemble à un lampadaire baroque) et l‟énumération non pas d‟adjectifs mais de substantifs appartenant à un champ lexical précis (« balcones », « arcadas », « cimborrios », « belverderes », etc.) sont autant de signes qui singularisent l‟écriture littéraire de Carpentier. Il s‟agit d‟une écriture baroque, on l‟a dit, mais qui l‟est à plus d‟un titre car l‟auteur, pour construire « la ciudad monumental »129, emprunte des éléments disparates : dans El siglo de las luces, il s‟inspire des écrits de Humboldt (datant du XIXème siècle) pour décrire La Havane du XVIIIème siècle et dans El recurso del método, la ville de Nueva Córdoba est un mélange de La Havane (avec son Capitole, sa cathédrale dont les tours ne sont pas très hautes, son Parque Central, ses palmiers, etc.130) et d‟autres villes latino-américaines. Dans la veine baroque, citons aussi un autre écrivain majeur de la littérature cubaine qui partage avec Carpentier la même vocation universaliste : José Lezama Lima. Architecte lui aussi à sa manière, il convoque la capitale cubaine dans ses écrits poétiques, ses articles et ses 127 Dans le prologue de son roman, El reino de este mundo (1949), Alejo Carpentier explique que le merveilleux se trouve à l‟état naturel sur le continent américain et qu‟il n‟a nul besoin des artifices des surréalistes pour être révélé. Nous y reviendrons dans notre troisième partie lorsqu‟il sera question du baroque cubain. 128 Alejo Carpentier, El siglo de las luces (1962), Barcelone, Seix Barral, 2007, p. 13. 129 Nous reprenons l‟expression qu‟emploie Emma Álvarez-Tabío Albo pour qualifier la ville chez Alejo Carpentier, Invención de La Habana, op. cit., p. 133-189. 130 Alejo Carpentier, El recurso del método (1974), Mexico, Siglo Ventiuno Editores, 1998, p. 159, 167, 168, 169, 182. 58 essais (écrits regroupés dans La Habana131) et ses romans (Paradiso [1966] et Oppiano Licario [1977]). Pour Lezama, il ne s‟agit pas tant de nommer la ville, les lieux, les rues, de décrire précisément les déplacements, que de transcrire une atmosphère mystérieuse et symbolique ou de sentir, comme l‟a dit Cintio Vitier, le « corps sacramental de la Ville »132. Dans l‟étude qu‟elle consacre à ces deux romans, Alina Camacho-Gingerich ne dit pas autre chose : Lo que interesa a Lezama, claro está, no es una representación fiel de la realidad (rechaza enfáticamente la mimesis y causalidad aristotélica) sino su visión de la realidad y la historia, vistas a través de la poesía y, específicamente de la imagen poética. Todos esos elementos que constituyen el referente, o la realidad extratextual, sufren una transformación o transfiguración al ser incorporados en el sistema poético lezamiano.133 Dans Paradiso, son œuvre narrative emblématique, l‟auteur brouille les frontières entre poésie, roman et essai. Il crée un texte assez hermétique, fortement autobiographique, dont les niveaux de lecture peuvent être multiples. Le récit du quotidien du jeune José Cemí, qui vit avec sa famille à La Havane, durant le premier tiers du XXème siècle, et celui de ses relations avec ses amis de l‟université (Fronesis et Foción), sont vite supplantés par un discours allégorique et mythique empreint de poésie. A l‟image du roman, La Havane que construit le narrateur est aussi onirique et symbolique mais n‟en demeure pas moins un référent spatial clairement déterminé. La Havane de Cemí se compose de la maison familiale de la rue du Prado, de ses environs (Centro Habana et le Malecón), de l‟université (appelée Upsalón dans le roman) et de La Habana Vieja, où se trouvent, au passage, les deux rues préférées de Cemí : Cemí salió de la siesta con deseos de salir de la casa y caminar por Obispo y O‟Reilly para repasar las librerìas. Esas dos calles fueron siempre sus preferidas [...]. Por una de esas calles parece que se sigue la luz hasta el mar, después al regreso por una especie de prolongación de la luz, va desde la claridad de la bahía hasta el misterio de la médula de saúco [...]. Esas dos calles tienen algo de barajas. Constituyen una de las maravillas del mundo. Raro era el día que Cemí no las transcurría, extendiéndose en sus prolongaciones, la plaza de la catedral, la plaza de los Gobernadores generales, la plaza de San Francisco, el templete, el embarcadero para la Cabaña, Casablanca o Regla. Los pargos que oyen estupefactos las risotadas de los motores de las lanchas [...], la compenetración entre la fijeza estelar y las incesantes mutaciones de las profundidades marinas contribuyen a formar 131 José Lezama Lima, La Habana. JLL interpreta su ciudad, Madrid, Editorial Verbum, 1991. Il existe une autre édition qui réunit les mêmes articles (parus en 1949 dans le Diario de la Marina) : Revelaciones de mi fiel Habana, La Havane, Ediciones Unión, 2010. 132 Cintio Vitier, « Un libro maravilloso (II) », in Diario de la Marina, La Havane, 29 juin 1958, p. 4. 133 Alina Camacho-Gingerich, La cosmovisión poética de José Lezama Lima en Paradiso y Oppiano Licario, Miami, Ediciones Universal, 1990, p. 23. 59 una región dorada para un hombre que resiste todas las posibilidades del azar con una inmensa sabiduría placentera.134 On le voit, le traitement spatial est, dans cette œuvre, tout à fait singulier : Lezama mêle inextricablement les évocations concrètes de la réalité urbaine (les rues, les lieux précis) et les images poétiques. Ainsi le réel est-il sublimé grâce aux comparaisons (« tienen algo de barajas »), aux métaphores (« el misterio de la médula de saúco ») et aux personnifications (« los pargos que oyen estupefactos las risotadas de los motores »). D‟un point de vue formel, le rythme des phrases Ŕ souvent longues, grâce aux asyndètes qui accentuent l‟impression d‟accumulation Ŕ et le jeu sur les sonorités (allitérations et consonances) rendent la prose lezamienne tout à fait poétique. Comme le montre cet extrait, l‟auteur utilise aussi la ville pour construire un territoire personnel, intimement lié au parcours vital et à la personnalité onirique de José Cemí. La Havane évolue ainsi en fonction de la vie du protagoniste : on passe du camp militaire de la toute jeune enfance à la maison du n°9 Paseo del Prado puis à l‟université, lieu qui, nous le verrons, aura une importance majeure. Pour expliquer cette trajectoire personnelle et initiatique et les étapes que franchit Cemí, Emma Álvarez-Tabío Albo écrit : « Paradiso contiene la casa de la infancia y la catedral, el Paseo del Prado y la Colina universitaria, la inocencia y el conocimiento, el día y la noche [...] Lezama ofrece la posibilidad de asociar la identidad con un territorio [...]»135. Puisque la ville et José Cemí entretiennent des relations profondes et se construisent simultanément, nous pouvons avancer que dans ce roman aussi, La Havane occupe une fonction narrative de premier ordre, à l‟instar des personnages. Le rôle de l‟espace urbain est d‟autant plus déterminant que c‟est grâce à lui, en partie, que s‟opère la transformation du réel. Ce sont, en effet, les rues et les lieux transcendés, entre autres, qui confèrent au roman une portée symbolique. Il convient d‟ajouter à ces grands noms de la littérature cubaine d‟autres noms d‟écrivains plus récents, qui ont aussi à cœur de décrire la capitale en détail. Si le « Quiquenio Gris » (1971-1976)136 et les années qui suivirent (Salvador Redonet clôt cette étape en 1982)137 ne constituent pas un jalon important dans notre corpus, il n‟en est pas de même des années quatre-vingt-dix et de la période spéciale en temps de paix. La crise profonde provoquée par l‟effondrement du bloc soviétique va, d‟un point de vue littéraire, donner lieu à une 134 José Lezama Lima, Paradiso (1966), Madrid, Ediciones Cátedra, 1989, p. 386. Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 241-243. 136 Nous l‟avons vu dans notre chapitre liminaire, au cours de cette période la littérature devient propagande. Les préoccupations des écrivains sont alors plutôt d‟ordre idéologique que littéraire. 137 Salvador Redonet, Los últimos serán los primeros, Antología de los novísimos cuentistas cubanos, op. cit., p. 11. 135 60 effervescence créative et à un regain d‟intérêt pour le milieu urbain. Un très grand nombre d‟écrivains s‟appliquent alors à décrire la métropole en ruines et le chaos citadin dans leur quotidienneté et contemporanéité. Plus que jamais, le réalisme, voire le réalisme sale, s‟impose chez ces auteurs féconds qui vont bouleverser le panorama littéraire cubain de cette fin de siècle. On le sait, les romans noirs et policiers entretiennent une relation quasi organique avec la ville et il en va de même pour la littérature policière cubaine. Mais si dans les années soixante-dix et quatre-vingt, époque du boom du genre policier à Cuba, l‟espace urbain dans ces romans se résumait à quelques références topographiques qui n‟en faisaient qu‟un arrière-plan, les années quatre-vingt-dix vont quant à elles marquer un tournant avec, entre autres, l‟apparition de Leonardo Padura Fuentes sur la scène littéraire cubaine. Dans sa tétralogie des Quatre Saisons138 et dans ses romans policiers postérieurs139, il décrit une Havane qui s‟écroule petit à petit sous le regard désenchanté et nostalgique du lieutenant Mario Conde. La capitale cubaine est ainsi le lieu où convergent la morosité présente et la nostalgie d‟un passé magnifié par le détective. L‟enquête policière n‟est guère plus importante que l‟environnement urbain et la critique sociale qui sont à l‟œuvre car la ville n‟a pas pour fonction d‟être un simple point d‟ancrage, comme c‟était le cas précédemment. C‟est même le contraire que revendique l‟auteur quand il explique que la trame policière n‟a qu‟une fonction secondaire dans ses romans : Incluso he llegado al punto de llamarlos [mis libros] y considerarlos falsos policíacos. Porque aparentemente se está leyendo una novela policíaca pero cualquier lector un poco avisado se da cuenta de que la trama policíaca es muy endeble, está muy en función de decir otras cosas. [...] todo lo que ocurre en el libro trasciende esa historia policíaca. Incluso, cada uno de los casos que debe resolver Mario Conde en estas cuatro novelas, son como miradas a la realidad cubana para penetrar un poco más allá de la misma solución de ese caso. El tiene que resolver con cada caso un problema de conciencia y tiene que entrar a desentrañar las profundidades de la realidad cubana contemporánea.140 Les enquêtes policières, qui, comble du paradoxe pour des romans noirs, ne sont que secondaires, vont être l‟occasion de dresser un portrait de la société havanaise en crise (économique et morale) où débrouille, fraude et criminalité constituent le pain quotidien des Cubains. Mais La Havane n‟est pas encore tout à fait le territoire sans foi ni loi que décrit 138 Pasado perfecto (1991), Vientos de cuaresma (1994), Máscaras (1997) et Paisaje de otoño (1998). La neblina del ayer (2005), Adiós, Hemingway (2006 ; 1e éd. 2000), La cola de la serpiente (2011). 140 Leonardo Padura Fuentes in Stephen Clark, « Conversación con Leonardo Padura Fuentes », Cyberayllu, 2000, http://www.andes.missouri.edu/andes/Cronicas/SCPadura/SC_Padura1.html (consulté le 20/06/2012) 139 61 Pedro Juan Gutiérrez dans les années quatre-vingt-dix et deux mille. En effet, des valeurs telles que l‟amitié, la loyauté, le sens du devoir et du partage sont aussi amplement véhiculées par Mario Conde et son cercle d‟amis (el Flaco Carlos, Josefina, José), ses collègues (Manuel Palacios, son chef Rangel) et même son indicateur et ami d‟enfance Candito el Rojo. Car, dans tous ses romans, la morale reste sauve : le criminel assassin qui corrompait le modèle révolutionnaire est arrêté et le détective rétablit un semblant d‟ordre dans le chaos havanais141. En revanche, dans les œuvres qui composent le « cycle Centro Habana », de l‟écrivain Pedro Juan Gutiérrez142, rien ne peut empêcher la catabase du narrateur protagoniste Pedro Juan. Avec une intensité sans précédent, les romans de Gutiérrez nous plongent au cœur de l‟enfer de Centro Habana et de La Habana Vieja, véritable jungle urbaine où la loi du plus fort règne : Todos salíamos de las jaulas y comenzábamos a luchar en la selva. [...] No teníamos ni idea de cómo era la batalla en la jungla. Pero había que hacerlo. Estuvimos encerrados treinta y cinco años en las jaulas del Zoo. [...] Y de pronto hay que saltar a la selva. [...] Sólo los mejores podrían competir por la vida en la jungla.143 Morale, loyauté, amitié n‟ont plus lieu d‟être et sont, au contraire, autant de failles qui peuvent coûter la vie144. Le réalisme sale, qui se traduit par une multitude de descriptions hyperréalistes, abjectes et violentes du chaos urbain, consisterait en une dissection minutieuse d‟un corps moribond qui serait La Havane145. Dans les œuvres de Gutiérrez, le désir de réalisme va de pair avec une multitude de repères topographiques, de retranscriptions minutieuses des déplacements des personnages à travers un labyrinthe urbain qu‟ils connaissent par cœur. Le cas du personnage éponyme de El Rey de La Habana, jeune marginal qui, porté au gré du vent, parcourt la ville en quête de quelques pièces, de nourriture ou tente de fuir la police, est assez probant. L‟existence de ce pícaro de la période spéciale n‟est faite que d‟errance et de fuite, comme nous pouvons le voir dans ces quelques lignes : 141 Caroline Lepage a écrit un article éclairant qui remet en question la prétendue « fracture générique » qu‟aurait opérée Padura. Selon elle, Conde « serait finalement à envisager comme élément central d‟une sorte de manœuvre visant précisément à mieux asseoir sa légitimation au sein du modèle révolutionnaire tactiquement modifié », Caroline Lepage, « Le grand sommeil de Mario Conde: relire Pasado Perfecto de Leonardo Padura Fuentes », in Caroline Lepage, Antoine Ventura, La littérature cubaine de 1980 à nos jours, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011, p. 165. 142 Trilogía sucia de La Habana (1998), Barcelone, Anagrama, 2004 ; El Rey de La Habana (1999), Barcelone, Anagrama, 2004 ; Animal tropical (2000), Barcelone, Anagrama, 2002 ; El insaciable hombre araña (2002), Barcelone, Anagrama, 2004 ; Carne de Perro (2003), Barcelone, Anagrama, 2004. 143 Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, (1998), op. cit., p. 139. 144 Par exemple, le personnage de Berta dans la nouvelle « Visión sobre los escombros » en est l‟illustration. Voir : Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 295-303. 145 L‟auteur parle de la plume de l‟écrivain comme d‟un « bisturí social », Pedro Juan Gutiérrez, « Verdad y mentira en la literatura », in Encuentro de la cultura cubana, n° 26, 27, automne-hiver 2002-2003, p. 278. 62 Rey saltó del muro al piso y echó a andar. En la esquina de Belascoaín, dos policías aburridísimos. Rey se electrizó. Viró en redondo. Entró por el túnel del elevado, Saliñ al parque. […] Tres policìas en la esquina de Belascoaìn y San Lázaro. Rey derivó hacia Márquez González, escapó por allí y luego fue atravesando por todas las calles pequeñas, hacia Jesús María. En las avenidas estaban los policías de guardia.146 Fuyant les policiers ou bien les situations critiques, Rey arpente constamment La Havane. L‟énumération des noms de rues et la présence importante de verbes actifs (« saltó », « échó a andar », « viró », « entró », « salió », « derivó », « escapó ») rendent les déplacements du protagoniste étourdissants et angoissants. Mais des pauses descriptives viennent ralentir cette fuite éperdue au dénouement tragique. Décrivant à l‟envi la misère et la crasse ambiantes, le narrateur s‟attarde souvent sur un immeuble en ruines, une rue pleine d‟immondices ou un appartement infâme. Sans atteindre le paroxysme du réalisme sale de Gutiérrez, les œuvres d‟Antonio José Ponte (qui se considère comme un « ruinologue ») et d‟Abilio Estévez construisent elles aussi un espace littéraire fait de ruines et de décombres qui marque l‟effondrement d‟une utopie. Dans le roman Los palacios distantes (2002) et dans le récit personnel et fragmenté Inventario secreto de La Habana (2004), d‟Estévez, l‟écriture se construit à partir de la ville et se fonde sur celle-ci. C‟est le quartier de Marianao, le Malecón et la mer, La Habana Vieja, Centro Habana et le Vedado, qui sont évoqués dans Inventario secreto de La Habana. C‟est aussi La Havane du passé, celle de la liberté, de la fête et de la sexualité assumée qui est remémorée dans cet inventaire qui se veut aussi complet que possible. C‟est enfin La Havane littérarisée (celle de Villaverde, de Meza, de Carpentier, de Lezama, etc.) qui est aussi rappelée dans une mise en abyme habile qui fait de la ville l‟élément incontournable de l‟œuvre littéraire. Vingtcinq ans après La Habana para un infante difunto, l‟argument de la ville comme structure même du récit réapparaît et, nous le verrons, comme pour Cabrera Infante, l‟exil sert à Abilio Estévez de contexte à cette reconstruction littéraire d‟une Havane perdue. En dressant ce rapide panorama chronologique, nous avons voulu rappeler quelques grands noms de la littérature cubaine qui ont marqué une étape importante dans l‟histoire de la représentation littéraire de La Havane, sans prétendre à l‟exhaustivité. En effet, d‟autres noms auraient pu compléter la liste mais il ne s‟agit pas d‟évoquer dès à présent toutes les œuvres de notre corpus. Grâce à la récurrence de l‟espace urbain dans leurs récits ou grâce à la 146 Pedro Juan Gutiérrez, El rey de La Habana, op. cit., p. 116, 117. 63 densité de leurs descriptions, certains écrivains se distinguent d‟autres auteurs qui n‟ont pas accordé la même importance à la ville. Il faut attendre le XXème siècle pour qu‟un nouveau discours sur la cité émerge et bouleverse les fonctions de l‟espace au sein du récit. Si la ville pouvait servir à appuyer une dénonciation sociale au XIXème siècle (avec Villaverde par exemple), elle construit le récit au XXème siècle en mettant en fiction une période de crise (la période spéciale) ou en étant l‟objet même de l‟écriture et une fin en soi (chez Carpentier et Cabrera Infante notamment). Chapitre 3 : Des lieux et des espaces 1- De quels quartiers parle-t-on ? a- La Havane dans la littérature du XIXème siècle Risquons ce truisme : il ne saurait y avoir de description d‟une ville sans évocation précise de ses lieux, de ses quartiers, de ses rues et/ou de ses monuments. Fonder l‟espace requiert donc nécessairement de localiser, de nommer et éventuellement de décrire ces points de repère qui rendent une cité lisible147. Pour analyser la ville représentée, nous distinguerons les lieux et les espaces en nous appuyant sur les travaux de Michel de Certeau. D‟après le philosophe, le lieu est distinct de l‟espace car il « est une configuration instantanée de positions. Il implique une indication de stabilité »148. L‟espace, en revanche, est davantage ancré dans le mouvement et le temps : L‟espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l‟ensemble des mouvements qui s‟y déploient. Est espace l‟effet produit par les opérations qui l‟orientent, les circonstancient, le temporalisent et l‟amènent à fonctionner en unité polyvalente [...]. L‟espace serait au lieu ce que devient le mot quand il est parlé [...]. En somme, l’espace est un lieu pratiqué.149 Déterminer l‟espace urbain à travers une série de lieux récurrents est une pratique littéraire courante tant au XIXème, au XXème qu‟au XXIème siècle. De quelle Havane parle-t-on ? De 147 Ces éléments sont au nombre de cinq, d‟après Kevin Lynch. Dans ses travaux sur la perception de la ville, l‟urbaniste et architecte américain a, en effet, dégagé cinq points fondamentaux structurant l‟espace urbain : les voies, les limites, les quartiers, les nœuds et les points de repère. Voir : Kevin Lynch, L’image de la Cité, Paris, Dunod, 1969, p. 54. 148 Michel de Certeau, L’invention du quotidien. Tome 1. Arts de faire, op. cit., p. 173. 149 Loc. cit. 64 quels quartiers ? Quelles rues, quels édifices et maisons sont évoqués ? Au fil de l‟histoire, les lieux évoluent car c‟est la morphologie même de la ville qui change. Des raisons historiques évidentes expliquent, par exemple, la prépondérance de La Habana Vieja au XIXème siècle et l‟irruption du Vedado et des autres quartiers périphériques surtout au XXème siècle150. Mais dans le cas de la vieille ville, sa présence sera constante dans les romans au fil des siècles, de la Comtesse Merlin à Zoé Valdés, en passant par Alejo Carpentier et Lisandro Otero, pour ne citer qu‟eux. La Habana Vieja, est au XIXème siècle le quartier des activités politiques, commerciales et sociales qui concentre quasiment toute la population. La ville intra-muros souffre d‟ailleurs de surpopulation dès 1740 et le phénomène ne fait que croître puisque le recensement de 1861 révèle que le quartier de la cathédrale compte autant d‟habitants que les faubourgs de Factoría et Arsenal réunis151. A cette concentration démographique s‟ajoutent également de meilleures infrastructures urbaines (rues, transports, éclairage, aménagements, gare ferroviaire en 1817), améliorations qui seront développées, notamment, grâce aux politiques urbanistiques du Général Tacón dès les années trente. Même si les constructions de Miguel Tacón ne se limitent pas au quartier historique, puisqu‟il envisage une extension physique de la ville, avec la construction de la promenade Tacón (1834) ou du Campo de Marte (1835), elles favorisent néanmoins, et c‟est logique, la ville intra-muros. Toutes ces raisons évoquées expliquent la prépondérance de ce quartier sur les autres, et ce, malgré la destruction des murailles dès 1863. Il est donc naturel que La Habana Vieja soit l‟espace de prédilection des écrivains de l‟époque. C‟est de cela et presque uniquement de cela que parle la Comtesse Merlin quand elle décrit La Havane puisque les maisons de son père, de Mamita et de son oncle se trouvent dans la vieille ville. En plus des observations précises qu‟elle fait des maisons bourgeoises du secteur, elle évoque également des lieux emblématiques : la place d‟Armes et le Templete, la rade, le port et la cathédrale. Quand il s‟agit d‟évoquer La Havane, elle ne sort quasiment pas de La Habana Vieja si ce n‟est pour décrire le riche et élégant théâtre Tacón152, situé extra-muros. Ce sont aussi précisément des rues de La Habana Vieja qui sont nommées dans les nouvelles de Tristán de Jesús Medina, précédemment évoquées, (« El doctor In-Fausto » et « Una 150 Cela ne veut pas dire qu‟aucune référence au Vedado ne soit observée au XIXème siècle car ce quartier a commencé à s‟édifier dès 1860. 151 Pour une analyse démographique plus approfondie, voir, Julio Le Riverend Brusone, La Habana, Madrid, Colecciones MAPFRE 1492, 1992. 152 C‟est, aujourd‟hui, le Grand Théâtre de La Havane ou le théâtre Garcìa Lorca. 65 notabilidad en La Habana »), dans Un hombre de negocios (1882), de Nicolás Heredia, et dans Mi tío el empleado (1887), de Ramón Meza153. Comme nous l‟avons vu précédemment, c‟est également la vieille ville que décrit minutieusement Cirilo Villaverde dans Cecilia Valdés et c‟est dans la rue Compostela, dans ce même quartier, que se déroule l‟essentiel de l‟histoire du roman Dos amores154. Si la vieille ville est prépondérante dans les récits du XIXème siècle, certains auteurs, sans forcément situer l‟action de leur récit ailleurs, vont décrire d‟autres quartiers. Ramón de Palma, dans sa nouvelle « El cólera en La Habana » (1838) évoque l‟actuel Centro Habana (le quartier de San Lázaro où vivent, nous l‟avons vu, Angélica et sa mère) et place l‟essentiel de l‟action dans la ville extra-muros. Dans Cecilia Valdés, Villaverde franchit lui aussi les murs de la ville, certes à de rares reprises, et évoque le Paseo del Prado, la rue San Rafael, le cimetière situé dans le quartier de San Lázaro, etc. Certaines œuvres de Ramón Meza sont en cela intéressantes : elles s‟éloignent du centre pour décrire des quartiers plus périphériques dont on ne parle pas ou peu dans les romans de l‟époque. L‟auteur évoque, par exemple, le théâtre Tacón, le Castillo del Prìncipe et l‟avenue Carlos III, dans Mi tío el empleado. Mais c‟est surtout dans Carmela (1887) que Meza va multiplier les décors en décrivant tour à tour La Habana Vieja, Centro Habana (puisque Carmela, l‟héroïne, vit dans la rue San Lázaro), le Vedado (réputé à l‟époque pour son air pur) et même le quartier Chinois, chose extrêmement rare pour l‟époque, car un des personnages, Assam, y vit. Notons au passage que les incursions que font Carmela et sa mère doña Justa dans ce quartier inconnu et mystérieux sont synonymes d‟étonnement, comme l‟atteste le récit de leur visite chez Assam le Chinois : Siguieron un largo y estrecho pasadizo, al cual caían las puertas de varios cuartos, abiertos unos, cerrados otros y ocupados todos por una abigarrada colonia asiática. Una corta escalerilla de madera, agrietada por el sol y roída por los ratones y la humedad, conducía a la habitación de Assam, amplia, fresca, ventilada, llena de muebles valiosos y mil objetos de China, de gran mérito. Nadie podía sospechar que en el fondo de aquel miserable tugurio, que olía a opio y aceite hirviente por sus cuatro costados, hubiese aquella habitación adornada con un gusto y riquezas de príncipe. Biombos, farolonas, cajas de sándalo, babuchas de gruesa suela y con las puntas muy encorvadas hacia arriba, todo exótico, raro, pero luciente, sin un polvillo, ordenado al gusto de su propietario, que gozaba con las sorpresas que llevaban doña Justa y Carmela en su minucioso examen de todos aquellos objetos.155 153 Ramón Meza, Mi tío el empleado (1887), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2001. Cirilo Villaverde, Dos amores, La Havane, Biblioteca de « la Ilustración cubana », 1858. 155 Ramón Meza, Carmela, op. cit., p. 145, 146. 154 66 Le contraste entre l‟immeuble crasseux et décati d‟Assam, où se mélangent les odeurs d‟opium et de friture, et sa chambre, parfaitement bien tenue, surprend les deux femmes qui scrutent tout ce qu‟elles voient, fascinées par tant d‟exotisme. Si les quartiers extra-muros, qui commencèrent à se développer entre 1841 et 1861 faute de place et à cause du coût des logements dans la ville intra-muros, ne sont pas les espaces préférés des écrivains du XIXème siècle, c‟est qu‟ils ne représentent pas La Havane dans l‟imaginaire collectif. Ces quartiers restent la périphérie, le lieu où habitent souvent les populations les plus pauvres156, même si l‟on sait qu‟historiquement, les secteurs aisés commencent à abandonner le centre et à se déplacer jusqu‟à la zone du Paseo del Prado dès les années soixante. Dans les récits de fiction, ce déplacement du centre, qui passe du port à l‟actuel Centro Habana, ne sera visible que plus tardivement157. b- L’émergence du Vedado dans la littérature Le quartier du Vedado n‟a que très peu d‟importance dans les récits de fiction du XIXème siècle car les familles aristocrates n‟ont pas encore jeté leur dévolu sur ce quartier qui, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, connaît une croissance très limitée à cause des Guerres d‟Indépendance et des crises économiques successives158. Il faudra attendre le temps des « vaches grasses » ou de la « Danse des Millions » (entre 1915 et 1920 environ) et l‟enrichissement de l‟oligarchie sucrière cubaine pour que le Vedado connaisse un véritable développement et apparaisse dans les fictions littéraires de manière plus soutenue et récurrente. Mais cette émergence est lente et ne correspond pas à l‟évolution historique des quartiers ouest de la ville, comme le souligne Yolanda Izquierdo lorsqu‟elle évoque la littérature de la première moitié du XXème siècle : 156 Reinaldo Arenas, dans un roman qui pastiche l‟oeuvre de Villaverde, montre bien que la ville extra-muros était synonyme de misère : « Tratando de huir por donde la muralla que rodeaba la ciudad era menos custodiada, [Dioniso] se dirigió a los barrios pobres en los que sólo vivía gente negra o mulata », La loma del Ángel (1987), Miami, Ediciones Universal, 2001, p. 47, 48. 157 Notons qu‟en revanche, les chroniqueurs se font l‟écho de ces changements dans leurs écrits. Voir : Cirilo Villaverde, « La Habana en 1840 » ou Luis Victoriano Betancourt « La Habana de 1810 a 1840 », in Salvador Bueno, Costumbristas cubanos del siglo XIX, op. cit., p. 167-170 et p. 355-361. 158 Le projet de construction du Vedado a été validé en 1860 et c‟est l‟ingénieur Luis Yboleñn Bosque qui l‟a conçu en s‟appuyant sur une nouvelle organisation spatiale : des constructions avec jardin, des pâtés de maisons d‟une longueur de cent mètres, des rues et des avenues amples et arborées. Au départ, le Vedado ne comptait que vingt-neuf pâtés de maisons. 67 A lo largo del siglo XX, La Habana se ha desarrollado hacia el Oeste, mientras que la narrativa urbana cubana correspondiente se caracteriza por la búsqueda de un espacio anterior Ŕ temporal y espacialmente Ŕ al que funciona como centro en su momento, siempre en dirección al Este, y opuesto al del desarrollo histórico de la ciudad hacia el Oeste [...].159 Ainsi, le Vedado et ce qu‟il représente à l‟époque vont apparaître de façon très progressive dans les romans. Ils commencent à poindre tout d‟abord timidement sous la plume de Miguel de Carrión, à la fin de son roman Las honradas (1918), puisque c‟est là que vivent Graciela et son mari dans un somptueux petit palais. Il s‟agit pour ces nantis de La Havane de s‟éloigner du tumulte du centre-ville, d‟avoir plus de confort et de verdure et de s‟isoler : « […] aquella mansión señorial a los más lejano y más alto dominio, dejando la mayor cantidad de parque posible entre ella y las expansiones plebeyas de la calle »160. L‟idée du quartier résidentiel paisible qui constitue un entre-soi géographique est également présent dans le récit d‟Ofelia Rodrìguez Acosta, La vida manda (1929). Dans ce roman qui se déroule à La Havane aux alentours de 1928, on peut lire par exemple : « la tarde se tendía sosegada y dulce, sobre la aristocrática barriada del Vedado »161. La protagoniste oppose à plusieurs reprises son quartier à celui de sa tante et de ses cousins (ou celui de son amant Damián Varona), qualifiés de « suburbios » où les maisons ne sont que des taudis162. Durant les années cinquante, le Vedado qui s‟oppose aux autres quartiers par son confort, son luxe, ses résidences cossues et ses gratte-ciels est un leitmotiv que l‟on retrouve toujours. Pour Guillermo Cabrera Infante, dans La Habana para un infante difunto, ce quartier est synonyme de commodité, de bien-être et s‟oppose en tout à la rue Zulueta de La Habana Vieja où le narrateur habitait avant : « […] los grandes edificios del barrio : Santeiro, Palace, Chibás, tan elegantes de arquitectura, tan herméticos de aspecto, tan buenos burgueses de apariencia sus inquilinos [...] todas las familias del barrio eran blancas [...] »163. Chaque adjectif (« grandes », « elegantes », « herméticos », « buenos ») sert ici à distinguer un peu plus ce quartier. Les immeubles, les habitants et les rues y sont différents, comme le suggère la métaphore du vilain petit canard et du cygne qui oppose une rue de Centro Habana (San Lázaro) et une rue du Vedado (la rue L) : 159 Yolanda Izquierdo, Acoso y ocaso de una ciudad. La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, op. cit., p. 28. 160 Miguel de Carrión, Las honradas, op. cit., p. 314. 161 Ofelia Rodríguez Acosta, La vida manda, Madrid, Editorial Rubén Darío, 1929, p. 77. 162 Nous pouvons lire, par exemple : « El suburbio donde se hundìa de miseria mi familia […] », ibid., p.236. 163 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 288. 68 […] hay una cierta sutileza de la calle L al convertirse en San Lázaro en la universidad sin que apenas se advierta la gradación : ésta es, estoy seguro, una gentileza de la calle L, que es moderna y agradable desde su mismo principio, mientras San Lázaro es una calle sin carácter, fronteriza, que no está en La Habana Vieja y sin embargo no es de La Habana Nueva, y subir por ella hacia la colina universitaria es ver cómo el pato feo se convierte en cisnecito.164 Les rues, sous la plume de Cabrera Infante, sont non seulement personnifiées mais semblent avoir une volonté propre (« una gentileza de la calle L »). Elles servent de frontières plus ou moins nettes à l‟intérieur de la ville et délimitent ainsi les espaces. Ce quartier élégant, paisible et vert, qualifié de « mejor logro urbanístico de La Habana » par Abilio Estévez165, est, dans Tres tristes tigres, le quartier des bars, des cabarets, des grands hôtels et des sorties nocturnes. Les personnages passent tour à tour de la rue 21, à la 23, à la Rampa, à la Avenida de los Presidentes puis à Paseo dans un tourbillon de déplacements qui en fait le quartier le plus cartographié du roman. C‟est le quartier de l‟oisiveté, de l‟effervescence et de la fête dont se souvient Gertrudis, l‟un des personnages-narrateurs du récit Sangra por la herida (2010), de Mirta Yáñez : ¡ Qué lindos fueron los años sesenta ! [...] ¡ Y cómo era La Habana entonces, caballeros ! Un hervidero, un remolino, un barullo a toda hora. Lo mismo se estaba en una trinchera esperando que nos cayera un misil nuclear en la cabeza que en una banqueta del bar del hotel Flamingo oyendo tocar el piano a Mame Solís. Se empataba el día con la noche : las clases, el helado en Coppelia, la Cinemateca, el club Coctel [...], conciertos, Chez Bola, el Cina Club Varona, bailes, la biblioteca, almorzar chícharos en el Comedor Universitario [...] la piscina del hotel Riviera [...] el bar de La Torre [...]. De noche, sobre todo, no pasaba el tiempo. Como si no se nos fuera a acabar nunca el tiempo.166 En décrivant l‟agitation perpétuelle qui animait ce quartier et en énumérant les lieux de divertissement les plus courus, Gertrudis met en lumière l‟extrême insouciance et désinvolture des jeunes de l‟époque. La crise des missiles, à laquelle elle fait allusion, ne contrarie pas le moins du monde leurs distractions frivoles. Le Vedado renvoie ici à un âge d‟or perdu, celui de la jeunesse de Gertrudis et il suscite d‟autant plus la nostalgie qu‟il n‟est plus aujourd‟hui ce qu‟il était dans les années cinquante et soixante. De fait, l‟avènement de la Révolution cubaine marque un profond changement et va estomper la polarisation sociale qui oppose le Vedado (et Miramar) aux vieux quartiers de la ville (La Habana Vieja et Centro Habana). En effet, la plupart des familles appartenant à la riche bourgeoisie partent assez vite après 164 Ibid., p. 310, 311. Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, Barcelone, Tusquets, 2004, p. 230. 166 Mirta Yáñez, Sangra por la herida, La Havane, Ediciones Unión, 2010, p. 36, 37. 165 69 l‟arrivée au pouvoir de Fidel Castro, abandonnant leurs belles résidences qui sont alors soit transformées par le nouveau régime en écoles, en garderies, en musées ou en bureaux administratifs, soit proposées à des familles plus pauvres ou provenant de zones urbaines plus insalubres. Les nouveaux arrivants apportent avec eux de nouvelles habitudes et des manières de vivre différentes de celles des anciens résidents. Le quartier change d‟allure et la littérature se fait l‟écho de ces changements. Le narrateur de Memorias del subdesarrollo (1965), d‟Edmundo Desnoes, en témoin quelque peu désenchanté, décrit La Havane postrévolutionnaire et son quartier du Vedado : En la esquina de G y Trece había un colegio de monjas ; las Dominicanas Francesas. Laura estudió allí. Recuerdo que me lo indicaba cada vez que subíamos por la calle G, y yo sólo me fijaba en la virgen del nicho ; una virgen azul, creo […]. Ahora tiene un letrero junto al techo : LENIN, escuela de superación obrera.167 Aux changements idéologiques qui se manifestent concrètement dans le quartier (des écoles communistes remplacent les écoles religieuses) s‟ajoute aussi déjà l‟impression de détérioration : « Para mí, La Habana es esto que veo desde la ventana. […] El Trotcha es ahora una destartalada casa de huéspedes ; veo a una mujer barriendo la nave de madera [...]. Pero la madera se ve gris y sucia y carcomida »168. La dégradation du quartier, laissé à l‟abandon faute de moyens (surtout à partir des années quatre-vingt-dix) et de réelles politiques urbaines, constituera un leitmotiv littéraire car il sera une preuve matérielle d‟une Havane élégante et prospère aujourd‟hui totalement désargentée169. On le voit, Le Vedado et ses représentations évoluent nécessairement au gré des circonstances historiques mais quoi qu‟il signifie, il va finir par s‟imposer et être presque omniprésent dans les romans de notre corpus à partir de la deuxième moitié du XXème siècle, à l‟image de La Habana Vieja et Centro Habana qui ne cesseront d‟être convoqués dans les écrits littéraires. Certains écrivains, comme Guillermo Cabrera Infante ou Leonardo Padura Fuentes, vont d‟ailleurs décrire de manière panoramique et globale La Havane grâce aux multiples 167 Edmundo Desnoes, Memorias del subdesarrollo (1965), Seville, Mono Azul Editora, 2006, p. 96. Notons au passage que le cinéaste Tomás Gutiérrez Alea fera une adaptation cinématographique de ce roman, en 1968. Le film, intitulé lui aussi Memorias del subdesarrollo, marquera profondément l‟histoire du cinéma cubain. 168 Ibid., p. 135. 169 Pour plus de précisions sur l‟histoire du Vedado, voir : Xabier Eizaguirre y Carles Crosas, El Vedado, La Habana. Proyecto y transformación, Barcelone, Edicions ETSAB (Escola Tècnica Superior d‟Arquitectura de Barcelona), 2006. 70 déplacements des personnages à travers les différents quartiers170, dont le Vedado, quand d‟autres écrivains se concentreront sur une zone bien délimitée, faisant de l‟espace décrit une synecdoque permettant de symboliser la ville tout entière. 2- Des microcosmes a- La ville polycentrique du XXème siècle Les trois quartiers emblématiques que l‟on vient d‟évoquer ont ceci de particulier qu‟ils représentent tous un centre urbain. Pour des raisons historiques, les centres névralgiques de la ville se sont déplacés au cours des siècles et font que La Havane compte aujourd‟hui plusieurs centres171. La Habana Vieja, centre historique par excellence, est toujours le centre-ville et constitue aujourd‟hui un haut lieu du tourisme (tout du moins pour ce qui est de la partie restaurée du quartier). Centro Habana, qui n‟a certes plus autant de magasins que dans les années cinquante et soixante, reste néanmoins un secteur vivant et commercial pour les Havanais. Enfin, le Vedado est toujours, plus de cinquante ans après le début de la Révolution, un quartier plus agréable et moins indigent que les deux autres, qui réunit de grands hôtels, des lieux touristiques et des centres d‟activités culturelles et de loisirs (bibliothèques, cinémas, théâtres, le glacier Coppelia, etc.). Ces trois quartiers peuvent fonctionner de manière autonome dans les récits littéraires car, pour décrire la ville, certains écrivains vont procéder à une sorte de focalisation. Ce « zoom » va se rapprocher d‟un quartier, d‟une rue, voire d‟un immeuble, et offrir une vision fragmentaire de la capitale. Dans son roman Llueve sobre La Habana, Julio Travieso ne fait quasiment évoluer ses deux personnages, Mónica et le protagoniste-narrateur, que dans le Vedado qui devient le seul et unique centre de la ville, comme le suggère ce passage : Ahora son las diez de la mañana, y Mónica sale al balcón de su apartamento y mira hacia abajo, hacia la calle 23, hacia La Rampa, el corazón de la ciudad, por donde fluye toda la sangre de La Habana, el gran corazón de La Habana, su verdadero centro. Pam, pam, resuena el corazón cuando los ómnibus, los autos, los camiones, las bicicletas, los taxis bicicletas, los carretones, y hasta los coches de caballo, hacen sonar sus bocinas y avanzan hacia y desde el mar. Ram, ram, se agita el corazón cuando la muchedumbre corre para tomar un ómnibus que acaba de detenerse a veinte metros, y dos 170 Nous aborderons ce point un peu plus loin dans cette partie. Roberto Sègre parle pour sa part d‟une « „configuraciñn urbana polinuclear‟ que se caracteriza por una „desproporcionada extensiñn del hábitat‟ », cité par Ángel Esteban, « A las duras y a las paduras : La Habana cielo e infierno », in Literatura cubana entre el viejo y el mar, op. cit., p. 307. 171 71 mujeres pelean a gritos por ver quién sube primero. Ta, ta, ta, se fatiga el corazón al pasar otro ómnibus con hombres colgados de puertas y ventanillas, que si en el techo pudieran estar allí subieran. 172 Le Vedado est le cœur de la ville, comme le montrent la métaphore filée qui personnifie la cité et les onomatopées qui soulignent l‟effervescence urbaine. Le Malecón et la Rampa sont amplement décrits dans le roman et constituent les limites d‟un territoire amoureux où les deux amants se donnent souvent rendez-vous sans forcément déterminer de lieu exact. Ils se retrouvent toujours car cet espace est le leur et constitue leur univers : « A pesar de lo azaroso de la búsqueda siempre nos encontrábamos, quizás atraídos por las emanaciones amorosas de nuestros cuerpos, seguramente porque, si no nos veíamos en el camino, al final los dos íbamos a parar inicio de La Rampa, junto al muro del Malecón »173. Ce sont sans doute La Habana Vieja et Centro Habana qui bénéficient le plus de cette approche. La Havane du réalisme sale de Pedro Juan Gutiérrez se résume, en effet, à ces deux quartiers. Le personnage de Pedro Juan vit dans Centro Habana et se déplace dans ce dédale urbain immonde et violent en cartographiant à son tour son quartier. Une kyrielle de lieux sont évoqués (Le Malecón, le parc de la Fraternidad, l‟église de la Caridad, les rues Colñn, Industria, Trocadero, Belascoaín, San Lázaro, le boulevard de San Rafael, le quartier Chinois, etc.) car il s‟agit pour l‟auteur de situer et de nommer l‟enfer urbain. « Los turistas no entran en las profundidades del infierno »174, nous dit le narrateur en parlant de Centro Habana, l‟opposant ainsi à La Habana Vieja. C‟est donc un microcosme infernal, envisagé lui-même à travers le prisme du protagoniste Pedro Juan, qui est décrit dans les romans du cycle « Centro Habana ». Nous laissons pour plus tard l‟interprétation de cet enfer urbain et la signification des ruines. b- Une microscopie de la ville Certains auteurs vont regarder d‟encore plus près un des quartiers de La Havane et se concentrer sur un bloc de rues, une seule rue ou encore un immeuble, quitte à ignorer tout le reste de la ville. Nous avons une vision de la ville non seulement fragmentaire mais aussi extrêmement réduite car les narrateurs ne sortent quasiment jamais de ces espaces restreints. Reina María Rodríguez est l‟un de ces écrivains qui vont regarder d‟encore plus près Centro Habana puisqu‟elle va poser sa loupe sur une zone géographique très précise : les rues situées 172 Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2004, p. 42. C‟est nous qui soulignons. 173 Ibid., p. 75, 76. 174 Pedro Juan Gutiérrez, El insaciable hombre araña, Barcelone, Anagrama, 2004, p. 104. 72 autour du magasin « Variedades de Galiano ». C‟est d‟ailleurs ce magasin qui donne son nom au titre de l‟ouvrage, titre programmatique puisqu‟il annonce d‟emblée une restriction géographique, comme le dit Adriana López Labourdette : […] tanto la pluralidad de géneros como el tìtulo del volumen, responden a una « limitada » voluntad de movimiento. En efecto, el texto transita por las calles habaneras en los albores del siglo XXI, pero lo hace preferentemente en un recinto estrecho entre Centro Habana y La Habana Vieja. Con ello elude la ciudad como conjunto […]. 175 Ce récit fragmenté (il est composé de trente-quatre chapitres indépendants) et polygénérique mêle à la fois des textes autobiographiques qui s‟apparentent à la chronique, des passages plus profonds qui invitent à la réflexion ou encore des passages descriptifs (en prose et parfois en vers). L‟écriture littéraire sert ici une vision personnelle et affective de la ville en ruines car comme le dit l‟auteur : « Variedades de Galiano es un texto de mi mapa cotidiano [...] donde busco, a través de caminatas habituales, la relación posible entre ficción y realidad, y viceversa »176. La narratrice, devenue spectatrice du déclin actuel de la ville, observe volontairement tout ce qui l‟entoure avec une distance salvatrice. Mais en se remémorant La Havane d‟antan et en confrontant ses souvenirs à la réalité présente, elle ne peut réprimer sa désolation qui trahit une colère sous-jacente. Etrangère dans son propre pays et dans sa ville, elle ne peut s‟empêcher d‟être ébranlée par le spectacle quotidien qu‟offre la pauvreté. Ainsi décrit-elle de vieilles personnes indigentes qui tentent de survivre jour après jour et qui se regroupent dans le parc Fe177, des magasins mal approvisionnés qui ne proposent que des produits douteux ou hors d‟usage et où les vendeuses mal aimables sont insupportables, des lieux réservés aux touristes auxquels les Cubains n‟ont pas accès, les cinémas du quartier qui ont disparu un à un, le mythique Sloppy Joe‟s Bar, fermé depuis longtemps et à l‟intérieur duquel il ne reste plus rien car tout a été vendu ou pillé. Elle se souvient de son passé et de celui de la ville et observe ce qu‟il reste du lustre d‟antan : Los lugares dejaron de ser lo que fueron, pero nosotros también [...]. La destrucción es una capa de polvo o bruma, niebla baja que, en la mañana y hacia el atardecer, transita conmigo el pedazo comprendido entre mi edificio y la esquina de San José donde no encuentro nada significativo tampoco [...]. 178 No obstante, hago este recorrido muchas mañanas continuas . 175 Adriana López Labourdette, « Cotidianidad, escritura y ciudad en Variedades de Galiano de Reina María Rodríguez », in La gaceta de Cuba, La Havane, Ediciones Unión, n°6, novembre-décembre, 2010, p. 4. 176 Reina María Rodríguez, Variedades de Galiano, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2008, p. 193. 177 On remarquera que la toponymie symbolique ne fait qu‟accroître, par contraste, le sentiment de désenchantement. 178 Ibid., p. 110. 73 La protagoniste ne s‟éloigne que très peu de ce secteur compris entre les rues Galiano, San José et San Miguel et ne quitte pour ainsi dire jamais Centro Habana. Le reste de la ville n‟est qu‟un lointain décor, comme le suggère cette évocation du Vedado : « Hacia la izquierda, donde la bahía hace una bolsa, los altos edificios pálidos del Vedado [...] paralizados. Un fondo de ciudad con desarrollo y altura cortado de un tajazo »179. Un autre traitement de l‟espace urbain va consister à se centrer principalement sur une rue. Reinaldo Montero nous propose une promenade intime et historique (mais pas chronologique) à travers toute la Calle del Obispo, dans La Habana Vieja, du début à sa fin, dans Bajando por Calle del Obispo (2008). Le lecteur progresse avec lui dans cette rue bouillonnante, à la fois belle et repoussante, en observant les devantures des boutiques, les passants, les intersections des rues. Le flâneur pénètre à l‟intérieur des boutiques et des cafés et réalise un véritable voyage dans le temps car c‟est toute l‟histoire de La Havane et de l‟Ile (l‟époque coloniale, les Guerres d‟Indépendance, la République) qui est présentée à travers la seule description de cette rue : La calle tiene mil ciento dos varas cubanas, doce cuadras, ciento veinticuatro edificios, veintitrés viviendas. La calle posee agrimensor, Censor Regio de la Segunda Instancia del Tribunal de Comercio, Bibliotecario Supernumerario, Intendente Honorario, obispos varios, y la mayor casa para venta de carbón cerca del menor de los especuladores de azúcar, la mejor chocolatería puerta con puerta con el peor fabricante de flores, y una importante imprenta litográfica al lado de un insignificante Oficial de Cuarta Clase del Tribunal de Cuentas, más el consulado en La Habana de Buenos Aires donde duerme de día un celador del barrio del Templete, más el Real Colegio de Corredores donde estudia de noche un profesor de barbería y cirugía. La calle abunda en bachilleres, lampisteros, comisionistas, boticarios, cambistas, apoderados, síndicos, picapleitos, jugadores de baraja y parará, vendedores de lotería, oficiales de administración, maestros retratistas al daguerrotipo [...].180 L‟auteur, non sans humour, poursuit son inventaire digne d‟un Prévert en énumérant absolument tout ce que pouvait prodiguer la rue en termes de boutiques. Les époques se superposent à mesure que l‟on progresse dans la rue car, on l‟aura compris, la Calle del Obispo, dans ce récit « patchwork », fonctionne ici comme une synecdoque et représente la ville tout entière. Nous retrouvons ce même procédé dans Perversiones en el Prado (1999), de Miguel Mejides, mais cette fois, le champ de vision est encore plus réduit puisqu‟il s‟agit d‟évoquer la ville 179 180 Ibid., p. 130. C‟est nous qui soulignons. Reinaldo Montero, Bajando por Calle del Obispo, La Havane, Ediciones Boloña, 2008, p. 8. 74 entière à travers un immeuble situé au numéro 112 de la rue du Prado. Cette focalisation n‟empêche pas quelques incursions dans La Habana Vieja et Centro Habana mais c‟est le microcosme que forment les habitants de l‟immeuble Prado 112 qui bâtit tout le roman. Le lecteur pénètre à l‟intérieur de l‟immeuble, des appartements, il entre dans la vie et le quotidien de ces personnages, à l‟image d‟un diable boiteux : Es de tarde y el edificio hierve. Es la hora en que la gente regresa de los trabajos y sintonizan cualquier emisora de radio a toda voz. Se entremezclan boleros con sones montunos [...]. Lo demás es el traqueteo de los cubos, la hora del baño, la hora en que la gente quiere calentar el agua y el gas no sube, llega hasta el piso 2 y allí se queda. Es el momento en que las ollas de presión silban sus vapores [...]. La mala hora de Prado transmite por sus engranajes en el mundanal bullicio de quienes desean que el último calor del día no los absorba en sus casas, en que discuten de pelota.181 Outre le quotidien des personnages, le lecteur découvre aussi leur histoire personnelle, leurs blessures, leurs aspirations, leurs bassesses. Cette œuvre n‟a pas un argument stricto sensu dont on suivrait le déroulement ; il s‟agit plutôt de plusieurs instantanés qui se juxtaposeraient, donnant une impression sinon polyphonique (le narrateur omniscient est le même du début à la fin) du moins kaléidoscopique. A ce récit fragmenté correspond une vision parcellaire et tout aussi plurielle de La Havane en ruines car d‟une part, comme nous l‟avons dit, c‟est un microcosme qui est décrit et, d‟autre part, la ville est tour à tour observée à travers le regard d‟un des nombreux personnages du récit. Le narrateur décrit la ville de chacun d‟entre eux, leurs parcours dans Centro Habana principalement, ce que chacun voit depuis sa fenêtre. Malgré cette vision plurielle, La Havane reste assez circonscrite, et ce, même quand le récit se fait fantastique et qu‟un personnage (Rocamora) peut voler car il s‟est transformé en oiseau : La ventana está abierta y el pájaro se lanza a conquistar una aventura en vuelo fugaz, ensayo que lo hace planear sobre el Prado, y en una pirueta encandilarse con la marquesina del hotel Inglaterra, para de ahí dejarse correr hasta la cúpula del Capitolio, y finalmente verse reflejado en los ángeles del antiguo teatro Tacón, y luego emprender el regreso a su apartamento con la Luna que le inflama las alas.182 Cette description zénithale, mais non panoramique, n‟est pas synonyme de conquête de la ville car ce nouvel Icare, dont les ailes sont brûlées par la lune, vole au-dessus de son quartier (le Prado et ses environs) sans s‟en éloigner. Notons au passage que Le Paseo del Prado, dans 181 182 Miguel Mejides, Perversiones en el Prado (1999), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2008, p. 117. Ibid., p. 196. 75 ce récit, n‟est plus le lieu des rendez-vous chics de la ville du XIXème siècle où les personnes élégantes paradaient en calèche sous ses belles façades bourgeoises mais qu‟il est laissé à l‟abandon, à l‟image de cette « sufrida Habana [...] ahora convertida en un Beirut Caribeño »183. Dans ces œuvres, l‟élément important du récit n‟est pas la ville dans sa globalité mais le quartier, la rue ou le voisinage. Ces microscopies de La Havane plus ou moins grossissantes sont l‟occasion de décrire des lieux somme toute assez symboliques et emblématiques : la calle del Obispo cristallise toutes les époques de la ville et « Variedades de Galiano » et le Paseo del Prado, tels qu‟ils sont décrits par les auteurs, symbolisent finalement la ville actuelle décrépite qui se meurt peu à peu dans une torpeur inéluctable. D‟autre part, ces descriptions, qui telle une loupe permettent de découvrir un point précis de la ville, ne font que mettre l‟accent sur les quartiers du centre qui restent les espaces littéraires de prédilection pour les écrivains de notre corpus. Mais cela ne signifie pas que la périphérie soit totalement absente des œuvres qui nous intéressent, bien au contraire. c- Le traitement des périphéries La présence des quartiers excentrés dans la littérature de fiction est certes sporadique mais elle n‟est pas complètement anecdotique et mérite que l‟on s‟y intéresse dans cette partie consacrée aux lieux et espaces littérarisés. On connaît l‟importance symbolique qu‟a le centre, qui devient pour Mircea Eliade « un lieu sacré par excellence [...] appelé littéralement le Centre du Monde »184, tandis que ce qui est extérieur au centre représente historiquement l‟inconnu, le chaos, voire la mort185. La périphérie, bien que n‟ayant pas toute la charge symbolique du centre, n‟en est pas moins intéressante. C‟est effectivement dans l‟opposition entre les deux espaces que se complexifie le territoire urbain. L‟étude de cinq quartiers (El Cerro, Marianao, La Víbora, Casino Deportivo et Alamar), décrits à des époques différentes, va nous permettre de voir comment est traitée la périphérie dans la diachronie. Il a déjà été question auparavant du cas particulier du roman du XIXème siècle Historia de un bribón dichoso où l‟action se déroule essentiellement dans les quartiers périphériques de El 183 Ibid., p. 216. Mircea Eliade, Images et symboles (1952), Paris, Gallimard, « Tel », 1980, p. 49, 50. 185 Ibid., p. 47, 48. 184 76 Horcón et de El Cerro. Même si, comme nous l‟avons dit, Ramón Piña ne construit pas de réelles descriptions spatiales et ne fait qu‟évoquer superficiellement ces espaces, cette œuvre est singulière car elle s‟éloigne du centre, ce qui est assez rare pour l‟époque. Aux XXème et XXIème siècles, la périphérie sera, cependant, plus souvent abordée. Cela dit, il est remarquable d‟observer que le développement du transport automobile, qui facilite grandement les déplacements à travers toute la ville, ne se traduit pas en littérature par un intérêt accru pour ces quartiers excentrés. On évoquera ainsi de temps à autre El Cerro, La Víbora, Marianao quand au contraire Arroyo Naranjo, Playa, Lawton ou Guanabacoa seront presque totalement absents des références spatiales. Quand il est fait allusion à ces zones périphériques, c‟est tout d‟abord de l‟histoire de leur urbanisation qu‟il est question. Quelques auteurs ne manquent pas de rappeler l‟origine bourgeoise de El Cerro, par exemple. Ainsi, Julio Travieso, dans son roman qui retrace les deux cents dernières années de l‟histoire cubaine, El polvo y el oro (1993), fait dire à Rosario, l‟une des descendantes des Montero, famille rivale des Valle : Sí los Valle han tenido mucho gusto para construir sus palacetes, éste de Miramar, el del Vedado y antes en el Cerro. [...] ¿ Quién no vivió en el Cerro ? En el siglo pasado todos tuvieron mansión allí Ŕ Rosario exhibe el orgullo de alguien cuya familia posee una historia de más de cien años y radicó en el lugar indicado en el momento preciso, en este caso el lujoso y floreciente Cerro, centro de la alta sociedad, no el actual barrio de pobres.186 On le voit, au XIXème siècle, la bonne société se devait d‟avoir une villa dans El Cerro car c‟était un signe de richesse. Avant d‟être le quartier pauvre et populaire qu‟il est aujourd‟hui, El Cerro constituait donc un secteur privilégié couru. Guillermo Cabrera Infante évoque une autre étape historique du quartier : celle du début de la République lorsque des combattants mambises reçurent certaines de ces demeures. Le quartier bourgeois est mis à mal par l‟arrivée de ces officiers qui héritaient de ces villas : « [...] las casonas de La Habana que se expandía extramuros, precisamente en la continuación de Zulueta o de la calle Montserrate, ubicándose como nuevos aristócratas, caricaturas coloniales, en El Cerro, en La Víbora y hasta en el lejano Vedado »187. L‟auteur se moque de ces nouveaux arrivants qui n‟ont d‟aristocrate que la demeure et qui vont reproduire les séparations spatiales de l‟ère coloniale. Il est intéressant d‟observer que El Cerro n‟est pas toujours synonyme de faste et d‟aristocratie et qu‟il se caractérise aussi par son manque d‟infrastructure urbaine, par sa saleté et son caractère rural. Faisant allusion à l‟histoire d‟Enrique, jeune Galicien qui arrive à 186 187 Julio Travieso, El polvo y el oro (1993), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 1998, p. 218. Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 60. 77 Cuba durant les Guerres d‟Indépendance et qui est ensuite rejoint par sa sœur Angelina, Abilio Estévez, dans Tuyo es el reino, explique qu‟ils achetèrent une maison dans El Cerro : [...] se fueron a El Cerro [...]. A ella La Habana le pareció un corral [...], las calles eran de puro fango, las paredes de las casas eran de puro fango como las calles, y las gallinas, cerdos, perros, guanajos, vacas, carneros que corrían delante y detrás de los coches, eran de puro fango como las paredes y las calles.188 Cette insistance sur la fange qui semble tout envahir montre que le quartier ne bénéficie d‟aucun aménagement urbanistique, contrairement au centre de la ville, et qu‟il est fortement marqué par la ruralité. Il constitue en quelque sorte une limite confuse qui sépare la ville de la campagne. Enrique et Angelina fuiront ce que cette dernière qualifie de « quinto infierno »189 pour s‟installer dans une propriété située à Marianao, appelée « la Isla ». Tuyo es el reino pourrait figurer parmi les rares œuvres qui ne placent pas l‟intrigue romanesque dans le centre de la ville mais dans un quartier périphérique. Il est pour ainsi dire une exception puisque le roman se passe à Marianao, et plus précisément dans la propriété que l‟on vient d‟évoquer. Le terme « microcosme » se justifie ici d‟autant plus que les personnages vivent dans un espace séparé du reste de la ville (« la Isla ») qui se situe luimême dans un quartier excentré. Mais le narrateur ne décrit pas précisément Marianao. Bien qu‟il évoque rapidement, au début du roman, les maisons, les parcs et la gare de ce municipio, il se focalise surtout sur la propriété et ses habitants. En outre, les autres quartiers de la ville, comme La Habana Vieja, bénéficient parfois de descriptions plus détaillées que Marianao190. Tuyo es el reino a beau avoir pour décor le quartier natal d‟Abilio Estévez, les descriptions de ce secteur n‟en sont pas moins sommaires et il faut attendre la publication de Inventario secreto de La Habana, en 2004, pour que l‟auteur développe un peu plus le portrait littéraire de Marianao. Dans ce récit, le quartier se caractérise par son isolement, son calme et sa tranquillité et c‟est d‟ailleurs ce qui fait dire au narrateur que « las afueras de La Habana siempre poseyeron una aureola de delicias »191. Estévez rappelle lui aussi, entre autres choses, une étape historique du quartier, quand il était un haut lieu de la nuit havanaise : 188 Abilio Estévez, Tuyo es el reino, Barcelone, Tusquets, 1997, p. 181. Ibid., p. 182. 190 Notons que Marianao apparaît également dans le roman d‟Estévez, El bailarín ruso de Montecarlo (2010), puisque le protagoniste, Constantino Augusto de Moreas y a grandi, mais les descriptions de ce quartier demeurent succinctes. 191 Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 89. 189 78 Nada parece recordar que ese rincón silencioso haya sido uno de los centros malditos de La Habana. Digo maldito en el sentido bendito del vocablo [...]. El gran sitio de cultura popular habanera, de la música, los bailes y las grandes juergas. Se decía que allí terminaban todos los noctámbulos fiesteros de La Habana. El espacio lo comprendía la Quinta avenida de Miramar, desde la rotonda, donde se hallaban La Frutada y El Cucalambé, hasta el Habana Yatch Club y el casino Español, pasando por el divertidísimo Coney Island [...]. Aquello, dice mi tío Roberto, era un hervidero de supuestas academias de baile, de quioscos con lucecitas de colores, de bares (El Gallito, El Cañabrava, El Bellamar), de night clubs y de posadas.192 Un peu plus loin, l‟auteur insiste sur cet aspect festif en expliquant que l‟endroit connut son apogée lors de la Prohibition dans les années 20 car les Américains prenaient alors une embarcation depuis les îlots les plus au sud de la Floride et arrivaient directement sur la plage de Marianao où plus aucune loi restrictive n‟était en vigueur. Mais le narrateur, qui a grandi dans ce quartier au début de la Révolution, retient surtout l‟impression d‟éloignement qu‟il ressentait : « [...] en el pequeño atlas de nuestra geografía familiar La Habana era aquel paraje no sólo lejano, sino además extraño, ajeno, incomprensible, en el que estábamos y no estábamos [...] »193. Quoi qu‟on en dise, Marianao, et tous ces quartiers excentrés, ne semblent pas être complètement La Havane, comme l‟illustrent ces quelques lignes qui font du centre-ville un monde à part (« lejano »), un univers étranger (« extraño », « ajeno »). On retrouve cette idée de territoire divisé où s‟élèvent des frontières aussi bien invisibles que subjectives dans Allegro de habaneras, de Humberto Arenal, où la protagoniste Cecilia parcourt la ville seule ou accompagnée de l‟Espagnol Joan qu‟elle a rencontré sur la Plaza de Armas. Lors d‟une de ces promenades, le narrateur omniscient explique : Hoy y siempre hiciste algo que se ha convertido en un necesario ritual. Caminas por la calle San Lázaro hasta el Paseo del Prado, que es la línea que para ti divide la Habana Vieja del resto de la ciudad que fue ganando nombres en su inevitable y expansivo crecimiento : El Cerro, Jesús del Monte, Luyanó, Puentes Grandes, Centro Habana, Marianao, Vedado, Miramar, y otros que para ti nunca contaron. 194 Dans une dichotomie radicale, le narrateur oppose La Habana Vieja au « reste de la ville ». Ce centre, qui est extrêmement limité (il n‟inclut même pas Centro Habana), est isolé du reste de la ville par le paseo del Prado, qui fait office ici de frontière matérielle. Pour Cecilia, tout ce qui n‟est pas la vieille ville forme un tout sans importance (« nunca contaron »). Cet ensemble est certes déterminé, puisque le nom des quartiers périphériques est cité, mais il est totalement 192 Ibid., p. 203. Ibid., p. 135. 194 Humberto Arenal, Allegro de habaneras, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2004, p. 13. 193 79 indifférencié. Cette évocation classique qui oppose le centre aux faubourgs (espace inconnu et chaotique) correspond parfaitement au schéma de Mircea Eliade évoqué précédemment. Au contraire, pour d‟autres, cette périphérie, celle où ne s‟aventurent pas les touristes, est la Havane authentique, la « vraie » ville en somme. C‟est le statut qu‟a La Víbora, dans le roman Llueve sobre La Habana de Julio Travieso, qui est le quartier de la grand-mère maternelle de la protagoniste Mónica. Voici ce qu‟en dit le narrateur protagoniste : « Quien no conoce La Víbora no conoce La Habana. Los parlanchines turistas [...] que deambulan por el centro de la ciudad no tienen, por suerte, la más mínima idea de la existencia de tal barrio »195. Nous aurons l‟occasion de revenir sur cette citation ultérieurement lorsque nous étudierons La Havane des touristes. Mais nous pouvons d‟ores et déjà dire que, cette fois, les barrières qui scindent l‟espace urbain isolent la périphérie du centre (et non pas l‟inverse) puisque s‟opère un renversement des valeurs et un déplacement de la focalisation : la périphérie représente la véritable ville par synecdoque alors que le centre n‟en serait qu‟un simulacre. Ici, La Havane se définirait justement par la périphérie196. Cela étant dit, il n‟en demeure pas moins que, dans ce roman, la périphérie semble aussi très isolée du reste de la ville. Si pour Abilio Estévez, c‟était le centre-ville qui semblait très éloigné de Marianao, chez Travieso, c‟est l‟inverse qui se produit car, période spéciale oblige, La Víbora est pratiquement inaccessible : « Muy lejana para ir a pie, muy afectada por la crisis del transporte, que exigía casi dos horas en la espera de un renqueante ómnibus, a La Víbora no iba desde que comencé a vivir en el cuarto de la azotea [...]. Incluso la había excluido de mis áreas de permutas »197. Le quartier, devenu inaccessible, est donc complètement séparé du reste de la ville et constitue une île dans l‟Île où les difficultés semblent ici plus aiguës qu‟ailleurs. Voici d‟ailleurs la description qu‟en fait le narrateur de Vientos de Cuaresma (1994), de Leonardo Padura Fuentes, lorsque le lieutenant Mario Conde se rend dans l‟appartement de Lissette, jeune professeur retrouvée morte : Desde aquel cuarto piso de Santos Suárez [el Conde] tenía una vista privilegiada de una ciudad que a pesar de la altura parecía más decrépita, más sucia, más inasequible y hostil. Descubrió sobre las azoteas varios palomares y algunos perros que se calcinaban con el sol y la brisa ; encontró construcciones miserables, adheridas como escamas a lo que fue un cuarto de estudio y que ahora servía de vivienda a toda una familia ; observó tanques 195 Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 275. On observe le même procédé chez Abilio Estévez : « [...] viajero, ahí tienes a La Habana, tanto tiempo descuidada, con tantos lugares que no son el casco histórico, o los centros donde se hace amable la estancia a los turistas, tantos lugares como Luyanó o Marianao o El Cerro [...] », Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 321, 323. 197 Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 276. 196 80 de agua descubiertos al polvo y a la lluvia, escombros olvidados en rincones peligrosos [...].198 Nous le verrons, pendant la période spéciale, la crasse et la détérioration ne sont pas l‟apanage de La Víbora, mais elles semblent surprendre le policier par leur intensité, comme le suggèrent la répétition de l‟adverbe « más » et les multiples adjectifs péjoratifs qui se succèdent. La misère, qui n‟est pas nécessairement plus importante qu‟ailleurs, semble en tout cas plus flagrante ici. Les œuvres de Padura Fuentes ont ceci de particulier qu‟elles décrivent à de nombreuses reprises des quartiers excentrés puisque certains personnages liés aux diverses enquêtes de Mario Conde y vivent. Le regard aguerri, mais non dénué de nostalgie, du détective se pose sur divers secteurs de la ville qui n‟apparaissent pas habituellement dans les récits de fiction. Le lecteur pénètre avec le lieutenant dans ces zones périphériques qui font de La Havane une mosaïque de « barrios », « municipios » et « repartos ». Outre le quartier de La Víbora, où Conde a d‟ailleurs grandi, El Cerro est souvent décrit. C‟est là que vit Tamara, la veuve de Rafael Morín, dans Pasado perfecto (1991), le premier opus de la tétralogie, et Alberto Marqués, l‟intellectuel homosexuel de Máscaras (1997). Casino Deportivo est le quartier de la mère de Lissette, dans Vientos de cuaresma. Ce quartier se distingue du reste de la ville par son passé bourgeois mais contrairement à El Cerro, il en a conservé certaines caractéristiques : [...] el Casino Deportivo había sido totalmente construido en los años cincuenta para una burguesía incapaz de llegar a fincas y piscinas, pero dispuesta a pagar el lujo de tener una habitación para cada hijo, un portal agradable y un garaje para el carro que no iba a faltar [...] [el conde] notó que allí oscurecía sosegadamente, sin cambios bruscos, y no había ventolera, como si las contingencias e impurezas de la ciudad estuviesen prohibidas en aquel coto pasteurizado casi completamente ocupado por los nuevos dirigentes de los nuevos tiempos. Las casas seguían pintadas, los jardines cuidados y los car-porsh ocupados ahora por Ladas, Moskovichs y Fiats polacos de reciente adquisición, con sus cristales oscuros y excluyentes. La gente apenas caminaba por la calle, y los que lo hacían andaban con la calma dada por la seguridad : en este reparto no hay ladrones, y todas las muchachas son lindas, casi pulcras, como las casas y los jardines, nadie tiene perros satos y las alcantarillas no se desbordan de mierda y otros efluvios coléricos.199 Cet espace aseptisé, gardant encore les marques de l‟american way of life qui faisait rêver la petite bourgeoisie dans les années cinquante, se distingue aujourd‟hui par un calme et une 198 199 Leonardo Padura Fuentes, Vientos de cuaresma (2001), Barcelone, Tusquets, 2007, p. 34. Ibid., p. 51. 81 tranquillité inhabituels dans La Havane des années quatre-vingt-dix. Cette sérénité caractérise aussi bien les habitants que leur quartier et fait du Casino Deportivo un espace homogène où même les voitures aux vitres teintées sont discriminantes. On observera par ailleurs qu‟au XXème siècle comme au XIXème, les plus aisés ne se déplacent pas à pied (« la gente apenas caminaba por la calle »). Ce havre de paix, qui accueille la nouvelle élite dirigeante et qui est complètement séparé du reste de La Havane (« aquel coto pasteurizado »), semble résister aux assauts de la ville en crise : saleté et délinquance restent aux portes du Casino Deportivo. Le quartier fonctionne ici comme une unité cohérente et harmonieuse quasiment imperméable à la période spéciale. A l‟opposé de ce quartier résidentiel paisible, l‟on trouve enfin Alamar, situé à l‟est de la ville. Mirta Yáñez, dans Sangra por la herida, s‟intéresse à cet ensemble construit durant la Révolution pour pallier le manque de logements dans la capitale, car deux de ses personnages y vivent : Willie et Daontaon. Tour à tour, ils vont décrire leur quartier marqué par la dégradation, le bruit infernal et les odeurs pestilentielles. Voici, par exemple, ce qu‟en dit Willie : Aunque quisiera no puedo cerrar las orejas o las narices con unos párpados que impidan la entrada de los ruidos y los hedores que los pobladores de este edificio generan durante las veinticuatro horas, sin ningún esfuerzo particular. Pero si lograse perder el olfato o adquirir sordera por un rato, y me pusiera a mirar el mar, el mar habanero, distinto y diferente a cualquier otro, valdría la pena vivir en este vecindario. ¿ Ya había mencionado su nombre ? « Alamar » [...]. Alamar se caracteriza fundamentalmente por su ambiente sonoro : en cualquier momento del día o la noche, el sonido más persistente es el aullido de las madamas clamando por sus retoños. [...] Otro componente acústico consiste en una barahúnda reconocida entre los miembros de la horda como « música » y que puede ser percibida hasta diez kilómetros a la redonda. Los aborígenes del edificio gozan con el hábito de intensificar al tope el audio de sus equipos estereofónicos para compartirlo con todos los moradores. [...] Junto a los fragores propios de las bestezuelas que conviven con los vecinos [...] otros bullicios habituales son los golpetazos propios del derribo y destrozo [...] ; las riñas matrimoniales con acompañamiento de vidrios rotos ; el feroz entrechocado de las fichas de dominó, las vociferaciones que acompaðan las borracheras […] ; el parloteo de la chismografía urbana y local ; los golpes de bate con la pelota contra los cristales y las paredes del edificio [...]. El tema de los olores sería, así mismo, motivo de más disquisiciones.200 Dans une sorte de dissection d‟Alamar (la narratrice parle d‟ « exposé »), Willie analyse son quartier à travers le prisme des cinq sens. Trois sont convoqués dans ces lignes : l‟odorat (« las narices », « los hedores », « el olfato », « los olores »), la vue (« párpados », « mirar ») et surtout l‟ouïe (« orejas », « los ruidos », « sordera », « sonoro », « sonido », « fragores », 200 Mirta Yáñez, Sangra por la herida, op. cit., p. 50, 51. 82 « bullicios », etc.). Pour mieux souligner le chaos d‟Alamar, la narratrice commence son inventaire par une synesthésie : « no puedo cerrar las orejas o las narices con unos párpados que impidan la entrada de los ruidos ». S‟ensuit alors une longue énumération de tous les bruits du quartier qui met en lumière la désagréable promiscuité contraignant tous les habitants d‟Alamar à se supporter. Chacun vit comme s‟il était seul sans se soucier du voisinage, ce qui génère un vacarme assourdissant de jour comme de nuit. Pour couronner le tout, la présence de bêtes et d‟odeurs répugnantes transforme cette cité aux allures architecturales soviétiques201 en véritable agglomération infernale. C‟est, de plus, une cour des miracles peuplée des rebuts de la société ; c‟est ce que suggère Daontaon quand elle inventorie les habitants du quartier : « Borrachos, niños piojosos, retrasados mentales, viejas locas, perros sarnosos, pervertidos sexuales, mal educados, zarrapastrosos, delincuentes, escoria [...] »202. On pourra lire d‟ailleurs un peu plus loin : « La Habana está llena de gente trastornada. Y se concentran en Alamar »203. Le délabrement matériel d‟Alamar et sa population peu scrupuleuse ont transformé le lieu en « un gigantesco conventillo patibulario [...] una favela residencial »204. Alamar serait donc le bidonville de La Havane, dans le roman de Yáñez, et constituerait un échec urbanistique à tout point de vue puisque s‟y concentrent tous les inconvénients de la ville et de la périphérie. Là encore, on ne peut que se rappeler la portée symbolique des espaces excentrés dont parlait Mircea Eliade : ce quartier représenterait par antonomase l‟enfer et le chaos. Du XIXème au XXIème siècle, le traitement littéraire des faubourgs oppose le centre au reste de la cité. Les frontières intérieures qui s‟érigent isolent ces quartiers éloignés des points névralgiques de la capitale. Bien qu‟isolées, les périphéries fonctionnent comme des caisses de résonance où s‟amplifieraient les phénomènes urbains. Le luxe et la tranquillité du Casino Deportivo n‟auraient sans doute d‟équivalent qu‟à Miramar quand, en revanche, la misère, la saleté et le délabrement actuels de La Víbora ou d‟Alamar semblent paroxystiques. Ces focalisations sur les différents secteurs de la ville font de La Havane une véritable mosaïque 201 Marylin Bobes fait dire à l‟un de ses personnages narrateurs : « Alamar parece una película rusa [...] », Marylin Bobes, « Alguien tiene que llorar », in Alberto Garrandés, La ínsula fabulante. El cuento cubano en la Revolución (1959-2008), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2008, p. 596. Senel Paz, quant à lui, fait dire à son personnage David qui se rend dans ce quartier : « […] al rato no sabìa con certeza si vagaba por un barrio de La Habana o de Bucarest, si me encontraba en la realidad, en el territorio indefinido de una pesadilla […] », Senel Paz, En el cielo con diamantes, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2007, p. 320. 202 Mirta Yáñez, Sangra por la herida, op. cit., p. 19, 20. 203 Ibid., p. 123. 204 Ibid., p. 126. 83 qui serait un agglomérat de quartiers indépendants. Si ces derniers semblent fonctionner de manière autonome, tels des microcosmes, force est de constater qu‟au contraire, des zones très précises vont symboliser la capitale tout entière. 3- Des « allégories du territoire » a- Le Malecón : un emblème ambivalent Des lieux très précis vont apparaître de manière récurrente dans les œuvres littéraires sans pour autant exclure des descriptions plus globales de la ville. Ce ne sont donc pas des microcosmes mais des « allégories du territoire », pour reprendre la formule de Bernard Debarbieux205. Ces abstractions de la ville ou emblèmes urbains vont représenter et définir la ville. Un des lieux les plus (d)écrits est sans doute le Malecón havanais. Ce grand boulevard de 9 kilomètres de long, construit en 1902 par les Américains pour protéger la ville des assauts de l‟océan et qui sera progressivement rallongé jusqu‟à la Boca de la Chorrera (l‟embouchure du fleuve Almendares), est un lieu emblématique, témoin de son époque. Tant dans les représentations iconographiques de La Havane que dans les romans de notre corpus des XXème et XXIème siècles, le Malecón est incontournable206. Emblème de la ville, il est presque systématiquement évoqué dans les écrits que nous étudions, car ce boulevard est singulier par sa localisation : il sert de frontière entre la ville et la mer et unit plusieurs quartiers entre eux. C‟est sans doute le roman La vida manda (1929), d‟Ofelia Rodríguez Acosta, qui offre une des premières descriptions du Malecón puisque c‟est là qu‟a lieu le défilé militaire pour la fête nationale du 20 mai, célébrant la proclamation de la République (en 1902) : Se celebraba en La Habana la fiesta patriótica del 20 de mayo. Esto no tenía en la vida civil del pueblo cubano trascendencia alguna, como no fuera la de ver pasar por la mañana a lo largo del Malecón la revista militar [...]. Del lado contrario, paralela al muro que bordeaba la costa, la hilera de casas resaltaba, todas blancas de sol, en el fondo azulísimo del cielo. Pendían de los balcones banderas de varias naciones, destacándose entre ellas la de Cuba republicana. [...] El gentío de ocasión invadía calles, aceras, ventanas y 205 Bernard Debardieux, in Guy Di Méo, « Que voulons-nous dire quand nous parlons d‟espace ? », Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géographies à Cerisy, sous la direction de Jacques Lévy et Michel Lussault, Paris, Belin, 2000, p. 42. 206 Voilà ce qu‟en dit l‟architecte et historien de l‟architecture Eduardo Luis Rodrìguez : « [...] la riqueza paisajística del lugar es tal que rápidamente se convirtió en la fachada por excelencia de la ciudad, en su valor visual más ponderado », Eduardo Luis Rodríguez, La Habana. Arquitectura del siglo XX, Barcelone, Blume, 1998, p. 30. 84 soportales. En las azoteas, los paraguas, utilizados como resguardadores del sol, asomaban sus conchas negras [...].207 Le Malecón sert ici le patriotisme national car il accueille les militaires qui défilent et les hommes politiques qui assistent au défilé. L‟auteur ne décrit pas tant l‟avenue du Malecón que l‟atmosphère festive et les badauds venus en nombre. Il faudra attendre le roman Fotuto (1948), de Miguel de Marcos, pour avoir une description plus étoffée du front de mer208. Le héros du roman, Telesforo Caraballo (alias Fotuto), après de nombreuses aventures dans la capitale cubaine s‟établira à quelques mètres du Malecón avec sa femme et sa fille, dans le rue Campanario, entre le Malecón et la rue San Lázaro. Le Malecón est un lieu déterminant dans ce récit car il suscite tout d‟abord l‟admiration du protagoniste qui s‟y rend régulièrement. C‟est un lieu de quiétude où l‟on admire sereinement la mer et la ville et qui transforme les personnages en spectateurs : En la noche de febrero, llegaba desde el Malecón, un aire agrio y frío. [...] [Fotuto] Siguió andando y se sentó en el muro del Malecón. [...] Y se quedó inmóvil, en éxtasis. Las olas que llegaban furiosas rompiéndose en los arrecifes lo salpicaban de agua. [...] Aumentó su inmovilidad, su inercia, su olvido de todo. Miraba hacia lo lejos, hacia la lumbre del Morro que, en la 209 noche, a cada vuelta, a cada guiño, parecía sonreírle [...]. A sa sortie de prison, Fotuto se rend sur le Malecón où il se retrouve comme paralysé face à la mer. La gradation (« su inmovilidad, su inercia, su olvido ») montre combien il est figé dans la contemplation, transporté hors de lui, comme le souligne l‟expression « en éxtasis ». On observera au passage que l‟agitation de l‟eau (« Las olas que llegaban furiosas ») rend l‟immobilité du personnage encore plus frappante. Comme s‟il était soudainement devenu incapable de se mouvoir, Fotuto n‟est plus qu‟un spectateur anéanti d‟un tableau vivant. A ce propos, nous verrons que le Malecón envisagé comme une œuvre d‟art sera une constante dans la littérature. Dans le roman qui nous occupe, ce lieu sera aussi déterminant car il sera la scène du très destructeur cyclone d‟octobre 1926 : Un derrumbe, entre espectacular y espantoso, en la esquina de Malecón y Lealtad. Una vieja casa de dos plantas. Había volado el techo de la sala, cayeron el balcón y las paredes del frente. Vigas viejas, piedras, muebles rotos [...]. Otros gritos de espanto. El Malecón estaba inundado desde San Lázaro hasta Belascoaín. El ras de mar se incorporaba al ciclón para 207 Ofelia Rodríguez Acosta, La vida manda, op. cit., p. 166, 167. De rapides allusions à cette promenade sont aussi faites sous la plume d‟Enrique Serpa, par exemple, (dans Felisa y yo et Contrabando) mais elles sont trop succinctes pour que l‟on s‟y intéresse ici. 209 Miguel de Marcos, Fotuto, La Havane, Editorial LEX, 1948, p. 118, 119. 208 85 materializar mayores estragos. En algunos lugares bajos la inundación se extendía hasta Galiano y lagunas, por donde circulaban botes pequeños.210 Avec une violence inouïe largement décrite dans le roman, ce cyclone s‟abat sur La Havane, détruisant tout sur son passage, inondant les avenues et les maisons et emportant aussi la fille de Fotuto, Yolandita, qui mourra prise par les eaux alors que son père fuyait en la tenant dans ses bras. Dans ce roman, Le Malecón est donc aussi le lieu de la tragédie et de la fatalité. Mais c‟est souvent un lieu aimé et apprécié que les écrivains se plaisent à décrire car il suscite les descriptions poétiques. C‟est le lieu où José Cemí, dans Paradiso, de Lezama Lima, rencontre ses amis (Foción et Fronesis) et où il aime aller : Fue bajando por San Lázaro [...] cruzó la calle para coger la acera ancha del Malecón. Las olas se hacían inaudibles, sin llegar casi al silencio, pues parecían guiadas por el vaho lunar. Parecían haber abandonado su ritmo propio, para ganar sus progresiones en la fatalidad de una ley desconocida.211 Lezama en fait un lieu magique et mystérieux qui n‟obéit pas aux lois de la nature puisque les vagues sont silencieuses et la force qui les guide est inconnue. Le Malecón est l‟espace qui devient paysage en somme. Comme nous l‟avons déjà dit, on contemple ce boulevard comme on contemplerait un tableau. Le procédé de l‟ekphrasis est d‟ailleurs récurrent dès lors qu‟il s‟agit de décrire le Malecón, ainsi que le démontre cet extrait tiré de Te di la vida entera, de Zoé Valdés : El sol rutila en el oleaje. El mar se balancea dorado, y cuando las olas rompen contra el muro, la ciudad se cubre de espuma ardiente, radiante. A contraluz, niños esqueléticos y semidesnudos corretean sobre el muro [...] las olas continúan ofreciendo el espectáculo más bello que ojos humanos han visto.212 La narratrice s‟attarde sur les reflets de la lumière sur la mer et offre une description très visuelle du Malecón (« rutila », « dorado », « radiante », « contraluz »). C‟est la vue qui est indéniablement stimulée ici, comme le suggèrent les dernières lignes de cette description (« el espectáculo más bello que ojos humanos han visto »). Les superlatifs semblent s‟imposer également dès lors que l‟on évoque le Malecón : à la fois tableau figé et spectacle vivant, c‟est l‟endroit le plus beau qu‟on n‟ait jamais vu. C‟est même « [el] espectáculo único de la ciudad 210 Op. cit., p. 319. José Lezama Lima, Paradiso, op. cit., p. 460. 212 Zoé Valdés, Te di la vida entera (1996), Barcelone, Editorial Planeta, « Booket », 2008, p. 293, 294. 211 86 más bella del mundo [...] ¡ Una maravilla ! ¡ Un orgasmo ! »213, chez Mirta Yáñez. Une chose est sûre, c‟est certainement le lieu le plus intéressant d‟un point de vue graphique et descriptif si l‟on considère le nombre de toutes ses représentations iconographiques et littéraires. Certains écrivains franchissent même les frontières entre récit et image en construisant une description très cinématographique du boulevard. Cabrera Infante est un expert en la matière car son écriture est fortement influencée par le cinéma. Passionné par le septième art, il a, en effet, rédigé des chroniques filmiques pour la revue Carteles, il a créé, avec Néstor Almendros, Tomás Gutiérrez Alea et le soutien d‟Henri Langlois, la cinémathèque de Cuba en 1951 et il a publié plusieurs essais sur le cinéma (Arcadia todas las noches (1978), Cine o sardina (1997) et Puro humo (2000)214). Ces rappels biographiques montrent bien que le cinéma et la littérature se confondent et s‟influencent mutuellement dans la vie de cet auteur. Ainsi, lorsqu‟il s‟agit de décrire le Malecón, Cabrera Infante ne peut qu‟en faire un décor de cinéma : [...] lo digo solamente para aquellos que nunca han paseado en un convertible por el Malecón, entre cinco y siete de la noche, [...] a cien o cientoveinte : esa regalía, esa buenavida, esa euforia del día que está en su mejor hora, con el sol de verano poniéndose rojo sobre un mar de añil, entre nubes que a veces lo echan a perder al convertirlo en un crepúsculo de final de película religiosa en Technicolor, [...] aunque a veces la ciudad es crema, ámbar, rosa arriba, mientras abajo el azul del mar es más oscuro, se hace púrpura, morado, y sube al Malecón y comienza a penetrar en las calles y en las casas y no quedan más que los concretos rascacielos rosados, cremosos, de merengue tostado [...].215 Ce lieu, associé au plaisir et au bien-être, comme le suggère la gradation (« regalía », « buenavida », « euforia »), unit les éléments (la terre et l‟eau) aux nuages et au soleil. Là encore, ces quelques lignes construisent un véritable tableau littéraire grâce à l‟ekphrasis qui fait la part belle aux détails chromatiques. Les variations de couleurs semblent donner vie à cette peinture narrative tout comme l‟impression de travelling qui se dégage de ce court extrait. Comme s‟il était au cinéma, le lecteur suit la voiture de Cué sur le Malecón et contemple avec lui le coucher de soleil grâce à une description très précise des couleurs qui transforment la ville et la mer. Le crépuscule devient un plan cinématographique stéréotypé qui marquerait la fin d‟un film. Le Malecón est abondamment évoqué dans les œuvres de Cabrera car c‟est aussi un lieu lié à sa trajectoire personnelle. Ce fut tout d‟abord l‟une des découvertes urbaines marquantes de 213 Mirta Yáñez, Sangra por la herida, op. cit., p. 14. Ce livre sur le tabac et le cinéma a d‟abord été publié en anglais en 1985 sous le titre Holy smoke. 215 Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 147, 148. C‟est nous qui soulignons. 214 87 l‟adolescent qu‟il était puis, plus tard, ce fut le lieu des réunions entre amis et des conquêtes sexuelles : Nos sentamos en el muro del Malecón. No podría decir cuántas veces me había sentado en el muro del Malecón desde esa luminosa tarde de verano de 1941 en que lo había descubierto, Colón de la ciudad, y me había encantado para siempre, los hados convirtiendo a La Habana en un hada. Me senté entonces en el muro con mi madre y mi hermano, ella mostrándome a Maceo en su parque [...]. Me senté en el muro con mi tío el Niño en las tardes transparentes, dulces, sin nubes del otoño de 1941. Después fue con compañeros del bachillerato, esta vez sentados en los parques frente al Malecón, a mirar pasar las muchas muchachas [...]. Volví al muro con colegas literarios de la revista Nueva Generación [...].216 Ce Malecñn qu‟il aimera à jamais lui donne l‟occasion de se sentir explorateur, à la manière de Christophe Colomb découvrant l‟Amérique, et de jouer, une fois de plus, avec les mots et leurs significations grâce à la paronomase (« hado », « hada »). L‟allusion aux différentes personnes qui l‟accompagnaient sur le mur de la jetée (famille, camarades puis collègues) ferait presque du Malecón un lieu de passage initiatique puisqu‟il est associé aux grandes étapes de son existence : l‟enfance, l‟adolescence et l‟âge adulte. Cet espace public est donc, pour Cabrera, le lieu de l‟intime par excellence. Véritable lieu poétique, le Malecón unit terre et mer et est ainsi tantôt qualifié de « mur des lamentations »217 ou de « cicatrice de la division des eaux »218 car c‟est un espace à part, un lieu autre : il n‟est pas tout à fait la ville et n‟est pas la mer non plus. Il est la frontière physique entre les deux espaces, ou pour le dire autrement, il est la matérialisation même de ce que Virgilio Piñera a qualifié de « maldita circunstancia del agua por todas parte »219. Il est le lieu des départs impossibles qui offre un horizon inaccessible et engendre donc de la mélancolie, ainsi que le suggère Abilio Estévez : Muro llamado Malecón, como podría llamarse Escollera, Rompeolas, Muralla, muro al que muchas veces se le han dado connotaciones simbólicas, como aquella del habanero atrapado en la Isla, el habanero frente al mar, el que mira al horizonte, el que mira con nostalgia a las lejanías, a la espera de revelaciones y mensajes.220 Même s‟il s‟appelait autrement, le Malecón n‟en resterait pas moins un lieu chargé de sens. Y être et regarder l‟horizon signifie toujours penser à autre chose, penser à sa condition, à ses 216 Id., La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 316, 317. Zoé Valdés, Te di la vida entera (1996), op. cit., p. 215. C‟est nous qui traduisons. 218 Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 319. C‟est nous qui traduisons. 219 Virgilio Piñera, « La isla en peso », in La isla en peso (1943), Barcelone, Tusquets Editores, 2000, p. 37. 220 Abilio Estévez, Los palacios distantes, Barcelone, Tusquets, 2002, p. 256. 217 88 frustrations ou encore à l‟avenir car, d‟après le narrateur, il est difficile de concevoir le mur du Malecón sans sa charge symbolique. S‟il est propice à la poésie et à la mélancolie, il donne lieu aussi à des descriptions plus prosaïques qui dénoncent une douloureuse réalité : la prolifération de la prostitution qui s‟est développée à partir des années quatre-vingt-dix et de la période spéciale. En se substituant aux anciennes maisons closes d‟avant la Révolution, le Malecón est devenu le théâtre du jineterismo221 où touristes et prostitué(e)s se croisent, surtout la nuit, transformant ainsi le front de mer en un sinistre supermarché du sexe. La prostitution, que la Révolution n‟a pas pu éradiquer, redevient visible et s‟affiche ostensiblement sur le Malecón malgré la répression policière. Cet aspect sordide, qui est aussi l‟une des facettes de la double morale que les Cubains ont commencé à adopter principalement pendant ces années-là, est présent dans les œuvres les plus récentes de notre corpus. Julio Travieso l‟évoque puisque Mñnica est l‟une de ces prostituées du Malecón qui a commencé à travailler comme jinetera au moment de l‟effondrement du bloc soviétique : A la inversa, las caminatas por el Malecón que, muerta tu madre, tu continuaste, te fortalecieron y salvaron de morir de hambre en los comienzos de la época de la Escasez Absoluta y te provocaron la idea de jinetear al ver la gran cantidad de extranjeros, gordos, rozagantes, con muchos dólares en el bolsillo, que pasaban por tu lado y se quedaban mirándote, igual que a una diosa surgida de las aguas.222 Le Malecón est l‟endroit où la richesse des touristes et la misère des Cubains (« la Escasez Absoluta ») convergent en temps de crise. Zoé Valdés, dans Te di la vida entera, fait également allusion à ces prostitué(e)s qui, en quête de quelques dollars, remplacent les pêcheurs diurnes et utilisent le Malecón comme une réserve de chasse : « [...] muchachas ojerosas, demasiado pintadas para la hora, lucen licras fluorescentes y se discuten los autos con chapa turista. Los pingueros, nueva clave para denominar a los prostitutos, cazan o pescan mujer, hombre o cosa »223. Le Malecón est donc devenu un lieu ambivalent au fil des années qui évolue en fonction des circonstances historico-sociales. Mais quoi qu‟il en soit, il 221 Terme désignant la prostitution à Cuba. On appelle jineteras ces femmes qui ont entre treize et trente ans et qui vendent leur corps aux touristes principalement. Pour plus de précisions sur l‟origine du terme et l‟histoire de la prostitution à Cuba, voir : Amir Valle, Jineteras, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, 2006, p. 13, 14. 222 Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 85, 86. 223 Zoé Valdés, Te di la vida entera, op. cit., p. 293. Dans Café nostalgia (1997), l‟auteur décrivait déjà ce phénomène avec les mêmes termes : « En el muro se negocia ron, cigarros, mariguana, cocaína. Las jineteras y los pingueros deambulan a la caza de extranjeros carentes de todo menos de dólares », Zoé Valdés, Café nostalgia, Barcelone, Editorial Planeta, 1997, p. 224. 89 se singularise toujours par sa beauté et reste, en littérature comme dans les arts visuels, le symbole de La Havane s‟il en est. b- Représentations du Castillo del Morro : prolepses224 et synecdoques de la ville Le Castillo del Morro constitue un autre emblème ou une autre « allégorie » de la capitale cubaine très présent dans l‟iconographie225 et la littérature. Construit à la fin du XVIème et au début du XVIIème siècle (de 1589 à 1630), ce fortin gardait à l‟origine l‟entrée du port. C‟est sans doute le phare, construit en 1845, qui est l‟élément le plus symbolique du Castillo car il sert de repère. Contrairement au Malecón, ce n‟est presque jamais un lieu où l‟on va mais c‟est plutôt un site que l‟on observe de plus ou moins loin. C‟est une vue en quelque sorte mais pas un lieu de passage à proprement parler. Il représente d‟autant plus la ville qu‟il est ce que l‟on voyait en premier quand on arrivait en bateau à La Havane et il était, en toute logique, la dernière chose que l‟on voyait de la ville quand on la quittait. Nombreuses sont les descriptions de ces arrivées à la capitale par la mer qui offrent une vue panoramique de la ville qui se précise progressivement à mesure que l‟on s‟approche du canal permettant d‟atteindre le port. Le Castillo et son phare, puisqu‟ils sont ce que les voyageurs voient en premier, suscitent souvent les toutes premières descriptions de la ville. On peut même dire que ces premiers passages descriptifs servent en quelque sorte d‟introduction aux représentations de La Havane. Ainsi, la Comtesse Merlin qui arrive à La Havane après presque une quarantaine d‟années d‟absence (elle avait quitté l‟Île à l‟âge de douze ans), dans sa lettre XIV, en fait une description à la fois poétique et programmatique : Devant moi, du côté de l‟occident, le Morro, planté sur son âpre rocher, s‟élève hardiment et s‟avance dans la mer. Ŕ Mais qu‟est donc devenue cette masse énorme qui jadis me semblait menacer le ciel ? ce rocher colossal que mon imagination élevait à la hauteur du mont Atlas ? Ŕ Rien n‟a plus la même proportion : au lieu de cette lourde et colossale forteresse, la tour du Morro me paraît seulement élancée, délicate, harmonieuse dans ses contours, une svelte colonne dorique assise sur son rocher [...]. La pierre dont le Morro est bâti a beaucoup blanchi, et son éclat contraste avec la noire âpreté du roc, avec la lourde et sombre ceinture formée par les douze apôtres qui l‟étreignent. 226 224 Il ne s‟agit pas là de raconter des événements qui se produiront ultérieurement mais plutôt de préfigurer ou annoncer ce qui suivra dans le récit. 225 Plusieurs gravures ont représenté ce fort, notamment, durant la prise de La Havane par les anglais en 1762. Plus tard, au XIXème siècle, Fréderic Mialhe, pour ne citer que lui, le représenta dans plusieurs lithographies. 226 La Comtesse Merlin, La Havane (1844), Tome I, Paris, Indigo et Côté-femmes, 1998, p. 284. 90 La narratrice confronte ici ses souvenirs d‟enfant avec la réalité présente et s‟amuse à repérer les divergences. Dans un jeu d‟écho antithétique, les adjectifs se répondent : « énorme », « colossal » et « lourde », qui qualifient le phare tel qu‟elle le voyait avant, s‟opposent à « élancée », « délicate », « harmonieuse » et « svelte », qui correspondent à la perception actuelle. Le regard de la femme adulte n‟étant évidemment plus le même, tout revêt un aspect différent. A cet égard, cette description inaugure un exercice qui sera presque systématique dans son œuvre : la comparaison entre le souvenir et la réalité. En outre, l‟enthousiasme de la Comtesse est palpable dans ces lignes où elle semble sublimer le phare dans une énumération d‟adjectifs laudatifs car, on l‟aura compris, ce retour à La Havane est source de grande joie pour elle. Nombre de descriptions de la ville se feront également à travers ce même filtre déformant qui n‟est autre que la vision partiale de cette « étrangère » enchantée et émue de retrouver sa terre natale. Notons que le Morro, par ailleurs, suscite de multiples métaphores. Mais après tout, il n‟y a rien de surprenant à cela car nombreuses sont les images que l‟on peut associer à un phare. Tout d‟abord « colonne dorique » chez la Comtesse Merlin, il devient ensuite « trompe » d‟éléphant sous la plume de Jesús Castellanos227, puis « vergajo de semental » avec Miguel Barnet228 ou plus explicitement « pinga » dans une nouvelle d‟Arturo Arango229. Dans Las palabras perdidas (1992), de Jesús Díaz, il sera le clitoris de la ville et la baie de La Havane sera son sexe. C‟est ce qui est écrit dans le poème consacré à la ville que lit un des personnages (el Gordo) à ses amis : Esta ciudad nació en la sal del puerto y allí creció caliente, deschavada, el sexo abierto al mar, el clítoris guiando a los marinos como un faro de luz en la bahía [...].230 La personnification de la ville, réduite ici à son phare et son port, fait de La Havane une prostituée qui attirerait les marins. La comparaison est d‟autant plus cocasse et audacieuse que l‟image est inversée : c‟est le clitoris de la ville qui est comparé à un phare. On observera au passage qu‟à travers cette métaphore qui associe la cité à un corps féminin, La Havane 227 « […] empujaba el Morro hacia el agua su trompa abrupta », Jesús Castellanos, « Los Argonautas », in Obras, op. cit., p. 18. 228 « Todos querían baranda para ver la entrada del puerto, con la farola del Morro que me pareció una vergajo de semental, y los edificios del Malecón y las arboledas », Miguel Barnet, Gallego (1981), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 1983, p. 42. 229 Arturo Arango, « La Habana elegante », Segundas vidas, Ediciones Unión, 1995, p.139. 230 Jesús Díaz, Las palabras perdidas (1992), Barcelone, Anagrama, 1996, p. 229. 91 devient matrice. Cette féminisation de l‟espace urbain, qui permet à la ville de prendre corps littéralement, est un procédé récurrent dont nous aurons l‟occasion de reparler. On le voit, le Morro se prête donc aisément aux comparaisons les plus diverses et aux métaphores les plus connotées. Celles-ci évoluent au fil des siècles car leur signification change en fonction des aléas de l‟Histoire. Au XIXème et jusqu‟à la moitié du XXème siècle, c‟est un lieu qui éveille la joie tant pour ces nombreux Espagnols qui fuient la pauvreté et viennent tenter leur chance à Cuba que pour les Cubains qui rentrent chez eux car il marque l‟arrivée ou le retour au pays de Cocagne. Tel était ce que souhaitait dépeindre Jesús Castellanos dans son roman inachevé, évoqué précédemment, Los Argonautas. Son projet était de décrire l‟Île du tout début du XXème siècle comme un centre d‟activités commerciales important, où se rendaient de nombreux émigrés motivés par l‟appât du gain. Les premières pages du roman traitent du retour du jeune Camilo Jordán qui arrive d‟Europe, sans un sou, après avoir été boursier pendant quatre ans. Le retour à Cuba est synonyme d‟espoir pour cet étudiant en droit : « Camilo pudo vislumbrar allá muy lejos, meciéndose sobre el manto lívido de las aguas, un punto luminoso que con largos guiños miraba a las perdidas soledades. ¡ El Morro !... El corazón palpitó violento [...] »231. La vue du phare met le personnage en joie car elle signifie la fin du voyage et surtout le début de tous les possibles. L‟importance du Morro est soulignée dans ces lignes par une personnification qui assimile le faisceau lumineux éclairant l‟horizon par intermittence à un œil qui clignerait. A la fois gardien et repère, il veille sur l‟étendue maritime tout en guidant les nouveaux arrivants. L‟exaltation ressentie par Camilo Jordán ne fera que se confirmer dans les pages suivantes puisque son arrivée à La Havane se fait, symboliquement, à l‟aube marquant ainsi le début d‟un jour nouveau et d‟une renaissance232. L‟évocation du Castillo de los Tres Morros est donc rarement neutre et souvent connotée car elle est à l‟image de ce que représente la venue à La Havane pour les personnages. Parce qu‟elle annonce ce qui va suivre et oriente la lecture du récit, nous pouvons dire que sa description est « le lieu de stockage des „indices‟ […] »233. En cela elle peut avoir une valeur prospective : elle prépare souvent ce qui va suivre. Mais préparer le récit à venir peut aussi signifer, renverser ce qui a été dit. Dans un procédé de disjonction, Nicolás Heredia, dans le roman Un hombre de negocios (1882), dépeint une 231 Jesús Castellanos, « Los Argonautas », Obras. Tomo II, op. cit., p. 13. « Una luz nueva, una luz que doraba con divino barniz la arboladura del barco y espolvoreaba irisadas lentejuelas en la cresta de las olas mansas, se diluìa en el ambiente marino […]. En el cielo de ámbar […] se había levantado un sol de día de fiesta que amalgamaba plata y oro sobre las colinas lejanas […] », ibid., p. 18. C‟est nous qui soulignons. 233 Philippe Hamon, Du descriptif, op. cit., p. 50. 232 92 arrivée bien décevante, comme l‟attestent les premières impressions de l‟Espagnol don Marcelo : Cuando Marceluco entró por la boca del Morro, sin ver aquellos bosques inmensos y cargados de frutos ; aquellos jardines poblados de rosas multicolores ; aquella riente florescencia de la naturaleza, que por tanto tiempo habían exaltado su viva imaginación, esperimentó un profundo desengaño. Al encontrarse como primer espectáculo, las baterías, los murallones, los fuertes, tuvo miedo porque no contaba con semejantes impresiones. Los cañones, especialmente, le espantaron por su enorme tamaño ; imaginaba que se lo iban a tragar con sus fauces de acero, abiertas en un interminable bostezo.234 Les fortifications de la ville et le Castillo del Morro, en particulier, impressionnent le jeune Asturien venu à Cuba pour fuir la pauvreté. Cependant, on sent toute la déception de l‟Espagnol qui avait idéalisé cette colonie tropicale qui ne correspond en rien au nouvel Éden qu‟il s‟était figuré. La nature luxuriante fantasmée a été remplacée par des constructions militaires et des canons hostiles. La description du fortin est certes à l‟image de la ville, dont les rues sales et étroites étonnent les émigrés à leur arrivée235, mais elle permet, dans ce roman, de mieux mettre en scène le retournement soudain et inattendu qui changera la vie de don Marcelo. En effet, si son arrivée à La Havane est marquée par la désillusion et l‟hostilité, très vite, l‟héritage qu‟il va recevoir de don Bruno, son oncle et associé, l‟amènera à considérer la ville d‟une tout autre manière. C‟est sans doute pour mieux souligner le revirement de situation que connaîtra le personnage et pour accentuer l‟effet de surprise chez son lecteur que l‟auteur a choisi de commencer son récit par une description peu flatteuse du Castillo et de la ville. Même s‟il ne présage pas la suite des événements, ce passage joue néanmoins un rôle clef car, par un jeu de contraste, c‟est sur lui que repose la suite du récit. Chez Enrique Serpa, le personnage-narrateur El Almirante, qui est marin, ne découvre pas le Morro avec les yeux de l‟étranger qui arrive à La Havane pour la première fois et son regard n‟en est que plus sévère. A l‟image de la ville, le Castillo est ses abords sont sales et répugnants : « Al pasar junto al Morro, la brisa nos trajo un olor fétido y repugnante, que producía náuseas. Era el sahumerio que devolvía a la ciudad la Playa del Chivo, donde desagua el túnel del alcantarillado »236. Quand il se rapproche de la ville, le personnagenarrateur est saisi par les odeurs nauséabondes provenant des eaux usées qui se déversent dans 234 Nicolás Heredia, Un hombre de negocios (1882), Matanzas, La Nacional, 1883, p. 13, 14. « Llega el forastero ; entra por La Habana Vieja ; ve sus calles sucias y estrechas ; sus casas gachas e indecentes ; estudia los primeros tipos que ni siquiera se fijan en el pobre inmigrante perdido en aquella confusión de hombres y negocios, y experimenta una decepción tan profunda como exageradas eran las ilusiones concebidas », ibid., p. 13. 236 Enrique Serpa, Contrabando, op. cit., p. 121. 235 93 la mer. Adjectifs et substantifs concourent à marquer la répugnance, de manière peut-être hyperbolique. Comme nous aurons l‟occasion de le voir un peu plus loin, c‟est souvent avec emphase (forte adjectivation, style imagé, comparaisons abondantes) que le narrateur décrira la laideur de la ville. La description du Morro n‟échappe donc pas aux procédés stylistiques de l‟auteur et est à l‟image de La Havane ; c‟est pourquoi le fort constitue une synecdoque de la capitale. Paradiso, de Lezama Lima, est en cela un exemple fort probant : le castillo est un lieu poétique où l‟imaginaire est très présent. Notons au passage que nous avons là une des rares descriptions de la citadelle qui soient faites sur place, et non de loin, puisque, dans ce roman, le père de José Cemí, José Eugenio Cemí, a travaillé sur le Morro et il y emmène sa fille Violante et son fils : Ahora, José Eugenio Cemí, inspeccionaba las obras del Castillo del Morro, que había reconstruido como ingeniero y que inauguraba como primer director [...]. Lo acompañaba también su otro hijo, José Cemí, a quien el fuerte aire salitrero comenzaba a hacer gemir el árbol bronquial. [...] Se acercaban los oficiales subalternos con zalemas, con fingidos afectos, con camaritas fotográficas para tomar vistas, donde estuvieran los muchachos sobre cañones, bancos de piedra [...]. Pasaron frente a un oscuro boquete, que terminaba en las cuevas rocosas, donde los selacios redondeaban sus sueños hipócritas y el látigo de su desperezo. Ŕ Por ahí tiraban a los prisioneros, en la época de España Ŕ dijo el Jefe para asustar a sus hijos [...]. Muchos años más tarde, supo que por ese boquerón siempre se había lanzado la basura, y que por eso los tiburones se encuevaban en la boca del castillo, para salir de sus sueños al babilónico banquete de sus detritus. Toneladas de basura que se metamorfoseaban en la plata sagrada de sus escamas y caudas, como si fuesen pulimentados por Glaucón y su cortejo alegres bocineros.237 Si cette visite est l‟occasion de mieux définir la personnalité du père, qui aurait voulu parader auprès des autres militaires mais qui est gêné par la crise d‟asthme de José et le début de noyade de Violante, elle provoque également chez José Cemí un cauchemar qui sera récurrent (Cemí se retrouve dans l‟eau et cherche à en sortir)238. D‟un point de vue stylistique, cette description porte indéniablement les marques du baroque de Lezama, comme en témoignent la présence de phrases longues où les nombreux adjectifs fonctionnent souvent par association d‟idées, les énumérations, la personnification des poissons ou encore les nombreuses métaphores et comparaisons qui subliment même les ordures jetées à la mer. 237 238 José Lezama Lima, Paradiso, op. cit., p. 259. Ibid., p. 260. 94 On le voit, les descriptions assez diverses de la citadelle reflètent moins la réalité qu‟elles ne la suggèrent. Le Castillo del Morro n‟est pas propice aux évocations neutres et précises des chroniques par exemple, et ce, même au XIXème siècle, car c‟est un lieu de suggestion dont la description préfigure le traitement littéraire de la ville tout entière. c- Les bars, les cabarets et les hôtels ou les allégories de l’oisiveté La Havane festive, joyeuse et désinvolte constitue un topique abondamment répandu dans les œuvres de fiction. Cette image d‟Épinal représente bien sûr La Havane prérévolutionnaire, quand Cuba était « l‟arrière-cour » des Etats-Unis. Les grands hôtels, érigés dès les années 30, les cabarets (le Tropicana en tête), les clubs et les bars sont autant de symboles que le cinéma a lui aussi filmés. PM (1961), de Sabá Cabrera, frère de Guillermo Cabrera Infante, ou Soy Cuba (1964), film cubano-soviétique de Mikhaïl Kalatozov, montrent cette Havane insouciante et légère qui caractérisait surtout l‟époque de Batista (même si PM se passe au tout début de la Révolution). Nous avons déjà eu l‟occasion de le voir, La Havane de Guillermo Cabrera Infante se résume essentiellement à cela, surtout dans Tres tristes tigres puisque les quatre personnages noctambules appartiennent au monde du spectacle. Sans répéter ce qui a déjà été dit, rappelons simplement que la nuit havanaise des années cinquante (1958 pour être précis) est au centre du roman puisque bars, clubs, cabarets et cafés sont énumérés à l‟envi. Dès le début du livre, cet univers festif et oisif est mis en avant car le prologue n‟est autre que le discours de présentation d‟un spectacle que fait l‟animateur du Tropicana, cabaret emblématique, créé en 1939 : Showtime ! Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Muy buenas noches, damas y caballeros, tengan todos ustedes. Good-evening, ladies & gentlemen. Tropicana, el cabaret MÁS fabuloso del mundo… « Tropicana », the most fabulous night-club in the WORLD… presenta… presents… su nuevo espectáculo… its new show [...]. El Trípico para ustedes queridos compatriotas… ¡ El Trópico en Tropicana ! [...] Nuestro primer gran show de la noche… ¡ en Tropicana ! [...] ¡ Arriba el telón !239 Les propos de l‟animateur, qui s‟exprime à la fois en espagnol et anglais pour ses « amis américains, les bons voisins du Nord »240, sont entièrement retranscrits dans ce prologue qui s‟achève sur un « ¡ Arriba el telón ! » qui permet d‟envisager l‟histoire qui va suivre, celle des « quatre tristes tigres », comme le spectacle à voir. Ce discours au style direct, qui sert de 239 240 Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 15-19. Ibid., p. 18. C‟est nous qui traduisons. 95 scène d‟ouverture au roman, donne au lecteur l‟impression d‟être un spectateur parmi d‟autres et permet une immersion dans l‟univers des cabarets des années cinquante. Ce « palacio de la alegría »241 est un lieu touristique, comme le rappelle Mrs. Campbell, un des personnagesnarrateurs du livre : « Me gustó Tropicana : a pesar de ser una atracción turística [...] es hermoso y exuberante y vegetal, como la imagen de la isla »242. Son mari va en faire une description un peu plus fouillée quand il sera à son tour narrateur : Queríamos conocer Tropicana, el Nigth-club que se anuncia a sí mismo como « el cabaret más fabuloso del mundo » [...]. Tropicana está localizado en un barrio de las afueras. Es un cabaret en la jungla. Los jardines crecen sobre los callejones de entrada y cada yarda cuadrada está plegada de árboles y arbustos y lianas y epyphites [...]. El night-club puede describirse como físicamente fabuloso, la cumbre, pero el espectáculo se queda en llanos desnudos mayormente y simples, como todo cabaret Latino, yo supongo, con mujeres semi desnudas que bailan la rumba y cantantes mulatos que gritan esas canciones tontas [...].243 Mr. Campbell retient surtout l‟extraordinaire végétation qui fait de ce cabaret un lieu exceptionnel. Pour le personnage-narrateur, c‟est son cadre qui en fait « le cabaret le plus fabuleux du monde » car le spectacle le déçoit : il trouve la prestation des danseurs et chanteurs assez médiocre. On le voit ici, ces passages où Cabrera donne la parole aux touristes américains servent aussi à les moquer et à railler leur condescendance. Cette Havane fortunée, festive et insouciante est, en partie, celle de Luis Dascal, dans En ciudad semejante (1970), de Lisandro Otero, puisque le personnage appartient à la bourgeoisie havanaise prérévolutionnaire. Ainsi, le jeune étudiant, partage son temps entre l‟université et les cafés. Un soir, il se rend au Tropicana pour y voir une amie danseuse mais il ne se sent pas à son aise dans ce cabaret luxueux qui attire les riches touristes américains et l‟oligarchie cubaine : La entrada de Tropicana estaba obstruida por una larga fila de Cadillacs y Buicks, Lincolns y Chryslers. Avanzó con lentitud [...] viendo los resplandecientes trajes de noche reflejados en el gran espejo de la entrada. [...] Dascal admiraba al grupo : la timba del Biltmore : el tanque, Johnny Diaz, Zubiarre, Cacharro, Sapo Ardura y algunas veces Nelson Simoni, Jimmy Buigas y Bernardito Armenteros. Estaban tostados de sol y vestían camisas de nilón de colores puros ; andaban con las niñas doradas, las hermosas herederas talladas en carne rosada y fresca por un orfebre delicado [...]. Dascal se les acercaba tratando de absorber las cualidades que deseaba 241 Ibid., p. 17. Ibid., p. 197. 243 Ibid., p. 204. 242 96 desesperadamente. [...] Dascal advirtió que gesticulaba en el vacío : estar allí aquella noche era una pequeña osadía.244 Dans cet extrait, on voit que le cabaret est un lieu très couru où se retrouve une minorité fortunée, comme le soulignent l‟énumération des marques de voiture qui attendent devant l‟entrée, la liste des clients présents ce soir-là (l‟équipe du casino de l‟hôtel Sevilla-Biltmore, que l‟on imagine être des figures emblématiques de la nuit havanaise) et la description des jeunes filles aristocratiques qui les accompagnent. Pour Dascal, être au Tropicana constitue déjà un privilège en soi car le cabaret symbolise à lui tout seul la réussite, le pouvoir et l‟argent sous l‟ère de Batista. Par conséquent, il est aussi la marque d‟une ségrégation sociale puisque même un jeune nanti éprouve un certain embarras à côtoyer les personnalités mondaines de l‟époque auxquelles il aimerait ressembler. Ce cabaret est donc l‟allégorie de La Havane des casinos, de la prostitution et de la corruption des années quarante et cinquante. Il représente la ville qui sert de décor à l‟intrigue de Notre agent à La Havane (1958), de Graham Greene, La Havane « louche [...] où tous les vices étaient tolérés et tous les trafics possibles »245. Ce cabaret symbolise, en définitive, tout ce que le régime révolutionnaire a voulu combattre246. Zoé Valdés reprend cette image festive de la ville au début du roman Te di la vida entera lorsqu‟elle narre l‟arrivée de la jeune Cuca Martínez à la capitale, dans les années cinquante, et sa rencontre avec la Mechunguita et la Puchunguita, deux femmes noctambules qui vont lui faire découvrir les secrets de la nuit havanaise : Ésa era La Habana, colorida, iluminada, ¡ qué bella ciudad, Dios santo ! Y que yo me la perdí por culpa de nacer tarde. [...] La Habana, con sus cuerpos acabados de bañar, entalcados, perfumados [...]. Cuerpos brillantes de sudor, el sudor del placer, el placer del baile, el baile del amor [...]. Ésa era la ciudad azucarada, miel de la cabeza a los pies, música y voces aguardentosas, cabareses, fiestas, cenas [...]. ¡ Ay coño, qué rica, esa Habana húmeda, esa ciudad de noches calientes, dulzonas ! [...] El habanero siempre busca la noche. La noche es su altar.247 A l‟aide d‟une prose expressive (exclamations, anaphores, énumérations en asyndète, forte adjectivation), la narratrice tente de rendre le rythme trépidant et exaltant de cette Havane festive et insouciante, diparue à tout jamais. Dans ce roman, la capitale des années cinquante, 244 Lisandro Otero, « En ciudad semejante », Trilogía cubana, (1970), La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2001, p. 228, 229. 245 Graham Greene, « Introduction », in Notre agent à La Havane (1958), Paris, Editions 10/18, 2008, p. 11. 246 Le changement radical opéré dès 1959 et les transformations qui ont bouleversé la vie nocturne havanaise sont expliqués dans l‟œuvre de Ponte. Voir : Antonio José Ponte, La fiesta vigilada, Barcelone, Anagrama, 2007. 247 Zoé Valdés, Te di la vida entera, op. cit., p. 31-37. 97 représentée comme la ville de tous les excès, tranche vivement avec la ville décatie et morne de la période spéciale. Ce contraste est d‟autant plus saisissant que l‟âge d‟or de la ville correspond à la jeunesse de Cuca Martínez et la ville en ruines à sa sénilité. D‟ailleurs, ces emblèmes de l‟oisiveté et du divertissement (les cabarets, les grands hôtels) sont aujourd‟hui essentiellement réservés aux touristes et sont devenus les symboles de l‟exclusion. d- La Havane des touristes : des frontières à l’intérieur de la ville La Havane opulente, joyeuse et désinvolte, dans les récits contemporains, correspond surtout à la ville que connaissent les touristes puisqu‟une scission assez nette semble diviser le territoire en deux. Dans les romans, il y aurait d‟un côté la ville des Havanais et de l‟autre celle des étrangers ; deux géographies se côtoieraient sans véritablement cohabiter. La loi en vigueur jusqu‟en 2008 qui interdit aux Cubains de fréquenter les espaces réservés aux touristes, peut, en partie, expliquer cela, même si dans les faits les frontières ne sont pas si hermétiques et les relations et les échanges peuvent exister. Nous verrons d‟ailleurs que les deux espaces peuvent parfois même se superposer. Cela dit, la suppression de cette interdiction ne semble pas avoir rendu les frontières beaucoup plus poreuses entre les deux univers car à « l‟apartheid cubain » semble s‟être substituée une autre barrière : la discrimination sociale. Ce sont souvent les Cubains les plus riches qui ont les moyens de se rendre dans les hôtels, les cafés et les restaurants réservés aux touristes. Les frontières qui se sont érigées à l‟intérieur de la ville restent donc quasiment inchangées. Dans la littérature de fiction, ces lieux touristiques apparaissent souvent comme séparés du reste de la ville et représentent une ville de carte postale qui ne correspondrait en rien à la réalité. La Habana Vieja, appartenant au patrimoine mondial de l‟UNESCO depuis 1982 et, en partie, restaurée grâce à la gestion efficace de l‟historien Eusebio Leal Spengler, est le quartier touristique par excellence et constitue aujourd‟hui une oasis au milieu des ruines, comme l‟explique Antonio José Ponte, dans La fiesta vigilada (2007) : Inaugurar museos ha sido el modo óptimo hallado por la Oficina del Historiador de la Ciudad para revalorizar inmuebles sin correr el riesgo de habitarlos. Así se alcanza restauración y asepsia. (El territorio de La Habana Vieja cuenta con disposiciones especiales […]. Cierran la 248 peligrosa frontera con ese Haití que es Centro Habana). 248 Antonio José Ponte, La fiesta vigilada, op. cit., p. 179. 98 Cet espace aseptisé est un territoire indépendant, voire un pays étranger, comme le suggère la frontière qui séparerait ce quartier de Centro Habana, comparé ici à Haiti. Pedro Juan Gutiérrez insiste aussi sur ces deux géographies contrastées malgré leur contiguïté : « A medida que uno se aleja del corazón de La Habana Vieja, comprueba que la pobreza y el deterioro de los edificios es deprimente. Sólo dos cuadras más arriba del lujoso Hotel Raquel, las cosas cambian. Para peor »249. Cette Havane réhabilitée serait en quelque sorte un décor en carton-pâte qui ne ferait que cacher une réalité moins agréable qui correspondrait cependant à la « vraie » ville. Il convient d‟ajouter toutefois que La Habana Vieja restaurée n‟est pas l‟apanage des touristes puisque nombre de Havanais y vivent toujours et que les façades rénovées cachent des écoles, divers centres sociaux mais aussi des appartements délabrés qui abritent entre 60 000 et 65 000 barbacoas, ces mezzanines en bois qui permettent de subdiviser horizontalement les habitations. Ce quartier reste donc un espace populaire (hypertrophié démographiquement) où Cubains et touristes se croisent sans nécessairement se mélanger. Quoi qu‟il en soit, il n‟est pas représentatif du reste de la ville qui, lui, est complètement laissé à l‟abandon. Voici ce qu‟écrit Abilio Estévez, dans Inventario secreto de La Habana, pour bien signifier que La Havane Vieja rénovée n‟est qu‟un simulacre : ¿ No será acaso mucho más interesante que, en lugar de pasear por la reconstruida zona de La Habana Vieja, donde cada edificio es como la tramoya de una gigantesca y presuntuosa producción teatral, a la espera del público y de su aplauso, se pasee por los callejones de Buena Vista, donde la gente vive casi en la calle, y casi en la calle hace todo cuanto se debe hacer a puertas cerradas ? 250 Le lexique de la représentation et du spectacle (« tramoya », « producción teatral », « público », « aplauso ») fait de cette Havane un décor de théâtre, un véritable trompe-l‟œil qui donnent l‟illusion que la ville ne tombe pas en ruines. Sans répéter ce qui a déjà été dit au sujet des périphéries, soulignons simplement que par le biais de ses questions rhétoriques, le narrateur oppose une fois de plus les quartiers rénovés que visitent les touristes à la périphérie (Buena Vista). Julio Travieso rappelle lui aussi que les quartiers que visitent les touristes ne représentent pas la « vraie » ville : Muchos extranjeros presumen de conocer la ciudad porque han caminado por La Habana Vieja, vivido en Miramar y, quizás paseado por El Vedado. Se equivocan. Quien no conoce La Víbora no conoce La Habana. Los 249 250 Pedro Juan Gutiérrez, Corazón mestizo, Barcelone, Planeta, 2007, p. 161. Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 304, 305. 99 parlanchines turistas, sandalias de Cristo, shorts norteamericanos, gorras de boys-scouts, que deambulan por el centro de la ciudad no tienen, por suerte, la más mínima idea de la existencia de tal barrio.251 Non sans mépris vis-à-vis des visiteurs étrangers, l‟auteur explique que La Havane touristique du centre ne correspond en rien au reste de la ville. La vieille ville, Miramar et le Vedado ne sont pas représentatifs de la capitale mais sont plutôt des enclaves qui font exception. Le touriste qui se contenterait de visiter ces quartiers n‟aurait qu‟une vision déformée et incomplète de la réalité havanaise. Mais après tout, explique le narrateur, c‟est mieux pour eux car, même si leur vision est altérée, elle a le mérite de rester agréable, ou tout du moins acceptable. On retrouve également cette idée de « fausse » et de « vraie » ville dans Habanecer (1990), de Luis Manuel García, quand le personnage écrivain, qui essaye d‟écrire sur la ville, sort de chez lui pour trouver l‟inspiration : « Estuvo escribiendo durante muchas horas, pero antes salió a buscar la ciudad en la ciudad, con tanta premeditación que la ciudad le camufló su verdadero rostro, mostrando el que suelen llevarse como souvenir los turistas. El rostro en que él, habanero impenitente, no creía »252. La personnification de la ville met en lumière son aspect changeant et pluriel : La Havane a de multiples facettes. Ces quelques lignes montrent aussi à quel point la ville des touristes n‟est pas celle des Cubains et que deux espaces se disputent un même territoire. Ce quartier qui serait rénové pour les touristes, et qui n‟est pas « la ville », a cependant la particularité de faire cohabiter à la fois Cubains et touristes. Si, comme nous le verrons un peu plus loin, le quartier de Miramar fonctionne vraiment comme une oasis, le Vedado, en revanche, n‟est pas aussi hermétique, malgré la présence importante d‟hôtels de luxe. Le quartier n‟est pas isolé et les habitants peuvent se mêler aux étrangers. Mais, une fois de plus, la rencontre entre Cubains et touristes peut revêtir un caractère sordide et peut subdiviser encore un peu plus le territoire. En effet, le secteur des grands hôtels où logent les touristes les plus aisés fonctionne comme une enclave. Prostitution oblige, cette zone parfaitement délimitée constitue un espace que les jineteras appellent le « Triangle des Bermudes ». Amir Valle, dans son roman noir Entre el miedo y las sombras, en fait une description intéressante : [...] el llamado Triángulo de las Bermudas : la zona turística más cara de toda la ciudad. ¿ Cuando [Alex] supo que las jineteras la llamaban así ? No recuerda. [...] su difunta hija, Patty, le explicó que ya había nombres para 251 Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 275. Luis Manuel García, Habanecer (1990), Seville, Mono Azul, 2005, « páginas sin tiempo ». C‟est nous qui soulignons. 252 100 marcar ciertas partes de La Habana, según su utilidad dentro de los tentáculos de la prostitución y el mercado negro. [...] Sólo sabe que aquella zona, delimitada en un perfecto triángulo por el hotel Meliá Cohíba, el hotel Riviera y un lujoso supermercado, la vida nocturna era tan escandalosa que a él, en su casa de Centro Habana, le llegaban día a día historias donde las putas, la droga y la venta ilícita de ron, tabaco y música cubana, eran simples ingredientes, banales condimentos de un festín macabro lanzado hacia los turistas.253 Ce « Triangle des Bermudes », qui est la chasse gardée des prostituées et des trafiquants en tout genre, constitue un espace de débauche et contraste ici avec Centro Habana qui passerait presque pour un quartier beaucoup plus calme. Avec Amir Valle, nous ne voyons pas la Havane soignée et rénovée des cartes postales mais nous observons, au contraire, l‟envers du décor. La nuit havanaise, faite ici de prostitution, de drogues et de trafics, n‟a plus rien de festif car elle a perdu de sa légèreté et de son allégresse254. Il est d‟ailleurs intéressant de constater que les lieux qui symbolisaient la fête et la distraction dans les années quarante et cinquante sont devenus aujourd‟hui des espaces à part qui matérialisent encore un peu plus la discrimination entre les Cubains et les touristes. Si La Habana Vieja ou le Vedado ne présentent pas de frontières physiques, ce n‟est pas le cas de ces hauts lieux touristiques qui excluent et sont inaccessibles pour le Cubain moyen. Le Tropicana, par exemple, n‟est plus le cabaret des mafieux nord-américains ni de la riche bourgeoisie havanaise mais reste cependant une étape touristique incontournable Ŕ comme au temps de Tres tristes tigres Ŕ inaccessible pour une majorité de Cubains. Ainsi, dans le roman de Julio Travieso, le protagoniste est frustré de ne pas pouvoir emmener la prostituée Mónica, de laquelle il s‟est épris, là où ses clients étrangers peuvent l‟inviter : Yo no podía invitarla al Tropicana, ni siquiera a La Zorra y El Cuervo, donde, en ese momento, entraban algunos turistas. No podía decirle : tengo una habitación alquilada en el Saint John o vamos a un restaurante. Y ella sí tendría quien la invitara a cabarets, restaurantes, hoteles. 255 Le narrateur cite ici le nom du fameux cabaret, celui d‟un club de jazz et d‟un hôtel qui lui sont interdits et montre que deux géographies coïncident dans un même espace car une nouvelle cartographie de la ville s‟est dessinée à mesure que l‟Île s‟est ouverte au tourisme. 253 Amir Valle, Entre el miedo y las sombras, Grenade, Zoela, Negrura, 2003, p. 68, 69. Dans la nouvelle « Tirar la primera piedra », de Nancy Alonso, c‟est l‟hôtel Habana libre qui sert de repaire aux jineteras : « A medida que iba cayendo la noche, el ambiente se fue haciendo sórdido. Las insinuaciones daban paso a abiertas provocaciones, molestas para algunos turistas, aunque para otros la diversión recién comenzaba. », Marilyn Bobes, « Tirar la primera piedra », in Espacios en la Isla. 50 años del cuento femenino en Cuba, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2008, p. 83. 255 Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 24. 254 101 Deux mondes commencent alors à coexister, dans les années quatre-vingt-dix, comme le souligne Antonio José Ponte dans La fiesta vigilada : il y a La Havane des coupures d‟électricité, des pénuries, des transports en commun inexistants et celle des hôtels pour les touristes. Pour qualifier cette ville pleine de contradictions, où dans la nuit noire, les hôtels apparaissent comme des « peceras claras en la noche »256, Antonio José Ponte utilise la métaphore de la « caja negra de la fiesta »257. Cette fête à laquelle seuls les touristes sont conviés attire néanmoins les prostituées qui espèrent, elles aussi, profiter du festin d‟une manière ou d‟une autre : Cuando cayera la noche y no existiera luz eléctrica en sus casas, emprenderían alguna prostitución alrededor de los hoteles [...]. Porque estar dentro de un hotel constituía ya algo milagroso. Como el fluido eléctrico. Era entrar a otro mundo. Una cerveza, la comodidad de un sofá, el tránsito de gente bien trajeada y de aspecto saludable, justificaban la salida de casa.258 Le quotidien des touristes constitue un véritable miracle pour ces Cubains qui essayent de profiter, coûte que coûte, de ce luxe inaccessible. Le simple fait de pénétrer à l‟intérieur d‟un hôtel est une chance exceptionnelle car, comme nous l‟avons déjà dit, l‟entrée des lieux réservés aux touristes est interdite aux Cubains jusqu‟en 2008. L‟image de l‟aquarium, qui caractérise l‟hôtel, se justifie donc d‟autant plus qu‟elle marque l‟impénétrabilité de ce miroir aux alouettes à la fois fascinant et trompeur. La population cubaine est donc majoritairement dépossédée des lieux de divertissement faute de moyens et/ou d‟autorisation. Ces barrières infranchissables alimentent d‟ailleurs les conversations ordinaires où la nostalgie n‟est jamais loin : El chófer, un hombre de sesenta años más o menos, viene hablando animadamente con una pasajera, también de esa edad aproximadamente. Recuerdan los años de los sesenta, setenta y ochenta, cuando con poco dinero se podía ir a bailar y a divertirse en muchos cabarés y salones de baile de La Habana. Hasta 1990. Hablan de precios. El chófer dice : Ŕ Ahora, pa bailar con Los Van Van o con NG La Banda tienes que ir a La Macumba y vale 20 dólares o más la entrada. ¿ Quién puede ? ¿ Quién ? Una jinetera únicamente, con su yuma. Un pinguero. Para la gente normal, casita y televisión. [...] Hay que ser yuma para vivir en Cuba. El yuma sí vive bien y se divierte.259 256 Antonio José Ponte, La fiesta vigilada, op. cit., p. 72. Ibid., p. 69. 258 Ibid., p. 73. 259 Pedro Juan Gutiérrez, Corazón mestizo, op. cit., p. 243. 257 102 Ce sont uniquement les prostituées et les étrangers qui semblent pouvoir s‟amuser aujourd‟hui à Cuba. Les Cubains moyens quant à eux doivent se résigner aux occupations bon marché comme la télévision. La ségrégation est donc à la fois spatiale et sociale Ŕ mais comment pouvait-il en être autrement ? Ŕ puisque la distraction semble aussi pâtir des barrières érigées à l‟intérieur de la ville. Une nouvelle de Marilyn Bobes met parfaitement en scène cette opposition spatiale qu‟Henri Lefebvre qualifie de contradiction quand il affirme qu‟« en tant que médiation, la ville est aussi l‟endroit où se manifestent les contradictions de la société »260. Dans « Pregúntaselo a Dios », Iluminada Peña rencontre le Français Jacques Dupuis grâce à qui elle va découvrir une face cachée de La Havane, celle des touristes. Celuici l‟emmène dans un restaurant onéreux d‟où l‟on a une vue imprenable sur la ville : Jacques Dupuis la invitó a La Divina Pastora, un restaurante que ni en sueños Iluminada Peña hubiera podido visitar. Se sentaron a una mesa desde la que se divisaba un gran tramo de la ciudad. El improvisó un mapa sobre una servilleta y le indicó el lugar exacto donde se encontraban. Entonces Iluminada comprendió por qué veía ahora el Malecón como si estuviera en un barco : del mar hacia la tierra y no del muro hacia el mar. Era la primera vez que Iluminada contemplaba La Habana, al menos esa Habana de las tarjetas postales.261 Iluminada Peña découvre donc une nouvelle ville, une Havane factice et pourtant bien réelle qui se révèle à elle grâce à un changement de perspective. La ville semble bien différente quand on adopte le point de vue des touristes. La jeune femme fera une expérience similaire lorsqu‟elle ira à l‟Hôtel National, avec Jacques Dupuis, où ils passeront leur première nuit ensemble, avant de quitter La Havane et Cuba pour Toulouse. Ces lieux touristiques, totalement isolés du reste de la ville et qui ne sont plus tout à fait La Havane aux yeux de la protagoniste, fonctionnent ici comme des lieux de transition qui la poussent progressivement vers l‟étranger. A l‟intérieur de la ville les séparations spatiales s‟opèrent donc à plusieurs degrés. On constate des frontières à l‟échelle des quartiers et à l‟intérieur de ces quartiers, d‟autres barrières apparaissent (hôtels, restaurants, cafés). L‟hermétisme qui, dans une zone déterminée, scinde les lieux entre eux est particulièrement bien défini dans Variedades de Galiano puisque la narratrice protagoniste décrit ce qu‟elle voit autour d‟elle (de vieilles personnes en haillons qui font la queue dans le parc Fe) alors qu‟elle est installée dans un café où elle peut aller grâce à ses dollars. Même si elle est cubaine, ses billets lui permettent 260 Henri Lefebvre, Espace et politique. Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 1972, p. 74. Marilyn Bobes, « Pregúntaselo a Dios », in Mujer perjura, La Havane, Ediciones Unión, 2009, p. 24. C‟est nous qui soulignons. 261 103 d‟accéder à certains lieux et d‟observer la ville comme une touriste (c‟est d‟ailleurs ainsi qu‟elle se définit) ; c‟est pourquoi, il nous semble judicieux d‟analyser ici les descriptions qu‟elle fait. C‟est depuis ce bar faisant office tantôt de mirador, tantôt de refuge qu‟elle scrute la ville avec le regard distant de l‟étrangère : [...] los observo parapetada desde mi mesa enfrente, con la única y miserable diferencia de tomar Ŕ mientras los contemplo Ŕ un café en USD o un jugo Tropical Island. [...] Soy también como ellos, sólo que formo [...] el lado interior de una escala de locura que me hace atisbar, como a través de un vidrio (una vitrina, una pecera), a los sujetos que esperan [...]. No por eso dejo de estar también dentro del espectáculo. Sólo que la línea divisoria la ha creado un billete con próceres ajenos que, a veces, poseo. A veces, [...] los viejos desamparados y más locos del conjunto se aventuran a pegarse al cristal. [...] me siento otro animal encerrado en la jaula de vidrio del café, un centro de experimentación de alta tecnología. Cuando miro del otro lado de la pecera o vidrio o pantalla hacia fuera [...], descubro a un semejante, más avanzado en edad [...]. Si el vidrio se rompiera y el otro se me abalanzara para entrar, entonces, no habría equilibrio entre los muchos otros y yo.262 La frontière matérielle est ici la vitrine du café qui sert à isoler les deux mondes : celui de la narratrice, qui essaye d‟écrire en faisant abstraction de ce qui l‟entoure, et celui des pauvres gens qu‟elle ne parvient cependant pas à ignorer. Elle insiste amplement sur cette séparation physique grâce aux métaphores qui marquent l‟enfermement (« una vitrina », « una pecera »263, « la jaula de vidrio ») car, pour elle, cette « delgada pared artificial »264 la protège de la réalité extérieure devenue insupportable. En effet, ce qui lui sert aussi d‟écran (« pantalla ») lui permet de tout voir comme s‟il s‟agissait d‟un spectacle irréel. Le personnage ne peut vivre qu‟avec cette mise à distance qui la coupe du monde extérieur. Ne dit-elle pas, un peu plus loin, qu‟elle est une touriste indifférente comme pour renforcer son isolement265 ? Mais que les personnages soient à l‟intérieur ou à l‟extérieur de l‟« aquarium », la frontière physique les transforme tous en animaux car, derrière sa vitre, la spectactrice devient aussi actrice (« me siento otro animal encerrado »). Par ailleurs, cette séparation qui isole la protagoniste du monde semble d‟autant plus absurde qu‟elle est fragile et pourrait se rompre à tout moment, brisant par là-même le précaire équilibre qu‟elle est parvenue à construire. L‟ironie du sort voudra qu‟elle soit à son tour victime d‟une de ces frontières matérielles puisqu‟elle sera chassée d‟un hôtel exclusivement réservé aux touristes : 262 Reina María Rodríguez, Variedades de Galiano, op. cit., p. 11, 12. C‟est nous qui soulignons. Notons qu‟elle utilise elle aussi la métaphore de l‟aquarium, comme Antonio José Ponte, pour caractériser cet endroit clos. 264 Reina María Rodríguez, Variedades de Galiano, op. cit., p. 13. 265 Ibid., p. 67. 263 104 A la entrada del hotel donde pretendo orinar me detiene el portero : Ŕ ¿ A qué viene señora ? Ŕ ¿ Por qué tendría que explicarle a qué vengo ? Ŕ No puede entrar señora, insiste el joven portero. Ŕ ¡ Cómo que no puedo entrar ! ¿ Por qué, por ser cubana ? ¡ Dígamelo !, quiero oírlo en su voz, ¿ es por ser cubana ? El apartheid entre el Info y el hotel Plaza ; entre el parque Fe y el portero de solapa almidonada.266 Les contradictions de la ville, pour reprendre la formule de Lebfevre, se manifestent avec violence et rappellent à la narratrice, qui ne peut pas entrer à l‟intérieur d‟un hôtel, que certaines barrières sont infranchissables et que cette fois-ci, c‟est elle qui se trouve de l‟autre côté. La littérature rend bien compte de ces frontières diverses qui se sont érigées avec l‟arrivée du tourisme et qui isolent des quartiers, certaines zones, des hôtels ou des cafés. L‟espace public est fractionné et non collectivisé puisqu‟il sépare au lieu de réunir. La contradiction de l‟espace urbain est ici d‟autant plus frappante que les symboles de La Havane touristique que nous venons d‟étudier n‟appartiennent plus aux Havanais et ne permettent donc plus une identification commune à tous. Mais s‟il est un lieu à part qui représente la ville paradoxalement, et auquel les Havanais continuent de s‟identifier, c‟est la mer. e- La mer : un lieu autre La mer, qui n‟est justement plus la ville, est cependant tellement bien intégrée au paysage urbain qu‟elle constitue un élément décrit de façon récurrente et plurielle dans les œuvres de notre corpus. Ce n‟est pas une allégorie de La Havane à proprement parler, comme le Malecón ou le Castillo del Morro, dans la mesure où sa seule description ne permet pas d‟identifier immédiatement la capitale cubaine mais on ne saurait concevoir La Havane sans la mer ; et ce, d‟autant plus qu‟elle est unique à en croire l‟un des personnages narrateurs de Sangra por la herida, Willie, qui explique : « el mar habanero, distinto y diferente a cualquier otro »267. Comme toute ville portuaire, l‟ancienne Villa de San Cristóbal de La Habana a grossi autour du port (établi dès 1509). Elle s‟est ensuite développée vers l‟intérieur puis vers l‟ouest avec 266 267 Ibid., p. 79, 80. Mirta Yáñez, Sangra por la herida, op. cit., p. 50. 105 l‟édification des quartiers du Vedado et de Miramar qui longent en partie la côte268. La construction du Malecón en 1902 permit d‟achever complètement l‟intégration de la mer dans la ville. Espaces urbain et maritime sont ainsi intimement liés, comme l‟atteste le grand nombre de descriptions littéraires qui mêlent les deux atmosphères. Ils sont même unis et indissociables car l‟un et l‟autre s‟influencent et se confondent : La Habana que se mira en el mar, que crece alrededor de la costa, ha conseguido más aún : sus muros son de agua [...]. Los ojos se detienen poco en el mar pese a que la ciudad crece en su orilla, pese a sus magníficos paseos marítimos. La Habana se alza en el aire, se refleja en el mar y los ojos parecen no ocuparse de esas ciudades paralelas de cielo y de agua. 269 Sous la plume d‟Antonio José Ponte, les deux villes (la vraie et celle qui se reflète dans la mer) ne font qu‟une. La ville reflétée, faite d‟eau, semble même pénétrer dans la ville faite de pierres puisqu‟elle en transforme les murs. Si pour les citadins, les extensions de La Havane dans l‟eau et dans l‟air n‟importent guère, elles sont fondamentales pour l‟observateur attentif qu‟est le narrateur-promeneur de Un seguidor de Montaigne mira La Habana (1985). Il déchiffre la ville et voit ce que les autres ne voient pas, comme la symbiose entre la mer et la cité. D‟autres écrivains préfèrent opposer les deux espaces soulignant ainsi les relations compliquées que la ville et l‟océan entretiennent. La mer se charge alors de valeurs ambiguës, voire contradictoires : Entre La Habana y el mar, sin embargo, existe una relación importante y complicada, con momentos terribles, siniestros, y otros momentos (los menos) de alguna felicidad. Más que en ningún otro sitio que yo conozca, el mar de La Habana tiene un poco de bien azaroso y un mucho de mal necesario. La Habana posee, por tanto, para mí, cierto aire de indefensión y de tristeza. De miedo. Una ciudad que mira al mar con tanta insistencia, con tanta inquietud, no sólo debe de sentirse indefensa, sino también triste y muy, muy acobardada. El mar, el maravilloso, el cálido mar de La Habana, el mar de refrescarse y de nadar [...] es asimismo el mar del miedo y también el de las lejanas promesas, o por decirlo de otro modo, el de la huida.270 La ville personnifiée (« tristeza », « miedo », « mira », « inquietud », « indefensa », etc.), tournée en permanence vers la mer, se trouve bien démunie face à l‟immensité de l‟océan 268 Opposant d‟ailleurs le quartier du Vedado à La Habana Vieja, Arturo Arango écrit : « La Habana Vieja se recoge, se encaracola, se oculta del mar. El Vedado se abre, se ofrece, se desnuda frente al azul », Arturo Arango, « La Habana elegante », in Segundas vidas, op. cit., p. 141. 269 Antonio José Ponte, Un seguidor de Montaigne mira La Habana. Las comidas profundas (1997), Madrid, Verbum, 2001, p. 40, 41. 270 Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op.cit., p. 18. 106 qu‟elle semble craindre. Cette eau qui rafraîchit aussi bien qu‟elle menace symbolise aussi le désir de liberté et devient l‟horizon de tous les possibles (« las lejanas promesas ») puisqu‟elle signifie la fuite quand la ville est alors synonyme d‟enfermement. Mais cette mer n‟est pas sans péril comme le rappelle l‟expression « un mucho de mal necesario » et c‟est d‟ailleurs cette ambivalence qui en fait son unicité. On l‟aura compris, dans ce passage, l‟écrivain évoque clairement la mer des balseros qui constitue la seule issue possible pour des milliers de Cubains. Cette mer représente aussi bien l‟espoir que la mort et c‟est dans cette dichotomie qu‟Estévez la définit271. Il poursuit d‟ailleurs ainsi son interprétation symbolique des deux espaces un peu plus loin dans le récit : Si un paseante habanero decide detener su camino en el Malecón y dar la espalda al mar para mirar ese lado frívolo de la ciudad, con los edificios de falsa elegancia de la década de los cincuenta [...], ¿ no estará mostrando su recelo al mar ?, ¿ o será tal vez que prefiere ocultar sus afanes, sus deseos ocultos ? Y aquel otro que antepone el mar a la ciudad, ¿ qué evoca, qué anhela, a qué se encomienda ?, ¿ qué nuevos caminos espera ? Una preciosa pregunta sería la siguiente : ¿ cuál de los dos posee más coraje ?, ¿ el que da la cara a la ciudad o el que parece despreciarla ?272 L‟auteur essaye d‟interpréter l‟attitude des passants qui contemplent tantôt la mer, tantôt la ville. L‟océan renvoie ici à des désirs cachés ou, au contraire, assumés selon qu‟on le regarde ou pas. Les termes « afanes », « deseos ocultos », « anhela » et « espera » prouvent, une fois de plus, que la mer nourrit les envies et les projets alors que la ville semble être l‟espace de la résignation. Là encore, Estévez fait sans aucun doute allusion aux rêves des balseros qui envisagent de prendre la mer en quête d‟un avenir meilleur. Même s‟il essaye de percer à jour ces passants-spectateurs, l‟auteur se garde bien de les juger, en témoigne la question finale qui reste sans réponse. Il ne sait pas, en effet, si celui qui accepte la réalité et regarde la ville a finalement plus de courage que celui qui rêve de partir en regardant la vaste étendue d‟eau. Quoi qu‟il en soit, les deux citations d‟Estévez révèlent que les deux espaces, chargés de significations, entrent en contradiction puis en rivalité. Cette concurrence revêt parfois une forme plus directe qui se traduit par une lutte impitoyable entre la terre et la mer car l‟océan représente une agression pour la ville déjà bien abîmée par 271 Jacobo Machover ne dit pas autre chose : « [El sol] Se infiltraba en en la piel como fuente de energía que permitìa mirar lo más lejos posible […] pensando, estúpidamente, […] que el muro del Malecñn jamás iba a ser infranqueable, […] que el mar no iba a ser transformado en cementerio anñnimo de tantos muchachos, de tantos niños, de tantos adultos y viejos, que cansados de mirar a lo lejos sentados sobre el muro del Malecón, iban a intentarlo todo, desafiando a los hombres y a los elementos, para alcanzar una playa demasiado cercana y demasiado lejana y fundirse para siempre en la multitud desconocida de los sobrevivientes, de los fugitivos », Jacobo Machover, El año próximo en... La Habana, Madrid, Ediciones Cocodrilo Verde, 2001, p. 40. 272 Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op.cit., p. 67. 107 son salpêtre et la violence de ses vagues. Les scènes de tempête et de mer démontée sont abondamment décrites en littérature, comme nous avons déjà pu le voir dans le roman Fotuto où les maisons du front de mer sont détruites par un violent cyclone qui dote la mer d‟un pouvoir quasi surnaturel. Après le passage de cette tempête extraordinaire, voici, par exemple, ce que disent les journaux, cités par le narrateur : « Todos los árboles en el suelo ; el mar tirando olas tentaculares, verticales, contra las casas del Malecón : la ciudad muerta, desmantelada en dos horas »273. La victoire de la mer sur la ville apparaît très clairement dans cette description antithétique qui oppose la vigueur de l‟eau à l‟anéantissement de la cité. Guillermo Cabrera Infante dépeint aussi une lutte acharnée entre les deux espaces mais qui est régulière et non plus extraordinaire : « [...] el Malecón : otra barrera de arrecifes, recibiendo el salitre siempre y rocío marino cuando hay viento y olas en los días en que el mar salta sobre la calle y pega en las casas buscando la costa que le arrebataron, creándola, haciéndose otra orilla [...] »274. Armée de ses vagues et de son salpêtre, la mer essaye de récupérer un peu du territoire qu‟on lui a volé en envahissant le Malecón. Dans cette guerre répétitive et cyclique qui oppose les éléments à la ville, la mer marque sa supériorité puisqu‟elle semble gagner la bataille : le Malecón devient un élément naturel (« otra barrera de arrecifes ») et la mer redessine la côte en empiétant sur l‟espace urbain. Nous constatons que la personnification et le lexique de la guerre sont une constante lorsqu‟il s‟agit d‟évoquer des scènes de mer démontée. Celles-ci sont d‟ailleurs décrites comme des batailles, en témoigne ce passage tiré d‟Inventario secreto de La Habana : Como todos los mares, también aquel de La Habana gemía y se enfurecía (o se enfurece) sin previo aviso, sólo que, a diferencia de otros, al mar de La Habana le parecía divertido romper en el Malecón con demasiada violencia. El mar se rehacía, recomenzaba cada día frente a la ciudad. Se hubiera dicho que le gustaba amenazarla. Que quería abatirla. No la arrasaba, claro, [...] porque sabía que si la arrasaba ahí hubiera terminado todo. Y lo bueno del mal (y valga la paradoja) está en la advertencia permanente de que todo será devastado, en el peligro y su sospecha, en la inquietud, la sospecha y la espera, el peligro que nunca se cumple del todo. La amenaza de la agresión.275 Des mots comme « gemía », « se enfurecía », « violencia », « abatirla », « amenazarla » soulignent le caractère belliqueux et menaçant de la mer qui attaque La Havane en permanence sans jamais la détruire complètement. La lutte prend ici des airs de jeu car la mer semble prendre un malin plaisir à menacer la ville. La cité est bien vulnérable face aux forces 273 Miguel de Marcos, Fotuto, op. cit., p. 318. Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit, p. 322. 275 Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 37. 274 108 de l‟océan mais elle triomphe toujours des charges les plus violentes. La ville n‟est, en effet, pas toujours la victime de la mer puisqu‟elle ignore parfois ses assauts non sans une certaine insolence. C‟est en tout cas ce que suggèrent ces quelques lignes tirées du roman Animal tropical, de Pedro Juan Gutiérrez : El mar encabritado. El último frente frío de este invierno lanzando viento y salitre sobre la ciudad. Las olas revientan contra el muro del Malecón, forman un espumaje blanco y empapan la calle y los edificios. Amanece. La ciudad se ilumina poco a poco. Casi todos duermen aún. Hay poco movimiento. El barrio casi desierto.276 La violence de l‟attaque, mise en lumière par les verbes « encabritarse », « lanzar » ou « reventar », marque, certes, une fois de plus la suprématie de la mer, accentuée, d‟ailleurs, par l‟endormissement de la cité. Mais cette fois, la ville, qui n‟offre aucune résistance, se moque des assauts maritimes puisqu‟ils ne parviennent pas à réveiller les Havanais. La population, lasse de ces intempéries, ne fait guère cas des vagues qui s‟abattent sur la ville, comme si elle savait d‟avance que la lutte de la mer était vaine. Grâce à son indifférence, La Havane semble gagner la bataille. Si l‟on pourrait encore citer bien d‟autres exemples témoignant de l‟hostilité de la mer à l‟égard de la ville, il convient néanmoins de nuancer ce portrait en évoquant les descriptions, tout aussi abondantes dans les récits, du calme et de la douceur marine. La mer n‟est pas toujours violente et destructrice et ne s‟inscrit pas constamment en opposition avec la ville. Les deux espaces cohabitent souvent en parfaite harmonie et les descriptions d‟une mer d‟huile miroitante sont pléthoriques dans les romans. Dès le XIXème siècle, les personnages sont sensibles à ce paysage marin paisible, comme nous le constatons dans cet extrait de Carmela, de Ramón Meza, où le narrateur décrit la vue que l‟on a depuis le toit de la maison de Carmela et doña Justa, située tout près de la mer, dans la rue San Lázaro : ¡ Ah !, pero en el verano nada más bello que aquel terrado, a la vez azotea y patio de la casa. Desde él se disfrutaba del siempre hermoso, nuevo y sublime espectáculo del mar ; aquel inmenso espacio ocupado por las olas de intenso color azul y que graciosas se rizaban acá y acullá, formando con la espuma vagos y caprichosos trazos semejantes a esparcidas plumas de cisne que se sumergiesen y volviesen a flotar en la inquieta superficie.277 276 277 Pedro Juan Gutiérrez, Animal tropical, op. cit., p. 75. Ramón Meza, Carmela, op. cit., p. 15. 109 Les nombreux adjectifs qui qualifient la mer (« hermoso », « nuevo », « sublime », « inmenso », « intenso », « graciosas ») en font un lieu unique et extraordinairement beau. L‟espace devient même un « sublime spectacle », qui tel un tableau vivant, connaît de légers mouvements continus. La poésie de ce passage est renforcée par la comparaison, quelque peu affectée et moderniste, entre l‟écume des vagues et les plumes d‟un cygne. La profondeur et la beauté des couleurs changeantes de l‟eau sont très souvent soulignées par les écrivains qui transforment alors l‟espace marin en tableau de maître. Comme lorsqu‟il s‟agissait de décrire le Malecón, métaphores et précisions chromatiques font de certains passages de véritables ekphraseis. En tâchant de ne pas anticiper sur notre troisième partie, qui analysera la transformation de l‟espace en paysage, nous pouvons évoquer trois exemples caractéristiques de descriptions stylisées. Le récit de l‟arrivée à La Havane par bateau des Campbell, dans Tres tristes tigres, met l‟accent sur les variations chromatiques de la mer : La Habana lucía bellísima desde el barco. El mar estaba en calma, de un azul claro, casi celeste a veces, mechado por una costura morada, ancha, que alguien explicó que era el Gulf Stream. Había unas olas pequeñitas, espumosas, que parecían gaviotas volando en un cielo invertido.278 Nous avons là la version de Mrs. Campbell qui compare les vagues ondoyantes à des mouettes qui voleraient. Cette comparaison, tout aussi artificielle que celle de Ramón Meza, est ironiquement lyrique puisque, dans ce passage, le narrateur se moque d‟un couple de touristes américains. Il s‟agit de marquer l‟émerveillement du personnage qui sera constant durant son séjour dans la capitale. C‟est sans sarcasme, en revanche, que Joan, le Catalan du roman Allegro de habaneras, parle de la mer comme d‟un véritable joyau : Es que este mar vuestro es una maravilla. Mira las iridiscencias de estas aguas. Qué belleza. Fíjate en los contrastes : estas olas que llegan a nosotros llenas de espuma son blancas y grises, las de más atrás verdosas, y las que están más lejos son azules. Unas son serenas y graves y otras más juguetonas y alegres. Lo que digo : una maravilla. Tenéis un tesoro.279 L‟Espagnol insiste sur les couleurs remarquables de l‟eau tantôt bleue, blanche, grise et verte puis sur les vagues changeantes qui semblent prendre vie, comme en témoignent les adjectifs qui personnifient la mer (« serenas », « graves », « juguetonas », « alegres »). Dans les deux exemples qui viennent d‟être cités, le regard neuf de l‟étranger permet de souligner encore davantage le caractère exceptionnel de l‟eau caribéenne. Venu de la ville provinciale 278 279 Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 196. Humberto Arenal, Allegro de habaneras, op. cit., p. 42. 110 d‟Holguín, Reinaldo Arenas découvre lui aussi la mer havanaise tel un étranger. Ce fut pour lui : « el descubrimiento y el goce más extraordinario ». Pour justifier le caractère unique et mystérieux de cette mer, il ajoutera tout de suite après : « Es un atardecer único el que se disfruta en Cuba cuando uno está cerca del mar, específicamente en La Habana, donde el sol cae como una bola inmensa sobre el mar mientras todo se va transformando en medio de un misterio único y breve [...] »280. Nous le voyons, décrire la mer est souvent l‟occasion pour certains auteurs d‟écrire des passages plus ou moins chargés de poésie qui constituent des pauses narratives. Nous reviendrons sur ces descriptions lyriques. Les représentations de l‟océan sont forcément plurielles. Ainsi, le réalisme sale n‟épargne pas la mer de la saleté urbaine qui contamine son rivage. Elle est gagnée par la « merde », comme se plaît à le répéter Pedro Juan Gutiérrez, et n‟est plus qu‟un répugnant mélange d‟eau « mezclada con petróleo y grasa de los barcos, y mierda y orina de la ciudad » ; et l‟auteur d‟ajouter : « Las aguas servidas van a parar al mar [...] »281. La mer polluée de La Havane ressemble plus à un cloaque qu‟à un océan limpide, mais c‟est déjà ce que décrivait Enrique Serpa, en 1938, dans Contrabando : « La atmósfera trascendía un olor de albañal, manso y repugnante. Sobre el agua flotaban espesas manchas de petróleo, irisadas en los bordes y ondulantes como cosas vivas. Semejaban moluscos gelatinosos, que avanzaban lentamente, a fuerza de contracciones »282. Les termes « albañal », « repugnante » et « gelatinosos » en font un liquide visqueux et fétide. Ce n‟est plus l‟écume blanche des vagues qui semble prendre vie ici mais les épaisses taches gluantes de pétrole. Enfin, chez Sarduy, la mer de La Havane est tout aussi repoussante et s‟apparente davantage à un marécage où l‟eau épaisse peine à se mouvoir : « Un oleaje anémico y lacustre, como provocado por un sacudimiento lejano, agitaba de tiempo en tiempo las espesas aguas, que espejeaban entonces con un reflejo de aluminio empeñado, gris de ceniza »283. Le gris s‟est substitué au bleu et donne à l‟eau un aspect métallique (« aluminio ») qui transforme l‟eau en une immense chape de plomb. La mer a perdu sa vitalité et sa force et semble être devenue un espace sans vie, ainsi que le suggère l‟expression finale « gris de ceniza ». 280 Reinaldo Arenas, Antes que anochezca (1992), Barcelone, Tusquets, 2006, p. 136. Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 282. 282 Enrique Serpa, Contrabando, op. cit., p. 11. 283 Severo Sarduy, Cocuyo, Barcelone, Tusquets, 1990, p. 189. 281 111 Tantôt agitée ou démontée, tantôt calme et majestueuse, tantôt répugnante et pleine d‟immondices, la mer est en définitive à l‟image de la ville : ambivalente. Elle donne à voir ce que son observateur veut bien y trouver. 4- L‟espace ou la création d‟un territoire a- Unir les lieux entre eux Pour reprendre la distinction qu‟établit Michel de Certeau entre lieux et espaces, nous pouvons dire que ces derniers sont marqués par le mouvement et le temps284. On pourrait dire, sans dénaturer la pensée du philosophe et historien, qu‟ils sont des lieux de passage et non de rassemblement. Pour les observer, il convient d‟effectuer une focalisation et de pénétrer à l‟intérieur de la ville. En effet, dans son étude intitulée « Marches dans la ville », Certeau montre bien qu‟il ne faut pas se contenter d‟une vision panoramique et zénithale de l‟espace urbain. Il faut au contraire que l‟« Œil solaire »285 du narrateur descende dans les rues, s‟y promène pour « pratiquer la ville ». C‟est effectivement la ville habitée et « pratiquée » qui est décrite dans les romans et ce sont les déplacements et les trajectoires qui transforment les lieux en espace. Deleuze et Guattari ne disent d‟ailleurs pas autre chose lorsqu‟ils écrivent : « La ville est le corrélat de la route. Elle n‟existe qu‟en fonction d‟une circulation, et de circuits ; elle est un point remarquable sur des circuits qui la créent et qu‟elle crée. […] c‟est un réseau […] »286. En reliant plusieurs points entre eux et en faisant déplacer les personnages à travers les rues de la ville, les auteurs font de l‟espace un parcours et rendent la ville vivante. On l‟a vu, Cecilia Valdés constitue un parfait exemple de ces cartographies littéraires puisque les nombreux déplacements de Leonardo Gamboa ou de Cecilia Valdés sont méticuleusement retranscrits et donneraient presque l‟impression que les deux personnages sont sans cesse en mouvement. Aucun détail ne semble devoir échapper au narrateur : Salió Leonardo a la calle [...] caminaba en dirección de Paula [...] le decidió a marchar la vuelta contraria, a fin de ganar lo más pronto posible la esquina de la calle de Santa Clara. [...] En poco más se puso en la calle de O‟Reilly y subió al alto terraplén o terrado del convento de Santa Catalina, lo atravesó de este a oeste y descendió a la calle del Aguacate por la escalera de tres o cuatro escalones mencionada al principio de esta historia.287 284 Nous renvoyons aux propos de Michel de Certeau cités au début de notre troisième chapitre. Expression employée par Michel de Certeau, L’invention du quotidien. Tome 1. Arts de faire, op. cit., p. 140. 286 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Les Editions de Minuit, 1980, p. 539. 287 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 313. 285 112 Outre les détails architecturaux, qui nous font même connaître le nombre exact de marches séparant le couvent de Santa Catalina de la rue Aguacate, le narrateur veille à énumérer les rues et places traversées par Leonardo pour relier les différents lieux entre eux et établir la configuration physique de la ville. Tous ces détails font que la ville littéraire se construit pas à pas ; elle prend forme et croît au fil des déplacements. Plus que jamais, ce sont les habitants qui donnent corps à l‟espace urbain. Au XXème siècle, avec la motorisation des transports, la ville s‟échafaude à une échelle bien plus grande : ce ne sont plus les rues mais les quartiers qui s‟unissent entre eux. Les trajets en voiture sont l‟occasion d‟avoir une vue panoramique de La Havane, comme en témoigne Tres tristes tigres qui décrit à l‟envi les déplacements des quatre personnages288. Grâce aux déplacements en voiture, la ville se déplie telle une carte et devient un espace horizontal. Citons, par exemple, la nouvelle « El Ford azul », de Lisandro Otero, qui, comme son titre le suggère, fait la part belle aux trajets faits au volant d‟une Ford bleue. Dans ce très bref récit, deux jeunes qui appartiennent au parti communiste, pendant une dictature que l‟on peut supposer être celle de Batista, transportent dans leur voiture des tracts politiques appelant à la grève. On suit leur parcours dans le Vedado jusqu‟à un contrôle de police qui obligera les deux personnages à se séparer : Pasaron del Ensanche a Carlos III. Cruzaron frente a la Quinta de los Molinos [...]. Cruzaron frente al castillo del Príncipe. [...] Habían bajado toda la calzada de Zapata y doblaron frente a Colón para tomar por la calle 12. En ese instante, con un chirriar de gomas, los interceptó la perseguidora. [...] El Ford descendió por la calle 12, seguido a corta distancia por la perseguidora. Se detuvieron en el semáforo de la calle 23. [...] La luz verde. La perseguidora avanzó primero. Antonio la siguió. Al doblar por 23 [Antonio] miró por el retrovisor.289 La description précise du trajet très risqué que font les deux personnages permet de suivre à la trace leur parcours et participe au suspens et à l‟atmosphère angoissante que l‟auteur parvient à créer en très peu de pages. C‟est avec le même souci du détail que Luis Manuel García, dans Habanecer, retranscrit les déambulations des divers personnages : […] gira en la calle Luz […]. De un timonazo sale a la Avenida del Puerto […]. Planea despacio, rodea la Lonja del Comercio […]. Acelera por Malecón hacia El Vedado, sin apenas mirar la acera, porque sabe que es 288 Nous reviendrons un peu plus loin sur cette œuvre car le traitement de l‟espace y est très singulier. Lisandro Otero, « El Ford azul », in Antonio Tello, Diez narradores cubanos, Barcelone, Editorial Bruguera, 1977, p. 180-183. 289 113 tierra de nadie. Sube por Galiano y rueda lento hasta Zanja, más por hábito que por la perspectividad del sector. Se adentra en el mermado barrio chino […]. Continúa Zanja derecho hasta la Facultad de Filología [...]. Bordea la escalinata universitaria, sale por L y 23, da varias vueltas desde G hasta el mar. [...] Al fin opta por irse tranquilo a casa. 290 Les « descriptions ambulatoires »291 ponctuent ce récit atypique, qui se déroule en une seule journée et qui décrit la ville à travers une focalisation multiple (la narration change en fonction des divers personnages). Qu‟il s‟agisse pour les personnages de trouver l‟inspiration, de retrouver la ville du passé en se promenant dans les rues de cette Havane d‟août 1987 (récits intitulés « Recuerdos del olvido ») ou bien encore d‟explorer la ville (récits intitulés « El día aciago de Jacinto Gutiérrez »), La Havane est souvent appréhendée du point du vue dynamique du déplacement. Dans l‟exemple cité, c‟est le trajet d‟une vieille personne au volant de sa voiture qui est retranscrit. Les rues et avenues traversées sont citées et les lieux sont exhaustivement évoqués comme s‟il était question pour le lecteur d‟accompagner le personnage dans son périple. Cette déambulation sans but précis se clôt là où elle avait commencé, chez le personnage, car le parcours constitue une fin en soi. Marcher sans objectif prédéfini, dans le seul but de se déplacer, est également une idée très présente dans le roman Paradiso, de Lezama Lima. José Cemí parcourt la ville à pied et déambule dans les rues de Centro Habana ou La Habana Vieja au gré de son humeur : « Nuestro paseante de la medianoche seguía un camino que se presentaba sin término, por lo menos sin meta obligada. Pasó frente a la salida de los cines, paseó por la avenida portuaria sin reconocer ni importarle nada de lo que había visto en noches anteriores »292. Cemí musarde dans la ville sans véritablement prêter attention à ce qu‟il voit car seule la promenade semble compter. Le narrateur parle même de « catarsis deambulatoria »293 quand il évoque les pérégrinations du personnage, ce qui montre bien l‟importance de la marche qui acquiert alors une fonction salvatrice, même s‟il ne s‟agit ici que d‟une sortie onirique. Cet extrait renvoie effectivement à une promenade nocturne que Cemí fait en rêve mais qui est extrêmement bien détaillée et ancrée dans l‟espace réel. Les rues traversées sont déterminées et le parcours effectué est cohérent puisqu‟il correspond à la topographie de la ville, comme l‟atteste le début de cette sortie fantasmée : Sería algo más de las tres de la madrugada cuando comenzó a descender por el Prado, rumbo a la Avenida de las Misiones […]. Al llegar a la calle 290 Luis Manuel García, Habanecer, op. cit., 3:32 pm, 4:03 pm, 4:15 pm. Terme de Robert Ricatte, cité par Philippe Hamon, Du descriptif, op. cit., p. 175. 292 José Lezama Lima, Paradiso, op. cit., p. 580. C‟est nous qui soulignons. 293 Ibid., p. 523. 291 114 Refugio, tal vez por la sugestión del nombre, sintió como si fuese transportado a una región de total entrega y confianza, como si esa región estuviese guardada por su madre. Eso lo hizo avanzar con entera seguridad. Cuando llegó a la calle Genios, no era ya tan sólo su madre la que lo acompañaba ; una divinidad propicia, un geniecillo parecía que guiaba su camino, iluminándolo con chispas, con una claridad que giraba como una rueda, como si lo estelar se hipostasiase en una claridad que lo precedía, dejando en sus contornos fría e inmovilizada a la noche. 294 Réalisme et fantastique se côtoient naturellement dans ce passage puisque la promenade de Cemí s‟inscrit dans la réalité mais elle acquiert très vite une autre dimension grâce à l‟intervention d‟un être surnaturel. Pour partir à la découverte de la ville et de ses zones interlopes (la zone du port), le personnage est accompagné de sa mère, tout d‟abord, puis d‟un génie protecteur qui le guide dans cette promenade quasi initiatique. L‟atmosphère change et la lumière devient vaporeuse, presque immatérielle, mais Cemí n‟en poursuit pas moins sa promenade à travers une Havane précisément évoquée. Onirique ou pas, ce parcours fait l‟objet d‟une description si précise que l‟on peur dire que la ville est cartographiée et devient un espace horizontal qui se déroule et prend forme sous les pas du personnage-explorateur. Car il s‟agit aussi bien évidemment de cela : explorer et découvrir la ville en s‟y promenant. b- La découverte d’un territoire Se déplacer à travers la ville, avec comme seul objectif la déambulation, permet aux personnages de s‟approprier l‟espace urbain. Comme le dit Michel de Certeau : « [l‟acte de marcher] est un procès d‟appropriation du système topographique par le piéton (de même que le locuteur s‟approprie et assume la langue) ; c‟est une réalisation spatiale du lieu (de même que l‟acte de parole est une réalisation sonore de la langue) »295. Le déplacement permet à la fois de s‟emparer de l‟espace mais aussi de le créer. Si les personnages fondent la ville grâce à leurs déambulations, la cité modèle aussi ces promeneurs. Ceci est manifeste dans le roman de Villaverde car Cecilia Valdés entretient des relations très étroites avec sa ville et son quartier. Très tôt la capitale exerce sur elle une fascination telle qu‟elle s‟échappe parfois de la maison familiale pour découvrir le monde extérieur : « [...] escapándose a veces por la ventana, aprovechándose otras del momento en que la enviaban a la taberna de la esquina inmediata, para andarse de calle en calle y de plaza en plaza »296. L‟espace urbain apparaît ici comme un territoire à explorer. Nous observerons que Reinaldo Arenas, dans sa version pastiche du 294 Ibid., p. 559. Michel de Certeau, L’invention du quotidien. Tome 1. Arts de faire, op. cit., p. 148. 296 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 89. 295 115 roman de Villaverde, La Loma del Ángel, insiste lui aussi sur le caractère curieux de la fillette qui parcourt inlassablement la ville297. Bien sûr, l‟origine sociale du personnage explique sa présence dans les rues de la capitale : Cecilia Valdés correspond effectivement au cliché de la femme mulâtresse ou noire qui se promène en ville avec désinvolture298. Partir à la découverte de La Havane permet aussi à la jeune femme de se construire, étant donné que la cité constitue un lieu d‟apprentissage, une véritable école de la vie : [...] las calles de la ciudad, las plazas, los establecimientos público [...] fueron su escuela, y en tales sitios, según es de presumir, su tierno corazón, formado acaso para dar abrigo a la virtudes [...] bebió a torrentes las aguas emponzoñadas del vicio, se nutrió desde temprano con las escenas de impudencia que ofrece diariamente un pueblo soez y desmoralizado.299 A l‟opposé des promenades en calèche des jeunes filles de bonne famille, les pérégrinations pédestres de Cecilia ne sont pas nécessairement agréables car elles lui montrent, sans doute trop tôt, les perversions et les bassesses humaines, comme le suggère la métaphore « bebió a torrentes las aguas emponzoñadas del vicio ». A mesure que la jeune fille découvre et s‟approprie le territoire urbain, celui-ci semble la façonner. Cette interdépendance très claire entre personnage et espace est d‟ailleurs l‟une des singularités de l‟œuvre de Villaverde 300, au point que le corps de la femme et celui de la ville ne font plus qu‟un. Emma Alvárez-Tabío Albo a très justement établi un parallèle entre les espaces (ville/campagne) et les deux figures féminines importantes du roman, Cecilia Valdés et sa rivale blanche et aristocratique Isabela Ilincheta : « […] Cecilia encarna también la ciudad y sus múltiples incitaciones, mientras que Isabel se asocia con la monotonía del campo »301. L‟image d‟une femme incarnant un paysage est renforcée, au début du roman, par une métaphore qui, par un effet de prolepse, annonce la disgrâce à venir de l‟héroïne : « […] hermosa flor arrojada en mitad de la plaza pública, para ser hollada del primer transeúnte […] »302. La jeune fille habite littéralement l‟espace public 297 « Tenía doce años y su pasión era caminar ; mejor dicho, chancletear ; perderse por las intrincadas calles de La Habana [...]. Ir y venir desde la Capitanía General hasta la puerta de Monserrate, entrar a plazas e iglesias atronando con su paso. [...] su pasión no era aún Leonardo, sino la calle », Reinaldo Arenas, La loma del Ángel, op. cit., p. 17. 298 La Comtesse Merlin s‟étonnait de cette présence : « Mais les négresses, oh ! pour celles-là, la rue est à elles. On les voit en grand nombre sur les devants des portes, le cigare à la bouche, à moitié vêtues, avec leurs épaules rondes et luisantes comme des boucliers de cuivre, se laissant conter fleurette […] », La Comtesse Merlin, La Havane, T. I, op. cit., p. 330. 299 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 75. 300 Dans son roman pastiche, Reinaldo Arenas souligne ainsi la relation particulière qui unit Cecilia à la ville : « Los demás tienen hermanos, padres, madres […]. Ella tiene las calles, los portales y la claridad del día », Reinaldo Arenas, La loma del Ángel, op. cit., p. 18. 301 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 59. 302 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 82. 116 avec insouciance mais elle est aussi à sa merci. Le narrateur suggère qu‟il provoquera sa perte. L‟identification entre le personnage et la cité est ainsi manifeste dans cette œuvre, à tel point qu‟Emma Álvarez-Tabío Albo parle de « femme-ville » pour caractériser Cecilia Valdés303. Découvrir la ville en la parcourant à pied, sans d‟autres objectifs que l‟exploration, est un phénomène récurrent dans les œuvres étudiées. Bien entendu, il s‟agit toujours de découvrir ce que les autres ne voient pas et de conquérir une Havane secrète. S‟aventurer dans les quartiers et les rues havanaises constitue une des occupations favorites du poète Julián del Casal, dont Arturo Arango imagine le quotidien, dans la nouvelle « La Habana elegante » : Antes, pocas distracciones le daban tanto placer como andar La Habana a tientas, sometiéndose al azar. Seguir un rumbo vago, doblar esquinas recomendadas por la intuición [...] y llegar a recovecos de la ciudad que jamás imaginó que existieran : un parque de intenciones japonesas oculto por espantosos edificios al por mayor, una casita art nouveau rodeada de palacetes coloniales, una quinta semiderruida que aún guardaba una imagen rural [...]. O caminar despacio, mirando lo que permanecía encima de todos, oculto por la rutina : hacer que en lugar de luz, fuera nieve lo que bañara los guardavecinos de un balcón hasta entonces no visto [...]. Vastedad de La Habana, ciudades protegidas dentro de la ciudad, mundos que conquistar por el módico precio de un paseo.304 Sans savoir qu‟il s‟agit là de sa dernière promenade dans La Havane305, Julian del Casal scrute la ville. En observateur averti, il découvre des « trésors urbains» (un parc japonais, une maison Art nouveau, une ferme dans la ville, etc.) qu‟il se plaît à transformer au gré de son imagination (« hacer que en lugar de luz, fuera nieve lo que bañara los guardavecinos de un balcón »). La Havane apparaît comme une immense ville gigogne qui garde jalousement ses merveilles. La seule condition pour les découvrir et les « conquérir »306 est de se promener, à l‟instar d‟un flâneur baudelairien qui ne retiendrait de son périple que l‟insolite beauté urbaine. Habanecer, œuvre précédemment évoquée, fait aussi la part belle à ces promenadesdécouvertes car, comme nous l‟avons dit, nombre de personnages flânent dans les rues. Ainsi, le personnage écrivain des récits intitulés « páginas sin tiempo », en quête d‟inspiration pour son livre sur La Havane, parcourt la ville dans le but d‟en découvrir ses facettes les plus secrètes : 303 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 39. Arturo Arango, Segundas vidas, « La Habana elegante », op. cit., p. 137, 138. 305 Arturo Arango imagine, dans cette nouvelle, la dernière journée du poète. 306 Terme employé par le narrateur dont nous reparlerons incessamment. 304 117 Escaló cerros en Nuevo Vedado y Santos Suárez, descendió desde Puentes Grandes a Miramar, vio perderse en una curva amurallada de edificios al maltratado Almendares [...]. Conminó a los vitrales y cornisas, a los almendros, escaleras, puntales, estatuas y balcones. Exigía confidencias y por eso la ciudad le ofreció señas engañosas: en Marianao Ŕ sugirió una balaustrada del Cerro Ŕ, en Guanabacoa quizás Ŕ un guardavecinos de La Habana Vieja Ŕ. Llegó decepcionado al Castillo de La Fuerza [...]. Caminó desalentado calle arriba, persiguió, a 346 años de distancia, los pasos de Fray Jerónimo de Lara. [...] Fue entonces cuando empezó a descubrir lo que antes había exigido : los ritmos ocultos de la ciudad, las oficinas y fábricas y bares, su respiración entrecortada, inhalando, expeliendo hombres y mujeres de un lado a otro. Descubrió los horarios de la ciudad, desde los albañiles, las putas y los músicos que van y vienen [...] ; borrachos y amantes de largas noches descubrió. El latido subterráneo de acueductos y alcantarillados. La impertinencia de los despertadores. El asma de las planchas al vapor en las lavanderías. El reumático trastabillar de los autos de alquiler.307 Il s‟agit là d‟une véritable exploration, comme le suggèrent les nombreux verbes d‟action et les énumérations précises des éléments qui composent ce territoire qui reste à déchiffrer. C‟est l‟image d‟une ville secrète que seul un initié peut découvrir qui transparaît dans ces lignes. C‟est pourquoi le narrateur s‟efforce d‟établir un dialogue avec la cité (« exigía confidencias ») mais elle ne se dévoile pas si facilement et trouver ce qui semble être son essence n‟est pas chose aisée car ce dédale urbain est aussi bigarré que trompeur. Par ailleurs, il importe d‟observer que la ville prend vie quand on la découvre ; c‟est ce que démontre la personnification de tout ce que le personnage voit sur son chemin (« los ritmos », « su respiración », « inhalando », « el látido », « el asma », « reumático »). On remarquera aussi que le moment de la découverte est mis en lumière par la formule « Fue entonces cuando », qui marque une rupture dans la narration et suggère que tout ce qu‟il verra par la suite sera une révélation. Cette idée de ville qui se révèlerait à l‟observateur attentif est poussée à son comble quand le personnage de Jacinto Gutiérrez, en véritable explorateur urbain, découvre sa ville comme s‟il s‟agissait d‟une terre étrangère : [...] se internó en calles sin pasado, donde habitaban seres tan ajenos para él como los esquimales o los zulúes. Descubrió que a ambos lados de la ruta 2341-116-51-Plaza de Marianao el planeta se extiende de una manera empecinada, que está densamente poblado de niños, automóviles, pelotas, tendederas, rosales, baños públicos y tatuados, perros públicos y privados, bodegas, plantas ornamentales, jubilados, fábricas, muchachas, ascensores, gatos, algo de césped, muchos no pise el césped, gorriones, árboles, colillas, faroles, azoteas, papeles, semáforos, anuncios, puestos de fiambre, estiércol, funerarias y cartas de amor. Se sintió Livingstonemarcopolomagallanescolón en los umbrales de un universo sin memoria. Fue anotando los nuevos descubrimientos en los anales de la sorpresa, implacable bitácora, y como cualquier explorador, se dio a nombrar las cosas : El Parque de las 307 Luis Manuel García, Habanecer, op. cit., « páginas sin tiempo ». 118 Despedidas, la Esquina de la Novia Ausente, El Bosque de los Acompañados.308 Ce nouvel explorateur découvre sa propre ville avec le regard de l‟étranger qui rencontrerait pour la première fois les autochtones d‟un pays inconnu. Il compare ainsi les habitants de ce quartier à des peuples exotiques pour lui (« esquimales », « zulúes »). Dans une énumération exhaustive, qui tient délibérément du catalogue, il répertorie tout à l‟image des anciens explorateurs qui consignaient leurs découvertes. Les plus grands noms sont d‟ailleurs convoqués (Livingstone, Marco Polo, Magellan, Colomb) dans un néologisme qui fait du voyage urbain de Jacinto Gutiérrez la quintessence de l‟exploration. A la fin de cet extrait, le personnage ne devient-il d‟ailleurs pas un démiurge, à l‟instar de ces explorateurs, en (re)nommant les lieux découverts ? Comme on l‟observe dans ce dernier exemple, les déplacements permettent aussi de découvrir des quartiers excentrés ou des zones moins connues, et parfois interlopes. Ici, Jacinto Gutiérrez, explore Marianao ; le personnage de Mario Conde dans les romans de Padura Fuentes, on l‟a vu, parcourt parfois d‟autres quartiers que Miramar et El Vedado puisque ses enquêtes l‟obligent à pénétrer dans El Cerro ou La Vìbora, par exemple. Le personnage du Général dans De donde son los cantantes (partie intitulée « Junto al río de Cenizas de Rosa »), de Severo Sarduy, découvre le quartier chinois, son théâtre Shanghai et ses maisons closes. Enfin, le quartier du port, longtemps malfamé, est aussi décrit lors des pérégrinations des personnages. On se souviendra de Menegildo, dans Écue-Yamba-Ó (1933), de Carpentier, qui se promène dans cette partie de la ville où marins, prostituées et mendiants se croisent309 ou de José Cemí, dans Paradiso, qui s‟aventure dans cette « zona peligrosa de los cafés portuarios »310. Dans ce dernier cas, précédemment évoqué, la promenade nocturne que Cemí fait en rêve est synonyme d‟expérience personnelle et de découverte d‟un quartier mais aussi d‟un univers car il pénètre dans les bars du port et y voit les marins. On l‟a vu, même si cette découverte est onirique, elle reste ancrée dans une réalité très précise car le parcours de Cemí et les lieux qui jalonnent son itinéraire sont répertoriés avec exactitude. 308 Ibid., 8:35 am, 8:36 am. « Siguieron los muelles [...]. Algunos marinos noruegos salían de una bodega [...]. Varias prostitutas, ajadas, miserables, llamaban a los transeúntes desde las puertas entornadas de sus accesorios de catre y palangana. [...] Y por todas partes, en bancos, bajo soportales, en la sombra de los quicios, grupos de hombres sin trabajo se refugiaban en el embrutecimiento de una miseria contemplativa que encontraba ya esfuerzo estéril en el gesto de implorar limosnas », Alejo Carpentier, Écue-Yamba-Ó (1933), Madrid, Alianza editorial, 2007, p. 149. 310 José Lezama Lima, Paradiso, op. cit., p. 560. 309 119 Les personnages qui explorent leur propre ville ou la redécouvrent d‟un œil nouveau sont légion et nous pourrions citer bien d‟autres exemples311. Leur point commun est qu‟ils ont tous le statut « d‟intrus » puisqu‟ils s‟introduisent dans un milieu qui n‟est pas le leur et découvrent une partie de la ville qui devient une terre inconnue. C‟est d‟ailleurs ce regard neuf posé sur la capitale qui motive la description spatiale. Bien évidemment, cela se justifie encore davantage quand le personnage « focalisateur »312 est réellement étranger et découvre La Havane pour la première fois. Explorateurs de la capitale cubaine, les émigrés, voyageurs ou touristes le sont à plus forte raison. Les rues de la ville sont un espace totalement inconnu qu‟il faut cependant apprendre à maîtriser. Cette idée est un leitmotiv dans les romans qui retracent l‟arrivée à la capitale d‟Espagnols, de guajiros 313 en quête de richesse ou de visiteurs étrangers à la recherche de dépaysement. Ainsi, dans La vida real, de Miguel Barnet, Julián Mesa, jeune Cubain d‟origine paysanne, décide de quitter son village pour tenter sa chance à La Havane avant de partir vivre aux Etats-Unis. Il parcourt la ville prérévolutionnaire le plus souvent à pied pour mieux la connaître : [...] con veinte mil tropiezos me aprendí en tres meses las calles de La Habana al dedillo. Con una clienta de la dueña, Mirita Bayo, directora de un plantel en la calle Almendares, tomé mis primeras clases. La letra también me entró por los pies, porque las caminatas mías todas las noches para llegar al plantel eran de treinta cuadras.314 On voit bien que la formation du jeune homme, analphabète à son arrivée à La Havane, va de pair avec la découverte et la maîtrise du territoire. Le personnage-narrateur ajoutera d‟ailleurs un peu plus loin : « [...] recorrí por unos cuantos meses todas las calles de La Habana. Si hay una calle de La Habana que yo no conozca, me dejo cortar una mano »315. S‟orienter dans la ville est une manière de la dominer et de contrôler sa propre existence puisque, dans ce cas précis, les multiples déambulations du personnage sont souvent motivées par son travail : il parcourt toute la ville pour livrer des chapeaux. 311 On pense aussi au personnage d‟Enrique qui retourne à La Havane après plusieurs années passées en Europe et qui, accompagné de Vera, retrouve sa ville : « Y fue mi deslumbramiento ante una ciudad re-descubierta, vista con ojos nuevos, con mirada capaz, ahora, de establecer nuevas escalas de valores [...], paseaba pues por mis calles [...]. Me detenía, atónito, ante un viejo palacio colonial que me hablaba por todas sus piedras, ante la gracia de una cristalería polícroma [...], ante la salerosa inventiva de una reja un tanto andaluza [...] », Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, op. cit., p. 326, 327. 312 Nous reprenons la formule de Philippe Hamon. Voir : Philippe Hamon, Du descriptif, op. cit., p. 175. 313 Paysans cubains. 314 Miguel Barnet, La vida real, Madrid, Alfaguara, 1986, p. 95. 315 Ibid., p. 162. 120 Partir à la découverte de la ville place le personnage-promeneur dans une position d‟infériorité car il semble être à la merci de l‟espace urbain. Mais l‟on constate qu‟une fois la cité maîtrisée, les déambulations peuvent, au contraire, signifier la supériorité du flâneur. c- Un territoire conquis Une fois le territoire exploré, il peut alors être conquis. Déambuler dans la ville devient le moyen de montrer que l‟on maîtrise le territoire et que celui-ci nous appartient. La Vieille Havane de la deuxième partie du roman Mi tío el empleado, de Ramón Meza, est le territoire exploré puis conquis du conde Coveo, qui s‟est empressé d‟oublier que, six ans auparavant, il se trouvait en bas de l‟échelle sociale. En effet, le jeune Espagnol, Vicente Cuevas, qui découvrait, émerveillé, la capitale cubaine à son arrivée n‟est plus et a laissé place au parvenu conde Coveo. Si dans la première partie du roman, les promenades dans la vieille ville, sans complètement l‟intimider, le frappent d‟étonnement et d‟admiration316, quelques années plus tard, elles seront le signe de sa fortune : « [...] tomaba por la calle del Obispo, O‟Reilly, los parques, el Prado, San Rafael, Reina, es decir, por las calles frecuentadas por los más lujosos trenes y por consiguiente las familias acomodadas de La Habana »317. Les rues qu‟il emprunte témoignent de sa réussite sociale qui se verra parachevée quand il se mariera avec Clotilde. Les promenades du couple seront alors, elles aussi, l‟occasion de manifester leur aisance : « [...] salían ambos esposos en la cómoda carretela blasonada a recorrer las tiendas, las casas de las modistas, las quincallerías y platerías ; comprando y encargando en todas partes lo más caro y lo mejor [...]. Después iban al teatro, a Tacón, a la ópera »318. La fastueuse maison de Coveo révèle sa supériorité319 tout comme la ville atteste son pouvoir : il parcourt les mêmes rues qu‟à son arrivée mais avec l‟assurance et la morgue de celui qui a réussi à se hisser en haut de l‟échelle sociale320. Tout comme le faisait l‟aristocratie de l‟époque, ce n‟est plus à pied mais en calèche qu‟il parcourt la ville. Notons au passage que dans les romans du XIXème siècle, les promenades en calèche le long du Paseo del Prado ou du Paseo de la 316 On se souviendra, par exemple, de la description d‟une rue commerçante où les boutiques luxueuses se suivent les unes après les autres, offrant aux badauds le spectacle de leurs vitrines. Voir : Ramón Meza, Mi tío el empleado, op. cit., p. 31. 317 Ibid., p. 213. 318 Ibid., p. 286, 287. 319 « Desde que se trasponía el umbral, comprendíase que el dueño de ella disfrutaba de holgadísima posición social y de no escasos recursos pecuniarios », ibid., p. 182. 320 Dans la deuxième partie du roman, il entre, par exemple, dans l‟orfèvrerie dont la vitrine l‟avait fasciné six ans auparavant. Les deux descriptions de cette même boutique se font écho pour mieux marquer la réussite du conde Coveo, ibid., p. 31 et p. 168. 121 Alameda, réservées à une élite qui profitait de ces moments pour parader, constituent une pratique discriminante de l‟espace urbain qui ne fait que confirmer la supériorité de ces promeneurs. La critique littéraire Mirta Suquet explique très bien cette volonté de la part de la bourgeoisie havanaise de se distinguer des autres catégories sociales et parle même d‟ « exhibitionnisme social » pour qualifier ces promenades : « El Paseo canalizará, además, la necesidad de exhibicionismo social de la burguesía habanera, su obsesión por mostrarse como casta refinada y suficiente y, por tanto, su interés por diferenciarse de las modas y conductas del comerciante o empleado peninsular […] »321. Dans un genre complètement différent, les œuvres de Guillermo Cabrera Infante témoignent aussi de cette volonté, de la part des personnages, de maîtriser et de conquérir la ville. Il s‟agit, dans un premier temps, de conquérir un territoire en multipliant les conquêtes amoureuses. Car, comme nous avons déjà eu l‟occasion de le voir, La Havane de La Habana para un infante difunto est le théâtre de l‟« éducation sentimentale » du protagoniste. Ses nombreuses promenades érotiques sont l‟occasion de maîtriser l‟espace dans la mesure où c‟est toujours le personnage qui prend l‟initiative de ces déambulations, en choisit l‟itinéraire et le point final. Ce cicérone séducteur emmène ses conquêtes à l‟hôtel, dans des bars, les raccompagne chez elles, va d‟une maison à l‟autre, rencontre d‟autres femmes au fil de ses promenades, construisant ainsi son propre territoire : « […] tuve que ir de mi casa en la frontera habanera al Vedado, donde vivía Olga Andreu, [...] y volver a La Habana Vieja, donde vivía Julieta. [...] hacer todos esos viajes casi era la vuelta a mi mundo en medio día […] »322. La ville parcourue est sienne (« mi mundo ») à l‟instar de toutes ces femmes qu‟il séduit. Dans ce roman, mais aussi dans Tres tristes tigres323, le narrateur associe inlassablement ville et amantes, comme l‟atteste la description de la conquête de Dulce dans le Vedado : « [...] comenzamos a caminar Paseo arriba [...]. Este paseo, esta calle, como la avenida gemela de los Presidentes, es bastante oscura [...]. Un poco más arriba de la calle 17 me incliné [...] y la besé. Se dejó besar [...]. Antes de llegar a la calle 23 le di vueltas y la besé fuerte [...] »324. Les différentes étapes de la séduction entretiennent un rapport étroit avec la topographie urbaine comme si les deux allaient de pair ou comme si le corps de la ville et le corps de la femme ne faisaient plus qu‟un. La passivité de Dulce (« se dejó besar ») marque la 321 Mirta Suquet, « Espacio citadino y problemáticas de género en el siglo XIX cubano », in La Siempreviva, La Havane, Instituto Cubano del Libro, Editorial José Martí, n°8, 2009, p. 42. 322 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 266. 323 Voici le récit d‟une conquête d‟Arsenio Cué : « […] cuando estábamos otra vez en El Vedado y ya habìamos cruzado por cuarta o quinta vez el túnel, empezamos a besarnos y eso y se dejó llevar a Once y Veinticuatro [...] caminando y subiendo Vedado arriba [...] llegamos a Dos y Treintiuno », Id., Tres tristes tigres, op. cit., p. 177, 178. 324 Id., La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 320, 321. 122 supériorité du personnage narrateur qui domine à la fois sa maîtresse et la ville, dont il a une parfaite connaissance. Comme nous l‟avons souligné, il semble décider de tout : aussi bien des rues qui seront empruntées que des fins à atteindre. Il conduira ainsi progressivement Dulce jusqu‟à un hôtel de passe : Ella [Dulce] quería conocer la exacta topografía de los alrededores [...]. Reanudamos el paseo por Paseo, [...] la interné en el terreno escabroso que conducía a la calle 31. Yo podía haberla llevado por la calle Zapata [...] hasta la calle 2 y por allí bajar hasta 31, pero vi un bar abierto en la esquina [...] y decidí tomar el camino más difícil, desde el punto de vista físico, pero a la vez más fácil, desde el punto de vista social. [...] Dulce seguía dejándose llevar por mí, [...] sin saberlo Dulce estaba en medio de la selva habanera […]. Et le narrateur de préciser ensuite : « nos acercábamos fatalmente al edificio erótico de la posada […] »325. Cette promenade, dont l‟itinéraire semble écrit d‟avance, ne peut que s‟achever à l‟hôtel puisque le protagoniste n‟en a pas décidé autrement. Il semble suivre un plan machiavélique pour arriver à ses fins, c‟est tout du moins ce que suggère la métaphore du chemin plus ou moins difficile à parcourir, et Dulce, telle une proie naïve, le suit docilement (« sin saberlo Dulce estaba en medio de la selva habanera »). Séduire les femmes tout en dominant la ville est aussi une manière de féminiser l‟espace car La Havane devient un corps de plus à conquérir326. Dans Tres tristes tigres, la conquête de La Havane se traduit par les déplacements en voiture incessants et rapides des quatre personnages qui tendent à fragmenter la ville plus qu‟à l‟unifier. Ainsi, les lieux observés, les rues et avenues empruntées sont cités mais ne semblent pas connectés les uns aux autres car la vitesse du déplacement en auto ne permet plus de relier les points entre eux : [...] el Malecón, en el carro de Cué que se desliza como un travelling del castillito de La Chorrera a los frontones del Vedado Ténis, el continuo Malecón ahora y siempre a la izquierda, hasta que demos la vuelta [...], y a la derecha el hotel Riviera [...] y la gasolinera frente a la rotonda [...], y al fondo el mar siempre y por sobre todo, el cielo embellecedor que es otro domo veteado [...].327 325 Ibid., p. 322, 323. Nous retrouvons cette idée de ville-corps à conquérir (sans féminisation de l‟espace urbain) chez Abilio Estévez : « En la búsqueda de esos cuerpos que sñlo son cuerpos […] comienzas a descubrir la ciudad. Cuerpos que, como no son más que eso, cuerpos, se integran de modo perfecto al cuerpo de la ciudad », Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 311. 327 Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 319. 326 123 La ville semble être, une fois de plus, un décor de film (la mer et le ciel paraissent irréels comme le sous-entend l‟adjectif « veteado ») et ne correspond plus qu‟à quelques points isolés (el Castillo de La Chorrera, el Vedado Ténis, l‟hôtel Riviera, une station service et un rond-point) qui sont autant d‟images furtives que le passager-spectateur glane ça et là. Les déplacements en voiture marquent la supériorité des quatre amis sur la ville car, dans leur bolide, ils dominent l‟espace et le temps, en témoigne cette formule : « La velocidad transforma el tiempo en espacio »328. En outre, ces voyages répétitifs, qui importent plus que la ville elle-même, constituent eux aussi une fin en soi : « Cué tenía esa obsesión del tiempo. Quiero decir que buscaba el tiempo en el espacio y no otra cosa que una búsqueda eran nuestros viajes continuos, interminables [...] »329. Le déplacement, considéré comme un moyen de maîtriser l‟espace-temps, est une quête sans doute illusoire qu‟Emma ÁlvarezTabío Albo interprète aussi comme une façon de conquérir la ville tout en la niant : Cabrera Infante no puede disimular una actitud hacia la ciudad que traiciona su voluntad de, más que vivirla, conquistarla, y en cierta forma, doblegarla. La imagen de los personajes de Cabrera Infante recorriendo las calles de la ciudad, desafiantes, a bordo de veloces autos deportivos es recurrente. Todos ellos, en el fondo, pretenden devolverle sus desdenes ignorándola [...].330 Ces affirmations, que nous faisons nôtres, montrent que la ville est non seulement conquise mais assujettie aux mouvements incessants des personnages. Si le déplacement semble faire exister l‟espace urbain, il est évident que, de manière paradoxale, il le dissout et l‟anéantit simultanément. La ville, réduite aux déambulations rapides des personnages, n‟existe plus ou, tout du moins, elle devient floue et insaisissable. Ce phénomène est clairement décrit dans la trilogie de Lisandro Otero, où Luis Dascal parcourt aussi La Havane en voiture à plusieurs reprises : « Veloz por la Quinta Avenida ; las fachadas inmutables de las residencias que custodian la tradición son borrosas imágenes en la ventanilla »331. L‟espace urbain, qui n‟est plus qu‟une suite d‟images imprécises, ne sert alors que le déplacement des personnages et devient une « scène passive »332, une simple référence topographique diffuse et évanescente. Les déplacements, selon qu‟ils se font à pied ou en voiture, acquièrent des valeurs et des fonctions différentes. Ils transforment la ville en espace et l‟espace en temps. L‟univers urbain envisagé comme le lieu de l‟expérience personnelle, commence déjà à poindre car, on l‟a vu, 328 Ibid., p. 352. Ibid., p. 322. 330 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 343. C‟est nous qui soulignons. 331 Lisandro Otero, Trilogía cubana, « La situación » (1963), op. cit., p. 164. 332 Nous reprenons la formule d‟Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 345. 329 124 ces déambulations sont l‟occasion pour les personnages d‟exprimer leur rapport à la ville : soumission s‟il s‟agit de découvrir un territoire inconnu ou domination si, au contraire, l‟espace est conquis. Ce troisième chapitre, qui s‟appuie sur la distinction entre les lieux et les espaces, aura permis de distinguer différents traitements spatiaux en littérature. Pour passer de la focalisation (portrait des microcosmes) à la création d‟un vaste territoire urbain plus panoramique et plus global, le narrateur ajuste son point de vue et construit une ville littéraire envisagée à des échelles différentes. Nous constatons qu‟il en va de même lorsqu‟il s‟agit d‟évoquer le cadre historique dans lequel s‟inscrivent les fictions. A l‟image du traitement spatial, le temps historique connaît lui aussi une focalisation plus ou moins grande. Chapitre 4 : L’espace-temps 1- Le théâtre de l‟Histoire a- Des fresques historiques On le sait, il est difficile, voire impossible, d‟étudier l‟espace sans évoquer le temps narré dans les œuvres littéraires. Le contexte historique a une influence manifeste sur les représentations de la ville et nous ne saurions étudier celles-ci sans évoquer le « chronotope », pour reprendre le terme employé par Bakhtine, dans Esthétique et théorie du roman (1978). Pour le théoricien russe, temps et espace sont inséparables car ils jouent un rôle essentiel dans l'économie de l'intrigue dans la mesure où ils déterminent et marquent les personnages. Bien sûr, ces indices temporels, dans un souci de réalisme (mais sans restreindre pour autant les œuvres littéraires au genre réaliste), contribuent à l'« effet de réel », dont nous avons déjà parlé au début de ce travail. Dans les romans de notre corpus, le « chronotope » apparaît sous différentes formes et à des degrés divers car, comme l‟a démontré Bakhtine, la temporalité historique n‟est autre que l‟association de « l'intrigue personnelle, commune, avec l'intrigue politique et financière, du secret d'État avec le secret d'alcôve, la fusion de la série historique avec la série des mœurs et de la biographie »333. Autrement dit, le « chronotope » se construit à plusieurs niveaux : il y a « le temps des événements personnels, intimes et familiaux » qui 333 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, « Tel », 1978, p. 388. 125 s‟individualise et se détache « du temps de la vie historique collective de l‟ensemble social, de l‟Histoire »334. Ces différentes échelles de valeur marquent profondément les descriptions spatiales car la ville est à la fois l‟espace de l‟intime et de l‟Histoire, comme l‟explique Marc Augé : Mais la ville souvenir est aussi historique et politique. Centres historiques, monuments, d‟un côté ; itinéraire de la mémoire individuelle et flânerie, de l‟autre : ce mixte fait de la ville un archétype du lieu, où se mêlent repères collectifs et inscriptions individuelles, histoire et mémoire. La ville est donc une figure spatiale du temps où se conjuguent présent, passé et futur. 335 La ville est l‟espace où confluent tous les temps, elle est tour à tour la scène des tragédies individuelles et collectives passées et présentes. L‟espace urbain est donc le lieu de l‟épopée puisqu‟une suite d‟événements historiques s‟y déroule et qu‟il en porte les marques mais il est aussi le reflet de la société. La Havane va donc être tantôt une scène historique, tantôt un espace social, comme nous le verrons dans ce chapitre. L‟architecture, les constructions et les monuments sont autant de preuves du passé historique et constituent des lieux identitaires forts. Mais tous les écrivains ne vont bien évidemment pas évoquer le contexte historique à travers les descriptions urbaines ; de plus, ceux qui exploitent cet arrière-fond ne vont pas le faire de la même façon ni avec la même intensité. Tantôt point d‟ancrage géographique, tantôt scène où se joue véritablement l‟Histoire nationale, La Havane est convoquée à des degrés différents. C‟est ce que nous allons tâcher de montrer à présent en étudiant deux traitements distincts de ce substrat historique. Le premier consiste à envisager la capitale cubaine comme l‟espace où l‟histoire du pays tout entier s‟écrit. Dans ce cas, les écrivains vont élargir le « chronotope » à une période très ample et vont inscrire la ville dans la diachronie. La seconde approche, quant à elle, s‟appuie sur une focalisation historique plus précise qui dépeindra La Havane à un moment déterminé. Une fois de plus, nous ne recherchons pas ici l‟exhaustivité car elle serait, d‟une part, impossible à atteindre sur deux siècles d‟Histoire et, d‟autre part, peu pertinente puisqu‟elle nous contraindrait sans doute à établir des listes d‟auteurs et de romans historiques. C‟est donc en nous appuyant sur quelques exemples choisis que nous préférons montrer de quelle manière l‟Histoire « transforme » la ville. 334 335 Ibid., p. 353. Marc Augé, Pour une anthropologie de la mobilité, Paris, Editions Payot & Rivages 2009, p. 74, 75. 126 Les fresques historiques vont offrir une vision globale temporellement parlant de La Havane et vont conférer à la capitale une « fonction symbolique nationale », pour reprendre la formule d‟Ineke Phaf336. Vista del amanecer en el trópico (1974), de Cabrera Infante, constitue à cet égard un excellent cas de figure puisque l‟œuvre retrace toute l‟histoire de l‟Île, depuis sa création jusqu‟à la période révolutionnaire, en passant par la découverte, la colonisation, les Guerres d‟Indépendance ou encore les dictatures. La Havane est évoquée à plusieurs reprises dans ce récit qui se présente sous la forme d‟une série de tableaux historiques se succédant chronologiquement. Mais elle l‟est en tant que décor qui est au service de l‟histoire individuelle et collective : il n‟y a aucune description de la ville mais des allusions aux symboles nationaux, par exemple (le Morro, le palais présidentiel, le Paseo del Prado ou le Capitole). De plus, à l‟instar des héros anonymes ou nationaux jamais nommés dans ce récit, la ville n‟est jamais La Havane mais « la ciudad » ou « la capital » car ce que l‟auteur dit au sujet de la sierra est également valable pour la ville : « LA SIERRA NO ES UN PAISAJE, es un escenario »337. Scène de l‟histoire, la ville l‟est aussi, mais elle n‟est pas que ça, dans la trilogie de Cintio Vitier, De Peña Pobre338, dont le premier volet, composé de « De peña pobre » (1978) et de « Violeta Palma » (1980), nous intéresse tout particulièrement parce qu‟il fait la part belle à la capitale. C‟est l‟histoire de Cuba de 1895 à 1970 qui est évoquée à travers plusieurs personnages (Máximo Palma, sa fille Violeta Palma, son fils illégitime Sandino, Kuntius, Jacinto, etc.). L‟histoire familiale des Palma, marquée par les plus grands bouleversements de la période, constitue le fil conducteur de ce récit historique. Le titre de l‟ouvrage indique clairement une relation très étroite avec la ville puisqu‟il renvoie au nom d‟une rue, Peña Pobre (rue Compostela aujourd‟hui), située dans La Habana Vieja. Dans cette rue se trouvait la maison de Violeta Fundora, la mère de Máximo Palma et donc grand-mère de Violeta Palma. Cette demeure et par extension cette rue servent de symboles patriotiques puisqu‟elles représentent les lieux de la conspiration anti-espagnole de 1895. En effet, des soldats indépendantistes se retrouvaient chez Violeta. Après la Guerre d‟Indépendance, ce sont la naissance de la République, le machadato, les manifestations étudiantes de 1930, la dictature de Batista suivie de sa fuite puis l‟arrivée des barbudos dans la capitale qui constituent les grandes étapes historiques du premier volet. Des évocations très précises d‟événements plus mineurs viennent aussi compléter ce panorama diachronique. C‟est le cas, 336 Ineke Phaf, Novelando La Habana, op. cit., p. 149. Guillermo Cabrera Infante, Vista del amanecer en el trópico (1974), New York, Penguin Books Ediciones, 1997, p. 131. 338 Ce triptyque est composé de « De Peña Pobre » (1980), « Los papeles de Jacinto Finalé » (1984) et « Rajando la leña está » (1986). 337 127 par exemple, des funérailles d‟Eduardo Chibás, fondateur du Parti Orthodoxe qui dénonça la corruption durant les présidences de Ramón Grau San Martín et Prío Socarrás : Kuntius llegó trabajosamente al pie de la escalinata, abriéndose paso entre la muchedumbre desbordada, cuando ya el carro fúnebre estaría doblando por 23. Su propósito no era ver nada, sino ir, ir con la multitud, como aquella noche de júbilo de « la jornada gloriosa », a la que esta tarde de luto parecía responder de modo definitivo. Funeral de las ilusiones del 30, funeral de la República, funeral ¿ de toda esperanza cìvica ? […] ¿ Qué significaba aquel río crecido, denso, indetenible, rodando lentamente por el kilómetro y medio de la calle 23, contemplando por millares de rostros enmudecidos en las aceras, en los árboles, en los postes, en los muros, balcones y azoteas, como si lo más importante ya no fuera el cadáver que encabezaba el desfile, sino el desfile mismo, la masa […] ?339 La mort de Chibás, qui survint en août 1951340, est lourde de sens pour Kuntius : elle marque la fin de toutes les illusions, comme le suggèrent la répétition du terme « funeral » et les deux questions finales. La comparaison entre la liesse populaire qui suivit les élections de 1944 (« la jornada gloriosa »341) et ce cortège funèbre ne fait qu‟accentuer cette désillusion : à l‟allégresse et aux espoirs d‟hier correspondent le silence et la gravité actuels. Le narrateur omniscient insiste sur la densité de la foule qui occupe tout l‟espace urbain grâce à de nombreux adjectifs et à des expressions telles que « río crecido » ou encore « millares de rostros ». L‟attention exclussive qu‟il porte à cette foule anonyme (le cercueil de l‟homme politique passe au second plan) montre que cet événement n‟a d‟intérêt que parce qu‟il permet un rassemblement populaire immédiat et spontané. C‟est d‟ailleurs ce que suggère l‟hypothèse finale : « como si lo más importante […] fuera […] el desfile mismo, la masa […] ». Le second récit, « Violeta Palma », renvoie à l‟époque révolutionnaire de 1959 à 1970 (année de la récolte des dix millions de tonnes de canne à sucre), en passant par la crise des missiles de 1962. Là encore l‟auteur convoque des événements et des personnages historiques réels pour inscrire sa fiction dans un contexte précis et s‟appuie sur une narration omnisciente pour confronter les différents points de vue. Dans cette œuvre, la ville semble moins marquée par l‟Histoire, sans doute parce que les bornes chronologiques sont plus réduites (un peu plus de dix ans). Malgré tout, il est naturellement question des changements qui transforment La Havane après l‟avènement de la Révolution : « […] Fernanda sentía la tristeza de unas calles que ya no colaboraban, siquiera fuese tácitamente, con sus ideas y sentimientos. Los letreros, 339 Cintio Vitier, Narrativa, « De peða pobre », „De peða pobre‟, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2002, p. 109. 340 Eduardo Chibás s‟est suicidé. 341 C‟est ainsi que Chibás avait qualifié cette journée. 128 los edificios, las gentes, parecían hablar otro lenguaje, tener como un sabor distinto »342. Fernanda, la mère de Violeta Palma, issue de la bourgeoisie cubaine, ne soutient pas le nouveau régime et souffre de ne plus reconnaître sa ville (elle finira d‟ailleurs par quitter le pays). Tout lui semble étranger car la capitale n‟est intrinsèquement plus la même : sa physionomie et ses habitants lui semblent différents. Son mari, Máximo Palma, qui lui restera dans l‟Île, fera un constat encore plus cinglant : « […] La Habana se la habían cogido y la estaban destruyendo los comunistas […] »343. C‟est aussi une famille que l‟on suit sur plusieurs générations qui constitue le fil rouge du roman El polvo y el oro, de Julio Travieso. Les bornes chronologiques sont plus vastes que chez Vitier puisque cette œuvre retrace deux cents ans de l‟histoire cubaine, depuis la fin du XVIIIème siècle à la Révolution castriste, à travers l‟histoire familiale des Valle dont on observe l‟évolution sur six générations. En évoquant La Havane esclavagiste du XIXème siècle, l‟arrivée de Miguel Tacón à la capitale (1834) et ses travaux d‟urbanisation, la naissance des mouvements indépendantistes, les Guerres d‟Indépendance (1868-1878344 puis 1895-1898), la dictature de Batista (1952-1958) et enfin l‟avènement de la Révolution et la nationalisation des biens, ce roman fleuve brosse un tableau très large de l‟histoire cubaine où La Havane, omniprésente, représente l‟Île tout entière. D‟illustres personnalités historiques apparaissent dans le récit et deviennent des personnages romanesques, c‟est le cas du Général Tacón qui prend même la parole pour rappeler combien son rôle a été fondamental dans la modernisation de la ville : Ŕ Pero, decidme, coronel ¿ quién empedró estas calles, acabó con criminales y ladrones, instituyó el cuerpo de serenos, abrió plazas y caminos, construyó un teatro mejor que el de Madrid, extendió el alumbrado público a toda la ciudad ? [...] Ŕ Su excelencia Ŕ dijo tratando de calmarlo Ŕ, y fue su excelencia quien mandó erigir una nueva cárcel con un trato más humano para los presos, y dragó el puerto, y ordenó abrir cloacas en las calles y una nueva pescadería y nuevos mercados, eso lo sabemos todos los buenos españoles y también los cubanos leales.345 Dans ce dialogue, non dénué d‟ironie, entre Tacón et un colonel tout aussi affable qu‟obséquieux, c‟est une étape historique de l‟urbanisme de La Havane qui est décrite. Des rues pavées, assainies, éclairées et sécurisées, l‟édification d‟un théâtre et d‟une nouvelle 342 Cintio Vitier, Narrativa, « De peða pobre », „Violeta Palma‟, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2002, p. 186. 343 Ibid., p. 233. 344 Première guerre de libération appelée guerre de Dix Ans. 345 Julio Travieso, El polvo y el oro, op. cit., p. 175. 129 prison sont quelques-unes des transformations que l‟on doit au Général. L‟énumération de tous ces travaux sert ici à flatter le gouverneur mais montre aussi à quel point Tacón a contribué à changer la physionomie de la ville en la dotant d‟infrastructures modernes qui font que La Havane d‟alors n‟a rien à envier à la métropole espagnole346. La ville et son évolution occupent une place importante dans ce roman, en témoigne le récit de la promenade dans la capitale de Frasco Valle, de retour à Cuba après un exil aux Etats-Unis : [...] se dedica a [...] recorrer la ciudad, tan insegura en cuanto a robos y asaltos en la calle como años atrás, pero muy cambiada en su aspecto externo, sin murallas que la circunden, con un alumbrado público recién inaugurado, calles nuevas, servicio de agua corriente y hoteles tan confortables como los de los Estados Unidos. Por todas partes los negros se mueven libremente y ya no se escucha el chasquido del látigo porque la esclavitud ha sido abolida.347 La destruction des murailles (1863), la diffusion de l‟éclairage public (1890), l‟eau courante dans les habitations mais surtout la fin de l‟esclavage (définitivement aboli en 1886) changent radicalement l‟aspect de la capitale qui, dès la fin du XIXème siècle, prend des allures de ville nord-américaine. L‟histoire urbaine et sociale se croisent dans cet extrait et montrent qu‟à travers La Havane, c‟est aussi l‟histoire du pays tout entier qui s‟écrit. Ainsi, la panique qui règne dans la ville lorsque le palais présidentiel est pris d‟assaut par les rebelles révolutionnaires est précisément décrite348, tout comme l‟arrivée des barbudos dans la capitale, après la fuite du dictateur Batista (le 1er janvier 1959) : La ciudad era carnaval de abrazos, besos, felicitaciones, de gentes alborotadas, hombres, mujeres, niños, ancianos, trabajadores, estudiantes, amas de casa que, en todas partes, calles, avenidas, plazas, y a todas horas, desde el amanecer a la medianoche, no querían perderse un solo suceso de los muchos que ocurrían a cada instante, en súbita aparición de portentos, donde los continuos disparos, ahora al aire y no para matar, ya no asustaban, ni los uniformes militares de hombres con melenas de mujer suscitaban odio, rechazo, como tampoco asombraban las muchas personas armadas, todas militares, civiles, con ametralladoras, fusiles, escopetas, pistolas, revólveres y hasta bazukas […]. Luego de días en vela, algunos dormían en los lobbys de los hoteles más lujosos despatarrados en sofás y butacones, y hasta en el suelo, [...] y nadie les prestaba atención porque mayores portentos se podían ver en la maravillada ciudad. La ciudad en la cual, una semana atrás, la noche era amenazante y oscura boca, lista para tragar a cualquier persona que, con aire sospechoso, caminase por sus calles, y devolverla en una esquina 346 Nous trouvons également quelques allusions aux travaux de Tacón dans Cecilia Valdés : la construction de la prison et la transformation des murailles. Voir : Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 142 et 281. 347 Julio Travieso, El polvo y el oro, op. cit., p. 404. 348 Ibid., p. 437. 130 despedazada a balazos. La ciudad siniestra había quedado sepultada transformándose en la ciudad resplandeciente, festiva [...].349 Dans une description partisane (Rosario et Javier Valle, personnages principaux de cette période, accueillent favorablement la Révolution), le narrateur saisit le contraste entre la ville de Batista (« amenazante », « oscura », « siniestra ») et celle des révolutionnaires (« maravillada », « resplandeciente », « festiva »). La joie et l‟effervescence qui animent La Havane s‟opposent à la paralysie qui caractérisait la ville de Batista, anéantie par la terreur. La confiance que tous les habitants (« hombres, mujeres, niños, ancianos, trabajadores, estudiantes, amas de casa »), unanimes, ont envers ces nouveaux militaires marque une rupture complète. Les uniformes, les armes et les coups de feu ne terrorisent plus la population mais sont, au contraire, synonymes d‟allégresse. Dans une dichotomie manichéenne, le narrateur montre l‟espoir que fait naître cette nouvelle étape historique chez tous les Cubains. On voit bien qu‟histoire individuelle et collective s‟écrivent simultanément et confèrent au roman un caractère épique. La trilogie de Lisandro Otero est un autre exemple probant de ces vastes fresques littéraires qui placent La Havane au centre des événements historiques. Dans La situación (1963), En ciudad semejante (1970) et Árbol de vida (1990), c‟est le XIXème siècle, les Guerres d‟Indépendance, la République, les dictatures de Machado et Batista puis l‟avènement de la Révolution en 1959 qui constituent l‟arrière-fond historique. Pour évoquer toutes ces étapes, plusieurs récits composent les deux premières œuvres (« Oro blanco », « Un padre de la patria », « Retrato de un héroe », « El nacimiento de una nación », « La educación revolucionaria », etc.). Nous noterons que la polyphonie narrative semble être la condition sine qua non de l‟écriture de ces romans historiques car dans El polvo y el oro plusieurs narrateurs se partagent aussi le récit. Chez Vitier, Travieso et Otero, la structure narrative complexe confronte les points de vue350 et met en scène des temporalités différentes, qui remontent jusqu‟à l‟époque coloniale, pour expliquer la généalogie des différentes familles. Cela permet à Otero de montrer, entre autres choses, l‟origine de la fortune de l‟oligarchie cubaine. Dans La situación, l‟histoire personnelle de l‟indiano351 Cayetano Sarría et celle du colonel Cedrón, qui deviendra sénateur en 1952, dénoncent l‟opportunisme et l‟appât du gain qui sont à l‟origine des richesses amassées pendant l‟étape coloniale puis républicaine. Dans 349 Ibid., p. 464. C‟est surtout vrai dans El polvo y el oro où des faits et des événements sont envisagés par plusieurs narrateurs. Pour une étude plus approfondie des différentes voix narratives dans ce roman, voir : « Estratos de poder en la historia de Cuba (Sobre El polvo y el oro, de Julio Travieso) », in Ángel Esteban, Literatura cubana entre el viejo y el mar, op. cit., p. 285-303. 351 Emigré espagnol ayant fait fortune en Amérique. 350 131 ce roman, les récits où apparaît Gabriel Cedrón décrivent La Havane de Machado, et ceux consacrés à l‟histoire de Luis Dascal, personnage principal du récit cadre, La Havane prérévolutionnaire du début des années cinquante. Cedrón assiste ainsi à la période agitée durant laquelle la dictature de Machado est remise en question par de nombreuses protestations populaires, en témoigne cette description d‟une manifestation estudiantine : El 30 de septiembre [Cedrón] no fue a trabajar. El gobierno estaba preparado. Las calles cercanas a la universidad eran patrulladas por policías a caballo. Vio a los amigos de Fernando, sus amigos ahora, que estaban junto al Alma Mater, tensos, callados. [...] Estaban llegando a la calle Infanta y se escuchaban tiros aislados. [...] La manifestación bajaba por San Lázaro. Más gritos y puertas que se cerraban. Al llegar al parque Maceo los refrescó el viento que soplaba del mar. Entre Gervasio y Belascoaín, un muro de plomo : todos los policías de la Quinta Estación disparaban contra los estudiantes. [...] Torriente y Figueroa heridos, Trejo se moría, gran conmoción en toda La Habana.352 Dans ce récit de la manifestation du 30 septembre 1930, qui se dirigeait vers la maison de l‟intellectuel Enrique José Varona, et durant laquelle l‟étudiant Rafael Trejo a réellement perdu la vie, l‟histoire et la fiction s‟entrecroisent pour mettre en évidence la violence de la répression policière, que le rythme entrecoupé des dernières lignes et la proposition nominale finale (« gran conmoción en toda La Habana ») accentuent. Gabriel Cedrón est un spectateur distant des événements historiques. Ainsi, même lorsque Machado tombe, il semble peu concerné par ce qui l‟entoure mais ne critique pourtant pas moins ce qu‟il voit : El día que cayó Machado recorrió [Gabriel] las calles. La huelga general revolucionaria había llegado a derrocar al tirano. Tomó una máquina de alquiler en San Lázaro y se apeó en el parque Zayas. Contempló un largo rato el Palacio Presidencial y al pueblo enfurecido. Caminó después por toda La Habana donde el pueblo confraternizaba con los soldados y vio las residencias saqueadas y el entusiasmo de la gente le pareció gratuito y estúpido.353 Avec la distance du juge, Cedrón jauge à la fois les circonstances historiques et ses compatriotes. C‟est avec la même distance et quasi indifférence que le jeune bourgeois, Luis Dascal, observe les soubresauts qui caractérisent la période prérévolutionnaire. Il assiste, par exemple, au coup d‟état de Fulgencio Batista en 1952 et se promène en ville tout de suite après : 352 353 Lisandro Otero, Trilogía cubana, « La situación », op. cit., p. 148, 149. Ibid., p. 186. C‟est nous qui soulignons. 132 Luis Dascal caminó por la calle L en dirección a 23. Nada sucedía en la calle. Los autobuses se cruzaban cargados de pasajeros y la gente lo esperaba en las esquinas y los billeteros exhibían sus billetes y vendían a veces y las cafeterías estaban abiertas y la gente bebía refrescos [...]. Todo estaba tranquilo, como todos los días y Dascal subió a una ruta 26 en la esquina de L y 23. Nadie hablaba : los pasajeros iban en silencio y aún el chofer y el conductor no intercambiaban sus comentarios habituales, un esfuerzo notable dada la circunstancia.354 Comme si de rien n‟était, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes mais un silence tout aussi pesant qu‟inhabituel trahit la gravité de la situation. On le voit, Dascal apparaît comme un spectateur distant des circonstances et contingences qui l‟entourent : il observe la ville après le coup d‟état sans que cet événement semble avoir sur lui un quelconque effet. Cela sera récurrent quand il s‟agira d‟évoquer la dictature de Batista (depuis le coup d‟état de Batista du 10 mars 1952 au 1er janvier 1959), dans En ciudad semejante, ou La Havane de 1959, dans Árbol de vida. Car le personnage de Dascal permet à l‟auteur de critiquer cette bourgeoisie oisive et apolitique qui est à l‟origine de tous les maux du pays, c‟est tout du moins ce que pense Eduardo Méndez y Soto : Otero critica despiadadamente la vida ociosa de la burguesía nacional, su apatía, su corrupción [...]. El autor afirma que los males de la nación son el producto del parasitismo social de esta clase. Asimismo, a pesar de la indiferencia y de la abulia de su personaje principal, a través de cuyo temperamento es en parte contemplada la realidad, clama por la erradicación del sistema causante de tales calamidades. La idea que informa la novela es que estas castas sociales, hundidas en el vicio y la perdición, sólo actúan determinadas por sus intereses de clase, haciendo caso omiso de los verdaderos intereses de la patria.355 D‟après Méndez y Soto, le manque d‟engagement politique, l‟absence de lutte pour le bien public et les velléités de la petite bourgeoisie cubaine sont tout ce qu‟Otero veut dénoncer. Le récit historique serait donc au service d‟une dénonciation politique qui ne serait pas propre au récit cadre. En effet, les chapitres « secondaires » (ceux qui ne concernent pas Dascal) décrivent La Havane coloniale, les Guerres d‟Indépendance, la chute de Manuel de Céspedes (1874), le départ des troupes espagnoles en 1898, la République et les dictatures de Machado et de Batista avec exactitude pour mieux appuyer le propos dénonciateur d‟Otero. Le dernier opus de sa trilogie, Árbol de vida, est en cela exemplaire car il est émaillé de descriptions intégralement historiques, en témoigne le récit d‟une fusillade en plein centre-ville durant la guerre de Dix Ans : 354 355 Ibid., p. 177. Ernesto Méndez y Soto, Panorama de la novela cubana de la Revolución (1959-1970), op. cit., p. 48. 133 Al atardecer, César encontró a Inocencio León en el café Dominica, frente al parque Isabel II. [...] Del otro lado de la avenida, El Louvre albergaba a los elegantes. [...] Algunos Voluntarios señalaban hacia el teatro, como si de allí hubiese partido la agresión. Otros se dirigieron en formación a la calle San Rafael [...]. Desde el Campo de Marte venían a toda prisa los militares que se encontraban en rutinas marciales. Un pelotón puso rodilla en tierra, como si se hallase en el campo de batalla, y disparó indiscriminadamente hacia la terraza del Louvre ; hombres y mujeres cayeron con grandes gemidos [...]. De la maestranza, de la pescadería, del seminario, bajaron los Voluntarios por las calles de Obispo y O‟Reilly profiriendo imprecaciones, y ofensas. [...] El pelotón situado frente al Louvre desenvainó las bayonetas [...]. Desde el Dominica, por la puerta entreabierta del almacén, César e Inocencio vieron el exterminio indiscriminado en medio de los ruegos y lamentos de los heridos.356 César, personnage fictif, devient le spectateur horrifié d‟un événement historique sanglant survenu les 23, 24 et 25 janvier 1869 quand le corps de Volontaires espagnols, créé pour pallier le manque de troupes régulières, après avoir causé plusieurs incidents dans le théâtre Villanueva, attaque les clients du Café du Louvre. La violence inouïe de cette exécution sommaire caractérise la cruauté de ces Volontaires espagnols, venus à Cuba pour défendre les intérêts de la couronne en luttant contre les criollos indépendantistes. La terreur qu‟ils faisaient régner dans la ville, les crimes commis en toute impunité, les demeures qu‟ils mettaient à sac puis brûlaient, sont décrits avec la même exactitude que la scène que nous venons de citer. Personnalités historiques réelles et personnages de fiction se croisent pour rendre le roman vraisemblable et la dénonciation de l‟auteur crédible. Ce puzzle historique (les récits renvoient à des périodes qui ne se suivent pas chronologiquement) permet d‟inscrire l‟espace urbain, scène de tous ces événements, dans une perspective historique large. Mais tant Julio Travieso que Lisandro Otero, en ne suivant pas un fil chronologique, considèrent l‟Histoire non pas comme une succession d‟événements mais comme un tout qu‟il convient d‟examiner dans son ensemble. Grâce à une approche holistique, ils offrent ainsi une vision plus globale que diachronique des événements sociaux et politiques qui ont marqué Cuba. b- Les tableaux d’une époque D‟autres romans vont s‟attacher à dépeindre La Havane d‟une période historique précise et ne tendent plus à inscrire l‟espace urbain dans une globalité historique. En analysant un moment déterminé, ces auteurs placent toujours la ville au cœur d‟un processus historique mais celui356 Lisandro Otero, Trilogía cubana, « Árbol de vida » (1990), op. cit., p.666, 667. 134 ci apparaît comme fragmenté puisque ce n‟est pas l‟évolution qui importe mais la période, voire l‟instant T. D‟autre part, le roman, même s‟il n‟est pas nécessairement historique, renvoie aux événements passés ou présents pour exposer les problèmes principaux ou les particularités d‟une époque, souvent dans un but dénonciateur. Dans ce cas, il s‟agit pour l‟écrivain d‟évoquer un contexte précis, en le recréant par le biais de la fiction littéraire, pour tenter de tirer un enseignement, autrement dit pour tenter de tirer les leçons du passé. Ainsi, l‟on constate que certaines étapes sont largement décrites quand, au contraire, d‟autres, tout aussi importantes sur le plan historique, n‟apparaissent pratiquement pas. En respectant l‟ordre chronologique, nous allons tenter de voir quels sont, dans la littérature, ces grands moments historiques qui ont marqué la ville et avec quelle intention les écrivains s‟y intéressent. Nous pouvons d‟ores et déjà dire que la capitale coloniale sert souvent de décor à des récits empreints de costumbrismo qui mettent surtout l‟accent sur les intrigues individuelles des personnages. À part Lisandro Otero et Julio Travieso, peu d‟auteurs évoquent précisément la ville bouleversée par les grands événements du XIXème siècle : les Guerres d‟Indépendance ou la fin de l‟empire espagnol. Cela est d‟autant plus étonnant que la littérature cubaine compte un grand nombre de romans historiques, publiés entre 1899 et 1923, qui décrivent cette période. Cette absence est manifeste chez Jesús Castellanos, dans La manigua sentimental, dont une partie de l‟action se déroule dans la capitale. Il a déjà été dit que, dans ce roman, La Havane de cette « fin de siècle » (1868-1898) ne bénéficie que d‟évocations très superficielles. Citons également Juan Criollo (1927), de Carlos Loveira, qui a pour cadre la fin du XIXème siècle et les premières années de la République. Avec cette œuvre, l‟auteur recrée plus un contexte social général qu‟il ne décrit précisément l‟impact qu‟ont sur la ville les différents événements historiques. Deux épisodes seulement renvoient à cette période agitée. Le premier rend compte des tensions, palpables dans la ville, qui opposaient les indépendantistes (dont le héros, Juan, faisait partie) aux anti-annexionnistes357. Le second évoque l‟Indépendance de l‟Ile et donne lieu à des allusions plus marquées. Après la signature du Traité de Paris, le protagoniste, qui vivait au Mexique, rentre au pays et retrouve avec joie et enthousiasme une Havane « libre », ou tout du moins, délivrée du joug espagnol : 357 Nous renvoyons à l‟épisode du défilé organisé pour glorifier la nation espagnole, dans la rue Muralla, qui révulse Juan, in Carlos Loveira, Juan Criollo, op. cit., p. 75, 76. 135 A gozar, a plenos pulmones, el ambiente de La Habana, sin soldados españoles, con los odiados voluntarios definitivamente restituidos a sus mostradores y trastiendas, con sus calles, paseos y edificios, plagados de banderas cubanas, y por dondequiera los amables grupos rojizos, resudados, casi asfixiados militares « americanos », que acababan de batirse con Cervera y Vara del rey, por humanidad.358 La ville, où les « aimables » soldats américains ont remplacé les « odieux » Espagnols, est décrite car elle symbolise la liberté recouvrée. La présence de drapeaux cubains flottant un peu partout dans la capitale matérialise l‟élan patriotique qui caractérise la période. Enfin, l‟allusion à deux militaires espagnols ayant réellement existé, l‟amiral Cervera et le général Vara del rey, tend à authentifier le récit du narrateur omniscient et à donner à ce passage le statut de chronique historique. La période qui suit ces soubresauts est davantage présente dans les romans de notre corpus. Le tournant du siècle et les débuts de la République semblent effectivement marquer un peu plus la capitale cubaine dans la littérature mais ils n‟en sont pas moins décrits de manière anecdotique et isolée, comme l‟attestent les œuvres naturalistes de Carlos Loveira et José Antonio Ramos359. Telle une parenthèse, Loveira, dans Juan Criollo, mentionne le premier anniversaire de la proclamation de la République, le 20 Mai 1903. En ce jour de commémoration, la ville entière concourt à exalter la nation cubaine : Estaba próximo el primer 20 de Mayo. La Habana vibraba de patriótico entusiasmo. Nos encontrábamos en el cenit de aquella época en que casi todos los cubanos anhelábamos contribuir, fervientemente, a la afirmación y engrandecimiento de una República ejemplar. […] Vivraba La Habana de patriótico entusiasmo. Levantábamos arcos en las principales bocacalles. Entraban en la ciudad carros y caballos cargados con verdes montañas de guano para las enramadas nutridas de banderas, farolillos y cadenetas de papel multicolor. Rodaban por todas partes los carruajes nuevos, charolados, con los más hermosos caballos, que en las tardes y noches formaban interminables, bulliciosas hileras ; Prado abajo, Prado arriba, como en ensayo de la invasión multitudinaria, anhelante y frenética, que habría de invadir aquellos lugares, a la hora de izar la Estrella Solitaria, en el Morro propincuo.360 La ville en liesse, parée de décorations, s‟apprête à célébrer cet anniversaire de manière exceptionnelle. L‟ardeur du narrateur, perceptible dans les répétitions (« vivraba », « entusiasmo », « patriótico »), les substantifs hyperboliques (« cénit », « engrandecimiento », 358 Ibid., p. 356. Nous ne reviendrons pas sur la description de la proclamation de la République et du défilé militaire sur le Malecón, dans La vida manda, puisque le narrateur en fait un événement tout à fait marginal qui n‟a qu‟un impact limité sur la capitale. Voir : Ofelia Rodríguez-Acosta, La vida manda, op. cit., p. 166. 360 Carlos Loveira, Juan Criollo, op. cit., p. 375, 376. 359 136 « ejemplar »), les nombreux adjectifs (« nutridas », « interminables », « bulliciosas », « multitudinaria », « frenética ») et le rythme des phrases, montrent que cette jeune République fait naître tous les espoirs. La ville devient un acteur décisif de la construction de la nation en permettant aux patriotes de manifester concrètement leur enthousiasme. L‟allusion finale au drapeau cubain qui sera hissé, lors d‟une cérémonie au Castillo del Morro, est en cela fort probante. Hélas, très vite, cet engouement retombera et les limites de la République seront flagrantes. C‟est encore Loveira qui brossera un portrait amer et accablant de ce premier quart de siècle, dans Generales y doctores (1920). Mais là aussi, la ville n‟est que ponctuellement convoquée pour servir de décor à cette démocratie de façade. Elle n‟est pas non plus marquée par l‟histoire du pays à proprement parler dans la mesure où, hormis quelques références topographiques, peu d‟allusions précises sont faites à La Havane361. Dans ce roman historicosocial, Loveira préfère décrire les personnages, les fraudes, la corruption et les intrigues politiques qui se jouent pour signifier toutes les défaillances du régime. Comme le titre l‟indique, seuls les gradés militaires ou les diplômés académiques peuvent s‟imposer dans la vie politique de la jeune République, discréditée par la fraude électorale et le népotisme. José Antonio Ramos, quant à lui, dépeint de manière allégorique la République cubaine, dans son roman Coaybay (1927). Même si Naraguá, Coaybay et Norlandia sont des noms fictifs, ils n‟en renvoient pas moins à une réalité très concrète : celle de La Havane, de Cuba et des Etats-Unis durant la deuxième décennie du siècle (1914-1918). « La soleada y alegre ciudad capitalina del trópico »362, qui n‟est autre que La Havane/Naraguá, est une ville caribéenne qui vit sous l‟influence nord-américaine : Naraguá antigua, la parte de la ciudad definitivamente conquistada por las bárbaras huestes del progreso para sus almacenes mal olientes, sus enormes y destartalados carros, sus peones sudorosos y ajetreados, sus potros de descarga, sus toldos, sus letreros : el down town de la gran ciudad moderna y norlandizada, conservaba todavía otro palacios de la misma época colonial espaðola […].363 361 Peu d‟événements marquent la ville, à l‟exception de la grève générale décrite à la fin du roman : « No circulan los tranvías. Están cerrados fondas y cafés. En el puerto hay tranquilidad de domingo neoyorquino. La noche anterior no hubo recogida de basuras, y las calles ofrecen el aspecto de largos vertederos o de santísimas callejas jerosolimitanas. La ciudad está envuelta en uno como hálito de mortales presagios. Los policías, taciturnos y recelosos, circulan en parejas. Tintinean las ambulancias rodando veloces por las calles limpias de vehículos », Carlos Loveira, Generales y doctores (1920), La Havane, Ediciones Huracán, Instituto Cubano del Libro, 1972, p. 401. 362 José Antonio Ramos, Coaybay (1927), La Havane, Editorial Arte y Literatura, 1975, p. 43. 363 Ibid., p. 30. 137 La vieille ville de Naraguá, qui correspond bien sûr à La Habana Vieja, se transforme en se modernisant sous la domination des « barbares » de Norlandia (les Etats-Unis). Le narrateur emploie le lexique de la guerre (« conquistada », « huestes ») pour souligner la perte de souveraineté de Coaybay. C‟est d‟ailleurs la pression que fait subir le voisin du Nord sur l‟île que dénonce, entre autres choses, Ramos dans son œuvre à travers la lutte du personnage don Marcelo Peñalba de Mendoza. Mais la ville n‟est décrite que pour signifier la suprématie « norlandienne » et ne bénéficie pas d‟une attention majeure. C‟est que, tant pour Loveira que pour Ramos, la ville n‟est qu‟un arrière-plan qui illustre sporadiquement leurs dénonciations socio-historiques et elle n‟est en aucun cas le support priviliégié pour véhiculer un quelconque jugement politique. En revanche, les périodes des dictatures de Machado (1925-1933) et de Batista (1952-1959) ne sont absolument pas traitées de la sorte. La capitale cubaine sous Machado et Batista constitue, en effet, le « chronotope » de très nombreuses publications littéraires qui verront essentiellement le jour après 1959. Dénoncer le climat de terreur et d‟injustice qui a marqué ces deux périodes, va effectivement faire partie du projet culturel castriste. Mais on ne saurait considérer ces récits qui vont, sciemment ou pas, servir l‟idéologie révolutionnaire, comme une littérature de propagande. En effet, dans ces œuvres de fiction, les qualités littéraires restent la préoccupation majeure des écrivains et priment sur l‟idéologie (contrairement aux romans publiés durant le « Quinquenio Gris »). Pour expliquer, en partie, l‟essor de ces romans à charge, on se souviendra du discours de Fidel Castro connu sous le nom de « Paroles aux intellectuels », prononcé en juin 1961, dans lequel il définit la politique culturelle du pays et prononce le fameux « dentro de la Revolución, todo ; contra la Revolución, nada ». Il est évident que ce nouvel axe va avoir une influence directe sur les publications littéraires à venir et va profondément marquer l‟histoire culturelle du pays. Mais n‟oublions pas que certaines œuvres de notre corpus publiées avant 1959 et 1961 font déjà état de ces périodes historiques difficiles ; c‟est le cas de la nouvelle « La noche de Ramón Yendía », de Lino Novás Calvo, écrite en 1933 et publiée en 1942, El acoso, d‟Alejo Carpentier, paru en 1956, et de El sol a plomo, d‟Humberto Arenal, publié en 1959, qui constituera d‟ailleurs, d‟après les critiques, le premier roman de la Révolution. L‟étape révolutionnaire marque aussi un tournant important pour l‟objet de notre étude : la présence de La Havane dans les œuvres de fiction. L‟intérêt pour l‟espace urbain va connaître à partir de 1959 un essor sans précédent qu‟Ángel Esteban explique ainsi : 138 A partir del triunfo de la Revolución del 59, las circunstancias de la ciudad y de la narrativa acerca de ella van a cambiar radicalmente. El hecho diferencial no es la pertenencia al Caribe, a los pueblos del mar, no lo es tampoco su corta vida como capital de una nación independiente, ni la huella que el imperialismo ha dejado en la época de Batista, ni siquiera la conciencia de una cultura nacional que ha madurado el sentimiento de un tiempo detenido. Por último, tampoco es un hecho decisivo y determinante el giro copernicano, en lo económico y en lo social, que confiere al país el establecimiento de una dictadura de cuño marxista. Son, en conjunto, todas esas circunstancias, las que configuran una ciudad absolutamente diferente a las del resto de América Latina, la singularizan y reverberan en la escritura y la lectura de la ciudad.364 L‟histoire récente et La Havane vont donc marquer la littérature du début de la Révolution, comme l‟atteste, par ailleurs, le travail d‟Ineke Phaf qui analyse l‟espace urbain havanais dans les romans publiés entre 1959 et 1980365. Outre la trilogie de Lisandro Otero analysée précédemment et Gallego, de Miguel Barnet, roman dans lequel on trouve quelques descriptions de La Havane de 1916 à 1959, Paradiso, de Lezama Lima, va dépeindre la ville du machadato. L‟agitation et la confusion qui naissent des manifestations étudiantes, sont très présentes dans le chapitre IX qui met en scène une marche contestataire qui grossit à mesure que les étudiants progressent dans la ville : Así los grupos, entre alaridos y toques de claxons, se fueron deslizando de la plaza a la calle de San Lázaro, donde se impulsarían por esa avenida que lanzaba a los conspiradores desde la escalera de piedra hasta las aguas de la bahía, frente al Palacio presidencial, palmerales y cuadrados coralinos [...]. La plaza de Upsalón tenía algo del cuadrado medieval, de la vecinería en el entono de las canciones del calendario : cohetes de verbena y redoblantes de Semana Santa. Fiestas de la Pasión en el San Juan y fiestas del diciembre para la Epifanía.366 L‟auteur souligne l‟agitation, le bruit et l‟énergie qui accompagnent cette manifestation d‟étudiants passionnés qui apparaissent, sous la plume de Lezama, comme les héros d‟une lutte à la fois épique et joyeuse puisque ce sont bien deux forces antagoniques qui semblent porter cette marche contestataire. Nous avons d‟un côté, des verbes soulignant le mouvement chaque fois plus violent des « conspirateurs » (« deslizando », « impulsarían », « lanzaba ») et de l‟autre des expressions qui marquent l‟ambiance festive du rassemblement (« canciones », « cohetes de verbena », « redoblantes de Semana Santa », « Fiestas », « Epifanía »). On le voit, le récit se fait poétique et tend à s‟éloigner de la réalité brute car nous ne trouverons pas, chez Lezama, le souci de rigueur et de précision historiques qui caractérise la prose d‟autres 364 Ángel Esteban, « A las duras y a las paduras : La Habana cielo e infierno », in Literatura cubana entre el viejo y el mar, op. cit., p. 306, 307. 365 Ineke Phaf, Novelando La Habana, op. cit. 366 José Lezama Lima, Paradiso, op. cit., p. 373. 139 écrivains. Bien qu‟il ait lui-même participé à cette manifestation, le 30 novembre 1930, il choisit de se détacher du récit purement documentaire, qui ne s‟intéresserait qu‟aux faits, pour évoquer plutôt des impressions subjectives, comme on le voit dans les comparaisons finales. Malgré tout, ce qui commence comme une fête va inévitablement se terminer dans la violence, comme si l‟histoire devait reprendre ses droits : Las descargas eran ráfagas y Cemí permanecía en su esquina como atolondrado por la sorpresa. No sabía a dónde dirigirse, pues el ruido incesante de los disparos impedía precisar cuál sería la zona de más relativa seguridad.367 Ces manifestations étudiantes réprimées avec force et brutalité par la police de Machado (« descargas », « ráfagas », « disparos »), sont également évoquées dans La consagración de la primavera (1978), grand roman historique d‟Alejo Carpentier, qui retrace l‟histoire des grands bouleversements de ce siècle (de la Révolution russe à la Révolution cubaine, en passant par la Guerre d‟Espagne et la Seconde Guerre mondiale). Concernant l‟histoire cubaine, le récit commence avec le machadato et se termine avec les événements de la baie des Cochons, en avril 1961. L‟un des deux personnages narrateurs, Enrique, issu de la grande bourgeoisie havanaise mais opposé au régime de Machado, a dû fuir Cuba pour des raisons politiques. Il se souvient des « casi cotidianas [...] turbamultas estudiantiles »368 et apprend, depuis l‟étranger (Paris), la chute du dictateur : [...] Machado había caído al cabo de una huelga general en mucho alentada por Rubén Martínez Villena. [...] Terminada era la abominable época de allanamientos y secuestros en la noche ; de campesinos colgados, de tres a tres por soga, en ramas de guásima, de obreros arrojados en pasto a los tiburones, en las afueras del puerto de La Habana [...].369 L‟allusion au poète très actif sur la scène politique Rubén Martínez Villena, que Carpentier a lui-même côtoyé au sein du « Grupo Minorista »370, marque la volonté de l‟auteur d‟apporter, autant que faire se peut, des précisions historiques. On connaît d‟ailleurs le souci d‟exactitude qui guidait ses nombreuses recherches lorsqu‟il écrivait un roman371. Dans cet extrait, 367 Ibid., p. 377. Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, op. cit., p. 149. 369 Ibid., p. 182. 370 Comme nous l‟avons dit dans l‟introduction, ce groupe réunit des intellectuels engagés politiquement et culturellement, entre 1924 et 1928. 371 Le prologue de El reino de este mundo, écrit par Carpentier, est en cela programmatique : « […] el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes Ŕ incluso segundarios Ŕ, de lugares y hasta de 368 140 l‟énumération des crimes perpétrés par le régime tyrannique insiste sur le climat de terreur qui régnait dans les villes et dans les campagnes à cette époque. Aussi, la ville conçue comme l‟espace de la traque et de la crainte est un élément récurrent pour caractériser cette période372. Cette idée est omniprésente, par exemple, dans « La noche de Ramón Yendía », de Novás Calvo, où le personnage éponyme, simple chauffeur qui collabore avec la police de Machado, se sent traqué par les révolutionnaires durant les manifestations d‟août 1933. Il se cache dans la ville au volant de sa voiture jusqu‟à ce que les policiers, le prenant pour un révolutionnaire, l‟abattent, au terme d‟une course poursuite. Cette nouvelle fait de La Havane un espace infernal, thématique que Carpentier reprendra dans El acoso, puisque le « fondateur » de « la ciudad de las columnas » s‟est, en partie, inspiré du récit de Novás Calvo pour construire son roman373. Pour ne pas anticiper sur notre deuxième partie, disons simplement que les deux fictions partagent la même vision d‟une ville hostile, voire cauchemardesque qui, tel un piège, se referme progressivement sur un personnage traqué, mais Carpentier construit un récit bien plus complexe. Dans El acoso, il est tout d‟abord difficile de situer avec précision les déplacements du personnage. L‟action se passe dans le Vedado, Centro Habana et La Habana Vieja ; des lieux décrits sont reconnaissables (la Avenida de los Presidentes ou el teatro Amadeo Roldán qui est l‟Auditorium dans le roman) mais beaucoup d‟imprécisions émaillent le roman. Ensuite, le temps narré est aussi flou : les analepses renvoient au machadato mais il est difficile, même impossible, de savoir si le récit en cours (la traque qui dure quarante-six minutes) a lieu avant ou après la chute du dictateur puisque Carpentier lui-même se contredit374. Quoi qu‟il en soit, la ville est synonyme de danger ou de « coto de caza en plena temporada »375 pour le personnage qui doit se cacher dans le Mirador d‟abord (sous Machado), puis dans un théâtre ensuite (après la dictature ?) puisqu‟il est tantôt traqué par la police à cause des crimes et des actes terroristes qu‟il a commis au nom du Parti, tantôt par deux hommes qui le cherchent, après qu‟il a dénoncé ses camarades de lutte lors d‟une détention. Caché dans ce théâtre, alors qu‟on veut le tuer, il se remémore certains événements récents de son existence. Les flash-back permettent de rappeler la violence de la répression calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y de cronologías », Alejo Carpentier, El reino de este mundo, (1949), Barcelone, Grijalbo Mondadori, 1995, p. 16. 372 Nous aurons l‟occasion de revenir sur cette idée dans notre deuxième partie lorsque nous étudierons le caractère aliénant de l‟espace urbain. 373 Pour une étude plus détaillée sur l‟intertextualité entre El acoso et « La noche de Ramón Yendía », voir : Yolanda Izquierdo, Acoso y ocaso de una ciudad. La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, op. cit., p. 73-77. 374 Ibid., p. 94, 95. 375 Ibid., p. 103. 141 policière de cette période et l‟engagement politique du jeune étudiant. Cela donne lieu à une nouvelle description de manifestation étudiante : [...] se vio arrastrado por una manifestación que bajaba, vociferante, las escalinatas de la Universidad. Un poco más lejos fue el choque, la turbamulta y el pánico, con piedras y tejas que volaban sobre los rostros, mujeres pisoteadas, cabezas heridas, y balas que se encajaban en las carnes. Ante la visión de los derribados, pensó que, en efecto, se vivían tiempos que reclamaban una acción inmediata, y no cautelas y aplazamientos de una disciplina que pretendía ignorar la exasperación. Cuando se pasó al bando de los impacientes, empezó el terrible juego que lo había traído nuevamente al Mirador, pocos días antes, en busca de una última protección, cargando con el peso de un cuerpo acosado, que era necesario ocultar en alguna parte.376 Violence et persécution règnent ici en maîtres, comme le suggère la riposte policière mise en lumière par une gradation (« pisoteadas », « heridas », « balas que se encajaban en las carnes »). Une autre gradation marque, quant à elle, la métamorphose de la ville qui devient un espace inquiétant et dangereux (« el choque », « la turbamulta », « el pánico »). Dans de telles circonstances, le cache-cache entre étudiants et policiers n‟a plus rien de ludique (« el terrible juego ») et justifie la radicalisation du protagoniste. Plus que jamais, l‟époque exige une lutte et un engagement sans demi-mesure. On observera enfin que la maison du Mirador, où vit le jeune homme, apparaît comme un refuge, un lieu protecteur (« última protección ») qui le met à l‟abri de la traque377. Ce sont les mêmes caractéristiques, qui dans une vision homogène, singularisent la ville du dictateur Batista, fréquemment décrite dans les romans post-révolutionnaires. Sans établir un catalogue exhaustif de toutes les œuvres décrivant La Havane durant cette période, nous pouvons malgré tout en citer quelques-unes, qui s‟ajoutent à la trilogie d‟Otero, pour témoigner de cet engouement : El sol a plomo (1959), d‟Humberto Arenal, Así en paz como en la guerra (1960)378, de Cabrera Infante, No hay problema (1961), d‟Edmundo Desnoes, la nouvelle « El regreso » (1962), de Calvert Casey, Gestos (1963), de Severo Sarduy, Rebelión en la octava casa (1967), de Jaime Sarusky, Muelle de caballería (1973), de César Leante, la nouvelle « El Ford azul » (1977), de Lisandro Otero, ou encore La vida real (1986), de Miguel Barnet. Roberto Gónzález Echevarría explique que les récits publiés au début des 376 Alejo Carpentier, El acoso (1956), México, Editorial Lectorum, 2005, p. 52. Dans Paradiso, de Lezama Lima, la maison familiale joue aussi cette fonction protectrice notamment après que José Cemí a fui la manifestation étudiante. Nous en reparlerons dans notre deuxième partie. 378 Dans ce recueil, seuls les quinze récits intercalés entre chaque nouvelle évoquent cette période extrêmement violente. Ces « vignettes », publiées auparavant dans la revue Carteles, « describían la náusea de vivir bajo la Tiranía », Guillermo Cabrera Infante, « Préface », Así en paz como en la guerra, La Havane, Ediciones R, 1960, p. 9. 377 142 années soixante, qui mettent en scène ce passé immédiat, éclairent surtout la situation présente (la Révolution) : « [son] obras todas que volvieron la vista sobre La Habana del batistato con mórbida fascinación, y a veces con extraña nostalgia, pero sobre todo con el propósito de hacer inteligible el presente analizando aquello que lo precedió »379. Pour rendre donc compréhensible le présent, quasiment toutes ces œuvres vont évoquer les manifestations estudiantines qui s‟opposent au dictateur, la ville paralysée par la peur, la présence policière, la répression féroce et/ou des scènes de tortures au commissariat central de la ville. Elles dressent, en somme, un portrait terrifiant de La Havane des années cinquante. Citons à titre d‟exemple un passage assez éloquent de No hay problema (1961), d‟Edmundo Desnoes, qui décrit une manifestation et l‟exécution par la police d‟un étudiant : Al bajar la escalinata distinguieron tres perseguidoras detenidas al pie de la colina. Alrededor de quince policías bloqueaban la calle. Los estudiantes también vieron los autos. La calle San Lázaro moría frente a la Universidad. Los manifestantes comenzaron a exigir la cabeza del dictador: « ¡ La cabeza de Batista, la cabeeeza ! » [...]. Cerca de ochenta estudiantes bajaron corriendo las tres cuadras que los separaban de la policía. Competían gritando, poseídos de entusiasmo y odio. Gritaban más y más alto a medida que descendían la colina. [...] Unas zancadas más abajo los estudiantes vieron que el cinturón de policías había crecido ; casi igualaban en número a los manifestantes. Se detuvieron bruscamente y comenzaron a correr en dirección contraria. La policía rastrilló las ametralladoras. […] Un estudiante solitario seguía corriendo hacia la policía. Sus brazos cortaban el aire como un ventilador eléctrico. [...] La policía lo derribó como un traje sin hombre. Sebastián se paralizó. Escuchó sólo el rat-rat-rat de la ametralladora.380 Dans cette description, les précisions numériques révèlent que, progressivement, les policiers sont aussi nombreux que les manifestants qui réclament le départ du dictateur. Mais la position de force de la police ne fait aucun doute et sa réponse impitoyable ne tarde pas à venir. Armés de mitraillettes, les policiers de Batista ripostent en tuant sur-le-champ un des manifestants. La sauvagerie de la police déshumanise, tout d‟abord, cet étudiant qui devient la cible d‟un sinistre balltrap (« como un ventilador eléctrico », « como un traje sin hombre »). Puis ce sont les policiers eux-mêmes qui sont déshumanisés à leur tour, n‟étant plus que le bruit de leur mitraillette (« [Sebastián] Escuchó sólo el rat-rat-rat de la ametralladora »). On le voit, que ce soit sous Machado ou sous Batista, l‟université de La Havane (la fameuse « Upsalón » de Paradiso) est le lieu de la contestation. C‟est de là que naissent les manifestations qui s‟étendent ensuite à toute la ville, répandant le chaos et la panique. La ville devient la scène d‟une véritable guerre, comme le suggère Severo Sarduy dans Gestos. Dans 379 380 Roberto González Echevarría, La ruta de Severo Sarduy, Hanovre, Ediciones del Norte, 1987, p. 78. Edmundo Desnoes, No hay problema, La Havane, Ediciones Revolución, 1961, p. 68, 69. 143 ce roman, les bombes explosent dans toute la ville provoquant l‟affolement et l‟épouvante des citadins traqués en permanence par les patrouilles de police : La explosión seca vibra aún en los oídos, mueve aún la lámpara, los cuadros, los cristales del aparador ; la luz pestañea todavía. De un golpe las ventanas se han cerrado dejando caer pedazos de vidrio [...]. Por las escaleras interiores del edificio la gente corre, se desplaza en bloques entre gritos, voces, llantos de niños, hasta el vestíbulo, a la calle. En tumulto. Después un silencio lo devora todo. Se van arremolinando ; se forma una espiral que crece lentamente. Desde las esquinas y los edificios vecinos corren, se agolpan a la puerta, preguntan. Corren, se agolpan a la puerta, preguntan ; después entran en el silencio que se espera y escapan en desorden, en desorden.381 Le désordre et la panique sont palpables dans l‟écriture même de Sarduy : rythme rapide et entrecoupé des phrases, propositions qui se succèdent en asyndète, accumulation de verbes d‟action qui marquent le mouvement (« corre », « se desplaza », « se van arremolinando », « se agolpan », « escapan »), répétitions quasi frénétiques (« corren, se agolpan a la puerta, preguntan. Corren, se agolpan a la puerta, preguntan »). Le fond et la forme concourent à rendre la tension extrême qui caractérise cette période, et l‟on peut dire avec Ernesto Méndez y Soto que : « [...] el relato refleja no sólo el ambiente de la ciudad habanera, sino el mundo incoherente de gestos y gesticulaciones en el cual la vida carece de propósito, si es que alguna vez ha tenido alguno en la capital habanera »382. Si d‟après le critique, c‟est l‟absurdité de l‟existence qui est mise en lumière dans ce récit, la détresse du peuple, qui transparaît dans des actes terroristes désespérés, n‟en est pas pour autant absente. Le personnage de la chanteuse noire, qui finit par répondre aux exigences de son amant en posant une bombe dans une centrale électrique, est un exemple paradigmatique du désespoir populaire. Mais La Havane de Batista n‟est pas seulement l‟espace de la répression, de la traque et du danger. C‟est aussi la ville de la frivolité et du divertissement, celle de Tres tristes tigres, par exemple, roman qui passe d‟ailleurs complètement sous silence le contexte politique de l‟époque et dont nous ne parlerons donc pas ici. On remarque que lorsqu‟elle est envisagée sous cet angle, la capitale des années cinquante se caractérise par ce qui, historiquement, va aussi changer son aspect : la mafia, les grands hôtels, les casinos, en somme, tout ce qui faisait de la capitale cubaine et de Cuba, « l‟arrière-cour » des Etats-Unis. C‟est sans doute Alejo Carpentier qui dresse un des portraits les plus intéressants de cette Havane, dans La 381 Severo Sarduy, Gestos (1963), Barcelone, Editorial Seix Barral, 1973, p. 38. Ernesto Méndez y Soto, Panorama de la novela cubana de la Revolución (1959-1970), Miami, Ediciones Universal, 1977, P. 205. 382 144 consagración de la primavera383. Vera, accepte la proposition de son ami José Antonio et fête la réussite de son ballet à l‟hôtel Riviera. Le luxe, les lumières, l‟ambiance du casino sont précisément décrits et correspondent à ce que José Antonio appelle le style « Lucky Luciano », du nom du célèbre mafioso. L‟hôtel Capri, quant à lui, a le style d‟un autre gangster, Frank Costello, ce qui ressemble, d‟après José Antonio, à « un invalorable mixto de maffia y Hollywood Ŕ como quien dijera : paso del románico al gótico »384. Et le personnage de poursuivre sa comparaison ironique entre les styles des deux hôtels comme si les deux mafiosi étaient des architectes s‟inspirant des grands mouvements préexistants : « El estilo Lucky Luciano es más flamígero. El de la familia Costello-Raft, es más misterioso y más soterrado, se sitúa más cerca de El Ángel azul, Caligari y el expresionismo alemán… »385. José Antonio oppose le style ostentatoire du casino de l‟hôtel Riviera à celui, plus discret, de l‟hôtel Capri en s‟appuyant une fois de plus sur une comparaison esthétique, non dénuée d‟ironie. Laissant l‟architecture de côté, il convoque, cette fois, le cinéma allemand expressionniste pour expliquer en quoi consiste précisément le style des Castello-Raft. Mais même s‟il essaye de tourner en dérision ces groupes mafieux qui contrôlent la ville, José Antonio n‟en est pas moins amer quand il fait le bilan de ce qu‟est devenue La Havane. Symbole du vice et de la corruption, pour lui, elle n‟est plus que : « una Metrópoli del Juego, muy superior, en incitaciones, ofrecimientos y posibilidades, a la rutilante sentina de Las Vegas »386. Finalement, ce portrait très critique que José Antonio fait de La Havane le conduit à faire un bilan de la République : « A esto hemos llegado al cabo de cincuenta y cinco años de burguesía cubana en el poder. ¡ Tal es hoy la « fermosa tierra » que pintara Colón a los Reyes Católicos !... »387. Ce constat désenchanté, loin d‟être anecdotique, marque une étape dans le roman : les considérations de José Antonio permettent de clore l‟époque républicaine et d‟envisager le début de la lutte des barbudos dans la Sierra Maestra puis la Révolution castriste comme un tournant historique sans précédent388. C‟est que cette nouvelle période bouleverse complètement l‟histoire cubaine mais aussi l‟échiquier politique international. Les années soixante vont donc être naturellement un autre 383 On retrouve cette ambiance crapuleuse dans Son de almendra, de Mayra Montero, où La Havane sert de décor aux comptes-rendus entre mafiosi (Meyer Lansky) qui s‟entretuent pour contrôler les casinos de la ville. 384 Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, op. cit., p. 576, 577. 385 Ibid., p. 577. 386 Ibid., p. 580. 387 Ibid., p. 581. 388 Il est intéressant de constater que, malgré son attachement à la Révolution, Carpentier n‟a jamais dépeint, dans ses romans, la ville révolutionnaire. La Consagración de la primavera s‟arrête justement en 1961, après l‟avènement de la Révolution. 145 référent temporel important pour notre travail car elles marqueront, elles aussi, l‟espace urbain. La ville va être le témoin de ce changement historique majeur, comme le suggère de manière tout à fait allégorique Severo Sarduy dans la troisième partie de De donde son los cantantes (1967). Bien que cette description ne prétende pas s‟inscrire dans le réel, puisque l‟auteur y évoque l‟entrée du Christ à La Havane et transforme la ville à sa guise, elle renvoie cependant de manière évidente à l‟arrivée de Fidel Castro dans la capitale, en janvier 1959, devant une foule exagérément fervente389. Pour trouver une évocation plus réaliste et plus historique de cet événement, il nous faut sans doute nous tourner une fois de plus vers La consagración de la primavera. On le sait, Carpentier s‟appuie, entre autres choses, sur les journaux de l‟époque pour décrire fidèlement les événements qui transforment la ville390. A travers le personnage d‟Enrique, qui retourne à Cuba en octobre 1959, le lecteur appréhende ces transformations de l‟intérieur et vit l‟Histoire au rythme des différents personnages. Alors qu‟il est toujours au Venezuela, Enrique apprend par les journaux que la population havanaise a mis à sac les salles de jeux de la capitale, symboles de la dépravation : [...] el pueblo de La Habana se había arrojado a las calles, espontáneamente, para destruir todas las casas de juego de la ciudad. A hachazos, a mandarriazos, se habían roto las mesas de los números y los tapetes verdes ; por el suelo se habían esparcido las ruletas, cubiletes de dados, y fichas de coimes. En horas quedaron destruidos los dominios proconsulares de Lucky Luciano, Frank Costello y sus familias mafiosas, con grandes hogueras callejeras donde se consumían los últimos naipes, taburetes de dealers [...]. Ŕ « Algo nuevo hay en mi ciudad », dije, leyendo y releyendo los periódicos [...].391 Faisant écho à l‟extrait décrivant les grands hôtels, cité précédemment, ce passage marque le premier changement perceptible dans la ville. Comme le dit le narrateur, l‟époque des mafiosi tout-puissants, qui tels des consuls régissaient l‟Île, est révolue : leurs casinos sont détruits avec une violence extraordinaire (« A hachazos, a mandarriazos », « grandes hogueras callejeras »). Et ce sont tous les symboles du jeu (« las mesas de los números », « los tapetes verdes », « las ruletas », « dados », « fichas », « naipes ») qui sont brisés ou brûlés et disparaissent un à un. Enrique remarque que ces premiers jours de Révolution s‟accompagnent d‟émeutes populaires, très violentes, qui vont radicalement transformer la physionomie de La Havane. Ce « quelque chose de nouveau », dont il parle, se fera plus concret quand il retournera dans sa ville natale : l‟égalité entre les Blancs et les Noirs, 389 Severo Sarduy, De donde son los cantantes (1967), Madrid, Cátedra, 2005, p. 223-227. Pour plus d‟informations sur les sources de l‟auteur dans ce roman, voir l‟introduction de Julio Rodrìguez Puértolas, in Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, op. cit., p. 40-50. 391 Ibid., p. 703. 390 146 l‟absence d‟annonces publicitaires392 puis la nationalisation des banques393 sont les signes les plus probants de ce changement. Ce qui est pour certains « la fin du monde »394, semble être, en revanche, pour Enrique le début d‟une nouvelle ère, une renaissance pour tout un peuple : « Aquí hay un pueblo que no tenía fe en nada y hoy cree en algo »395, dit-il pour résumer l‟enthousiasme des Havanais. On le voit, la ville chez Carpentier n‟est pas un simple décor mis au service de la trame romanesque, elle n‟est pas spectatrice des événements historiques mais révèle, au contraire, l‟Histoire car elle porte en elle les marques du tournant politique radical et des nouvelles réalités sociales qui surviennent396. Edmundo Desnoes s‟est lui aussi attaché à redéfinir la ville révolutionnaire dans deux de ses œuvres : tout d‟abord de manière très superficielle dans El cataclismo397, paru en 1965, puis de façon plus appuyée dans Memorias del subdesarrollo, publié la même année. Le personnage protagoniste de ce roman, dont il a déjà été question, est un petit-bourgeois solitaire dont la femme est partie vivre aux Etats-Unis. Dépossédé de ses biens par la Révolution, il choisit malgré tout de rester à Cuba mais se replie sur lui-même en essayant de s‟adapter au changement de politique. Desnoes construit, en somme, un anti-héros nihiliste qui, en témoin de son temps, observe les évolutions de sa ville avec perplexité. Les changements idéologiques qui s‟imposaient déjà dans le quartier du Vedado, comme nous l‟avons vu auparavant, transforment à présent la ville entière : La Habana parece ahora una ciudad del interior : Pinar del Río, Artemisa o Matanzas. Ya no parece el París del Caribe, como decían los turistas y las putas. Ahora parece más bien una capital de Centroamérica, una de esas ciudades muertas y subdesarrolladas, como Tegucigalpa o San Salvador o Managua. No es sólo porque destruyeron El Encanto y hay pocas cosas buenas en las tiendas, pocos artículos de consumo de calidad. Es la gente también, ahora toda la gente que se ve por las calles es humilde, viste mal, compra todo lo que ve aunque no le haga falta. Ahora tienen un poco de dinero y lo gastan en cualquier cosa ; pagan, por mi madre, hasta veinte pesos por un orinal si se lo ponen en una vidriera. Se ve que nunca han tenido nada 392 Ibid., p. 707-709. Ibid., p. 723. 394 Ibid., p. 715. 395 Ibid. p. 719. 396 Chez l‟écrivain contemporain Antonio José Ponte, cette transformation de la ville revêt un tout autre caractère. Elle marque le début d‟une guerre qui transformera la ville en champ de bataille : « Recién triunfada la revolución de 1959 fue cerrado el teatro Shanghai y prohibida la prostitución. Las salas de juego fueron desvalijadas […]. El Sloppy Joe‟s y otros bares bajaron las cortinas metálicas para transformarse en ruinas. […] Y La Habana fue declarada campo de una guerra que durarìa décadas. […] La capital cubana empezñ a vivir bajo un más o menos flexible toque de queda », Antonio José Ponte, La fiesta vigilada, op. cit., p. 66. 397 Dans ce roman, qui a pour bormes historiques juillet 1960 et avril 1961, seule la substitution des bateaux et des marins américains par des navires tchèques fait état des évolutions qui apparaissent concrètement dans la ville après l‟avènement de la Révolution. Voir : Edmundo Desnoes, El cataclismo, La Havane, Ediciones R, 1965, p. 11-14. 393 147 bueno. Todas las mujeres parecen criadas y todos los hombres obreros. No todas y todos, casi todas y todos.398 Dans une description qui oppose le passé au présent, le narrateur montre que le sousdéveloppement gagne la capitale et lui donne des allures de bourgade provinciale. La répétition de l‟adverbe « ahora » accentue le contraste entre La Havane d‟antan (« el París del Caribe ») et la ville révolutionnaire. Les plus riches ayant majoritairement quitté le pays, seuls les plus pauvres peuplent les rues et les boutiques. La médiocrité et l‟indigence caractérisent donc la ville du début des années soixante399. Dans l‟adaptation filmique de Tomás Gutiérrez Alea, les images de La Havane prennent à ce propos tout leur sens : le réalisateur filme la ville en la mettant à distance comme pour mieux signifier que le protagoniste, Sergio Carmona, est un observateur en marge qui ne fait que traverser le paysage urbain 400. L‟extrait qui vient d‟être cité montre bien que Memorias del subdesarrollo devient une « véritable radiographie du regret »401 et que le personnage observe, constate et déplore la situation actuelle sans jamais s‟impliquer ni s‟engager vraiment alors que son pays traverse un moment crucial. Cela est manifeste lorsqu‟éclate la crise des fusées en octobre 1962. Face au risque d‟une troisième guerre mondiale ou d‟une attaque fulgurante des Etats-Unis, le personnage anonyme est alors hanté par la peur de mourir : Salí, regresé. No soporto la casa ni la calle [...]. Caminé y caminé, y de pronto sentí un rugido que se cercaba por el ancho malecón. El rugido parecía llenar toda la ciudad. Empezaron a pasar tanques, camiones remolcando cañones, bultos muchas veces incomprensibles y una larga rastra, casi interminable, una oscura lona cubriéndolo todo, algo grande. Se me aflojaron las piernas, tenía miedo a otro arresto ; de noche por el Malecón, me acusarían de espía ; ni siquiera miraba, oía sólo el rugido.402 Puis le narrateur d‟ajouter : « Cualquier ruido me parece ya el fin del mundo [...]. Todos los ruidos son como el principio del fin. [...] Yo me veo entre las ruinas del Vedado, convertido 398 Id., Memorias del subdesarrollo, op. cit., p. 28. On le sait, Desnoes n‟est pas un écrivain de la dissidence et au moment où il publie son roman, il travaille comme fonctionnaire au Ministère de l‟Education. Il n‟établit donc pas une critique de la Révolution, au contraire, il se sert de son héros anonyme pour fustiger les préoccupations bourgeoises. Pour une analyse politique plus développée de ce roman, voir : Ernesto Méndez y Soto, Panorama de la novela cubana de la Revolución (1959-1970), Miami, Ediciones Universal, 1977, p. 183-186. 400 La scène où le personnage observe La Havane (« la ciudad de cartón » comme il dit) depuis son balcon à travers sa lunette est en cela très éloquente. Les premières images de la ville sont filmées à travers une longuevue qui sert indéniablement de filtre entre le protagoniste et la réalité environnante. 401 José Antonio Portuondo, Historia de la literatura cubana. Tomo III. La Revolución (1959-1988), op. cit., p. 218. C‟est nous qui traduisons. 402 Ibid., p. 145. 399 148 en vapor »403. La tension extrême provoquée par cette crise des missiles est visible dans les rues de la ville : l‟importante présence militaire, le défilé d‟engins de guerre et la suspicion généralisée rappellent au protagoniste qu‟une guerre peut éclater à tout moment. Mais tout tourne autour de sa peur et de sa mort éventuelle, comme le prouve la multiplication des verbes conjugués à la première personne du singulier. Pour le personnage, les circonstances historiques ne semblent pas avoir d‟autre portée que les craintes qu‟elles génèrent sur sa propre personne et c‟est comme si l‟histoire individuelle masquait l‟Histoire du pays. La paupérisation de la capitale est également ce qui frappe le personnage de Guillermo, dans le récit fortement autobiographique Mapa dibujado por un espía, de Cabrera Infante. Cette œuvre, publiée à titre posthume, relate le dernier voyage qu‟effectua l‟auteur à Cuba, en 1965. Ayant quitté La Havane pour Bruxelles, en 1962, l‟écrivain n‟avait pas revu la cité caribéenne depuis trois ans. A son retour, il découvre une ville appauvrie, où le rationnement, les pénuries, le marché noir et le délabrement commencent à transformer l‟univers urbain : Siguieron Obispo abajo y notó la depauperación de la calle. Todo estaba como lleno de polvos y telarañas : un lugar donde no hubiera habido actividad en mucho tiempo. […] Sus pasos resonaban sobre la acera y por un momento le pareció que caminaba por un pueblo fantasma en el Oeste del cine. […] Llegaron a una esquina […] habìa un edificio derruido y esto le asombró por un momento. Luego encontraron otras ruinas y su asombro momentáneo dio lugar al sentimiento de finalidad, de término de cosa que se acaba.404 Le personnage est surpris de voir que la vieille ville, laissée à l‟abandon, est devenue un quartier fantôme où les immeubles en ruines se multiplient. La distance avec laquelle il observe la capitale lui permet d‟interpréter les changements de manière plus profonde : il y voit la fin d‟un cycle. Et, comme le personnage de Desnoes, Guillermo assiste à ce qu‟il considère être le sous-développement de La Havane. C‟est tout du moins ainsi qu‟il explique la substitution, dans les jardins, des arbres d‟ornement par des arbres fruitiers : Los vecinos se ayudaban con los posibles plátanos para remediar la pobre dieta obligada por el racionamiento. Este descubrimiento Ŕ plátanos en el lugar de las rosas Ŕ lo pertubó y no supo, al principio, por qué. Luego, pensando, descubrió que era el subdesarrollo de la idea lo que le molestaba : La Habana regresaba al campo y era como estar en su pueblo natal, miserable […]. Ahora la ciudad, su ciudad, regresaba al pueblo pobre, al campo en viaje de visible retroceso.405 403 Ibid., p. 151. Guillermo Cabrera Infante, Mapa dibujado por un espía, Barcelone, Galaxia Gutenberg, « Círculo de Lectores », 2013, p. 94, 95. 405 Ibid., p. 159. 404 149 La ville se « ruralise » et prend des airs de village, à telle enseigne que le personnage a l‟impression de retrouver son bourg natal, abandonné en 1941. Le narrateur insiste d‟ailleurs sur le processus de recul provoqué par la pauvreté (« subdesarrollo », « regresaba », « retroceso »). Ce retour en arrière que le protagoniste déplore marque la perte de quelque chose qui lui est cher, comme l‟indique l‟adjectif possessif présent dans l‟expression « su ciudad ». Mais la ville révolutionnaire n‟est pas que pauvreté et tensions extrêmes et, pour nuancer ce regard pessimiste, on pourrait citer les paroles d‟un personnage de Jesús Díaz, dans Las palabras perdidas : No se puede, hoy por hoy, escribir sobre La Habana sin tener en cuenta lo que la revoluciñn ha hecho por ella… ¿ No se erradicaron los barrios insalubres ? ¿ Y las zonas de tolerancia ? Esta puñetera ciudad era un gran prostíbulo, y algo más, un garito, y si no hubiera sido por la revoluciñn…406 Ce que le directeur de journal rappelle au personnage de El Flaco, c‟est que la ville et la Révolution sont devenues indissociables tant cette dernière a façonné une nouvelle cité, conforme, en théorie, aux idées révolutionnaires. En théorie seulement puisque l‟on sait que les quartiers insalubres et la prostitution n‟ont jamais pu être extirpés de la ville. Quoi qu‟il en soit, on voit bien que l‟étape révolutionnaire a eu un impact important sur la physionomie de la capitale cubaine, non pas d‟un point de vue architectural mais plutôt social. Si Machado et Batista avaient changé l‟aspect de la capitale en faisant construire, par exemple, le Capitole (achevé en 1929) ou de grands buildings dans le Vedado (années cinquante), la Révolution, elle, semble avoir voulu changer intrinsèquement la ville. Bien sûr, La Havane révolutionnaire est aussi celle de la persécution, des interdits, de la répression, celle que Reinaldo Arenas a dépeinte dans Antes que anochezca (1992) ou dans « Final de un cuento » où l‟on peut lire : [...] una ciudad de balcones apuntalados y un millón de ojos que te vigilan, una ciudad de árboles talados, de palmares exportados, de tuberías sin agua, de heladerías sin helados, de mercados sin mercancías, de baños clausurados, de playas prohibidas, de cloacas que se desparraman, de apagones incesantes, de cárceles que se reproducen, de guaguas que no pasan, de leyes que reducen la vida a un crimen, una ciudad con todas las calamidades que esas calamidades conllevan…407 406 Jesús Díaz, Las palabras perdidas, op. cit., p. 333. Reinaldo Arenas, « Final de un cuento », in Adiós a mamá (de La Habana a Nueva York) (1996), Barcelone, Altera, 2000, p. 158, 159. 407 150 Dans cette longue énumération des pénuries (qui caractérisent déjà la ville avant la période spéciale) et des interdits, Arenas montre à quel point La Havane est une ville impossible : on y manque de tout (comme le rappelle la répétition de la préposition « sin ») et on ne peut rien y faire puisque tout est un crime. L‟idée d‟une cité frappée par de multiples châtiments point déjà mais nous aurons l‟occasion d‟y revenir, aussi nous n‟insisterons pas davantage sur cet aspect. Tout comme nous laissons pour plus tard l‟étude de l‟autre grand événement historique qui va profondément marquer la ville révolutionnaire : « la période spéciale en temps de paix ». Cette étape qui va suivre la chute de l‟Union Soviétique à la fin des années quatre-vingt et la crise aiguë que va alors connaître Cuba vont être amplement décrites dans les romans qui vont une nouvelle fois faire émerger l‟espace urbain. Ce que la critique appellera « la littérature du désenchantement » trouvera dans la ville le décor idéal pour dépeindre la misère quotidienne et la crise morale qui caractérisent cette période. Le marasme économique, les pénuries et les difficultés sont évoqués tandis que la ville en ruines devient un leitmotiv littéraire qui matérialise la désillusion. L‟esthétique des ruines va à ce point marquer la littérature des années quatre-vingt-dix que nous y consacrerons une partie ultérieurement. Nous n‟allons donc pas nous étendre davantage sur cette période d‟autant plus que la période spéciale dans la littérature n‟est pas tant une étape historique précise qu‟un contexte socio-économique diffus qui sert encore de « chronotope » aux récits publiés en ce début de XXIème siècle. Passer en revue, et de manière chronologique, les différentes périodes historiques qui ont marqué plus ou moins profondément la ville permet de dégager des temps forts qui ne correspondent pas toujours aux grands bouleversements passés. Certains événements sont évoqués à l‟envi quand d‟autres, tout aussi importants, semblent n‟avoir presque aucune incidence sur la capitale. Car, envisagée à travers le prisme des représentations littéraires de la ville, l‟histoire du pays ne peut se réécrire que partiellement. Il en va de même pour la représentation de la société havanaise : les romans de notre corpus dressent des portaits plus ou moins précis et plus ou moins complets d‟une époque. 151 2- L‟espace social a- Évolutions urbanistiques et ségrégations spatiales La ville est témoin de son histoire mais aussi de son époque. La société et les mœurs apparaissent dans les romans qui constituent alors autant de cartes sociales de la ville. S‟il était nécessaire, dans un souci de cohérence, de suivre le déroulement chronologique des événements dans la partie précédente, afin de voir quelles étaient les étapes qui bénéficiaient d‟une attention particulière, nous nous attacherons ici à regrouper thématiquement les caractéristiques de la société cubaine au fil des siècles. Malgré les tumultes de l‟histoire et les bouleversements qu‟ils ont engendrés, des constantes se dégagent très clairement ; et nous avons préféré à l‟exhaustivité une étude thématique à l‟intérieur de laquelle l‟évolution chronologique prend tout son sens. Bien sûr ces éléments caractéristiques ne sont pas l‟apanage de La Havane ou de Cuba mais nous ne pourrions les omettre dans notre analyse des représentations de la ville sous prétexte que certains sont des lieux communs. Ainsi, l‟image d‟une société très hiérarchisée socialement parlant n‟est pas propre à la capitale ni au pays mais elle se dessine de façon très nette dans les romans de notre corpus. Elle apparaît clairement Ŕ mais il ne pouvait en aller autrement Ŕ au XIXème siècle, durant l‟étape coloniale, mais pas seulement : nous le verrons, même le projet socialiste de la Révolution cubaine a, en partie, échoué dans sa tentative de niveler la société. A ce propos, l‟évolution historique de La Havane mérite que l‟on s‟y intéresse car elle va façonner des ségrégations spatiales. Dès le XIXème siècle, la ville est l‟espace que doivent se partager différents groupes sociaux, qui, à l‟époque, avec l‟esclavage, correspondent aussi à différents groupes ethniques408. On l‟a vu, les quartiers évoluent socialement et ces changements apparaissent aussi dans la littérature mais pas toujours de manière concomitante. La Habana Vieja coloniale (intra-muros) est le quartier de la bourgeoisie cubaine : elle y travaille, s‟y promène en calèche (le long des avenues arborées), fréquente les théâtres et les cafés. La ville est une scène où l‟aristocratie se montre, comme l‟a fort bien décrit la Comtesse Merlin : 408 A ce sujet, la Comtesse Merlin écrit : « Il n‟y a pas de peuple à La Havane, il n‟y a que des maîtres et des esclaves. Les premiers se divisent en deux classes : la noblesse propriétaire et la bourgeoisie commerçante », La Comtesse Merlin, La Havane, Tome I, op. cit., p. 347. 152 Dès six heures, tous les quitrins attendent aux portes ; les dames coiffées en cheveux, des fleurs naturelles sur la tête, les hommes en habit habillé, cravate, gilet et pantalon blancs. Tous, dans une parfaite tenue de recherche et de fraîcheur, montent en voiture, chacun seul dans la sienne, et l‟on se rend à la promenade Tacon. Dans ces belles allées, que le soleil couchant fait resplendir, personne ne se promène à pied : on ne marche pas ici, autant par indolence que par orgueil. De tous côtés glisse la volante, si digne de son nom, et dont la capote renversée laisse apercevoir la voluptueuse et rieuse Havanaise nonchalamment étendue, et jouissant du souffle léger de la brise.409 Parée de ses plus beaux atours, l‟aristocratie havanaise se promène en calèche le long de la promenade Tacón. Ce rendez-vous incontournable de la haute société est aussi l‟occasion de parader en faisant montre de sa richesse. On remarquera au passage que le simple fait de ne pas marcher et de se déplacer en calèche constitue déjà une marque de distinction sociale. La vieille ville, en fin d‟après-midi, prend alors une tout autre allure : l‟agitation des travailleurs et l‟effervescence des commerçants laissent place à des occupations plus raffinées (promenades et concerts). María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo poursuit ainsi sa description : En revenant de la promenade on entend déjà retentir les sons de la musique militaire : les quitrins se portent en foule vers la place d‟Armes, où le concert a lieu. Les beaux palais du général et de l‟intendant, le brillant éclairage de la place, l‟air d‟élégance et de propreté répandu partout, ces voitures si bien vernies, si luisantes, tout respire un parfum de distinction aristocratique générale dont les autres régions du globe ne vous offriraient pas d‟exemples [...] ; ici nous n‟avons pas de peuple ni de misère.410 Cette description laudative de la place d‟Armes, devenue scène de spectacle le temps d‟une fanfare militaire, montre que la bourgeoisie havanaise se réapproprie une partie de l‟espace urbain. Cette place, qui en journée brasse les populations411, se voit vidée de sa composante populaire en fin d‟après-midi, et c‟est comme si, n‟étant plus visible, la pauvreté n‟existait plus. De manière surprenante, la Comtesse Merlin semble, en effet, signifier que La Havane n‟a pas de pauvres. Mais c‟est qu‟en réalité, ces derniers ne se mélangent pas à l‟aristocratie car le territoire urbain est segmenté. A l‟époque, comme nous avons déjà eu l‟occasion de le voir, les quartiers populaires sont situés hors les murs, dans les faubourgs alentour et n‟apparaissent d‟ailleurs que très peu dans la littérature. Mais cela ne signifie pas que les classes populaires sont absentes de la vieille ville. Contrairement à ce que semble établir 409 Id., La Havane (1844), Tome III, Paris, Indigo et Côté-femmes, 2003, p. 62. Ibid., p. 62, 63. 411 « A aquella hora [el palacio del Capitán General en la plaza de Armas] estaba lleno de gente no por cierto del mejor pelaje, aunque no podía calificársele, en general, como de la clase del pueblo bajo de Cuba », Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 281. 410 153 l‟écrivaine, le quartier historique est aussi un espace mixte, et c‟est là toute sa particularité. On sait que Cecilia Valdés et Leonardo Gamboa, dans le roman de Villaverde, évoluent tous deux dans la même zone, empruntent les mêmes rues, traversent les mêmes places, bien qu‟ils ne fréquentent pas, c‟est vrai, les mêmes endroits. Les lieux de divertissement (les bals, par exemple) ne sont pas les mêmes car le quartier est socialement et ethniquement fragmenté, nous y reviendrons un peu plus loin. Si nous poursuivons notre étude chronologique de l‟urbanisme, nous constatons que si durant la première moitié du XIXème siècle, le cœur historique de la ville réunit encore plusieurs classes sociales, durant la deuxième moitié du siècle, les différences spatiales vont mieux se définir et de nouveaux quartiers, créés pour l‟oligarchie sucrière qui ne peut plus rester dans la vieille ville à cause de l‟explosion démographique et du manque de commodités, vont apparaître vers l‟ouest et le sud412. La ville s‟étend hors des murailles, qui sont détruites en 1863 car elles n‟ont plus d‟utilité. Cette division du territoire s‟accentuera à la fin des Guerres d‟Indépendance, à partir de l‟occupation des Etats-Unis (entre 1898 et 1902) et de la modernisation des infrastructures. L‟abandon de la vieille ville par les classes aisées s‟intensifie et plusieurs espaces sociaux que l‟on pourrait schématiser ainsi se dessinent : la petite bourgeoisie s‟installe vers le sud-est (la Víbora et Lawton413), la haute bourgeoisie, quant à elle, s‟installe à l‟ouest (Vedado et Miramar414), tandis que les classes populaires restent soit dans La Habana Vieja, soit dans les quartiers de Jesús María et Cayo Hueso. La ville moderne, qui ne partage en rien l‟architecture coloniale de la vieille ville, continue son développement et sa transformation durant toute la République recevant ça et là des influences européennes ou nord-américaines415. Aux plans urbanistiques développés par le Français Jean-Claude Nicolas Forestier (1925-1930) s‟ajoutent aussi des constructions diverses qui changent définitivement l‟aspect de la capitale : le Palais Présidentiel (1919), le Capitole (1929), de nombreux hôtels (l‟Hôtel National en 1930, par exemple), des parcs et des 412 Ce développement territorial sera en partie planifié par Antonio María de la Torre (entre 1817 et 1819) puis il s‟organisera autour d‟une série de lois urbanistiques (en 1861 et 1881) qui auront pour but de réglementer les projets de construction. 413 Lawton deviendra plus tard : « una de las barriadas más pobres de la ciudad [...] », Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 22. 414 Le quartier de Miramar, créé en 1911, connut son essor à partir de 1918. 415 Pour Alejo Carpentier, ce mélange de styles est devenu le style architectural propre à La Havane : « La vieja ciudad, antaño llamada intramuros, es ciudad en sombras, hecha para la explotación de las sombras Ŕ sombra, ella misma, cuando se la piensa en contraste con todo lo que fue germinando, creciendo, hacia el Oeste, desde los comienzos de este siglo, en que la superposición de estilos, la innovación de estilos, buenos y malos, más malos que buenos, fueron creando a La Habana ese estilo sin estilo que a la larga, por proceso de simbiosis, de amalgama, se erige en un barroquismo peculiar que hace las veces de estilo, inscribiéndose en la historia de los comportamientos urbanísticos », Alejo Carpentier, La ciudad de las columnas (1970), op. cit., p. 13, 14. 154 avenues416. La phase prérévolutionnaire des années cinquante est marquée, outre par la construction de buildings et la multiplication des casinos, cabarets, bars et night-clubs, par la spéculation et l‟investissement de la bourgeoisie dans l‟immobilier (surtout dans le Vedado, Miramar et Country Club)417. On l‟aura compris, cette expansion et cette transformation urbaines, qui divisent un peu plus le territoire, concernent uniquement les classes très favorisées, c‟est-à-dire celles qui peuvent s‟acheter une maison dans le Vedado, une villa dans Miramar ou une propriété au Country Club. Sans répéter ce que nous avons dit dans notre troisième chapitre au sujet du caractère résidentiel et luxueux du Vedado, soulignons simplement que ces quartiers matérialisent la ségrégation spatiale de la ville et qu‟ils sont toujours considérés aujourd‟hui, malgré les changements survenus avec la Révolution, comme des quartiers favorisés. C‟est surtout vrai pour Miramar qui reste un lieu d‟exception, comme l‟explique Pedro Juan Gutiérrez : Salimos hacia el oeste, por Quinta Avenida, en Miramar, el barrio de lujo de La Habana. Aquí están las residencias de los diplomáticos, algunas embajadas, oficinas de negocios. Hay jardines bien cuidados a lo largo de unos ocho kilómetros o un poco más, que es la extensión total de la avenida. A ambos lados, mansiones espléndidas, casi todas construidas en los años treinta, cuarenta y cincuenta. En esa época los ricos disponían hasta de un puente levadizo sobre el río Almendares, para separarse más aún del resto de la ciudad. Ya La Habana Vieja había sido invadida por gente pobre y negros. En Centro Habana funcionaba a todo trapo el barrio de Colón, la zona de putas de la ciudad [...].418 Du fait de ses résidents et des activités qui régissent le quartier, Miramar fonctionne encore à l‟heure actuelle comme une enclave. Le pont-levis, mentionné par l‟auteur, qui, autrefois séparait cette partie du reste de la ville, marque la frontière matérielle entre les espaces et ne fait qu‟accentuer la division spatiale. Et ce, d‟autant plus que, dans ce passage, Gutiérrez rappelle la situation précaire des autres quartiers. La Révolution, qui s‟était attachée à estomper les inégalités sociales et territoriales en redistribuant les logements et en mélangeant les groupes sociaux, n‟est pas tout à fait parvenue à ses objectifs. Certes, des quartiers comme le Vedado ont vu affluer les couches populaires dans les années soixante mais Miramar est resté une enclave. Vidé de ses habitants au tout début de la Révolution, le quartier est resté un temps abandonné. Plusieurs demeures ont même été pillées et détruites car il fallait reconstruire une ville plus juste, conforme aux idées marxistes de la Révolution et donc 416 On rappellera que la politique urbanistique de Machado à été très active puisqu‟il souhaitait, sans doute, manifester son pouvoir par le biais de constructions grandiloquentes. 417 Les projets architecturaux du Catalan Josep Lluís Sert marqueront aussi la ville de cette période. 418 Pedro Juan Gutiérrez, Corazón mestizo, op. cit., p. 185, 186. 155 exempte de tout signe aristocratique. Le fait est que, dans les années soixante-dix, les hauts fonctionnaires, les diplomates, les ambassadeurs, en un mot l‟élite de la société cubaine, revint vivre dans les somptueuses demeures du quartier, bouclant ainsi la boucle. Aujourd‟hui, Miramar reste donc un espace à part où le calme, l‟ordre et le luxe des villas y sont tout à fait singuliers : Es un barrio extenso, silencioso, con calles arboladas y jardines bien cuidados, con pequeñas playitas y caletas a todo lo largo de la costa. En fin, está muy bien, sólo que no tiene nada que ver con el resto de la ciudad. Vivir en Miramar, por supuesto, es el sueño dorado de muchos habaneros. El non plus ultra del lujo de vivir.419 Miramar est toujours l‟eldorado de la capitale cubaine, le quartier inaccessible pour les Havanais ordinaires, à ce point inaccessible qu‟il semble ne pas faire partie de la ville. La ségrégation spatiale n‟est plus marquée aujourd‟hui par le pont-levis, bien sûr, mais par le fleuve Almendares qui fait office de frontière naturelle entre ce quartier et le reste de la ville. Aujourd‟hui, l‟insalubrité, la misère et la saleté n‟épargnent que quelques rares zones urbaines et l‟on constate que, dans l‟indigence, on trouve également des seuils. Ainsi, les romans de Padura Fuentes mettent-ils en lumière cette gradation que l‟on a déjà pu percevoir lors du traitement des périphéries. A travers les romans policiers de l‟auteur, une nouvelle carte sociale semble se définir. Les quartiers du Vedado, du Nuevo Vedado, du Cerro et du Casino Deportivo420 fonctionnent comme des îlots autonomes, préservés un tant soit peu de la misère environnante. Ainsi, Mario Conde, devenu vendeur de livres d‟occasion, cherche la perle rare (des bibliothèques composées de livres de valeur), en sillonnant ces anciens quartiers bourgeois et en se fiant à l‟aspect des maisons : [...] el sistema de escoger las casas con « olor » se imponía en los barrios antes aristocráticos de El Vedado, Miramar y Kohly, y en algunos sectores de Santos Suárez, el Casino Deportivo y El Cerro, donde la gente, a pesar de la envolvente miseria nacional, había tratado de preservar ciertos modales cada vez más obsoletos.421 C‟est d‟ailleurs dans une maison du Vedado qu‟il découvrira la très précieuse bibliothèque des Montes de Oca et qu‟il se lancera dans une nouvelle enquête : reconstituer le passé mystérieux d‟une chanteuse de boléros, Violeta del Río. 419 Ibid., p. 188. C‟est nous qui soulignons. Voir ce que nous avons déjà dit au sujet de ce quartier dans le chapitre 3, 2c. 421 Leonardo Padura Fuentes, La neblina del ayer, Barcelone, Tusquets, 2005, p. 19. 420 156 Comme si la ville était faite de cercles concentriques, Conde va traverser des strates qui le plongent progressivement au cœur de l‟enfer havanais422. Le quartier chinois pourrait constituer la première étape de cette catabase : A pesar de algunos retoques recientes, el viejo Barrio Chino de La Habana seguía siendo el lugar sórdido y opresivo donde se arracimaron por décadas los asiáticos llegados a la isla [...] la geografía de la zona seguía exhibiendo, casi descaradamente, un deterioro furioso, al parecer imparable, que emergía desde los hoyos callejeros, desbordados de aguas pútridas, para trepar por los latones repletos de desperdicios hasta alcanzar la verticalidad de las paredes, carcomiéndolas y derribándolas en más de un caso. Aquellas viejas edificaciones de principios del siglo XX, muchas de ellas convertidas en solares donde se hacinaban varias familias, habían olvidado hacía demasiados años el posible encanto que alguna vez pudieron tener y en su decadencia irreversible ofrecían un panorama de compacta pobreza. Negros, blancos, chinos y mestizos de todas las sangres y creencias convivían allí con una miseria que no distinguía tonalidades epidérmicas y procedencias geográficas [...].423 Le quartier chinois de La Havane est, historiquement, l‟une des zones interlopes de la ville424 et sa dégradation y est encore plus manifeste qu‟ailleurs. Frappé par la surpopulation, la détérioration et le pourrissement, le Barrio Chino est plus que jamais un secteur sinistré qui a perdu tout attrait. Ce qui a sans doute changé avec la Révolution c‟est que la misère n‟épargne à présent personne : tous (Blancs, Noirs, Asiatiques) vivent dans la crasse et les décombres. Mais il semble y avoir pire que Centro Habana et son quartier chinois : les alentours du port sont, pour Padura, « el tramo más innoble de La Habana »425. L‟ancien quartier de San Isidro n‟est pas seulement laid, il est synonyme de misère et d‟abandon quasiment depuis son édification. Aussi, tant les constructions que les habitants sont marqués par une désolation et une marginalisation qui semblent inéluctables : Lo terrible era que en aquellos edificios, despojados de balcón ; de soportales y hasta de columnas visibles ; vivía gente, quizás demasiada : sus diminutos 422 A l‟image de Dante et de Virgile, dans La Divine Comédie, Mario Conde descend les cercles de l‟enfer jusqu‟à arriver au cœur de la Terre. 423 Leonardo Padura Fuentes, La neblina del ayer, op. cit., p. 138. 424 « Siempre fue un barrio jodido », dit l‟ancien policier, ibid., p. 139. Dans La cola de la serpiente, le narrateur qualifie ce quartier de « viejo tugurio de La Habana » et ajoute que c‟est : « […] un sitio mucho más degradado, casi en ruinas, asediado de basureros desbordados y delincuentes […] », Leonardo Padura Fuentes, La cola de la serpiente, Barcelone, Tusquets, 2011, p. 12-14. 425 Puis il poursuit ainsi la description de ce quartier : « [...] ni siquiera es feo, sucio, horrible, desagradable, enumeró, descartando otros adjetivos : es ajeno, concluyó [...] mientras avanzaba por la calle flanqueada de almacenes antiestéticos de la banda del mar y de edificios inhóspitos del lado de la ciudad : bloques de ladrillo y concreto levantados con la única perspectiva de su utilidad y sin la menor concesión a la belleza, se sucedían formando una muralla [...] en la que se acumulaba la basura desbordada de los tanques, donde algunos perros hurgaban con más esperanzas que posibilidades », Leonardo Padura Fuentes, Paisaje de otoño, Barcelone, Tusquets, 1998, p. 116. 157 apartamentos habían sido diseñados en función del placer rápido expendido por las prostitutas a los marineros de paso, a los obreros del puerto y a los habitantes de la ciudad que se arriesgaban a bajar aquella última frontera del viejo barrio de San Isidro, en pleno territorio apache : « los muelles », aquel sitio cargado con toda una historia de piratería moderna, vicio y perdición, aquella crónicas oscuras [...] en aquellas lagunas de un mal sin fondo. Luego, muchas de esas practicantes de sexo, redimidas moralmente y recicladas en lo social, se habían quedado a vivir en aquellos cuartones, convertidos así en casas de familias por unas ex putas que ahora tenían hijos [...] pensó en la añadida tristeza cotidiana de esas personas, atrapadas por un fatalismo urbanístico definitivamente cruel, gentes que al salir a la calle siempre debían ver ese mismo panorama oscuro y desolador [...]. No, no podía ser agradable echar la vida en aquella zona, con un cubo de agua en cada mano y aquella fealdad congénita a rastras, se dijo mientras bordeaba la antigua iglesia de Paula [...].426 Les petites habitations, autrefois destinées aux prostituées, aux marins ou aux ouvriers du port abritent aujourd‟hui la même misère sociale, comme si le quartier était marqué du sceau de la fatalité et de la prédestination. Pourtant situés dans la zone historique de la ville, les abords du port sont devenus des limbes infernaux qui seraient presque un territoire étranger (« territorio apache »). L‟idée de déterminisme urbain, qu‟il qualifie de « fatalismo urbanístico », est importante chez Padura et montre que la ville du XXème siècle est plus que jamais fragmentée. Il semble évident que, même dans La Havane socialiste Ŕ ou tout du moins dans La Havane socialiste de la période spéciale Ŕ, grandir et vivre dans tel ou tel quartier conditionne l‟être humain. Ainsi, lorsque l‟on naît au cœur de l‟enfer havanais, qui est pour Padura Fuentes le quartier d‟Atarés, situé derrière le port, aucune échappatoire ne semble possible : [...] pensó que la circunstancia de nacer, vivir y morir en aquel sitio era una de las peores loterías que podía tocarle a un ser humano. Como la que te hace nacer en Burundi o en Bombay o en una favela brasileña, en lugar de de ver la luz en Luxemburgo o Bruselas [...]. O en cualquier otro sitio amable, pero lejos de aquel barrio donde se mamaba la violencia y la frustración histórica, se crecía entre la fealdad más insultante y la degradación moral cotidiana, entre el caos y los acordes de las trompetas feroces del Apocalipsis, dispuestas entre todas a atrofiar para siempre las capacidades de discernimiento ético de una persona y convertirla en un ser primario, sólo apta para luchar y hasta matar por la supervivencia. Los olores insultantes, el paisaje de edificios devastados, los ríos urbanos de detritus humanos, [...] la respuesta agresiva como expresión de necesidades acumuladas por siglos y generaciones, convertían en condenados sin causa ni juicio a los maldecidos por el destino, hacinados en aquel lugar [...] en aquel círculo infernal.427 Des termes frappants (« violencia », « frustración », « fealdad », « degradación », « caos », etc.) et des métaphores saisissantes (« se mamaba la violencia », « los acordes de las 426 427 Ibid., p. 116, 117. C‟est nous qui soulignons. Id., La neblina del ayer, op. cit., p. 310, 311. 158 trompetas feroces del Apocalipsis », « círculo infernal ») se succèdent dans cette longue description qui se rapproche du réalisme sale par sa crudité. Nous ne commenterons pas davantage la métaphore de l‟enfer car nous aurons l‟occasion d‟y revenir. Disons simplement que tout dans ce quartier semble concourir à modeler des êtres qui n‟ont plus rien d‟humain car ils sont réduits à leur instinct animal. Ils sont « condamnés » d‟avance par les circonstances, leur quartier en l‟occurrence, qui se voit chargé d‟un pouvoir coercitif inéluctable. A la manière d‟un microcosme, ce quartier infra-populaire façonne l‟habitus de ses habitants et constitue de la sorte, un espace social discriminant. La ville est donc invariablement l‟espace de l‟inégalité et de la ségrégation. Le projet utopique révolutionnaire de créer une ville égalitaire et socialement plus juste semble avoir achoppé sur des mécanismes urbains incontrôlables qui reproduisent des fragmentions visibles également à l‟échelle de l‟habitat. b- Le traitement descriptif des habitations Les habitations, à l‟image des quartiers où elles se trouvent, portent également la marque des inégalités. Nous pouvons même ajouter qu‟il n‟y a sans doute rien de plus révélateur que l‟habitat pour définir un milieu social. La description des façades, de l‟agencement des maisons et de leur intérieur permet ainsi de situer immédiatement l‟origine sociale des personnages. A ce propos, nous avons vu avec Cecilia Valdés que, dans un souci d‟efficacité, les écrivains ne s‟attardaient sur les demeures que si elles étaient significatives dans l‟économie de l‟œuvre. Ainsi, il n‟est pas étonnant que la Comtesse Merlin s‟empresse de décrire les belles bâtisses havanaises qu‟elle voit depuis le bateau qui l‟amène d‟Europe. C‟est d‟ailleurs l‟une des toutes premières choses qui attirent son attention et qui, surtout, lui font reconnaître sa ville natale : La voilà, c‟est bien elle, avec ses balcons, ses tentes, ses terrasses ; puis ses jolies maisons bourgeoises de plain-pied, aux grandes portes cochères, aux immenses fenêtres grillées. Portes et fenêtres sont ouvertes ; tout est à jour, l‟œil pénètre jusqu‟aux intimités de la vie domestique, depuis la cour arrosée et couverte de fleurs jusqu‟au lit de la niña, dont les rideaux de linon sont garnis de nœuds roses. Ensuite viennent les maisons aristocratiques à un étage, entourées de galeries qui signalent de loin de longues rangées de persiennes vertes.428 428 La Comtesse Merlin, La Havane, Tome I, op. cit., p. 286. 159 La ville et ses maisons ne font qu‟un, comme le suggère le tout début de cette description. Ce qui surprend la Comtesse, c‟est l‟ouverture des demeures privées sur la ville : espaces intime et public se confondraient presque puisque portes et fenêtres, n‟étant pas fermées, permettent à quiconque de voir et d‟être vu. Cela permet d‟ailleurs à la narratrice de pénétrer à l‟intérieur d‟une maison bourgeoise et de décrire en détail ce qu‟elle voit. Ces demeures cossues et raffinées qu‟elle redécouvre sont le premier signe de ses retrouvailles avec La Havane et elles déclenchent un processus d‟anamnèse qui va marquer tout le récit429. Décrire les habitations insalubres des plus pauvres n‟a pas lieu d‟être dans le récit de María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo puisqu‟elle évoque le milieu aristocratique dans lequel elle évolue quand elle retourne à La Havane. D‟autres auteurs, en revanche, s‟appliquent à dépeindre différents habitats pour mieux souligner les contrastes sociaux. Dans ce cas, rares sont les entre-deux et ce n‟est pas sans manichéisme que se construisent ces descriptions. Nous avons vu précédemment, dans notre deuxième chapitre, combien les allusions aux maisons de Leonardo Gamboa et de Cecilia Valdés étaient révélatrices dans le roman de Cirilo Villaverde. Elles permettaient, en effet, d‟opposer socialement les personnages. La description de la maison de la mulâtresse Nemesia (amie de Cecilia Valdés) et de son frère José Dolores Pimienta est aussi signifiante à ce sujet : En una de éstas [casas], inmediato a la calle Aguacate, vivía Nemesia Pimienta con su hermano José Dolores, ocupando dos cuartos seguidos, cuyo mueblaje se reducía a un par de sillas, un columpio, una mesita de pino y un catre de viento, que se abría de noche y se cerraba de día, a fin de despejar el campo.430 Sans s‟attarder sur l‟intérieur de cette maison, le narrateur expose en quelques lignes l‟exiguïté et la simplicité des lieux. Comme chez Cecilia Valdés, bois noble et ornements sont totalement absents car, dans ce roman, l‟habitat permet de distinguer les Blancs, les Noirs et les mulâtres et donc de marquer un peu plus les clivages socio-ethniques qui structurent toute la trame. Nous retrouvons ce procédé différenciateur dans Un hombre de negocios et plus généralement dans les romans de composition classique du XIXème et début du XXème siècle. Dans le roman de Nicolás Heredia, il ne s‟agit pas pour le narrateur d‟opposer des groupes ethniques mais simplement des groupes sociaux. Pour mieux marquer l‟opposition entre la villa du riche 429 430 Les premiers souvenirs sont effectivement évoqués tout de suite après ce passage. Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 235. 160 don Marcelo Ordoño431, Asturien qui s‟est enrichi à Cuba, et la misérable demeure de doña Marta, qui a été sa maîtresse et dont la fille, doña Gertrudis, est née de cette union illicite, le narrateur décrit avec insistance la pauvreté du lieu : Ocuparse en describir en esa casucha, choza vergonzante, sin espacio donde colocar cómodamente un catre, húmeda y casi desprovista de muebles, sería concederle un honor que ni el mismo Zola hubiera sido capaz de discernirle. Vosotros habéis visto, por desgracia, muchas reproducciones de esos antros en que el reumatismo, la tísis y la fiebre se disputan el predominio. Una saleta, un cuarto con dos catres apiñados, tres taburetes, ninguno con el cuero en buen estado ; un sillón con una pata astillada y la pajilla llena de agujeros, una tinaja en el suelo [...] ; una mesa de pino con señales de la plancha, la cual mesa servía para todo, hasta para comer, y una botella donde se colocaba la vela de sebo ; he aquí el inventario exacto y minucioso de la vivienda y del menage de las dos mujeres, a que venimos refiriéndonos. 432 Le narrateur, qui ne veut pas s‟attarder sur la description de cette demeure en piteux état de crainte de lui concéder trop d‟importance, en dresse pourtant un portrait assez précis (« el inventario exacto y minucioso de la vivienda ») où les nombreuses énumérations participent à l‟élaboration d‟un décor misérabiliste. L‟allusion métanarrative à Zola, qui ne se serait certainement pas attardé sur ce taudis, donne à ces lignes un caractère hyperbolique que le narrateur semble assumer. Pensant aller donc plus loin que l‟écrivain naturaliste français, il se livre à une longue parenthèse descriptive de ce cloaque immonde qu‟il qualifie au moyen de termes dépréciatifs (« casucha », « choza », « antros ») et d‟ajectifs qui marquent tantôt l‟insalubrité, tantôt l‟exiguïté (« vergonzante », « húmeda », « desprovista », « apiñados »). Une fois de plus, la précision et l‟emphase avec lesquelles le narrateur présente cet intérieur ne sont pas gratuites : elles opposent et divisent les membres de la société cubaine de l‟époque de manière radicale. A la lecture de ces fragments, naît l‟image d‟une société coloniale polarisée entre les nantis d‟un côté et les pauvres de l‟autre, sans juste milieu. Mais cette polarité sociale n‟est pas l‟apanage du XIXème siècle, il en va de même au siècle suivant où les écrivains ne s‟attacheront à décrire précisément les lieux d‟habitation que s‟ils sont porteurs de sens et/ou sont la marque d‟une opposition. Ainsi, n‟est-il pas étonnant de trouver la même asymétrie dans les œuvres naturalistes de Miguel de Carrión. La description de la luxueuse villa de Graciela et Pedro Arturo, dans Las honradas, met en lumière le néoclassicisme pompeux qui caractérise les constructions du Vedado : 431 « la casa palacio [con] expléndidas habitaciones del opulento capitalista habanero », Nicolás Heredia, Un hombre de negocios, op. cit., p. 27. 432 Ibid., p. 65. 161 […] fuimos a despedirnos de Graciela y de su marido, quienes no vivìan en uno de los famosos repartos que enriquecieron a Pedro Arturo, sino en lo mejor de la calle Diecisiete, en un suntuoso palacete que éste había adquirido […]. Un parque inglés, meticulosamente limpio, sin arbusto, se extendìa […]. En el fondo […] levantaba ésta [la casa] su doble fachada gris rodeada de columnas […]. Era como si […] huyera aquella mansiñn seðorial a lo más lejano y más alto del dominio, dejando la mayor cantidad de parque posible entre ella y las expansiones plebeyas de la calle.433 La sobriété et l‟étendue du jardin rendent la demeure encore plus imposante. En personnifiant la villa (« Era como si […] huyera aquella mansión »), la narratrice montre la volonté de ses occupants de se distinguer de la plèbe. Ce sont bien eux, en effet, qui ont choisi de s‟isoler du reste de la ville en éloignant leur maison de la rue. La description de l‟intérieur, qui fait suite à ce passage, ne fait d‟ailleurs que renforcer l‟idée d‟une demeure hors du commun qui se distingue par sa magnificence. A cette construction majestueuse et écrasante s‟oppose, quelques pages plus loin, la maison où vit Teresa : Una casa antigua de la calle de Villegas, un patio embaldosado donde crecían algunas plantas en barriles pintados de verde, una vieja escalera de piedra, de peldaños gastados, […] he aquì lo que fue ofreciéndose a mi vista […]. Me pareciñ que aquella vivienda sin habitantes tenìa tristezas de monasterio y sonoridades de tumba. 434 Le luxe et la splendeur ont laissé place à la simplicité d‟une maison défraîchie que la narratrice (Victoria) compare, tout d‟abord, à un monastère, puis à un cimetière. En s‟appuyant sur leur maison, Miguel de Carrión n‟oppose rien d‟autre que la vie de ses personnages : la légèreté et l‟allégresse de Graciela, à qui tout semble sourire, sont le parfait contraire de la gravité de Teresa, personnage plus austère, fragilisé par des difficultés de tout ordre. Dans Las impuras, l‟auteur développera le portrait de Teresa, puisqu‟elle sera le personnage principal du roman, et les decriptions de cette maison. Voici ce qu‟en dit le narrateur quand Teresa, tout juste arrivée à La Havane, découvre cet endroit sinistre où son amant Rogelio lui a loué une chambre : […] el zaguán, a oscuras y desierto parecìa la boca de una caverna. […] Estaban [Rogelio y Teresa] en su casa. La entrada era fea y triste, y ambos quedaron un momento paralizados ante el desagradable aspecto de aquellas paredes, desnudas y sucias, en que se rezumaba la humedad. […] Teresa vaciló antes de avanzar un paso, sintiendo el corazón oprimido en presencia de aquella lobreguez de cueva. […] Sin ver más que esta parte del edificio, se 433 434 Miguel de Carrión, Las honradas, op. cit., p. 314. Ibid., p. 350, 351. C‟est nous qui soulignons. 162 adivinaba, pues, el resto : una profusión de habitaciones, especie de nichos la mayoría de ellas, distribuidas alrededor de una patio cuadrado, con pavimento este de grandes baldosas y adornado con viejos barriles pintados de verde […]. El piso bajo era, poco más o menos, lo mismo que el principal, y entrambos ofrecìan un conjunto de abandono y de incuria […]. 435 L‟endroit n‟est plus comparé à un monastère ou à un cimetière mais à une grotte humide et sombre. On retrouve les bidons verts qui font office de pots de fleurs, déjà évoqués précédemment par Victoria, mais le narrateur insiste ici surtout sur la promiscuité et l‟exiguïté des lieux. Les petites chambres, distribuées autour d‟un patio, se succèdent les unes aux autres dans une sinistre monotonie et l‟ensemble, laissé à l‟abandon, donne à cette maison un aspect décrépit déjà souligné auparavant. Ce passage situé au tout début du roman et qui marque, rappelons-le, l‟arrivée de Teresa à la capitale, annonce par anticipation ce que sera la vie de ce personnage une fois à La Havane. Cette maison vétuste et repoussante, qui s‟avèrera être une maison de passe où logent prostituées et étudiants, est à l‟image des déboires et de la pauvreté que va connaître Teresa à cause de son amant Rogelio. Plus loin dans le XXème siècle, pendant la période spéciale, par exemple, nous allons retrouver ce même procédé. Si, comme nous l‟avons dit précédemment, le projet castriste a échoué en partie à dessiner une ville homogène socialement parlant, les descriptions littéraires de l‟habitat vont rendre les contrastes encore plus manifestes. Les descriptions de Padura Fuentes sont en cela éclairantes car elles divisent le territoire urbain et créent des strates sociales, nous l‟avons vu. A l‟échelle de l‟habitat, ces subdivisions persistent et l‟on distingue nettement trois catégories : les demeures des nantis (Tamara et son mari Rafael Morín, dans Pasado perfecto436 ; Faustino Arayán, dans Máscaras ; ou encore Miguel Forcade Mier et Gerardo Gómez de la Peña, dans Paisaje de otoño437), celles de l‟ancienne bourgeoisie désargentée (la maison des Montes de Oca dont s‟occupent Dionisio Ferrero et sa sœur, dans La neblina del ayer) et enfin celles des plus démunis (la mère de Rafael Morín, dans Pasado perfecto ; Candito el Rojo, dans Máscaras, pour ne citer qu‟eux). Le narrateur évacuera donc toute description non connotée de sorte que le lecteur ne trouvera quasiment aucune indication concernant l‟habitat du Cubain moyen. Aussi étrange que cela puisse paraître, l‟intérieur de l‟appartement de Mario Conde n‟est jamais décrit, à l‟instar de celui de son ami El Flaco, personnage pourtant incontournable chez qui le détective se rend souvent pour savourer les mets délicieux préparés par Josefina. Mais n‟oublions pas que Padura se sert du 435 Miguel de Carrión, Las impuras, op. cit., p. 13-15 Leonardo Padura Fuentes, Pasado perfecto (1991), Barcelone, Tusquets, 2000, p. 39. 437 Id., Paisaje de otoño, op. cit., p. 56, 57. 436 163 genre policier pour créer des chroniques sociopolitiques qui dressent un tableau de la situation de l‟Île durant la période spéciale. Ce sont donc les traits saillants et marquants de cette société malmenée par les circonstances que le Conde observe en témoin distancié. Ses enquêtes l‟amènent à scruter ce qui l‟entoure, comme l‟atteste la récurrence des verbes « ver », « mirar » et « observar » dans tous les romans, et font de lui un observateur privilégié. Il traverse les strates sociales au gré de ses investigations, ce qui lui permet de souligner les disparités. Dans Máscaras, par exemple, il compare la villa de Miramar appartenant au père d‟Alexis Arayán, le jeune homosexuel retrouvé mort dans le Bois de La Havane, à la sinistre maison de l‟intellectuel Alberto Marqués, située de manière oxymorique rue Milagros, entre Delicias y Buenaventura : Las antípodas, pensñ el Conde, […] mientras observaba otra vez la casa de Faustino Arayán y la comparaba con la gruta húmeda y oscura donde vivía Alberto Marqués […]. Entre aquellos dos espacios vitales existìa un abismo, insalvable y sin puentes posibles, de estratos establecidos, intereses creados, méritos reconocidos u olvidados, favores pedidos o concedidos, oportunidades aprovechadas o no, que los alejaban y los distinguían , como la luz y las tinieblas, la pobreza y la opulencia, el dolor y la alegría.438 Les termes « antípodas », « abismo », « estratos » ou l‟expression « sin puentes posibles » opposent les deux habitats qui sont le reflet de deux existences complètement antagoniques. La réussite sociale de Faustino Arayán semble ici d‟autant plus injuste qu‟elle ne tient pas du mérite mais plutôt du hasard, ainsi que le montrent les adjectifs qui se succèdent dans un rythme binaire, rythme que l‟on retrouvera jusqu‟à la fin du fragment quand le narrateur jouera sur les antithèses pour parachever sa comparaison439. Ces romans du désenchantement ne s‟appuient pas uniquement sur les contrastes sociaux pour décrire les habitats en ruines et insalubres. Parler des maisons décrépites oblige souvent à opposer la splendeur passée au délitement actuel. Ce constraste qui confronte deux époques est récurrent, par exemple, chez les jeunes écrivains que Salvador Redonet a baptisés Posnovísimos, comme Ena Lucía Portela. Dans Cien botellas en una pared, la narratrice et 438 Id., Máscaras (1997), Barcelone, Tusquets, 2001, p. 86. C‟est nous qui soulignons. L‟auteur utilise le même procédé quand il oppose l‟origine modeste de certains de ses personnages à leur situation actuelle privilégiée. Voici la description de la maison de la mère de Rafael Morín : « La gloria y la pintura se habían olvidado hacía mucho tiempo de aquel caserón de la Calzada de Diez de Octubre, convertido en un solar ruinoso y caliente, cada estancia de la antigua mansión se transformó en casa independiente, con lavadero y baño colectivo al fondo, paredes desconchadas y escritas de generación en generación, un olor a gas imborrable y una larga tendedera muy concurrida esa maðana de domingo […]. Aquella cuartería promiscua parecía tan distante de la residencia de la calle Santa Catalina que podía pensarse que las separaban océanos y montañas, desiertos y siglos de historia. Pero en esta ribera habìa nacido Rafael Morìn […] », id., Pasado perfecto, op. cit., p. 105,106. C‟est nous qui soulignons. 439 164 protagoniste prénommée Zeta habite un solar440 situé dans un ancien petit palais du Vedado où elle habite depuis toujours : […] desde que nacì habito un palacete del Vedado que es una joya arquitectónica, un monumento a la extravagancia, un prodigio de retazos y parches y costuras, un Frankenstein ecléctico según la moda de 1926 y hecho una ruina según la moda del aðo en curso. Este palacete […] ha padecido tantas y tan brutales transformaciones a lo largo de casi un siglo, que uno se asombra de que aún permanezca en pie. Cualquier dìa se desploma […]. Por lo pronto, el techo se filtra y suelta boronilla, pedazos de estuco. He pensado en usar un casco de construcción, por si acaso, no vaya a ser que un día se me estropee el cráneo. También hay grietas en los muros. Grietas verticales, de las peligrosas. En temporada ciclónica el agua entra por todos lados (excepto la pila, claro) […]. En sus inicios, aunque parezca increìble, esta preciosidad fue la residencia de alguien con mucha plata […].441 Non sans humour et ironie, le personnage explique que cette vieille bâtisse aristocratique a été défigurée par le temps et les circonstances. Dans un va-et-vient temporel, la narratrice compare ce qu‟était le palais (« una joya arquitectónica », « esta preciosidad », « residencia de alguien con mucha plata ») à ce qu‟il est devenu. Ressemblant aujourd‟hui à un monstre architectural (« un Frankenstein ecléctico »), la demeure répond aux critères esthétiques de la période speciale (« según la moda del año en curso ») et menace bien évidemment de s‟effondrer à tout instant. L‟eau qui s‟infiltre quand il pleut, les murs lézardés et le plâtre qui tombe sont des signaux clairs d‟un effondrement annoncé. Le contraste saisissant entre ce qu‟étaient ces maisons bourgeoises au départ et ce qu‟elles sont devenues frappe également le narrateur de Los palacios distantes, d‟Abilio Estévez : Dos siglos atrás vivía en él una sola y holgada familia [...]. Ahora, por supuesto, no hay amos ni esclavos, ni habita el palacio un solo y tranquilo y espacioso clan, sino veinte, treinta, cuarenta familias hacinadas [...]. La mansión ha sido dividida en exiguos cuartos, y por tanto ya no debe llamársele palacio, sino solar, conventillo, falansterio, corralo, casa de vecindad, cuartería.442 Ce sont les solares surpeuplés que met en lumière ici le narrateur. Si au tout début ces petits palais n‟accueillaient qu‟une seule famille, ils en abritent aujourd‟hui une quarantaine. Pour souligner ce changement, le narrateur insiste sur les dénominations pour bien montrer que ces constructions n‟ont plus rien à voir avec leur passé aristocratique. Avec Françoise Moulin Civil, nous pouvons dire que ces deux descriptions « s‟appuie[nt] sur une stratégie à l‟œuvre 440 Grande maison qui a été divisée en plusieurs appartements. Ena Lucía Portela, Cien botellas en una pared, Madrid, Debate, 2002, p. 31, 32. 442 Abilio Estévez, Los palacios distantes, op. cit., p. 18 441 165 dans d‟autres textes de la période : celle de la constante confrontation entre la remémoration d‟un passé glorieux et le constat d‟une décrépitude sentie comme irréversible »443. Les romans de la période speciale décriront également la misère et l‟insalubrité des foyers sans nécessairement s‟appuyer sur un effet contrastant. En effet, chez Pedro Juan Gutiérrez, par exemple, peu importe ce qu‟était la maison autrefois, seule la déliquescence actuelle compte. Nombreuses sont les descriptions de la crasse qui envahit les appartements, de l‟eau qui s‟infiltre dans les murs mais ne sort plus des robinets ou des chasses d‟eau, des bâtiments qui s‟écroulent tels des chateaux de cartes. L‟habitat du réalisme sale est souvent petit (réduit à cause des barbacoas444), surpeuplé, en ruines et forcément abject, en témoigne l‟évocation de l‟immeuble du narrateur Pedro Juan : Fui para mi cuarto en la azotea. […] Lo jodido son los vecinos y el baðo colectivo. El baño más asqueroso del mundo, compartido por cincuenta vecinos […]. Y en el baðo la mierda llega al techo. En ese baño cagan, mean y se bañan todos los días no menos de doscientas personas. 445 Le style hyperbolique de l‟auteur montre à quel point les toilettes communes que se partagent toutes les familles de l‟immeuble sont répugnantes. A la promiscuité et exiguïté des lieux s‟ajoutent les immondices qui s‟amoncellent. Mais une autre pratique, née avec la crise, va rendre la crasse encore plus paroxystique : période spéciale oblige, familles et animaux de la ferme se partagent les lieux de vie. Dans un phénomène de « ruralisation » de la ville, cochons, poules et pigeons envahissent les solares. On élève ces bêtes, qui serviront à se nourrir, sur les toits (les azoteas)446 ou parfois même à l‟intérieur des appartements. Le roman de Ronaldo Menéndez, Las bestias, est en cela saisissant. Claudio Cañizares, professeur que deux hommes tentent d‟assassiner, élève un porc dans sa salle de bains. Lorsque le protagoniste parvient, à la fin du roman, à séquestrer chez lui l‟un des deux assassins potentiels (Bill), commence alors un huis clos anxiogène entre les deux hommes et le porc affamé. Une fois Bill dévoré par l‟animal, Claudio se retrouve prisonnier de la bête qui, 443 Françoise Moulin Civil, « La Havane brisée d‟Ena Lucìa Portela », in Les villes et la fin du XXème siècle en Amérique latine: littératures, cultures et représentations, Bern, Teresa Orecchia Havas (éd.), Peter Lang, LEIA, Vol. 9, 2007 p. 192. 444 L‟appartement du personnage Miriam constitue un bon exemple de ces habitations divisées puis subdivisées qui sont sur le point d‟imploser : « vivìa en una covacha desastrosa, oscura y con mal olor, […] en un solar en Trocadero 264. […] El cuarto era de tres por cuatro metros. Atrás tenìa un espacio mínimo para una cocina de kerosene y yo debía estar encorvado siempre, porque habían construido una tarima de madera, con una escalera, que le restaba la mitad de la altura al lugar. […] empezaron a caer piedras y polvo del techo. „Oye, ¡ esto se va a derrumbar !‟ „No. No te asustes. Eso es normal.‟ », Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 46. 445 Ibid., p. 81. 446 Caridad élève des bêtes sur sa terrasse par exemple : « La casa se les había llenado de mierda. Hacía pocos años que vivían allí pero ya apestaba a mierda de los pollos y los cerdos que criaban en la terraza », ibid., p. 21. 166 tenaillée par la faim, rôde dans l‟appartement. Au bout de plusieurs jours de lutte intense, le professeur parviendra finalement à tuer le porc, qualifié à plusieurs reprises de « máquina de devorar todo lo que no sea su propio cuerpo »447, et le mangera à son tour. L‟appartement devient donc la scène d‟une guerre sans merci où chacun essaye de sauver sa peau à coups de machette. Dans Bestias, on franchit un cap dans l‟horreur puisque la saleté n‟est rien à côté de la violence et des atrocités commises entre les murs de cet appartement. Cette analyse diachronique du traitement descriptif des habitats a mis au jour deux approches différentes : d‟une part, la description contrastée qui oppose les catégories sociales entre elles ou bien les époques (Cirilo Villaverde, Miguel de Carrión, Padura Fuentes, Ena Lucía Portela, etc.), d‟autre part, la description uniforme et homogène qui insiste sur une caractéristique (la Comtesse Merlin, Pedro Juan Gutiérrez, Ronaldo Menéndez). Dans un cas comme dans l‟autre, ces passages descriptifs sont à la fois significatifs et interprétatifs puisqu‟ils témoignent d‟une correspondance entre habitat et habitant. Ils permettent donc de mieux définir les personnages et de les catégoriser de manière immédiate et efficace. Philippe Hamon a, en effet, démontré que « l‟habitant [est] englobé par inclusion dans l‟habitat englobant » et que le lieu d‟habitation fonctionne comme un « trait distinctif » qui permettrait d‟inclure les personnages « dans un stéréotype ou dans un archétype plus englobant »448. Cette approche de l‟espace social aura permis de montrer une fois de plus que la ville est le lieu de la ségrégation et ce à des échelles différentes (quartiers et habitats). Cependant, ces oppositions internes s‟estompent et finissent par disparaître complètement dès lors que l‟on confronte la ville au reste du pays. Si l‟on ne scrute plus la ville à travers une loupe, mais, au contraire, avec une focalisation plus large, La Havane semble être un tout plus homogène. 3- Du symbole collectif aux particularismes a- La Havane : lieu de pouvoir et d’identité nationale En tant que capitale et métropole, la Havane se définit dans une dialectique particulière : elle symbolise l‟identité nationale tout en se distinguant du reste du pays. Cette dynamique contradictoire se fait jour en littérature où certaines œuvres vont insister sur le rôle emblématique de la ville quand d‟autres, au contraire, mettront en lumière les particularités 447 448 Ronaldo Menéndez, Las bestias, Madrid, Editorial Punto de Lectura, 2008, p. 121, p. 123, p. 168. Philippe Hamon, Du descriptif, op. cit., p. 108. 167 discriminantes de La Havane. Dans le premier cas, elle est conçue comme « une excroissance du palais ou du temple »449. La cité, parce qu‟elle est le lieu du pouvoir, est une capitale qui représente, par synecdoque, le pays tout entier. Ville impériale ou palatiale, pour reprendre la terminologie de Deleuze et Guattari, La Havane est un « emblème » de Cuba, à l‟instar des lieux étudiés précédemment qui constituaient des allégories de la capitale. Portant les marques de l‟autorité politique (le Capitole, le Palais Présidentiel) et religieuse (la cathédrale), La Havane est profondément liée à l‟identité nationale. Elle devient ce qu‟Anne Cauquelin a appelé une « légende urbaine » ou un « trésor mythique »450, grâce notamment aux différents monuments qui convoquent un passé national commun et grâce aux mises en scènes du pouvoir. A travers les monuments et la statuaire, on crée des lieux identitaires nationaux et historiques qui perpétuent la mémoire collective du pays : […] les monuments dressés çà et là dans la cité, dessinent à leur manière des « topoi ». Non qu‟ils servent uniquement de repères géographiques et aident le voyageur ou l‟habitant à se reconnaître sur le plan [...], mais à se reconnaître dans l‟espace-temps, dans le « lieu » même [...]. Une connexion s‟impose qui les lie entre eux et les lie à la cité, à son histoire et aux mythes qu‟ils font vivre par leur présence. Ils font la cité au point qu‟elle pourrait disparaître et que leurs seuls vestiges en diraient encore l‟existence.451 Les monuments et les statues, parce qu‟ils sont le souvenir de la ville et de la nation, ont une fonction particulière452. Témoins de la grandeur passée et présente, ils disent l‟Histoire, à telle enseigne qu‟ils constituent des lieux de mémoire, pour reprendre une expression de l‟historien Pierre Nora. Une œuvre, mettant en scène un régime dictatorial féroce, est en cela remarquable : El recurso del método (1974), d‟Alejo Carpentier. Et c‟est principalement sur elle que nous allons nous appuyer pour étudier ces symboles nationaux qui incarnent le 449 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit., p. 538. Anne Cauquelin, Essai de philosophie urbaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, p. 34. 451 Ibid., p. 105, 106. 452 On évoquera à ce sujet la description de la statue de José Martí, dans le roman de Carlos Loveira, Los inmorales. En rappellant le rôle fondamental qu‟a joué l‟homme politique dans la création de la patrie cubaine, le protagoniste, Jacinto, de retour à Cuba et profondément déçu par ce qu‟il y trouve, essaye d‟interpréter le bras tendu de la sculpture : « Llegñ a la estatua de Martì […]. Allì, a su lado, el Apñstol […] ; indigna, la ofrenda, del prócero civismo del último de los libertadores ; pobre, la artística consagración, para la gloria continental del Genio. Allí estaba, de cara al palacio de omnipotente banquero, arca de egoísmos, del concupiscente acaparar de advenedizas plutocracia […]. Antojábasele a Jacinto que aquel instante escultñrico en que el artista quiso cristalizar el gesto tribunicio, apostólico del Maestro, más bien debió ser arranque de santa ira provocada por el encanallamiento de los que trocaron la soñada patria libre, feliz y soberana, con todos y para todos, en triste orgía de desenfrenados apetitos. Cabal sería la pose, si aquel brazo estirado terminase en un látigo ; el látigo para los mercaderes del templo ; el látigo que debió cruzar el rostro de cuantos alzaron su voz y se apretujaron al pie de aquel pedestal, a mentir patriotismo, a soliviantar las masas para acometer empresas de punible servilismo […] », Carlos Loviera, Los inmorales, La Havane, Sociedad Editorial Cuba Contemporánea, 1919, p. 280. 450 168 pouvoir central. Emma Álvarez-Tabío Albo avait déjà souligné le rôle clef de ce roman dans la construction (au sens propre comme au figuré) de La Havane monumentale : Aunque Carpentier repite en su obra esta representación literal de sus construcciones textuales urbanas, es en El recurso del método donde esta operaciñn adquiere carácter paradigmático. […] esta novela constituye sobre todo, el relato de la construcción de la « ciudad monumental » que es, entre todas las encarnaciones de La Habana exploradas por Carpentier, la más perdurable, transformada en materialización física de las palabras, indisociable de la ciudad real. […] Asì como la Universidad representará la culminación de la ciudad ideal de Lezama, el Capitolio con su elevada cúpula […] constituye la apoteosis de la « ciudad monumental » construida por Carpentier.453 Même si, comme nous l‟avons dit, Carpentier ne situe pas explicitement l‟action de son roman à La Havane (la ville s‟appelle Nueva Córdoba), il ne fait aucun doute que c‟est de la capitale cubaine qu‟il parle, notamment quand il évoque le Capitole en construction. Emma Álvarez-Tabío Albo considère d‟ailleurs ce bâtiment et sa coupole comme les attributs par excellence de La Havane monumentale carpentérienne. Le dictateur, el Primer Magistrado, décide de faire construire cet édifice public pour matérialiser son pouvoir454 et faire de la ville une capitale quasi impériale : El Capitolio crecía. Su mole blanca, aún informe, enjaulada en andamios, se iba elevando sobre los techos de la ciudad, alzando columnas, ensanchando las alas […]. Y ocurrìa entonces que en los perìodos de inactividad, la zona más céntrica de la capital se transformara en una suerte de foro romano, explanada de Baalbek, terraza de Persépolis […].455 On observera, tout d‟abord, que l‟emplacement du Capitole n‟est pas anodin. Il s‟agit de « la zona más céntrica de la capital », point hautement stratégique et symbolique, on l‟a vu précédemment avec Mircea Eliade. Situé au centre de la ville, l‟édifice représente le cœur naturel de la cité et du pays. D‟ailleurs, le gros diamant de chez Tiffany qui sera incrusté dans le sol du hall du Capitole, pour marquer le point zéro de toutes les routes du pays, ne matérialise pas autre chose que cela456. Non seulement l‟édifice est situé dans le centre mais 453 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 178, 179. « Después de mucho meditarlo, el Primer Magistrado se entregñ, con remozada energìa […] a lo que habrìa de ser su gran obra de edificador, materialización, en piedra de su obra de gobierno : dotar el país de un Capitolio Nacional… », Alejo Carpentier, El recurso del método, op. cit., p. 152, 153. 455 Ibid., p. 159. 456 « […] se dio por concluida la construcciñn del edificio, no faltándole el suntuario toque final de un grueso diamante de Tiffany encajado […] en el corazñn de una estrella de mármoles rojiverdes, el Punto Cero de todas las carreteras de la República Ŕ el lugar de convergencia ideal de los caminos […] para comunicar la Capital con los más alejados confines del paìs… », ibid., p. 169. 454 169 nous pouvons dire qu‟il « construit le centre »457 à la manière des temples et autres lieux sacrés des civilisations passées. L‟extrait cité montre également que le bâtiment semble prendre vie à mesure que la construction avance. Il grossit tel un être vivant (« crecía », « enjaulada », « se iba elevando », « ensanchando las alas ») et c‟est la ville entière qui gagne en importance, ainsi qu‟en témoigne la comparaison entre le centre de la ville et Rome, Baalbek ou Persepolis. Le narrateur place La Havane dans la continuité des grandes cités de l‟Antiquité, pour en faire une ville monumentale et universelle. Cette idée est aussi suggerée par la description des travaux pharaoniques que nécessite ce projet : Y se inició entonces un trabajo de egipcios. Con ayuda de centenares de campesinos […] empezaron a pararse las columnas que aún estaban por pararse, se irguieron obeliscos, subieron dioses y guerreros, danzantes, musas y caciques, adelantados de morrión y coraza, jinetes y hoplitas, a los más altos frisos Ŕ se pulió lo que había de pulirse, se doró lo que había de dorarse, se pintó lo que había de pintarse. Se trabajaba de noche, a la luz de los focos y reflectores. Eran tantos los martillazos que, durante semanas, se vivió en estrépito de fragua […]. Y, una tarde, las Palmas Reales entraron horizontalmente en la ciudad […] para ser enraizadas en hoyos profundos. Detrás Ŕ selva de Macbeth Ŕ aparecieron los pinos pequeños, los bojes tallados, las arecas, traìdos de todas partes […].458 Tout dans la forme (les énumérations, les termes au pluriel renforcés par une allitération en « s », les polyptotes, les répétitions, le rythme saccadé dû à une ponctuation marquée, etc.) met en valeur le côté titanesque et demesuré du chantier. Les colonnes, statues, obélisques et dorures permettent au palais néoclassique de rivaliser avec les constructions gréco-latines du passé. La Havane se dote ainsi des bâtiments dignes des plus grandes villes impériales et le Primer Magistrado, dans une subtile comparaison (« selva de Macbeth »), s‟apparente à Macbeth, roi ambitieux, tyrannique et cruel s‟il en est, qui symbolise l‟usurpation du pouvoir. Palais, capitale et nation semblent prendre forme de manière simultanée, c‟est tout du moins ce qu‟indique l‟évocation de l‟arrivée par bateau de l‟immense statue de bronze représentant la République, fabriquée en Italie par le sculpteur Nardini : « la República llegó por fin a su capital, y asì fue como la Naciñn […] vio erigirse una estatua del milanés Nardini […] »459. La prosopopée montre bien que la République et la Nation prennent vie grâce à ces symboles que l‟on érige. Cette sculpture symbolique est d‟autant plus marquante qu‟elle est immense et peine à entrer dans la niche qui lui est assignée, dans le hall du Capitole : 457 Nous renvoyons à un chapitre d‟Images et symboles, intitulé « Construction d‟un „centre‟ », in Mircea Eliade, Images et symboles, op. cit., p. 65-72. 458 Alejo Carpentier, El recurso del método, op. cit., p. 168. 459 Ibid., p. 158. 170 Encerrada ya entre las paredes de un palacio demasiado angosto Ŕ pese a su monumentalidad Ŕ para servirle de morada, la Gigante, la Titana, la Inmensa Mujer Ŕ a la vez Juno, Pomona, Minerva y República Ŕ se había puesto a crecer, de día en día, dentro del ceñimiento progresivo de su ámbito. Cada maðana parecìa mayor […]. Como oprimida, comprimida, por la piedra circundante, lucía dos veces más espesa, más corpulenta y más alta Ŕ siempre más alta Ŕ que cuando hubiese sido erigida, trozo a trozo, en espacio destechado. La cúpula se había cerrado ya sobre su cabeza, alzando la majestuosa linterna Ŕ imitada de Los Inválidos de París Ŕ que, ya iluminada, faro y emblema, señoreaba las noches de la ciudad, minimizando cruelmente las torres de la Catedral, ahora tan menguadas en proporciones que roto para siempre era el diálogo entablado por ellas […].460 Ces lignes mettent l‟accent sur la monumentalité démesurée de la statue qui apparaît comme un joyau enfermé dans un écrin trop petit. Les majuscules, l‟évocation des plus grandes déesses de la mythologie romaine ainsi que la profusion d‟adjectifs (« oprimida », « comprimida », « espesa », « corpulenta », « alta ») soulignent le caractère exceptionnel de cette sculpture censée représenter la grandeur du pays. La lanterne du Capitole, placée juste au-dessus de la coupole et inspirée de celle située sur le dôme des Invalides, assimile une fois de plus La Havane aux plus grandes capitales mais suggère aussi que le bâtiment sert de repère (« faro y emblema »). La République et le pouvoir politique sont ainsi visibles de loin puisqu‟ils dominent la ville, dépassant même les tours de la cathédrale. Enfin, la personnification des tours de l‟édifice religieux (« roto para siempre era el diálogo entablado por ellas mismas ») marque symboliquement la suprématie de l‟autorité politique sur le religieux : la cathédrale dorénavant muette semble écrasée par l‟imposant palais. Les différentes cérémonies qui rythment le calendrier national viennent s‟ajouter à ces symboles tangibles pour renforcer le patriotisme national. Le Primer Magistrado le sait bien et organise en grande pompe l‟inauguration du Capitole : Y, por fin, aquel martes, amaneció la capital […] relumbrante, charolada, vestida de banderas, estandartes, faniones, escudos y enseñas, con alegorías callejeras, caballos de cartón evocadores de batallas famosas, cien cañonazos en alborada, cohetes y voladores sobre los techos, salvas en todos los barrios, gran parada militar, y bandas, muchas bandas […], circulándose […] las partituras […] que, dándose preferencia a los aires nacionales y marchas patrióticas, incluían algunos trozos de resistencia […].461 La ville s‟est parée de ses plus beaux atours, comme le montre la liste exhaustive des décorations. La musique des fanfares, les salves et les parades militaires créent une atmosphère à la fois festive et solennelle. Aux côtés des ambassadeurs, toutes les 460 461 Ibid., p. 168. Ibid., p. 169. 171 personnalités politiques de la République sont présentes et assistent à cet événement où hymne national et discours officiel ne sauraient manquer. La ville est donc la scène où le sentiment patriotique se matérialise, comme nous l‟avions déjà constaté antérieurement lorsqu‟il était question du défilé militaire qui se tenait sur le Malecón, dans La vida manda, d‟Ofelia Rodríguez Acosta, à l‟occasion de la proclamation de la République, le 20 mai 1902, ou lorsque Carlos Loveira décrivait l‟anniversaire de la proclamation de cette même République, le 20 mai 1903, dans Juan Criollo. La littérature rend bien compte du besoin de mettre en scène le pouvoir et l‟amour pour la patrie, montrant de la sorte que La Havane, en tant que capitale, joue un rôle essentiel dans le processus de construction nationale. Capitale qui représente le pays tout entier, elle n‟en est pas moins représentée dans toute sa singularité dans certains romans. b- Les particularités de la métropole « Cuba es La Habana y el resto es paisaje »462, nous dit Pedro Juan Gutiérrez pour bien rappeler que la capitale représente l‟Île tout entière mais fonctionne aussi de façon autonome. Distinguer La Havane du reste du territoire est un leitmotiv dans notre corpus. On la différencie de la campagne, bien sûr, mais aussi des autres villes du pays. Deux auteurs d‟origine provinciale, qui vont s‟installer dans la capitale durant leur jeunesse, vont faire part de leurs impressions en comparant La Havane aux bourgs qu‟ils ont laissés. Le jeune Cabrera Infante oppose la pauvreté de son village à l‟opulence de la capitale, à travers l‟évocation de l‟éclairage urbain : Yo venìa de un pueblo pobre […] no habìa más que un bombillo de pocas bujías en cada esquina que apenas alumbraba el área alrededor del poste […]. Pero en La Habana habìa luces dondequiera, no sñlo útiles sino de adorno, […] luces dondequiera, en las calles y en las aceras, sobre los techos, dando un brillo satinado, una pátina luminosa a las cosas más nimias, haciéndolas relevantes, concediéndoles una importancia teatral […].463 La profusion de lumières étonne le jeune garçon âgé de douze ans qui arrive à La Havane en 1941. Avec son éclairage, la capitale est une ville résolument moderne et spectaculaire. C‟est ce que suggèrent la répétition de « luces dondequiera » et la comparaison avec une scène de 462 463 Pedro Juan Gutiérrez, Corazón mestizo, op. cit., p. 184. Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 13. 172 théâtre (« una importancia teatral ») qui donne l‟impression que la ville n‟est qu‟un décor. Tout lui semble si différent qu‟il a l‟impression de découvrir une terre étrangère : « […] la ciudad hablaba otra lengua, la pobreza tenía otro lenguaje y bien podía haber entrado a otro país […] »464. La répétition de l‟adjectif « otro » n‟évoque rien de moins qu‟un nouveau territoire qui se révèlerait à lui. L‟espace urbain s‟oppose aussi au reste de l‟Île chez Reinaldo Arenas, qui a grandi dans la petite ville orientale d‟Holguín et qui découvre la capitale en 1960, quand il a dix-sept ans. S‟y rendant pour la première fois pour assister au discours de Fidel Castro sur la Place de la Révolution, le narrateur insiste sur l‟anonymat que procure la ville : « Llegamos a La Habana. Me fascinó la ciudad ; una ciudad, por primera vez en mi vida ; una ciudad donde nadie se conocía, donde uno podía perderse, donde hasta cierto punto a nadie le importaba quién fuera quién »465. Ici, c‟est la répétition du terme « ciudad » qui marque la découverte d‟un nouvel espace, qui sera synonyme, dans un premier temps, de liberté. La Havane permettra, en effet, à Arenas d‟avoir une vie sexuelle plus débridée et clairement assumée. Tout de suite après, le narrateur explique comment il a été séduit et fasciné par la capitale, dès la première rencontre : « El caso es que aquel primer viaje a La Habana fue mi primer contacto con otro mundo ; un mundo hasta cierto punto multitudinario, inmenso, fascinante. Yo sentí que aquella ciudad era mi ciudad y que de alguna manera tenía que arreglármelas para volver a ella »466. Une fois la métropole découverte, il n‟aura de cesse de vouloir y vivre car c‟est la terre de tous les possibles qui s‟offre à lui. Le terme « mundo » vise bien à signifier que La Havane est un univers à part, un microcosme qui n‟a rien à voir avec le reste du pays et qui s‟oppose en tout à Holguín. Quand il part définitivement s‟y installer, il écrit d‟ailleurs : « Dejaba atrás una granja llena de gallinas escandalosas, un mundo lleno de gente inconforme, maloliente, desarrapada y mal pagada, unos amores frustrados y un pueblo como Holguín, ajeno a todo lo que fuese la belleza tanto espiritual como arquitectónica »467. En confrontant la capitale à la ville de son enfance, le narrateur oppose la vie rurale forcément fruste et misérable à la beauté et à la délicatesse de la ville. Dans un style antithétique, le narrateur dénigre son village et ses habitants (« inconforme, maloliente, desarrapada y mal pagada ») qui ne peuvent lui offrir rien de bon. A Holguín, même ses histoires d‟amour sont des échecs… 464 Ibid., p. 12. C‟est nous qui soulignons. Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 75. 466 Ibid., p. 75. 467 Ibid., p. 91. 465 173 La Havane se distingue aussi du reste de l‟Île par un grand nombre de traits distinctifs. Si la Comtesse Merlin soulignait déjà les mœurs et les habitudes propres aux Havanais, elle opposait surtout celles-ci aux coutumes européennes. Certes, elle décrit des scènes costumbristas havanaises et se plaît à souligner la singularité des gens de la capitale, mais son récit ne se situe pas dans l‟opposition entre la ville et le reste du pays. D‟ailleurs, la plupart de ses observations pourraient ne pas s‟appliquer exclusivement à La Havane, comme en témoignent ses diverses remarques sur les Havanais : Le Havanais, bien que sous l‟influence d‟un climat brûlant, aime la danse avec passion, et c‟est un contraste digne de remarque de le voir, après avoir passé toute la journée mollement étendu sur la butaca, les yeux à demi fermés, et immobile, un jeune nègre à côté de lui pour l‟éventer […] ; c‟est, dis-je, un singulier contraste de le voir sortir de cet état d‟apathie voluptueuse, pour se livrer avec ardeur à l‟exercice animé de la danse. Ce contraste se reproduit dans toutes ses dispositions morales : doux jusqu‟à la faiblesse dans les circonstances ordinaires de la vie, violent et indomptable lorsque ses passions sont en jeu.468 Ce jugement, fatalement généralisateur, qui souligne le caractère à la fois nonchalant et fougueux du Havanais pourrait sans doute caractériser d‟autres créoles fortunés de l‟Île. Encore une fois, María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, à travers le terme « H/havanais », ne désigne pas tant les habitants de la capitale que les Cubains nantis vivant en ville. Il nous faut nous tourner vers un roman plus récent pour trouver les distinctions les plus intéressantes : La Habana para un infante difunto. Cabrera Infante y répertorie tous les éléments propres à La Havane et crée un monde à part. Des mœurs à la langue, en passant par la sexualité, la physionomie ou encore les prénoms, tout est différent à La Havane. Dans les moindres détails, le protagoniste scrute la ville et ses habitants à la manière d‟un anthropologue. Ainsi, les femmes qui, si elles ne sont pas havanaises sont exotiques469, n‟y ont pas les mêmes oreilles qu‟ailleurs, par exemple : « […] las orejas que eran, como la de las muchas mujeres en La Habana, pequeñas y pegadas al cráneo »470. Les hommes aussi ont un physique particulier : [Pepe era] el prototipo del cubano (mejor dicho del habanero : en mi pueblo, tal vez por la pobreza, la gente tendía a ser magra, casi Quijotes y 468 La Comtesse Merlin, Souvenirs et mémoires de Madame la Comtesse Merlin. Souvenirs d’une Créole (1836), Paris, Le temps retrouvé, Mercure de France, 1990, p. 29. 469 « Mi temor con las habaneras Ŕ las otras eran todas exóticas Ŕ era que la cursilería las hiciera imposibles para vos y para nos […] », Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 449. 470 Ibid., p. 364. 174 poco Panzas) con sus caderas tan anchas como los hombros, el pelo raleando desde la frente sin darle visos de inteligencia a la cara […]471. Tout en étant quelque peu persifleur, le narrateur dresse le portrait type du Havanais. Il explique la différence de corpulence par des considérations matérielles qui singularisent La Havane, singularité qu‟un clin d‟œil littéraire permet d‟ailleurs de renforcer. Mais c‟est le langage propre à la ville qui fascine encore plus le personnage. En inventoriant les expressions, les substantifs, les adjectifs employés principalement à La Havane et en soulignant les intonations particulières, l‟auteur s‟amuse à recréer cette langue « havanaise » dans son roman : Pera Ŕ dijo ella [...] para demostrar su origen habanero, mostrándose incapaz de decir espera nada más que cuando se vigilaba como hablaba, policía de su dicción. Ese pera además era casi como una descripción en un pasaporte o cualquier otro documento personal : Dulce era, además de habanera, humilde.472 A Cuba comme ailleurs, la manière de parler et d‟avaler les mots déterminent immédiatement l‟origine géographique et sociale des personnes. La comparaison avec le passeport montre à quel point le langage peut définir une personne, en l‟occurrence Dulce, l‟une des nombreuses conquêtes féminines du personnage. Havanaise issue d‟un milieu modeste, elle initie, en quelque sorte, le protagoniste à cette langue des quartiers populaires de la capitale. Mais ce n‟est pas seulement l‟accent ou les syllabes que l‟on avale qui font du havanais une langue à part : l‟abondance de termes propres, qui sont inusités ailleurs, en fait un élément à ce point distinctif que le narrateur parle de « dialecto habanero »473. L‟idée que le havanais serait une langue étrangère est récurrente dans l‟œuvre. Par exemple, le narrateur dit que la mièvrerie se dit « picuismo » à La Havane474 et il ajoute que c‟est « [una] palabra intraducible al español »475. En disant cela, il signifie que le havanais ne serait pas de l‟espagnol mais bel et bien une autre langue. Cette idée est soulignée également quand, un peu plus loin, le narrateur explique ses intentions : « he exaltado el carácter precioso del lenguaje habanero, tan vulgar, tan vivo, tan sentida su desaparición […] ese lenguaje ido con el viento de la historia, una 471 Ibid., p. 420. Ibid., p. 333. 473 Ibid., p. 25. 474 « […] esa cursilerìa exacerbada que se llamaba en La Habana picuismo […] », ibid., p. 343. Dans les faits, l‟emploi de ce terme n‟est pas propre à La Havane, comme l‟indique le Diccionario de americanismos, Madrid, Santillana Ediciones Generales, 2010, p. 1693. 475 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 343. 472 175 lengua muerta […] »476. Cette langue qui, pour Cabrera, est morte à cause de la distance géographique et temporelle imposée par l‟exil est malgré tout recréée, de manière tout à fait volontaire, dans le roman. La littérature permet donc de faire revivre le parler populaire de la capitale. Il s‟agit même d‟un projet d‟écriture revendiqué qui montre l‟attachement du protagoniste (et de l‟auteur) à La Havane. Soulignées de façon récurrente dans le roman, toutes ces particularités créent une ville qui se situe aux antipodes de la cité monumentale et universelle de Carpentier. Cabrera Infante ne convoque pas les villes antiques ou les grandes capitales contemporaines pour décrire La Havane car son objectif est tout autre : il souhaite parler de sa ville et de sa vie. Ce n‟est donc pas une capitale impériale garante du pouvoir qu‟il échafaude mais une Havane populaire, anecdotique et résolument personnelle. De fait, à la fin de son récit, il fait dire à son personnage : « Yo no vivo en Cuba, yo vivo en La Habana. [...] La Habana no sólo [es] mi fin y mi principio sino mi medio »477. Evinçant le reste du pays, comme d‟un revers de main, le narrateur montre, s‟il en était encore besoin, que La Havane n‟est pas Cuba. Mais il exprime surtout son attachement viscéral à la ville qui est sa raison de vivre (un moyen et une fin, dit-il). Deux aspects de la ville, contradictoires en apparence, coïncident donc en littérature. D‟un côté, il y a La Havane conçue comme la capitale du pays, le symbole de la Nation, de l‟autre, il y a la représentation d‟une ville indépendante qui serait un microcosme hermétique et indifférent au reste du pays. Une approche assemble quand l‟autre tend à disjoindre et c‟est toujours dans cette double tension que s‟inscrit La Havane. Tout au long de ce chapitre, nous avons vu effectivement qu‟une dynamique à la fois inclusive et exclusive apparaissait à tous niveaux. Dans un effet de synecdoque, la ville est la scène où se joue l‟histoire nationale, voire supranationale, mais elle est aussi l‟espace de la ségragation sociale et donc de la différenciation. Parce qu‟elle est à la fois un espace historique et social, un territoire vécu et pensé, une scène des pratiques individuelles et collectives, La Havane littérarisée devient un lieu anthropologique au sens où l‟entend Marc Augé478. 476 Ibid., p. 379. Ibid., p. 472. 478 « Nous réservons le terme de „lieu anthropologique‟ à cette construction concrète et symbolique de l‟espace qui ne saurait à elle seule rendre compte des vicissitudes et des contradictions de la vie sociale mais à laquelle se réfèrent tous ceux à qui elle assigne une place, si humble ou modeste soit-elle. […] le lieu anthropologique, est simultanément principe de sens pour ceux qui l‟habitent et principe d‟intelligibilité pour celui qui l‟observe. […] [Ces lieux] se veulent identitaires, relationnels et historiques », Marc Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Editions du Seuil, « La librairie du XXIème siècle », 1992, p. 68, 69. 477 176 Cette première partie a permis d‟établir tout d‟abord une carte géographique des lieux évoqués dans les récits de fiction de notre corpus. Pour montrer qu‟il s‟agissait avant tout d‟un espace référentiel, c‟est-à-dire d‟un cadre spatial concret, il était nécessaire de recenser les quartiers, les espaces et les lieux décrits. Cet inventaire préalable est, en effet, indispensable aux analyses qui vont être proposées par la suite. Mais nous nous sommes attachée à ce qu‟il mette aussi en lumière différents traitements descriptifs car si les représentations de La Havane sont multiples, les approches narratives pour la décrire le sont tout autant (évocations plus ou moins précises de la ville ; points de vue panoramiques ou, au contraire, focalisations extrêmes ; représentations figées ou vivantes ; descriptions comparatives et contrastées ou alors homogènes). En collationnant ces différentes représentations de La Havane, nous avons pu distinguer les multiples fonctions que pouvait avoir l‟espace urbain au sein des œuvres (dénonciation d‟un fait social, anticipation des événements à venir, consolidation des personnages, entre autres choses). Parmi ces fonctions, il convient à présent d‟en analyser une, à peine abordée dans cette première partie : la fonction symbolique de la ville. Nous allons donc voir comment se construit un espace allégorique à partir du référent « réel » que nous venons d‟étudier. 177 DEUXIÈME PARTIE L’ESPACE URBAIN : UNE UNITÉ SYMBOLIQUE Chapitre 1 : Le paradis 1- Espace de vie a- La nouvelle Arcadie de la Comtesse Merlin Dans une perspective non plus référentielle, mais proprement interprétative, nous nous proposons à présent de lire et de déchiffrer les connotations de la ville. A l‟instar des textes littéraires qui peuvent avoir plusieurs niveaux d‟interprétation, l‟espace décrit peut lui aussi s‟appréhender de différentes manières. C‟est un cadre précis qui renvoie à une réalité spatiotemporelle concrète, comme nous venons de le voir, mais c‟est également un truchement : à travers son évocation, les auteurs expriment un peu plus leur point de vue, renforcent davantage leur projet narratif. Rarement neutre, l‟évocation des lieux se charge, en littérature, de valeurs et de significations symboliques que le lecteur doit décrypter. L‟espace urbain connoté devient une construction culturelle qui traduit un jugement souvent moral de la part du narrateur. C‟est en nous appuyant sur une schématisation religieuse du monde que nous nous proposons d‟étudier La Havane littérarisée. Cela nous permettra de voir que la capitale cubaine est perçue tour à tour comme un espace paradisiaque, expiatoire et enfin infernal. Cette lecture parabolique se justifie par les nombreuses allusions au paradis et à l‟enfer qui imprègnent notre corpus. En effet, les écrivains usent abondamment de ces allégories pour décrire la capitale cubaine. Au cours de cette étude thématique, nous tâcherons de dégager les symboles les plus évidents associés à La Havane. L‟étendue de notre corpus nous oblige, en effet, à réduire cette multiplicité de paysages à quelques types nettement dominants. Certaines œuvres, riches en allégories (nous pensons notamment à Paradiso, de Lezama Lima), mériteraient une étude quasiment exclusive mais cela nous éloignerait de notre projet initial qui est de créer des liens entre les œuvres, entre les siècles et de faire « résonner » les récits entre eux. Plutôt que d‟être exhaustive, nous avons donc préféré dégager quelques constantes. 178 Le premier symbole qui se dégage de notre corpus pourrait de prime abord aller à l‟encontre d‟un topique littéraire très répandu qui veut que le paradis terrestre (le locus amœnus) se trouve dans la nature. Sans nécessairement prendre le contrepied de cette conception rousseauiste du monde, certains auteurs vont situer l‟Arcadie non pas à la campagne mais en ville. La Havane, de la Comtesse Merlin, est en cela remarquable : dans cette œuvre, presque toutes les évocations de la ville participent à la construction d‟un espace paradisiaque 479. En brossant un portrait assez homogène de la capitale, la femme de lettres cubaine se distingue des autres auteurs que nous étudions qui ont souvent une vision plus nuancée. Ainsi crée-telle une nouvelle Arcadie en s‟appuyant sur les paysages, les constructions architecturales et même la société havanaise. Sans bouleverser les codes de la représentation classique du paradis terrestre, l‟auteur va tout d‟abord composer une cité enchanteresse. Dans un procédé tout à fait conventionnel, elle décrit une nature luxuriante qui fait de La Havane un havre exotique : […] nous traversâmes la belle promenade de la Punta et ses immenses allées de sycomores. Bientôt la mer reparut à droite, bleue, calme, éblouissante de jets de lumière qui tombaient à flots du ciel sur sa surface. A ma gauche s‟étendait une végétation splendide, baignée par les rayons brûlants du soleil ; mais loin de s‟affaisser sous sa puissance, elle se montrait haute, orgueilleuse, jeune et riante, se dessinant dans de moelleux contours, étalant ses grâces dans ce golfe de lumière et d‟or. A cette vue, je sentis un rayon de joie qui me pénétra au cœur.480 En décrivant tantôt l‟abondante et vigoureuse végétation, la mer et la lumière éclatante du soleil, l‟écrivain dresse un tableau merveilleux de cet endroit situé au bord de la mer, aux confins de la ville justement. Grâce à une forte adjectivation méliorative (« belle », « immenses », « éblouissante », « splendide », etc.), une personnification de la nature (« orgueilleuse, jeune et riante »), un style précieux (« éblouissante de jets de lumière qui tombaient à flots du ciel sur sa surface », « ce golfe de lumière et d‟or ») et un rythme harmonieux (enchaînement de propositions en asyndète), la narratrice fait de La Havane un espace idyllique. La vue de ce tableau fait d‟ailleurs naître une sensation de bien-être chez le personnage. Mais, on l‟aura compris, il ne s‟agit pas d‟idéaliser le paysage urbain mais de louer la beauté de la nature, comme en témoigne la description du crépuscule à La Havane : 479 La chaleur excessive qui ramollit l‟esprit et l‟esclavage sont quelques-unes des rares choses que la Comtesse déplore. 480 La Comtesse Merlin, La Havane, T. II, op. cit., p. 89, 90. 179 […] le soleil se couchait enveloppé de larges draperies d‟or. Le palmier, le maboa, la yagua et les buissons gracieux de rose althea, agités par la brise du soir, se balançaient doucement. L‟oiseau […] chantait gaiement en choisissant son gîte, et resserrant ses ailes, se balançait sur la branche flexible et parfumée qui devait lui servir d‟asile et le protéger contre la rosée de la nuit.481 La nature propre aux tropiques et la lumière dorée sont une fois de plus au cœur de ce passage descriptif. Les deux éléments sont décrits ici aussi de façon quelque peu affectée, comme l‟atteste la métaphore qui compare la lumière du soleil à « de larges draperies d‟or » ou l‟anthropomorphisme qui point lorsque l‟oiseau est évoqué (« chantait gaiement », « choisissant son gîte », « lui servir d‟asile »). L‟harmonie est aussi rendue par le rythme des phrases longues et les sonorités douces (allitération en « s » notamment). La présence de l‟oiseau qui chante, véritable topique littéraire et pictural, parachève la construction d‟un décor édénique. La Comtesse construit donc un véritable pays des délices que seule l‟hyperbole est capable de rendre, même quand il s‟agit de décrire la nuit havanaise : La vie de nuit est si belle, si pleine de charmes ici ! Quelle transparence ! Quelle grandeur dans le ciel éblouissant d‟étoiles et de météores ! Ŕ Et ces nuages gigantesques qui planent dans l‟air, habillés d‟opales et de rubis ! et ce souffle tiède de la brise de terre, chargée de tous les parfums de la végétation, si doucement incisif à travers des pores épanouis par la chaleur ! Comment te décrire la puissance de cette vie animée et sensuelle, quand l‟ardeur brûlante du jour a fait place à l‟air doux et voluptueux du soir ? Ŕ Lorsque […] à demi couchée au fond de ma butaca, sur le balcon de mon oncle, je contemple un bâtiment les voiles déployées, se détachant au loin sur le firmament étoilé, au milieu de l‟air diaphane et phosphorescent, que la lune m‟apparaît à droite et le château du Morro à gauche […] Ŕ je me crois livrée à un rêve enchanteur, et je jouis de ce bonheur fugitif à pleine poitrine.482 Tout, dans la prose de l‟auteur, marque la splendeur du paysage nocturne : les points d‟exclamation, les adjectifs laudatifs et hyperboliques, les métaphores. Les mots ne semblent pas suffisants pour traduire tant de beauté et de contentement (« Comment te décrire […] »). D‟ailleurs, si plusieurs sens sont convoqués pour souligner le bien-être du personnage, c‟est la vue, bien sûr, qui est omniprésente car il s‟agit pour la narratrice-spectatrice de décrire un tableau vivant. Cette idée est soulignée par l‟ekphrasis déjà visible dans les deux citations précédentes mais qui est ici plus manifeste que jamais. D‟autre part, ce spectacle est si merveilleux qu‟il semble irréel comme en témoigne l‟impression qu‟elle a d‟être dans un rêve. Dans son récit de voyage, María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo s‟appuie donc 481 482 Id., La Havane, T. I, op. cit., p. 328, 329. Ibid., p. 317. 180 sur des procédés rhétoriques classiques pour faire de La Havane un véritable locus amœnus. Dans les trois extraits cités, nous retrouvons d‟ailleurs la quasi-totalité des six composantes stéréotypées du locus amoenus codifiées par le rhéteur de l‟Antiquité Libanius et que reprend Jean-Michel Adam : sources, plantations, jardins, brise légère, fleurs et chant des oiseaux483. Les beaux fruits savoureux pourraient compléter cette liste puisque María de las Mercedes ne manque pas de les décrire dans une de ses lettres : […] je ne saurais te dire avec quel délice je savoure ces caïmitos veloutés, ces zapotillos suaves et d‟un goût sauvage, ces mameyes, nourriture des âmes bienheureuses dans les vallées sacrées de l‟autre monde, selon la croyance haïtienne, et enfin le mamon, cette crème exquise dont le goût, composé des plus délicieux parfums, est un nectar digne de l’Éden.484 L‟énumération, les pluriels et l‟adjectivation positive permettent au lecteur de se figurer une corne d‟abondance qui regorgerait de fruits exotiques au goût indescriptible (« je ne saurais te dire »). Cuba apparaît comme une terre nourricière et un véritable paradis terrestre, comme le suggère explicitement l‟allusion aux croyances populaires (« les vallées sacrées de l‟autre monde ») et à l‟Éden. La Comtesse rend La Havane paradisiaque en se fondant amplement sur la nature et pour la célébrer encore davantage, elle dira : « […] partout où la nature se manifeste, tout est grandeur, magnificence ! partout où le pied de l‟homme pose son empreinte, il ne reste que souffrance et misère ! »485. Opposer l‟homme à la nature ne l‟empêche pas pour autant d‟exalter la culture et la civilisation, comme l‟attestent certaines descriptions architecturales. Au sujet de la cathédrale, elle écrit : Tout était éclat dans l‟intérieur de l‟église. De hautes pyramides de bougies allumées, comme des foyers ardents, rehaussaient la magnificence des autels tout éblouissant de dorures, de reliques et de flambeaux en or et en argent incrustés d‟émaux et de pierreries. Toute l‟église était jonchée de fleurs, dont les parfums divers se mêlaient à l‟odeur de l‟encens.486 Les bougies, les pierres précieuses, les métaux et les peintures dorées font de ce lieu de culte un temple raffiné et luxueux. La vue et l‟odorat contribuent une fois de plus à magnifier cet 483 Voir la définition du locus amœnus. Jean-Michel Adam, « locus amœnus », in Encyclopædia Universalis [ressource électronique], Encyclopædia Universalis France SA, 2012. 484 La Comtesse Merlin, La Havane, T. I, op. cit., p. 305, 306. C‟est nous qui soulignons. 485 Id., La Havane, T. II., op. cit., p. 90. 486 Ibid., p. 95. 181 endroit hors du commun. Dans un processus d‟idéalisation, c‟est presque toute la ville (architecture, société, habitudes) qui est perçue comme extraordinaire et merveilleuse. Peu après la description de son arrivée à La Havane, on peut ainsi lire : […] j‟aimais tout ! les fruits, les nègres qui les portaient sur leur tête pour les vendre, les négresses qui se pavanaient en se balançant sur les hanches dans la rue, avec leur mante sur la tête, leurs bracelets autour des bras et leur cigare à la bouche !487 C‟est bien sûr la voix de l‟Européenne étonnée et enjouée, qui trouve charmant tout ce qu‟elle découvre, que l‟on entend dans ce passage. L‟image de ces Noirs qui vendent des fruits ou se promènent l‟enchante car elle est sentie comme exotique. Les scènes de la vie quotidienne sont représentées comme des images d‟Epinal superficielles qui sont autant de tableaux subjectifs de l‟époque. Envisagée sous l‟angle de l‟exotisme, la vie à La Havane est donc très souvent idéalisée. Même si l‟auteur explique bien qu‟« il n‟y a pas de peuple à La Havane, il n‟y a que des maîtres et des esclaves »488, son jugement sur la société havanaise n‟en est pas moins biaisé et sa vision déformée à cause du paramètre affectif. Trop contente de retrouver la ville de son enfance, la Comtesse ne décrit que ce qu‟elle veut bien voir. La messe, par exemple, lui donne l‟occasion de montrer que la société cubaine n‟est pas raciste : « […] contemplant avec plaisir, blancs, hommes de couleur et nègres mêlés. Fière du bon sens et de l‟humanité de mes compatriotes, je me disais […] : „Ici au moins les rangs s‟effacent là où la religion règne, et la maison de Dieu est la maison de tous !‟ »489. A Cuba, les discriminations semblent s‟arrêter aux portes de l‟église. Cette spécificité cubaine l‟amène à porter un jugement moral sur ses « compatriotes » : ce sont des humanistes dotés de bon sens. L‟on sait, bien sûr, que la réalité était tout autre et qu‟à l‟époque coloniale la société était ethniquement et socialement très hiérarchisée ; la Comtesse elle-même le rappelle à plusieurs reprises dans ses lettres. Elle évoque le système esclavagiste en vigueur et fait aussi état d‟habitudes et de pratiques urbaines différentes selon que l‟on est noir, mulâtre ou blanc, pauvre ou aristocrate. Mais il ne fait aucun doute que, dans ce récit de voyage, la critique sociale se trouve presque annulée par le discours laudatif largement dominant. En sacrifiant parfois l‟objectivité historique à l‟émotion et aux sentiments, l‟écrivain remodèle La Havane pour en faire une ville qui correspond à un idéal. Il n‟est donc pas étonnant de trouver des descriptions élogieuses des mœurs familiales : 487 Id., La Havane, T.I, op. cit., p. 297. Ibid., p. 347. 489 Id., La Havane, T. II, op. cit., p. 96. 488 182 La vie de famille, à La Havane, renouvelle les charmes de l‟âge d‟or : on y retrouve les élans du cœur, l‟abandon dans la confiance, la foi dans l‟amour et dans l‟amitié, et quelque chose de souple, de moelleux, de caressant, qui va jusqu‟au fond du cœur de celui qui en est l‟objet. [...] tout est pétulance, gaieté, abandon, délire ! On se tutoie ; les âges, les conversations se mêlent ; tout le monde est heureux, le bien-être est partout : c‟est que le cœur est seul chargé des honneurs de la fête. 490 La narratrice met en lumière les sentiments profonds et sincères qui unissent les membres d‟une même famille. Même dans l‟aristocratie, on s‟aime avec simplicité et joie, en faisant fi de certaines conventions sociales. C‟est donc encore un jugement de valeur que porte ici la Comtesse Merlin en soulignant le caractère spontané et enthousiaste des Cubains. Dans cet extrait, le procédé d‟idéalisation est évident : en parlant d‟« âge d‟or » renouvelé, l‟auteur expose clairement son projet qui est de faire de La Havane un paradis non pas perdu mais toujours existant. C‟est comme si, en redécouvrant la capitale cubaine, elle retrouvait le moment mythique de l‟humanité, si bien que rien ne semble encore avoir été perverti ou corrompu. Ainsi, dans certains portraits moraux, le mélange de simplicité et de candeur caractérisant les Havanais n‟enlève rien à leur grandeur d‟âme : […] d‟une âme ardente et d‟une intelligence facile, le Havanais est capable de tout comprendre et de s‟élever parfois à l‟héroïsme par un élan spontané [...] son cœur est toujours ouvert à une généreuse sympathie [...] il donnera sa fortune et sa vie pour son ami, pour son pays. 491 Ce portrait élogieux fait du Havanais le parangon de l‟intelligence et de la générosité. Sans forcément se le proposer, l‟auteur enjolive systématiquement la réalité et fait le panégyrique de ses compatriotes492. En insistant sur leurs vertus, leur naturel et la grande liberté dont jouissent les Havanais (même les jeunes filles aristocrates), la narratrice défend une conception rousseauiste de l‟éducation et des mœurs. Dans l‟œuvre de María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, La Havane apparaît souvent comme une nouvelle Arcadie. C‟est un espace où prévaut une nature enchanteresse dont la beauté n‟a d‟égal que la douceur et où la société se distingue par ses valeurs morales authentiques. En magnifiant sa terre natale, l‟auteur fabrique une cité idéale et mythique qui 490 Id., La Havane, T. I, op. cit., p. 310, 311. Ibid., p. 357. 492 La description physique des Havanaises est en cela très probante : « Le pied d‟une Havanaise n‟est pas un pied, mais un luxe poétique de la nature. […] La liberté dont elle jouit dès l‟enfance, la douce et constante chaleur de l‟atmosphère, conservent à ses membres tout leur fraîcheur et leur souplesse primitives, et donnent quelque chose de doux, de velouté et de tendre à sa peau, souvent d‟une blancheur pâle, mais sous laquelle on entrevoit un reflet chaud et doré [...] », id., La Havane, T. II, op. cit., p. 144, 145. 491 183 reste figée dans une estampe littéraire assez univoque. Dans les autres œuvres de notre corpus, l‟idée du paradis est certainement moins prégnante et apparaît comme plus disséminée. Ce sont des éléments particuliers évoqués ça et là qui rappellent, entre autres choses, que La Havane est un espace vivant, festif et joyeux. b- La scène des plaisirs et de la vie La Havane envisagée comme un haut lieu de la fête et de la distraction est un cliché que nous avons déjà eu l‟occasion d‟aborder dans notre partie précédente. Nous avons vu, par exemple, que les bars et les cabarets fonctionnaient comme de véritables allégories de l‟oisiveté pour caractériser la ville prérévolutionnaire. Si nous élargissons les bornes chronologiques, nous observons que dès le XIXème siècle, la capitale cubaine est associée à la fête et aux réjouissances. Le théâtre, l‟opéra, les fêtes privées et les bals constituent, pour la bourgeoisie havanaise, autant d‟occasions de sortir et de se montrer493. Ces rendez-vous mondains sont d‟ailleurs amplement relatés par les chroniqueurs494 et les écrivains de l‟époque. Cirilo Villaverde, qui dans de nombreux récits décrit les fêtes et les bals qui se donnent en ville, ne fait pas exception. Dans Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, le narrateur évoque tantôt les bals populaires où se retrouvent les Noirs et les Métisses, tantôt les bals aristocratiques qui n‟accueillent que la fine fleur de la société havanaise, comme par exemple celui de la Sociedad Filarmónica : « […] allì se hallaba reunido lo más granado y florido de la juventud cubana de ambos sexos, entregada […] con alma y cuerpo a su diversiñn favorita. […] aquella juventud gozaba a sus anchas de los placeres del momento […] »495. Ces bals raffinés offrent donc à la jeunesse dorée havanaise amusement et plaisir immédiats. Cette jeunesse qui fait sien le carpe diem horacien vit dans l‟insouciance du moment présent et accorde de ce fait beaucoup d‟importance à ces événements frivoles. Les préparatifs sont donc une étape essentielle et constituent même une fête avant la fête, comme le suggère Villaverde lorsqu‟il évoque l‟effervescence qui anime les boutiques juste avant le bal : « En vísperas del sarao, la juventud de ambos sexos acudía en tropel a los establecimientos de modas y novedades para 493 Voici ce qu‟écrit Álvaro Salvador Jofre à ce sujet : « Funciñn de escaparate, a la vez que de lugar de observaciñn, adquieren en la época los teatros y, sobre todo, la ñpera […]. Las „fiestas‟, ofrecidas en salones oficiales o por familias importantes, suponían un momento culminante en todo ese mecanismo de exhibición, y „voyeurismo‟ con el que los „burgueses aúreos‟, según feliz expresiñn de Mejìa Ramos, medìan la verdadera importancia de su ascensión social », Álvaro Salvador Jofre, El impuro amor de las ciudades (Notas acerca de la literatura modernista y el espacio urbano), La Havane, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2002, p. 156, 157. 494 Nous pensons notamment à Julián del Casal et à sa chronique « Un baile », publiée en 1890 dans le journal La Discusión. Voir les annexes d‟Álvaro Salvador Jofre, ibid., p. 215, 216. 495 Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 229, 230. 184 hacerse de trajes nuevos, de adornos, joyas y guantes »496. La ville semble alors vivre au rythme de ces fêtes. Elle est gagnée par l‟agitation et la frénésie de cette jeunesse oisive qui ne pense plus qu‟à parader et s‟amuser. Frivolité et tempus fugit sont aussi présents dans un autre récit de Villaverde, La joven de la flecha de oro. L‟héroïne de ce roman, Paulina, se rendait elle aussi dans les bals et les fêtes les plus courus de la ville497 avant de se marier avec un homme plus âgé, fruste et jaloux. Ne pouvant plus sortir de chez elle, c‟est avec une peine infinie qu‟elle se remémore cette allégresse passée : […] como a golpe de vara del mágico, vivas, reales, se agolparon a su espíritu conmovido las variadas escenas de su alegre soltería. El baile, la música, el tumulto de jóvenes danzantes ; el teatro con sus palcos llenos de damas y caballeros, en que resplandecían las sedas y las piedras preciosas […].498 Les souvenirs sont apparus de manière presque surnaturelle : c‟est en prononçant, telle une formule magique, le nom de son ancien prétendant, Jacobo, que Paulina se rappelle les fêtes et les sorties passées et ressent à nouveau la joie qu‟elle éprouvait alors. Les distractions (le bal et le théâtre), intimement liées au bien nommé Jacobo Enamorado, ne sont plus que de doux souvenirs qui rendent le présent encore plus insupportable. Les bals et les sorties mondaines sont donc associés ici au bonheur passé et font de la capitale un espace de liberté et de légèreté. En effet, dans ce récit, la maison où Paulina vit recluse avec son mari, don Simón Alegrías499, est un lieu clos et hermétique qui s‟oppose à l‟espace urbain, synonyme de vie et de gaité. Lieu de plaisir et de divertissements multiples, la ville l‟est plus encore dans les romans du XXème siècle. « ¡ Aquí es donde se gosa ! »500, dit d‟ailleurs Longina à Menegildo, dans Écue-Yamba-Ó, comme pour signifier qu‟il n‟y a qu‟à La Havane que la jouissance est possible. Sans répéter ce que nous avons dit dans notre première partie, rappelons simplement que nombreux sont les récits qui, comme Tres tristes tigres, font la part belle à cet aspect récréatif et festif qui caractérise la capitale cubaine d‟avant la Révolution et qui la différencie des autres villes du monde. Citons à cet égard le musicologue Rafael Giró qui, dans le roman 496 Ibid., p. 213. On pense notamment au bal de la Sociedad Habanera qui est amplement décrit dans ce roman. Voir : Cirilo Villaverde, « La joven de la flecha de oro » (1841), in La joven de la flecha de oro y otros relatos, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 1984, p. 218-230. 498 Ibid., p. 293. 499 On remarquera que c‟est par antithèse que le personnage se nomme ainsi. 500 Alejo Carpentier, Écue-Yamba-Ó, op. cit., p. 153. 497 185 de Padura, La neblina del ayer, rappelle à Mario Conde que La Havane des années cinquante était unique au monde et n‟avait rien à envier à des villes comme Paris ou New York : Imagínense que en esa época, en La Habana, había más de sesenta clubes y cabarets con dos y hasta tres espectáculos por noche. […] La Habana era una locura : yo creo que era la ciudad con más vida de todo el mundo. ¡ Qué carajo Parìs ni New York ! Demasiado frìo… ¡ Vida nocturna la de aquì ! […] la gente se divertìa y la noche empezaba a la seis de la tarde y no se acababa nunca. ¿ Te imaginas que en una misma noche podías tomarte una cerveza a las ocho oyendo a las Anacaonas en los Aires Libres del Prado, comer a las nueve con la música y las canciones de Bola de Nieve, luego sentarte en el Saint John a oír a Elena Burke, después irte a un cabaret a bailar con Benny Moré, con la Aragón, con la Casino Playa, con la Sonora Matancera, descansar un rato vacilando […] y, para cerrar la noche, a las dos de la mañana, escaparte a la playa de Marianao a ver el espectáculo del Chori […].501 Superlatif, exclamations, comparaisons et énumérations des artistes et des lieux de divertissement se succèdent pour faire de La Havane un lieu exceptionnel, une sorte de capitale mondiale de la fête et du spectacle. C‟est le rythme de la ville qui apparaît ici, avec ses horaires et ses rites nocturnes immuables. A mesure qu‟il les décrit, le musicologue dresse une carte précise de cet espace festif qui, dans un mouvement centrifuge, s‟éloigne progressivement du centre pour atteindre le quartier périphérique de Marianao. Il crée, en somme, une topographie parallèle qui viendrait se substituer à la topographie diurne des Havanais. Cette cartographie de la vie nocturne n‟est pas sans rappeler l‟inventaire (ou « la guía del ocio »502) établi par Guillermo Cabrera Infante dans Tres tristes tigres et La Habana para un infante difunto. Il est inutile de redire que la Havane prérévolutionnaire, « toujours en fête »503, est marquée par l‟oisiveté, la frivolité et l‟amusement. Terminons simplement en soulignant que même après 1959, la capitale n‟est pas dépourvue de ces caractéristiques, comme en témoigne ce passage de Silencios, de Karla Suárez, où la protagoniste se souvient de La Havane des années quatre-vingt qu‟elle a connue grâce à son ami Dios : […] yo salìa con Dios ; era otro mundo, una forma diferente de aprehender la ciudad. Por aquel entonces, La Habana era una ciudad con luces y muchos lugares adonde ir, conciertos de la nueva trova, muestras de cine, estrenos en todos los teatros. […] todo resultaba un mundo interesante que yo debía observar y observaba.504 501 Leonardo Padura Fuentes, La neblina de ayer, op. cit., p. 87, 88. Nous reprenons une idée déjà citée d‟Emma Álvarez-Tabío Albo, in Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 344. 503 « […] ella siempre está de fiesta, que La Habana fiestea las veinticuatro horas, desde que sale el sol hasta que se pone […] », Abilio Estévez, Tuyo es el reino, op. cit., p. 193. 504 Karla Suárez, Silencios, (1999), Madrid, Santillana Ediciones Generales, 2008, p. 120. 502 186 Dios lui montre une autre facette de la ville, lui fait découvrir la richesse de la vie culturelle havanaise, l‟initie au monde de la nuit et lui fait rencontrer des personnes différentes issues de la « farándula »505. Un peu plus tard, en pleine période spéciale, la jeune femme repensera non sans nostalgie à ces années fastes et à cet univers intrigant qui la fascinait tant. Cette époque dorée révolue contrastera avec un présent difficile (la période spéciale) que la protagoniste préfèrera oublier en s‟isolant chez elle. Nous en reparlerons. Aux fêtes et aux sorties nocturnes amplement décrites s‟ajoute également l‟évocation d‟une agitation urbaine perpétuelle qui fait de La Havane une ville pleine de vie. Carpentier ne commence-t-il pas un des chapitres de La ciudad de las columnas par ces mots : « En todos los tiempos fue la calle cubana bulliciosa y parlera […] »506, avant de poursuivre en énumérant un à un tous les bruits de la ville ? Effervescence constante, mouvements continus, brouhaha permanent, la ville se caractérise depuis toujours par un intense fourmillement qui commence dès les premières lueurs du jour507. Les descriptions de l‟aube sont en cela très probantes puisque l‟on y voit La Havane prendre littéralement vie : La ciudad despertaba. No es de ningún modo parabólica esta manera de expresarnos, porque también las ciudades duermen y tienen vida especial, semejante a los mismos hombres que las habitan. La nuestra se hace oír por lo regular con el estrépito de sus carretones y la voz de sus campanas, que la conmueven […] apenas alborea la luz del nuevo dìa. 508 La personnification « filée », procédé récurrent quand il s‟agit de décrire la ville, permet bien entendu de faire de l‟espace urbain un personnage supplémentaire mais surtout de créer un territoire vivant visible et lisible. L‟humanisation du paysage urbain dote la ville de codes faciles à décrypter : La Havane a un rythme régulier, immuable et des caractéristiques qui lui sont propres. Le rythme de la cité n‟est pas simplement « semblable » à celui des hommes, comme le suggère l‟auteur, il est en fait dicté par l‟activité humaine. Les deux rythmes se confondent créant de la sorte une interaction supplémentaire entre la ville et ses habitants. Cette simultanéité est évidente dans un autre texte de Villaverde commençant ainsi : En una apacible mañana del mes de abril de 1836, a la hora en que el sol alumbra solamente las torres de la ciudad […] ; en que empieza a oírse en 505 Elle emploie elle-même ce terme qui regroupe les artistes et les gens du spectacle, ibid. p. 121. Alejo Carpentier, La ciudad de las columnas, op. cit., p. 37. 507 Dans certains cas, cette agitation assourdissante pourra revêtir un caractère infernal. 508 Cirilo Villaverde, « La joven de la flecha de oro », in La joven de la flecha de oro y otros relatos, op.cit., p. 182, 183. 506 187 ellas el pregón de los vendedores ambulantes y el ruido de los carruajes, al mismo tiempo que los pasos de las gentes que acuden a los mercados, o van a los templos o andan a sus negocios […] iba un hombre de edad madura […].509 L‟incipit de Dos amores décrit la ville qui se réveille à mesure que les activités humaines commencent. Ici encore, ce sont les bruits qui sont précisément évoqués par le narrateur. L‟énumération faite de termes presque exclusivement au pluriel et de verbes d‟action (« acuden », « van », « andan », « iba ») rend encore plus manifeste l‟agitation matinale qui anime la ville. Notons que les deux extraits de Villaverde que nous venons de citer se situent au tout début des romans. Les deux histoires commencent donc de façon symbolique par la description d‟un jour nouveau mais elles semblent surtout, du point de vue narratif, être intimement liées à la ville. Expliquons-nous : c‟est comme si La Havane, en plus d‟être présente dans la diégèse, rythmait ou encadrait le récit littéraire même. Dans les deux cas, c‟est à travers une description inaugurale de la ville que l‟on pénètre dans la fiction. A propos de la symbiose qui s‟opère entre la ville et ses habitants, notons que celle-ci est encore plus manifeste lorsqu‟il est question de traiter des activités humaines liées au travail. Le rythme effréné des travailleurs et en particulier des dockers fait de la zone portuaire un lieu d‟effervescence et d‟agitation permanentes : […] et tous sont affairés, pressés, ruisselants. Ŕ On voit pêle-mêle des tonneaux, des caisses, des colis portés par des carretons [...] et les braves gens de nègres toujours de chanter et de crier à vous fendre la tête [...]. Partout on se meut, on s‟agite, rien ne reste en place ; la rareté diaphane de l‟atmosphère prête même au bruit, comme à la clarté du jour, quelque chose d‟incisif et d‟éclatant qui pénètre dans les pores et donne le frisson ; la vie est partout, dans tout, mobile, ardente comme le soleil qui darde ses rayons sur nos têtes.510 A son arrivée à La Havane, la Comtesse est frappée par le branle-bas du port et l‟activité incessante des Noirs qui travaillent en chantant. Enumérations qui s‟enchaînent et récurrence de termes au pluriel et de verbes d‟action permettent une fois de plus de souligner le bouillonnement. A cela s‟ajoutent aussi des propositions dominées par un rythme binaire ou ternaire qui, du point de vue formel, rendent compte de la cadence de travail soutenue. Mais le plus intéressant à observer est sans doute l‟allusion à trois des cinq sens traditionnels : l‟ouïe (« chanter », « crier », « bruit »), la vue (« voit », « diaphane », « clarté », « éclatant », « soleil », « rayons ») et le toucher (« incisif », « pénètre dans les pores », « frisson », 509 510 Cirilo Villaverde, Dos amores, La Havane, Biblioteca de « la Ilustración cubana », 1858, p. 5, 6. La Comtesse Merlin, La Havane, T.I, op. cit., p. 292. 188 « ardente », « darde »). La capitale apparaît donc comme un espace vivant (« la vie est partout », nous dit l‟auteur) et aussi sensoriel, puisque presque tous les sens y sont stimulés. c- Un espace sensoriel et matériel L‟idée d‟une ville qui mettrait les sens à contribution (l‟odorat, l‟ouïe et la vue essentiellement511) est très prégnante dans nos œuvres. Guillermo Cabrera Infante dit d‟ailleurs que La Havane était pour lui : « la explosión de la vista, la explosión del olfato, del oído, del gusto »512. Cette sollicitation des sens permet d‟ailleurs une interaction supplémentaire entre l‟espace urbain et ses habitants, on le voit notamment quand il est question des odeurs de la ville. Tantôt nauséabondes513, tantôt délicieuses, les effluves de la cité sont convoquées pour caractériser La Havane et marquer son unicité. Dans La novela de mi vida, Leonardo Padura Fuentes imagine ce qu‟aurait pu être l‟autobiographie de José María Heredia et fait du grand poète cubain du début du XIXème siècle le narrateur homodiégétique d‟un des trois récits qui composent ce roman polyphonique. Heredia se souvient ainsi des odeurs de la ville gravées à jamais dans sa mémoire : […] la magia de La Habana brota de su olor. […] su olor resulta capaz de otorgarle ese espíritu inconfundible que la hace permanecer viva en el recuerdo. Porque el olor de La Habana no es mejor ni peor, no es perfume ni es fetidez, y, sobre todo, no es puro : germina de la mezcla febril rezumada por una ciudad caótica y alucinante. 514 Après avoir évoqué les spécificités des effluves de la ville, le narrateur va décrire plus précisément les odeurs qui l‟ont fasciné quand il est retourné à Cuba en 1818, après avoir passé une grande partie de son enfance à Saint Domingue et au Venezuela : Aquel olor me atrapó desde la primera vez que, ya con facultad de conciencia, llegué a La Habana. […] La Habana me abrazñ con una maravillosa amalgama en la que el olor incisivo de los chorizos gallegos compite con el del tasajo montevideano ; […] el del negro de nación y sus emanaciones ácidas, con el de las señoritas blancas (o que pasan por tal) perfumadas con dulces lavandas francesas ; el de las aguas estancadas con el del aceite recio que se quema en las lámparas ; el de las telas nuevas, 511 Le toucher apparaît notamment quand il est question du climat puisque chaleur et moiteur sont évoquées à l‟envi. Nous en parlerons ultérieurement. 512 Guillermo Cabrera Infante, in Jacobo Machover, « La ciudad-fantasma (conversación con Guillermo Cabrera Infante) », La memoria frente al poder. Escritores cubanos del exilio : Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas, Valence, Universitat de València, 2001, p. 225. 513 En toute logique, nous ne traiterons pas, dans cette partie consacrée à la construction d‟un paradis urbain, les odeurs pestilentielles de la ville. 514 Leonardo Padura Fuentes, La novela de mi vida, Barcelone, Tusquets, 2002, p. 19. 189 caras y europeas, con el de los perros sarnosos […]. Y flotando en el cielo, los efluvios des jazmín y el del tabaco, […] el del pescado fresco y el del vino derramado, que se amalgaman con el de todas las frutas que el prodigioso clima tropical convoca en los mercados habaneros, perfumados por las piñas, mangos, guayabas, papayas […]515. Et l‟auteur de poursuivre en énumérant une à une les odeurs de fruits tropicaux qui se mêlent entre elles. Cette description permet d‟évoquer en filigrane la ville coloniale : l‟antithèse, constamment à l‟œuvre dans cet extrait, oppose bien sûr les senteurs entre elles mais met l‟accent sur les contrastes de la société de l‟époque (oppositions sociales, économiques et ethniques). L‟image des étals de marché pleins de fruits odorants évoque, à la manière de la Comtesse Merlin516, une corne d‟abondance qui symboliserait l‟opulence. Pour le personnage de José María Heredia, l‟importance de l‟odorat est telle que c‟est sur lui que repose en partie le souvenir de la ville : « es que el olor perdido de La Habana me late en el pecho con la intensidad dolorosa de la novela que ha sido mi vida »517. C‟est d‟ailleurs la première chose qu‟il décrit quand il parle de La Havane au tout début du récit autobiographique imaginé par Padura. On trouve, dans Tres tristes tigres, une description similaire puisque le narrateur insiste aussi sur l‟odeur des fruits exotiques et sur le mélange d‟effluves : « Seguimos envueltos en el ruido de la ciudad y ahora en el olor de frutas (mamey, mango, anón sin duda [...]) de batidos, de refrescos de melón, de tamarindo, de coco, y en la mezcla otro olor de fruta, el olor del betún y la tintarrápida […] »518. Le narrateur détaille une à une les odeurs de fruits mais évoque aussi celle de ce qu‟il considère métaphoriquement comme « l‟autre fruit » de la ville : le cirage qu‟utilisent les cireurs de chaussures. L‟arôme de La Havane serait donc un mélange très particulier d‟odeurs naturelles et artificielles. Cette fusion insolite d‟éléments disparates, déjà mise au jour dans l‟extrait de Padura, constitue l‟une des nombreuses contradictions de l‟espace urbain. Luis Manuel García rend exactement la même idée, dans Habanecer : [Daniel] Siente el placer de ser azotado por la leve brisa que […] le trae los efluvios recién amanecidos de la ciudad : olores marrones, verde carmelitosos a tabaco, olores amarillos, verde brillantes, claros : olor a pan, leche, uniformes escolares recién planchados […].519 515 Ibid., p. 20. Le narrateur insiste à nouveau sur l‟odeur particulière de la ville, à la fin du roman, quand il retourne à Cuba (cf., ibid., p. 286, 288). 516 Nous renvoyons à la description des fruits exotiques faite par la Comtesse Merlin évoquée précédemment. 517 Leonardo Padura Fuentes, La novela de mi vida, op. cit., p. 20. 518 Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 43. 519 Luis Manuel García, Habanecer, op. cit., 7:19 am, 7:28 am. 190 Le narrateur omniscient inventorie les odeurs perçues par Daniel dans une synesthésie qui conjugue senteurs et couleurs et fonctionne par association d‟idées (on imagine des effluves de terre, de tabac ou encore de végétation). C‟est comme si la ville stimulait agréablement les sens et les perceptions du personnage. Comme chez Padura et Cabrera, des odeurs très différentes se mélangent pour donner un parfum particulier à La Havane. Cet extrait est d‟autant plus intéressant qu‟il appartient à un chapitre intitulé « un olor desamparado » dont l‟épigraphe prend ici tout son sens : « El olfato es el sentido de la imaginación »520. Les pages qui vont suivre vont effectivement illustrer cette citation de Jean-Jacques Rousseau puisque, dans un processus d‟anamnèse, Daniel, va identifier dans son appartement toute une série d‟odeurs qui lui rappellent son ex-femme. En les répertoriant soigneusement et en analysant les composés chimiques de chacune d‟elles, le narrateur tente de rendre palpable l‟odorat et de matérialiser l‟être absent. L‟ouïe est aussi un des sens les plus stimulés par la ville car le bruit y semble presque omniprésent : circulation, musique, éclats de voix, etc., sont évoqués à l‟envi pour suggérer que la capitale cubaine vit. Abilio Estévez qualifie d‟ailleurs cette dernière de « ciudad del alboroto »521. Dès le XIXème siècle, les auteurs soulignent cette caractéristique : El tráfico de guaguas, tranvías y arrastra-panzas ensordece y marea a los que llegan de los pueblos del interior y abren tamaña bocaza cuando asoman en los parques ; los coches particulares aumentan la animación y el ruido ; oleadas de personas que vomitan las calles del Obispo, O‟Reilly y San Rafael, van a estrujarse en los paseos […] ; los cafés parecen repletos de empleados, periodistas, corredores y otros ilustres desocupados ; los teatros contienen en sus pórticos más o menos elegantes, una muchedumbre […] en fin, de todos lados brota una sinfonía de murmullos que es como la respiración de las grandes capitales.522 Au bruit étourdissant du trafic s‟ajoute celui de la foule qui encombre les rues et les cafés du centre ville. L‟enchaînement de propositions, l‟accumulation de termes au pluriel et les multiples énumérations rendent compte de l‟agitation et du brouhaha. Les activités humaines donnent à ce point vie au paysage urbain qu‟il finit par prendre corps : les rues vomissent et la ville a sa propre respiration. Notons au passage qu‟une métaphore compare la rumeur de la cité à une symphonie harmonieuse (« sinfonía de murmullos ») qui devient le souffle de la ville. Cette personnification permet de concevoir La Havane comme un organisme biologique 520 Ibid., 6:53 am. Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 317. 522 Nicolás Heredia, Un hombre de negocios, op. cit., p. 58. C‟est nous qui soulignons. 521 191 indépendant. L‟ouïe est en cela intéressante qu‟elle participe à plus d‟un titre à l‟anthropomorphisme de la cité. On constate effectivement que si la capitale est source de bruits, elle peut aussi entendre et parler. C‟est ce que suggère Abilio Estévez, dans Los palacios distantes, quand le personnage de Victorio fuit et tente de se cacher dans la ville après un larcin anodin : « Sube despacio, con temor a que La Habana entera escuche los latidos de su corazón »523. La ville, qui est capable d‟entendre, représente une menace pour ce personnage inquiet qui déambule dans une Havane en ruines. Cette personnification va même plus loin dans le roman d‟Estévez puisque une communication peut s‟établir entre le personnage et la capitale. Alors qu‟il sort de chez lui pour se promener sans but précis, Victorio interpelle directement la ville décatie : « […] no le impide [a Victorio] vocear un exaltado Ya nos veremos las caras, al que la ciudad, como era de esperar, no replica. O acaso replica en la voz de una mulata maquillada, perfumada y entallada, quien, al tropezar con él, replica ¡ Este niño, y a ti ¿ Qué te pasa ? ! »524. Comme le souligne le narrateur, c‟est à la manière d‟Eugène de Rastignac, qui à la fin du Père Goriot lance à Paris son célèbre « à nous deux maintenant ! », que Victorio s‟adresse à la ville. Mais sa réplique grandiloquente et théâtrale reste sans réponse (« la ciudad […] no replica »). De façon habile, le narrateur va malgré tout faire intervenir la capitale cubaine par le biais d‟un personnage féminin qui va devenir l‟interprète de la cité (« la ciudad […] replica en la voz de una mulata »). En lui prêtant voix, cette femme donne littéralement vie et corps à La Havane. Il n‟est pas anodin que ce soit une mulâtresse, sans doute une jinetera (quel sens donner sinon aux trois adjectifs qui la qualifient ?), qui incarne la ville. La féminisation de l‟espace urbain permet d‟associer une fois de plus La Havane à une prostituée525 et de rendre de manière directe le parler de la ville. A l‟odorat et à l‟ouïe s‟ajoute enfin la vue, amplement convoquée, il va de soi, dès lors que l‟espace est décrit. La Havane stimule ce sens peut-être plus qu‟un autre grâce à sa luminosité particulière. La lumière des tropiques imprègne complètement le paysage urbain à tel point qu‟elle semble parfois le modeler. Citons à titre d‟exemple le tout début de La joven de la flecha de oro, de Villaverde, qui décrit le lever du jour : Acababa de amanecer, y el tibio sol de invierno […] derramaba mansas olas de luz sobre los techos y campanarios de la ciudad […] ; y a medida 523 Abilio Estévez, Los palacios distantes, op. cit., p. 86. Ibid., p. 43. 525 C‟était déjà le cas dans Las palabras perdidas, de Jesús Díaz, roman évoqué précédemment. 524 192 que el sol se levantaba, descubría más y más la gran población de intra y extramuros con sus arrabales en el fondo de una inmensa hoya, que la forman y circunscriben al oeste el castillo del Príncipe, al sur las lomas de Jesús del Monte, las áridas de Guanabacoa al este, y al norte las tranquilas y azules aguas del mar […]. Quebrábanse los primeros rayos del sol en los vidrios de algunos postigos […]. [Anacleta] Abriñ un postigo con vidrios, y la luz se lanzó por allí, de modo que la asustó y la hizo pestañear ; y vencido el obstáculo de las cortinas de seda, fue a morir en la cándida frente de la joven dormida […].526 A mesure qu‟il se lève, le soleil donne forme à la ville en faisant apparaître les différents quartiers. Le point de vue zénithal permet au narrateur de circonscrire le territoire urbain et de l‟embrasser d‟un seul coup d‟œil. Une fois le décor planté, l‟« Œil solaire »527 du narrateur va pénétrer dans la ville et observer les effets de cette lumière éclatante. Celle-ci semble prendre vie et agresser les habitants, comme l‟attestent le lexique du combat (« quebrábanse », « se lanzó », « vencido », « fue a morir ») et la réaction de l‟esclave Anacleta (« la asustó », « la hizo pestañear »). Mais cette lumière éblouissante, parfois gênante, reste malgré tout source de plaisir. Après avoir été réveillée par Anacleta, la jeune Paulina, du haut de son balcon découvre la ville baignée de soleil : « […] y el sol, ya sobre las cumbres de Guanabacoa, inundaba el cielo y la tierra, la cual pareciñ entonces exhalar un suspiro de placer […] »528. La personnification, encore à l‟œuvre ici, donne vie à la nature qui semble se réjouir de la chaleur que procurent les rayons matinaux. C‟est, bien sûr, une manière détournée de souligner le bien-être de Paulina. La lumière qui participe au contentement d‟un personnage est également présente dans une œuvre bien plus moderne : La Habana para un infante difunto. Alors que le personnage protagoniste sort d‟un bar pour se rendre dans un hôtel accompagné d‟une de ses maîtresses, il est ébloui par le soleil. Lumière et chaleur lui rappellent qu‟il est vivant et heureux : « Me sentía contento de estar vivo en La Habana [...]. La luz violenta del verano se había vuelto un crepúsculo suave, más rosa que malva, mientras caminábamos rumbo a la posada urbana […] »529. Si la lumière est source de ravissement, elle suscite aussi, d‟un point de vue formel, des descriptions chromatiques et poétiques. Nous y reviendrons. Le traitement de la lumière est d‟autant plus intéressant chez Cabrera que c‟est, en partie, sur lui que repose l‟écriture de La Havane. Dans une vision très moderniste de la ville, l‟auteur va se centrer sur ses abondantes lumières artificielles. C‟est d‟ailleurs l‟une des premières choses 526 Cirilo Villaverde, « La joven de la flecha de oro », in La joven de la flecha de oro y otros relatos, op.cit., p. 182-186. 527 Formule de Michel de Certeau déjà employée dans notre première partie. 528 Cirilo Villaverde, « La joven de la flecha de oro », in La joven de la flecha de oro y otros relatos, op.cit., p. 189. 529 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 403. 193 qui frappe le protagoniste, originaire d‟un village de province, dans La Habana para un infante difunto530 : La gran aventura […] sucedìa […] en La Habana de noche, con sus cafés al aire libre, novedosos […] y la profusa iluminación : focos, faros, bombillas, reflectores, letreros luminosos : luces haciendo de la vida un día continuo [...]. Pero en La Habana había luces dondequiera, no sólo útiles sino de adorno, [...] luces dondequiera, en las calles y en las aceras, sobre los techos, dando un brillo satinado, una pátina luminosa a las cosas más nimias, haciéndolas relevantes, concediéndoles una importancia teatral […].531 Les énumérations au pluriel et les répétitions rendent formellement l‟étourdissement du narrateur. D‟autre part, les sources lumineuses recensées une à une éclairent La Havane avec une telle intensité qu‟on ne différencie plus la nuit du jour. En défiant l‟ordre des choses, la ville devient une construction artificielle qui perd de sa matérialité : elle devient un décor factice, trop brillant pour être réel (« un brillo satinado », « una pátina luminosa », « una importancia teatral »). Nous aurons l‟occasion de reparler de la capitale envisagée comme une scène de théâtre car c‟est un leitmotiv qui traverse les siècles532. Disons pour le moment que la vision esthétisante de Cabrera permet de construire une ville résolument moderne qui porte en elle les changements de son temps. Ajoutons que, dans cette œuvre, la lumière permet aussi au personnage d‟interagir avec la capitale : « La ciudad entrándome no sólo por los ojos sino por los poros, que son los ojos del cuerpo era fascinante »533. Grâce à un calembour rapprochant « ojos » et « poros », le narrateur montre qu‟une relation charnelle le lie à La Havane. La synesthésie qui associe les pores de la peau à des yeux ne fait que renforcer l‟idée d‟une relation à la fois intense et concrète. Ce lien intime prend, de surcroît, des allures de communion mystique puisque le personnage compare cette immersion dans la ville illuminée à un véritable baptême : « […] todavìa recuerdo ese primer baðo de luces, ese bautizo, la radiación amarilla que nos envolvía, el halo luminoso de la vida nocturna, la fosforescencia 530 C‟est aussi ce qui étonne la jeune Cuca, dans Te di la vida entera : « Una niebla salitrosa cubría de misterio la noche iluminada con focos amarillos en majestuosas e imponentes lámparas […] Cuquita […] pensaba […] en la oscuridad tan desolada de los campos, y en seguida los comparó con la luminosidad de La Habana, tan bella, tan nueva y tan radiante para sus ojos », Zoé Valdés, Te di la vida entera, op. cit., p. 27, 28. 531 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 13. 532 Au XIXème siècle, Cirilo Villaverde parle déjà de la ville comme d‟un spectacle dont la mise en scène accorde une place prépondérante à la lumière : « Espectáculo digno de contemplarse era, en efecto, entonces, el paseo en carruaje y a caballo, del nuevo Prado de La Habana, iluminado a medias por los últimos rayos de oro del sol poniente, que en las tardes de otoño o de invierno se degradan en manojos de plata, antes de confundirse con el azul purísimo de la bóveda celeste », Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 216 533 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 18. 194 fatal […] »534. Le lexique choisi (« radiación », « halo », « fosforescencia ») et la gradation finale (« amarilla », « luminoso », « fatal ») rendent l‟atmosphère citadine mystérieuse et presque fantastique. Chez Cabrera Infante, la vue revêt un autre aspect : l‟observation attentive du paysage urbain et de ses habitants. Scruter la ville devient un des passe-temps favoris du protagoniste qui ne se définit pas simplement comme un simple observateur mais comme un voyeur. Autrement dit, ce n‟est pas le spectacle de la cité qui l‟intéresse mais l‟intimité de celle-ci. D‟ailleurs, d‟après lui, La Havane est la ville du voyeurisme par antonomase : « En La Habana, donde el voyeurismo era una suerte de pasión nativa, como el canibalismo entre los caribes, no había una palabra local para describir esta ocupación que a veces se hacía arte popular »535. Cette habitude qui, comme par atavisme, semble concerner tous les Havanais devient une des nouvelles passions du personnage à laquelle il s‟adonne du haut de son immeuble. Depuis la azotea, il observe sans être vu la rue Zulueta et surtout les chambres de l‟hôtel « Pasaje » tout proche. Plus tard, quand il changera de quartier et habitera dans le Vedado, cette habitude ne le quittera pas, au contraire : […] fue en el apartamento de la calle 27 y Avenida de los Presidentes que me volví un mirón minucioso, activo en mi pasividad. [...] De noche solía sentarme en nuestro balcón [...] solo en mi acecho. Curiosamente esto era lo más excitante de la caza visual : aguardar a que se produjera un desnudo [...]. Pero ahora yo buscaba expresamente esa exhibición que era, por supuesto, ignorada por esas mujeres, […] vìctimas de la violaciñn visual del voyeur.536 L‟antithèse « activo en mi pasividad » rend bien compte de la contradiction du voyeur, mise au jour dans cet extrait. Il se considère comme un chasseur aux aguets qui attend patiemment sa proie. Notons au passage que cette attente constitue une fin en soi puisqu‟elle est finalement ce qu‟il y a de plus excitant. La métaphore filée de la chasse (« acecho », « caza », « aguardar », « víctimas ») fait du personnage un prédateur, c‟est d‟ailleurs aussi comme cela qu‟il se voit quand il séduit une femme537. Le voyeurisme envisagé comme une passion havanaise est manifeste aussi chez Ponte, dans un texte dont le titre est on ne peut plus explicite : « Los ojos en La Habana ». Le champ lexical de la vue y est omniprésent : 534 Loc. cit. Ibid., p. 286. 536 Ibid., p. 287. 537 Nous renvoyons à notre partie précédente sur l‟espace conquis. 535 195 Los edificios habaneros valen […] por lo que dejan a la indiscreción, por cuánto dejan asomarse hacia adentro. […] Decir paseante en La Habana es decir voyeur. […] En La Habana se acostumbra a mirar rostros, cuerpos, con el mismo aire con que un turista revisa un monumento y, si es posible, con mayor descaro. El habanero mira a la cara y pone en ello todo. Mirar a los ojos es una pasión habanera. Mirar, ser mirado. Casi ofender con la mirada y, a su vez, recibir la ofensa devuelta. 538 Répétitions et polyptotes mettent en lumière une réciprocité dans l‟acte de regarder. Contrairement à Cabrera Infante, Ponte montre que tout le monde se scrute mutuellement à La Havane et que l‟intérêt de ce « jeu » réside justement dans l‟échange. Ici, le flâneur devient forcément voyeur et son regard est si insistant qu‟il peut outrager. Là encore, la synesthésie semble s‟imposer pour témoigner de la force d‟un sens (« ofender con la mirada », « recibir la ofensa devuelta »). Le narrateur conçoit ces regards échangés comme de véritables joutes visuelles. Leur vigueur est telle que, un peu plus loin dans le texte, c‟est la ville elle-même qui observera : « La ciudad es esos ojos durante un momento »539. La Havane, une nouvelle fois personnifiée, peut regarder. Cette image se concrétise d‟ailleurs lorsque Ponte, dans une métaphore très poétique, va comparer la peinture écaillée des murs décrépits de la ville à des yeux : « La vieja pintura abre párpados en la pintura más reciente y desde esas manchas nos mira en las paredes la mirada del tiempo »540. La ville observe et vit dans sa chair, pourrait-on dire, les ravages du temps. Si les sens (l‟ouïe, l‟odorat, la vue) donnent vie et corps à la cité de manière fragmentée, notons aussi que la ville apparaît parfois comme un organisme vivant faisant partie d‟un tout : […] Mñnica sale al balcñn de su apartamento y mira hacia […] La Rampa, el corazón de la ciudad, por donde fluye toda la sangre de La Habana, el gran corazón de La Habana, su verdadero centro. Pam, pam, resuena el corazón cuando los ómnibus, los autos, los camiones, las bicicletas […] hacen sonar sus bocinas […]. Ram, ram, se agita el corazón cuando la muchedumbre corre para tomar un ómnibus que acaba de detenerse a veinte metros […]. Ta, ta, ta, se fatiga el corazón al pasar otro ómnibus con hombres colgados de puertas y ventanillas […].541 Dans cet extrait de Travieso, déjà évoqué dans notre première partie, la ville est un cœur qui bat et La Rampa une de ses artères (au sens propre comme au figuré). Ce cœur palpite, s‟accélère, ralentit mais son fonctionnement n‟est pas dû aux activités humaines. En effet, si 538 Antonio José Ponte, « Un seguidor de Montaigne mira La Habana », in Un seguidor de Montaigne mira La Habana. Las comidas profundas, op. cit., p. 42. C‟est nous qui soulignons. 539 Loc. cit. 540 Ibid., p. 40. 541 Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 42, 43. C‟est nous qui soulignons. 196 nous avons vu précédemment que la cité prenait vie grâce à l‟intervention humaine, nous constatons à présent que c‟est le contraire qui se produit : La Havane, en tant qu‟organe, permet à ces activités de se produire. Cette comparaison permet à Travieso de montrer de la manière la plus évidente qui soit que la ville est un espace de vie. Cette idée est d‟ailleurs renforcée par les répétitions, les onomatopées et la succession de verbes d‟action. De manière tout à fait symbolique, Cabrera Infante, dans son roman autobiographique, ne dit pas autre chose quand, en réinterprétant un vers de José Martí (« Dos patrias tengo yo : Cuba y la noche »), il associe la ville à l‟utérus maternel : « Dos matrias tengo yo : La Habana y la noche »542. La cité devient matrice, donc mère, et incarne la fécondité et la vie. La lecture que fait Claudia Hammerschmidt de l‟incipit de La Habana para un infante difunto est en cela éclairante. Elle voit dans l‟ascension du jeune protagoniste qui, fraîchement arrivé à La Havane, monte pour la première fois de sa vie des escaliers, une mise au monde : […] marca un primer nacimiento del yo narrado a un universo nuevo y desconocido. Este nacimiento puesto en escena y como « túnel » y como espectáculo Ŕ por lo cual este nacimiento sugiere también la entrada al escenario del mundo Ŕ se hace explícitamente iniciación a una nueva etapa […].543 La Havane donne une deuxième naissance au personnage et ce n‟est pas anodin si cette ascension constitue le tout premier souvenir qu‟il garde de La Havane. L‟épilogue fantastique, mais tout aussi symbolique, qui clôt le roman est encore plus explicite à ce propos. Alors qu‟il est dans une salle de cinéma de la capitale avec une femme, le personnage cherche tout d‟abord son alliance, puis sa montre, dans le vagin de celle-ci et se retrouve soudainement happé par le corps féminin. Perdu à l‟intérieur de l‟utérus, il parvient néanmoins à s‟éclairer et à progresser dans cet espace inquiétant : […] dirigì la linterna hacia las paredes primero, que brillaron rosadas, coralinas o reflejando puntos de color escarlata. Hacia el fondo la luz se perdió en una curva morada. Gateé como pude por la rampa mucosa hasta el orificio por el que habìa caìdo […]. Solamente vi un vestíbulo a oscuras con una campana malva arriba y unas colgaduras moradas a los lados. […] Me hallaba en un laberinto […] me encontré con un cul-desac. […]. El cul-de-sac […] habìa pasado por mi lado empujado por 542 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 425. Claudia Hammerschmidt, « Del „experimento ecolñgico‟ a la autobiografìa Ŕ y viceversa : La Habana para un infante difunto de Guillermo Cabrera Infante », in Carmen Ruiz Barrionuevo, Francisca Noguerol Jiménez, Mª Ángeles Pérez López, Eva Guerrero (éd.)., La literatura iberoamericana en el 2000. Balances, perspectivas, prospectivas, Salamanque, Universidad de Salamanca, 2003, p. 1541. http://www.romanistik.uni-jena.de/wp-content/uploads/2009/03/del-experimento-ecologico-a-la-autobiografia-yviceversa.pdf (consulté le 07/03/13) 543 197 muros color violeta y mucosas columnas enfermas y modulores blandos.544 Les entrailles de la femme clairement suggérées par les couleurs, les formes et la consistance des parois ne sont pas sans rappeler la ville même, comme le souligne Dominique Diard : « Convergent ainsi vers le fond de l‟abîme […] la femme et La Havane, „La Ville des colonnes‟, toutes deux rassemblées dans l‟expression „colonnes muqueuses‟ »545. Contrairement au début du roman, l‟homme ne renaît pas ici mais retourne dans les profondeurs de la matrice originelle, à l‟intérieur de la ville-mère (incarnée ici par la salle obscure de cinéma, puis par le corps féminin), avant d‟en être violemment éjecté 546. Le roman s‟achève d‟ailleurs abruptement sur cette deuxième renaissance allégorique : « Empecé a girar en un torbellino sin centro. Stop ! Luego hubo como un choque en una falla, un estertor en la espelunca y caí libremente en un abismo horizontal. Aquí llegamos »547. Non sans violence, le personnage est expulsé de la matrice et renaît, tel Jonas sortant de la baleine. Gaston Bachelard qui, dans une lecture psychanalytique, interprète ce mythe comme un retour à la mère, verrait dans cet épisode une « naissance de l‟initié après l‟initiation »548. Notons que cette deuxième mise au monde allégorique fait écho à l‟incipit et boucle ainsi la boucle. Sans nous étendre davantage sur la lecture symbolique de cet épilogue aux allures d‟odyssée549, terminons simplement en soulignant que la ville-matrice apparaît aussi dans le roman grâce à la métaphore du cordon ombilical : « La etapa Zulueta 408, más que un tiempo vivido, fue toda una vida y debió quedar detrás como la noche, pero en realidad era un cordón umbilical que, cortado de una vez, es siempre recordado en el ombligo »550. Bien plus qu‟une simple étape dans son existence, le protagoniste considère ses premières années à La Havane (l‟époque de la rue Zulueta) comme une période de gestation au cours de laquelle il serait relié à la ville-mère par un cordon. Cette vie avant la vie (avant une autre vie, en fait), l‟a marqué à tout jamais dans sa chair, comme le suggère l‟évocation finale du nombril. Il est 544 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 503-505. Dominique Diard, « La Havane baroque et créole de Guillermo Cabrera Infante dans La Habana para un infante difunto », in La ville caraïbe : baroque et créolité, Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Caen, n°35, novembre 2003, p. 119. 546 Toujours dans cette idée de ville-corps capable d‟engloutir, notons que La Havane est aussi pensée comme un ventre qui ingère le protagoniste : « […] a mì me habìa tragado la ciudad profana para siempre », Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 341. 547 Ibid., p. 509. 548 Gaston Bachelard, « Le complexe de Jonas », La Terre et les rêveries du repos, 2e éd., Paris, José Corti, « Les Massicotés », 1948, p. 172. 549 Nous renvoyons à l‟article de Dominique Diard, « La Havane baroque et créole de Guillermo Cabrera Infante dans La Habana para un infante difunto », in La ville caraïbe : baroque et créolité, op. cit., p. 118-120. 550 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 122. 545 198 inutile de dire que les métaphores utérine et ombilicale ne font que souligner les liens viscéraux qui unissent le personnage narrateur à La Havane. Les descriptions anthropomorphiques qui permettent à la ville de prendre corps sont le résultat d‟une conception culturelle de la cité. Ainsi littérarisée et esthétisée, celle-ci devient un espace vivant et acquiert plus que jamais le statut de personnage. Parce qu‟elle est envisagée comme un lieu de vie, voire comme la matrice donnant la vie, la capitale cubaine peut être associée au paradis originel. 2- La construction du paradis a- De l’Eldorado au paradis retrouvé Si nous poursuivons notre lecture symbolique de l‟espace urbain, en nous appuyant toujours sur une interprétation biblique, nous constatons que trois approches permettent de construire une cité édénique. La Havane est tantôt conçue comme le paradis retrouvé, tantôt comme l‟Éden duquel on est expulsé, tantôt comme le paradis perdu. Nous avons souligné précédemment que les arrivées à la capitale étaient souvent chargées de sens. La Havane peut apparaître comme un paradis que l‟on découvre pour la première fois ou que l‟on retrouve après un temps d‟absence. L‟Espagnol Vicente Cueva, personnage de Mi tío el empleado, est séduit par la capitale dès son arrivée : […] la música de la retreta que poblaba el espacio de acordes armoniosos y dulces melodías ; los paseantes […] iban y venían por las torcidas callejuelas orilladas de arbustos, todo esto se presentó a nuestra vista con cierto encanto desconocido, inexplicable. El parque con sus ruidos, movimientos, luces, fuentes cristalinas, verde césped, alegres flores, nos pareció entonces una especie de soñado edén.551 Le narrateur découvre la ville et son agitation (musique, passants, bruits) qui mettent, une fois de plus, les sens à contribution. Il est charmé par ce paysage urbain agréable, comme l‟attestent les adjectifs laudatifs (« armoniosos », « dulces », « cristalinas », « alegres ») et les substantifs (« encanto », « edén »). L‟expression finale, « una especie de soñado edén », est on ne peut plus explicite : La Havane est, pour Vicente Cueva, un véritable Eldorado. Julián Mesa, paysan cubain sans le sou, ne parle-t-il pas, quant à lui, de « encontrar en La Habana 551 Ramón Meza, Mi tío el empleado, op. cit., p. 33. 199 [su] sueño dorado »552 ? Mettant tous ses espoirs dans la capitale et les possibilités qu‟elle représente, le jeune guajiro ne se laisse pas décourager quand on lui explique que la vie y est très difficile553 ou quand une pluie battante l‟accueille à son arrivée : « Llovía a cántaros cuando el tren llegó a la Estación Terminal. Se había cumplido un sueño mío y empezaba para mí una nueva vida »554. Rien ne peut ébranler sa confiance et sa volonté de réussir car la ville représente pour lui un rêve qui se matérialise. Être à La Havane est déjà une fin en soi (« se había cumplido un sueño mío ») puisque tous les possibles s‟ouvrent à lui. Revenir à Cuba et retrouver la capitale sont également lourds de sens pour certains personnages. Fotuto, personnage du roman éponyme de Miguel de Marcos, est très attaché à la ville, malgré tous les déboires qu‟il y a connus. Ainsi, après s‟être enfui à New York pour échapper à la police cubaine, il n‟a qu‟une envie : retourner à La Havane. Il s‟agit même d‟un besoin vital et impérieux : « Necesito volver a La Habana, necesito respirar el aire de la lechería de San Lázaro y Manrique, necesito los bancos del Parque Central, necesito la esquina de Galiano y San Rafael »555. La répétition du verbe « necesitar », l‟allusion à l‟air qu‟on y respire et aux lieux précisément évoqués marquent son profond attachement à la ville. Son retour prend donc des allures d‟arrivée au pays de Cocagne : En la mañana del 23 de agosto avistaron La Habana. Fue una impresión única de júbilo sagrado y que el ex guarijito villareño saboreaba por la primera vez. Todo le parecía nuevo y desconocido, pero todo le entraba dulcemente en el corazón. Mira, Héctor, El Morro. ¿ No ves allá una cosita que se mueve, una cosita de tres colores ? Es la bandera cubana. […]. Mira, mi hermano. El monumento a Maceo… El Vista Alegre… Mira, mira.556 Accompagné de ses amis Héctor et Mr. Carroll, Fotuto retrouve la Terre promise, comme le suggère l‟expression religieuse « júbilo sagrado ». L‟importance de ce moment est indéniable, le narrateur en rappelle précisément la date et montre que les impressions ressenties sont uniques (« impresión única », « por la primera vez », « nuevo », « desconocido »). La symbiose entre le protagoniste et la ville est manifeste et ces retrouvailles ont un effet physique immédiat sur Fotuto (« todo le entraba dulcemente en el corazón »). Ne pouvant 552 Miguel Barnet, La vida real, op. cit., p. 82. Dans le train qui l‟amène à la capitale, un homme lui dit : « La Habana no es la que la gente se cree. Allá se dobla el lomo de verdad ». Un peu après, Emerlina, sa fiancée, lui explique : « La Habana es muy dura. Y tú ahí no vas a levantar cabeza más nunca », ibid., p. 83 et p. 99. 554 Ibid., p. 89. 555 Miguel de Marcos, Fotuto, op. cit., p. 444. 556 Ibid., p. 444, 445. 553 200 cacher sa joie, le protagoniste s‟exclame à plusieurs reprises « Mira », dans un enthousiasme qui se voudrait contagieux et dont la vigueur est accentuée par le passage au style direct à l‟intérieur même de la narration. Enfin, pour bien marquer son attachement au pays, Fotuto attire l‟attention de ses compagnons sur des symboles patriotiques : le drapeau cubain et la statue équestre du leader indépendantiste Antonio Maceo. Même s‟il s‟agit d‟un retour en demi-teinte, l‟arrivée à La Havane d‟Esteban, personnage de El siglo de las luces, met un point final à un long voyage aussi initiatique que cauchemardesque (« una larga pesadilla Ŕ pesadilla de incendios, persecuciones y castigos […] »557). Après une série d‟expériences intenses et brutales558, ce retour marque une sorte de pause qui sera propice au bilan. Ce ne sont pas tant les retrouvailles avec la maison familiale qui enthousiasment Esteban que celles avec la ville : Estaba impaciente por respirar los aires de una ciudad que, al desembarcar, le habìa parecido muy cambiada. […] Hasta el atardecer anduvo, errante por las calles de los Oficios, del Inquisidor, de Mercaderes, yendo de la Plaza de Cristo a la Iglesia del Espíritu Santo, de la remozada Alameda de Paula a la Plaza de Armas, bajo cuyas arcadas se concertaban ya, en crepúsculo, bullentes tertulias de transeúntes desocupados. Aglomerábanse los papanatas ante las ventanas de una casa de donde cundía el sonido nuevo de un pianoforte recién traído de Europa. Taðìan guitarras los barberos, en el umbral de sus oficinas. […] dos sabrosas esclavas le hicieron ofertas al pasar. Esteban sopesó las monedas que llevaba y se metió con las dos, en las penumbras de un 559 equìvoco albergue… Esteban retrouve une ville qui a certes changé mais qui est restée vivante grâce aux nombreux badauds et à la musique omniprésente. Les rues et les lieux parcourus sont énumérés comme pour signifier qu‟il se réapproprie un territoire précis qu‟il convient de nommer. Cette idée est renforcée par la rencontre avec les deux prostituées qui, de manière allégorique, semble matérialiser ces retrouvailles avec le pays natal560. De manière encore plus évidente, le voyage à La Havane marque un retour aux sources chez la Comtesse Merlin. Presque quarante ans après avoir quitté la capitale cubaine pour l‟Europe, María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo entame un véritable « viaje a la semilla »561. 557 Alejo Carpentier, El siglo de las luces, op. cit., p. 280. Le narrateur parle de « años convulsos y desaforados », ibid., p. 290. 559 Ibid., p. 291. 560 Ces lignes ne sont pas sans rappeler le court essai de Carpentier « La Habana vista por un turista cubano », où l‟auteur fait part de se redécouverte de la ville après onze ans d‟absence. Id., « La Habana vista por un turista cubano », in Alejo Carpentier, El amor a la ciudad, La Habana de Alejo Carpentier (1996), Madrid, Alfaguara, 1997, p.17-57. 561 Nous empruntons cette expression à Alejo Carpentier. 558 201 Contrairement à Esteban, elle est ravie de retrouver sa ville natale et la maison familiale. Pas de demi-teinte ici, tout est joie et contentement et ce bien avant d‟arriver à La Havane : Depuis quelques heures je suis immobile, humant à pleine poitrine l‟air embaumé qui m‟arrive de cette terre bénie de Dieu… Salut, île charmante et virginale ! salut, ma belle patrie ! Je le sens à ces battements de mon cœur, à ce frémissement de mes entrailles, l‟éloignement et les longues années n‟ont pas attiédi mon premier amour ! Je t‟aime et ne pourrais te dire pourquoi […]. Lorsque je respire ce souffle parfumé que tu m‟envoies, lorsque je le sens qui effleure doucement mon front, je frémis jusqu‟à la moelle, et je crois sentir la tendre étreinte du baiser maternel !562 L‟air des Caraïbes, qui lui fait l‟effet d‟un « baiser maternel », permet d‟enclencher un processus de réminiscence qui sera à l‟œuvre tout au long du récit. L‟allusion claire à l‟enfance et à la mère-patrie indique que ce voyage est placé sous le signe de l‟anamnèse. La Comtesse, âgée d‟une cinquantaine d‟années, part retrouver ses souvenirs et son enfance à La Havane. Ce voyage dans le temps a des effets immédiats : les sensations physiques (« battements de cœur », « frémissement de mes entrailles », « je frémis jusqu‟à la moelle ») se mêlent à l‟émotion pour marquer l‟attachement, là encore, viscéral de la Comtesse à Cuba. Aimée comme une personne563, l‟Île représente, on l‟aura compris, le paradis de l‟enfance. Quand elle arrive enfin à La Havane et reconnaît son oncle qui l‟attend sur une chaloupe, elle s‟exclame : « […] on dirait que mon cœur devient ma vue dans cet instant, car je sens mon cœur, ma vue et ma mémoire se confondre dans cette vive révélation »564. Seule la synesthésie semble être à même de montrer que les souvenirs se présentent simultanément aux sens et à la conscience de la narratrice. Le présent et le passé se bousculent et finissent même par fusionner. Dorénavant, La Havane ne sera plus que cela : un espace-temps ambivalent où passé et présent se confronteront565. Les lieux qu‟elle retrouve sont ainsi l‟occasion d‟évoquer un passé heureux toujours magnifié : La terrasse de la maison de Mamita ! Ŕ Toute mon âme s‟élance vers ces lieux ! [...] C‟est là que toujours entourée d‟exemples d‟ordre et de 562 La Comtesse Merlin, La Havane, T. I, op. cit., p. 267, 268. Elle dira aussi un peu plus loin : « […] je suis toujours là, humant l‟air natal et dans un ravissement presque comparable à celui de l‟amour heureux », ibid., p. 271. 564 Ibid., p. 295, 296. 565 Dans une étude comparant ce récit de voyage à Viaje a La Habana, de Reinaldo Arenas, Françoise Moulin Civil parle de « „narcissisation‟ de l‟espace-temps à l‟intérieur d‟un récit où tout, sans cesse, se ramène au sujet », Françoise Moulin Civil, « De la Comtesse Merlin à Reinaldo Arenas : les avatars d‟un voyage à La Havane », in Philippe Meunier ; Jacques Soubeyroux (éd.), Le voyage dans le monde ibérique et ibéroaméricain, Actes du XXIXème Congrès de la SHF, Saint Etienne, 19-21 mars 1999, Publications de l‟Université de Saint-Etienne, 1999, p. 58. 563 202 sagesse, j‟appris à connaître et à aimer le bien ; c‟est là que la vertu m‟apparut comme inséparable de notre nature, tant ses divins préceptes étaient appliqués sans effort aux plus simples actions de la vie !566 L‟allusion à son arrière-grand-mère maternelle et aux préceptes que celle-ci lui a inculqués font de La Havane la scène de l‟apprentissage de la vertu. Tout de suite après, la Comtesse rappelle la pureté des sentiments qui accompagnait cette éducation : Mon âme est saisie d‟un attendrissement profond à la vue de ces lieux où je fus reçue dans la vie avec tant d‟amour et de sollicitude, où j‟ai vu éclore tant de bons sentiments ! Ŕ Ici la charité se pratiquait en famille […]. A de tels souvenirs, je sens mille ardentes sympathies se réveiller dans mon sein.567 Cette sorte de « temps retrouvé », marqué du sceau de l‟amour et de la bienveillance, ravive un bonheur passé grâce à l‟émergence de souvenirs restés intacts dans le présent. Les sentiments et les impressions d‟antan renaissent avec la même ardeur. Les retrouvailles avec le paradis de l‟enfance se manifestent par un élan d‟émotions que la Comtesse ne peut ni ne veut contenir. Et comme pour résumer la mise à l‟œuvre de la mémoire et la résurgence de cette félicité, elle dira un peu plus loin : « Chaque objet qui frappait ma vue renouvelait une impression d‟enfance, et je me sentais pénétrée de je ne sais quelle joie folle et sauvage qui m‟attendrissait et me faisait pleurer »568. C‟est comme si La Havane permettait au passé de se révéler à nouveau, de ressusciter et de signifier que rien de ce qui a été vécu par la narratrice n‟est perdu. Le retour à La Havane est aussi synonyme, entre autres choses, d‟une renaissance nourrie par de très fortes émotions dans Viaje a La Habana de Reinaldo Arenas569. Ce n‟est d‟ailleurs pas innocent de la part d‟Arenas de reprendre le titre espagnol de l‟œuvre de la Comtesse Merlin570. Ismael, le protagoniste va, en effet, effectuer lui aussi un voyage dans le passé en retournant à La Havane pour y retrouver son ancienne femme et son fils. Avant de quitter New York, où il s‟est exilé, il s‟imagine ce que pourrait être ce retour au pays. Dans un passage mêlant narration omnisciente et narration homodiégétique, Cuba et les Etats-Unis sont comparés dans un va-et-vient permanent : 566 La Comtesse Merlin, La Havane, T. I, op. cit., p. 288. Ibid., p. 289. 568 Ibid., p. 297. 569 Cette œuvre relate à travers trois nouvelles plusieurs voyages : la fuite de La Havane (« Que trine Eva »), l‟exil (« Mona ») et le retour à La Havane (« Viaje a La Habana »). 570 L‟épigraphe de cette nouvelle est aussi empruntée au récit de la Comtesse Merlin (« ¡ Sólo encuentro un montón de piedras sin vida y un recuerdo vivo ! »). 567 203 […] él quiso ser aquel joven, solitario e independiente que nadaba en un mar transparente, no como estos de aquí fríos y cenicientos donde nunca se les ve el fondo ; quiso sentir la brisa de su tierra, no este viento cortante que nos obliga a forrarnos con trapos de pies a cabeza, quiso, sólo por un momento, sólo por una vez en su vida, en mi muerte, pasearse por las calles donde había sido joven, donde había sido él, no por estas calles donde siempre he sido un extraño caminando a empujones ; quiso no solamente pasearse por las calles de su barrio, de allá, sino detenerse en una esquina, tocar una pared […], sentir la brisa de la tarde entrar a sus pulmones, cómo la noche le rozaba la piel, esa noche única del trópico ; sentir que entre él y el paisaje no había hostilidad, sino, por el contrario, una dulce y sensual sensaciñn de complicidad […].571 La double narration donne plus de force au jeu antithétique qui oppose, non sans manichéisme, le pays de l‟exil et la terre natale. Progressivement, le « je » de la narration interne s‟efface au profit de la narration omnisciente et la comparaison systématique cesse. Le voyage s‟impose à Ismael comme une évidence, les Etats-Unis disparaissent petit à petit et seul Cuba semble exister. Il s‟agit là aussi d‟un retour aux sources, comme le suggère l‟allusion à son quartier et à la jeunesse qu‟il prétend retrouver. Comme chez la Comtesse Merlin, les retrouvailles passent par le corps et les sensations physiques. C‟est le toucher qui prédomine dans cet extrait préfigurant le retour (« tocar », « sentir la brisa », « rozaba la piel », « dulce »). L‟osmose entre le personnage et Cuba est manifeste dans les dernières lignes puisqu‟une relation sensuelle et harmonieuse les unit. Bien sûr, il s‟agit là du voyage imaginé, fantasmé et idéalisé depuis l‟exil et nous verrons un peu plus loin qu‟il diffèrera de la réalité. Cela dit, les retrouvailles physiques avec la ville qui se traduisent par des sensations retrouvées ont bel et bien lieu : […] salir de pronto a aquella claridad, a la tibieza de aquella tarde, fue como recuperar súbitamente su juventud, como sentirse súbitamente transportado a un tiempo mágico, detenido en la espera, exclusivo para él, donde en oleadas vivificantes, algo Ŕ aquella luminosidad, aquel resplandor, aquel cielo insólitamente alto y azul Ŕ le penetraba por los poros, por la nariz, por el cabello, por la punta de los dedos y lo conminaba a avanzar, ajeno a toda sensación que no fuera andar, ver, estar.572 La magie semble opérer lors de sa première sortie dans Miramar, tout près de son hôtel. Ses sens sont stimulés (la vue et le toucher surtout) et la fusion imaginée se produit réellement : la ville pénètre complètement en lui (« le penetraba por los poros, por la nariz, por el cabello »). De plus, le voyage dans le temps fonctionne puisqu‟il retrouve sa jeunesse : l‟expression « tiempo mágico » évoque cet âge d‟or recouvré de manière quasi surnaturelle. Enfin, c‟est 571 572 Reinaldo Arenas, Viaje a La Habana (1990), Miami, Ediciones Universal, 2000, p. 117, 118. Ibid., p. 120. 204 comme s‟il vivait à nouveau en redécouvrant la lumière et la chaleur de Cuba, comme le signifient les trois verbes à l‟infinitif clôturant cet extrait. Et le narrateur de poursuivre en matérialisant encore davantage ces retrouvailles grâce à une personnification de la ville : « Cada árbol parecía hacerle como una misteriosa señal de complicidad, emitiendo un susurro que le saludaba ; el mismo césped, los bancos de la avenida, el tiempo, todo, también parecía saludarlo »573. Tous les éléments de la ville communiquent avec lui comme pour illustrer leur complicité retrouvée. Mais nous constaterons très vite que vouloir retrouver le temps passé est illusoire. Nous avons vu à travers ces exemples que La Havane représentait un Eldorado pour certains personnages en quête d‟une existence meilleure, qu‟elle était le paradis retrouvé pour d‟autres et qu‟elle pouvait même, grâce à un processus anamnestique, faire renaître le passé. Mais c‟est aussi parce qu‟on peut en être chassé que la ville est appréhendée comme un paradis. b- L’expulsion du paradis Un peu comme s‟ils devaient quitter l‟Éden, certains personnages vont abandonner La Havane avec tristesse et regret. Puisque nous avons étudié les retrouvailles de la Comtesse Merlin avec sa terre natale, nous allons voir à présent comment son départ est évoqué. Par deux fois, María de las Mercedes doit quitter Cuba : la première lorsque, âgée de douze ans, elle part vivre à Madrid pour retrouver ses parents ; la seconde, qui a lieu presque quarante ans plus tard, quand elle regagne la France après avoir effectué un séjour de plusieurs mois dans l‟Île. Dans ses mémoires, l‟auteur se rappelle le tout premier départ avec le regard distancié de l‟adulte qui n‟a cependant pas oublié la profonde tristesse ressentie alors : En m‟éloignant de mon pays, je quittais tout ce qui m‟avait aimé, tout ce que j‟avais aimé jusqu‟alors, et je sentais même, à cet âge où les habitudes ont de si courtes racines, combien est douloureux à l‟âme ce passage qui sépare les affections passées des affections nouvelles.574 Ce départ, vécu comme une déchirure, marque une étape dans son enfance, un « passage », écrit-elle. La jeune fille laisse derrière elle un pays, des amis, une famille aimée et aimante, une vie douce et agréable. Malgré son âge, elle semble avoir pleinement conscience de ce que 573 Ibid., p. 120. La Comtesse Merlin, Souvenirs et mémoires de Madame la Comtesse Merlin. Souvenirs d’une créole, op. cit., p. 70. 574 205 représente cette séparation, aussi ne peut-elle pas contenir sa peine quand la ville au loin disparaît complètement : Appuyée sur la balustrade de la poupe, les yeux fixés sur la ville, je la vis s‟éloigner, s‟obscurcir, et enfin disparaître !... Alors je n‟aperçus plus autour de moi que l‟immensité de la mer et du ciel. Je n‟avais pas peur ; mais en faisant un retour sur moi-même, je fus saisie du sentiment de ma faiblesse et je fondis en larmes […].575 Depuis le bateau qui la conduit vers une Europe inconnue, la jeune María de las Mercedes regarde son départ se matérialiser : à mesure qu‟elle pénètre dans « l‟immensité » de l‟océan, la ville, au contraire, disparaît graduellement (« s‟éloigner », « s‟obscurcir », « disparaître »). Dans ces deux extraits, c‟est bien sûr la femme adulte qui suggère en filigrane que ce départ symbolise la fin de l‟insouciance et l‟expulsion du paradis de l‟enfance. Le départ de la Comtesse lorsqu‟elle a cinquante-deux ans n‟est naturellement pas aussi lourd de sens. Il ne marque pas le passage d‟un âge à un autre, ni l‟abandon d‟une vie pour une autre ; cela dit, son importance est indéniable car il met un terme à un voyage qui fut, comme on l‟a dit, un retour aux sources : Malgré l‟heure peu avancée les balcons, étaient remplis de monde qui nous saluait et nous souhaitait un heureux voyage. Mais au milieu de ce bruit, de ce mouvement, de cette foule, mes yeux étaient toujours attachés sur ce toit hospitalier où j‟avais été reçue comme l‟enfant aimée de la maison !... et de grosses larmes ruisselaient lentement sur mes joues… On le voyait solitaire, ce balcon paternel où mon âme s‟épanouissait si souvent au souffle de la brise… Personne n‟avait osé affronter notre départ, et les volets de ma tante étaient restés fermés ; les jalousies, les stores, tout était hermétiquement fermé… 576 Ignorant l‟agitation qui accompagne son départ, la Comtesse ne peut détacher son regard de la maison familiale où elle a été accueillie à bras ouverts par ses proches. La ville et les gens alentour s‟effacent au profit de cette demeure qui symbolise à la fois le lieu des retrouvailles mais aussi le lieu de l‟enfance. Ne se qualifie-t-elle pas d‟ailleurs d‟« enfant aimée de la maison », comme pour signifier qu‟à Cuba elle est redevenue la fillette qu‟elle était ? L‟idée d‟un retour à l‟origine est également manifeste quand l‟auteur évoque le balcon paternel. Soulignons au passage que ce balcon était aussi l‟une des premières choses qu‟elle distinguait en arrivant à La Havane577. Le voyage commence et se clôt sur la même image : celle du 575 Ibid., p. 71. Id., La Havane, T. III, op. cit., p. 192. 577 « J‟aperçois déjà le balcon de la maison de mon père qui s‟allonge en face du château de la Punta », id., La Havane, T. I, op. cit., p. 286. 576 206 balcon de la maison du père qui, du reste, est synonyme d‟un bonheur infini (« où mon âme s‟épanouissait »). Quoi de mieux que la maison pour symboliser ce retour aux sources puisqu‟elle est, pour Bachelard, « le premier monde de l‟être humain »578 ? Bien sûr, la fin du voyage est douloureuse car elle marque une rupture nette et définitive avec l‟enfance chérie que la Comtesse a tenté de retrouver pendant son séjour, dans un processus « rétroinitiatique »579. Ces « retrouvailles » avec le passé s‟achèvent sur une image éloquente : la maison familiale est complètement close au moment de son départ. En insistant sur cette demeure « hermétiquement fermé[e] », la narratrice semble signifier que le retour à l‟origine est lui-même clos. Partir signifie donc quitter une nouvelle fois l‟enfance pour ne plus jamais la retrouver. On comprend de la sorte pourquoi ce deuxième départ de Cuba est encore plus douloureux que le premier (« de grosses larmes ruisselaient »)580. Essayant d‟imprimer dans sa rétine, comme pour les photographier, les dernières images de Cuba et souhaitant emporter avec elle l‟air doux des tropiques, María de las Mercedes ne quitte pas le pont du navire : Nous longeons toujours l‟île, et je reste toujours là immobile à la contempler jusqu‟à ce qu‟elle disparaisse… Je veux dire adieu à son dernier rivage, au dernier rayon du soleil qui l‟éclaire… Je veux remplir ma poitrine du dernier souffle de la brise qui caressa ses bords… 581 Le récit de voyage se termine sur l‟image d‟une Île personnifiée (« dire adieu à son dernier rivage », « la brise qui caressa ses bords») et d‟une femme figée par la gravité de l‟instant, gravité que renforce la répétition de l‟adjectif « dernier ». C‟est aussi la tristesse qui domine quand le jeune orphelin, Juan Cabrera, doit quitter La Havane, dans Juan Criollo, de Carlos Loveira. Ici, le départ revêt un caractère d‟autant plus symbolique que le garçon est banni après avoir commis une faute : embrasser la jeune Nena dont il est amoureux. En flirtant innocemment avec cette jeune fille issue de l‟aristocratie, Juan a commis l‟irréparable : il a déshonoré la famille qui l‟accueillait. Cette dernière prend la décision d‟éloigner le garçon de La Havane et de l‟envoyer dans une propriété à la campagne. 578 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, op. cit., p. 26. Idée que nous empruntons à Françoise Moulin Civil, cf. Françoise Moulin Civil, « De la Comtesse Merlin à Reinaldo Arenas : les avatars d‟un voyage à La Havane », in Philippe Meunier ; Jacques Soubeyroux (éd.), Le voyage dans le monde ibérique et ibéro-américain, op. cit., p. 56. 580 L‟émotion et la peine de la Comtesse prennent tout leur sens à la lecture de Bachelard : « En évoquant les souvenirs de la maison, nous additionnons des valeurs de songe ; […] et notre émotion ne traduit peut-être que de la poésie perdue. Ainsi, en abordant les images de la maison avec le souci de ne pas rompre la solidarité de la mémoire et de l‟imagination, nous pouvons espérer faire sentir toute l‟élasticité psychologique d‟une image qui nous émeut à des degrés de profondeur insoupçonnés », Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, op. cit., p. 25. 581 La Comtesse Merlin, La Havane, T. III, op. cit., p. 193. 579 207 C‟est donc comme une expulsion du paradis après le péché originel que l‟on pourrait lire ce départ forcé : […] Juan, sentado en los cojines del vehìculo, al lado del seriote Don Roberto, disimula una vaga y fugaz tristeza, que en su alma de desorbitado de la vida, produce el instante de la separación del que ha sido su hogar durante unos cuantos años. Disimula el temblor de sus labios y el incontenible asomo de sus lágrimas de despedida […]. 582 Aux côtés de Don Roberto, qui va le conduire à sa finca, « Los Mameyes », Juan Cabrera traverse La Havane. Il ressent tout d‟abord une peine superficielle (« vaga y fugaz tristeza ») qui, malgré tout, semble peu à peu s‟imposer. Mais à la tristesse va s‟ajouter un profond sentiment d‟injustice : Hay en él mudez y seriedad, sistemáticas, de castigado y cierta vaga emociñn, cierta tristeza recñndita e inconsciente. […] La ciudad le da un raro y fuerte sentido de las cosas ; como si esta excepcional mañana de su vida tuviese que imprimir en su tierno cerebro un profundo e imperecedero recuerdo.583 C‟est bien d‟un châtiment qu‟il s‟agit (« castigado ») et c‟est comme tel qu‟il est ressenti par Juan. La peine est comme affaiblie ou, du moins, elle n‟est pas aussi manifeste comme le signalent les adjectifs qui la qualifient (« cierta », « vaga », « recóndita », « inconsciente ») car l‟émotion a laissé place à la gravité. En effet, ici aussi le départ revêt une importance majeure dans l‟existence du protagoniste, comme semble le suggérer l‟image d‟un souvenir qui serait en train d‟être gravé à tout jamais dans sa mémoire. C‟est que, au-delà de l‟anecdote malheureuse avec Nena, ce départ illustre l‟injustice sociale dont Juan est victime depuis toujours. Quitter La Havane peut être vécu douloureusement surtout quand la ville est chargée de valeurs affectives et qu‟elle est perçue comme un Éden584. Avec la Comtesse Merlin, nous avons vu que la capitale représentait le paradis de l‟enfance qu‟un voyage aux origines tentait de faire renaître. Mais sa tentative pour raviver le passé et retrouver la capitale de son enfance est restée vaine, bien sûr, car la cité de María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo est un paradis perdu à jamais. 582 Carlos Loveira, Juan Criollo, op. cit., p. 149. Ibid., p. 150. 584 Abilio Estévez ne dit pas autre chose : « La Habana fue y ha sido siempre mi ciudad blanca, mi sueño de la infancia », Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 87. 583 208 c- Le paradis perdu La ville est l‟Éden originel, impossible à retrouver aussi bien pour ceux qui ont tenté de partir « à la recherche du temps perdu », en confrontant le passé et le présent, que pour les exilés nostalgiques585 qui conçoivent La Havane comme une nouvelle Ithaque. Il est évidemment illusoire de vouloir revivre intact le bonheur passé et, risquons cette tautologie, de vouloir retrouver La Havane d‟autrefois qui n‟est évidemment plus. Même la Comtesse Merlin, qui « s‟obstine à montrer que les retrouvailles avec l‟âge d‟or et le lieu paradisiaque sont consommées, que Cuba et La Havane sont récupérées en leur essence »586, en fait parfois l‟amère expérience. En rendant visite à sa tante, la Comtesse de Montalvo retrouve la maison paternelle où elle vécut enfant. Comme toujours, la réminiscence opère et fait rejaillir des souvenirs précis : […] cette maison je l‟avais habitée, j‟avais touché ses portes, j‟avais joué sur ces dalles de marbre ; cet escalier ! je l‟avais monté et descendu cent fois. Ŕ Là, de cette marche, je tombai un jour, je me blessai ; mama Agueda me releva et me pansa. Ŕ Je ne me trompais point : c‟était bien la maison de mon père. Tout était encore à sa place.587 Mais elle ajoute : « Hélas ! où est mon père ? Je ne retrouve plus qu‟un amas de pierres sans vie et un souvenir vivant ! »588. Son père disparu laisse une blessure à jamais béante que le souvenir semble raviver. C‟est l‟absence de la figure paternelle qui ressurgit ici, soulignant ainsi les limites de la remémoration autobiographique. La redécouverte du « déjà vécu » ne permet pas de retrouver, et encore moins de revivre, ce passé. Si elle se rend compte que La Havane renferme un passé perdu pour toujours, la Comtesse Merlin éprouve aussi, à de rares moments il faut le dire, les limites de son voyage. Dans la comparaison perpétuelle entre les images passées et présentes, la déception point parfois, même si celle-ci est systématiquement contrebalancée par des propos enthousiastes589. Il est très rare, en effet, que la narratrice abandonne la quête nostalgique, les descriptions costumbristas ou l‟éloge quasi systématique 585 Nous parlons là de l‟exil réel et de l‟exil intérieur. Françoise Moulin Civil, « De la Comtesse Merlin à Reinaldo Arenas : les avatars d‟un voyage à La Havane », in Philippe Meunier ; Jacques Soubeyroux (éd.), Le voyage dans le monde ibérique et ibéro-américain, op. cit., p. 59. 587 La Comtesse Merlin, La Havane, T. I, op. cit., p. 332. 588 Ibid., p. 333. 589 A ce sujet, Françoise Moulin Civil explique que « le récit [est] mû par la mythification et la réticence à avouer l‟échec de la confrontation. Les décalages forcés entre l‟attendu et le vu, entre le remémoré et le retrouvé ne sont que suggérés et les déceptions ne prennent jamais le pas sur l‟enthousiasme admiratif », Françoise Moulin Civil, « De la Comtesse Merlin à Reinaldo Arenas : les avatars d‟un voyage à La Havane », in Philippe Meunier ; Jacques Soubeyroux (éd.), Le voyage dans le monde ibérique et ibéro-américain, op. cit., p. 59. 586 209 pour signifier une déconvenue. Cela dit, la chaleur accablante lui fait, par exemple, regretter l‟Europe : La chaleur est excessive ; le vent souffle comme d‟une fournaise ; tout travail devient impossible, et j‟éprouve une angoisse vague, causée par la lutte qui s‟établit entre l‟activité de mon cerveau et l‟affaiblissement de mon corps. Les habitudes agissantes d‟Europe, les facilités qu‟offre en tout point la civilisation du vieux monde, me manquent ici, et je sens parfois avec dépit que je suis dégénérée, puisque le dolce far niente de nos anciens, les Indiens, ne suffit plus à mon bonheur.590 Être à La Havane ne la comble plus entièrement car, une fois le charme des retrouvailles passé, les aspects les plus désagréables de la vie sous les tropiques (chaleur insupportable, moustiques voraces591, activités au ralenti592) s‟imposent à l‟auteur. Dans une vision empreinte d‟ethnocentrisme, la Comtesse suggère qu‟il est impossible d‟entretenir une activité intellectuelle à Cuba et que la paresse ne peut combler son esprit d‟Européenne. La confrontation échoue aussi pour Esteban, dans El siglo de las Luces, puisqu‟en rentrant à La Havane, non seulement, il ne retrouve pas la maison familiale qu‟il a quittée mais il a bien du mal à reconnaître sa cousine, Sofía, dont l‟allure et même les propos le surprennent. Tout lui semble étranger : « Si extraño Ŕ forastero Ŕ se había sentido Esteban al entrar nuevamente en su casa, más extraño Ŕ más forastero aún Ŕ se sentía ante la mujer harto reina y señora de esa misma casa […] »593. Et lorsque le narrateur omniscient explique clairement qu‟Esteban a définitivement perdu l‟affection de sa cousine, la peine et le regret sont manifestes : « Ahora el cariðo de Sofìa […] se habìa fijado en otro hombre, y la evidencia de ello se hacía tanto más dolorosa para quien tuviera mayores motivos que nunca para añorar los tiempos de un Paraíso Perdido […] »594. L‟image d‟un paradis perdu, explicitement formulée par Carpentier, est mise en lumière par des majuscules qui confèrent à ce passé un caractère encore plus sacré. Le décalage entre les attentes d‟Esteban, qui rentre au pays après un périple difficile, et la réalité marque bien l‟impossibilité de faire concorder deux chronologies ou deux époques vécues car rien ne reste figé dans le temps. 590 La Comtesse Merlin, La Havane, T. I, op. cit., p. 313. « […] si la vue d‟une nature grandiose et variée ravit l‟âme et les yeux, force est d‟endurer les inconvénients de cette opulence. Voilà ce que je me répète sans cesse et de mon mieux, pendant que les moustiques impitoyables mettent ma patience à l‟épreuve. Mes bras, mes mains sont dans un état déplorable […], je suffoque, je ruisselle, je meurs […] », ibid., p. 314, 315. 592 « Pour un pas à faire, pour un mot à dire, pour une signature qu‟il s‟agit d‟apposer, on vous renverra toujours au lendemain : le soleil est là terrible, s‟interposant chaque jour entre la maison de votre notaire et vous, entre votre écritoire et vos doigts », ibid., p. 314. 593 Alejo Carpentier, El siglo de las luces, op. cit., p. 289. 594 Ibid., p. 310. 591 210 Cette dissonance revêt un caractère tragique dans la nouvelle de Calvert Casey intitulée « El regreso » (1962). Comme son nom l‟indique, ce récit met en scène un retour au pays. Il s‟agit en l‟occurrence du retour à La Havane, dans les années cinquante, d‟un exilé cubain vivant à New York. Cette nouvelle est d‟autant plus intéressante que le personnage retourne dans son pays natal à deux reprises. La première fois, les retrouvailles sont parfaites (« La sorpresa fue agradable »595) et placées sous le signe du plaisir. Le soleil et la chaleur tropicale lui procurent une sensation de bien-être et éveillent en lui des souvenirs plaisants : Y luego aquel sol, aquel sol maravilloso y omnipresente de enero, que le reconfortaba y le quemaba suavemente los omóplatos, brillando desde un cielo transparente, que le hacía olvidar los dolorosos inviernos del Norte y el tiritar violento que destrozaba sus nervios enfermos, y le despertaba viejas memorias de infancia […].596 L‟opposition entre le pays du Nord froid et désagréable et Cuba montre que le personnage retrouve un paradis perdu. La lumière intense semble lui redonner une deuxième naissance. D‟ailleurs, quand il rentre aux Etats-Unis, le protagoniste est métamorphosé et veut retrouver cet apaisement en retournant définitivement à La Havane. Mais ce besoin impérieux va lui être fatal car le contexte politique a changé. Les tensions, qui se sont radicalisées entre le dictateur Batista et les révolutionnaires, font régner un climat délétère extrêmement violent. Les secondes retrouvailles avec sa patrie tournent court rapidement : Cuando llegñ […] encontrñ la ciudad un poco cambiada. Era difícil precisar en qué consistía el cambio. Como siempre, la gente parecía alegre y despreocupada, pero habìa cierta inquietud en el ambiente […]. Lo que sí chocó a su vista de inmediato fue la superabundancia de uniformes. En las esquinas de la ciudad se veían a todas horas grupos de soldados y policías con armas automáticas modernas, de grueso calibre. […] Por las calles de la ciudad vieja desfilaban cada varios minutos con monñtona regularidad pequeðos vehìculos militares […].597 L‟ambiance n‟est plus la même et la présence menaçante des militaires et des policiers donne l‟impression que le pays est en guerre. Le superlatif « superabundancia », les pluriels et les termes qui indiquent la répétition insistent sur le changement d‟atmosphère. La ville a à ce point changé qu‟elle va rapidement être la source de ses souffrances. Arrêté par erreur par la police de Batista, le personnage sera sauvagement torturé puis abandonné, gisant, tout près de la mer. Le retour à la patrie s‟achève ici de manière dramatique sur la mort injuste du 595 Calvert Casey, « El regreso » (1962), in Alberto Garrandés, La ínsula fabulante. El cuento cubano en la Revolución (1959-2008), op. cit., p.36. 596 Ibid., p. 37. 597 Ibid., p. 40. 211 protagoniste. Casey, qui lui aussi a vécu le retour au pays puisqu‟il est rentré à Cuba après la dictature de Batista, montre que toute tentative pour retrouver le paradis perdu est un leurre. La déception marque aussi le retour d‟Ismael, dans Viaje a La Habana, d‟Arenas. Si nous avons vu précédemment que le protagoniste et La Havane pouvaient encore se retrouver dans un lien presque fusionnel, très vite, la réalité présente va interrompre ces retrouvailles. Dès qu‟il voudra retrouver la ville de son enfance, il en sera empêché car La Havane des années quatre-vingt-dix est marquée par les interdits, une forte présence policière et une surveillance omniprésente. Un exemple se répète à trois reprises dans le récit : Ismael veut se baigner dans la mer et retrouver le contact physique de l‟eau mais l‟accès à la plage lui est systématiquement interdit : Estaba ya frente a la playa, aquella playa donde él había pasado su juventud, los mejores momentos de su juventud, tendido en la arena o nadando mar afuera […]. Y ahora regresaba, y ahora iba a entrar otra vez en esa playa ; luego de quince años de ausencia. Pero dos soldados le cortaron el paso […] se trataba de un club militar.598 Le décalage est ici d‟autant plus douloureux qu‟il s‟agit exactement du même lieu, comme le rappellent la répétition du mot « playa » et les déictiques « aquella » et « esa » : la plage est la même mais les époques sont différentes. Les circonstances ont changé et la ville est comme transformée : les arbres ont été rasés et remplacés par des monuments militaires ou du béton, le parc d‟attractions pour enfant, laissé à l‟abandon, n‟est plus que l‟ombre de ce qu‟il était, La Habana Vieja et la zone du port sont devenues inaccessibles pour qui n‟a pas d‟autorisation spéciale. Les évocations de la ville actuelle se multiplient et corroborent toutes l‟idée d‟un âge d‟or perdu à jamais : « no había ya ningún paraíso »599, dit d‟ailleurs le narrateur pour exprimer clairement l‟échec de l‟entreprise d‟Ismael. Retrouver le passé est non seulement impossible mais source de dépit et de colère : « ¿ Cómo aceptar que aquella juventud, lo único realmente hermoso de su vida, se haya perdido ? ¿ Y cómo aceptar que aquel lugar donde había pasado esa juventud sea ahora sólo una prisión ? »600. Les deux questions rhétoriques expriment le désarroi d‟Ismael qui ne peut se résoudre à accepter l‟inacceptable : non seulement sa jeunesse est perdue pour toujours mais plus rien ne pourra l‟aider à la toucher du doigt. Le dialogue entre les époques est totalement rompu et cette rupture se charge ici d‟une dénonciation politique évidente. Arenas, en tant qu‟écrivain de 598 Reinaldo Arenas, Viaje a La Habana, op. cit., p. 120, 121. Ibid., p. 123. 600 Ibid., p. 124. 599 212 l‟exil et de la dissidence, construit une cité-prison sur laquelle nous aurons l‟occasion de revenir601. Si retrouver le paradis perdu est difficile, voire impossible, le reconstruire est en revanche une entreprise envisageable. Sans effectuer de retour aux sources, certains écrivains de l‟exil ou de l‟insilio602 vont façonner, dans leurs écrits, un nouvel Éden symbolisant la patrie abandonnée ou perdue. Dans ce cas, la ville est aussi intimement liée à l‟enfance et au passé mais elle revêt d‟autres significations. Elle est à la fois la figure de l‟absence et du manque, le lieu du souvenir, un espace mémoriel fantasmé et reconstruit603. Parlant de la poésie de l‟exil, Ambrosio Fornet explique : Aquí, la verdadera protagonista del drama es la memoria. Es ella quien sostiene consigo misma, y con cada uno de los sujetos líricos, un monodiálogo que intenta rescatar al conjunto de los mitos nacionales y familiares, la atmósfera incontaminada de aquel paraíso que primero se vio como perdido y después, con el paso de los años, irrecuperable. 604 Ces propos, qui peuvent parfaitement s‟appliquer à la prose cubaine, mettent l‟accent sur le rôle joué par la mémoire et la nostalgie dans ce processus de récupération et de reconstruction d‟un paradis perdu. Montrer comment La Havane devient « une géographie de la nostalgie »605 nous oblige une fois de plus à être sélective car l‟écriture de la mémoire chez les écrivains cubains, a fortiori chez ceux de la diaspora, est une vaste question que nous ne saurions circonscrire ici. Aussi, notre projet est de nous appuyer sur quelques exemples emblématiques, parfois maintes fois analysés mais néanmoins incontournables, afin de mettre au jour différentes approches littéraires qui, finalement, convergent toutes. C‟est pourquoi il ne nous semble pas pertinent de distinguer ici les auteurs de l‟exil de ceux qui sont restés à Cuba ou de les séparer en fonction de leurs affinités politiques car, malgré toutes leurs 601 Dans « Final de un cuento », grâce à un dialogue intérieur, le narrateur imagine un retour à La Havane qui est rapidement évacué. Il est remarquable d‟observer que ce retour fantasmé et la réalité évoquée sont très proches de ce qui est décrit dans Viaje a La Habana : « Tus ojos buscando una calle por donde la gente cruza como meciéndose, adentrándose ya en un parque donde hay estatuas que identificas, figuras, voces y hasta arbustos que parecen reconocerte. […] olfateas, sientes, no sabes qué transparencia en el aire […]. Mira los balcones estibados de ropa tendida. […] ¡ Sì !, ¡ sì ¡, te interrumpìa yo, una ciudad de balcones apuntalados y un millñn de ojos que te vigilan, una ciudad de árboles talados, […] de tuberìas sin agua, de heladerìas sin helados […] », id., « Final de un cuento », Adiós a mamá (De La Habana a Nueva York), op. cit., p. 158. 602 Ce terme désigne l‟exil intérieur vécu par ceux qui n‟ont pas quitté le pays mais qui ne s‟en sentent pas moins étrangers. 603 Nous évoquerons dans notre troisième partie la ville transformée, voire transfigurée, par le souvenir. 604 Ambrosio Fornet, Memorias recobradas. Introducción al discurso literario de la diáspora, Santa Clara, Ediciones Capiro, 2000, p. 64. 605 Nous reprenons une expression de Renée Clémentine Lucien, in Résistance et cubanité. Trois écrivains nés avec la Révolution cubaine : Eliseo Alberto, Leonardo Padura et Zoé Valdés, Paris, L‟Harmattan, 2006, p. 193. 213 différences, ces écrivains se réfugient, via la littérature, dans une ville du passé qu‟ils réinventent à travers le paramètre affectif et la distorsion (spatio-)temporelle. Ils reconstruisent à leur manière un espace et une époque perdus, une ville invisible qui est celle du souvenir606. Dans son ouvrage critique, Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI, Jorge Fornet défend ce parti pris que nous faisons nôtre : […] existen muchìsimos puntos de coincidencia entre ellos [un exiliado radical y un funcionario del gobierno]. […] Atenerse al lugar de residencia o a la postura política del autor no sólo no garantiza una especificidad literaria sino que obligaría al estudioso a subordinarse a inesperados vaivenes y mantener el precario equilibrio de quien se mueve sobre una cuerda floja.607 Ce n‟est pas un hasard si nombre de ces écrivains, exilés ou pas, ont fait la part belle à l‟espace urbain dans leurs récits littéraires et ont souhaité reconstruire une ville faite de mots comme pour se la réapproprier. On pense, bien sûr, à Cabrera Infante608, Reinaldo Arenas609, Zoé Valdés610, Abilio Estévez611 ou encore Antonio José Ponte612. Parmi eux, certains ont commencé ce processus de reconstruction de la ville avant de quitter l‟Île (Cabrera Infante avec Tres tristes tigres (1967)613, Zoé Valdés avec La nada cotidiana (1995) et Te di la vida entera (1996)614, Abilio Estévez avec Tuyo es el reino (1997) et Los palacios distantes (2002)615, Antonio José Ponte avec Un seguidor de Montaigne mira La Habana (1995) et Las comidas profundas (1997) ; d‟autres ont reconstruit La Havane sans jamais la quitter (Leonardo Padura Fuentes). Ainsi se dessinent deux approches différentes mais une seule et même nostalgie que nous allons analyser à travers quelques exemples saillants. Dans une étude comparative, nous verrons comment se manifeste la nostalgie chez plusieurs écrivains cubains. Pour ce faire, nous dégagerons deux groupes d‟auteurs : ceux dont l‟œuvre est pétrie de nostalgie et ceux qui, à un degré moindre, l‟utilisent sans qu‟elle constitue le véritable moteur de l‟écriture littéraire. Dans ce deuxième groupe, on observera qu‟il n‟y a pas 606 Renée Clémentine Lucien voit, de façon très juste, dans cette reconstitution de l‟espace insulaire « une entreprise désespérée de suspendre le temps », ibid., p. 314. 607 Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI, La Havane, Editorial Letras Cubanas, 2006, p. 74. 608 Il quitte définitivement Cuba en 1965 pour Madrid, puis pour Londres (en 1966). 609 Il part de Cuba par le « pont de Mariel » en 1980. 610 Elle vit à Paris depuis 1995. 611 Estévez quitte Cuba en 2000. Il vit actuellement à Barcelone. 612 Ponte part vivre à Madrid en 2007. 613 Publié alors que Cabrera a déjà quitté Cuba, le récit Tres tristes tigres a cependant été écrit avant son départ (dès 1961). Il fut remanié ensuite entre 1965 et 1966, en Espagne. 614 L‟auteur nous a confirmé que la première version de ce roman fut écrite à Cuba. Cette version fut ensuite remaniée une fois en exil puis publiée. 615 Cette œuvre a été écrite avant et après l‟exil (à La Havane et en Espagne). 214 d‟idéalisation systématique du passé et que la nostalgie y est parfois désacralisée. Enfin, nous étudierons quelques motifs récurrents, communs à plusieurs écrivains, qui illustrent ce regret obsédant pour une époque et une géographie perdues. La ville et les souvenirs personnels sont étroitement liés, on le sait. Frances A. Yates, dans son étude sur l‟art mnémotechnique de l‟Antiquité à la Renaissance a montré comment le mécanisme de la mémoire reposait en partie sur les lieux (les loci) : « Mais les loci restent dans la mémoire et nous pouvons les utiliser de nouveau […]. Les loci sont comme les tablettes enduites de cire qui demeurent quand ce qu‟on y a écrit a été effacé et qui sont prêtes à un nouvel emploi »616. Si l‟espace est ce support indélébile propice au déclenchement de la mémoire individuelle, nous pouvons dire que les écrivains qui nous occupent créent en quelque sorte une géographie mnémotechnique. Se remémorer La Havane qu‟ils ont connue leur permet de « retrouver la mémoire », pourrait-on dire. Ce processus est évident chez Cabrera Infante pour qui écriture et réminiscence vont de pair. La Havane de La Habana para un infante difunto est décrite à mesure qu‟une mémoire sensorielle est à l‟œuvre. Nous l‟avons vu, dans ce roman tout passe par les sens et la sensualité617, à telle enseigne que nous pouvons affirmer que la mémoire du narrateur est plus sensorielle que visuelle, en témoigne le peu de descriptions précises qu‟il accorde aux lieux et aux personnes. Jacobo Machover dit à propos de La Havane de Cabrera : « Es sobre todo sensual, su recuerdo se refiere exclusivamente a los sentidos, lejos de cualquier tipo de erudición, arquitectónica o histórica, sistemáticamente dejada de lado »618. C‟est donc à travers les sensations (la vue, l‟odorat mais aussi le langage) et les impressions personnelles que sont évoquées la capitale et l‟adolescence du personnage. En suivant les méandres d‟une mémoire parfois labile qui ne respecte pas le déroulement chronologique des événements, le narrateur reconstruit La Havane « brique après brique, mot après mot »619. La référentialité systématique, qui se manifeste par une énumération des rues, des lieux et des parcours, témoigne du besoin presque obsessionnel de l‟auteur de nommer l‟espace pour le faire exister. Inventorier et catégoriser la géographie urbaine est l‟une des particularités de l‟écriture de l‟exil. C‟est ce qu‟explique Rafael Rojas quand il parle de « structure taxinomique du récit »620 évoquant les cas de Zoé Valdés et d‟Eliseo Alberto. En effet, dans son essai, Informe contra mí mismo, 616 Frances A. Yates, L’art de la mémoire, Paris, Editions Gallimard, 1975, p. 19. C‟était déjà le cas dans Tres tristes tigres. 618 Jacobo Machover, La memoria frente al poder. Escritores cubanos del exilio : Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas, op. cit., p. 26. 619 Guillermo Cabrera Infante cité par Ángel Esteban, in Ángel Esteban, « „Asir a la risa‟ : el arte de narrar en Cabrera Infante », Literatura cubana entre el Viejo y el mar, op. cit., p. 249. C‟est nous qui traduisons. 620 Rafael Rojas, « Diáspora y literatura. Indicios de una ciudadanía postcolonial », in Encuentro de la cultura cubana, Madrid, n°12/13, printemps-été 1999, p. 146. C‟est nous qui traduisons. 617 215 l‟écrivain cubain, qui s‟était exilé au Mexique, constitue à plusieurs reprises des listes de noms de rues ou de lieux emblématiques de la capitale pour reconstruire avec des mots La Havane perdue621. Mais ne nous y trompons pas ; dans le cas de Cabrera Infante, cette prose bavarde qui veut « dire » la ville n‟est qu‟un prétexte pour se raconter622. La ville ne sert que l‟évocation des souvenirs personnels, comme le suggère Emma Álvarez-Tabío Albo : « […] a pesar de las apariencias, la ciudad nunca será la verdadera protagonista de sus novelas »623. Le narrateur ne s‟en cache d‟ailleurs pas : « yo quiero hablar de incursiones íntimas [...] describir la topografía de mi paraíso encontrado y a veces de mi patio de luneta »624. Ses intentions sont claires : parler de lui et de son passé à travers l‟évocation d‟un paradis urbain. De sorte que la réitération des possessifs, très présente dans l‟œuvre, sert davantage à signifier que la ville lui appartient plutôt que le contraire : « mi Habana »625, « mi mundo »626, « mi paraíso »627, etc. A cet égard, les nombreuses conquêtes amoureuses du protagoniste renforcent l‟idée d‟un territoire dominé, nous l‟avons vu. Cela dit, il n‟en demeure pas moins que la ville est omniprésente dans cette fiction largement autobiographique ainsi que dans d‟autres récits de l‟auteur puisque il n‟eut de cesse d‟écrire et de chercher La Havane même quand il évoquait d‟autres villes628. Ce qui fut « el gran descubrimiento de [su] vida »629, c‟est-à-dire la capitale cubaine, constitue une véritable obsession littéraire630 qui le hante avant et surtout après son exil. Cette ville est un territoire fait de mots qui sert à la fois de décor et de moteur à l‟écriture littéraire : « La Habana no sólo era mi fin y mi principio sino mi medio »631. Mais une fois abandonnée, La Havane n‟existe plus en tant que référent spatial réel et tangible ; elle n‟est plus qu‟une représentation, un mirage ou, pour le dire autrement, 621 Citons à titre d‟exemple ce passage où l‟auteur se lance dans une liste exhaustive des rues havanaises faisant partie de sa géographie personnelle : « Calzada de Bejucal, entre Mangos y Pinar, donde yo vivía, Calle Paula, Trocadero, Calle 11, Calle C, Calle 51, Calle 100, Amargura, Soledad, Tenienterrey, Oficio, Mercaderes, Plaza Vieja, San Lázaro, Obrapía, Prado y Neptuno, Monte, Animas, Lealtad, Dragones, […] Calle E donde aún yo vivo, venas de mi cuerpo, […] calles mìas : no me dejen mentir », Eliseo Alberto, Informe contra mí mismo, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1997, p. 132. 622 Chez Carpentier, c‟est le contraire qui se produit : l‟histoire individuelle des personnages s‟efface au profit de l‟Histoire nationale et supranationale et de la construction d‟une ville tout aussi monumentale que mythique. 623 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 345. 624 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un Infante Difunto, op. cit., p. 147. C‟est nous qui soulignons. 625 Ibid., p. 202. 626 Ibid., p. 457. 627 Ibid., p. 147. 628 Nous renvoyons au livre El libro de las ciudades. L‟écrivain explique dans le prologue : « Es asì que he buscado en otras ciudades el esplendor que fue La Habana », Guillermo Cabrera Infante, « Elogio de la ciudad », in El libro de las ciudades, Madrid, Alfguara, 1999, p. 14. 629 Guillermo Cabrera Infante cité par Ángel Esteban in Ángel Esteban, « „Asir a la risa‟ : el arte de narrar en Cabrera Infante », Literatura cubana entre el Viejo y el mar, op. cit., p. 249. 630 « Habanidad de habanidades, todo es habanidad. La Habana es una fijaciñn en mì […] », Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op.cit., p. 461. 631 Ibid., p. 472. 216 une construction mémorielle que seule la nostalgie fait exister. « La Habana en realidad es una ciudad que no existe más que en la nostalgia, en los sueños y en la literatura para mí. No creo que haya un futuro regreso a La Habana », disait Cabrera en 1976 632. Non seulement il ne revint jamais à Cuba mais la ville ne serait plus que cela pour lui : un espace littéraire lui permettant de reconstruire un paradis doublement perdu (à cause de la séparation temporelle et spatiale). Le besoin d‟écrire La Havane est tout aussi manifeste chez Abilio Estévez qui va convoquer la ville à divers degrés dans ses écrits. Si dans son premier roman, Tuyo es el reino, c‟est la capitale de la toute fin des années cinquante qui apparaît au second plan (derrière l‟espace allégorique de la Isla), c‟est en revanche La Havane en ruines de l‟année deux mille qui sera omniprésente dans Los palacios distantes. Cette ville qui vit dans sa physionomie les affres de la période spéciale, est un espace que les personnages (Don Fuco, Victorio et Salma) fuient en se réfugiant dans un ancien théâtre laissé à l‟abandon. Les ruines ne sont plus que les vestiges d‟une splendeur passée qu‟on essaie malgré tout de retrouver : « Victorio recorre los palacios gloriosamente reconstruidos, como si anduviera por otro tiempo, el de Julián del Casal, el gran decadente »633. Faire abstraction du chaos présent pour se réfugier dans un passé plus rassurant est une stratégie mise à l‟œuvre également dans El navegante dormido, avec le personnage d‟Olivero. Ce dernier tente de fuir non pas la ville de la période spéciale mais celle des années soixante et soixante-dix. Et il ne va pas se réfugier dans une époque lointaine, comme peut l‟être le XIXème siècle de Julián del Casal, mais dans un passé proche qu‟il a lui-même vécu : La Havane prérévolutionnaire. Il profite des périodes où il doit vivre dans l‟appartement familial de la rue Reina pour se souvenir : « Allí Olivero se sentía siempre un tanto melancñlico […] »634. La nostalgie, pour Olivero, n‟est pas source de souffrance, au contraire, il aime se souvenir : « […] a Olivero le gustaban los recuerdos »635. Comme nous l‟avons dit, l‟espace joue un rôle clef dans l‟émergence du passé puisqu‟il est le support de la mémoire. C‟est en étant à nouveau en plein Centro Habana, en retrouvant une géographie urbaine familière, qui s‟est certes transformée, que le processus d‟anamnèse s‟opère : A Olivero le gustaba la sensación de « restablecimiento » de su vida que a veces le otorgaba volver a caminar por La Habana. Subir, por ejemplo, la calle Reina. Cuando era niño, y su madre iba allí de compras, él la 632 Propos tirés d‟un entretien de Joaquìn Soler Serrano avec l‟auteur au cours de l‟émission de télévision « A fondo », « Entrevista completa a Guillermo Cabrera Infante », RTVE, 1976. http://www.youtube.com/watch?v=QZJozijmWQA (consulté le 20/03/2013) 633 Abilio Estévez, Los palacios distantes, op. cit., p. 35, 36. 634 Id., El navegante dormido, Barcelone, Tusquets, 2008, p. 230. 635 Ibid., p. 230. 217 acompaðaba. […] Olivero recordaba los buenos tiempos de Al Bon Marché […]. O la Casa de los Tres Quilos […]. A pesar de tanta destrucción y tanta pobreza, subir por la calle Monte seguía procurándole un placer extraordinario. Había, en especial, un minuto que continuaba manteniendo su magia. Un instante milagroso de La Habana : aquel en que la calle Monte, ahora sucia y venida a menos, se abría […] a la amplitud del Parque de la Fraternidad. ¿ Qué dios generoso, sabio, propicio y voluptuoso había creado ese espacio […] ?636 C‟est toute une vie passée qui ressurgit comme le révèle le terme « restablecimiento » que des guillemets mettent d‟ailleurs en lumière. En parcourant les rues empruntées autrefois (nous ne les avons pas citées dans leur intégralité dans un souci de concision), le personnage crée une cartographie personnelle du souvenir. L‟inventaire que le narrateur réalise en nommant une à une les rues traversées semble être aussi une manière de lutter contre l‟oubli. Malgré les nombreux changements qui ont transformé la ville (« A pesar de tanta destrucción y tanta pobreza », « ahora sucia y venida a menos ») et qui opposent deux époques, La Havane reste pour Olivero un territoire mémoriel puisque les retrouvailles avec son enfance semblent encore possibles. La prégnance de ce passé est telle que la magie d‟antan opère à nouveau quand il arrive à l‟angle des rues Monte et Amistad, à l‟extrémité du Parque de la Fraternidad. Il n‟est pas indifférent d‟observer que ce n‟est pas l‟endroit qui est magique (« milagroso ») mais l‟instant de la découverte (« un minuto », « un instante »). L‟intervention divine qualifiée de manière laudative ne fait que renforcer le caractère merveilleux de la ville. Cette sublimation de l‟espace et du temps637 est assumée et recherchée par le personnage : « Olivero poseía el capricho, o la rara destreza, de convertir en hermosos los recuerdos que estuvieran asociados con sucesos anteriores a 1959 »638. Transformé et idéalisé, le passé constitue un refuge que la ville post-révolutionnaire lui permet encore de trouver639. Enfin, on notera que la confrontation spatio-temporelle qui oppose la Havane d‟avant 1959 à celle des années soixante et soixante-dix fait naître un mal-être existentiel chez Olivero : 636 Ibid., p. 232, 233. On trouve également ce procédé de sublimation qui transforme La Havane d‟autrefois en véritable Arcadie dans Los palacios distantes : « Cuentan que en otras y satisfechas épocas llegó a ser bastante pródiga con los que carecían de techo. Alguna vez los portalones amplios, las cómodas aceras techadas de la Ciudad de las Columnas, sirvieron de refugio a cientos y cientos de vagabundos. [...] muchos indigentes encontraron refugio en la maternal nobleza de tantas galerías habaneras. Cuentan que no sólo abundaban cobertizos y columnas ; había, además, agua sana y dulce en las fuentes, árboles en los jardines, y frutas en los árboles de los jardines, y panes y sopas que repartían en las sacristías en las iglesias, y peces, muchos peces en el mar », id., Los palacios distantes, op. cit., p. 44. 638 El navegante dormido, op. cit., p. 231. 639 « Algunos refugios quedaban aún en La Habana de finales de los sesenta y principios de los setenta. », ibid., p. 234. 637 218 […] Olivero aprovechaba la mudada forzosa al pequeðo apartamento […] para restablecer un diálogo con las voces, cada vez más apagadas, enronquecidas, ocultas, de la ciudad a la que él había pertenecido y de la que, de alguna manera, había sido dueño. La ciudad que ahora pretendía excluirlo.640 Cette « recherche du temps perdu » met au jour l‟exil intérieur que le personnage ressent bien malgré lui. La ville personnifiée est dotée d‟une force capable d‟écarter certains de ses habitants. Malgré cela, le protagoniste tente de rétablir une certaine complicité avec cette Havane devenue personnage. D‟ailleurs, la parole est au centre de ces retrouvailles, comme l‟attestent les termes « diálogo », « voces » et « enronquecidas ». On constatera aussi que le rapport de force s‟est inversé : si auparavant Olivero pensait dominer la cité (« había sido dueño »), à présent, c‟est plutôt lui qui semble être à sa merci 641. Le personnage nostalgique d‟Olivero est sans doute assez proche du narrateur homodiégétique d‟Inventario secreto de La Habana. Dans ce texte, Estévez abandonne la fiction pure pour un récit hybride mêlant ses souvenirs personnels à des textes sur La Havane issus d‟autres ouvrages. Donnant libre cours à une nostalgie plus intime, l‟auteur semble y assumer le besoin de reconstruire La Havane depuis l‟exil. En évoquant Proust642, en puisant dans le champ lexical du souvenir, en parlant de ses aïeux ou en rappelant ses rencontres, le narrateur s‟inscrit clairement dans une démarche autobiographique qui remonte à l‟enfance : « La Habana fue y ha sido siempre mi ciudad blanca, mi sueño de la infancia »643, dit-il. En paraphrasant l‟écrivain autrichien, Joseph Roth, Estévez montre que la cité est envisagée comme un paradis perdu qui devient une quête perpétuelle puisqu‟il ajoute tout de suite après que, même enfant, alors qu‟il habitait à Marianao, il a toujours cherché La Havane : « Aunque nací en La Habana, no puedo negar que invariablemente la buscaba, la reclamaba como se buscan y reclaman las ciudades remotas, que son, por eso mismo, las ciudades fantásticas, las que pueblan las ilusiones de cualquier infancia […] »644. Et le narrateur d‟ajouter : « La Habana fue para mí un espacio distante, […] un lugar que debía ser […] conquistado »645. La Havane d‟Abilio Estévez 640 Ibid., p. 235. C‟est nous qui soulignons. Le personnage de El bailarín ruso de Montecarlo, Constantino Augusto de Moreas, éprouvait lui aussi un sentiment de déracinement quand il vivait à La Havane : « Porque lo cierto es que cuando estaba en La Habana sí me atacaba (y mucho) la nostalgia. Hubo días en que despertaba como el viajero que se descubre de pronto en una isla del Pacífico, sin estar realmente en una isla del Pacìfico. […] Y he comprobado lo violento que puede ser eso de hallarse en el Pacífico, extraviado para siempre en los confines del Pacífico, sin haberse desplazado de una vieja casa casi en ruinas, de un Marianao casi en ruinas », id., El bailarín ruso de Montecarlo, Barcelone, Tusquets, 2010, p. 146, 147. 642 « […] lejanìsima y empobrecida evocaciñn de Proust con su magdalena », id., Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 55. 643 Ibid., p. 87. 644 Ibid., p. 88. 645 Loc. cit. 641 219 semble avoir toujours été une Ithaque, une ville mythique et irréelle même lorsqu‟elle était à portée de main. Ce territoire à conquérir annonce déjà la ville lointaine de l‟exil qui doit être réécrite mot à mot. L‟auteur va même plus loin quand il suggère que La Havane n‟existe finalement que grâce à l‟éloignement et au souvenir : ¿ No será que La Habana fue la ciudad cuando se convirtió en verdadero recuerdo, es decir, cuando dejó de ser sólo lejanía, para ser lejanía y recuerdo ? ¿ No será que para entender una ciudad, aun aquella en la que uno ha nacido y vivido, es preciso abandonarla, para poder evocarla después ? Un lugar común, ya sé. También podría apelar aquí a la idea, tan socorrida, de que el único paraíso es el que se ha perdido.646 Les questions rhétoriques permettent d‟atténuer une vérité peut-être trop abrupte : c‟est l‟exil, et lui seul, qui fait la ville et permet de la comprendre ; c‟est aussi lui qui fonde le paradis perdu. Lucide, l‟écrivain ne se laisse pas tromper par une nostalgie trop facile qui ne serait que regret. Il transforme celle-ci en projet d‟écriture en reconstruisant La Havane (et pas seulement « sa » Havane) dans une dynamique assez éloignée de celle de Cabrera Infante. C‟est que les contextes sont très différents : vingt-cinq années séparent la publication de La Habana para un infante difunto et Inventario secreto de La Habana. De plus, si Cabrera Infante appartient à la première génération d‟écrivains dissidents, qui ont quitté l‟Île au début de la Révolution, Abilio Estévez, un des représentants de la littérature du « désenchantement » des années quatre-vingt-dix et deux mille, s‟est exilé tardivement, après avoir connu les difficultés de la période spéciale. Ensuite, leur projet sont bien distincts : Cabrera décrit surtout la capitale pour se raconter alors que chez Estévez, l‟expérience personnelle semble être un prétexte pour dire et pour bâtir la ville, comme l‟atteste le titre de l‟ouvrage. Par ailleurs, dans cet « inventaire », les souvenirs personnels s‟enchaînent alors que des fragments de textes d‟autres écrivains semblent leur répondre, permettant ainsi une lecture de la ville en miroir. Les textes résonnent entre eux, s‟éclairent, répondent en écho aux souvenirs de l‟auteur et finissent par composer une ville kaléidoscopique. Estévez s‟adonne donc à une réédification à la fois personnelle et littéraire de La Havane (les plus grands noms sont cités, de la Comtesse Merlin à Lezama, en passant par Blasco Ibáñez, Luis Cernuda, María Zambrano ou encore Eliseo Alberto). L‟importance de la nostalgie dans l‟œuvre de Padura Fuentes, écrivain résidant toujours à Cuba, est incontestable. L‟exil n‟explique donc pas à lui tout seul ce besoin de se tourner vers 646 Ibid., p. 99. 220 le passé et de faire appel aux souvenirs647. La mélancolie, qui traverse l‟œuvre de cet auteur, n‟a pas la même charge autobiographique que chez les deux écrivains exilés que l‟on vient d‟étudier : elle apparaît dans des romans policiers et c‟est un personnage purement fictionnel, Mario Conde, qui s‟en fait l‟interprète648. Le détective est en effet un personnage à la fois nostalgique et désabusé : « […] el Conde era un cabrñn sufridor, un incorregible recordador, un masoquista por cuenta propia […] y el tipo más difìcil de consolar de los que habìa en el mundo […] »649. Souffrant régulièrement d‟« accès de mélancolie aiguë »650, le lieutenant, qui finira par quitter la police pour se consacrer à la vente de livres anciens, se réfugie dans ses souvenirs pour échapper à un présent fait de frustrations et de désillusions. En effet, les œuvres qui composent le cycle des Quatre saisons se déroulent juste avant la période spéciale, en 1989651. Cette année cruciale à plus d‟un titre (fin du bloc soviétique, chute du mur de Berlin) fut marquée, à Cuba, par un scandale qui leva le voile sur une affaire de corruption impliquant des gradés de l‟armée652. Cet événement, qui remettait en question les principes idéologiques révolutionnaires, révéla la profonde crise morale qui frappait le pays. A celle-ci s‟ajouta la crise économique que l‟on sait, la fameuse « période spéciale en temps de paix »653. Les années quatre-vingt-dix et deux mille constituent le contexte socio-historique des romans de Padura mettant en scène le personnage de Conde (nous ne parlons pas seulement de la tétralogie). Qu‟elle soit idéologique et/ou économique, la crise est le matériau qui fonde ces récits et qui légitime la nostalgie. Se tourner vers un passé tantôt personnel, tantôt collectif permet au personnage de fuir un présent marqué par les pénuries, la corruption, les magouilles et les crimes. Les liens étroits que Mario Conde entretient avec ses anciens camarades de lycée, El Flaco Carlos et El Conejo, favorisent cette résurgence du passé. Le 647 A ce propos, Antonio José Ponte explique de façon très juste pourquoi La Havane est pétrie de nostalgie : « […] la ciudad de hoy apenas existe. Más que de hoy es una ciudad del pasado. Es por eso que habitándola uno llega a sentir nostalgia de La Habana. Hay algo escamoteado en estas calles que nos hace añorar, algo que echamos de menos. Detrás de cualquier gesto de la vida habanera puede encontrarse ese aðorar […]. », Antonio José Ponte, « Un seguidor de Montaigne mira La Habana », in Un seguidor de Montaigne mira La Habana. Las comidas profundas, op. cit., p. 41. 648 On observera, cela dit, que le personnage et l‟écrivain partagent plusieurs éléments biographiques. 649 Leonardo Padura Fuentes, Máscaras, op. cit., p. 18. 650 Ibid. C‟est nous qui traduisons. 651 L‟auteur a choisi de ne pas exploiter le contexte de la période spéciale dans sa tétralogie pour des raisons narratives : « [1989] Fue un año de lucha por la supervivencia ideológica, mientras que en el periodo especial la lucha fue por la supervivencia física. Estas novelas reflejan la realidad de los 90 pero no transcurren entonces porque el contexto histórico iba a dejar poco espacio para la literatura ; tendría que dedicar casi todo el espacio a explicar por qué pasaban las cosas. El contexto iba a pesar más que la propia novela », Leonardo Padura Fuentes in Eva Cosculluela Quintín, Leonardo Padura : « No sé vivir en otra parte que en Cuba », entretien avec l‟auteur, août 2006, http://www.losportadoresdesuenos.com/blog/Entrevista_Padura.htm (consulté le 03/04/2013). 652 Quatorze officiers furent accusés de trafic de drogue (quatre furent condamnés à mort dont le Général Ochoa). 653 La période spéciale commence officiellement le 29 août 1990. 221 policier aime à se remémorer cette époque heureuse et insouciante où tous les rêves étaient permis et où la guerre en Angola n‟avait pas encore brisé une vie 654. Les analepses sont donc nombreuses et rythment ces romans à tel point que, comme le suggère Elena Zayas, la biographie de Conde prend le pas sur les intrigues policières : El enigma en sì no alimenta de manera permanente el suspenso […]. Por lo tanto el interés del lector deriva a menudo hacia el nivel narrativo que se refiere a la vida del protagonista Mario Conde. A este respecto, es fácil comprobar que Padura elige sus enigmas con una finalidad precisa : servir de catalizador para los recuerdos […].655 Le souvenir semble nourrir la fiction peut-être plus que l‟enquête elle-même. Dans nombre de romans, les deux éléments s‟entremêlent d‟ailleurs habilement puisque l‟investigation renvoie directement au passé du policier. Le premier opus de la tétralogie, Pasado perfecto, fait ressurgir les années de lycée du protagoniste puisque l‟homme disparu, Rafael Morín, et sa femme, Tamara, étaient d‟anciens camarades de Conde. Le meurtre de Lissette Núñez Delgado, dans Vientos de cuaresma, conduit le détective dans son ancien lycée de la Víbora car la jeune femme y enseignait la chimie. Ce sont donc les enquêtes qui rendent possible le processus d‟anamnèse car elles en sont le facteur déclenchant. La Havane, omniprésente dans ces œuvres, devient ainsi, un espace mémoriel. Là encore, c‟est en observant la ville que le personnage fait émerger les souvenirs : « Colgado de la nostalgia, el Conde miraba el inalterable paisaje que se le ofrecìa desde la ventana de su cubìculo […]. Le gustaba aquel paisaje recortado por el marco de la ventana […] porque le permitìa pensar y, sobre todo, recordar, y él sí era un cabrón recordador »656. L‟espace urbain devient ici un « tableau » (ou un paysage, comme le dit le narrateur) car il est perçu depuis une fenêtre dont l‟encadrement fait office de cadre. Laissant pour plus tard l‟analyse plus fouillée du procédé de l‟ekphrasis, signalons que le Conde apprécie la vue de son appartement car elle permet justement la réminiscence qu‟un polyptote met d‟ailleurs en évidence (« recordar », « recordador »). Parce qu‟il ne change pas (« inalterable »), ce panorama semble réconforter le policier. Ces moments de contemplation, qui marquent une pause dans le déroulement de l‟enquête, permettent donc l‟introspection, comme on le voit aussi quand le personnage se promène dans son quartier : 654 Carlos El Flaco, paralysé depuis cette guerre, vit cloué dans un fauteuil roulant. Elena Zayas, « Leonardo Padura Fuentes : las máscaras de la nostalgia », in Christian Giudicelli (dir.), América : cahiers du CRICCAL - Les nouveaux réalismes. 2ème série, n°25, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000, p. 156. 656 Leonardo Padura Fuentes, Máscaras, op. cit., p. 113. 655 222 De cualquier forma aquel paseo en solitario por el barrio era un placer que cada cierto tiempo el Conde se concedía : en aquella geografía precisa habían nacido sus abuelos, su padre, sus tíos y él mismo, y deambular por aquella Calzada […] era una peregrinación hacia sí mismo hasta límites que pertenecían ya a las memorias adquiridas de sus mayores.657 Le rappel généalogique, qui installe le Conde dans une lignée, fait émerger un passé qui va bien au-delà des souvenirs personnels du détective. C‟est toute la mémoire familiale qui marque ce quartier (« memorias adquiridas de sus mayores »). Se dessine alors une véritable géographie de l‟intime où la notion d‟espace-temps prend tout son sens. Ce quartier, que le narrateur définit aussi comme « la patria de sus nostalgias y sus muertos »658, est un territoire intemporel car les générations le traversent. Cette immuabilité rassurante est la preuve d‟un ordre et d‟une logique alors que le chaos règne partout dans cette Havane en crise. C‟est pourquoi Mario Conde apprécie ces moments d‟isolement propices au souvenir. L‟idée que le passé est apaisant et qu‟il peut être un refuge est évidente puisque le policier n‟a de cesse de le chercher dans les lieux qu‟il observe : […] adivinñ, más que vivo, el techo de tejas inglesas del castillo en cuya construcción había trabajado, casi cien años atrás, su abuelo Rufino el Conde. Saber que el castillo seguía allí, prepotente y altanero, siempre resultaba un alivio, pues le hacía sentir que en el mundo quedaban cosas invariables, capaces de navegar incólumes entre las turbulencias del tiempo y la historia.659 Là encore, l‟évocation de son grand-père inscrit le personnage dans une filiation et le place surtout dans un espace familier. Non seulement, il n‟est pas étranger à La Havane mais un de ses aïeux a participé à sa construction. Autrement dit, cet ancêtre a marqué la ville et fait maintenant partie de son histoire. Par procuration, le protagoniste se sent donc appartenir un peu plus à la ville. Le château, qui semblerait être le Castillo de Averhoff (dans le quartier de Arroyo Naranjo), symbolise la pérennité des choses dans une cité où tout s‟écroule et où tout semble voué à disparaître. Retrouver le passé est donc un soulagement pour ce personnage mélancolique qui cherche aussi dans la ville les traces de sa propre jeunesse. Dans un exercice assez courant, Mario Conde confronte deux époques en comparant un même lieu. L‟avenue de La Rampa est sans doute l‟endroit qui révèle le mieux le contraste temporel. Cette grande artère que le personnage fréquentait de manière compulsive lorsqu‟il était jeune fut à ce point liée à sa trajectoire personnelle qu‟elle constitua un lieu initiatique : 657 Id., Viento de cuaresma, op. cit., p. 84. C‟est nous qui soulignons. Id., La neblina del ayer, op. cit., p. 170. 659 Loc.cit. 658 223 […] subir y bajar la Rampa habìa sido la primera experiencia extraterritorial del Conde y sus amigos. Tomar la guagua en el barrio y hacer el largo recorrido hasta el Vedado, con el único propósito de subir y bajar, o bajar y subir aquella pendiente luminosa […] decretó para ellos el fin de la niðez y el inicio de la adolescencia […]. Pero llegaron a creer que todas las fronteras hacia la adultez estaban marcadas por aquella avenida prometedora, levemente pecaminosa para su mística adolescentaria, una pendiente por la cual debían bajar o subir Ŕ o subir y bajar Ŕ en manadas […]. Fue como un segundo bautismo aquel acto lleno de significados del ascenso y el descenso por esa calle [...].660 Cette frontière physique qui symbolise le passage entre différentes étapes de la vie (« niñez », « adolescencia », « adultez ») a fortement marqué la jeunesse du personnage car la promenade sur l‟avenue s‟est répétée à l‟envi. Le caractère lancinant de ces déambulations est rendu par la répétition tout aussi obsédante de « subir y bajar ». Monter et descendre La Rampa constitue justement un rite hautement symbolique, comme le suggèrent les adjectifs qui qualifient l‟avenue (« luminosa », « prometedora » et « pecaminosa »). La métaphore finale qui compare ce passage sur la Calle 23 (l‟autre nom de La Rampa) à un second baptême montre qu‟il s‟agit bien là d‟un rituel sacré. Cette artère vivante décrite par Padura n‟est pas sans rappeler La Rampa des années cinquante de Tres tristes tigres, qui est, pour le personnage de Cué, « el centro de La Habana nocturna y diurna »661. Bien sûr, aujourd‟hui cette grande avenue du Vedado est radicalement différente et Mario Conde, non sans désappointement, fait l‟expérience du passage du temps : Y en aquella misma Rampa, que Heráclito de Éfeso habría calificado, dialécticamente, de diferente, encontró el Conde otra vez sus deslumbramientos de aquellos tiempos, ahora a oscuras, con los clubes cerrados, el Pabellón mustio, la pizzería abarrotada y la ausencia de aquella novia remota […].662 En convoquant Héraclite, le précurseur de la dialectique et le philosophe du devenir qui proclamait « Tout coule, l‟homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », le narrateur fait de La Rampa le lieu où l‟écoulement du temps se matérialise663. Il constate douloureusement que tout passe irrémédiablement et que les choses, dans le cas présent, se dégradent. L‟avenue de 1989 n‟est pas seulement « différente », elle est morne et défraîchie 660 Id., Paisaje de otoño, op. cit., p. 67. Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 327, 328. 662 Leonardo Padura Fuentes, Paisaje de otoño, op. cit., p. 69. 663 Il est aussi question de cela dans La neblina del ayer : « […] Conde se alejó del bullicio nocturno y tomó la pendiente de La Rampa, con los límites cronológicos de la nostalgia ubicados más allá de su memoria personal […] y tratñ de encontrar los rastros todavìa visibles de una ciudad rutilante y pervertida, un planeta lejano […] », id., La neblina del ayer, op. cit., p. 203. 661 224 (« a oscuras », « cerrados », « mustio »). Les effets du temps sont visibles sur la ville et perceptibles dans la vie du détective : le narrateur omniscient rappelle en effet que Mario Conde n‟a plus sa fiancée d‟autrefois. Notons au passage que le terme « ausencia » insiste sur la solitude actuelle du personnage. Même si, comme nous aurons l‟occasion de le voir, le policier aime La Havane et y est très attaché, il n‟empêche que sa mélancolie l‟isole. A l‟instar du personnage d‟Estévez, Olivero, le Conde va se sentir exclu de la ville : « Conde sintió, por primera vez en sus casi cuarenta y ocho años de vida, que trashumaba por una ciudad desconocida, que no le pertenecía y lo empujaba, excluyéndolo »664. Là aussi la personnification de la ville met en avant une certaine passivité de la part du protagoniste et signifie que l‟exil intérieur n‟est pas volontaire mais subi. Conde se sent en décalage, voire en rupture, avec cette ville qu‟il ne reconnaît plus et la nostalgie éprouvée va l‟éloigner de la réalité : Miró a su alrededor y tuvo la nerviosa certeza de hallarse extraviado, sin la menor idea de qué rumbo debía tomar para salir del laberinto en que se había convertido su ciudad, y comprendió que él también era un fantasma del pasado […] colocado aquella noche […] ante la evidencia del fracaso genético que encarnaban él mismo y su brutal desubicación entre un mundo difuminado y otro en descomposición.665 L‟image du labyrinthe, dont nous reparlerons, illustre le malaise du personnage qui est comme pris au piège dans cette ville devenue étrangère. La perte de repères lui fait prendre conscience qu‟il n‟est plus à sa place. La nostalgie qui le tiraille entre deux époques vouées à disparaître (« difuminado », « en descomposición ») éloigne Mario Conde de la réalité. Non seulement, il semble ne plus appartenir à la réalité environnante mais lui-même perd de sa matérialité : il devient un fantôme. Chez Arenas, la nostalgie se fait plus âpre et plus violente. Elle ne constitue pas un projet d‟écriture, à proprement parler, qui va fonder un récit mais va plutôt poindre ça et là. Tantôt sous-jacente, tantôt explicite, elle est présente dans certaines de ses œuvres mais n‟est source d‟aucune consolation car la colère prédomine chez cet écrivain de la dissidence qui rejetait aussi bien la dictature castriste que le système capitaliste : « La diferencia entre el sistema comunista y el capitalista es que, aunque los dos nos dan una patada en el culo, en el comunista te la dan y tienes que aplaudir, y en el capitalista te la dan y uno puede gritar ; yo vine aquí a gritar »666. Cette déclaration faite juste après avoir quitté Cuba donne le ton. L‟exil 664 Ibid., p. 204. Ibid., p. 205. 666 Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 309. 665 225 lui permet de recouvrer la liberté, de retrouver certains amis et de récupérer aussi ses nombreux manuscrits littéraires mais, dès le début, il est vécu dans la rage et la douleur même si c‟est, pour lui, le seul moyen de « vivre dans un monde libre […] et [de] récupérer son humanité perdue »667. La nostalgie n‟est donc pas évacuée mais elle indissociable de la colère. « No tardé, desde luego, en sentir nostalgias de Cuba, de La Habana Vieja, pero mi memoria enfurecida fue más poderosa que cualquier nostalgia »668, dit le narrateur une fois à New York, après avoir quitté Miami qu‟il qualifie de « purgatoire »669. Si le présent n‟est pas idéalisé, le passé ne l‟est pas davantage, même dans son autobiographie, Antes que anochezca, publiée de façon posthume en 1992. L‟attachement qu‟il a pour le sol natal ne débouche pas sur la quête d‟un âge d‟or perdu qui se ferait, par exemple, grâce à la littérature. Quand il se rappelle la douceur de son enfance, la figure maternelle aimante ou la grande liberté sexuelle dont il jouissait à La Havane, d‟autres évocations plus ou moins douloureuses et cruelles (l‟absence du père qui est la figure du « traître », la pauvreté, la solitude de son enfance, la violence de la campagne, etc.) viennent presque systématiquement contrebalancer ces souvenirs. Il n‟y a donc pas d‟idéalisation même quand il s‟agit d‟exorciser La Havane en décrivant la ville depuis l‟exil, comme dans Viaje a La Habana. En effet, les trois nouvelles qui composent ce récit neutralisent la capitale cubaine d‟une certaine manière. Dans « Que Trine Eva », le couple insolite (Ricardo et Eva/Evattt) doit quitter La Havane et parcourir l‟Île. La ville disparaît donc de la fiction pour ne réapparaître qu‟à la toute fin du récit. Dans le deuxième voyage (« Mona »), elle est complètement absente puisqu‟il est question d‟un exilé cubain qui vit aux Etats-Unis. Enfin, dans « Viaje a La Habana », le troisième voyage, le retour à Cuba est stérile puisqu‟il ne fait que souligner que la ville est perdue à jamais pour Ismael. Comme le dit Jacobo Machover, chez Arenas, La Havane est souvent un point de départ ou d‟arrivée mais elle est surtout ce que l‟on fuit pour aller ailleurs670. D‟autre part, l‟image de l‟exilé considéré comme un homo viator apatride constitue un topique littéraire largement répandu que Reinaldo Arenas va réinterpréter : Diez años después de aquello [la llegada a Nueva York], me doy cuenta de que para un desterrado no hay ningún sitio donde se pueda vivir ; que no existe sitio, porque aquél donde soñamos, donde descubrimos un paisaje, leímos el primer libro, tuvimos la primera aventura amorosa, sigue siendo el lugar soñado ; en el exilio uno no es más que un fantasma, 667 Ibid., p. 304. C‟est nous qui traduisons. Ibid., p. 314. 669 « Si Cuba es el infierno, Miami es el Purgatorio », loc. cit. 670 « En varias ocasiones, La Habana aparece como punto de partida o de llegada […]. Pero el verdadero objetivo está en otra parte, en la huida hacia otro lugar », Jacobo Machover, La memoria frente al poder. Escritores cubanos del exilio : Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas, op. cit., p. 119. 668 226 una sombra de alguien que nunca llega a alcanzar su completa realidad ; yo no existo desde que llegué al exilio ; desde entonces comencé a huir de mí mismo.671 A mesure que le narrateur accepte son statut d‟exilé heimatlos et la perte définitive de l‟Éden (mise en lumière par de nombreuses négations), il va aussi se reconsidérer ontologiquement. Sous la plume d‟Arenas, un renversement s‟opère : ce n‟est pas le pays abandonné qui devient diffus et évanescent dans la mémoire mais l‟exilé qui perd de sa matérialité. Il n‟est plus qu‟un être fantasmagorique dont l‟existence serait mise entre parenthèses. « Yo no existo desde que llegué al exilio », dit le narrateur signifiant très clairement que l‟exil l‟a tué à jamais. En perdant son pays il s‟est lui-même perdu, semble-t-il suggéré quand il écrit « comencé a huir de mí mismo ». Cette expression montre aussi que dans une attitude schizophrénique, l‟exilé se définit dans le dédoublement, voire le déchirement. Il se fuit et apparaît comme une « conscience malheureuse », pour reprendre la formule de Hegel. Cette aliénation est manifeste dans un récit très symbolique, « Final de un cuento », écrit en 1982, où le narrateur établit un dialogue intérieur véhément où le « je » s‟oppose au « tu ». Cette fragmentation du moi est d‟autant plus intéressante qu‟elle va déboucher, à la fin du récit, sur la mort allégorique du « tu » qui se jettera de l‟Empire State Building. La nouvelle commence par la fin, quand le narrateur est à Key West (le point le plus au sud des Etats-Unis, à un peu plus de 150 kilomètres des côtes cubaines), prêt à disperser les cendres de son autre moi suicidé : Pensabas que lo que me atraía a este sitio era sólo la nostalgia : la cercanía de la Isla, la soledad, el desaliento, el fracaso. Nunca has entendido nada […]. Soledad, nostalgia, recuerdo […], todo eso lo siento, lo padezco, pero a la vez lo disfruto. Sí lo disfruto. Y por encima de todo, lo que me hace venir hasta aquí es la sensación, la certeza, de experimentar un sentimiento de triunfo… Mirar hacia el sur, mirar ese cielo que tanto aborrezco y amo […]. 672 Dans ces lignes apparaissent le tiraillement éprouvé par l‟exilé et l‟ambivalence de ses sentiments : non seulement la nostalgie n‟est pas source de souffrance mais procurerait du plaisir ; le désir de triompher fait pièce au sentiment d‟échec ; enfin, le ciel du pays natal est à la fois aimé et détesté. Étant donné sa situation, le narrateur ne semble pouvoir s‟inscrire que dans la contradiction et ses propos au sujet de la nostalgie sont en cela exemplaires. Un peu plus loin il dira : « […] la nostalgia también puede ser una especie de consuelo, un dolor 671 672 Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit.,., p. 314. Id., « Final de un cuento », in Adiós a mamá (De La habana a Nueva York), op. cit., p. 150. 227 dulce, una forma de ver la cosas y hasta disfrutarlas »673. Oxymore et antithèse sont nécessaires pour définir cet état d‟âme qui s‟impose à l‟exilé bien malgré lui. Le dédoublement de sa conscience met en lumière la lutte qu‟il entreprend contre la nostalgie : d‟un côté, il est tenté de se laisser aller aux regrets, aux souvenirs, de partir à la recherche du passé (en allant par exemple chercher La Havane à Key West) ; d‟un autre, il refuse de recourir à ces subterfuges. Le texte se construit donc autour d‟une dialectique rigoureuse, à l‟œuvre du début à la fin. Citons, à titre d‟exemple cet extrait où, à New York, le narrateur est à la fois absent, s‟imaginant à La Havane, et totalement hostile à un éventuel retour : Pero tu alma estaba en otro sitio ; allá abajo, en un barrio remoto y soleado con calles empedradas donde la gente conversa de balcón a balcón y tú caminas y entiendes lo que ellos dicen, pues eres ellos… Y qué ganaba yo con decirte que yo también deseaba estar allá, dentro de aquella guagua repleta […], cruzando la Rampa, o entrando en un urinario donde seguramente, de un momento a otro, llegará la policía y me pedirá identificaciñn… Pero, ñyelo bien, nunca voy a volver, ni aunque la existencia del mundo dependa de mi regreso. ¡ Nunca !674 L‟envie de retourner à Cuba est réelle et partagée par les deux aspects du moi mais elle est impossible et donc violemment rejetée par le narrateur (le « je »), comme le prouvent l‟impératif (« óyelo »), les points d‟exclamation et la répétition de l‟adverbe « nunca ». De plus, toute idéalisation de la terre natale est réfutée par des souvenirs douloureux indélébiles (ici, la traque policière contre les homosexuels). A cet égard, la distinction qu‟établit Gustavo Pérez Firmat entre immigré et exilé s‟avère tout à fait éclairante : « […] asì como el inmigrante quiere que su nuevo país se convierta en su patria, el exiliado quiere que su patria vuelva a convertirse en su país. Uno se identifica con la tierra en que vive y el otro con la tierra en que nació »675. Tout le drame du personnage de « Final de un cuento » est qu‟il se sent à fois exilé et immigrant ; il vit dans un ici et un ailleurs, sorte de non-lieu qui l‟écartèle. N‟ayant plus ni pays ni patrie, son existence est aliénante. Toute réconciliation entre l‟exilé et l‟immigrant étant ici impossible, un des deux moi doit disparaître. C‟est la conscience nostalgique (l‟exilé) qui finit par se tuer, celle qui du haut du gratte-ciel new-yorkais s‟imagine toujours à La Havane : Me asomé. Vi el Hudson expandiéndose […]. ¡ El Hudson, dije, qué grande !... ¡ Imbécil !, me dijiste y seguiste observando : un mar azul 673 Ibid., p. 156. Ibid., p. 154, 155. 675 Gustavo Pérez Firmat, « Transcender el exilio : la literatura cubano-americana, hoy », in La gaceta de Cuba, La Havane, Ediciones Unión, septembre-octobre 1993, p. 20. 674 228 rompìa contra los muros del Malecñn. […] Las olas batìan contra los farallones de El Castillo del Morro, ventilando la Avenida del Puerto y las estrechas calles de La Habana Vieja.676 Poursuivant l‟évocation de cette Havane fantasmée qui se confond avec New York, le narrateur évoque le grand saut de cet autre je malheureux qui a trouvé dans le suicide une manière d‟exister à nouveau et de retrouver la mère-patrie : « Saltaste. Esta vez Ŕ lo vi en tu rostro Ŕ estabas seguro de que ibas a llegar, que lograrías mezclarte en el tumulto de tu gente, ser tú otra vez »677. Voici comment le narrateur abandonne la nostalgie mortifère et assassine qui le ronge : en la tuant et en se tuant lui-même en partie. La phrase écrite quelques années plus tard dans Antes que anochezca, que nous avons citée plus haut, prend alors tout son sens : « Yo no existo desde que llegué al exilio ». Si nous avons dit que l‟exil était une mort, nous voyons à présent que la nostalgie l‟est aussi. L‟exil est inévitable mais la nostalgie, au contraire, peut être maîtrisée et étouffée, c‟est d‟ailleurs sur cette idée que se clôt la nouvelle : […] y con esta historia haré un cuento […] para que veas que aún puedo escribir ; y hablaré arameo, japonés y yídish medieval si es necesario que lo hable con tal de no volver jamás a una ciudad con malecón, a un castillo con un faro ni a un paseo con leones de mármol que desembocan en el mar. Óyelo bien : yo soy quien he triunfado, porque he sobrevivido y sobreviviré. Porque mi odio es mayor que mi nostalgia. Mucho mayor, mucho mayor. Y cada dìa se agranda más…678 L‟écriture littéraire d‟Arenas n‟est pas motivée par la nostalgie ou le désir de recréer ce qui a été perdu (contrairement à Cabrera ou à Estévez), comme l‟explique le commentaire métanarratif. Écrire permet au contraire de tuer dans l‟œuf toute manifestation nostalgique. Comme s‟il voulait s‟en convaincre, le narrateur répète à l‟envi et avec force (grâce à l‟impératif, au superlatif et aux répétitions) qu‟il ne veut pas retourner à La Havane, que sa haine grandissante a raison de sa mélancolie et qu‟il sort triomphant de cette lutte intérieure. Cette insistance met clairement au jour le rôle à la fois cathartique et libérateur de l‟écriture pour Arenas. A cet égard, on observera que la volonté de rompre avec le passé et avec la mère-patrie passe aussi par le langage. L‟évocation des langues rares montre qu‟il est même prêt à abandonner sa langue maternelle s‟il faut que ce dernier lien soit coupé. A l‟inverse d‟un Cabrera Infante, Reinaldo Arenas prétend s‟inscrire dans la rupture complète et totale avec la terre natale car il en va de sa survie. Parce qu‟il sait que la nostalgie peut tuer lentement en gangrénant le cœur de l‟exilé, l‟écrivain préfère trancher dans le vif. Bien sûr, on 676 Reinaldo Arenas, « Final de un cuento », in Adiós a mamá (De La habana a Nueva York), op. cit., p. 168. Ibid., p. 171. 678 Ibid., p. 174. 677 229 pourra arguer qu‟en prétendant la nier et la tuer, le narrateur place finalement la nostalgie au cœur de son récit. Il n‟en reste pas moins que celle-ci est bien moins prégnante chez Arenas que chez les auteurs précédemment cités et qu‟elle n‟est pas un ressort littéraire qui fonderait l‟œuvre de l‟auteur. Chez Zoé Valdés, le besoin d‟écrire La Havane avant et après l‟exil est manifeste mais, comme pour Arenas, l‟écriture romanesque ne se bâtit pas autour de la nostalgie même si sa prose en est empreinte. La capitale cubaine qu‟elle a laissée en 1995 apparaît à des degrés divers dans plusieurs de ses œuvres : La nada cotidiana (1995), Te di la vida entera (1996), Café Nostalgia (1997) et Los misterios de La Habana (2004). La nostalgie point de façon plus ou moins manifeste dans ces récits fictionnels ou qui, du moins, se présentent comme tels. Aussi marqués soient-ils par l‟expérience personnelle de l‟auteur679, ces écrits ne partagent pas le caractère clairement autobiographique de certains textes cités auparavant. A l‟instar des écrivains que l‟on vient d‟évoquer, Zoé Valdés se tourne vers le passé pour retrouver un âge d‟or perdu mais il ne s‟agit pas systématiquement de son propre passé. La ville prérévolutionnaire des années cinquante qu‟elle n‟a jamais connue devient un véritable Éden magnifié et mythifié dans Te di la vida entera. Les trois premiers chapitres du roman décrivent une ville joyeuse, sensuelle et grisante que la narratrice, née après la Révolution, aurait aimé connaître : « Ésa era La Habana, colorida, iluminada, ¡ qué bella ciudad, Dios santo ! Y que yo me la perdí por culpa de nacer tarde »680. Il s‟agit donc ici d‟une nostalgie éprouvée non pas envers ce qui a été perdu personnellement mais envers ce qui n‟a jamais été connu. Le chapitre quatre du roman, intitulé de façon explicite « Se acabó la diversión »681, marque une rupture nette et sert de frontière temporelle entre une époque dorée et un présent fait de difficultés et de ruines où la ville s‟écroule, comme par mimétisme, à mesure que la protagoniste Cuca Martínez vieillit. Dans Café Nostalgia, roman écrit en exil, la dialectique entre ici et là-bas, entre maintenant et avant, confronte sans manichéisme Paris à La Havane. Le titre du roman évoque d‟emblée la perte d‟un espace, d‟une vie et d‟une jeunesse qui ressurgissent grâce aux souvenirs de la Cubaine Marcela qui vit exilée à Paris. Le scénario écrit par un autre exilé, Samuel, que la protagoniste découvre par hasard et lit en secret, participe également de cette résurgence du passé. Ce scénario, retranscrit dans le roman, est une fiction dans la fiction. La mise en abyme permet de mettre en parallèle les souvenirs de Marcela et ceux de Samuel qui ont en commun un seul et même espace : La Havane 679 On pense notamment à Café Nostalgia. Zoé Valdés, Te di la vida entera, op. cit., p. 31. 681 L‟auteur reprend ici un vers très connu d‟une chanson de Carlos Puebla : « Y en eso llegó Fidel » (« Se acabó la diversión / llegó el comandante / y mandó a parar »). 680 230 révolutionnaire. La nostalgie ne prend pas ici une tournure idéalisatrice. La jeunesse de la protagoniste est certes marquée par une certaine légèreté (on pense, par exemple, aux fêtes organisées sur les azoteas682) mais elle n‟est pas exempte de gravité. L‟exil de ses parents marielistas ou encore la mort d‟un homme dont Marcela pense être responsable sont des événements qui ont profondément ébranlé la jeune femme. Alors qu‟elle est à Paris, l‟héroïne se réfugie dans la littérature en se replongeant pour la troisième fois dans l‟œuvre de Proust. La lecture de A la recherche du temps perdu constitue l‟une des premières manifestations de la nostalgie puisque Marcela relit une œuvre déjà lue à Cuba et qui la ramène à sa jeunesse : Con los ojos aguados de lágrimas por la nostalgia de aquellas citas adolescentes con la literatura, lo menos que podía hacer era un homenaje silencioso a mi Habana. Hay obras que […] como ésa nunca dejarán de estremecerme ; […] porque releerlas me retrotraen a mi inocencia inexplorada, a los dìas en que yo confiaba en mi futura madurez […]. 683 Notons que c‟est la lecture d‟un livre de mémoires qui déclenche ici l‟anamnèse. Choisir A la recherche du temps perdu n‟est absolument pas anodin de la part de Valdés car cette œuvre fonctionne justement comme la fameuse madeleine de Proust : le roman français fait ressurgir des souvenirs et des impressions passées, et c‟est parce que le récit proustien produit sur elle cet effet que la Cubaine y est attachée. Car elle ne s‟en cache pas, elle aime la mélancolie : « […] me regodeo en la tristeza, disfruto con tremendismo de los estados melancólicos »684. On notera que l‟importance de Proust tout au long de Café Nostalgia renforce le caractère rétrospectif de ce roman. La nostalgie se manifeste aussi au détour d‟une conversation ou d‟une promenade dans Paris comme lorsque, avec ses amis cubains, elle s‟amuse à se rappeler les endroits de La Havane sous forme de devinettes : […] la mayorìa del grupo nos dirigìamos a refrescar la mente a orilla del Sena, nuestro sustituto del Malecñn. […] Entonces jugábamos […] a acordarnos de los sitios de La Habana, de las comidas obligadas, de los libros oficiales. A rememorar todo un pasado. Era divertido, pero también angustioso. Nuevos amigos, nuevas nostalgias. Ŕ A ver, ¿ cómo se llaman las calles que hacen esquina con La Moderna Poesía ? Ŕ Fácil, Obispo y Bernaza. Ŕ ¿ Qué había en Muralla y Teniente Rey ? Ŕ Una cafetería. Ŕ Correcto. Pero ¿ cómo se llamaba ? 682 « No habìa sábado que no tuviéramos una fiesta. Nos alternábamos las azoteas. […] El asunto era bailar, sudar, divertirnos, comer mierda […] », Zoé Valdés, Café Nostalgia, op. cit., p. 137. 683 Ibid., p. 65. 684 Loc. cit. 231 Ŕ La Cocinita.685 Ou quand, toujours à Paris, ce groupe d‟amis rend hommage à certaines grandes figures historiques en commémorant leur mort : Cumplíamos ritos extravagantes en honor a una juventud malherida o moribunda. Por ejemplo, un veintiocho de octubre, echamos flores blancas en el Sena en honor a Camilo Cienfuegos, pero esa vez nos dio por llorar de nuestra propia ingenuidad, por el hecho de que la nostalgia nos obligara a acometer acto tan ridículo. 686 L‟autodérision et le regard distancié de la narratrice désacralisent la nostalgie mais ne la rendent pas pour autant moins émouvante. Malgré l‟exil, les blessures du passé ne sont pas toujours refermées, comme le suggère l‟adjectif « malherida », et ces jeunes gens doivent faire le deuil d‟une jeunesse passée (« moribunda ») qu‟ils essaient malgré tout de recréer à Paris. Cet acte que Marcela qualifie d‟« extravagant » est surtout vain et illusoire (elle ne s‟y trompe d‟ailleurs pas) mais il met en lumière le besoin de retrouver l‟espace que l‟on a abandonné dans la géographie actuelle, autrement dit, de reconstruire La Havane à travers d‟autres villes. Laissant pour un peu plus tard l‟étude de ce motif récurrent, il convient d‟évoquer un autre traitement de la nostalgie à travers un dernier exemple. Le temps qui passe est aussi au cœur du roman d‟Abel Prieto, El vuelo del gato, comme en attestent les multiples allusions aux frises (où les souvenirs sont comme gravés dans le marbre) et au dieu du temps, Chronos. Dans ce récit, l‟écrivain et ancien ministre de la Culture, qui vit toujours à Cuba, met en scène les retrouvailles, dans les années quatre-vingtdix, d‟une bande d‟amis de lycée. Cela sert de prétexte à un voyage dans le temps qui couvre trois décennies et qui a pour décor La Havane. Les souvenirs personnels et l‟histoire récente de Cuba se superposent dans ce roman où l‟espace urbain permet une fois de plus de « récupérer le passé »687, notamment à la fin du roman lorsque les deux protagonistes principaux, Marco Aurelio et Freddy Mamoncillo, se retrouvent à Marianao pour attendre la naissance de l‟enfant d‟Amarilis (femme de Freddy et maîtresse de Marco Aurelio). Etre à nouveau dans ce quartier, trente ans après les années de lycée, fait émerger les souvenirs : Marco Aurelio recibía a su vez la oleada agridulce del pasado y la acogía con menos objeciones que su compañero de marcha. Ante el Obelisco […] recordaba aquellas tertulias al aire libre […], y la calle 100 le 685 Ibid., p. 261, 262. Ibid., p. 263. 687 Abel Prieto, El vuelo del gato (1999), Barcelone, Ediciones B, 2000, p. 217. C‟est nous qui traduisons. 686 232 aportaba, como diría el poeta « una fuente inagotable de remembranzas » […].688 Les personnages sont à leur corps défendant submergés par ce passé, comme en témoignent le terme « oleada » et l‟expression « fuente inagotable ». A l‟inverse d‟un Mario Conde, les personnages de Prieto ne considèrent pas la nostalgie comme un refuge. Ils semblent soigneusement l‟éviter car elle pourrait être douloureuse. C‟est en tout cas ce que suggère la comparaison faite avec des mines anti-personnelles : « La Avenida 31 estaba sembrada de esas minas antipersonales (e intransferibles), destinadas a explotar calladamente, a que saltaran los recuerdos en fragmentos […] »689. Les souvenirs surgissent de manière violente et inattendue (« explotar », « saltaran »). L‟oxymore (« explotar calladamente ») suggère que l‟effet de ces « bombes » sur les deux hommes est étouffé et dissimulé. C‟est parce que ces assauts du passé pourraient les renvoyer à une époque plus heureuse et à une complicité passée désormais caduque, que Marco Aurelio et Freddy se prémunissent contre les souvenirs. Quoi qu‟il en soit, dans ce roman, La Havane sert de décor à la mémoire mais elle n‟en est pas l‟objet ; bien qu‟elle permette la réminiscence, elle ne constitue pas une quête, comme chez d‟autres auteurs évoqués. Il convient de signaler à présent d‟autres manifestations de la nostalgie communes à plusieurs auteurs. La première est la reconstruction de la ville à travers l‟évocation d‟un passé éloigné, ou tout au moins jamais vécu. Los misterios de La Habana (2004), de Zoé Valdés, est un recueil de récits très courts qui mettent en scène la ville des XIXème et XXème siècles. En convoquant des figures emblématiques du passé qui ont marqué l‟histoire littéraire, intellectuelle ou politique du pays (José María Heredia, Domingo del Monte, la Comtesse Merlin, José Martí ou encore Dulce María Loynaz) ainsi que des anonymes et en mêlant des légendes et des événements historiques, l‟auteur se livre à une reconstruction mythique de La Havane. Elle se tourne vers le passé pour rendre hommage à la ville car, comme le laisse entendre le titre, la capitale est le fil conducteur de tout le récit, même si les descriptions spatiales sont finalement assez rares. Réécrire le passé de la ville en fouillant dans l‟histoire individuelle et collective permet de signifier son attachement à la patrie. La nostalgie affleure car, même sans être passéiste ni idéalisatrice, cette œuvre fait ressortir les charmes désuets d‟une époque lointaine. Le passé y est décrit à travers la distance temporelle qui, à la manière d‟un filtre, transforme parfois ces courts récits en vignettes, voire en chromos anciens. Cette idée se justifie d‟autant plus que la dénonciation politique présente dans les derniers récits 688 689 Ibid., p. 314. Loc. cit. 233 s‟appuie sur une opposition temporelle évidente. Le présent révolutionnaire est marqué du sceau de la décrépitude, du manque et de l‟agonie alors que le passé est glorifié : Una pena para La Habana, que no se acerca ni remotamente a albricias semejantes, más bien se aleja cada segundo, en su pobre supervivencia ; de aquellas noches luminosas y espectaculares de sí misma, anteriores a la fatalidad. Los personajes legendarios, sus mitos, se han fugado a Miami o a otros santos lugares.690 La ville du présent, vidée de ses artistes mythiques, est devenue une ville fantôme et moribonde. L‟évocation de lieux emblématiques comme le grand magasin Tencent 691 ou la librairie La Moderna Poesía692 avant et après la Révolution ne fait que renforcer cette opposition. Chez Zoé Valdés, le mythe et les légendes de La Havane appartiennent irrémédiablement au passé. Leonardo Padura Fuentes fait aussi revivre, sans l‟idéaliser, La Havane du XIXème siècle dans La novela de mi vida en imaginant le récit autobiographique du grand poète cubain José María Heredia693. Sont ainsi décrits son amitié avec Domingo del Monte, ses histoires sentimentales et ses divers voyages qui l‟éloignèrent de La Havane coloniale de l‟époque. Dans la veine policière, le roman La neblina del ayer, du même auteur, renvoie à une époque moins éloignée (la capitale des années cinquante) mais il est pétri de la même nostalgie. L‟enquête de Mario Conde sur l‟ancienne chanteuse de boléros, Violeta del Río, n‟est qu‟un prétexte pour décrire une Havane festive où les plus grands artistes se retrouvaient694. Dans Adiós, Hemingway, comme le titre l‟indique, c‟est La Havane de l‟écrivain nord-américain qui ressurgit pour les besoins d‟une enquête que mène l‟ex-policier à la Finca Vigía. Ici aussi, l‟énigme policière semble être au service de l‟analepse. On soulignera, par ailleurs, que l‟attachement du Conde pour ces époques passées, qu‟il n‟a pas connues, apparaît déjà dans le deuxième roman de la tétralogie : […] le gusta la vida nocturna y en el Rìo Club todavìa se puede respirar una atmósfera bohemia y de caverna para iniciados que ya no existe más en otros sitios de la ciudad. Sabe que el alma profunda de La Habana se está transformando en algo opaco y sin matices que lo alarma […], y siente una nostalgia aprendida por lo perdido que nunca llegó a 690 Ibid., p. 234. C‟est nous qui soulignons. Ibid, p. 196-200. 692 Ibid, p. 230-321. 693 On notera au passage que la nostalgie de la patrie perdue traversait déjà l‟œuvre de ce poète qui dut quitter Cuba. 694 A ce sujet, Renée Clémentine Lucien explique que « La nostalgie du paradis perdu, de cette Havane devenue mythique pour une génération d‟écrivains habitée par la hantise de sa disparition, se reflète dans les obsessions de leurs personnages désenchantés, pour qui la ville prérévolutionnaire invitait à l‟exaltation de soi, à la jouissance effrénée des corps et des esprits », Renée Clémentine Lucien, Résistance et cubanité. Trois écrivains nés avec la Révolution cubaine : Eliseo Alberto, Leonardo Padura et Zoé Valdés, op. cit., p. 196. 691 234 conocer : los viejos bares de la playa donde reinó el Chori con sus timbales, las barras del puerto donde una fauna en extinción pasaba las horas […] cantando […] los boleros del Benny, Vallejo y Vicentico Valdés […]. Aquella Habana del cabaret Sans Souci […], una ciudad desfachatada, a veces cursi y siempre melancólica en la distancia del recuerdo no vivido ya no existía […].695 Là aussi, nommer exhaustivement les artistes et les lieux de divertissement qui firent la gloire de La Havane, permet de reconstruire une ville et une époque que le personnage aurait aimé connaître. Pour ne pas insister davantage sur la confrontation qui oppose le passé au présent, opposition mise en lumière ici par la répétition de la locution adverbiale « ya no », disons simplement que Conde devient le « gardien de la mémoire insulaire »696. On voit bien, à travers ces exemples, que ce n‟est pas le souvenir personnel qui est recherché ici. Les auteurs convoquent des gloires du passé, des personnalités marquantes qui ont fondé l‟identité cubaine et des lieux emblématiques pour reconstruire une Havane mythique, morte à jamais. Renée Clémentine Lucien, analysant les œuvres d‟Alberto, Padura et Valdés, fait une observation qui peut éclairer nos propos : […] les trois auteurs travaillent à donner épaisseur à des espaces de la ville symboliques par leur charge nostalgique et idéalisés parce que […] soit ils portent, à leur sens, l‟empreinte de figures cardinales de la culture ou de l‟Histoire, soit ils y retrouvent, préservées, des traces du cadre urbain d‟autrefois ayant échappé à l‟appauvrissante métamorphose de La Havane. En tout état de cause, le recours au baume du passé revivifiant et consolateur est la manifestation d‟une perte de foi dans le credo révolutionnaire, dans la pertinence d‟une pérennisation du canon de l‟Homme Nouveau.697 Avec la période spéciale, la nostalgie chez Zoé Valdés et Padura Fuentes revêt une tonalité politique. On se tourne vers le passé pour oublier les difficultés présentes et pour signifier un désenchantement manifeste. Nous remarquerons, cela dit, que toutes les évocations du passé et les manifestations de la nostalgie ne sont pas toujours connotées politiquement. C‟est le cas d‟Arturo Arango, écrivain résidant toujours à Cuba, qui convoque de façon tout à fait neutre une époque éloignée dans la nouvelle « La Habana elegante ». En s‟inspirant de la biographie de Julián del Casal, Arango imagine son dernier jour de vie et il décrit cette journée du 21 Octobre 1893 en la ponctuant de moments plus ou moins anecdotiques. Il évoque, par exemple, les activités professionnelles de l‟écrivain à la revue littéraire La Habana Elegante, 695 Leonardo Padura Fuentes, Vientos de cuaresma, op. cit., p. 92. C‟est nous qui soulignons. Nous reprenons une expression de Fabienne Viala, in Fabienne Viala, Leonardo Padura, le roman noir au paradis perdu, Paris, L‟Harmattan, 2007, p. 30. 697 Renée Clementine Lucien, Résistance et cubanité. Trois écrivains nés avec la Révolution cubaine : Eliseo Alberto, Leonardo Padura et Zoé Valdés, op. cit., p. 193. 696 235 ses promenades dans La Havane, les rencontres avec ses amis écrivains 698 et aussi le dîner fatidique durant lequel Casal perdit la vie. Pour sa part, Reinaldo Montero, dans Bajando por Calle del Obispo, décrit en détail l‟évolution et les transformations de la rue Obispo depuis l‟époque coloniale sans contester le présent. Aucune époque n‟est idéalisée même si les nombreuses illustrations (photos anciennes, gravures, dessins, vieilles publicités) qui accompagnent son récit tiennent parfois volontairement de l‟image d‟Epinal. Chez les quatre auteurs que nous venons de citer la nostalgie revêt un caractère plus fédérateur car ils recourent aux emblèmes culturels et historiques cubains et non pas aux souvenirs intimes et personnels. La nostalgie se traduit également par un autre traitement de la ville particulier et pourtant récurrent : la transposition de La Havane dans d‟autres villes. Nombreux sont les auteurs (surtout de la diaspora) qui tentent de retrouver la capitale cubaine dans les rues de New York, Miami ou Paris. Ils corroborent ainsi l‟idée selon laquelle « el exiliado reside en un lugar y vive en otro »699. Nous avons vu, il y a peu, que le personnage nostalgique de « Final de un cuento », d‟Arenas, essayait de retrouver La Havane à New York. A plusieurs reprises, il se laisse submerger par ses souvenirs jusqu‟à s‟abstraire de la réalité environnante. Ainsi, alors qu‟il se promène sur Broadway, il s‟imagine soudainement à La Havane : […] caminas por la Octava Avenida. Tomas 51 Street. Cada vez más remoto entras en el torbellino de Broadway ; los pájaros, nublando un cielo violeta, se posan ya sobre los tejados y azoteas del Teatro Nacional, del Hotel Inglaterra y del Isla de Cuba, del cine Campoamor y del Centro Asturiano […].700 Le narrateur poursuit la description précise de cette promenade imaginaire en répertoriant les lieux traversés (la place du Capitole, le Paseo del Prado, le Malecón, la place de la cathédrale). Cette promenade agréable stimule les sens du personnage et le rend contemplatif. Des verbes comme « ves », « observas », « contemplas »701 l‟apparentent à un flâneur. Si dans un premier temps, la géographie havanaise se substitue à New York, quand la réalité rattrape le protagoniste, c‟est la mégapole nord-américaine qui s‟impose en happant le personnage comme dans un tourbillon : 698 Non sans humour Arturo Arango cite le nom d‟écrivains contemporains comme Reinaldo Montero, Leonardo Padura et même Arturo Arango ! 699 Gustavo Pérez Firmat, « Transcender el exilio : la literatura cubano-americana, hoy », in La gaceta de Cuba, op. cit., p. 19. 700 Reinaldo Arenas, « Final de un cuento », in Adiós a mamá, op. cit., p. 159, 160. 701 Ibid., p. 160. 236 Te lanzas. Los autos Ŕ taxis sobre todo Ŕ impiden que sigas caminando. Esperas junto a la multitud por la señal del WALK iluminado. Cruzas 50 Street y pareces difuminarte en las luces de Paramount Plaza, de Circus Cinema, Circus Theater […]. Ahora el tumulto de los taxis ha convertido todo Broadway en un río amarillo y vertiginoso.702 Les deux descriptions s‟inscrivent en totale opposition puisqu‟à New York la promenade n‟a plus rien d‟agréable. La ville semble même engloutir le personnage (« difuminar ») qui va préférer retourner à La Havane de manière aussi abrupte que précédemment : « Cruzas ya frente a Bond y Disc-O-Mat […]. Todos cruzan frente a ti […]. Por Oreilly, por Obispo, por Obrapía, por Teniente Rey, por Muralla, por Empedrado, por todas las calles que salen de la bahìa, camina la gente […] »703. Ce va-etŔvient entre les deux villes permet aux deux espaces de se superposer. Grâce à un voyage imaginaire, La Havane existe toujours à travers New York. Faire coïncider deux géographies constitue même la quête de l‟exilé selon les propres termes d‟Arenas : El desterrado es ese tipo de persona que ha perdido a su amante y busca en cada rostro nuevo el rostro querido y, siempre autoengañándose, piensa que lo ha encontrado. Ese rostro pensé hallarlo en Nueva York, cuando llegué aquí en 1980 ; la ciudad me envolvió. Pensé que había llegado a una Habana en todo su esplendor, con grandes aceras, con fabulosos teatros […], con gente de todo tipo, con la mentalidad de un pueblo que vivìa en la calle […], no me sentì extranjero al llegar a Nueva York.704 L‟expérience personnelle de l‟écrivain montre qu‟il est à la fois naturel et vain d‟essayer de retrouver la ville qu‟on a laissée. New York l‟a certes séduit dès son arrivée mais l‟exil et le déracinement n‟en ont pas été moins douloureux car, comme le souligne la métaphore qui associe la ville au visage de l‟être aimé, Arenas était profondément attaché à La Havane. C‟est une autre ville nord-américaine que Zoé Valdés associe à la capitale cubaine : Miami. L‟association entre les deux villes est d‟autant plus évidente qu‟elles sont proches géographiquement et culturellement car la ville floridienne constitue un véritable fief pour les exilés cubains au point qu‟un de ses quartiers s‟appelle Little Havana. Zoé Valdés rappelle, dans, Los misterios de La Habana, que Miami, longtemps considérée comme « une parodie » ou « une copie simpliste de La Havane »705, a supplanté aujourd‟hui la ville cubaine : « Miami empezó siendo una copia que superó al original. El suburbio se ganó el galardón de centro de gravedad de la vida cultural y política cubana. Porque por Miami „cae‟ La Habana entera. 702 Ibid., p. 161. Ibid., p. 163. 704 Id., Antes que anochezca, op. cit., p. 315. 705 Zoé Valdés, Los misterios de La Habana, op. cit., p. 230. 703 237 Miami es hoy por hoy la capital de Cuba […] »706. Une ville a remplacé l‟autre en lui prenant son essence. L‟auteur reprend d‟ailleurs ensuite une boutade qui dit que la partie de Cuba la plus proche des Etats-Unis n‟est pas La Havane mais Miami. Ici, les espaces ne se superposent pas mais se substituent l‟un à l‟autre. A La Havane agonisante et fantasmagorique correspond la ville de Miami. Vivante et fringante, cette dernière est capable de ressusciter la cité cubaine : « […] Miami habrá aventajado sin duda a la capital, pero sólo por este largo momento ahistórico, porque será Miami la que, con sus mejores luces, resucitará a La Habana, y ese suburbio idealizado en que la hemos convertido recuperará vida y milagros »707. Il n‟est pas étonnant que la dissidente Zoé Valdés considère Miami comme la voie du salut pour La Havane post-révolutionnaire. Tout ce que la ville américaine a pris à la capitale cubaine (artistes, habitants, atmosphère) lui sera restitué après cette étape que l‟auteur qualifie d‟« ahistorique ». Notons au passage que cet adjectif tend à écarter l‟étape révolutionnaire de l‟Histoire cubaine. Dans un discours moins subversif, Padura traite également cette transposition géographique mais il le fait par le truchement d‟un personnage secondaire et en renversant complètement la critique. Miriam est la veuve d‟un ancien membre de l‟establishment cubain, Miguel Forcade Mier, qui vécut dix ans à Miami et dont le cadavre a été découvert sur une plage proche de La Havane. Elle explique à Mario Conde ce que représentait pour elle Miami avant qu‟elle ne parte y vivre avec son mari : En mi cabeza yo había fabricado la Calle 8, y era como una fiesta y un museo, […] un lugar divertido, lleno de luces y algarabìa, donde se escuchaba música a todo volumen y la gente caminaba por las aceras, despreocupados y felices de la vida disfrutando de aquella Pequeña Habana donde sobrevivía lo bueno y lo malo que se extinguió en esta otra Habana. Por eso también debía ser un sitio detenido en el tiempo, donde iba a encontrar un paìs que no conocì […] : este mismo paìs, antes de 1959, con un café en cada esquina, una victrola tocando boleros en cada bar, […] una calle donde se podìa conseguir cualquier cosa sin necesidad de hacer cola […].708 Dans l‟esprit de Miriam, Miami était le double de La Havane prérévolutionnaire : une ville festive et facile qui serait en quelque sorte la mémoire de la capitale cubaine. Bien sûr, cette ville idéalisée n‟a jamais existé et Miriam s‟empresse d‟expliquer au policier combien fut grande sa désillusion quand elle arriva en Floride. En faisant dire à cette femme d‟exilé, dont le mari était par ailleurs corrompu, que Miami pouvait être imaginée comme une sorte d‟Éden retrouvé et en insistant longuement sur sa déception, l‟écrivain invalide complètement la 706 Ibid., p. 231. Ibid., p. 235. 708 Leonardo Padura Fuentes, Paisaje de otoño, op. cit., p. 74, 75. 707 238 comparaison. Padura s‟appuie donc sur ces fantasmes quelque peu éculés pour mieux les renverser : « […] la calle 8 no es más que eso : una calle fabricada con la nostalgia de los de Miami y con los sueños de los que queremos ir a Miami. Es como las ruinas falsas de un país que no existe ni existiñ […] »709. La Havane comme Miami sont les espaces de la nostalgie, sauf que la ville américaine apparaît comme factice. C‟est un décor artificiel, une coquille vide en quelque sorte qui, contrairement à La Havane, n‟a jamais eu d‟âge d‟or. C‟est ce mirage, ce simulacre d‟Éden que Padura dénonce ici. La capitale cubaine d‟autrefois est donc une ville irrécupérable que rien ne pourra remplacer. En cela, la nostalgie de cet écrivain prend un accent désespéré. Chez Zoé Valdés, La Havane se mire aussi dans une autre ville : Paris. Quand elle compare sa ville natale à Paris, son discours se fait moins politique et la nostalgie est moins âpre. Dans Café Nostalgia, nous avons vu que Marcela et ses amis exilés s‟amusaient à évoquer La Havane et à faire montre d‟un certain patriotisme dans Paris. Il importe de remarquer que la protagoniste recherche La Havane dans la capitale française, comme lorsqu‟elle compare son immeuble du Marais à un solar havanais (« [Charline] repudió la decisión mía de mudarme a la calle Beautreillis, del Marais, a un solar francés estilo habanoviejero […] »710) ; ou encore lorsqu‟elle voit dans les bords de Seine le Malecón cubain (« […] a la orilla del Sena, nuestro sustituto del muro del Malecón »711). Dans Los misterios de La Habana, Valdés va même plus loin en faisant fusionner les deux villes. Elle construit sa ville idéale en imbriquant les deux espaces : Si pudiera, cargaría al hombro mi esquina preferida parisina y la mudaría hasta superponerla encima de mi esquina habanera más querida […]. Esto harìa una ciudad ideal, mitad La Habana, mitad Parìs […]. Tomaría la esquina de Beautreillis y Charles V y la pegaría con la esquina de Muralla y San Ignacio, o bulevar Bourdon y bulevar Sully con Empedrado y Villegas, o M y Calzada con la punta de la plaza Saint-Michel.712 Comme dans un collage surréaliste, la narratrice associe les rues de deux villes différentes entre elles pour créer un espace imaginaire parfait. La cité devient un corps hybride plus chimérique que jamais, à l‟image justement de la chimère et de ces autres créatures légendaires composées d‟éléments disparates. L‟espace urbain perd de sa réalité et de son unité, il devient fragmenté car l‟exilé n‟a plus d‟ancrage : il est un nomade vivant entre ici et là-bas. Avec Renée Clémentine Lucien nous pouvons dire que Zoé Valdés construit « un 709 Ibid., p. 75. Zoé Valdés, Café Nostalgia, op. cit., p. 116. 711 Ibid., p. 261. 712 Zoé Valdés, Los misterios de La Habana, op. cit., p. 236. 710 239 univers disséminé mais nostalgique configurant une construction « archipélique » pour paraphraser Edouard Glissant »713. La ville idéale de l‟écrivaine montre donc le tiraillement de l‟exilé pris entre deux géographies, celle de l‟exil et celle de la nostalgie. Enfin, on voudrait s‟arrêter sur un dernier exemple d‟autant plus intéressant qu‟il associe la capitale cubaine à des cités imaginaires. Sans doute est-ce l‟insilio qui amène Antonio José Ponte à reconstruire la ville de la période spéciale à travers des espaces inventés de toutes pièces. Dans la nouvelle « Un arte de hacer ruinas », les références topographiques réelles ne servent qu‟à décrire une Havane en ruines qui disparaît un peu plus à chaque éboulement d‟immeuble. A cette ville qui s‟écroule correspond Tuguria714, cité souterraine, qui s‟élève à mesure que les Tugures (les habitants de Tuguria) utilisent les ruines de La Havane pour édifier leur propre ville en sous-sol. A La Havane en ruines s‟oppose ainsi Tuguria, la ville en construction, que le protagoniste découvre lorsqu‟il pénètre par hasard dans un tunnel : Había llegado a una ciudad de pesadilla […]. De no salir inmediatamente, tendría que reconocer que allí existía una ciudad muy parecida a la de arriba. Tan parecida que habría sido planeada por quienes propiciaban los derrumbes. Y frente a un edificio al que faltaba una de sus paredes, comprendí que esa pared, en pie aún en el mundo de arriba, no demoraría en llegarle.715 Tuguria devient donc la réplique exacte de La Havane puisque les immeubles qui se sont écroulés là-haut sont reconstruits à l‟identique en bas. Le matériau de construction de la ville imaginaire est donc bien réel et par un effet d‟asymétrie complète, La Havane disparaît au profit de Tuguria qui grandit. Ponte construit un territoire-palimpseste (Tuguria) qui se bâtit non pas sur mais sous un autre espace qui est, lui, comme effacé progressivement716. Dans ce récit, la cité souterraine anéantit la capitale cubaine tout en étant le lieu du souvenir, c‟est-àdire l‟espace de la nostalgie : « Tuguria [es] la ciudad hundida, donde todo se conserva como en la memoria »717. Contrairement à Zoé Valdés, qui fait d‟une ville réelle (Miami) le dépositaire de la mémoire de La Havane, Ponte préfère, quant à lui, se tourner vers une ville fantastique autrement plus symbolique. Quoi qu‟il en soit, dans le récit de Ponte sourd 713 Renée Clémentine Lucien, « Zoé Valdés : portait de femmes cubaines en exil », in Caroline Lepage, Antoine Ventura, La littérature cubaine de 1980 à nos jours, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011, p. 61. 714 Notons que ce nom est fortement connoté puisque « tugurio » signifie « taudis » en français. 715 Antonio José Ponte, « Un arte de hacer ruinas », in Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 72, 73. 716 Cette construction d‟un espace en palimpseste était déjà présente dans un très court récit intitulé « Única tarde en Granada ». Deux géographies se superposent dans ce texte puisque la guagua que le narrateur emprunte à La Havane est un bus venant d‟Andalousie qui a conservé le plan et les arrêts de Grenade. Voir : « Un seguidor de Montaigne mira La Habana », in Un seguidor de Montaigne mira La Habana. Las comidas profundas, op. cit., p. 23, 24. 717 Id., « Un arte de hacer ruinas », in Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, op. cit., p. 73. 240 également une certaine dénonciation politique. La création d‟une cité imaginaire qui serait le double parfait de La Havane ne fait que remettre en question la réalité environnante. Cette idée est renforcée à la toute fin de la nouvelle, quand le personnage se remémore quelques phrases du récit fantastique de l‟écrivain anglo-irlandais Lord Dunsany. Ce court extrait, que lui citait son grand-père autrefois, évoque une autre cité irrélle : Bethmoora, ville disparue qui a été engloutie par le désert. Après la découverte de Tuguria, ces mots prennent tout leur sens : « Mi pensamiento está muy lejos, en la soledad de Bethmoora, cuyas puertas baten en el silencio, golpean y crujen en el viento, pero nadie las oye. […] Está muerta y sola más allá de los montes, y yo quisiera ver de nuevo Bethmoora pero no me atrevo »718. Le protagoniste, en faisant sienne la nostalgie ressentie pour une ville perdue à jamais, ne fait qu‟anticiper la disparition complète de la capitale cubaine. Car l‟allusion à Bethmoora ne signifie pas autre chose que la mort prochaine d‟une Havane qui ne vit plus qu‟en sursis. L‟espace de la nostalgie chez Ponte n‟est donc pas la cité du passé mais un territoire inventé, fantasmagorique et hautement symbolique. Tant pour l‟écrivain exilé que pour celui qui vit toujours à La Havane et qui se souvient avec nostalgie du passé, le retour au paradis ne peut se faire que par l‟écriture. La propension des auteurs cubains (de la diaspora ou pas) à reconstruire une Havane personnelle qui devient le territoire du regret est considérable. Si nous avons vu que, pour les personnages vivant toujours dans la capitale, l‟espace urbain permettait l‟anamnèse, pour ceux qui sont exilés, c‟est au contraire la mémoire qui reconstruit l‟espace. De sorte que tous ces écrivains de la nostalgie deviennent eux aussi les « architecte[s] d‟une ville de mots érigée dans le temps », pour reprendre une expression d‟Isabel Álvarez-Borland déjà citée dans notre première partie719. Chez certains, le regret fonde le récit et l‟écriture de la nostalgie semble être un but en soi. Chez d‟autres, elle n‟est pas l‟armature du roman mais sa fonction est tout aussi importante. Qu‟ils soient « citoyens du non-lieu »720 ou écrivains de l‟insilio, tous modèlent cette nostalgie pour lui donner des teneurs et des fonctions différentes. Elle peut revêtir des tonalités plus ou moins désespérées et plus ou moins acrimonieuses. Dans tous les cas, elle permet de sublimer le passé, de confronter les époques ou encore d‟établir une critique politique qui peut être virulente. 718 Ibid., p. 73. Isabel Álvarez-Borland qualifiait ainsi Cabrera Infante mais cette expression nous semble pouvoir s‟appliquer de manière plus large à tous les écrivains que nous venons d‟étudier. Isabel Álvarez-Borland, « Viaje verbal a La Habana, ¡ Ah Vana ! Entrevista de Isabel Álvarez-Borland con G. Cabrera Infante, arquitecto de una ciudad de palabras erigida en el tiempo », in Hispamérica II, op. cit., p. 63. 720 Rafael Rojas, « Diáspora y literatura. Indicios de una ciudadanía postcolonial », in Encuentro de la cultura cubana, op. cit., p. 140. C‟est nous qui traduisons. 719 241 La Havane envisagée comme un espace édénique est un motif récurrent qui a traversé les siècles. Lieu de vie et de jouissance, elle est un paradis que l‟on est heureux de retrouver. La Havane de la Comtesse Merlin en est l‟exemple emblématique. Dans cette représentation schématique, quitter la ville est vécu comme un déchirement et vivre ailleurs comme une souffrance aliénante. Aussi, réécrire la ville abandonnée est-il un moyen de la posséder à nouveau. De ce point de vue, la nostalgie joue un rôle majeur puisqu‟elle marque profondément l‟écriture littéraire. Renversant complètement cette vision favorable de la cité, certains auteurs vont s‟attacher à construire, de façon catégorique ou nuancée, un espace urbain insupportable voire infernal. Chapitre 2 : Le purgatoire 1- La scène des péchés a- Oisiveté et perdition La grande ville considérée comme hostile, dangereuse et pernicieuse est un topique littéraire qui n‟est bien évidemment pas l‟apanage de La Havane. Si au XIXème siècle et au début du XXème siècle, la littérature latino-américaine a idéalisé la nature, avec notamment le romantisme puis « la novela de la tierra », le développement du roman urbain n‟a pas permis de connoter positivement la ville. Les auteurs qui ont choisi un décor urbain pour leurs fictions ont effectivement souvent fait de la cité une scène d‟intrigues politiques, un lieu de corruption et de perversion. Ce regard critique vis-à-vis du phénomène urbain qui apparaît au XIXème siècle, sans être neuf, va introduire pour longtemps une thématique et un discours aux accents moralisateurs. Aussi, pour poursuivre notre lecture parabolique des représentations de la ville, nous nous attacherons à dégager les principaux péchés qui stigmatisent La Havane au fil des siècles. Celle-ci fonctionne comme un révélateur de vices que nous étudierons en dégageant quelques-unes des récurrences, regroupées sous cinq rubriques principales. Une étude diachronique prend ici tout son sens puisque la société et la morale évoluent. En effet, les jugements réprobateurs d‟hier perdent parfois en virulence durant la deuxième moitié du XXème siècle selon l‟objet de la condamnation. 242 Les écrivains naturalistes de la jeune République vont mettre en lumière la dépravation qu‟entraîne la ville pour rendre encore plus cinglant le portrait qu‟ils dressent de la société cubaine du début du XXème siècle. Le cas de Miguel de Carrión est exemplaire car avec ses deux romans, Las honradas (1918) et Las impuras (1919), et certaines de ses nouvelles, l‟auteur va tirer parti d‟une symbolique démonstrative pour asseoir sa critique sociale. Notons que le titre des deux ouvrages romanesques cités met l‟accent sur le jugement moral puisque, de prime abord, l‟auteur semble distinguer deux groupes d‟individus : les honnêtes femmes d‟un côté et les dépravées de l‟autre. Mais la schématisation n‟est qu‟apparente car tout l‟art de Carrión va consister, sinon à inverser les archétypes, tout au moins à les nuancer. Ainsi, comme nous le verrons, Victoria, l‟héroïne de Las honradas mettra à l‟épreuve sa vertu et Teresa, protagoniste de Las impuras, ne sera en aucun cas un parangon d‟immoralité. Le titre de ce roman publié en 1919 renvoie explicitement aux femmes de mauvaise vie que rencontre Rogelio et qui ne constituent qu‟un aspect de son existence dissolue. Comme le remarque Max Henríquez Ureña, Las Impuras se déroule dans le monde du vice721 et c‟est le protagoniste, Rogelio, qui va figurer cette débauche. Le personnage se place effectivement dès le début du côté de l‟immoralité puisqu‟il entretient deux relations sentimentales (il a une femme légitime et une maîtresse, Teresa) auxquelles viendront s‟ajouter d‟autres histoires. Uniquement guidé par son plaisir, le protagoniste va fuir toutes ses responsabilités pour s‟adonner au jeu, à l‟alcool et surtout aux femmes. Et c‟est la ville qui semble être directement responsable de cet avilissement car elle a une influence nocive sur le personnage, comme nous le constatons dans cet extrait déjà évoqué partiellement auparavant : Pero los últimos seis meses que había vivido en La Habana, lejos de Teresa, ocasionaron un profundo cambio en la dirección de sus ideas. Adquirió nuevas amistades de hombres y de mujeres, que influyeron mucho en su espíritu. Tomó parte en la vida sensual y fácil de la ciudad, llena de aventureros de la política dispuestos a gozar sin escrúpulos de todos los placeres […].722 Influençable, Rogelio se laisse pervertir par ses nouvelles fréquentations. Ses habitudes et sa mentalité changent au contact de ces gens. La ville apparaît ici comme un piège qui attire grâce aux plaisirs sensuels qu‟elle offre (« vida sensual », « gozar », « los placeres »). L‟empreinte négative laissée par la ville apparaît dès le début du roman lorsque Teresa retrouve son amant à La Havane : « Pero Teresa no podía dejar de advertir aquellos pequeños 721 « Las impuras [se desenvuelve] en el mundo del vicio », in Max Henríquez Ureña, Panorama histórico de la literatura cubana (1963), T. 2, La Havane, Edición Revolucionaria, 1967, p. 399. 722 Miguel de Carrión, Las impuras, op. cit., p. 57. 243 síntomas aislados, indicios de que la capital ejercía una peligrosa influencia en el carácter débil y vanidoso de Rogelio »723. Le verbe d‟action « ejercer » montre que la ville agit et peut changer les comportements. Elle prend donc activement part à la déchéance du personnage, même si le caractère de ce dernier le rend enclin aux turpitudes, comme le soulignent les deux adjectifs qui le qualifient. Par ailleurs, sans répéter ce qui a déjà été dit dans la première partie, ajoutons que l‟arrivée de Teresa à La Havane laisse présager les déboires à venir car les retrouvailles entre les deux amants ne font que souligner les changements qui se sont multipliés en six mois. Il n‟est pas indifférent d‟observer que le protagoniste lui-même rend la ville responsable de ses échecs et il va rapidement avoir La Havane en aversion : « Su aburrimiento crecía, y con él su odio a la ciudad que había presenciado sarcásticamente su derrota »724. Pris dans la spirale infernale de l‟ennui, de l‟alcool, du jeu et des dettes Rogelio fait de la capitale la responsable de tous ses maux au point qu‟il décidera de fuir La Havane, à la fin du roman, pensant régler ainsi tous ses problèmes725. Bien sûr, la ville n‟est pas la seule responsable de sa chute. A la source de la dépravation du protagoniste, il y a sa versatilité, sa lâcheté et sa faiblesse. Sans concession aucune, le narrateur dresse un portrait peu flatteur du héros qu‟il présente comme un être immature et irresponsable : Toda su vida podría resumirse en la agitación de su ánimo en aquel momento : la inquieta lucha por asegurar la posesión del goce presente, la rabiosa cólera ante todo lo que retardaba la satisfacción de un placer esperado, semejante a la del niño a quien niegan un juguete y su indiferencia enfrente de las complicaciones o las vagas amenazas de lo porvenir.726 Ne supportant pas la frustration, Rogelio va se dérober à toutes ses obligations pour ne faire que ce qui lui plaît. L‟hédonisme, qui le conduira à sa perte, guide toute son existence. Cette quête perpétuelle et insatiable du plaisir est blâmée par le narrateur qui compare le personnage à un enfant incapable d‟accepter les difficultés. Dans cet agencement, les femmes « impures » qu‟il séduit ne sont que des objets (« juguetes ») et Teresa et son épouse, Florinda, représentent des entraves à son bien-être. A l‟inconséquence du personnage s‟ajoutent aussi la nonchalance et l‟oisiveté. Si la paresse des domestiques noirs pouvait amuser la Comtesse 723 Ibid., p. 84. Ibid., p.43, 44. 725 A une époque très différente et pour des raisons bien distinctes, le personnage protagoniste de Pedro Juan, dans les romans du cycle « Centro Habana » de Pedro Juan Gutiérrez, s‟éloignera aussi progressivement de la capitale dans un mouvement centrifuge bénéfique. Rogelio et Pedro Juan cherchent leur salut en abandonnant la ville, considérée comme la source de leurs difficultés. 726 Ibid., p. 111. 724 244 Merlin727, sous la plume de Miguel de Carrión, elle se charge d‟autres significations et a des conséquences bien plus lourdes. Le désœuvrement précipite Rogelio dans une fuite en avant qui provoque l‟infortune de sa femme légitime et de sa maîtresse (Teresa se verra dans l‟obligation de se prostituer à la fin du roman). Beuveries et orgies rythment le quotidien du personnage qui devient le représentant d‟une jeunesse havanaise oisive et désinvolte qui vit dans le « sensualisme et l‟ostentation »728. Cette existence vide qui consiste à sortir de bar en bar pour boire, séduire des femmes et exhiber son oisiveté est critiquée avec véhémence : […] empezñ la ronda estúpida del alcohol, a través de las dos o tres barras elegantes consagradas por la moda del dìa. […] Era la diversiñn favorita de una juventud melancólica y sin ideales, en la extraña ciudad del trópico, llena de lujuria y de sol. […] y si bebìan […] era únicamente por hacer público alarde de sus vicios y por mostrarse como hombres despreocupados y fuertes […]. 729 Dans cet extrait, le narrateur se fait censeur puisqu‟il se sert du cas de Rogelio et de ses amis pour établir une critique morale plus large qui condamne les mœurs légères d‟un certain type de personnes. En effet, l‟existence de Rogelio n‟est qu‟un exemple concret de la vacuité de cette jeunesse havanaise en perdition qui trompe son ennui dans un épicurisme pernicieux. L‟auteur ne dénonce donc pas uniquement le cas individuel du protagoniste et, pour élargir sa critique, il fait de Rogelio l‟archétype de l‟être immoral. Notons que la catégorisation qu‟établit Carrión est assumée, comme le prouvent, entre autres, les titres des deux romans évoqués. Il s‟agit bien pour l‟auteur de lister les travers de la société urbaine de son pays à travers des exemples précis. En cela ses œuvres sont démonstratives et pourvues d‟exemplarité : l‟intrigue ne fait que soutenir une thèse morale clairement définie. Avec la même charge moralisatrice Enrique Serpa dénonce cette vacuité dans une très courte nouvelle intitulée « Una mujer depravada » (1937). L‟auteur y dresse le portrait d‟une femme désœuvrée, Laura, qui mène une existence dissolue. Ici aussi le titre porte en lui les marques d‟un jugement moral lapidaire, même s‟il sera nuancé par le narrateur qui verra en Laura (dont il est amoureux) une pauvre femme essayant de résoudre ses problèmes du mieux qu‟elle peut730. C‟est son divorce qui, d‟après le narrateur, l‟a conduite sur « le chemin de la 727 « [Ma tante] ne gronde jamais ses nègres et leur permet toutes sortes de paresses et d‟insouciances dans le service ; aussi, excepté l‟heure des repas, voit-on ses négresses étalées toute la journée par terre sur des nattes de jonc, chantant, causant et se peignant l‟une l‟autre », La Comtesse Merlin, La Havane, T. I, op. cit., p. 308. 728 Miguel de Carrión, Las impuras, op. cit., p. 75. C‟est nous qui traduisons. 729 Loc. cit. 730 « No había tal divorciada viciosa. No existía la gozadora despreocupada y superficial, dócil a la lujuria de cualquier advenedizo. No había sino una pobre mujer, una mujer desdichada, una madre resolviendo como podía 245 dépravation »731. Depuis, cette mère de famille est « un hermoso tipo de trampa de cabaret » et « una bebedora experta »732 qui multiplie les amants avec une avidité qui n‟a d‟égal que son goût pour l‟alcool et les sorties. Laura et ses amis font montre d‟une oisiveté nuisible puisqu‟ils passent le plus clair de leur temps dans les bars : Laura podìa soportar cotidianamente […] un programa capaz de hacer una piltrafa de cualquier ser humano […]. Lo iniciaba a las ocho de la mañana […] para caer en el Bohío del « Hotel Sevilla ». Allí con su amante de turno y otras dos parejas, tomaba un aperitivo […], aceitunas con limón y martini-seco. Dos horas después marchaban todos hacia el « Palacio de Cristal ». Terminado el almuerzo, se dirigìan al « Jockey Club » […]. Luego, de siete a nueve de la noche, iban a inundarse de high-balls en el speakeasy de Prado 86 […]. Y la etapa final de la jornada concluìa en « Sans-Souci », entre […] los vapores del whisky […].733 Avec une grande précision, le narrateur indique les horaires, les bars où elle se rend et les alcools qu‟elle boit pour mieux motiver sa réprobation. Il montre concrètement de quoi est faite la « vida pecadora y superficial »734 du personnage féminin. Par ailleurs, ce programme immuable qui se répète quotidiennement se fait de jour, ce qui montre que Laura n‟a aucune obligation professionnelle et que ses contraintes familiales (ses deux enfants) n‟entravent pas son oisiveté. Laura, qui est aguerrie aux nombreuses tentations qu‟offre la ville, supporte aisément ce rythme frénétique et inhumain qui malmènerait quiconque. Mais cette existence n‟est pas sans conséquence et elle ne reste pas impunie. Après que le protagoniste-narrateur lui a ouvert les yeux, Laura semble prendre soudainement conscience de son égarement et paraît se repentir de cette vie stérile. Le récit s‟achève sur l‟image de cette femme en larmes qui semble accablée par tout le poids de ses péchés. Elle n‟est plus la courtisane séduisante et désinvolte du début mais une femme tragiquement fragile. Sous la plume de certains écrivains plus tardifs, la flânerie, l‟amusement et l‟oisiveté ne seront plus condamnés avec la même virulence. Au contraire, cette légèreté s‟érigera même en style de vie comme en témoignent les œuvres de Cabrera Infante déjà évoquées. Notons toutefois que la Révolution se placera du côté de la morale traditionnelle encline à fustiger les jouisseurs et leur désœuvrement. On rappellera à ce titre que le court-métrage d‟Orlando Jiménez Leal et de Sabá Cabrera Infante, PM (« Pasado Meridiano »), fut censuré en 1961 par las autorités cubaines qui considérèrent ce reportage sur la vie nocturne dans les bars du port su problema, que era el problema de sus hijos », Enrique Serpa, « Una mujer depravada », Felisa y yo, op. cit., p. 105. 731 Ibid., p. 101. C‟est nous qui traduisons. 732 Ibid., p. 99. 733 Ibid., p. 100. 734 Ibid., p. 101. 246 de La Havane en désaccord avec les valeurs artistiques révolutionnaires. Outre cette oisiveté dénoncée en littérature puis combattue politiquement et culturellement dans le but de forger l‟homme nouveau, un autre péché se développe en ville : l‟avarice et la cupidité. b- L’appât du gain La capitale corrompt les mœurs, pervertit les âmes et émousse les valeurs morales. Aussi, la littérature présente-t-elle une Havane souvent peuplée de personnages misérables et immoraux prêts à tout pour s‟enrichir. Les vols y sont légion et rendent la capitale dangereuse. Les recommandations et conseils que l‟on prodigue à celui qui quitte la province pour partir vivre à La Havane montrent bien que la capitale n‟a rien de rassurant. La mère du jeune Alfredo, dans la nouvelle « En familia » (1902), de Miguel de Carrión, est à la fois ravie que son fils puisse partir étudier dans la capitale, après tant d‟années de sacrifices, mais elle est aussi très inquiète : […] iba a vivir solo, en una ciudad desconocida y rodeada de peligros, donde era preciso evitar que lo robaran a uno, que lo sedujeran o que lo asesinaran, usando precauciones […]. En medio de sus brillantes ilusiones, la pobre mujer temblaba ante las asechanzas que no conocía, pero que imaginaba encerradas en aquella Babilonia. 735 La mère, qui ne connaît pas La Havane, imagine le pire et se figure que son fils part pour une nouvelle Babylone. Effectivement, de multiples déconvenues marqueront les sept années qu‟Alfredo passera dans la capitale. Les craintes de la mère ne seront pas confirmées car son fils ne sera victime d‟aucun malfaiteur ni d‟aucune femme cupide. Son drame sera plus cruel encore : il ne pourra lutter contre l‟injustice sociale. N‟ayant pas les appuis nécessaires à La Havane, il ne parviendra jamais à gagner sa vie comme avocat. Cela dit, les inquiétudes de cette mère sont justifiées car la grande ville peut présenter de nombreux dangers. On se souviendra, par exemple, des larcins évoqués dans Cecilia Valdés736 ou encore de l‟ingénu Fotuto, dans le roman éponyme de Miguel de Marcos, qui, à peine arrivé à La Havane se fait 735 Miguel de Carrión, « En familia », in La última voluntad y otros relatos (1903), La Havane, Editorial Arte y Literatura, Instituto Cubano del Libro, 1975, p. 97. 736 Le Gouverneur Général Vives rapporte certaines plaintes qui lui sont faites : « Ayer tarde vino a mí un joven dependiente de una casa de comercio para quejarse de que […] en la plaza de San Francisco, le habìan arrebatado un saco de dinero de su principal. [...] También se me quejó otro de que al oscurecer del día de ayer, dos negros con puñal en mano le pararon cerca de la estatua de Carlos III y le desbalijaron de cuanto llevaba encima de valor, el reloj etcétera », Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 298 247 voler son argent par un faux mendiant737. L‟insécurité qui règne en ville dès le XIXème siècle est un véritable fléau que veut d‟ailleurs éradiquer le Général Tacón à son arrivée à Cuba en 1834. Le roman historique de Travieso, El polvo y el oro (1993), insiste beaucoup sur cet aspect puisqu‟il donne la parole à plusieurs reprises au militaire espagnol : Observo […] que la limpieza y el ornato de la ciudad dejan mucho que desear. Las calles son estercolero, pocas las plazas y deficiente el alumbrado público […]. También veo muchos hombres que se han ocultado a nuestro paso, probablemente, malhechores […]. Pero todo lo pondremos en orden […]. En esta ciudad pronto habrá limpieza y seguridad.738 En faisant l‟inventaire de toutes les insuffisances de la ville du premier tiers du XIXème siècle, Tacón établit son projet urbanistique : assainir la ville, l‟éclairer et la rendre plus sûre, car à l‟époque assassins et voleurs agissaient en toute impunité. Plusieurs fois dans ce roman il est question de la dangerosité de la ville. Le narrateur rappelle ainsi qu‟on pouvait s‟y faire attaquer et poignarder en pleine journée (« La Habana era sitio para desconfiar, donde se podía ser asaltado y hasta apuñalado a plena luz del sol»739) ou que tout y était imprévisible (« La Habana era una ciudad sucia, inculta y peligrosa en la cual cualquier cosa podía suceder en cualquier instante, desde un crimen nocturno, jamás descubierto, hasta una revuelta de esclavos salvajes »740). La Havane de la première moitié du XIXème siècle apparaît, dans ce roman, comme un antre aussi abject que malfamé où l‟honnête homme se trouvait à la merci des truands et des scélérats. Chez la Comtesse Merlin, ces crimes prennent une autre connotation. Les vols et les assassinats sont certes mentionnés dans La Havane mais ils sont nuancés par un portrait des brigands plutôt favorable. Les actes de ces derniers s‟expliquent par leur caractère fougueux, comme le montrent les propos de la tante que l‟écrivain rapporte au style direct : Les assassinats en plein jour, plus rares depuis le gouvernement du général Tacon, se reproduisent encore quelquefois. La vengeance […] et l‟ardeur du sang dans ce pays, ardeur qui pousse l‟assassin à tuer sans cause, produisent plus de meurtres que l‟appât du vol [...]. Celui qui tue [...] devient voleur pour pourvoir à son existence, assassin pour la conserver ; mais, dans sa dégradation, il conserve la plupart du temps un certain caractère aventureux, chevaleresque, qui n‟est pas dépourvu de générosité.741 737 Miguel de Marcos, Fotuto, op. cit., p. 55. Julio Travieso, El polvo y el oro, op. cit., p. 164. 739 Ibid., p. 13. 740 Ibid., p. 269. 741 La Comtesse Merlin, La Havane, T.I, op. cit., p. 319, 320. 738 248 L‟importance de l‟empreinte laissée par Tacón est une fois de plus soulignée. Il a permis de rendre la ville plus sûre, comme le dit doña Maria-Antonia, la tante de la Comtesse. D‟après elle, le mobile des meurtres n‟est pas l‟avidité mais répondrait plutôt à une sorte de code d‟honneur dont la vengeance ferait partie. Par ailleurs, celui qui vole ou assassine semble agir en désespoir de cause puisqu‟il le fait pour survivre (« pourvoir à son existence […] [ou] la conserver »). Enfin, il n‟est pas fondamentalement mauvais et possède une certaine noblesse d‟âme. Il serait même, d‟après elle, de la trempe des anciens chevaliers. L‟image du brigand au grand cœur, topique littéraire de l‟époque, se dessine très clairement dans ce portrait positif que la tante complètera en évoquant deux anecdotes qui démontreront elles aussi la loyauté du voleur cubain742. En plus de ces malfaiteurs et voleurs de grand chemin, des escrocs plus perfides, prêts à tout pour s‟enrichir, agissent également en toute impunité. Souvent, ces fripons profitent de leur position sociale pour abuser les gens. Le roman de Ramón Piña, Historia de un bribón dichoso (1860), dresse le portrait d‟un homme vil mû uniquement par l‟enrichissement, comme le suggère le titre. Pour séduire les femmes, il se laisse guider non pas par ses sentiments mais par sa cupidité. Il parviendra à ses fins et sera un homme riche à la fin du roman. Le protagoniste n‟est donc puni d‟aucune manière dans cette œuvre qui reste néanmoins moralisante. Il en va de même pour un autre personnage plus abject encore : le docteur In-Fausto de Tristán de Jesús Medina. Dans « Doctor In-Fausto » (1854), nouvelle au titre très évocateur, le personnage principal est un médecin cupide et cleptomane. Non seulement, il trompe et vole sans scrupule ses patients à leur domicile mais il est maléfique : il provoque la mort et la maladie. Don Fernando, ne se doutant pas que le médecin est responsable du décès de sa femme et du mal qui ronge sa fille, continue naïvement de lui accorder toute sa confiance et de lui donner de l‟argent. Dès le début du récit, il est présenté comme un être diabolique, comme on le voit dans le premier chapitre où, en guise d‟introduction, l‟auteur explique son projet (écrire une histoire dont le héros serait aux antipodes du Docteur Faust de Goethe) : El doctor de quien vamos a hablar era el in de todo buen doctor, de todo buen hombre, de todo hombre, mejor dicho : su ciencia el in de todas las ciencias, su virtud el in de todas las virtudes. Así diremos que era InHipócrates, In-Hanneman, in-hábil, in-perfecto, in-salubre, sus escritos son in-congruentes, sus recetas in-oportunas, su presencia in-necesaria. 742 Elle ajoutera un peu plus loin : « […] ici, un voleur qui vous parle en ami ne vous trahit jamais. Téméraire, il résiste seul aux gens de la justice, aux soldats, et défend sa vie avec fureur », ibid., p. 325. 249 Era in-feliz, in-digno, in-noble, in-discreto, in-soluble, in-tranquilo, […] in-soportable. […] In-grato […]. In-exorable.743 Ni grandeur, ni quête d‟amour ou de savoir n‟animent ce médecin sans vertu. Cette longue liste d‟adjectifs, tous précédés du préfixe in, montre de manière insistante que cet homme n‟a rien de bon. Le portrait physique dressé un peu plus loin ne fera que corroborer l‟idée que cet être patibulaire est le démon incarné. La perte de valeurs et la cupidité laissent des traces visibles sur la ville elle-même. Dans son très court récit, « Día de difuntos », Tristán de Jesús Medina montre que La Havane est devenue une cité marchande où l‟or commande tout, à l‟image de la Venise du XVème siècle : « […] La Habana es la Venecia del comercio, de las coplas y del sainete andaluz ; la cittá d’oro de los mercaderes »744. La ville n‟offre plus que le négoce et la distraction à ses habitants. Et pour illustrer son propos, le narrateur va s‟appuyer sur un personnage créé par l‟écrivain espagnol Mariano José de Larra, Figaro, qui apparaît dans un article intitulé « Día de difuntos de 1836 ». Le personnage de Larra voit la mort partout et imagine des épitaphes qui témoignent de son profond pessimisme. Medina reprend donc cette figure et imagine ce qu‟aurait pu dire Figaro en regardant les commerces de La Havane : Al pasar por la puerta de tantos almacenes y establecimientos de lujo, Figaro hubiera leído en las muestras : « Aquí yace el oro. » […] La casa de cierto médico : « Aquí se padecen hinchazones de dinero. » es decir, se da a rédito : una moneda de plata produce diez de oro. La de un usurero : « Botiquín para todas las enfermedades ».745 Non sans ironie, le narrateur mentionne la richesse accumulée par les marchands, les médecins et les usuriers. Il critique l‟enrichissement outrancier de certains et l‟importance de l‟argent dans la société. A la manière d‟un Quevedo, le narrateur se désole de constater qu‟à La Havane l‟argent est tout-puissant. De surcroît, le divertissement a supplanté la pensée et le recueillement. Un peu plus loin, le narrateur prend l‟exemple du cimetière pour illustrer cette idée. Non seulement, les tombes sont dépourvues d‟épitaphe, même celles des poètes et écrivains du pays, mais en ce jour de célébration des morts, le cimetière de La Havane est complètement vide. Personne ne s‟y rend car tous préfèrent l‟amusement et les frivolités mondaines à la prière silencieuse. 743 Tristán de Jesús Medina, « Doctor in-Fausto », in Narraciones, op. cit., p. 292, 293. Id., « Día de difuntos », in Narraciones, op. cit. p. 333. 745 Ibid. 744 250 Dans les romans de notre corpus qui décrivent la vie politique de la jeune République (Generales y doctores, Coaybay, Juan Criollo), le constat est tout aussi amer. Les hommes politiques sont corrompus et n‟agissent que pour leurs intérêts personnels. La Havane devient la scène d‟intrigues douteuses et malhonnêtes où se meuvent des êtres sans scrupules. Le personnage de Juan, dans Juan Criollo, constitue l‟exemple parfait de l‟arriviste qui a réussi à intégrer les sphères du pouvoir de la capitale. A la fin du roman, la leçon qu‟il tire de son existence semée d‟embûches est la suivante : « Si puedes, haz dinero honradamente. Si no, haz dinero »746. Et c‟est en respectant cette maxime qu‟il demande à sa femme d‟élever leur fils. S‟ensuit toute une apologie de l‟argent que le personnage exprime en ces termes : Con dinero se dispone de los grandes especialistas médicos, que no curan a los pobres. Con dinero se puede adquirir la más amplia cultura. Con dinero, mal o bien habido, nos tratan los más austeros y descollantes sujetos ; desde el magistrado hasta la santa Superiora […]. Con dinero se consiguen diplomas, presidencias, condecoraciones. Con dinero es más fácil que nos « quieran » las mujeres. Con dinero, únicamente se es libre de veras, digno de veras, hombre de veras.747 Le protagoniste assume un discours cynique qui porte aux nues l‟argent. Celui-ci permet de tout acheter, la santé, les mérites, le pouvoir et même la liberté. Parce que s‟y concentrent les pouvoirs politique et économique, la ville pervertit progressivement les plus candides. L‟avidité que s‟applique à dénoncer Loveira et de manière plus générale les récits réalistes du XIXème et du début du XXème siècle cités ici, ne constitue qu‟un aspect de la critique sociale qui transparaît en littérature. On ne s‟étonnera pas que cette thématique ne réapparaisse avec force que bien plus tard, à partir des années 90, avec l‟émergence de la crise économique. Avec la période spéciale, la ville devient une véritable jungle où magouilles, vols et tromperies semblent indispensables à la survie. La rapacité de certains redevient alors flagrante et des écrivains, qui ne sont plus censeurs ni moralistes, vont montrer les différentes formes qu‟elle revêt en temps de crise extrême. A cet égard, les œuvres de Pedro Juan Gutiérrez et certains romans policiers sont édifiants. La Havane du réalisme sale est, en effet, un univers glauque où le sauve-qui-peut général justifie les comportements les plus immoraux et les plus sordides : certains n‟hésitent pas à dépouiller les morts de leurs vêtements ou de leurs dents en or748, à simuler un handicap pour inspirer davantage de compassion749, à risquer quotidiennement leur vie en étant l‟objet 746 Carlos Loveira, Juan Criollo, op. cit., p. 436. Ibid. 748 Id., El Rey de La Habana, op. cit., p. 73. 749 Id., Animal tropical, op. cit., p. 277, 278. 747 251 de paris insensés (« El Fórmula Uno »750), à fabriquer de fausses pièces de monnaie751 ou encore à vendre au marché noir des organes humains en les faisant passer pour des abats752. Tout est bon pour gagner trois sous et, dans un tel contexte, les rapports sont complètement faussés par l‟intérêt. Même l‟amitié et les liens familiaux n‟ont guère plus d‟importance : « Si tienes dinero tienes amigos, si no te meten el dedo por el culo »753, affirme Luisito, personnage de Trilogía sucia de La Habana. Son histoire en est la parfaite illustration : trahi par son propre frère qui l‟oblige à abandonner la balsa sur laquelle ils se trouvent, il est aussi frappé puis dépouillé par ses amis d‟enfance. Citons également l‟exemple de Berta, cette septuagénaire de Trilogía sucia de La Habana754 qui accorde naïvement sa confiance à ses nouveaux voisins et qui est dupée par l‟un deux. Séduite par Omar, un jeune homme qui ne travaille ni n‟étudie, la femme de soixante-seize ans ne voit pas qu‟il profite d‟elle et de sa générosité, au point qu‟elle décide de lui léguer tout ce qu‟elle a. Après la visite chez le notaire, qui fait d‟Omar le seul héritier testamentaire de Berta, celui-ci cesse d‟aller la voir et la femme meurt de tristesse755. Les pícaros des temps modernes qui envahissent La Havane des années quatre-vingt-dix sont légion dans les romans de l‟auteur. Si le narrateur se garde bien de les juger, il explique cependant que ces personnes malhonnêtes qui profitent du désarroi d‟autrui témoignent de l‟échec de la construction de l‟homme nouveau : « Es una nueva era. De repente el dinero hace falta. Como siempre. El dinero lo aplasta todo. Treinta y cinco años construyendo el hombre nuevo. Ya se acabó »756. Désabusé, le narrateur fait un bilan plutôt pessimiste de la Révolution. La crise, en réveillant les instincts les plus vils, fait clairement apparaître que toutes ces années de socialisme ne sont pas parvenues à éradiquer l‟appât du gain. Les romans policiers se chargent aussi de dénoncer la cupidité, soulignant de la sorte les limites du système socialiste. Notons que la critique est d‟autant plus corrosive que ce sont parfois des membres de la nomenklatura qui sont impliqués dans des affaires de malversation. Rafael Morín, le personnage assassiné de Pasado perfecto, de Padura, était un membre haut placé au sein du Ministère de l‟Industrie. Corrompu, il profitait de sa situation dans l‟entreprise étatique pour s‟enrichir grâce à des manœuvres malhonnêtes. C‟est aussi la corruption de hauts dignitaires qui est dénoncée dans Entre el miedo y las sombras, d‟Amir 750 « El Fórmula Uno» doit son surnom à son « gagne-pain » qui consiste à traverser à vélo une avenue pleine de voitures en roulant à toute vitesse. Certains parient sur son succès, d‟autres sur sa mort. Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 135, 136. 751 Id., Carne de perro, op. cit., p. 130. 752 Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 330, 331. 753 Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 234. 754 Ibid., p. 295-303 755 Elle meurt plus précisément d‟une hémorragie cérébrale après qu‟Omar l‟a abandonnée. 756 Ibid., p. 97. 252 Valle, puisque la découverte de trois cadavres conduit le policier, Alain Bec, sur la piste d‟un vaste trafic de drogue qui implique des membres du pouvoir. La dénonciation prend ici d‟autant plus de poids qu‟elle s‟appuie sur des faits réels (l‟affaire Ochoa, entre autres), comme le précise l‟auteur dans une note introductive. Durant la période spéciale, la corruption opère donc à tous les niveaux et à des degrés divers : « […] la corrupciñn que se extendìa como una gigantesca ameba, pudriendo hasta el alma de la gente […] »757. La dénoncer prend une tournure bien plus politique qu‟auparavant puisque cela signifie remettre en question les acquis de la Révolution et montrer les limites, voire l‟hypocrisie, du système socialiste758. Cette conscience aiguë des circonstances politiques dont font preuve les écrivains permet aussi de dénoncer la tromperie qui, à l‟instar de la cupidité, gangrène toute la société. c- Mensonges et tromperies Le mensonge et la fausseté sont amplement pointés du doigt par des écrivains qui, une fois de plus, s‟érigent en juges de leur temps. Comme la cupidité, la tromperie gagne toutes les couches de la société et apparaît dans la sphère publique et privée. Nous avons vu précédemment que certains romans de la République dénonçaient la corruption des hommes politiques. Dans ces récits, la ville est insinuée car elle sert surtout de décor aux intrigues politiques. Mais, ces descriptions spatiales, aussi lacunaires soient-elles, suffisent à faire de La Havane, en tant que capitale politique où se concentre le pouvoir, une ville propice à la duperie. À cet égard, l‟œuvre de Loveira, Generales y doctores, présente un intérêt indéniable puisque l‟auteur y fustige les mauvaises pratiques politiques qui font que la République n‟est qu‟une démocratie de façade. Les personnages de l‟oncle et de El Nene représentent de manière paroxystique la tromperie et l‟illégalité. Cela dit, la machine politique est si puissante qu‟elle avilit même les honnêtes gens, en témoigne le parcours du narrateur Ignacio García. Malgré ses principes et sa probité initiale, il va s‟impliquer dans la vie politique du pays par un biais frauduleux. Ainsi énonce-t-il les moyens qui lui permirent d‟être élu : La elección me costó algunos tragos desagradables. Susana sufría hondamente cuando me veía en el ajetreo de la propaganda, fraguando alianzas innobles, traficando con el sufragio, desenredando chismes y calumnias, certificando con mi palabra de honor mil mentiras y mil compromisos falsos e indignos […]. Abominable le parecìa a Susana que 757 Amir Valle, Entre el miedo y las sombras, op. cit., p. 82. Les œuvres d‟Amir Valle, bien plus sombres et subversives que celles de Padura, ne sont d‟ailleurs pas publiées à Cuba. 758 253 su hombre bueno, puro, incontaminado de la lepra política, estuviera haciendo el histrión en las mascaradas electorales.759 L‟antagonisme entre le bien et le mal prend corps grâce aux deux personnages. Susana, la femme du protagoniste, condamne les moyens malhonnêtes employés par son mari qui a succombé aux sirènes du pouvoir. Elle le renvoie à ses idéaux et à sa droiture passés, ce qui renforce encore davantage le caractère pernicieux de la politique. Verbes, adjectifs et substantifs s‟inscrivent en complète opposition pour bien marquer le tiraillement du personnage qui est comme pris au piège. Tel un garde-fou, Susana contribuera à le ramener dans le droit chemin à la toute fin du roman puisque Ignacio abandonnera la politique. Le mensonge dans la sphère privée est lui aussi relayé par une littérature qui, une fois de plus, revêt souvent une fonction moralisatrice. Dans de nombreux récits, l‟anonymat de la ville facilite l‟infidélité mais ces aventures adultères ne sont pas sans conséquence pour les personnages qui doivent parfois payer un lourd tribut pour réparer la faute commise. Victoria, la protagoniste de Las honradas, de Miguel de Carrión, expiera longtemps son imprudence. Comme nous l‟avons dit dans notre première partie, c‟est à La Havane que cette femme se laisse séduire par le chef de son mari, Fernando, mais c‟est aussi dans la capitale que Victoria doit avorter clandestinement chez une faiseuse d‟anges alors que son mari se trouve en province pour ses obligations professionnelles. Ce qui n‟est qu‟une amourette passagère pour le supérieur de Joaquín prend donc une tournure bien plus dramatique pour la femme infidèle qui ne parviendra que difficilement à ne plus être rongée par la culpabilité. Dans une représentation antinomique évidente, Carrión fait de La Havane la scène du péché alors que la campagne (la sucrerie) est l‟espace de la moralité. Un autre récit de Carrión, « Noche buena », montre combien la ville est propice aux tromperies les plus sinistres. Aquiles Melón, petit bourgeois quinquagénaire, trompe sa femme avec Julieta, dont il s‟est épris. Cette femme aux mœurs légères profite matériellement d‟Aquiles et entretient parallèlement d‟autres relations, notamment avec Juanito, qui n‟est autre que le fils de Melones. La fin de cette histoire est tout à fait sordide puisque, après avoir contracté une maladie vénérienne suite à cette liaison, Juanito se voit dans l‟obligation de dévoiler à son père l‟identité de la prostituée qu‟il a fréquentée. Aquiles est à ce point dépité par les révélations de son fils que ce dernier comprend l‟effroyable vérité. Afin de s‟assurer le silence de Juanito, le père lui dit : « ¡ Son cosas de la vida que los hombres comprendemos y las mujeres, no ! »760. Et le narrateur de poursuivre ainsi : « Fue una gran frase, una terrible frase, resumen tristísimo de todas las 759 760 Carlos Loveira, Generales y doctores, op. cit., p. 372, 373. Miguel de Carrión, « Noche buena », in La última voluntad y otros relatos, op. cit., p. 253. 254 mentiras, de todas las claudicaciones de la miserable carne humana, obligada a esconderse y a fingir siempre para amar […] »761. Mensonges, concupiscence et avidité s‟imbriquent dans cette nouvelle moralisante qui blâme les faiblesses humaines. Notons qu‟à l‟époque coloniale, les tromperies se chargent d‟une portée sociale plus forte à cause de l‟esclavage. Le facteur racial (et social) est un élément déterminant mis en avant dans de nombreux récits dont l‟intrigue se bâtit autour d‟un mensonge originel. On pense bien sûr à Villaverde qui, dans Cecilia Valdés, place le mensonge au cœur de sa trame romanesque. La mulâtresse Cecilia Valdés ne sait pas, en effet, que son père n‟est autre que l‟aristocrate blanc don Cándido Gamboa, le père de son amant Leonardo. L‟héroïne, qui ignore les liens incestueux qui l‟unissent au jeune homme, répète malgré elle l‟histoire familiale en tombant enceinte de ce fils de bonne famille. Alors que Leonardo s‟est éloigné de sa maîtresse et va épouser une jeune femme blanche issue de l‟aristocratie, Cecilia accouche d‟une petite fille qui est donc elle aussi la fille illégitime d‟un Gamboa. Leonardo, contrairement à son père, ne connaîtra jamais son enfant adultérin puisqu‟il mourra assassiné le jour de ses noces. Le mensonge, qui prend ici une dimension tout à fait dramatique, permet de mettre en lumière le caractère impitoyable de l‟organisation sociale de l‟époque. Un peu avant, un autre auteur avait souligné, avec la même acuité, la fatalité qui condamne les femmes noires dans La Havane esclavagiste du XIXème siècle. Félix M. Tanco Bosmeniel, dans une nouvelle écrite en 1838, intitulée « Petrona y Rosalía », fait vivre à la mère et à la fille la même histoire tragique. Petrona est la servante noire d‟une famille aristocratique de la capitale qui tombe enceinte après que son maître a abusé d‟elle. En représailles, elle est envoyée loin de la ville, dans un ingenio762 situé en province. Elle y accouche d‟une mulâtresse prénommée Rosalía. Plus tard, cette dernière est envoyée à La Havane et subit le même sort que sa mère : le fils légitime de cette famille aristocratique, don Fernando, viole la jeune Rosalía qui tombe enceinte. A quatorze ans d‟intervalle, le scénario se répète et condamne de la même manière les esclaves puisqu‟à son tour Rosalía est envoyée à la sucrerie. Elle y retrouve sa mère qui mourra peu après. Rosalía et son fils mourront eux aussi après l‟accouchement. Que ce soient María del Rosario Alarcón, Petrona ou leur fille respective, Cecilia Valdés et Rosalía, toutes ces femmes sont finalement victimes de « ces hommes pervers qui ont un cœur de pierre »763. Abusant de leur position sociale, ces aristocrates fortunés trompent non seulement leur épouse mais profitent de la vulnérabilité des 761 Ibid., p. 254. Lieu où l‟on cultive la canne et fabrique le sucre. 763 Félix M. Tanco Bosmeniel, « Petrona y Rosalía » (1838), in Cuentos cubanos del siglo XIX. Antología, La Havane, Editorial Arte y Literatura, Instituto Cubano del Libro, 1975, p. 131. C‟est nous qui traduisons. 762 255 femmes noires ou mulâtres en toute impunité et sans en assumer les conséquences. Les deux exemples cités auront certainement suffi à montrer que La Havane est le lieu du mensonge, du châtiment (tout au moins pour Petrona et Rosalía puisqu‟elles s‟y font violer) mais aussi de l‟injustice sociale qui condamne sur plusieurs générations les Noires (ou mulâtresses). Ces récits mettent également au jour, on l‟aura deviné, la concupiscence des hommes. d- La luxure Ce qui ne faisait qu‟affleurer dans nos parties précédentes va être confirmé par de nombreux textes du corpus : La Havane, de façon tout à fait paroxystique, est associée, en littérature, à la luxure et aux plaisirs sexuels débridés. Le jugement porté sur cette sexualité effrénée va évoluer au fil des siècles tant et si bien que les frontières entre l‟enfer et le paradis deviennent poreuses. Tantôt condamné chez les uns, tantôt loué chez les autres (surtout chez les auteurs contemporains), le sexe est jugé de façon très ambivalente. Si nous le traitons dans cette partie consacrée au purgatoire Ŕ et non dans la partie précédente Ŕ c‟est qu‟au regard de la morale religieuse qui oriente notre développement, la luxure est l‟un des sept péchés capitaux. La première image solidement implantée est celle d‟un espace orgiaque où tous les excès sont permis. La prédisposition de la ville caribéenne pour l‟intempérance sexuelle est signalée, par exemple, chez Loveira (« […] el mal, el vicio, la flor maldita de la ciudad lujuriosa, […] este manicomio de eróticos que se llama La Habana »764) et encore plus explicitement chez Carrión : « No hay entre nosotros nada que hacer fuera de la sensualidad, y todo predispone a ella : el clima, el cielo, la sangre árabe que nos legaron nuestros antepasados andaluces, el trabajo […] y la educación […] »765. Tout concourt à érotiser La Havane, du climat en passant par des considérations ataviques et culturelles. En guise de démonstration, le narrateur de Las impuras décrit, dans un chapitre portant le titre éloquent de « La orgía », une fête donnée chez Felicia, sorte de maquerelle occasionnelle qui organise quatre fois par an des bals libertins. Cette orgie, à laquelle participe Rogelio, prend des allures de beuverie répugnante : « […] la orgía iba haciéndose más animada y más brutal. […] Una gorda vomitñ en la sala […]. Aquella habitación ofrecía un aspecto lastimoso y pintoresco »766. La fête dégénère à cause de l‟alcool, certains sont malades, d‟autres se battent, blessent les prostituées. En somme, 764 Carlos Loveira, Generales y doctores, op. cit., p. 396. Miguel de Carrión, Las impuras, op. cit., p. 77. 766 Ibid., p. 202. 765 256 Carrión décrit sur plusieurs pages une scène de débauche effrénée et d‟« indécence »767. Plus on avance dans le XXème siècle et plus cette luxure est évoquée tout en étant de moins en moins condamnée. Chez Cabrera Infante, la capitale cubaine est « una ciudá pernisiosa para la jente joven »768, puis elle sera de façon plus générale un « escenario sexual »769, dans La Habana para un infante difunto. Nous n‟insisterons pas davantage sur l‟association quasi systématique entre espace urbain et conquêtes féminines qui rythme tout le roman ; disons simplement qu‟avec Cabrera, la sexualité, loin d‟être vilipendée, est pleinement assumée. Abilio Estévez rappelle, quant à lui, que l‟omniprésence du sexe n‟est pas une légende ou un cliché qui serait trop facilement associé à la ville tropicale : « […] esa promiscuidad que sì no es un mito ni símbolo en esta ciudad donde lo primero, y lo último, es templar, coger, follar, tirar, singar y singar »770. Les synonymes et la répétition se veulent ici les marques d‟une sexualité outrancière qui caractérise la ville et que le réalisme sale va décrire inlassablement avec un grand luxe de détails. Pedro Juan Gutiérrez, figure emblématique de ce style littéraire cru et violent, fait du sexe la pierre angulaire de ses récits aux tonalités franchement pornographiques. Il élève à son paroxysme la vision stéréotypée qui fait de Cuba, et de la Caraïbe en général, un espace où l‟érotisme est débordant. En reprenant un certain nombre de clichés (la mulata insatiable ou encore le Noir doté d‟un sexe démesuré), l‟auteur place la sensualité au cœur de tous les récits du cycle « Centro Habana ». Déclinée sous toutes ses formes et toutes ses pratiques (gérontophilie, pédophilie, nécrophilie, bestialité, exhibitionnisme, voyeurisme, sadisme, masochisme, etc.), la sexualité, qui dans le cas qui nous occupe semble « animaliser » les personnages771, paraît être le dernier lien qui relie l‟homme à la vie, dans un contexte de crise aiguë. Car, ce que González-Abellás qualifie de « énfasis en lo sexual »772 n‟est pas qu‟une évocation lancinante et gratuite. Le sexe est une échappatoire qui permet de fuir la réalité environnante comme l‟explique le personnage de Pedro Juan : « Y estaba repleto de sexo [...]. Y eso es muy bueno para el espíritu. Tú descargas el semen según lo fabricas. Mantienes vacíos los almacenes y muchas cosas se ordenan solas y ya no hay que preocuparse de ellas. Siempre lo digo : un hombre sin mujer es 767 Nous reprenons l‟expression d‟un personnage, ibid., p. 211. C‟est ce qu‟écrit Delia Doce à son amie Estelvina, dans une lettre retranscrite dans le récit, Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 24. 769 Id., La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 447. 770 Abilio Estévez, Los palacios distantes, op. cit, p. 256, 257. 771 Comme nous le reverrons un peu plus loin, l‟animalité de l‟homme est un motif récurrent dans les œuvres du cycle « Centro Habana », de Gutiérrez. Le titre d‟un de ses romans, Animal tropical, en est une illustration. 772 Miguel González-Abellás, « La figura de la mulata cubana en el fin del milenio : Trilogía sucia de La Habana », in Hispanic Journal, vol. 22, n°1, Indiana University of Pennsylvania, printemps 2001, p. 252. 768 257 un desastre total »773. Si elle maintient en vie, cette sexualité hyperbolique est aussi une marque de transgression et d‟insubordination à la société et à la morale établie. La quête de plaisir, parce qu‟elle est la seule règle qui puisse encore dicter les actes des personnages, devient la dernière rébellion possible dans une société agonisante marquée par l‟interdit, la pénurie et la misère. On retrouvait déjà cette fonction contestataire de la sexualité dans les scènes de carnaval décrites en littérature. Fête transgressive s‟il en est, le carnaval est souvent associé à une sexualité débridée et donc à l‟orgie que nous évoquons ici. Dans notre corpus, deux exemples retiennent particulièrement notre attention parce qu‟ils transforment La Havane en scène de spectacle grotesque où les débordements licencieux sont de mise. La ville est tout d‟abord carnavalisée à la toute fin du chapitre IX de Paradiso de Lezama Lima puis, de manière hyperbolique et constante, dans El color del verano, d‟Arenas. Dans le premier texte, Cemí découvre un cortège burlesque et joyeux alors qu‟il se trouve sur l‟escalier central de l‟université : De pronto, entre el tumulto de los pífanos, vio que avanzaba un enorme falo, rodeado de una doble hilera de linajudas damas romanas, cada una llevaba una coronilla, que con suaves movimientos de danza parecía que depositaban sobre el túmulo donde el falo se movía tembloroso. El glande remedaba el rojo seco de la cornalina. [...] Un genio suspendido sobre el phallus acercaba el círculo de flores a la boca abierta de la cornalina, […] luego lo alejaba, perseguido por las doncellas romanas, que tendían sus manos como para clavarle las uðas […]. El genio que volaba en la promesa de la corona para la cornalina fálica, estaba rodeado de innumerables kabeiroi, demonios enanos que portaban unos falos casi del tamaño de su cuerpo, que golpeaban a las vírgenes romanas y luego se perdían en la muchedumbre, enredándose en sus piernas y golpeando en sus cuerpos con su enorme rabo fálico. […] La carroza y la figura del genio […] avanzaban protegidos por un palio, sostenido por cuatro lanzas, que remedaban serpientes que ascendían entrelazadas para terminar en un rostro que angustiosamente se metamorfoseaba en una punta de falo, partido al centro como una boca. […] Un grupo de robustas matronas precede a la carroza, soplando en extensas trompetas. Formando como la cara de la carroza, una vulva de mujer opulenta, tamaño proporcionado al falo […], estaba acompaðada por geniecillos que con sus graciosos movimientos parecían indicarle al falo el sitio de su destino y el final de sus oscilaciones.774 C‟est avec beaucoup d‟attention que le narrateur décrit ce défilé grivois qui honore le sexe masculin. L‟omniprésence de la forme phallique (le phallus bien sûr mais aussi la queue des démons, les lances et les serpents), les scènes explicites (un génie joue autour du gland avec une couronne de fleurs ; une vulve féminine semble s‟offrir au phallus), les jeunes femmes déguisées en Romaines et, enfin, la musique et la danse font de cette procession une véritable 773 774 Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 118. José Lezama Lima, Paradiso, op. cit., p. 429, 430. 258 bacchanale lascive. La présence de génies et de démons parachève la mise en scène de ce spectacle loufoque qui semble prôner, avec humour, la libération du corps. Il n‟est pas indifférent d‟observer que ce passage clôt un chapitre marqué par les manifestations estudiantines et la terrible répression de la police déjà évoquées dans la deuxième partie de notre travail. Peu avant cet extrait, la tension est encore palpable au sein d‟Upsalón puisque des coups de feu sont tirés, des étudiants se battent et la police tente de rétablir l‟ordre 775. Cet élan festif et bouffon, qui semble faire contrepoids à la violence, revêt clairement la fonction contestataire et subversive du carnaval mise au jour par Bakhtine dans ses travaux sur Rabelais776. Les codes moraux sont abolis et les interdits transgressés dans une sorte de catharsis populaire qui pourrait aussi être le signe d‟un certain renouveau. Bakhtine a en effet montré que, par le déguisement ou le travestissement, le carnaval marquait une renaissance. Cette scène, située à la toute fin du chapitre IX, peut donc se lire comme le triomphe final de la vie. Par ailleurs, cet extrait fait suite au fameux chapitre VIII, censuré en son temps à cause de sa teneur sexuelle explicite. Après la description des verges de deux adolescents, Farraluque et Leregas, qui découvrent la sexualité, ce sont les multiples aventures hétéro- et homosexuelles du premier qui sont relatées dans les moindres détails. Cette partie du livre met en lumière une exploration sexuelle libérée de tout jugement moral et place le plaisir charnel au cœur de cette quête. Chez Lezama, la ville est donc, à plus d‟un titre, la scène de la découverte, de l‟initiation et de l‟apprentissage ; nous allons y revenir très vite. Le deuxième exemple qui illustre la carnavalisation de l‟espace est le roman d‟Arenas, El color del verano, publié à titre posthume en 1991 et qui fait partie du cycle que l‟auteur a dénommé la « pentagonie » (cinq agonies)777. Le titre complet, El color del verano o Nuevo « Jardín de las Delicias », conçoit le récit comme une version littéraire du célèbre triptyque de Jérôme Bosch, Le jardin des Délices (1500-1510). Grâce à l‟adjectif « nuevo », le paratexte situe d‟emblée l‟œuvre du côté du pastiche, si cher à Arenas. L‟outrance et l‟hyperbole, présentes tout au long de ce récit déstructuré, composé de fragments successifs qui font l‟effet d‟un collage, ne feront que confirmer le caractère parodique de l‟écriture littéraire. Sur le fond, ces différentes sections mettent en scène une foule de personnages qui, à l‟occasion de la grande 775 « Cemì se detuvo, se oìan disparos que iban en aumento. […] Los estudiantes de Upsalñn salìan de una asamblea rubricada a balazos. Al salir del aula un grupo pequeño de hombres y mujeres más corajudo agredía a otro más numeroso […]. Los disparos espaciados iban impulsando la salida tumultuosa de los asambleìstas. Corrían los ujieres y la policía para separar a los participantes en la improvisada promaquia », ibid., p. 429. 776 Nous renvoyons à son étude des scènes carnavalesques chez Rabelais. Voir : Mikhaïl Bakhtine, « Les formes et images de la fête populaire dans l‟œuvre de Rabelais, in L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, « Tel », 1970, p. 198-276. 777 Ce cycle comprend les cinq œuvres suivantes : Celestino antes del alba (1967), El palacio de las blanquísimas mofetas (1980), Otra vez el mar (1982), El asalto (1988) et El color del verano (1991). 259 fête donnée par Fifo (double parodique de Fidel Castro) pour célébrer ses cinquante années au pouvoir, participent à un immense carnaval au cours duquel ils s‟adonnent à des pratiques sexuelles transgressives habituellement réprimées : Siguieron retumbando las orquestas y todos, mientras bailaban, con las pintas llenas de cerveza, se excitaban. Y sin importarles qué era lo que tenían a su lado, ni quién los miraba, se palpaban, se restregaban, se apretaban. Y allí mismo, en plena muchedumbre, se enculaban o por lo menos mamaban… 778 L‟enchaînement de verbes marque la frénésie qui habite ces personnages ayant perdu toute pudeur. Comme chez Bosch, les corps s‟unissent et s‟enchevêtrent dans une sorte d‟orgie générale mais chez Arenas, ces scènes n‟ont rien d‟infernales. Au contraire, la sexualité débridée et insatiable n‟est nullement condamnée car elle sert d‟exutoire, comme l‟explique clairement le narrateur dans le prologue (qui ne se trouve pas au début mais au milieu de l‟œuvre !), lorsqu‟il tente de définir El color del verano : « […] la manera de no tomar nada en serio para poder seguir sobreviviendo y el sexo como una tabla de salvación y escape inmediatos »779. L‟érotisme à outrance témoigne donc d‟un désir désespéré de lutter contre le Pouvoir (une tyrannie vieillissante), ses différentes formes de répression et, en dernière instance, contre la mort (« sobreviviendo »). A ce propos, les travaux de Georges Bataille, qui a mis au jour la relation unissant le sexe et la mort, s‟avèrent éclairants. Ne dit-il pas, en effet, que l‟érotisme « est l‟approbation de la vie jusque dans la mort » ? 780 Célébrant le tout dernier carnaval du siècle, les personnages d‟Arenas sont comme pris d‟un élan vital incontrôlable qui les conduit à des pratiques sexuelles exaltées où l‟individualisation et le genre781 s‟effacent au profit d‟une jouissance collective. Encore plus peut-être que chez Lezama, le carnaval revêt ici une fonction contestataire : tout est moqué et parodié, de la fête patriotique à ses participants (le nom de nombreuses personnalités politiques et culturelles cubaines est à peine transformé). Les codes et la hiérarchie sont renversés dans un récit blasphématoire et iconoclaste qui fait de la ville le dernier espace de liberté 782, car le carnaval, spectacle urbain s‟il en est, permet aussi de se réapproprier momentanément un territoire. 778 Reinaldo Arenas, El color del verano (1991), Barcelone, Tusquets, 1999, p. 422. Ibid., p. 262. 780 Georges Bataille, L’érotisme, Paris, Les Editions de Minuit, 1957, p. 17. 781 Outre la présence de travestis et de transsexuels, l‟identité instable du personnage de Gabriel, alias Reinaldo, alias Tétrica Mofeta, puis l‟homosexualité qui touche tout le monde (tous deviennent des « locas ») corroborent cette idée. 782 Pour une étude plus approfondie de cette inversion des valeurs qui s‟opère à tous niveaux dans El color del verano, voir l‟article de Françoise Moulin Civil, « Carnaval y carnavalización : El color del verano, de Reinaldo Arenas » in Christian Giudicelli (dir.), América : cahiers du CRICCAL - La fête en Amérique Latine. 2ème série. Rupture, carnaval, crise, n°28, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2002, p. 65-74. 779 260 Enfin, soulignons que la carnavalisation de la ville, en faisant de l‟espace urbain une scène de théâtre, sera un élément éminemment baroque dont nous reparlerons. Outre l‟excès et la démesure, La Havane permet aussi l‟initiation sexuelle. Ce qui apparaissait déjà dans le chapitre VIII de Paradiso, à travers le personnage de Farraluque, va se confirmer : les jeunes gens s‟ouvrent à la sexualité et aux plaisirs charnels dans la capitale cubaine. La ville fait donc figure d‟espace initiatique permettant aux personnages de passer d‟un âge à un autre. Le narrateur de La Habana para un infante difunto le formule explicitement : « Había en La Habana dos ceremonias iniciáticas que permitían pasar de la adolescencia a la adultez, alcanzar la hombrìa, „hacerse hombre‟ […] »783. Pour devenir adulte, le premier « temple initiatique », pour reprendre l‟expression du narrateur, est le théâtre Shanghai où se jouent des spectacles érotiques. La deuxième épreuve, plus difficile car elle implique un rôle actif de la part du personnage, consiste à aller voir les prostituées, dans le quartier Colón. Pour Reinaldo Arenas, la ville entière est synonyme de découvertes sensuelles puisqu‟il peut y explorer intensément et en toute liberté les plaisirs homosexuels : […] La Habana disfrutaba también de otra vida homosexual poderosísima ; subterránea, pero muy evidente. Esa vida era el flete nocturno por toda la Rampa, por Coppelia, por todo el Prado, por todo el Malecón, en el Coney Island de Marianao. […] « Ligué » con cientos de ellos [reclutas y becados] y los llevé para mi cuarto […]. Creo que nunca se singó más en Cuba que en los años sesenta. 784 Les rues havanaises constituent un espace de désir débridé où l‟homosexualité est assumée. Les années soixante représentent donc une sorte d‟acmé sexuel pour le jeune Arenas qui, alors âgé d‟une vingtaine d‟années, maîtrise parfaitement la géographie érotique de la ville. Les propos du narrateur de Inventario secreto de La Habana, d‟Estévez, sont assez proches puisqu‟ils renvoient également à cette initiation à la fois urbaine et sexuelle : Hay una cara de la ciudad, la cara libidinosa de la ciudad libidinosa, que de súbito se te hace manifiesta, familiar. […] Así fue. Con quince años. Iba desde Marianao, desde la lejanía de mi barrio, a conocer la ciudad […]. Necesitaba que alguien, un hombre, me revelara cuál era ese clandestino secreto de la relación entre los cuerpos. […] Recorría las calles Galiano, San Miguel, San Rafael, el paseo del Prado. Me sentaba un tiempo en el Parque Central con aquella curiosidad que, desesperadamente, todo lo abarca. Y poco a poco, […] la ciudad fue desvelando sus laberintos malévolos y sagrados, sus lados oscuros, que han sido siempre los más luminosos. 785 783 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 225. C‟est nous qui soulignons. Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 130. 785 Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 309. 784 261 Comme chez Arenas, le besoin de nommer les rues qui conduisent à la « connaissance » est manifeste. La magie de la découverte est rendue par l‟antithèse (« malévolos », « oscuros » et « luminosos ») mais surtout par le lexique choisi. Les verbes « conocer », « revelar », « desvelar » et les termes « clandestino », « secreto », « laberintos », « sagrados » invitent à envisager cette promenade guidée par le désir et la curiosité comme un véritable rite initiatique qui changera le protagoniste à jamais. En filigrane, c‟est l‟image d‟un espace mystérieux qu‟il faut décrypter qui se fait jour. Les personnages, d‟abord profanes, deviennent initiés une fois qu‟ils sont à La Havane mais pour ce faire, ils doivent passer par une série d‟étapes ou d‟épreuves, dans la plus pure tradition littéraire. L‟escalier, qui signifie l‟ascension, le passage d‟un âge à un autre, est l‟une des images symboliques récurrentes. Il apparaît, par exemple, dans Paradiso, quand José Cemí quitte le lycée pour aller à l‟université de La Havane, la fameuse Upsalón. On peut ainsi lire au début du chapitre IX : La escalera de piedra es el rostro de Upsalón, es también su cola y su tronco. […] Tiene algo de mercado árabe, de plaza tolosana, de feria de Bagdad ; es la entrada de un horno, a una transmutación, en donde ya no permanece en su fiel la indecisión voluptuosa adolescentaria. Se conoce a un amigo, se hace el amor, adquiere su perfil el hastío, la vaciedad.786 Les escaliers permettent de « vertébrer » littéralement l‟université qui, sous la plume de Lezama, est animalisée. Lieu vivant, comme le suggère la personnification, ces escaliers font office d‟agora permettant les rencontres et l‟ouverture à l‟autre. C‟est tout du moins ce qu‟évoque la comparaison avec les places orientales. L‟université contraste donc avec la maison familiale plutôt fermée sur le monde extérieur787. Aller à Upsalón et monter ces marches constituent une expérience initiatique bouleversante puisqu‟il est question de « transmutation ». Dans un article sur Paradiso, Françoise Moulin Civil ne dit pas autre chose quand elle explique que l‟université est « un espace d‟initiation et de liberté […] », que c‟est « […] le lieu à la fois concret et symbolique de la transgression d‟un ordre (loi ou modèle) établi et désacralisation de l‟autorité […] »788. Effectivement, pour José Cemí, l‟entrée à Upsalón sera une étape déterminante : il y fera l‟expérience de l‟autre (il y retrouve Fronesis et rencontre Foción), sera confronté au contexte politique de son temps (il assiste aux 786 José Lezama Lima, Paradiso, op. cit., p. 370, 371. Nous étudierons ce point un peu plus loin. 788 Françoise Moulin Civil, « ¡ Upsalón ! ¡ Upsalón ! : una universidad en el Paradiso », in Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, La Havane, n°3-4, juillet-décembre 2002. http://www.bnjm.cu/sitios/revista/2003/01-02/francoise.htm (consulté le 12/10/2012) C‟est nous qui traduisons. 787 262 manifestations estudiantines) et s‟ouvrira à la sexualité. Les escaliers de l‟université marquent clairement la progression vers la connaissance et la transfiguration de José Cemí qui s‟éloigne de la sorte du noyau familial. Dans La Habana para un infante difunto, de Cabrera Infante, l‟initiation commence avec les escaliers de l‟immeuble de la rue Zulueta puisqu‟ils sont la toute première image que le narrateur a de La Havane (il parle de « recuerdo inaugural »789 pour les évoquer) et vont matérialiser cette deuxième naissance symbolique déjà évoquée précédemment. L‟incipit du roman leur accorde une place prépondérante : Así mi verdadero primer recuerdo habanero es esta escalera lujosa que se hace oscura en el primer piso […] para abrirse, luego de una voluta barroca, al segundo piso, a una luz diferente, filtrada, casi malva, y a un espectáculo inusitado. Enfrente […] un pasillo largo, un túnel estrecho, un corredor como no había visto nunca antes, al que se abrían muchas puertas […]. El tiempo se detuvo ante aquella visiñn : con mi acceso a la casa marcada Zulueta 408 había dado un paso trascendental en mi vida : había dejado la niñez para entrar en la adolescencia. 790 Cette description de la cage d‟escalier, qui semble finalement plus importante que le nouvel appartement familial, place d‟emblée le lecteur dans un monde onirique. La lumière presque surnaturelle, les adjectifs « diferente » et « inusitado », l‟expression « nunca antes visto » et le temps qui est comme suspendu, concourent à créer une atmosphère fantastique. On notera que l‟approche descriptive, largement esthétisante (insistance sur les jeux chromatiques et le long couloir, comparaison avec un « spectacle inhabituel », multiplication des portes qui ne sont pas sans rappeler un passage des Aventures d’Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll), participe à la théâtralisation de cette « scène d‟ouverture ». Les escaliers qu‟il faut monter et le long « tunnel » étroit qu‟il faut traverser apparaissent comme des rites d‟initiation qui permettront au protagoniste d‟accéder à la lumière. D‟aucuns pourraient y voir encore une allusion implicite à la matrice maternelle, ce qui renforcerait cette idée de deuxième naissance791. Véritable étape vitale et ontologique, l‟arrivée à La Havane marque le passage d‟un âge à un autre, comme le suggèrent les dernières lignes citées (« un paso trascendental en mi vida » ; « había dejado la niñez para entrar en la adolescencia ») ainsi que le titre de ce premier chapitre : « La casa de las transfiguraciones ». Le narrateur sortira effectivement transformé et grandi de cette période passée au cœur de Centro Habana qui sera synonyme d‟éveil à la ville et aux femmes. Enfin, dans En el cielo con diamantes, de Senel Paz, 789 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 11. Loc. cit. 791 Une des interprétations du tunnel proposées par le Dictionnaire des symboles va dans ce sens. Cf Jean Chevalier ; Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres (1982), Paris, Robert Laffont Ŕ Jupiter, « Bouquins », 1997, p. 981, 982. 790 263 l‟initiation structure aussi le roman puisqu‟il est question de l‟arrivée à La Havane de deux adolescents provinciaux, David et Arnaldo, qui vont s‟ouvrir à l‟amitié, à l‟amour et à la sexualité. A cause d‟une prophétie, Arnaldo se sent investi d‟un devoir : tout faire pour que son ami David perde sa virginité avant ses dix-sept ans. Aussi, la fin du roman revêt-elle un caractère hautement symbolique puisque David emmène enfin sa fiancée Vivian dans un hôtel de passe. Le caractère initiatique de cette expérience est patent car les deux jeunes gens se perdent dans ce dédale de chambres, montent et descendent des escaliers, se retrouvent au point de départ et finissent par trouver leur chambre qui porte symboliquement le numéro dixsept : […] subimos las escaleras, llegamos a un pasillo y pasamos puertas, pasamos puertas, pasamos puertas hasta que arribamos al mismo punto de partida, junto a la boca de la escalera, sin encontrar la habitaciñn. […] Bajamos, llegamos a un vestíbulo idéntico al anterior, tomamos a la izquierda y pasamos puertas, pasamos puertas, pasamos puertas, hasta encontrarnos de nuevo frente a la escalera. […] Subimos de nuevo y cuando llegamos arriba allí estaba la diecisiete, frente a la escalera, como si siempre hubiera estado allí.792 Escaliers et labyrinthe sont des sortes d‟épreuves qui rendent la quête difficile, angoissante et secrète. Notons que, dans ce parcours initiatique, l‟escalier occupe une place centrale puisque les personnages, bien malgré eux, reviennent toujours à lui et qu‟il donne directement sur la fameuse chambre dix-sept (sorte de saint Graal). La répétition des verbes d‟action, le rythme ternaire et la ponctuation insistent sur le caractère aliénant et exaspérant de cette expérience qui, ayant tout d‟un rite, sera jusqu‟au bout semée d‟embûches (une fois devant la porte, ils auront beaucoup de mal à pénétrer à l‟intérieur de la chambre car la clef résistera et la porte ne s‟ouvrira que difficilement). On l‟aura compris, tout contribue à sacraliser l‟acte sexuel qui signifie la perte de la virginité de David. Espace et sexualité entretiennent des relations très étroites qui prennent également la forme d‟une sexualisation du territoire. Comme nous l‟avons vu à plusieurs reprises, la ville est personnifiée mais surtout féminisée : elle devient un corps érotisé qu‟il faut posséder. Chez Jesús Díaz, elle était dotée d‟un clitoris et attirait les marins793, chez César Leante, elle est à la fois un sexe féminin et masculin : « La Habana es una inmensa vulva y un falo todopoderoso. Los signos de esta tierra, no reclames otros, no hay más que éstos. Púdrete en ello »794. Le sexe définit la ville, il est son commencement et sa fin, au point que la cité est souvent 792 Senel Paz, En el cielo con diamantes, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2007, p. 313, 314. Jesús Díaz, Las palabras perdidas, op. cit., p. 229. 794 César Leante, Muelle de caballería (1973), Madrid, Editorial Pliegos, 2002, p. 85. 793 264 associée à la Babylone biblique, la fameuse Grande Prostituée : « Decía Miller que París es como una puta, pero La Habana es más puta todavía : sólo se ofrece a los que le pagan con angustia y dolor […] »795, explique le narrateur de Vientos de cuaresma. Amir Valle faire dire exactement la même chose à l‟un de ses personnages, à la toute fin de Entre el miedo y las sombras : « […] La Habana será siempre una puta hermosísima, gobierne quien gobierne »796. Cupide, impitoyable mais néanmoins attirante, la capitale reste immuablement la catin caribéenne par excellence. Ville portuaire importante, point de passage obligé entre l‟Ancien et le Nouveau Monde puis cité touristique emblématique, La Havane est depuis toujours un haut lieu de la prostitution, comme le rappelle Montero : « La Habana siempre ha sido una ciudad de putas, vamos a echarle la culpa al puerto y a las flotas que convierten la putería en necesidad »797. Après l‟époque coloniale, le fameux quartier Colón devient à lui seul le symbole de la vie libertine havanaise puisque on y trouve presque toutes les maisons closes de la ville. Un personnage de Muelle de caballería, de César Leante, dit à son sujet que c‟est le « burdelero más ampliamente habitado de La Habana »798 et s‟étonne du fait qu‟il porte le même nom que le cimetière de la ville. Dans De donde son los cantantes, de Sarduy, où il est aussi question de ce quartier car la partie « Junto al río de cenizas de Rosa » se veut un hommage au fameux théâtre pornographique Shanghai, comme l‟indique le sous-titre, on peut lire : « […] en esta ciudad donde hay […] una puta y un marinero en cada esquina »799. Cette phrase semble annoncer l‟histoire à venir : celle d‟un Général espagnol obsédé par la vedette du Shanghai, le travesti Flor de Loto. Après les années cinquante et l‟avènement de la Révolution, bordels et théâtres burlesques n‟ont plus lieu d‟être à La Havane. Mais, comme nous l‟avons dit, la prostitution ne disparaît pas pour autant de la cité, au contraire, elle ressurgit avec force durant la terrible crise économique des années quatre-vingt-dix. La Havane redevient donc la capitale de la prostitution, comme l‟atteste l‟émergence de la figure de la jinetera et du jinetero dans les romans de la période spéciale. Zoé Valdés, Pedro Juan Gutiérrez, Daína Chaviano, Daniel Chavarría ou encore Amir Valle, sont quelques-uns des auteurs traitant cette thématique dans certaines de leurs œuvres. Les nouvelles aussi se font l‟écho d‟un jineterismo outrancier ; en témoigne le récit de Nancy Alonso, « Tirar la primera piedra », dont l‟action se déroule à La Havane, juste après l‟effondrement du bloc soviétique. La Cubaine Nora Acosta retrouve, dans un très grand hôtel de la ville, un couple d‟Argentins 795 Leonardo Padura Fuentes, Vientos de cuaresma, op. cit., p.138, 139. Amir Valle, Entre el miedo y las sombras, op. cit., p. 157. 797 Reinaldo Montero, Bajando por Calle del Obispo, op. cit., p. 20 798 César Leante, Muelle de caballería, op. cit., p. 147. 799 Severo Sarduy, De donde son los cantantes, op. cit., p. 110. 796 265 qui découvrent les ravages de la crise : « Nunca pensé encontrar prostitución ni tanto acoso a los turistas en Cuba. […] Para nosotros, Cuba era el paraìso terrenal […], la utopìa hecha realidad »800. Surprise et déception se mêlent dans les propos de Gladys, la femme argentine, qui fait amèrement l‟expérience de l‟échec de l‟utopie révolutionnaire. Son séjour à La Havane lui montre, en effet, les perversions que provoque le tourisme de masse : la prostitution est visible partout et les enfants délaissent l‟école pour arracher quelques dollars aux touristes. Dans un tout autre genre, l‟essai Jineteras, d‟Amir Valle, nous semble incontournable dès lors que l‟on traite de la prostitution à Cuba. Cette œuvre, composée de nombreux témoignages directs, essaye d‟évaluer l‟ampleur du phénomène et laisse la parole aux acteurs de ce vaste trafic : prostitué(e)s, clients, proxénètes mais aussi policiers corrompus. Amir Valle lève le voile sur une douloureuse réalité que les autorités préfèrent minorer : la prostitution, loin d‟être condamnée, est acceptée et même considérée par beaucoup comme la seule issue possible. La commercialisation du corps, qui semble toucher tout le monde, s‟affiche ostensiblement dans les rues de la capitale et donne à cette dernière, avec un paroxysme sans doute encore jamais atteint, des allures d‟immense lupanar. Plus on avance dans le temps et plus l‟espace urbain havanais semble révéler, et parfois même exacerber, certaines caractéristiques de la sexualité. Qu‟elle soit contestataire, salutaire, symbolique ou sordide, elle se manifeste toujours dans l‟excès. e- La nouvelle Babylone Au-delà de l‟oisiveté, de la cupidité, du mensonge et de la luxure, c‟est la corruption des mœurs et la décadence en général que dénoncent certains écrivains. La Havane symbolise le mal et est traitée, en littérature, comme une nouvelle Babylone. La comparaison entre les deux villes est un leitmotiv qui apparaît dès le XIXème siècle sous la plume, par exemple, de Meza puisque, à peine arrivé à Cuba, l‟Espagnol, Vicente Cuevas, s‟exclame : « ¡ Esto es una Babilonia, sobrino ! »801 ; elle est reprise au début du XXème siècle par Carrión dans sa nouvelle « En familia », nous l‟avons vu802. Sans reprendre toutes les occurrences du mot, disons que la comparaison perdure et se nourrit encore davantage de cette référence biblique au point que certains textes revendiquent ostensiblement une intertextualité avec le livre sacré. 800 Nancy Alonso, « Tirar la primera piedra », in Marilyn Bobes, Espacios en la Isla. 50 años del cuento femenino en Cuba, op. cit., p. 82. 801 Ramón Meza, Mi tío el empleado, op. cit., p. 24. 802 « […] aquella babilonia » dit le narrateur de « En familia », Miguel de Carrión, La última voluntad y otros relatos, op. cit., p. 24. 266 L‟épigraphe qui inaugure le roman En ciudad semejante (1970), de Lisandro Otero, est un extrait de l‟Apocalypse qui décrit la destruction de Babylone803. En mettant en exergue le texte biblique, l‟auteur signifie explicitement que La Havane de Batista est la nouvelle Babylone puisque le roman commence en 1952 avec le coup d‟état du dictateur et s‟achève le 1er janvier 1959 avec la victoire des troupes révolutionnaires. La citation a ici une fonction programmative évidente car elle oriente une lecture symbolique de la ville. Ainsi, lorsqu‟à la fin du récit, la capitale est libérée du tyran, le chaos et la violence, qui marquent la mise à sac de La Havane, font clairement écho à la chute de Babylone : Viendo que no sucedía nada cargaron con las máquinas traganíqueles, con las ruletas, con las mesas de dados y las lanzaron a la calle destrozándolas a golpe. Alguien trajo gasolina y enseguida ardiñ una pira gigantesca. […] Lo mismo ocurrió en el Sevilla, en el Morocco, en el Nacional. Muchas vidrieras estaban rotas. […] En el parque Central la muchedumbre corrìa a guarecerse en los portales. […] Estallaban tiroteos esporádicos. En la Acera del Louvre, al pie de un gigantesco pasquín de Rivero Agüero, [Dascal] vio a un joven mulato muerto. Aparecieron unas milicias improvisadas con escopetas de caza, revólveres vizcaínos y brazaletes del Movimiento. […] Hacia la ciudad vieja se alzó una columna de humo : el periódico Tiempo ardía.804 La destruction quasi complète des symboles de la tyrannie (casinos, grands hôtels, journaux) transforme la ville en no man’s land (« En el primer día de la Revolución La Habana era tierra de nadie »805). Si nous poursuivons notre lecture parabolique, comme nous invite à le faire l‟épigraphe, nous pouvons nous risquer à lire l‟avènement de la Révolution comme « La victoire du Messie » qui a combattu « la grande prostituée qui corrompait la terre de sa prostitution »806. Quelques décennies plus tard, Abilio Estévez, dans Tuyo es el reino, offre lui aussi une lecture en filigrane du texte biblique. Par deux fois, un personnage fantasmagorique intervient pour rapporter une prophétie faite par un ange : […] caerá la gran Babilonia, se ha vuelto vivienda de demonios, guarida de todo tipo de espíritus impuros, y caerá, pueden estar seguros, se vendrán abajo estas columnas, se desmoronarán estas paredes, se harán polvo los techos, sí estén seguros, la gran Babilonia caerá y no quedará de ella ni el recuerdo.807 803 Lisandro Otero, « En ciudad semejante », in Trilogía cubana, op. cit., p. 213. Ibid., p. 500, 501. 805 Ibid., p. 508. 806 La Bible (TOB), « Apocalypse 19.2 », Alliance Biblique Universelle Ŕ Le Cerf, Paris, Editions du Cerf, 1988, p 1812. 807 Abilio Estévez, Tuyo es el reino, op. cit., p. 195. Cette description de la chute de Babylone sera reprise un peu plus loin par ce même personnage prophétique : « […] caerá la gran Babilonia, […] la gran Babilonia caerá, 804 267 Nous ne nous attarderons pas sur le caractère apocalyptique de cette chute car nous l‟aborderons peu après, lorsque nous parlerons du châtiment. Soulignons tout de même que le narrateur reprend les versets de l‟Apocalypse en faisant intervenir un ange et en respectant les termes et les répétitions du texte original808. Estévez ne se contente pas d‟évoquer Babylone pour signifier que La Havane est la ville du péché extrême, il va le démontrer par un exemple concret, en rappelant l‟histoire d‟Enrique et de sa sœur Angelina, qui achetèrent la propriété de « La Isla » autrefois. La jeune femme, qui a quitté sa Galice natale pour rejoindre son frère à Cuba, est dégoûtée par la ville : « Si estoy contigo no me importa vivir en esta Babilonia de negros […] »809. Angelina ne croit pas si bien dire puisque la capitale va effectivement devenir, pour elle et son frère, une véritable Babylone. Parlant toujours de La Havane, elle dit d‟ailleurs : « […] no es una ciudad sino el tumulto de una pesadilla deleitosa, una pertubaciñn […] »810. L‟oxymore, qui sert à définir les impressions contradictoires du personnage, annonce la faute à venir. L‟atmosphère irréelle (« pesadilla ») et anormale (« pertubación ») qui règne semble servir d‟explication à la relation incestueuse que maintiendront le frère et la sœur pendant quatre ans. Le fruit de cette union consanguine prohibée sera monstrueux : « Hay quien dice que nació un minotauro. Hay quien dice que un basilisco. Otros, que una medusa »811. Une fois l‟épouvantable créature tuée et enterrée, le frère et la sœur sèment des graines qui, plus tard, formeront le jardin luxuriant de « La Isla ». L‟origine de cette finca est lourde de symbole et marquée du sceau du péché (elle finira d‟ailleurs ravagée par un incendie) ; par extension, c‟est la ville entière qui devient une « […] ciudad babilónica con alma de aldea »812. La Havane est aussi le lieu de l‟inceste chez Arenas, dans Viaje a La Habana, inceste auquel vient s‟ajouter l‟homosexualité. Ismael ignore que le jeune homme qui dit s‟appeler Carlos et avec qui il a une relation sexuelle est son fils, Ismaelito, qu‟il n‟a pas revu depuis des années. A l‟image d‟Œdipe, le personnage d‟Arenas ne sait pas qu‟il commet l‟irréparable. Seule l‟anagnorèse finale lui révèlera sa faute. En revanche, le fils sait parfaitement que l‟homme qu‟il aborde sur la plage est son père et c‟est en connaissance de cause qu‟il accepte de le estallarán los edificios, subirá el mar, […] yo vi al ángel que anuncia la destrucciñn de la gran Babilonia […] », ibid., p. 197, 198. 808 Voici ce qui est écrit dans le Nouveau Testament au sujet de la chute de Babylone : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ; elle est devenue demeure de démons, repaire de tous les esprits impurs […] », La Bible (TOB), « Apocalypse 18.2 », op. cit., p. 1811. Nous reviendrons sur cette citation un peu plus loin. 809 Abilio Estévez, Tuyo es el reino, op. cit., p. 181. 810 Ibid., p. 182. 811 Ibid., p. 185. 812 Ibid., p. 184. 268 suivre dans sa chambre d‟hôtel. Dans ce récit, La Havane se charge de nombreux symboles : elle est incontestablement la ville d‟un des péchés universellement condamné mais elle sert aussi de décor à un calvaire, ce qui ne fait que renforcer l‟allusion biblique. A plusieurs reprises, Ismael apparaît effectivement comme une incarnation du Christ. Il marche tout d‟abord à moitié nu dans les rues de La Havane, traînant avec lui un tronc d‟arbre couvert de clous, tandis qu‟on le frappe et lui jette des pierres. Cette scène renvoie bien sûr au Christ portant sa croix sur le mont Golgotha. Il est aussi fait mention de ses blessures aux mains et aux pieds qui rappellent évidemment les stigmates de Jésus : « […] el recorrido no sñlo se hizo más extenso, sino más penoso. Atravesó pedregales, terraplenes y arrecifes que le desgarraron los pies y hasta las manos »813. Son ancienne femme, Elvia, lui lave les pieds quand il arrive chez elle épuisé et en sang. Cette scène évoque le geste du Christ lavant les pieds de ses apôtres, la veille de sa Passion. Enfin, on ajoutera que tout cela se passe un 25 décembre. La somme de tous ces exemples montre que cette fois, c‟est La Havane qui apparaît comme une ville-palimpseste car elle se donne à lire par strate. L‟écriture de la ville se fait à partir d‟un substrat biblique évident dont elle conserve la trace, de sorte que plusieurs cités hautement symboliques (Babylone et Jérusalem, en l‟occurrence) se superposent pour définir la ville caribéenne. Cette écriture palimpsestique de l‟espace urbain est renforcée par l‟image d‟une Havane châtiée et détruite pour ses péchés. 2- Le châtiment a- De la chute de Babylone à la destruction de Sodome et Gomorrhe A l‟image des cités bibliques pécheresses, qui se sont attiré les foudres de Dieu, la capitale cubaine, en tant que symbole du mal, doit tomber. C‟est tout d‟abord la grande Babylone, mère de tous les vices, qui est convoquée pour exprimer l‟expiation. Dans notre corpus, le châtiment divin est annoncé par des anges qui descendent sur Terre, exactement comme dans le texte biblique. Nous avons vu effectivement qu‟Abilio Estévez proposait une réécriture de l‟Apocalypse de Jean, dans Tuyo es el reino, puisqu‟un personnage répète à deux reprises les propos qu‟un ange lui a tenus814. Comme pour donner plus de poids à ses propos, le personnage reprend, un peu plus loin, cette prophétie à laquelle personne ne veut croire : 813 814 Reinaldo Arenas, Viaje a La Habana, op. cit., p. 150. Cf. Abilio Estévez, Tuyo es el reino, op. cit., p. 195. 269 Caerá, no te preocupes, caerá la gran Babilonia, el ángel me lo contñ, […] la gran Babilonia caerá, estallarán los edificios, subirá el mar, serán sepultados por el mar, el cielo bajará de un golpe hasta el mar, mar y cielo se unirán, la unión de los dos es el fuego, el fuego, se harán polvo las esperanzas polvo las ilusiones […].815 Comme il a été dit peu avant, le narrateur respecte assez fidèlement le texte biblique original (« L‟annonce du jugement »816 et « La chute de Babylone »817) puisqu‟il répète avec emphase le verbe « tomber », évoque les « esprits impurs » et prédit une série de catastrophes qui détruiront la ville (les constructions s‟effondreront, la cité sera engloutie par les eaux puis brûlera avant de disparaître pour toujours). Les deux autres villes bibliques qui servent de référent symbolique à La Havane littérarisée sont Sodome et Gomorrhe, cités détruites par le soufre et le feu dans la Genèse. Décrivant l‟église méthodiste du fameux quartier Colón, connu pour ses innombrables bordels, César Leante, dans Muelle de caballería, explique : Era un edificio de factura absolutamente griega, con pórtico de sólidas columnas y frontispicio triangular. Resultaba inconcebible una construcción así, destinada a cercar al hombre a la luz purísima de la razón, erigido en sitio tal y en desnivel arquitectónico y ético diabólicamente desproporcionado con la religión que dominaba. Pues precisamente a partir de aquella Atalaya del Buen Sendero se iniciaban los callejones de puertas cerradas y voces desaladas. Incongruentemente hacía las veces de portón de Sodoma y la suma paradoja la prestaba un cartel sobresaliente del muro en el que se notificaba : Sed bienvenidos.818 Avec humour, le narrateur souligne le contraste entre l‟édifice religieux, qui symbolise la vertu, et l‟ensemble du quartier, qui se distingue par son libertinage. L‟antinomie constante dans ces lignes marque l‟incongruité de ce temple situé aux portes de « Sodome » (« inconcebible », « desnivel », « desproporcionado », « incongruentemente »). Le narrateur ne manque d‟ailleurs pas de signaler l‟ambiguïté du panneau de bienvenue accroché sur une des façades de l‟église. L‟allusion à la ville biblique, qui tient ici du clin d‟œil humoristique, prend souvent une tonalité plus grave, surtout quand le châtiment divin est évoqué. Dans El navegante dormido, d‟Estévez, l‟évocation de Sodome s‟accompagne d‟un certain 815 Ibid., p. 197, 198. « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution », La Bible (TOB), « Apocalypse 14.8 », op. cit., p 1807. 817 « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ; elle est devenue demeure de démons, repaire de tous les esprits impurs, repaire de tous les oiseaux impurs et odieux. Car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution ; les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe », La Bible (TOB), « Apocalypse 18.2 », op. cit., p 1811. 818 César Leante, Muelle de caballería, op. cit., p. 148. 816 270 dramatisme car l‟avènement de la Révolution, envisagé comme le châtiment divin, provoque la mort de la ville et l‟insilio du personnage d‟Olivero : « Como a Sodoma, a La Habana le había correspondido su lluvia de azufre, su terremoto y su simbólica sepultura bajo las aguas de su propio Mar Muerto »819. L‟arrivée des barbudos au pouvoir change profondément la cité et sonne le glas de cette vie festive et délicieuse qui plaisait tant au personnage. Le narrateur poursuit d‟ailleurs en énumérant tous les bouleversements qui, symboliquement, sont associés aux trois fléaux bibliques qu‟il vient de citer : Habìan huido Celia Cruz, Freddy, La Lupe […]. Se habìa acabado la Playa de Marianao, con sus bares de mala muerte y vida maravillosa. Se habían acabado las navidades, y esto no significaba, como se pretendía, el fin de una festividad religiosa, sino el fin de la familia reunida, del lechón asado […], el fin del congrì con mucho comino y aceite de oliva, el fin del yuca con mojo. Se habían acabado las fiestas de carnaval, o, por lo menos, el verdadero carnaval […]. Se habìa acabado la irresponsable y deleitosa alegría de ignorar lo que era una guerra. […] Despertaron los caìnes y los abeles […].820 L‟exil, les pénuries, l‟austérité, les guerres et les trahisons sont quelques-uns des châtiments réservés à la ville qui doit payer le prix fort pour sa rédemption, après des années d‟insouciance et de légèreté. On notera au passage que l‟allusion aux fils d‟Adam et Ève, Abel et Caïn, dont il est également question dans la Genèse, renforce notre lecture allégorique du traitement spatial. Un peu plus loin, le narrateur reprend cette métaphore biblique mais il insiste cette fois sur ce qui distingue La Havane de Sodome : Olivero se sentía como uno de los calcinados por el azufre, uno de los sepultados por el Mar Muerto. Sí, tal vez fuera la estatua de sal […]. La particularidad de aquella Sodoma radicaba en que la lluvia de azufre no la provocaba sólo el castigo de un dios. Algo aún más trágico : el dios provocaba a los que se amaban, el dios incitaba a los propios amigos, a los amantes, los obligaba a que se castigaran entre sí y se lanzaran el azufre los unos a los otros.821 Tel un Sodomite, Olivero semble subir dans sa chair la violence du châtiment divin. S‟il est inutile de rappeler que la pluie de soufre, la mer Morte et la statue de sel renvoient directement au Livre, il convient de noter que La Havane et Sodome ne subissent cependant pas tout à fait le même sort. La punition infligée à la ville cubaine est bien plus cruelle et perfide car elle oblige les Havanais à s‟entretuer. En effet, ce sont les habitants eux-mêmes 819 Abilio Estévez, El navegante dormido, op. cit., p. 235. Ibid., p. 235, 236. 821 Ibid., p. 238. 820 271 qui s‟infligent les supplices punitifs. Aux antipodes d‟un Lisandro Otero, Abilio Estévez fait de La Havane révolutionnaire une nouvelle Sodome et dénonce, de façon à peine voilée, la perversité du régime castriste qui divise la population pour mieux régner. Le substrat biblique n‟est pas toujours exprimé aussi explicitement ; il apparaît de manière plus ou moins évidente dans des récits où la force dévastatrice du feu est clairement synonyme de punition. Le roman de Ramón Meza, Don Aniceto el tendero, se clôt sur un terrible incendie qui ravage la boutique d‟Aniceto822. Avec ce magasin qui part en fumée, ce sont aussi tous les efforts du personnage pour devenir riche qui sont réduits à néant. L‟obsession pour l‟appât du gain, pour « avoir un capital », comme se plaît à le répéter le commerçant, l‟idolâtrie de l‟argent, sont punies de la façon la plus catégorique qui soit : par la destruction complète. Dans un récit plus tardif, Tuyo es el reino, d‟Abilio Estévez, c‟est toute la propriété de « La Isla » qui prend feu, le 31 décembre 1958, la veille de l‟arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Cet incendie accidentel revêt un caractère hautement symbolique puisqu‟il marque clairement la fin d‟une étape et le commencement d‟une autre. La référence biblique présente dans l‟épilogue renforce cette idée puisque les sept anges, leur sept trompettes et le septième sceau de l‟Apocalypse sont cités : « La señorita Berta decía con desconsuelo Ya los siete ángeles tienen las siete trompetas, ya El abrió el séptimo sello, éste es el fuego del incensario, el fuego del altar que cae sobre la tierra… »823. Les expressions « lado sagrado de aquel fuego », « categoría divina », «exorcismo » et l‟allusion aux mille ans du règne christique qui suivront (« los aðos por venir estarían pletóricos de paz y de bonanza »), aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre (« el inicio de una Nueva Era »824) parachèvent la lecture allégorique de cet incendie. « La Isla », et donc La Havane, sont jugées puis châtiées, comme Babylone, mais elles ne bénéficieront pas des mille ans de paix car le narrateur rappelle que toute cette interprétation symbolique n‟est qu‟une espérance personnelle (« tuve la inguenuidad de creer que […] »825). Dans Sangra por la herida, de Mirta Yáñez, ce n‟est pas une partie de la ville qui est réduite en cendres mais la cité entière. Une des narratrices de ce récit polyphonique, composé de différentes sections portant à chaque fois le nom du personnage dont il est question, est une femme inquiétante qui parle seule (« Mujer que habla sola en el parque »). Dans ses propos délirants, elle décrit systématiquement un épisode de l‟extermination totale de la ville et conclut toujours sur la phrase « Y La Habana se muere », à la manière d‟une ritournelle. A deux reprises, elle 822 « El incendio, en tanto, tomaba alarmantes proporciones. Toda la tienda no era ya más que una gran llama, contra la cual se estrellaba el esfuerzo impotente de los bomberos », Ramón Meza, Don Aniceto el tendero, La Havane, Publicación de la Comisión Nacional de la Unesco, 1961, p. 152. 823 Abilio Estévez, Tuyo es el reino, op. cit., p. 322. 824 Ibid., p. 323. 825 Loc. cit. 272 imagine la capitale détruite par les flammes : « Por todas partes aparecieron fueguitos y fueguitas que ardían, quemaban, y achicharraban lo que encontraban a su paso. Y entonces la ciudad entera se convirtió en una loma de cenizas. Y La Habana se muere… »826. Le polyptote (« fueguitos y fueguitas ») et la redondance emphatique (« ardían, quemaban, y achicharraban ») rendent l‟incendie hyperbolique. Un peu plus loin, elle envisage un autre incendie de la ville, provoqué cette fois par le soleil qui serait resté à son zénith : « El sol se quedó quietecito en el cielo a las doce del día y no se movió de ahí. Y entonces el pavimento se derritió, las aguas empezaron a hervir y a evaporarse, los puentes se fundieron y los edificios se calcinaron en cenizas. Y La Habana se muere… »827. Sous l‟effet de la chaleur, les éléments passent d‟un état physique à un autre jusqu‟à leur disparition complète. La ville n‟a alors plus aucune existence matérielle et est littéralement réduite à néant. Outre la destruction de Sodome, les propos apocalyptiques de ce personnage rappellent aussi d‟autres catastrophes bibliques, comme les dix plaies d‟Egypte. b- Les plaies de La Havane Le texte de Yáñez compte vingt-deux interventions différentes de ce personnage prophétique et autant de destructions de la ville. Ces courtes interventions se répètent de manière lancinante pour dépeindre des scènes proprement infernales où il est tantôt question d‟éléments (le vent, les nuages, l‟eau de la mer, l‟orage, le soleil), d‟animaux (serpents, gallinacés, insectes, rapaces, lions828) ou encore de substances visqueuses (excréments, goudron, huile de moteur), entre autres choses, qui détruisent complètement la ville. Les propos de cette femme s‟achèvent toujours sur une épanalepse, « Y La Habana se muere », qui, tout en donnant une certaine prosodie au discours, le rend très obsédant. Ces passages peuvent se lire à la lumière de certains épisodes de l‟Exode, lorsque l‟Egypte est, par exemple, envahie par les grenouilles, les moustiques, la vermine ou encore les sauterelles. D‟ailleurs, à bien observer les textes du corpus, on voit que les invasions d‟insectes ou d‟animaux constituent un leitmotiv. Sans nécessairement lui donner une interprétation symbolique, la Comtesse Merlin évoquait déjà la présence fort déplaisante de moustiques assez voraces (« […] les moustiques impitoyables mettent ma patience à l‟épreuve. Mes bras, 826 Mirta Yáñez, Sangra por la herida, op. cit., p. 89. Ibid., p. 196. 828 Il s‟agit des huit lions en bronze de la rue du Prado qui prennent vie et dévorent tout sur leur passage. Cf ibid., p. 150. 827 273 mes mains sont dans un état déplorable […], je suffoque, je ruisselle, je meurs […].829). Dans Cocuyo, de Sarduy, ce sont les mites830 mais surtout les rongeurs qui envahissent la ville : « La ciudad estaba tan infectada por ellos [los ratones] que por la noche les pertenecía. Brotaban al crepúsculo, en procesiones lentas, con ojos brillantes, como atraídos por el olor del salitre »831. A la fin du roman, il est même question d‟une multitude de rats qui envahissent le port de La Havane : « Las hordas de roedores, como asistidas por una intuición infalible y gregaria, más precisa que todos los telégrafos, habían invadido desde la noche anterior las cloacas y los desagües todos del puerto, esperando el olor de los granos resecos para asaltar »832. Le lexique martial (« hordas », « asaltar ») suggère que leur présence est belliqueuse et nocive. L‟idée du châtiment est d‟autant plus prégnante à la fin de ce roman que les dernières lignes expriment le désir de vengeance de Cocuyo qui, après être entré dans une maison close, souhaite débarrasser le monde de son impureté : « Se juró volver, para exterminarlos a todos. Y a él mismo con ellos, y así limpiar el universo de tanto estiércol »833. Zoé Valdés parle aussi des rongeurs et des cafards qui infestent la ville à deux périodes différentes : « […] a finales de los ochenta, La Habana fue atacada por una plaga de cucarachas voladoras. […] Llegaron los noventa y la plaga se extinguió […]. En los noventa invadieron los ratones […] »834. La ville semble être continuellement à la merci des assauts d‟animaux nuisibles. Attaquée et affaiblie, La Havane l‟est aussi par les épidémies. Quelques auteurs font référence aux maladies meurtrières qui déciment la population. La pandémie de choléra qui s‟abat sur la capitale en 1833 est au cœur de la nouvelle « El cólera en La Habana » (1838), de Ramón Meza. Le narrateur y dresse un tableau fantasmagorique et apocalyptique de la ville tandis qu‟il évoque la lumière blafarde de l‟aube : […] si a esta claridad siniestra y funeraria se mezclaban los gemidos y maldiciones de los coléricos, el ruido de los carros, y la vista de los cadáveres y sus conductores, entonces llegaba a impresionarse el ánimo de manera que se le representaba todo aquello como una escena del infierno.835 829 La Comtesse Merlin, La Havane, T.I, op. cit., p. 314, 315. « […] el récamier devorado por las polillas », Severo Sarduy, Cocuyo, op. cit., p. 61. 831 Ibid., p. 17 832 Ibid., p. 175. 833 Ibid., p. 209. On rappellera qu‟il est également question de vengeance au début du roman puisque Cocuyo tente d‟empoisonner sa famille qui ne l‟aime pas. 834 Zoé Valdés, Te di la vida entera, op. cit., p. 187, 188. 835 Ramón Meza, « El cólera en La Habana », in Cuentos Cubanos, op. cit., p. 138. 830 274 L‟ouïe et la vue sont convoquées dans cette scène pour rendre palpable l‟atmosphère mortifère. L‟effroi et la désolation s‟imposent à la vue de ce funeste spectacle. Il est aussi question des ravages du choléra dans El polvo y el oro, de Julio Travieso. Cette pandémie semble être le fléau le plus meurtrier qu‟ait jamais connu la ville : La Enfermedad asaltó la ciudad, pronto aterrada por la cantidad nunca vista de muertes diarias. La Habana no sufría un huracán más, siempre terrible, pero pasajero en veinticuatro horas, no un incendio destructor, sino la Gran Epidemia, cuyo término y costo en víctimas humanas sólo Dios podría saber. La enfermedad estaba en la ciudad, en las alcobas de los blancos, en los barracones y cuartuchos de los negros, especialmente en los barrios de Jesús María, La Salud […] y el Manglar, en los cuales los cadáveres de los negros enfermos eran tantos que carruajes y tumbas no alcanzaban para los entierros.836 Plus dévastatrice qu‟un ouragan ou un incendie, la maladie extermine les Havanais avec une rigueur implacable : elle n‟épargne personne, même s‟il semble toutefois que les quartiers les plus populaires (où habite une population majoritairement noire) soient les plus touchés. Les majuscules (« Enfermedad », « Gran Epidemia »), l‟article défini (« la Gran Epidemia ») et enfin le caractère inédit du phénomène (« nunca vista ») marquent l‟intensité de cette catastrophe sanitaire. Au XXème siècle, ce sont le typhus et le sida qui sont évoqués de manière très ponctuelle. Reinaldo Arenas illustre l‟état d‟insalubrité de La Habana Vieja en rappelant qu‟une épidémie de fièvre jaune frappa le quartier dans les années quatre-vingt : […] se desató una epidemia de tifus en La Habana Vieja. Fidel Castro se paseó por todo aquel barrio y dijo que la enfermedad se debía a la gran cantidad de basura que había en la ciudad. En realidad, hacía más de tres años que no se recogía en aquella zona ; los edificios se derrumbaban y aquello era un verdadero paraíso para las ratas y toda clase de animales portadores de virus infecciosos.837 Aussi étrange que cela puisse paraître, le sida n‟est pas véritablement traité comme un fléau dans les textes qui nous occupent838. Il apparaît de manière sporadique lorsque sont évoqués ça et là des personnages malades ou susceptibles de l‟être (chez Pedro Juan Gutiérrez, par exemple). A ce propos, un cas retient particulièrement notre attention : Llueve sobre La Habana, de Julio Travieso, car, dans ce roman, c‟est l‟héroïne, Mñnica, qui est atteinte du 836 Julio Travieso, El polvo y el oro, op. cit., p. 197. Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 277. 838 Un recueil de dix-huit nouvelles traitant du sida à Cuba fut publié en 1997. Ces textes furent écrits par des malades internés dans le sanatorium « Villa de los Cocos ». La ville et le centre de santé y apparaissent de manière sporadique et superficielle. Voir Lourdes Zayón Jomolca et José Ramón Fajardo Atanes, Toda esa gente solitaria. Cuentos cubanos sobre el SIDA, Madrid, Ediciones La Palma, 1997. 837 275 virus. Le livre commence en évoquant sa maladie et sa mort ; tout le récit, ensuite, n‟est qu‟une analepse relatant la rencontre et les liens que tissent le protagoniste et cette jinetera. Au fil de l‟histoire, on apprend que c‟est un Mexicain qui a contaminé Mónica et une de ses amies, Malú. Malgré son refus initial, la protagoniste est finalement internée, comme tous les porteurs du sida, dans le centre « Los Cocos » (situé à l‟extérieur de la ville), où elle mourra peu après Malú. Dans ce roman, Travieso met en lumière la propagation ineluctable de cette maladie et le traitement réservé aux malades (ils sont traqués pour être ensuite enfermés afin de limiter les risques de contamination). Signalons, enfin, qu‟au motif de la contagion s‟ajoute celui de l‟intempérie, comme pour mieux signifier le châtiment. La pluie est effectivement récurrente dans le roman : celui-ci s‟ouvre sur une description des averses violentes qui frappent la ville839 et se clôt sur une image similaire840. De surcroît, le récit porte en épigraphe un vers de Verlaine où il est question de pluie : « Cae el llanto en mi corazón como la lluvia en la ciudad »841 ; et le titre du roman, bien sûr, n‟évoque pas autre chose. Outre les averses abondantes, c‟est l‟image d‟un climat capricieux et violent qui se dessine, de manière plus générale, dans notre corpus. Les cataclysmes naturels peuvent être envisagés comme un châtiment divin qui viendrait punir les Havanais. Ces catastrophes cycliques se répètent et frappent la population avec une violence inouïe. A cause du climat tropical, les cyclones s‟abattent périodiquement sur l‟Île, détruisant tout sur leur passage ; en témoigne cet extrait tiré de El siglo de las luces : En tal época del año, el Ciclón Ŕ designado así, en singular, porque nunca se producía sino uno que fuese desolador Ŕ era algo esperado por todos los habitantes de la urbe. […] Para quienes vivìan en la isla, el Ciclñn era aceptado como tremebunda realidad celeste, a la que, tarde o temprano, nadie escapaba.842 S‟il est attendu et ne surprend personne, l‟ouragan n‟en demeure pas moins dévastateur et imprévisible. Le fatum qui transparaît dans ces lignes place l‟homme dans une position de passivité et d‟impuissance face aux forces de la nature qui le rend vulnérable, à l‟image de la ville qui subit les assauts de la tempête. La description qu‟en fait Carpentier est en cela éloquente : 839 « Llovía con fuerza, como llueve en La Habana durante la temporada de lluvias, con violencia y rapidez, en gruesas gotas que repiqueteaban sobre techos y calles […] », Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 7. 840 « A lo lejos unos nubarrones venían hacia nosotros. Pronto volvería a llover sobre La Habana », ibid., p. 309. 841 Ibid., p. 7. Le vers original est : « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». 842 Alejo Carpentier, El siglo de las luces, op. cit., p. 60, 61. 276 Fue poco después de la medianoche cuando entró el grueso del huracán en la ciudad. Sonó un bramido inmenso, arrastrando derrumbes y fragores. Rodaban cosas por las calles. Volaban otras por encima de los campanarios. Del cielo caían pedazos de vigas, muestras de tiendas, tejas, cristales, ramazones rotas, linternas, toneles, arboladuras de buques. Las puertas todas eran golpeadas por inimaginables aldabas. Tiritaban las ventanas entre embate y embate. Estremecíanse las casas de los basamentos a los techos, gimiendo por sus maderas.843 Fond et forme collaborent ici étroitement puisque l‟hyperbole, les énumérations, la personnification des habitations, les nombreux verbes d‟action, la mise à contribution de l‟ouïe et de la vue, permettent de rendre la violence de la scène. La prose foisonnante et sonore (allitérations en « s », « r » et « t », ponctuation rythmique) de l‟auteur traduit le vacarme du cataclysme. Avant Carpentier, d‟autres écrivains s‟étaient appuyés sur les mêmes procédés littéraires pour décrire un ouragan. Enrique Serpa représentait un véritable monstre pour parler du cyclone qui menaçait la ville : « Un fantástico remolino de viento y agua, de angustia y muerte, de ruina y desolación. Un monstruo de cien brazos, de mil brazos, de cien mil millones de brazos, con ansias de destrucción, con hambre de vidas humanas »844. La comparaison avec une créature effrayante (sorte de pieuvre gigantesque) et le style emphatique rendent la tempête surnaturelle. Dans Fotuto, Miguel de Marcos décrivait sur plusieurs pages les ravages provoqués par le fameux « cyclone de 26 », qui frappa Cuba le 20 octobre 1926. Comme nous l‟avons déjà remarqué dans notre première partie, la vulnérabilité de la cité y est manifeste, et ce dès le début de la tempête : Las puertas temblaban gelatinosas […]. Eran las primeras ráfagas. […] Escuchó un estallido que lo puso de pie. Era un techo de cinc de alguna casa vecina, una lámina que, en acrobacia, desde treinta metros de distancia, por una fantasía ciclónica o por la agilidad aérea del metal, había venido a caer en el patiecillo de Fotuto. Ahora la lluvia torrencial convertía la escueta lámina en parche metálico de tambor, arrancándole redobles siniestros de atroz resonancia. Pero el viento, el viento de las furias, de las vorágines y de los torbellinos, le extirpó a la lluvia su juguete, y cogiendo el techado de cinc lo convirtió en proyectil, tirándolo rabiosamente contra las puertas.845 Comme chez Carpentier, emphase, personnification, verbes d‟action, adjectifs, adverbes, répétitions et pluriels participent à la création d‟une scène apocalyptique qui est d‟autant plus brutale que les éléments semblent entrer en compétition pour s‟amuser de la fragilité de la ville. Car La Havane n‟est plus qu‟un précaire décor en carton-pâte où les portes et les toits 843 Ibid., p. 62. Enrique Serpa, Contrabando, op. cit., p. 96. 845 Miguel de Marcos, Fotuto, op. cit., p. 311. 844 277 volent en éclats846. Elle n‟abrite plus mais devient même une menace pour les habitants. Un peu après, un passage suggère explicitement qu‟il pourrait s‟agir d‟un châtiment divin : Las ráfagas adoptaban todas las formas : látigo, remolino de locura, espiral en crispación inexhausta, tromba y escalera de caracol, una escalera de caracol, retorcida, vertiginosa, con mil demonios implacables en cada uno de sus peldaños. Ah, castigo de Dios, decían algunas personas, mientras impetraban la divina misericordia. ¿ Castigo de Dios ? ¿ Por qué ? La Habana no cometiera ningún pecado, desde el 25 de julio de 1515 a la fecha.847 Une forte adjectivation souligne la violence du cyclone. L‟image du tourbillon dévastateur, déjà présente dans l‟extrait précédent, renforce le côté infernal de la scène et montre que les hommes n‟ont plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Parce qu‟ils se trouvent assujettis aux forces de la nature, certains invoquent Dieu et sollicitent sa pitié, considérant qu‟il punit ainsi la ville (« látigo », « castigo », « pecado » marquent le châtiment). Même si le narrateur réfute cette interprétation des faits (selon lui, La Havane n‟a commis aucune faute depuis sa toute première fondation), l‟idée d‟une intervention divine se fait jour dans ces lignes. Le caractère injuste de ce désastre apparaîtra avec plus de vigueur quand la fille de Fotuto sera emportée par les eaux torrentielles. Chez Padura, nous retrouvons le caractère cyclique et inévitable de l‟ouragan saisonnier ainsi que l‟idée du châtiment divin. Dans Paisaje de otoño, qui se déroule, comme son nom l‟indique, en automne pendant la période des tempêtes tropicales, il est question d‟un ouragan qui menace : […] aquel preciso y cabrñn ciclñn podìa entrar dentro de pocos dìas por estas calles y demoler la belleza decrépita de esas segundas y terceras plantas […]. ¿ Cuál podìa ser el destino de aquella ciudad sino esa muerte violenta […] ? ¿ O también morirá castrada, nueva Atlántida hundida en el mar por un pecado imperdonable aunque todavía desconocido ? 848 Le narrateur insiste sur la précarité du paysage urbain et le danger permanent qui guette Cuba. Une disparition complète et violente semble certaine puisque les deux questions posées n‟envisagent pas autre chose. L‟évocation de l‟île mythologique de l‟Atlantide renforce l‟idée 846 La fragilité de la ville qui, telle une maquette, est balayée par la tempête apparaît très clairement aussi dans Cocuyo : « Bajo la lluvia, la ciudad le pareció un tejido de bandas diagonales, de todos los colores pulverizados, pegadas sobre un fondo de cartñn blanco […]. El viento soplaba con tal fuerza que arrancaba los aleros de tajo. Volaban las tejas, manchones rojos en el gris de la lluvia, como semillas de granada ; se pulverizaban contra los zócalos y las fachadas de azulejos. Los granizos azotaban el ventanal vendado con un redoble estridente y metálico, minúsculos tambores de hojalata », Severo Sarduy, Cocuyo, op. cit., p. 24, 25. 847 Miguel de Marcos, Fotuto, op. cit., p. 320. 848 Leonardo Padura Fuentes, Paisaje de otoño, op. cit., p. 46, 47. 278 d‟une mort annoncée qui serait le fruit d‟un châtiment (« un pecado imperdonable »)849. Un dernier exemple corrobore cette interprétation biblique des intempéries : la fin du roman de Pedro Juan Gutiérrez, El rey de La Habana. Des pluies torrentielles s‟abattent sur la ville et provoquent l‟effondrement des immeubles (dont celui de Magda, l‟héroïne), tuant ainsi de nombreuses personnes850. Parce qu‟il provoque un dénouement aussi tragique qu‟effroyable, ce cataclysme peut se lire comme le Déluge provoqué par Dieu, dans la Genèse, pour punir les hommes qui avaient corrompu la Terre. En effet, il semble mettre un point final aux errances des deux personnages, Rey et Magda, qui survivent in extremis à l‟éboulement de leur immeuble. Après un court sursis passé aux abords d‟une décharge, Rey finira par tuer sauvagement Magda, dont le corps sera mangé par les rats, puis lui aussi mourra et finira dévoré par les charognards. La fin terrible de ces deux antihéros semble rétablir un certain ordre moral : Rey paraît expier ses crimes à travers la longue agonie qui précède sa mort. L‟importance du substrat biblique dans notre corpus ne fait aucun doute à la lecture de ces extraits qui envisagent La Havane comme une cité pécheresse qu‟il faut punir. La ville et ses habitants doivent payer pour leurs fautes et nulle rédemption n‟est possible. La Havane est donc damnée et vouée à périr en enfer. Chapitre 3 : L’enfer havanais 1- Composition de l‟enfer a- Un climat hostile Le motif du locus terribilis est très présent dans les textes de notre corpus, et ce dès le XIXème siècle. Les évocations d‟un espace apocalyptique sont légion et construisent une cité impossible dont le référent symbolique n‟est plus le purgatoire mais bel et bien l‟enfer. Nous nous proposons, dans ce chapitre, d‟analyser les éléments constitutifs de ce lieu infernal, d‟étudier son fonctionnement pour enfin dégager quelques-unes des pratiques spatiales qu‟il impose. 849 Le destin est à l‟œuvre également dans El navegante dormido, d‟Abilio Estévez, puisque toute l‟intrigue se construit autour de l‟attente d‟un cyclone qui se révèlera destructeur et mortel (l‟un des personnages, Jafet, perdra la vie en mer alors qu‟il tentait de fuir l‟Île sur un canot). 850 « Era zona de catástrofe. Decenas de edificios desplomados. Nadie sabía cuántos muertos y cuántos heridos había », Pedro Juan Gutiérrez, El rey de La Habana, op. cit., p. 203. 279 Le climat hostile est l‟un des composants de ce locus horridus. Outre les intempéries que nous venons d‟étudier, la chaleur excessive rend la ville insupportable. Même la Comtesse Merlin ne manque pas de rappeler que la chaleur accablante empêche tout mouvement : « L‟activité et les jouissances de la vie ne commencent à La Havane qu‟à l‟approche de la nuit. Pendant la journée on languit sous le poids du soleil ; et jamais, que je sache, un Havanais n‟a fait vingt pas dans la rue à midi »851. Elle ne dit pas autre chose dans La Havane : « La chaleur est excessive ; le vent souffle comme d‟une fournaise ; tout travail devient impossible »852. Quelle que soit la période de l‟année, la chaleur écrasante paralyse la ville car il ne semble pas y avoir de saison à La Havane. Ainsi, bien plus tard, Estévez parle à plusieurs reprises d‟un été qui est continu : « No importaba que en La Habana el verano no tuviera principio ni fin : a aquella eterna canícula se le intentaba otorgar la digna parcelación de las estaciones »853. Cette chaleur accablante lui donne l‟occasion d‟ironiser sur les touristes qui sont ravis de trouver un tel climat : Con la luz de La Habana sucede como con su clima. « ¡ Qué maravilla ! », exclaman los turistas que llegan de las zonas templadas de Europa o de los nortes helados. « ¡ Qué maravilla ! ¡ Esta calidez no acaba nunca ! ¡ Este verano permanente… ! ¡ Poder ir de playa todo el año ! ¡ Aguas esmeraldinas y transparentes bajo un sol de gloria ! » Uno de los eslóganes famosos de las compañías cubanas de turismo rezaba (o reza) « ¡ Cuba, un eterno verano ! » […] Y en cuanto a los turistas, no hay uno, por más susceptible que sea, que desee detenerse a pensar en la atrocidad de ese sol perpetuo, que jamás atempera su violencia […]. Así sucede con esta plaga de La Habana que es la luz. La inexistencia de La Habana viene de su luz. La luz, tan rabiosa, descompone colores, contornos y hasta la materia misma de las cosas. Una luz de tal virulencia desintegra, desde su centro mismo, cualquier objeto.854 Le narrateur reprend les exclamations des touristes et les slogans des campagnes promouvant le tourisme à Cuba pour mieux les moquer. Ce qui fait le bonheur des uns devient cauchemardesque pour les autres, ainsi que le montre le style antithétique de cet extrait qui oppose les expressions laudatives au champ lexical de la cruauté (« atrocidad », « violencia », « plaga »). Par ailleurs, cette chaleur écrasante a pour corollaire une lumière solaire agressive et destructrice. Aveuglante, cette dernière empêche de distinguer les formes et les couleurs, de 851 La Comtesse Merlin, Souvenirs et mémoires de Madame la Comtesse Merlin. Souvenirs d’une créole, op. cit., p. 61. 852 Id., La Havane, T.I, op. cit., p. 313. 853 Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 33. Cette idée apparaissait déjà dans Los palacios distantes : « […] en La Habana la única estación es el verano, un verano eterno, sólo interrumpido por las turbonadas que se encargan de realzar, con mayor eficacia, los vapores del suelo », Abilio Estévez, Los palacios distantes, op. cit., p. 49. 854 Id., Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 173, 174. 280 sorte que la ville devient une image évanescente vouée à disparaître complètement855. La Havane est donc anéantie sous l‟effet de la chaleur et de la lumière et devient un espace infernal : « [...] a este calor húmedo, nadie se acostumbra, ni el paso de los años convierte en hábito este infierno »856. La comparaison étant évidente, immanquablement le climat havanais est associé à l‟enfer. Il serait fastidieux et sans intérêt de citer ici plusieurs occurrences de ce lieu commun ; signalons simplement une formule de Cabrera Infante qui synthétise parfaitement cette idée : « […] nuestro cielo era nuestro infierno »857. Pour matérialiser encore davantage cette chaleur insupportable, quelques auteurs vont comparer La Havane à un volcan. La Comtesse Merlin, tout d‟abord, parle d‟une atmosphère qui « brûle comme la lave enflammée de l‟Etna »858 avant de convoquer le Vésuve : « Voilà les rues de La Havane ; Herculanum et Pompéi n‟étendent pas sous le soleil une poussière plus ardente et plus déserte »859. Plus tard, et surtout pour des raisons morales, Amir Valle fera dire à son personnage Alex Varga : La Habana es como un volcán […]. El espectáculo de un volcán en erupciñn es una de las cosas más hermosas que hay… claro, visto desde lejos, desde fuera. Debajo de esa erupción, en las entrañas ardientes del volcán, está la semilla de tanta belleza […]. Toda la mierda y el desecho de siglos y siglos de la tierra acumulado y recalentado allí, para lograr ese líquido hermoso pero letal que es la lava.860. La métaphore filée du volcan (éruption, cratère, magma et lave) fait de La Havane un véritable Pandémonium, au sens propre comme au figuré. Capitale de l‟enfer, la ville est aussi un espace chaotique et corrompu qui fascine à condition d‟être vu de l‟extérieur et de ne pas y vivre. b- Une saleté paroxystique Comme le suggère la citation d‟Amir Valle, la capitale est infernale à plus d‟un titre. Outre le climat, les mœurs des habitants participent aussi à la construction d‟un territoire hostile. Il ne 855 Chez Severo Sarduy c‟est l‟association de la chaleur et de l‟humidité qui attaque la ville et la fait disparaître comme le ferait un acide : « La humedad y el calor, como un ácido, habían corroído las fachadas encaramadas las unas encima de las otras ; cascarones morados, como postillas o chancros supurantes, se desprendían de dinteles incompletos, pórticos triangulares y resquebrajadas volutas », Severo Sarduy, Cocuyo, op. cit., p 102. 856 Abilio Estévez, Los palacios distantes, op. cit., p. 236. Un peu plus loin, il ajoutera : « El calor puede ser infernal », ibid., p. 248. 857 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 285. 858 La Comtesse Merlin, La Havane, T.I, op. cit., p. 309. 859 Id., La Havane, T.III, op. cit., p. 59, 60. 860 Amir Valle, Largas noches con Flavia, Cordoue, Editorial Almuzara ; « Tapa negra », 2008, p. 121. 281 s‟agit bien évidemment pas de répéter ce qui a déjà été dit dans notre chapitre précédent, au sujet du rôle pervertisseur de La Havane, mais d‟aller plus loin en montrant comment la capitale cubaine devient un espace abject. Insalubrité et saleté semblent y être, en effet, particulièrement exacerbées. L‟aspect repoussant de la ville frappait déjà au XIXème siècle. On se souvient des propos du naturaliste allemand, Alexander von Humboldt, qui présentaient une Havane désagréable et malodorante : A l‟époque de mon séjour, peu de villes de l‟Amérique espagnole offraient […] un aspect plus hideux. On marchait dans la boue jusqu‟au genou ; la multitude de calèches ou volantes, qui sont l‟attelage caractéristique de La Havane, les charrettes chargées de caisses de sucre, les porteurs qui coudoyaient les passants, rendaient fâcheuse et humiliante la position d‟un piéton. L‟odeur du tassajo ou de la viande mal séchée empestait souvent les maisons et les rues tortueuses. 861 A l‟image du géographe allemand, l‟étranger qui découvre La Havane pour la première fois est surpris par ses rues sales. C‟est en ces termes que le narrateur de Un hombre de negocios (1882), de Nicolás Heredia, exprime la désillusion de l‟immigré : « Llega el forastero ; entra por La Habana vieja ; ve sus calles sucias y estrechas ; sus casas gachas e indecentes […] y experimenta una decepción tan profunda como exageradas eran las ilusiones concebidas »862. Le jeune Vicente Cuevas de Mi tío el empleado (1887) ira même plus loin en comparant les rues insalubres de la ville aux personnes qui les peuplent : « […] seguimos […] por algunas calles estrechas poco limpias, en donde algunos hombres […] no se hallaban en mejor estado que las calles »863. Même les écrivains contemporains évoquent la saleté des rues pour décrire la ville du XIXème siècle. On pense, par exemple, à Julio Travieso, dans El polvo y el oro (1993), ou encore à Zoé Valdés, dans Los misterios de La Habana (2004). Ainsi, quand cette dernière imagine la ville de 1836, celle qu‟ont connue Heredia et Domingo del Monte, elle écrit : [Domingo del Monte] reparó en que una Habana muy sucia recibiría a Heredia : pobremente iluminada, charcos de fango impedían el paso de los vehículos en las calles de tierra. Era una ciudad nauseabunda, pululante, de mendigos, cuatreros, enfermos de la fiebre amarilla, lomas de basura apestaban por doquier. En el muelle se amontonaba el pescado podrido.864 861 Alexander von Humboldt, Essai politique sur l’île de Cuba, op. cit., p. 5. Nicolás Heredia, Un hombre de negocios, op. cit., p. 13. 863 Ramón Meza, Mi tío el empleado, op. cit., p. 24. 864 Zoé Valdés, Los misterios de La Habana, op. cit., p. 29, 30. 862 282 Chez Valdés aussi les rues sont à l‟image de leurs habitants : crasseuses et répugnantes, comme le soulignent les verbes et les adjectifs. Par ailleurs, les énumérations permettent d‟accentuer, du point de vue formel, l‟accumulation des détritus. Malgré les améliorations urbanistiques apportées par Tacón et les politiques hygiénistes, la saleté continuera à caractériser La Havane des XXème et XXIème siècles. Tout est repoussant, les rues, les immeubles, le port et le fleuve Almendares : Más allá de los árboles corría el río, muy abajo, hediondo ya de mosto cuando llega el puente, sucio, cargado de una nata verde que sol pudre y que como nunca llueve jamás se diluye. […] Más allá del parque, entre los árboles, se veía negrear el río, casi detenido e infecto, despidiendo un vaho húmedo de calor y mal olor.865 Même la nature est contaminée, putride et source de relents pestilentiels. L‟odorat et la vue ne sont convoqués que pour renverser le cliché qui voudrait que cet endroit excentré et verdoyant, qui plaît par ailleurs beaucoup aux Havanais, soit bucolique. Sous la plume de Casey, le fleuve et ses rives verdoyantes ne sont donc plus qu‟un antre dégoûtant. Avec la période spéciale, la description de la saleté urbaine se fait récurrente et outrancière puisqu‟elle est, en partie, l‟un des matériaux de la « littérature du désenchantement ». Les écrivains qui émergent alors (les « novísimos » puis « posnovísimos », selon l‟appellation de Salvador Redonet), se plongent dans les bas-fonds de La Havane et scrutent les milieux interlopes et marginaux, peuplés de drogués, prostitué(e)s, travestis, friquis866. En un mot, ils dissèquent cette Havane underground qu‟Ena Lucía Portela a qualifiée de « capitale du désastre »867 et à l‟intérieur de laquelle les conditions de vie sont inhumaines868. Ainsi, ordures, détritus et immondices en tout genre envahissent l‟espace, matérialisant l‟état de décomposition de la société, à partir des années quatre-vingt-dix. Un des personnages d‟Ena Lucía Portela exprime parfaitement cette déliquescence à la fois physique et morale : « […] porque no había agua ni presente ni futuro ni opciones y sí un calor del coño de su madre y tremenda porquería y edificios a punto del derrumbe y otros ya derrumbados y escombros y churre y peste y apagones y una pila de bichos y… »869. Le zeugme, qui réunit ici le concret (l‟eau) et l‟abstrait (le présent, le futur, les options), est tout à fait caractéristique du style 865 Calvert Casey, « Amor : El río Almendares ahora en sus edad madura tiene 12 millones de años », El regreso y otros relatos, Barcelone, Editorial Seix Barral, 1967, p. 172. 866 Friqui vient de l‟anglais freak et qualifie les personnes excentriques, aux mœurs étranges. 867 Ena Lucía Portela, Cien botellas en una pared, op. cit., p. 161. C‟est nous qui traduisons. 868 Zoé Valdés parle de « […] condiciones infrahumanas en que vive esta gente », Zoé Valdés, Te di la vida entera, op. cit., p. 296. 869 Ena Lucía Portela, Cien botellas en una pared, op. cit., p. 166, 167. 283 ironique de l‟auteur. Dans cette litanie, la répétition de la négation « ni » et de la conjonction « y » oppose les nombreuses privations à l‟excès de décombres et de crasse. Ce phénomène paraît répondre au principe des vases communicants : à mesure que le néant grandit (pénuries et nihilisme), la ville croule sous les ruines et la saleté. Par ailleurs, les pluriels, les répétitions, le polyptote (« derrumbe », « derrumbados ») et l‟oralité hyperbolique (« tremenda », « del coño de su madre ») témoignent de la décrépitude extrême de la ville. Chez Padura, ces quartiers délabrés et crasseux matérialisent les cercles de l‟enfer que Mario Conde doit traverser au gré de ses enquêtes : De inmediato empezó a entender la afirmación de Yoyi el Palomo de que los dominios del Barrio Chino eran apenas los primeros círculos del infierno citadino, pues una primera mirada le hizo patente que estaba penetrando en el núcleo de un mundo tenebroso, un hoyo oscuro que allí perdía el fondo y hasta las paredes. Respirando una atmósfera de peligro latente, avanzñ por un laberinto de calles intransitables […] ; de latones desbordados de desperdicios, como montaðas infectas […] ; de jaurìas de perros deambulantes, invadidos de sarna […]. Una sensaciñn de estar atravesando los límites del caos le advirtió de la presencia de un mundo al borde de un Apocalipsis difícilmente reversible.870 Nous avons vu, dans notre première partie, que La Havane de Padura ressemblait à l‟enfer de La Divine Comédie puisqu‟elle se composait de strates. En pénétrant dans le quartier d‟Atarés, situé derrière le port, le détective atteint le centre de la Terre, le cœur de l‟enfer dantesque, comme le suggèrent les allusions finales au chaos et à l‟Apocalypse. Dans ce territoire caverneux, obscur, inquiétant et plein d‟immondices, tout est en putréfaction, à l‟image de ces chiens galeux errants. L‟enchaînement de propositions assez longues, qui se caractérisent par une forte adjectivation, donne à voir une réalité à ce point inconcevable qu‟elle impressionne le personnage de Conde, pourtant aguerri aux duretés de la ville. Si ce dernier pénètre ponctuellement dans les marges infernales de la société cubaine, le personnage de Pedro Juan, dans les autofictions de Gutiérrez, lui, y vit au quotidien. Le narrateur, qui habite dans Centro Habana Ŕ quartier qu‟il qualifie de « profundidades del infierno »871 ou encore de « barrio diabólico »872 Ŕ décrit de manière lancinante cette crasse omniprésente car elle constitue la matière première de son écriture873. Son quotidien est donc fait de « mugre, cochambre, desidia, abandono »874 et pour survivre, il tente de fuir ce qu‟il qualifie lui-même 870 Leonardo Padura Fuentes, La neblina del ayer, op. cit., p. 208. Pedro Juan Gutiérrez, El insaciable hombre araña, op. cit., p. 104. 872 Ibid., p. 84. 873 « Mi materia sigue anclada entre los escombros », id., Animal tropical, op. cit., p. 20. Il considère aussi qu‟il est « un revolcador de mierda », id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 104. 874 Id., Animal tropical, op. cit., p. 20. 871 284 d‟apocalypse875. Décrite à travers le prisme du réalisme sale, La Havane n‟est plus qu‟une décharge à ciel ouvert, un territoire en putréfaction fait d‟excréments et de déchets. Ainsi, les cages d‟escaliers des immeubles sont nauséabondes, en témoigne l‟évocation des odeurs présentes dans un ascenseur : « una peste permanente a orina, porquería y a los vómitos diarios de un borracho del cuarto piso »876. Cette saleté est accentuée par un phénomène déjà abordé : l‟élevage de bêtes au cœur même des appartements. L‟absurdité de la « ruralisation » de la ville est rendue, avec humour, par Zoé Valdés : « los animales se educan para los apartamentos y los hombres para las granjas »877. En plus d‟être saugrenue et intempestive878, cette présence animale rend le décor urbain encore plus insalubre : Los olores de la mierda de los pollos y los puercos empezaron a atraer más cucarachas. Siempre hubo cucarachas, pero ahora eran más. Y las ratas : unos bichos grandísimos que subían desde el sótano del edificio, casi cuarenta metros. Subían por los tragantes pluviales, corrían hasta las jaulas a comer las cáscaras y los desperdicios, y de nuevo se lanzaban abajo, a guarecerse.879 Sans revenir sur l‟aspect symbolique de l‟infestation par les cafards et les rats, disons que la ville, en cèdant du terrain aux bêtes agricoles et aux nuisibles, perd l‟urbanité qui lui est propre et devient un espace aussi absurde que malsain. Avec le réalisme sale, la saleté s‟étend évidemment bien au-delà des immeubles ; elle gagne toute la ville et n‟épargne rien, pas même la mer du Malecón qui est contaminée par la « merde »880 : « Se tiran [los muchachos del barrio] en el agua sucia del litoral, mezclada con petróleo y grasa de los barcos, y mierda y orina de la ciudad. Las aguas servidas van a parar al mar [...]. Ignoran la peste a cloaca y se divierten »881. Cet univers fait d‟ordures en décomposition est élevé à son comble à la fin du roman El rey de La Habana, quand Rey et Magda trouvent refuge à quelques mètres d‟une décharge : « El enorme basurero de la ciudad, a unos cien metros, emitía un hedor insoportable, nauseabundo. Rey olfateó y se sintió a gusto. Los olores de la miseria : mierda y pudrición »882. Comme le souligne cette dernière phrase, la fange nauséabonde est donc la 875 Loc. cit. Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 30. 877 Zoé Valdés, La nada cotidiana, op. cit., p. 179. 878 Voici ce qu‟écrit Ena Lucìa Portela au sujet de ces élevages : « Los recién habitantes, muchos de ellos con acento oriental y desconocedores de los usos urbanos, aportaron una nueva fauna, insólita en el paisaje citadino : gallinas, pavos, palomas, jicoteas, un cerdo, un chivo […]. Todas estas criaturas hacen pipì y caca donde mejor les parece, como si habitaran en la floresta. […] el solar huele a jungla, a naturaleza agreste, a salvajismo », Ena Lucía Portela, Cien botellas en una pared, op. cit., p. 42. 879 Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 96. 880 Ce terme est récurrent dans la prose de Pedro Juan Gutiérrez. 881 Ibid., p. 282. 882 Id., El rey de La Habana, op. cit., p. 207. 876 285 matérialisation de la misère, et Rey, personnage marginal s‟il en est, s‟y sent bien car il ne connaît que ça. Sous la plume de Gutiérrez, la crasse mais aussi la putréfaction gagnent les personnes. Les corps sont sales, sentent mauvais, sont infestés de poux et de morpions, comme ceux de Rey et Magda, justement : A ninguno le molestaba la suciedad del otro. Ella tenía un chocho un poco agrio y el culo apestaba a mierda. El tenía una nata blanca y fétida entre la cabeza del rabo y el pellejo que la rodeaba. Ambos olían a grajo en las axilas, a ratas muertas en los pies, y sudaban.883 C‟est avec beaucoup de détails et sans concession aucune que le narrateur décrit ces corps crasseux tout à fait repoussants. Cet exemple suffira certainement à montrer que, dans le réalisme sale, la crudité du langage est à l‟image de l‟abjection décrite. Et Gutiérrez ira même encore plus loin, à la toute fin du roman, en passant de l‟abject à l‟effroyable, en troquant la crasse pour la putréfaction. C‟est le corps de Magda, tout d‟abord, qui se décompose après que Rey l‟a tuée (« la putrefaccón del cadáver », « La peste de Magda hedionda », « la carroña » 884). Puis c‟est au tour de Rey de pourrir avant d‟être dévoré par les charognards (« su cuerpo ya se pudría », « El cadáver se corrompió » 885). Déchets, ordures et pourriture sont la preuve matérielle d‟un monde décadent et putréfié. La Havane comparée à une décharge en état de décomposition constitue également le thème central d‟un très court texte d‟Antonio José Ponte : « Dos basureros ». Cette élégie qui ne dit pas son nom commence ainsi : « Aflora la basura acumulada durante muchos años [...].Y alrededor, como hierba entre árboles, crece la mierda. […] Vivimos en medio de toda esta mierda. […] »886. Le texte se termine sur la disparition complète de la ville qui semble inévitable puisque la capitale n‟est plus que « un chiquero », « una porquería » ou encore « [un] paisaje de basuras »887. Avec la crise des années quatre-vingt-dix, la saleté de la ville semble avoit atteint son degré le plus élevé en littérature car elle sert le projet d‟un nouveau discours narratif qui, obsédé par le ici et le maintenant, crée un « réel-angoissant »888. 883 Ibid., p. 55. Ibid., p. 216. 885 Ibid., p. 218. 886 Antonio José Ponte, « Dos basureros », in Nexos, n°292, Avril 2002, p. 31. 887 Ibid., p. 32. 888 Expression de Rogelio Riverón citée par Jorge Fornet, in Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas Prólogo narrativo al siglo XXI, op. cit., p. 98. 884 286 c- La misère humaine Un autre aspect de cette écriture du réel est l‟intérêt porté à la misère et aux drames humains. La pauvreté urbaine n‟est bien évidemment pas l‟apanage de la période spéciale et nombreux sont les personnages démunis et accablés qui peuplent les fictions de notre corpus. On se souvient, par exemple, de l‟histoire du jeune Juan Cabrera, dans Juan Criollo (1928), de Loveira, dont l‟enfance est marquée par une succession d‟infortunes. Vivant très chichement dans un quartier infâme des faubourgs de la ville889, Juan doit aider sa mère qui est contrainte de se prostituer, après avoir été bannie de l‟hospice qui l‟employait. Emprisonnée injustement après un meurtre, Josefa Valdés laisse son fils à des voisins tout aussi démunis qu‟elle, puis Juan est finalement recueilli chez Don Roberto, avant que sa mère ne meure. Avec un style pathétique, Loveira décrit la terrible existence de cette mère et de son fils qui tentent de faire face aux circonstances. On peut également penser aux femmes de Las impuras (1919), de Carrión, Teresa et Florinda. La maîtresse et l‟épouse de Rogelio subissent toutes deux l‟inconstance et l‟inconséquence de cet homme joueur et volage. La tension dramatique va crescendo tout au long du roman jusqu‟au chapitre final intitulé d‟ailleurs « ¡ Señor ! ¡ Señor ! ¿ Por qué nos abandonas ? ». Dans cette sorte d‟acmé, la fille de Rogelio et de Florinda, Llillina, meurt des suites d‟une longue maladie et Teresa doit se prostituer pour payer les funérailles que Florinda ne peut régler toute seule (Rogelio l‟a abandonnée en fuyant La Havane). Comme pour la saleté, la misère humaine occupe une place de plus en plus importante dans la littérature à partir des années quatre-vingt-dix. On ne s‟étonnera pas qu‟avec la crise aiguë qui frappe le pays et bouleverse le quotidien des Cubains, la pauvreté devienne une récurrence dans les récits de fiction, car l‟indigence se progage dans toute la société et atteint des sommets sans précédent. Privations, faim, pénuries et apagones890 sont le lot quotidien des Havanais et l‟opulence n‟est plus qu‟un très lointain souvenir : ¿ Te acuerdas de las colas para tomar frozen, cuando este helado aguado irrumpió e hizo furor en la isla ? ¿ Te acuerdas de los cakes-helados en la heladerìa de Prado y Neptuno ? […] ¿ Te acuerdas de las croquetas Soyuz 15, que se pegaban en el cielo de la boca ? ¿ Te acuerdas de la cafetería de la Manzana de Gómez ? ¿ Te acuerdas de los tallarines ? […] ¿ Te acuerdas de los panes de gloria, de los mojones de Perico destilando 889 « Habitaba con su madre una casucha de madera y zinc, en lo que era entonces una orilla de La Habana : la pina calle del Príncipe, cerca del litoral, en aquellas fechas huérfano de asfaltado, malecón y palacetes ; abundante de charcos, basuras y construcciones como la tal casucha », Carlos Loveira, Juan Criollo, op. cit., p. 5. 890 Coupures d‟électricité. 287 hirviente diarrea de mermelada de guayaba en el chinchalito de la calle Obispo ? ¿ Te acuerdas del Palacio de las Moscas : la pizzería Europa ?891 En associant tout ce qu‟elle mangeait à un lieu très précis, la narratrice de La nada cotidiana fait de La Havane un lieu d‟abondance. L‟anaphore insiste sur la profusion d‟aliments tout en rendant les souvenirs obsédants, car il s‟agit pour elle de fuir le présent et les pénuries pour se tourner vers le passé et revivre ces moments de plaisir. Dans cette lettre qu‟elle adresse à son amie exilée, « La Gusana », la narratrice parlait peu avant des coupures d‟électricité qui l‟empêchent de travailler, des transports inexistants, du manque d‟eau courante et du paysage urbain métamorphosé par le contexte économique : La Habana está triste, desvencijada, hecha leða. Mira p‟allá, un muchacho de treinta años armado de una cuchara hurga en el latón de basura de G y 17. Expurga cuidadosamente en los nailones grasientos y devora sin el menor escrúpulo las sobras podridas que encuentra. […] Es cierto que en toda la América Latina se pasa un hambre de pinga, pero ellos no hicieron la Revolución.892 Le spectacle des gens qui, poussés par la faim, fouillent dans les poubelles lui donne l‟occasion de remettre en question les acquis de la Révolution. Elle explique que tous les efforts faits depuis 1959 restent vains car Cuba ressemble à présent à n‟importe quel autre pays pauvre du sous-continent. La faim, qui est l‟une des conséquences directes de la crise, apparaît également chez Ena Lucía Portela, dans Cien botellas en una pared, puisque la protagoniste, Zeta, l‟évoque avec un certain dramatisme non dépourvu d‟humour : « […] capturé las papas. ¡ Ja ! Sin duda era mi día de éxitos, mi gran día. Porque en La Habana la hora de las papas es más incierta que la hora de la muerte »893. En pleine période spéciale, avoir des pommes de terre est devenu une victoire sur le quotidien894. En revanche, l‟humour n‟a plus lieu d‟être dans le réalisme sale de Pedro Juan Gutiérrez car, une fois de plus, ce style littéraire se ditingue par la quantité et l‟acuité des cas tragiques qu‟il expose. C‟est sans pathos aucun que le narrateur relate des situations dramatiques et désespérées qui ont souvent pour cause la misère. La mère du protagoniste explique à ce propos : « Ay hijo, no son tragedias. Es que la vida se ha puesto así. Hay una pobreza muy grande y no hay de dónde sacar dinero y ... »895. Les exemples de vies tragiques sont donc légion dans les nouvelles de 891 Zoé Valdés, La nada cotidiana, op. cit., p. 102. Ibid., p. 101. 893 Ena Lucía Portela, Cien botellas en una pared, op. cit., p. 130. 894 Un peu plus loin, la narratrice ajoutera : « Porque demasiados tipos estaban pasando un hambre de tres pares de cojones […] », ibid., p. 166. 895 Pedro Juan Gutiérrez, El insaciable hombre araña, op. cit., p. 126. 892 288 l‟auteur. Nous pensons, par exemple, à ce clochard alcoolique qui a vu ses deux fils mangés par des requins alors que tous deux tentaient de fuir le pays. Il finira lui-même dévoré par les charognards et les rats après avoir confié à Pedro Juan : « Tengo ganas de morirme »896. La malédiction s‟acharne sur certains sans leur accorder de répit, comme en témoigne la vie de Rogelio qui n‟est qu‟une succession de drames. Elle commence par la mort de sa mère, coupée en petits morceaux par un amant, alors qu‟il avait huit ans. Adulte, il est continuellement trompé par sa femme. A sa mort, il laisse une épouse gravement malade, un fils emprisonné et une fille prostituée897. De nombreuses « tragédies sans solution »898 semblent condamner les Cubains dans l‟Île mais aussi lorsqu‟ils sont en exil. Tatiana, par exemple, se voit contrainte de donner ses yeux à la fille de l‟étanger avec qui elle avait fui le pays : Ŕ Le hicieron firmar un papel y le sacaron los ojos. Ŕ ¿ Vendió los ojos ? Ŕ No. El papel decía que ella los donaba a la hija de ese hombre. El papel estaba en otro idioma y ella ni sabía lo que firmaba... , ay, qué desgraciao. Y parecía una persona decente, qué educado y qué fino. [...] [Tatiana] llegó medio loca. La montaron en un avión y me la devolvieron. Ay, Rey, [...] me ha dejado ciega a mi niñita. 899 Fredesbinda s‟occupe donc à nouveau de sa fille que l‟on a aussitôt renvoyée à La Havane une fois l‟opération effectuée. Si le stoïcisme est de mise pour survivre face à tant de douleur Ŕ le personnage de Pedro Juan se caractérise d‟ailleurs par son insensibilité Ŕ, d‟autres ne parviennent pas à accepter l‟insupportable. Le suicide apparaît donc comme un dernier geste de liberté, source de délivrance. Peut-être parce qu‟il s‟agit de l‟œuvre la plus sombre parmi les récits du cycle Centro Habana900, Trilogía sucia de La Habana en relate un certain nombre. Nous renvoyons, par exemple, à la description froide et précise du suicide d‟un homosexuel qui s‟est pendu avec des cables électriques901, ou encore à celle d‟Angelito, un veuf de soixante ans, abandonné par ses enfants, qui s‟est jeté du haut de son immeuble. La mort d‟Angelito est d‟autant plus abominable qu‟il est ensuite mangé par des chiens : 896 Id., Carne de perro, op. cit., p. 16. Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 104. 898 Expression employée par le narrateur. Id., El insaciable hombre araña, op. cit., p. 125. C‟est nous qui traduisons. 899 Id., El rey de La habana, op. cit., p. 82, 83. 900 Pedro Juan Gutiérrez explique souvent que Trilogía sucia de La Habana est une oeuvre cathartique qui reflète la rage et la douleur qu‟il ressentait à l‟époque : « […] por eso esos cuentos son tan duros. [...] Son cuentos muy furiosos. [...] Para mí escribir la Trilogía sucia fue algo muy doloroso », Stephen Clark, « El Rey de Centro Habana : conversación con Pedro Juan Gutiérrez », 2000. http://www.pedrojuangutierrez.com/Entrevista_ES_Librusa.htm (consulté le 14/07/2013). 901 Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 26, 27. 897 289 « Comieron un buen pedazo del cerebro sangrante y caliente. [...] Era el quinto muerto en el barrio en pocos días »902. La somme de tous ces exemples montre que, envisagée sous l‟angle du réalisme sale, la vie n‟est qu‟amertume, désillusion et drame. Climat infernal, insalubrité, crasse extrême et misère humaine sont les composantes de l‟enfer havanais. Dans un tel contexte, on ne saurait être supris que les personnages ne croient plus en rien et aient abandonné tout code moral. 2- Un univers sans foi ni loi a- Des crimes atroces C‟est sans éthique aucune que certains individus agissent faisant de la ville un territoire de non-droit. Plus aucune règle morale ne dicte la conduite humaine et les crimes deviennent effroyables. Dans cette perspective, La Havane ne sert plus seulement de scène aux délits, vols et autres escroqueries, étudiés dans notre chapitre précédent, elle devient un univers sans foi ni loi. Les romans noirs des années quatre-vingt-dix, dont la fonction dénonciatrice a été établie, font état de cette déliquescence morale présente à Cuba903. Les œuvres de l‟écrivain et journaliste Amir Valle sont en cela remarquables : elles plongent le lecteur au cœur de la marginalité havanaise où règne la violence la plus aiguë. Cette série de romans policiers porte d‟ailleurs le titre explicite de « El descenso a los infiernos »904. L‟écrivain, qui dit s‟appuyer sur des faits réels pour concevoir ses intrigues romanesques, lève le voile sur des réseaux de prostitution infantile, de trafic de drogue ou encore de trafic humain, à mesure que le policier Alain Bec résout les enquêtes. On y découvre des malfrats plus puissants que les policiers, des militaires corrompus et des malfaiteurs qui, ayant perdu tout scrupule, ne reculent devant rien pour gagner un peu d‟argent. C‟est le cas de cette famille dont parle le détective, dans Largas noches con Flavia, qui a même enfreint « l‟éthique de la marginalité »905 en introduisant de la drogue dans des bonbons destinés aux écoliers. Les trafiquants s‟enrichissaient sur le dos des enfants devenus accros à ces confiseries. Tous les membres furent arrêtés, emprisonnés et 902 Ibid., p. 113. Avec la période spéciale, le roman policier cubain se renouvelle complètement et bouleverse les canons appliqués dans les années soixante-dix par une majorité d‟écrivains qui donnèrent naissance à une littérature policière clairement militante. De façon plus générale, nous pouvons dire que la crise a offert aux écrivains une nouvelle liberté. Ne pouvant plus être publiés à Cuba, faute de moyens, les auteurs ont libéré leur discours. 904 « El descenso a los infiernos » se compose de Las puertas de la noche (2001), Si Cristo te desnuda (2001), Entre el miedo y las sombras (2003), Santuario de sombras (2006), Largas noches con Flavia (2008), Los nudos invisibles (2009). 905 Amir Valle, Largas noches con Flavia, op. cit., p.101. C‟est nous qui traduisons. 903 290 sévèrement punis par leurs codétenus de cellule. C‟est de cette manière qu‟Alain Bec explique qu‟avec cette sombre histoire, une limite avait été franchie : En ese caso, la ley y la ética es muy simple […] : eres mayor de edad y si te da la gana y tienes el dinero, compras la droga. Es tu decisión. Pero con los niños nadie tenía derecho a meterse. Había sus excepciones, « que de todo hay en la viña del Señor », pero para eso estaba la gente como Alex, recordándoles a unos cuantos degenerados en los barrios « que hay cosas, zonas, lugares, que deben estar a salvo de esas leyes que justifican y defienden la lucha por la supervivencia. […] ».906 Certains ne reculent devant rien pour trouver de l‟argent, quitte à transgresser les règles tacites qui régissent la délinquance. Les enfants deviennent des proies quelconques et on les appâte de la manière la plus vile qui soit. On s‟en doute, la lutte pour la survie quotidienne justifie aussi les pires crimes chez Pedro Juan Gutiérrez. D‟ailleurs, le narrateur de Trilogía sucia de La Habana explique : « la miseria destruía todo y destruía a todos, por dentro y por fuera. Ésta es la época del sálvase quien pueda […] »907. Pour illustrer cette affirmation, citons le cas de Tácito qui n‟a pas hésité à tuer sa mère avec de l‟acide pour toucher son héritage. Cet assassinat est d‟autant plus sinistre que le personnage avait déjà tué, dix ans auparavant, son beau-père pour les mêmes raisons matérielles908. Il y a aussi l‟exemple de ce jeune couple qui a tué l‟octogénaire dont ils s‟occupaient pour pouvoir vivre dans son appartement sans avoir à la supporter. Ils lui administrent des doses de plus en plus fortes de somnifère et finissent par la tuer complètement909. Enfin, nous pouvons également évoquer l‟histoire de Betty, cette femme d‟une quarantaine d‟années, sauvagement violée et torturée par deux hommes qui se sont introduits chez elle pour lui voler de l‟argent et des bijoux. La scène est d‟une violence inouïe : Ella chilló de dolor, pero el tipo le dio unos pesconzones y la obligó a callarse. […] Betty pensñ que se le iba a detener el corazñn. Pero no. Temblaba de miedo y de dolor. Le dolía el interior de la vagina como si le hubieran introducido un palo a martillazos. […] El blanco le metió todos los dedos y la mano por la vagina. Con mucho odio. Cerró el puño dentro de ella y le golpeñ duro los ovarios. […] Ella empezñ a sangrar abundantemente. Le habían desgarrado. No sabía si fue el negro o el blanco, que seguía golepándole dentro de la vagina y ahora se divertía con la sangre. Ella se retorcìa de dolor. […][El negro] comenzñ a pincharla de nuevo con el cuchillo. Ahora le pinchaba duro los pezones, el pecho, la 906 Ibid., p. 104. Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 173. 908 Ibid., p. 88, 89. 909 Ibid., p. 112. 907 291 cara. El cuchillo penetraba y hacía pequeñas heridas. Dolorosas, sangrantes.910 La description détaillée de ce viol insiste sur la sauvagerie des deux criminels qui, avec un sadisme insupportable, prennent un malin plaisir à torturer Betty. Les comparaisons, les adjectifs, les verbes d‟action soulignent une brutalité monstrueuse. Betty ne mourra pas après son agression mais vivra recluse, traumatisée et apeurée. La barbarie de ce crime provoque aussi la mise à l‟écart de la victime, elle l‟éloigne donc de l‟humanité. Car l‟autre caractéristique de l‟enfer havanais est de révéler l‟animalité de l‟être humain. b- Violence et animalité retrouvée Tout au long du XXème siècle, La Havane est un espace chaotique et anxiogène. Nous avons eu l‟occasion de voir, dans notre première partie, que l‟Histoire du pays générait une violence politique tout d‟abord. Les dictatures de Machado puis Batista ont marqué la ville de leur brutalité, comme l‟ont démontré bon nombre d‟écrivains. Alejo Carpentier décrit la scène de torture que les policiers de Machado font subir au protagoniste de El acoso avant que ce dernier ne passe aux aveux : La primera mordida de una pinza le arrancó un grito de bestia, tan largo y desolado, que los otros, tratándolo de cobarde, se lo acallaron de una bofetada. Y cuando volvió a sentir el metal sobre su piel recogida, clamó por la madre, con un vagido ronco que le volvió en estertor y sollozo a lo más hondo de la garganta.911 Le narrateur insiste sur les cris de bête effroyables que pousse le détenu pour signifier que la torture déshumanise complètement l‟individu. Dans No hay problema, Edmundo Desnoes évoque un interrogatoire tout aussi musclé mené par les policiers de Batista. Ils frappent et emmènent le journaliste Sebastián Soler y Powers sur un bateau pour le jeter à l‟eau, une enclume accrochée à ses pieds. Cette violence policière est encore plus injuste et impitoyable dans la nouvelle « El regreso », de Casey, dont il a déjà été question. Arrêté par erreur, le protagoniste est torturé à mort par des policiers qui le frappent et utilisent des décharges électriques pour le faire parler : Sintió que le agarraban los puños e inmediatamente comenzó a recibir golpes brutales en el rostro y en las costillas. Los golpes le ahogaban, no 910 911 Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 229, 230. Alejo Carpentier, El acoso, op. cit., p. 98. 292 podìa gritar, y sus aprehensores mantenìan un silencio obstinado, […] realizando su tarea metódicamente. Perdió la noción del tiempo, reducida su actividad pensante a esperar cada nuevo golpe. […] El interrogatorio durñ exactamente veinticuatro horas. […] Un violento mazazo le derribñ por el suelo. […] La primera descarga tuvo la inmensa virtud de hacerle perder nuevamente el sentido. Al despertar de la segunda, gritaba de dolor.912 Les policiers semblent être devenus des professionnels de la torture. Ils agissent froidement et sans état d‟âme puisqu‟ils se moquent de tuer un innocent913. Leur sauvagerie est croissante jusqu‟au dénouement final : ils finissent par abandonner le corps moribond du personnage le long d‟une route et laissent les crabes le dévorer. A la traque et à la répression policière s‟ajoute aussi la résistance active et meurtrière des opposants aux régimes de Machado et de Batista. Gardons pour plus tard l‟exemple de El acoso, de Carpentier, et évoquons, pour illustrer cette idée, El sol a plomo, d‟Arenal, où la violence apparaît comme nécessaire à la lutte. Dans ce récit assez démonstratif, le personnage de Luis incarne deux positions antithétiques : refusant, dans un premier temps, le recours à la force et aux armes, il finit par l‟accepter car cela lui semble finalement indispensable pour vaincre Batista. Une phrase prononcée par l‟un des personnages, Cuca, résume parfaitement ce point de non-retour : « Estos no son tiempos para nada, como no sea esto : secuestrar y matar y odiar »914. La dureté et l‟implacabilité des propos de cette femme témoignent d‟un jusqu‟au-boutisme militant que nous retrouvons aussi chez Sarduy. Dans Gestos, l‟écrivain de Camagüey met en scène des attaques terroristes qui visent à renverser Batista. La panique et l‟angoisse sont palpables dans la ville à chaque fois qu‟une bombe explose915. Décombres, mouvements de foule, bruit strident des sirènes, répression meurtrière, sont décrits dans un style percutant qui matérialise la violence et le chaos urbain : La bomba aturde aún, como si la explosión continuara en el aire, latente, tomando fuerza para una acometida más violenta. Ellos se quedan mudos, se miran unos a otros, corren en silencio. Sólo los niños protestan, gritan, se revuelven. Los niños que no comprenden una realidad que hace temblar la suya, que aumenta hasta […] lo monstruoso […]. 916 912 Calvert Casey, « El regreso », in Alberto Garrandés, La ínsula fabulante. El cuento cubano en la Revolución, op. cit., p. 42. 913 Peu importe que l‟homme torturé ne soit pas le criminel qu‟ils recherchent. « Si no es éste, es lo mismo… », dit l‟un des policiers, ibid., p. 44. 914 Humberto Arenal, El sol a plomo, New York, Ediciones Nuevos Mundos, 1959, p. 82. 915 Nous renvoyons à la première partie de ce travail, au chapitre 4, 1-b. 916 Severo Sarduy, Gestos, op. cit., p. 39. 293 La ponctuation rend le rythme des phrases saccadé et parvient à traduire, de manière formelle, le climat angoissant. Les enfants sont les seuls à réagir face cette situation insoutenable, tandis que les adultes paraissent accepter silencieusement la violence. Après Batista, la ville ne cessera pas pour autant d‟être un espace inquiétant et terrible, nous le verrons dans notre prochaine partie, quand il sera question du caractère aliénant du territoire. Qu‟elle soit politique ou sociale, la violence est manifeste dans notre corpus. La brutalité des rapports sociaux va bien au-delà des injustices socioéconomiques, du racisme ou encore du sexisme qui ont pu poindre jusqu‟à présent dans nos analyses. Une fois de plus, la période spéciale bouleverse les comportements sociaux en érigeant en règle de (sur)vie des principes égoïstes et violents. Si chez Portela la ville devient progressivement violente917, chez Gutiérrez, elle l‟est complètement et de manière extrême. Toutes les relations humaines obéissent à un rapport de force impitoyable : il y a d‟un côté les dominants et de l‟autre les dominés, et dans cet univers, seuls les plus forts survivent. « O buscas de dónde agarrarte o te hundes »918, explique le narrateur qui résume ainsi les deux options qui s‟offrent à tous en temps de crise. Les personnages du réalisme sale répondent assez clairement à cette dichotomie puisqu‟il y a ceux qui luttent coûte que coûte, et parviennent tant bien que mal à résister, et les plus faibles qui sont écrasés et vaincus. Dans la nouvelle intitulée explicitement « Amos y esclavos », le narrateur exprime ainsi les rapports de force qui régissent toute relation humaine : Es así de cabrona la vida. Si tienes un carácter fuerte, eres intransigente y despreciativo. El rigor y la disciplina te convierten en un tipo implacable. Sólo los débiles son sumisos y parasitarios. Y necesitan del fuerte. [...] Ya sé que es engorroso decirlo en voz alta, pero lo cierto es que unos mandan y otros obedecen.919 Les faibles, souvent qualifiés de « comemierda » par les personnages, sont donc victimes de la loi du plus fort mais aussi de la nature profondément maligne et sadique de l‟être humain qui reste, pour Pedro Juan Gutiérrez, un « hijo de puta [a quien le] gusta tener a alguien abajo, pa‟ aplastarlo y pisotearlo »920. Ce principe justifie les conduites les plus immorales, nous l‟avons vu, mais surtout il marque le retour de l‟Homme à l‟animalité. Dans un cercle aussi 917 « La Habana poco a poco se estaba convirtiendo en una ciudad algo violenta […] », Ena Lucìa Portela, El pájaro : pincel y tinta china, Barcelone, Casiopea, 1999, p. 50. 918 Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 99. 919 Ibid., p. 210. 920 Id., Animal tropical, op. cit., p. 284. 294 vicieux qu‟infernal, la violence engendre la violence : « En Centro Habana la gente tiene mucha rabia contenida. Furia, desespero, agresividad. Es contagioso. Te acostumbras a vivir con los colmillos y las garras afiladas, listo para destrozar al primero que te mire mal »921. La métaphore animale Ŕ motif récurrent dans la prose de l‟auteur Ŕ montre que l‟individu perd de son humanité et devient « un loup solitaire »922 mû par un instinct de survie primaire. L‟Homme, en retrouvant son animalité, se déleste de ses principes moraux pour agir librement et sans état d‟âme : « Y hay que sobrevivir. Como sea. Con garras y colmillos. Hay que defenderse y luchar. [...] La moral y la ética son una carga pesada, por tanto se ponen a un lado y uno queda con las manos libres. Y a luchar. Con garras y colmillos »923. Sans insister davantage sur le lexique bestial, notons que l‟obligation, qui se répète, signifie qu‟aucune alternative à la lutte n‟est envisageable pour le narrateur. Dans un tel contexte, la ville devient une « jungle » peuplée d‟une « faune » louche et redoutable : Todos salíamos de las jaulas y comenzábamos a luchar en la selva. [...] No teníamos ni idea de cómo era la batalla en la jungla. Pero había que hacerlo. Estuvimos encerrados treinta y cinco años en las jaulas del Zoo. [...] Y de pronto hay que saltar a la selva. [...] Sólo los mejores podrían competir por la vida en la jungla.924 Pour souligner la violence de la ville, la métaphore de la jungle et de la chasse n‟est pas propre à Gutiérrez925, mais elle est récurrente dans sa prose et revêt un caractère martial qui apparaît nettement dans ces lignes (« batalla »). La Révolution est comparée à une cage et à un zoo qui auraient gardé la population sous contrôle, pendant des années, jouant en quelque sorte un rôle de garde-fou. Avec la crise, les chaînes ont été brisées et les fauves rôdent en liberté dans un espace devenu menaçant. L‟univers impitoyable que construit la littérature cubaine de la période spéciale s‟appuie sur une prose hyperréaliste qui tient parfois de la chronique journalistique. Ce style « documentaire » prétend révéler, le plus fidèlement possible, la réalité présente. Les récits autofictionnels de Gutiérrez, qui brouillent volontairement les pistes entre la fiction et la réalité, constituent un exemple emblématique de cette écriture de la circonstance qui crée une Havane apocalyptique. Si la ville est infernale, les pratiques spatiales qui permettent de s‟y 921 Id., Carne de perro, op. cit., p. 108, 109. Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 290. C‟est nous qui traduisons. 923 Id., Animal tropical, op. cit., p. 215, 216. 924 Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 139. 925 Citons, par exemple, cette phrase de Miguel Mejides : « La Habana es un campo minado, un pantano palúdico […], una selva donde una furia tñrrida no dejará nada para la compasiñn […] », Miguel Mejides, « Rumba Palace », in Alberto Garrandés, La ínsula fabulante. El cuento cubano en la Revolución (1959-2008), op. cit., p. 334. 922 295 mouvoir le sont tout autant, et ce depuis l‟émergence du roman urbain dans la littérature cubaine. 3- Un espace aliénant a- La traque Même avant les années quatre-vingt-dix, le territoire urbain est source d‟aliénation. Différentes manières de l‟appréhender le rendent particulièrement infernal et angoissant. Qu‟il soit vécu comme l‟espace de la persécution, de la fuite ou de l‟enfermement, il apparaît toujours comme un piège qui se referme sur les personnages. La ville est effectivement le lieu de la répression et de la persécution où se pratique une chasse à l‟homme impitoyable. Cabrera Infante en fait état dans plusieurs fragments de Vista del amanecer en el trópico. Il est question, par exemple, de jeunes gens luttant contre un pouvoir dictatorial tyrannique, poursuivis puis executés par la police926. Il est aussi fait mention d‟un piège tendu aux opposants de Machado qui, le croyant parti, célèbrent sa chute en se rendant au Palais Présidentiel. Cette manifestation se termine dans le sang puisqu‟ils sont perfidement executés par l‟armée du dictateur. Rappelons que Carpentier relate aussi cet événement survenu le 7 août 1933, dans El recurso del método : […] en eso aparecen los carros blindados de la 4ª Motorizada, abriendo fuego sobre la multitud. Dispara de golpe, la guarniciñn de Palacio […]. Caen granadas de la torre de la Telefñnica […]. Cerrando las avenidas avanzan ahora, lentamente, pausadamente, policías y soldados en filas apretadas, largando una descarga de fusil a cada tres pasos. Y ahora corren, huyen, las gentes despavoridas, dejando cuerpos y más cuerpos y otros cuerpos más […]. Y las tropas avanzan, despacio, muy despacio, disparando siempre, pisando a los heridos que yacen en el piso […]. 927 La rigueur implacable des forces armées transforme la ville en un véritable piège pour ces manifestants qui sont traqués, cernés puis abattus comme du gibier. La progression lente mais certaine des troupes est rendue par les nombreux adverbes, les verbes d‟action et le rythme régulier des propositions. Les soldats avancent avec fluidité et impassibilité à mesure que la panique se répand parmi les opposants au régime. La ponctuation, qui crée un rythme 926 « Se escondieron en una casa de la calle Esperanza y vino la policía y los sacaron a la calle y los mataron cerca del mercado. […] lo realmente conmovedor es saber que esos tres muchachos casi desnudos […], perseguidos, dijeran : „Nos persigue la Tiranìa‟, y no : „Nos persigue la policìa, o el ejército‟ », Guillermo Cabrera Infante, Vista del amanecer en el trópico, op. cit., p. 93. 927 Alejo Carpentier, El recurso del método, op. cit., p. 263. 296 saccadé, permet aussi de rendre l‟agitation extrême qui secoue les civils. En insistant sur les cadavres qui s‟amoncellent (le mot « corps » est répété trois fois dans une phrase), Carpentier décrit une scène de guerre d‟une violence extraordinaire. Le plan machiavélique du dictateur fonctionne parfaitement : le centre-ville n‟est plus qu‟une scène de bataille où gisent les ennemis. La cité sert ici le sinistre projet du tyran car non seulement elle permet d‟acculer la population mais rend aussi manifeste l‟écrasante victoire du « Primer Magistrado ». Dans « La noche de Ramón Yendía » (1942), de Lino Novás Calvo, et bien sûr dans El acoso (1956), de Carpentier, la traque qui fonde l‟intrigue permet aussi à l‟espace urbain d‟être un véritable ressort dramatique. Dans le premier texte, Ramón Yendía est un chauffeur qui, poussé par des difficultés économiques, décide de collaborer avec la police du dictateur Machado, en dénonçant les révolutionnaires avec qui il travaille. Ce rôle inconfortable de délateur le rend nerveux et suspicieux, aussi, dès sa première mission pour la police, il se sent surveillé : « […] tuvo la sensación de que había por todas partes ojos que lo vigilaban »928. Au fil des mois, l‟angoisse monte car il se sent pris au piège : […] se sentìa inmovilizado, sin poder avanzar ni retroceder. Esta tensiñn durñ algunos meses […]. Se sentìa rodeado, copado, bloqueado ; sabía que, en alguna parte y a alguna hora, ojos que acaso no hubiese visto lo buscaban ; o acaso esperaran tan sólo la ocasión más propicia que se acercaba.929 Comme le montrent les adjectifs, l‟impression d‟être traqué devient obsédante. La synecdoque qui évoque l‟ennemi en ne parlant que de ses yeux renforce l‟idée d‟une surveillance dont Yendía serait victime. Toute la tension dramatique de la nouvelle repose sur l‟angoisse du protagoniste qui va crescendo au point qu‟il s‟est armé d‟un Colt et que, lorsque commence le récit in medias res, Ramón Yendía n‟est pas rentré chez lui depuis quatre jours et erre, pour se cacher, dans les rues de la capitale, au volant de sa voiture. Ce « cache-cache » anxiogène, dont le dénouement ne peut qu‟être tragique, est envisagé comme la dernière solution pour échapper à des adversaires invisibles : « Ramón no podía huir, lo sabía, quizá pudiera quedarse, ocultarse, o simplemente esperar »930. Tout s‟accélère lors d‟une importante manifestation populaire qui paralyse la ville et durant laquelle Ramón se voit contraint de transporter des révolutionnaires. La cité devient alors un tourbillon (« un remolino », « una 928 Lino Novás Calvo, « La noche de Ramón Yendía », in Órbita de Lino Novás Calvo, La Havane, Ediciones Unión, 2008, p. 145. 929 Ibid., p. 147. 930 Ibid., p. 141. 297 vorágine »931) auquel il ne peut échapper et la chasse à l‟homme se généralise : « Era esto lo que más le angustiaba : todo el mundo tenía, en sus ojos, una intención de caza »932. Finalement, l‟ironie du sort voudra qu‟il soit tué, à cause d‟une méprise, par des hommes de Machado, après une course-poursuite dans la ville, retranscrite en détail933. C‟est aussi la délation qui est au cœur du récit de Carpentier puisqu‟il est question d‟un jeune étudiant engagé politiquement contre la dictature de Machado qui, sous la torture, a vendu ses camarades à la police. S‟il n‟est pas nécessaire de nous attarder sur la genèse de cette œuvre, qui doit beaucoup au récit de Novás Calvo que l‟on vient d‟étudier, nous pouvons rappeler, en revanche, que ce n‟est pas une voiture qui sert de refuge au protagoniste traqué mais une salle de concert. La traque dure ici quarante-six minutes (le temps du concert) et se termine de manière tout aussi tragique que dans « La noche de Ramón Yendía » : le protagoniste est abattu par ses anciens compagnons de lutte. Même si nous l‟avons déjà remarqué dans notre première partie, soulignons à nouveau que le personnage est traqué à deux reprises : tout d‟abord par la police lorsqu‟il commet des actes terroristes pour le Parti puis par ses anciens acolytes qui veulent se venger. La Havane est donc constamment le lieu de la peur et du harcèlement, comme l‟indique le titre du roman et l‟appellation « el fugitivo » ou « el acosado » qui se répète dans l‟œuvre pour désigner le protagoniste anonyme. Ainsi, quand il fait partie du « camp des impatients »934 et qu‟il se cache de la police dans le Mirador, après avoir commis des crimes, le personnage n‟est plus qu‟un corps traqué : « […] un cuerpo acosado, que era necesario ocultar en alguna parte »935. Cette image déshumanise le sujet en le transformant en machine agissante. On voit bien qu‟en modifiant et en asservissant l‟individu, l‟espace urbain devient aliénant. Le corps qu‟il faut dissimuler est d‟ailleurs un leitmotiv dans le roman : le personnage se cache à l‟intérieur du Mirador (« […] habìa tenido que refugiarse en el Mirador, cerrando, de afuera, la puerta que conducía a la azotea »936), dans les rues de la ville (« Después de ponerse las gafas, tras de cuyos cristales oscuros […] se sentìa más 931 Ibid., p. 153. Ibid., p. 155. 933 Sur plusieurs pages le narrateur décrit le parcours à travers la ville de Ramón Yendía et des policiers. Voici un extrait qui témoigne de cette précision : « La carrera se inició entonces en las calles céntricas. Ramón, al llegar al Parque Central, se disparó como una flecha hacia la ciudad antigua, donde la estrechez de las calles le daba ventaja. Además, en este dédalo de calles, mil veces recorridas por él, podría maniobrar constantemente […]. Viéndolo descender por Obispo, uno de los auxiliares se lanzó a atajarlo por una calle lateral [...]. Bajó, a todo lo que daba el carro, por la calle San Isidro ; desembocó en la Alameda de Paula, subió a Oficios, y finalmente, por Tacón, salió a la Avenida del Malecón », ibid., p. 163. 934 « el bando de los impacientes », ibid., p. 52. C‟est nous qui traduisons. 935 Ibid. 936 Alejo Carpentier, El acoso, op. cit., p. 44. On pourra lire aussi un peu plus loin : « Protegiéndose con el cuerpo del Mirador de la siempre temible azotea del edificio moderno, asomábase a la calle, a ratos cortos, contemplando el mundo de casas […] », ibid., p. 48. 932 298 escondido, comenzó a andar en la sombra, apretando el paso, metiendo la cara entre las solapas, cuando cruzaba una luz »937) ou chez la prostituée Estrella (« Estaba oculto nuevamente. La casa que se cerraba a sus espaldas lo cubría y encubría »938). Le personnage doit d‟autant mieux se cacher qu‟il se sent surveillé : « Pero le pareció, en el momento, que unos cargadores lo observaban demasiado »939. La tension dramatique est au plus haut quand le « fugitif » se trouve dans la salle de spectacle, traqué par ses deux bourreaux, et que la narration change de point du vue. Le protagoniste devient narrateur et exprime ainsi toute son angoisse : … ese latido, que me abre a codazos ; ese vientre en borbollones, ese corazón que se me suspende, arriba, traspasándome con una aguja fría ; golpes sordos que me suben del centro y descargan en las sienes, en los brazos, en los muslos ; aspiro a espasmos ; no basta la boca, no basta la nariz ; el aire me viene a sorbos cortos […]. Vuelve el martilleo ; lato hacia los costados ; hacia abajo, por todas las venas ; golpeo lo que me sostiene ; late conmigo el suelo […].940 Signalons tout d‟abord que cette scène qui précède l‟assassinat final ne se trouve pas à la fin du récit mais au début car l‟œuvre polyphonique (il y a plusieurs instances narratives) de Carpentier est composée de fragments qui ne respectent pas la chronologie des événements. Le lecteur doit donc reconstruire le puzzle narratif pour reconstituer l‟histoire. En juxtaposant les époques, Carpentier, plus encore que Novás Calvo, construit la chronique d‟une mort annoncée941. L‟angoisse du personnage est perceptible dans le rythme saccadé des propositions courtes qui s‟enchaînent en asyndète. Celles-ci semblent d‟ailleurs correspondre à la respiration haletante du personnage et aux palpitations qui secouent violemment chacune des parties de son corps, corps qui n‟est d‟ailleurs plus subsumé mais au contraire fragmenté pour mieux marquer l‟agitation. Là encore, le corps se fait machine, ainsi que le montrent tous les verbes actifs, mais c‟est une machine qui s‟emballe. Et pour illustrer la force de ce corps devenu incontrôlable, le narrateur homodiégétique explique que son agitation intérieure gagne le théâtre puisque tout ce qui l‟entoure vibre au rythme des battements de son cœur (« late conmigo el suelo »). La traque politique caractérise aussi l‟époque révolutionnaire. A cet égard, trois auteurs retiennent particulièrement notre attention puiqu‟ils font état d‟une surveillance et d‟une 937 Ibid., p. 69. Ibid., p. 72. 939 Ibid., p. 82. 940 Ibid., p. 26, 27. 941 L‟auteur garde toutefois pour la toute fin du roman l‟assassinat du « fugitif ». 938 299 chasse permanentes : Cabrera Infante, Arenas et Ponte, qui ont subi personnellement cette répression. Tous trois évoquent, à des époques différentes, le climat de supsicion générale, l‟éviction de personnalités « dérangeantes » (soupçonnées d‟être contre-révolutionnaires) et le contrôle intellectuel sur la création artistique. Dans Mapa dibujado por un espía, Guillermo Cabrera Infante revient sur un épisode de sa vie assez troublant : son retour à La Havane en 1965, alors qu‟il a quitté l‟Île trois ans auparavant pour travailler à l‟ambassade cubaine de Bruxelles. Il est censé ne rester que quelques jours à Cuba, pour les funérailles de sa mère, mais il va finalement être contraint à rester quatre mois. Au moment de repartir pour l‟Europe, on lui signifie, en effet, qu‟il ne peut quitter le pays942. Le récit relate ce séjour « forcé » durant lequel le personnage de Guillermo découvre une ville clairement hostile. En plus des pénuries et de la pauvreté qui transforment le paysage citadin, le narrateur évoque une atmosphère délétère : des jugements sommaires à l‟encontre d‟étudiants suspectés de ne pas être révolutionnaires se tiennent à l‟université, les amis homosexuels du protagoniste (Piñera, Triana, Arrufat) lui parlent ouvertement de la traque dont ils sont victimes, on lui fait part de plusieurs révocations de fonctionnaires et des quinze mille prisonniers politiques que l‟on dénombre déjà et lui-même subit une surveillance inquiétante : […] se acercñ a él un desconocido que le preguntñ la hora y después fue a sentarse en un banco no lejos de allí. Una vez levantó la vista del libro y vio que el desconocido lo estaba observando. Otra vez volvió a mirarlo y el desconocido seguìa mirándolo. […] A los pocos dìas vino otro desconocido a pedirle la hora. Esto ocurrió varias veces. Asombrado le preguntó a los amigos en una reunión si había algo con los relojes cubanos […] porque él era interrogado demasiado a menudo por desconocidos que en la calle le preguntaban la hora. La respuesta se la dio Antón Arrufat. - Son agentes de Lacras Sociales Ŕ dijo. - ¿ Cómo ? Ŕ preguntó él. - Gente del ministerio del Interior. Ta han visto raro, con ropas europeas y un corte de pelo desconocido, y han querido saber si eras homosexual o no.943 Cette anecdote met en lumière le contrôle omniprésent qui règne dans le pays. Tout ce qui s‟écarte du patron préétabli (physiquement et moralement) est suspect. L‟existence même d‟un département ministériel s‟appelant « Lacras Sociales » témoigne bien de la volonté de purger le pays en le débarrassant des personnes considérées comme nuisibles par la Révolution. Un peu plus tard, Arenas et Ponte évoquent eux aussi leur expérience personnelle, notamment le contrôle intellectuel qui les a écartés du circuit de diffusion officiel, dans Antes 942 Son frère Sabá subit le même sort : il ne peut regagner Madrid car le Ministère de l‟Intérieur le lui en empêche. 943 Guillermo Cabrera Infante, Mapa dibujado por un espía, op. cit., p. 116. 300 que anochezca (Arenas) et La fiesta vigilada (Ponte). Notons que le titre de l‟œuvre de Ponte renvoie explicitement à la surveillance systématique et répressive qui s‟exerce à Cuba. C‟est en ces termes que celui-ci exprime son éviction de l‟UNEAC944 : […] en una terraza de la Uniñn de Escritores, dos funcionarios me notificaron la expulsión de la ciudad letrada : en adelante ningún trabajo mío podría aparecer en las revistas y editoriales del país, suspenderían cualquier presentación en público que intentara y, ya que no podían controlar mis movimientos en el extranjero, no iba a encontrar ayuda de ninguna institución para afrontar las gestiones migratorias. Me dejaban a solas en el laberinto burocrático.945 En l‟excluant de la « ville lettrée », les fonctionnaires signent son arrêt de mort artistique. Parce qu‟ils le soupçonnent d‟être anti-révolutionnaire, ils le rendent invisible et donc inexistant à Cuba. Aussi compliqué soit-il, l‟exil est la seule issue possible. Avant lui, d‟autres intellectuels furent bannis, voire humiliés, par le régime castriste. Arenas rappelle l‟« affaire Padilla », qui marqua une rupture dans l‟histoire culturelle du pays946, et se souvient de l‟excommunication dont fut victime Virgilio Piñera, à cause de son homosexualité et de son hétérodoxie. On l‟arrêta puis on l‟évinça de la vie artistique du pays : « […] tenìa que pagar muy alto el precio de ser maricón. Fue recogido a principios de la Revolución y llevado al Morro […]. Después fue mirado de reojo y sufrió incesante censura y persecución »947. Ponte, sans le nommer, évoque aussi l‟histoire du dramaturge qui fut puni à cause de son anticonformisme : « Retirada su obra de todas las bibliotecas y librerías del país, ausente su nombre de los programas de estudio de literatura […], prohibida toda representación de sus piezas dramáticas […], a los sesentitantos años quedaba condenado a ganarse la vida como traductor »948. Les autorités anéantissent complètement les intellectuels dérangeants en éliminant leurs œuvres, en niant leur existence et en les réduisant au silence. Cet ostracisme imposé, que le narrateur dénomme « mort civile »949, s‟accompagne d‟une surveillance inquiétante : 944 Unión de Escritores y Artistas Cubanos. Institution culturelle créée en 1961. Antonio José Ponte, La fiesta vigilada, op. cit., p. 41. 946 Heberto Padilla était un écrivain cubain qui fut arrêté en 1971. Le discours qu‟il prononça juste après son arrestation marqua les esprits puisqu‟il y répudiait toute son œuvre artistique. Plusieurs intellectuels étrangers, pourtant partisans de la Révolution, signèrent un manifeste pour montrer leur désaccord. Arenas évoque cette sombre histoire dans son récit autobiographique. Voir Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 162167. 947 Ibid., p. 105. 948 Antonio José Ponte, La fiesta vigilada, op. cit., p. 32. 949 Ibid. 945 301 Vigilaban los pasos del viejo escritor, impedían que los jóvenes se le acercaran […]. Las cartas que le llegaban, esqueléticas desde sus remitentes, pasaban luego por la rapiña de los censores de correspondencia. Sus conversaciones telefónicas eran escuchadas […]. Y en el aeropuerto auscultaban a cada visitante que se hubiese detenido a conversar con él, pues temían la salida de manuscritos suyos hacia el extranjero. En su ausencia entraban al apartamento […] para hozar en lo que escribía. Lo visitaban con el fin de hacerle preguntas y amenazas. 950 Cette traque permanente, qui durera jusqu‟à la mort de Piñera951, transforme la ville en un piège immense qui isole complètement le dramaturge. Ponte aussi est victime de cette persécution méthodique : à chacun de ses voyages, il est interrogé et ses bagages sont fouillés, les étrangers qui lui rendent visite sont suivis952 puis malmenés à l‟aéroport, ses amis sont interrogés, il est mis sur écoute, tous ses faits et gestes sont répertoriés : […] supe que un agente de la policìa secreta habìa interrogado a varios conocidos míos. Supe, por las preguntas hechas, que mis convesaciones telefónicas eran escuchadas. Deseaban conocer con quién me reunía, a quién visitaba, quién se acostaba conmigo. Merodearon mi calle, visitaron el comité de vecinos […].953 Le rythme rapide des phrases et la multiplication des verbes traduisent l‟intensité de la traque et son efficacité redoutable. L‟écrivain apparaît comme une proie sans défense qui subit les rigueurs du régime sans pouvoir protester. Car, chez Ponte, la surveillance omniprésente est d‟autant plus terrible qu‟elle est favorisée par l‟architecture même de la ville. Les ruines, en ne dissimulant rien, encouragent l‟espionnage : Y a tal red de espionaje habría de corresponderle, en lo arquitectónico, una red de edificaciones en ruinas. ¿ Acaso el espionaje no procura virar al revés habitaciones del mismo modo en que se viran medias y guantes ? […] Todo espionaje aspira a la simultaneidad de interior y exterior que es atributo de las ruinas. Lo mismo que el teatro y las operaciones de allanamiento policial, el espionaje recurre a habitaciones de solo tres paredes.954 En concédant aux ruines un rôle politique de premier ordre, l‟auteur révèle la perversité du système. Le décor urbain décati participe de ce réseau de contrôle auquel nul n‟échappe. La Havane, telle une maison de poupée (ou une scène de théâtre, pour reprendre la comparaison 950 Ibid. Mêmes ses funérailles seront surveillées, cf ibid., p. 33. 952 L‟anecdote de l‟Italien venu photographier Ponte est en cela effrayante : alors qu‟à Cuba le photographe ne s‟était aperçu de rien, il se rend compte, en développant ses clichés, que tous deux étaient surveillés par un homme posté sur une azotea voisine. Cf ibid., p. 150. 953 Ibid., p. 47. 954 Ibid., p. 203. 951 302 de l‟auteur), est comme observée par un diable boiteux tout puissant. La ville porte donc en elle les traces de cette surveillance à outrance. Arenas, dans Antes que anochezca, insiste davantage sur la traque faite à l‟encontre des homosexuels. En s‟appuyant sur son expérience personnelle, l‟écrivain dépeint un climat qui se fait de plus en plus hostile et délétère. Il évoque la mise en place de camps de concentration pour « rééduquer » les homosexuels, la pression progressive de la police (« Enormes cantidades de jóvenes nos reuníamos en Coppelia, en la cafetería del Capri o en el Malecón, y disfrutábamos de la noche a despecho del ruido de las perseguidoras de la policía »955) et les multiples arrestations qu‟il a subies956. Dans un chapitre intitulé « El erotismo », il rappelle une anecdote révélatrice : il est arrêté par l‟inconnu avec qui il vient d‟avoir une relation sexuelle, car ce dernier travaille pour le département de l‟Ordre Public957. D‟autres expériences similaires avec des militaires sont relatées, comme l‟expérience de son ami Hiram Pratt, qui fut arrêté, tondu puis envoyé dans un camp agricole de province, pour témoigner de la persécution dont étaient victimes les homosexuels et du degré de perversion de certains fonctionnaires. Par ailleurs, il rappelle qu‟en 1969 eut lieu une grande rafle qui permit au régime de trouver une grande quantité de main d‟œuvre pour la récolte des dix millions de tonnes de canne à sucre de 1970 (« la zafra de los diez millones ») : […] aquella misma noche en que Cintio [Vitier] se declaraba castrista, se hacía en La Habana una de las más grandes recogidas de jóvenes ; una redada brutal de la Seguridad del Estado en la que cientos y cientos de jóvenes eran arrestados a golpes por la policía y eran llevados a los campos de concentración, pues se necesitaban brazos para cortar la caña. […] Nunca más aquellos adolescentes volvieron a ser lo que eran ; luego de tanto trabajo forzado y vigilancia en general se volvieron fantasmas esclavizados […].958 Arenas dénonce la brutalité de ce système répressif qui, non content de contrôler la population, la réduit aussi en esclavage. Les conséquences sur ces jeunes gens sont indélébiles, comme le montre la comparaison finale qui apparente ces adolescents à des bagnards fantasmagoriques. 955 Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 117. Avec un peu plus de légèreté, Senel Paz dénoncera aussi le traitement fait aux homosexuels à Cuba, à travers l‟expérience du personnage de Diego : « Yo, uno : soy maricón. Dos : soy religioso. Tres : he tenido problemas con el sistema ; ellos piensan que no hay lugar para mì en este paìs […]. Cuatro : estuve preso cuando lo de la UMAP. Y cinco : los vecinos me vigilan, se fijan en todo el que me visita », Senel Paz, El lobo, el bosque y el hombre nuevo (1991), Mexico, Ediciones Era, 1994, p. 19, 20. 957 « Acompáñame ; estás arrestado ; preso por maricón », lui dit le fonctionnaire en question. Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 121. 958 Ibid., p. 153. 956 303 La surveillance change la ville et les comportements. Elle déshumanise l‟individu traqué, qui devient tantôt un animal chassé, tantôt une machine, tantôt un fantôme, mais aussi les poursuivants. Comme surveiller ne va pas sans punir, pour reprendre le titre d‟un célèbre ouvrage de Michel Foucault, c‟est aussi l‟image d‟une ville-prison qui se façonne progressivement. b- La ville-prison Les allusions aux différents pénitenciers de La Havane mais aussi la création métaphorique d‟une cité qui serait, dans son intégralité, une prison font de la capitale un espace d‟enfermement. Dans les récits du XIXème siècle, l‟intérêt pour la prison, alors située dans la vieille ville, relève souvent du besoin de situer topographiquement les édifices importants ou alors de signifier les évolutions urbanistiques. C‟est d‟ailleurs l‟un des premiers bâtiments que la Comtesse Merlin aperçoit depuis le bateau qui la conduit à La Havane : Quel est le colossal fantôme qui s‟élève du milieu de ces gracieuses habitations et semble vouloir les envelopper de son blanc linceul ? Ŕ A ces murs épais, à ces grilles dont les pointes aiguës et meurtrières se dessinent au loin sur chacun de ses étages, je reconnais la carcel de Tacon. Ŕ L‟ancienne prison n‟ayant pas suffi à ses inexorables sévérités, il en fit bâtir une qui est immense comparativement aux autres bâtiments de la ville, apparemment dans l‟intention d‟y loger un jour tous les habitants.959 Connotée négativement (« fantôme », « linceul », « meurtrières »), la description de la nouvelle prison permet à l‟écrivain d‟orienter un peu plus son discours critique à l‟égard du Gouverneur. D‟après elle, cet édifice important est à l‟image de la politique répressive de Tacón ; d‟ailleurs, non sans exagération, elle suggère que l‟intention de celui-ci est d‟emprisonner tous les habitants de la ville. Dans Cecilia Valdés, l‟évocation de la prison permet à Villaverde d‟apporter quelques précisions topographiques (« […] hallándose la cárcel en el ángulo occidental del edificio conocido por la Casa de Gobierno, donde funcionaba asimismo el Ayuntamiento »960) et de décrire précisément les travaux engagés par Tacón pour séparer le pénitencier du reste du bâtiment961. Le passage décrivant l‟ancienne 959 La Comtesse Merlin, La Havane, T.I, op. cit., p. 285. Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, op. cit., p. 141. 961 « Al yermo desolado y polvoroso que limitaban al oeste las primeras casas de madera de la barriada de San Lázaro […] sucediñ un edificio de tres cuerpos, macizo, cuadrangular, erigido por el Capitán General D. Miguel 960 304 prison de La Havane (avant les modifications de Tacón) est d‟autant plus intéressant que l‟auteur y explique le véritable chemin de croix que devaient effectuer les prisonniers avant leur exécution : […] tenìa el reo que recorrer una larga y angustiosa carrera antes que se pusiera fin a su vida en el campo de la Punta, inmediato a la mar. En efecto, por la calle de Mercaderes pasaba a la plazuela de la Catedral, torcía luego a la de Cuba, en seguida por la orilla de la muralla a pasar por debajo de la puerta abovedada y oscura llamada de la Punta […].962 Au vu et au su de tous, les condamnés devaient parcourir une partie de la ville, tels des pénitents. Il ne s‟agit certes pas de se repentir publiquement d‟un crime commis mais plutôt d‟obéir aux contraintes architecturales de la prison. Cela dit, cette « lugubre procession »963 joue malgré tout un rôle punitif évident. Et dans cette mise en scène, La Havane a une importance de premier ordre puisqu‟elle sert de décor à cette cérémonie judiciaire. Au-delà des considérations architecturales, parler de la prison permet surtout de restituer les conditions de vie de l‟univers carcéral. En cela, les trois chapitres de Écue-Yamba-Ó (1933), intitulés « Rejas », retiennent notre attention, d‟autant plus que Carpentier les a écrits alors qu‟il était lui-même emprisonné à La Havane. Pour le protagoniste, Menegildo, la capitale est étroitement liée à la prison puisqu‟il s‟y rend pour la première fois pour y être incarcéré. Suivre ce personnage donne l‟occasion au narrateur de décrire la prison de l‟extérieur964, puis de pénétrer à l‟intérieur de la forteresse de San Carlos de la Cabaña pour y traiter l‟enfermement, de manière à la fois visuelle et poétique : Toda noción de redondez debe abandonarse cuando suena el cerrojo de una prisiñn. […] Rectángulo mayor del patio, en que el sol da lecciones de Geometría descriptiva antes y después del mediodía ; rectángulo del patio, visto por las ventanas rectangulares. Ventanas divididas en casillas cuadradas por los barrotes de las rejas. Baldosas, peldaños, molduras sin curva, corredores rectos, paralelas. Estereotomía. Tablero de ajedrez en gris unido. Mundo de planos, cortes y aristas, capaz de dar extraordinario relieve al quepis oval de los brigadas, al ojo de una cerradura, al disco de Tacón para cárcel pública, depósito presidial y cuartel de infantería. El espacio descubierto que quedó al lado setentrional de ese edificio, todavía se obstruyó más con la construcción de unos cobertizos de madera para abrigo de una parte del presidio, empleada en picar piedra menuda a martillo, con destino al empedrado de las calles de la ciudad, según el sistema de Mc Adams. », ibid., p. 142. 962 Ibid., p. 141. 963 Ibid., p. 143. C‟est nous qui traduisons. 964 « La cárcel de la ciudad estaba instalada en una chata fortaleza española, coronada por torres y atalayas. Construida con bloques de roca marítima, sus paredones leprosos encerraban miríadas de caracoles petrificados. Un puente levadizo tendido sobre un foso inútil conducía a un ancho vestíbulo adornado con retratos de alcaides coloniales », Alejo Carpentier, Écue-Yamba-Ó, op. cit., p. 130. 305 una ducha. Súbitamente, el vasto cielo se ha vuelto una mera figura de teorema […].965 Le narrateur conçoit la prison comme un ensemble de formes géométriques. Notons au passage que dans cette attention portée aux volumes, le lecteur peut deviner la formation d‟architecte que reçut l‟écrivain. À l‟intérieur de cet espace, tout est rectangulaire et rectiligne, y compris la forme des ombres dessinées par la lumière du jour et le ciel que l‟on aperçoit partiellement à travers des barreaux. Le monde extérieur semble donc se soumettre à la rigueur géométrique de l‟édifice. Les lignes abruptes, que des termes comme « cortes » ou « aristas » ne font que renforcer, sont bien sûr le reflet de la dureté de la prison. Elles contrastent avec les rares formes arrondies qui viennent rompre l‟harmonie linéaire et austère de ce damier. Cette lecture de l‟espace carcéral témoigne d‟une réinterprétation de la réalité propre à celui qui fondera, un peu plus tard, le concept de réel merveilleux. Ainsi, même s‟il s‟attache à expliquer les règles qui régissent la prison, la précarité, la privation ou encore la corruption, l‟auteur effleure à peine la dureté et la violence, préférant faire de cette expérience une étape initiatique pour le protagoniste. Menegildo côtoie effectivement d‟autres prisonniers qui vont l‟initier à la ville, au ñañiguismo (pratiques religieuses afro-cubaines) et à leurs coutumes. Cette transformation frappe d‟ailleurs son cousin Antonio quand il lui rend visite : [Antonio] quedó maravillado de la transformación que se había operado en el carácter del primo. Unas pocas semanas de obligada promiscuidad con hombres de otras costumbres y otros hábitos, habían raspado la costra de barro original que acorazaba al campesino contra una serie de tentaciones y desplantes.966 La prison est donc synonyme d‟apprentissage car elle police le jeune paysan, comme le laisse entendre l‟image d‟une sculpture que l‟on modèle. Il s‟agit, pour le personnage, d‟une étape transitoire avant de découvrir et de connaître La Havane, qui apparaît alors comme un territoire à explorer. Cette expérience carcérale a de la sorte un rôle symbolique : d‟une certaine manière, elle prépare l‟initié à la « connaissance », même si celle-ci peut être synonyme de perversion. Comme le consigne Roberto González Echevarría, l‟étape carcérale de Menegildo marque le passage de la naïveté paysanne à la corruption citadine. Le protagoniste y devient un pícaro qui s‟enorgueillit de son crime : 965 966 Ibid., p. 130, 131. Ibid., p. 141. 306 Menegildo sufre una conversión en la cárcel. Cuando su primo Antonio, que es su ìdolo […], viene a verlo, se sorprende de la transformaciñn sufrida por su pariente rural, que era un guajiro ingenuo al entrar. Menegildo ahora se enorgullece de haber acuchillado a Napoleón, se jacta de su valor, y se ha comprado una camisa estrepitosa con el dinero ganado en el juego. Menegildo se ha convertido en un pícaro, pero lo que es más importante, ha objetivizado su comportamiento anterior, que había sido motivado espontáneamente por la pasión, y se ha convertido deliberadamente en un reflejo de Antonio y de las otras figuras del bajo mundo que lo rodean en su nuevo ambiente.967 L‟approche de Carlos Montenegro, dans Hombres sin mujeres (1938)968, est assez éloignée de celle de Carpentier. Ce roman, qui se déroule entièrement dans une prison de La Havane, pendant la République, met au jour la rudesse et la violence du monde carcéral. L‟auteur y décrit avec beaucoup de réalisme le fonctionnement et les règles tacites qui régissent cet univers, le quotidien des prisonniers et crée un microcosme inhumain. Les similitudes avec le texte d‟Arenas, Antes que anochezca, sont nombreuses car les prisons cubaines des années soixante-dix, dépeintes dans l‟autobiographie de ce dernier, sont tout aussi impitoyables que celle décrite par Montenegro. Deux chapitres d‟Antes que anochezca sont consacrés à la terrible forteresse du Morro969. Bruit infernal, odeurs pestilentielles, chaleur et saleté insupportables caractérisent ce lieu infâme970 où la violence s‟érige en règle. Arenas, à l‟instar de Montenegro, évoque ainsi clairement les viols entre les détenus : « Las relaciones sexuales se convierten, en una cárcel, en algo sórdido que se realiza bajo el signo de la sumisión y el sometimiento, del chantaje y de la violencia ; incluso, en muchas ocasiones, del crimen »971. Il ajoutera un peu plus loin : Cada vez que llegaban muchachos jóvenes, a los que les llamaban « carne fresca », éstos eran violados por aquellos delincuentes. Los mandantes tenían unos palos con pinchos y al que se negaba le traspasaban las piernas con aquellos clavos ; era difícil negarse. Primero tenían que mamarle la pinga y luego dejarse poseer ; si no, le clavaban los pinchos en las piernas.972 L‟homme perd toute humanité et ne devient qu‟un corps (de « la chair ») soumis aux autres. La déshumanisation des détenus est d‟ailleurs renforcée quand ils sont comparés à des 967 Roberto González Echevarría, Alejo Carpentier : el peregrino en su patria (1993), Madrid, Gredos, 2004, p. 126. 968 Carlos Montenegro, Hombres sin mujeres (1938), Mexico, Ediciones Nuevo Mundo, 1959. 969 « Aquella prisión era tal vez la peor de toda La Habana », écrit le narrateur. Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 204. 970 « La peste y el calor eran insoportables. Ir al baño era ya una odisea ; aquel baño no era sino un hueco donde todo el mundo defecaba ; era imposible llegar allí sin llenarse de mierda los pies, los tobillos, y después, no había agua para limpiarse. Pobre cuerpo ; el alma nada podía hacer por él en aquellas circunstancias », ibid., p. 205. 971 Ibid., p. 205. 972 Ibid., p. 210. 307 monstres : « […] cientos y cientos de presos desfilaban hacia el comedor ; parecían extraños monstruos […] »973. Pendant les trois ans que dure son incarcération, Arenas est témoin de nombreuses tragédies : tortures, vengeances, assassinats et suicides rythment, en effet, la vie de la prison. Et pour mieux souligner l‟horreur des conditions de vie, les divers établissements pénitenciers ainsi que les différentes unités où sont enfermés les « délinquants » sont décrits de manière à rappeler les cercles de l‟enfer (« Aquella galera de locas era, realmente, el último círculo del Infierno »974). On parque les prisonniers en fonction des délits commis, de sorte que le sort qui leur est réservé peut être plus ou moins supportable. Seulement, à La Havane, l‟univers carcéral ne se réduit pas à la prison car la ville tout entière est source d‟enfermement. Dans l‟œuvre d‟Arenas toujours, la métaphore d‟une ville-prison est prégnante. Ainsi, dans Antes que anochezca, même après la libération du protagoniste, celui-ci est toujours prisonnier puisqu‟il lui est impossible de quitter l‟Île : parce qu‟il est écrivain et dissident, les autorités cubaines ne veulent pas le laisser partir avec les marielitos975. Il parvient à recouvrer malgré tout la liberté en changeant son identité, ce qui lui permet d‟embarquer sur un des bateaux du port Mariel et d‟émigrer aux Etats-Unis. Dans La Havane de Viaje a La Habana, Ismael, qui est retourné à Cuba voir son fils, ne peut circuler librement. Il doit loger dans un hôtel pour étrangers, l‟accès aux plages lui est interdit, il est surveillé et les patrouilles l‟inquiètent au point qu‟il se sent pris au piège et craint de ne pouvoir plus jamais repartir pour les Etats-Unis : Y una sensación de pánico lo invadió de pronto al pensar que tal vez, por alguna de las tantas formalidades burocráticas allí imperantes, no podría salir nunca más de aquel sitio. Algo mucho peor que la muerte, pensó. […] la sensación de estar en un lugar donde el miedo es la única ley, la sensación de estar amenazado ; y esa amenaza, impalpable, pero inminente, brotaba de los mismo árboles, se agazapaba en el aire, avanzaba con él por la acera carcomida… 976 973 Ibid., p. 203. On retrouve cette idée chez Barnet aussi : « La vida en la calle era un asco, pero en la cárcel era un infierno. Yo vi al diablo en figura de hombre entre aquellas rejas », Miguel Barnet, La vida real, op. cit.,p. 158. 974 Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, op. cit., p. 206. 975 On appelle « marielitos » les Cubains qui fuirent le pays en partant du port de Mariel en 1980. 976 Id., Viaje a La Habana, op. cit., p. 122. 308 La ville devient angoissante car Ismael pourrait ne plus jamais en sortir977. Absolument tout (même la nature) devient suspect et rend l‟espace inquiétant. Un peu plus loin, l‟image d‟une ville-prison se fait encore plus explicite : « ¿ Y cómo aceptar que aquel lugar donde había pasado esa juventud sea ahora sólo una prisión ? »978. S‟il n‟est pas nécessaire de revenir sur la frustration que génèrent les retrouvailles avec la capitale, nous pouvons dire que le personnage ne peut accepter la réalité. Dans ces conditions, son rapport à la ville est ambivalent : celle-ci est à la fois aimée et redoutée979. On observe la même ambiguïté chez Ponte, dans une nouvelle intitulée « Corazón de skitalietz ». La Havane est à la fois source de liberté (les personnages peuvent y errer pour littéralement habiter la ville, nous le verrons) et motif de traque et d‟enfermement. Escorpión et Veranda décident tous deux de changer de vie et d‟abandonner leur appartement respectif pour devenir vagabonds (« skitalietz » en russe). Mais il est interdit d‟être marginal dans cette Havane où tous sont surveillés et où tout est codifié, listé et chiffré, comme l‟explique Veranda lorsqu‟ils sont interrogés par une assistante sociale : Todo tiene que estar en números […]. Nos perseguirán hasta meternos en la columna debida. […] Igual a lo que pasa con animales en peligro de extinción. Te hacen alguna marca, te ponen un anillo para saber en dónde estás, para reconocerte adondequiera que vayas. Hacen censo de los pocos que quedan para…980 Là encore, la deshumanisation est évidente : les individus ne sont plus que des numéros qui doivent entrer dans des cases statistiques et sont bagués pour être pistés981. Il s‟agit d‟un contrôle social qui se fait au nom de l‟ordre mais qui n‟en est pas moins répressif puisqu‟il débouchera sur l‟internement des deux personnages dans un centre d‟accueil. Cet exercice du pouvoir n‟est pas sans rappeler les propos de Michel Foucault, dans Surveiller et punir, au sujet des exclus, des anormaux ou des marginaux qui, à l‟image des lépreux et des pestiférés d‟antan, doivent être repérés, marqués, comptabilisés et mis en quarantaine : 977 Cette même crainte habitait déjà Guillermo, le personnage de Mapa dibujado por un espía, car il ne peut plus quitter La Havane pour repartir en Europe : « […] hasta este momento él no habìa pensado en que estaba verdaderamente atrapado, pero ahora, […] sentìa que se habìa organizado una conspiraciñn contra él […] », Guillermo Cabrera Infante, Mapa dibujado por un espía, op. cit., p. 131. 978 Reinaldo Arenas, Viaje a La Habana, op. cit., p. 124. 979 Ce paradoxe apparaît aussi dans les propos d‟un personnage de Zoé Valdés. María Regla compare La Havane à une prison mais emploie un possessif qui marque son attachement à la ville : « mi ciudad prisión », Zoé Valdés, Ti di la vida entera, op. cit., p. 354. 980 Antonio José Ponte, « Corazón de skitalietz », in Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, op. cit., p. 182. 981 L‟animalisation est renforcée un peu plus loin, quand Escorpiñn est arrêté et emmené par la police : « Era un animal al que salvaban de morir por agua », ibid., p. 184. 309 […] l‟asile psychiatrique, le pénitencier, la maison de correction, l‟établissement d‟éducation surveillée, et pour une part les hôpitaux, d‟une façon générale toutes les instances de contrôle individuel fonctionnent sur un double mode : celui du partage binaire et du marquage (fou Ŕ non fou ; dangereux Ŕ inoffensif ; normal Ŕ anormal) ; et celui de l‟assignation coercitive, de la répartition différentielle (qui il est ; où il doit être ; par quoi le caractériser, comment le reconnaître ; comment exercer sur lui, de manière individuelle, une surveillance constante, etc.). […] Le partage constant du normal et de l‟anormal […] reconduit jusqu‟à nous […] l‟existence de tout un esemble de techniques et d‟institutions qui se donnent pour tâche de mesurer, de contrôler, et de corriger les anormaux […].982 L‟activité de la travailleuse sociale de Ponte, qui surveille, interroge, répertorie et punit, correspond en tous points au « quadrillage disciplinaire »983 décrypté par le philosophe. Néanmoins, elle envisage sa mission comme une action de bien public. Ne dit-elle pas à Escorpión, qui est conduit par la police dans un foyer pour vagabonds : « „Vas a estar bien‟ […]. „No te mojarás más.‟ […] „No es peligroso‟ […] »984, comme pour légitimer son intervention ? Sa traque est aussi efficace que redoutable car elle finit aussi par retrouver et enfermer Veranda, quelques semaines plus tard. Malgré les efforts d‟Escorpión pour donner à son amie gravement malade l‟illusion d‟être encore libre (« Quería abrirle un espacio imposible de libertad »985), Veranda se meurt progressivement. Durant son agonie, l‟enfermement croît et toute possibilité de jouir d‟une certaine liberté est réduite à néant : elle quitte le centre d‟internement pour un hôpital, puis mourra chez elle aux côtés d‟Escorpión, dans un appartement vide et froid. L‟ironie du sort veut donc qu‟elle décède dans le lieu qu‟elle souhaitait justement quitter dans l‟espoir d‟être libre. Si pour les deux personnages la ville signifiait la délivrance, elle est vite devenue un espace contrôlé et interdit. Ponte joue sur les constrastes en opposant les lieux clos et le territoire ouvert de la cité mais en définitive, les deux espaces s‟avèrent être des prisons parce qu‟ils sont surveillés et font tous deux partie du même dispositif disciplinaire. Une approche littéraire assez classique dans les romans urbains transforme aussi La Havane en prison. Il s‟agit de la construction d‟un espace labyrinthique. c- Le labyrinthe Avec son réseau inextricable de rues et de ruelles, la ville devient un plan au tracé compliqué, difficile à parcourir. La cité se fait dédaléenne lorsque celui qui la parcourt s‟y perd et s‟y sent 982 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, « Tel », 1975, p. 232, 233. Ibid., p. 132. 984 Antonio José Ponte, « Corazón de skitalietz », in Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, op. cit., p. 184. 985 Ibid., p. 187. 983 310 pris au piège. Concernant la capitale cubaine, c‟est surtout la vieille ville, avec ses nombreuses rues étroites, qui désoriente le flâneur, car les quartiers plus modernes répondent à un schéma urbanistique plus régulier fait d‟axes parallèles et perpendiculaires qui quadrillent l‟espace. L‟image de l‟homme qui se perd au cœur d‟une multiplicité de chemins apparaît dans Allegro de habaneras, d‟Arenal. Joan, le Catalan, découvre La Havane accompagné de Cecilia qui est son cicérone : Y así iban a perderse en el laberinto de estas históricas y vetustas calles habaneras, a veces limpias y reconstruidas, y otras sucias, semidestruidas […]. Por las calles que se nombran : Obrapía, Empedrado, Monserrate, Oficios, Muralla, Cuba, Aguiar, O‟Reilly, Bernaza, Teniente Rey, Compostela, Aguacate, Villegas, Lamparilla, Leonor Pérez, Cristo, Habana, Paula, Amargura, Sol, Luz, San Juan de Dios, y otras más que no hay por qué mencionar todas. Recorriendo catedrales, plazas, iglesias, hoteles, restaurantes, museos, farmacias, cafés, palacios, cuarterías, escuelas, bibliotecas, librerías, mansiones, etcétera, etcétera, etcétera […].986 La narration omnisciente donne le point de vue de l‟étranger qui appréhende la vieille ville comme une succession de rues, de places, d‟églises, de commerces et d‟établissements publics en tout genre, sans les différencier les uns des autres. Plus qu‟à situer géographiquement, l‟accumulation de noms propres, qui se voudrait presque exhaustive quoi qu‟en dise le narrateur, tend davantage à créer un lacis urbain extrêmement dense. D‟ailleurs, une liste de lieux indéterminés, tous au pluriel, suit cette longue énumération topographique. Joan ne se perd pas dans ce labyrinthe car il est guidé par Cecilia, mais tous n‟ont pas un fil d‟Ariane pour trouver leur chemin, comme ce personnage de Cabrera Infante qui est complètement désorienté dans ce quartier. La femme du musicien Miari de Torre, Havanaise vivant pourtant dans La Habana Vieja, n‟a plus aucun repère dès qu‟elle s‟éloigne de chez elle : « conocimos a su mujer […] tan despistada que se perdía, todavía veinte años después, si salía lejos de su casa, entre las calles circulares de La Habana Vieja, convertidas para ella en un laberinto local, y Miari debía emprender expediciones de búsqueda de la esposa perdida […] »987. Cette anecdote racontée sur le ton de la plaisanterie n‟en révèle pas moins le caractère captieux de la ville qui trompe et égare le non-initié. Ces rues qui formeraient des cercles concentriques (« calles circulares ») correspondent à l‟image que l‟on se fait du labyrinthe. Aussi, traverser la ville devient une véritable aventure, comme le suggère le terme 986 987 Humberto Arenal, Allegro de habaneras, op. cit. , p. 19. Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 252. 311 « expediciones ». Car il s‟agit bien de distinguer les initiés, ceux qui peuvent circuler dans le dédale sans se perdre, des autres qui doivent apprendre à maîtriser un territoire complexe988. La ville labyrinthique devient donc un espace à découvrir et à déchiffrer. Le philosophe et écrivain Pierre Sansot l‟explique d‟ailleurs clairement : « […] une ville, par ses multiples contours, par ses tracés parfois imprévisibles, évoque le labyrinthe. Elle nous fait passer de l‟égarement à la connaissance »989. Nous avons déjà eu l‟occasion de souligner le rôle initiatique que pouvait jouer la capitale sur certains personnages. Perçue comme un labyrinthe, elle devient le lieu de l‟expérience : Así fue. Con quince años. Iba desde Marianao, desde la lejanía de mi barrio, a conocer la ciudad […] recorrìa las calles Galiano, San Miguel, San Rafael, el paseo del Prado. Me sentaba un tiempo en el Parque Central con aquella curiosidad que, desesperadamente, todo lo abarca. Y poco a poco, con esa socarrona paciencia de La Habana, la ciudad fue desvelando sus laberintos malévolos y sagrados, sus lados oscuros, que han sido siempre los más luminosos.990 Cette citation d‟Estévez déjà évoquée auparavant, permet d‟envisager La Havane comme un espace secret qui impose patience et persévérance à celui qui prétend la découvrir. La personnification de la ville (« paciencia », « desvelando ») fait du protagoniste une sorte d‟élu qui peut cheminer vers la connaissance une fois passée une série d‟épreuves (ici, l‟attente). Cette idée est manifeste à la toute fin de La Habana para un infante difunto qui se déroule dans un cinéma de la capitale. Le personnage se trouve perdu à l‟intérieur d‟un utérus qui est comparé à un labyrinthe : « […] me hallaba en un laberinto [...] un cul-de-sac [...] ¿ Estaría perdido ? [...] ¿ Es a la derecha o la izquierda que está la salida a la realidad del cine ? »991. Les questions du narrateur traduisent bien sûr son inquiétude ; il se trouve prisonnier d‟un univers tout aussi angoissant qu‟inconnu. Ce que nous avons considéré comme une deuxième naissance allégorique se voit ici confirmé par l‟image de l‟initié parvenant finalement à sortir du dédale, après en avoir trouvé le centre992. Estévez et Infante forgent ainsi un territoire sacralisé qui débouche sur la connaissance. 988 Par ailleurs, Cabrera Infante explique que c‟est le marcheur qui construit le labyrinthe : « Recorrimos las calles vacías, silenciosas y oscuras : el dentista vivía en San Nicolás pero no me explico por qué cogimos por tantas calles laterales Ŕ o sí me explico : mi padre tenía el arte de Dédalo urbano de hacer de La Habana un laberinto de calles en zigzags », ibid., p. 118. 989 Pierre Sansot, Poétique de la ville (1973), Paris, Payot & Rivages, 2004, p. 86. 990 Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 309. 991 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 504. 992 Signalons de surcroît que le centre du labyrinthe symbolise le centre du monde. Voir : Jean Chevalier ; Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, op. cit., p. 554. 312 Mais le labyrinthe peut aussi signifier une menace, à la manière de la construction mythologique qui enferme le Minotaure. Aussi, plusieurs écrivains ont recours à cette image lorsqu‟un danger est imminent. On le voit dans Árbol de vida, de Lisandro Otero, lorsque César essaye d‟échapper aux tirs de l‟armée espagnole durant la guerre d‟Indépendance : Fue escurriéndose, intentando ganar la calle Obispo y desde allí llegar a Oficios, pero le parecía que jamás lograría salir de aquel laberinto : las descargas atronadoras de los Remington del ejército español y los Peabody de los Voluntarios se escuchaban por toda la ciudad : había comenzado una cacería indiscriminada que duraría hasta el amanecer.993 Même s‟il connaît les rues de la vieille ville et sait parfaitement quel est l‟itinéraire à suivre pour s‟échapper, le paysage urbain lui semble former un labyrinthe difficile à parcourir. C‟est la traque des troupes espagnoles rôdant et tirant sur la population qui transforme la cité. Le labyrinthe représente ici un piège mortel qui se referme sur les habitants. Chez Padura, l‟image du dédale est tout aussi inquiétante mais elle caractérise plutôt des zones urbaines inconnues et suspectes. Comme nous l‟avons vu il y a peu, dans La neblina del ayer, l‟ancien détective doit pénétrer dans le quartier d‟Atarés qu‟il ne connaît pas. Revenons sur la découverte de cet antre : […] una primera mirada le hizo patente que estaba penetrando en el núcleo de un mundo tenebroso, un hoyo oscuro que allí perdía el fondo y hasta las paredes. Respirando una atmósfera de peligro latente, avanzó por un laberinto de calles intransitables, como de ciudad posbélica, plagadas de furnias y escombros ; de edificios en equilibrio precario, heridos por grietas insalvables, apoyados en muletas de madera […].994 Mario Conde s‟aventure au cœur d‟un univers obscur et oppressant (« tenebroso », « oscuro », « peligro ») qui n‟est pas sans rappeler les « prisons imaginaires » gravées par le Vénitien Piranèse. Cette partie de la ville n‟est plus qu‟un gouffre obscur sans fond où les murs sont tombés un à un pour ne laisser apparaître que les squelettes d‟une architecture ancienne et éprouvée. Ce labyrinthe en ruines évoque au narrateur les constructions bombardées après un assaut (« posbélica », « escombros »). Le protagoniste éprouve aussi l‟impression d‟être étranger au territoire quand il confronte passé et présent. Certaines rues du Vedado, qu‟il connaît pourtant très bien, ne lui sont plus familières au point qu‟il s‟y sent complètement perdu : « Miró a su alrededor y tuvo la nerviosa certeza de hallarse extraviado, sin la menor idea de qué rumbo debía tomar para salir del laberinto en que se había convertido su ciudad, y 993 994 Lisandro Otero, « Árbol de vida », in Trilogía cubana, op. cit., p. 657. Leonardo Padura Fuentes, La neblina del ayer, op. cit., p. 232. 313 comprendió que él también era un fantasma del pasado […] »995. Avec le passage du temps, le personnage n‟a plus ses repères et c‟est ce sentiment d‟étrangeté qui transforme la ville en labyrinthe. De même, quand le personnage de « Un arte de hacer ruinas » pénètre dans Tuguria (La Havane souterraine), en traversant un long tunnel, il a une impression similaire : Un auto iluminó por un instante el sitio y estuve a punto de convencerme de que nada era real, ni la reja sin cierre en la boca de un túnel, ni la pared de piedra. […] Dentro del túnel, demoré en descubrir claridad suficiente. […] llegué a la intersecciñn con otro túnel completamente a oscuras, de diámetro más grande. Unos tablones de madera indicaban la continuación del camino […] y descubrí que el camino desembocaba en una gran luz. Deberìa tratarse de otra intersecciñn, esta vez iluminada. […] Al final del túnel la luz brillaba más que en un día soleado. El espacio, una vez que se entraba a tanta claridad, era enorme. […] intenté el regreso. Pero me fue imposible hallar salida. Habìa llegado a una ciudad de pesadilla […]. 996 Sans le formuler explicitement, le narrateur décrit un labyrinthe mystérieux. En effet, l‟entrée dans ce tunnel quasi fantastique (« nada era real »), les multiples galeries qui se croisent, l‟existence d‟un centre et enfin la sortie impossible, font de cet espace un dédale symbolique. Tuguria se trouve donc au centre d‟un labyrinthe protecteur. D‟ailleurs, juste avant d‟atteindre la cité souterraine, le personnage doit surmonter une ultime épreuve : donner la bonne formule à une femme qui prononce une phrase sibylline. Lui aussi devient donc initié en découvrant la ville secrète mais cette révélation lui est fatale : il est pris au piège et ne peut regagner la surface. L‟image classique d‟un réseau citadin si dense qu‟il en devient labyrinthique ne saurait surprendre. Le caractère usuel de ce procédé littéraire ne le rend pas moins intéressant car il revêt des significations multiples. Ouvrant à la connaissance, servant à distinguer l‟initié du commun des mortels, matérialisant physiquement les angoisses et la confusion des personnages, le dédale havanais révèle, en somme, l‟individu qui le traverse. Quoi qu‟il en soit, les trois manières d‟appréhender la ville que nous venons de dégager (le lieu de la traque, la prison et le labyrinthe) participent toutes à la création d‟un espace urbain aliénant qui implique des pratiques spatiales spécifiques. 995 996 Ibid., p. 205. Antonio José Ponte, « Un arte de hacer ruinas », in Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, op. cit., p. 71, 72. 314 4- Des dérives aux hétérotopies : autres pratiques spatiales a- Dériver dans la ville ou comment habiter le territoire Pour vivre dans cet espace hostile, certains vont établir des pratiques particulières, parfois contradictoires. Il s‟agira tantôt de faire de la ville son propre territoire en habitant l‟espace public grâce à l‟errance et la dérive, qui deviennent des vecteurs de liberté ; tantôt, au contraire, de nier la cité en s‟isolant et en se repliant chez soi ; tantôt de construire des lieux autres, autrement dit, de créer des hétérotopies997 permettant aux personnages d‟échapper à la réalité environnante devenue insupportable. Il s‟agit alors non plus d‟habiter le territoire tel qu‟il est, ni de le fuir, mais de le transformer. L‟errance, parce qu‟elle implique une habitude, une inscription sur le territoire urbain, sur un milieu codé, marqué de repères et de limites, permet de se (ré)approprier la ville. Cette appartenance au milieu urbain est facilitée par l‟inclination qu‟ont les Cubains à vivre dehors, à habiter la rue. Les écrivains des XIXème et XXème siècles qui ont relevé cette caractéristique sont légion : Y los habaneros de entonces, los de fines del XIX y principios del XX, ¿ vivían, como los de ahora, en la calle ? ¿ Cumplía la calle con los requerimientos del refugio, del templo, de la casa ? ¿ Era la calle de ayer, como la de hoy, el lugar con el cual sustituir la vivienda que no existe, o que existe en precario ? […] Preguntas ociosas. […] Las calles están ahì, los habaneros no viven dentro de las casas, sino volcados […] hacia el exterior. Los habaneros viven en las calles.998 Estévez montre que la rue se substitue à toutes les habitations possibles, tant aux lieux profanes que sacrés. Le Havanais habite littéralement sa ville pour en faire son milieu, quitte à délaisser le foyer personnel. Mais comment vivre dans cet espace quand il est devenu infernal ? Bien loin des déambulations ou explorations oisives analysées dans notre première partie, l‟errance peut apparaître comme une nouvelle manière d‟habiter la cité. Le concept de dérive, empruntée à la philosophie situationniste, peut éclairer certains textes de la fin du XXème siècle. Pour Guy Debord, la dérive permet de qualifier les parcours (ou passages) aléatoires à travers la ville. D‟après le philosophe français, la dérive est « une technique de 997 D‟après Michel Foucault, les hétérotopies, contrairement aux utopies, sont des lieux réels et localisables qui sont hors de tous les lieux. Ce sont des lieux à part soit parce qu‟ils juxtaposent plusieurs espaces en un lieu réel (le cinéma, le théâtre), soit parce qu‟ils sont hors du temps (musée, bibliothèque), soit parce qu‟ils supposent un système d‟ouverture et de fermeture (caserne, prison, hôpital). Le corps utopique. Les hétérotopies, Paris, Nouvelles Editions Lignes, 2009, p. 23-36. 998 Abilio Estévez, Inventario secreto de La Habana, op. cit., p. 183, 184. 315 passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d‟effets de nature psychogéographique, […] ce qui l‟oppose en tous points aux notions classiques de voyage et de promenade »999. Il s‟agit donc de se mouvoir dans la ville en renonçant aux raisons qui motivent habituellement le déplacement, « pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent »1000. En omettant l'aspect programmatique et maîtrisé que les situationnistes associent à la dérive, nous pouvons analyser la pratique de la ville durant la période spéciale à la lumière de cette notion. L‟espace urbain, devenu aliénant, est marqué par la traque et la persécution, nous l‟avons vu. Les relations entre les personnages et leur ville se complexifient et des stratégies sont mises en place pour survivre dans une Havane hostile et chaotique. Une nouvelle praxis spatiale apparaît donc : le nomadisme ou l‟errance soit pour fuir, soit pour recouvrer une certaine liberté. Notons que Deleuze et Guattari associent le concept de nomadisme à celui d‟espace lisse. Contrairement à l‟espace strié et hierarchisé du sédentaire, l‟espace lisse est celui de l‟immédiateté, où le promeneur se laisse porter sans s‟imposer de direction péremptoire. C‟est un espace fluide où il n‟y a pas d‟ancrage possible1001. Cet espace lisse, territoire de liberté et d‟indépendance pour le nomade, apparaît dans plusieurs romans des années quatre-vingt-dix et deux mille. Les personnages des récits de cette période Ŕ souvent des marginaux, des types hors-norme, voire des criminels Ŕ vont fuir un danger ou une traque policière en se cachant dans l‟anonymat de la ville. Il ne s‟agit pas pour eux de se tapir dans un lieu clos mais au contraire d‟habiter l‟espace en le traversant de long en large, en se laissant porter par le hasard ou certains automatismes. Ces errances sans but, sans objectif préconçu, sont aussi un moyen de se réapproprier le territoire. Deux exemples nous semblent particulièrement éloquents dans les récits contemporains de notre corpus : la fuite en avant de Rey, dans El Rey de La Habana, et la cavale de Lorenzo/Gabriela, dans La sombra del caminante. Tout au long du roman de Pedro Juan Gutiérrez, le lecteur suit les itinéraires nomades de Rey, parmi la misère, la saleté et les ruines. Porté au gré du vent, ce marginal vit une errance quotidienne incessante : Rey se alejó Galiano arriba. Ya venían dos policías corriendo [...]. Caminó muy poco y se sentó en un banco, en el parque de Galiano y San Rafael [...]. Bajó el bulevar de San Rafael. [...] Al rato pudo seguir caminando bulevar abajo. Dobló por Águila y siguió caminando hasta el parque de la Fraternidad. [...] regresó por Águila. [...] Siguió por Águila abajo y volvió al malecón, frente al Deauville. [...] y al rato reinició su 999 Guy Debord, Œuvres, « Théorie de la dérive », Paris, Editions Gallimard, « Quarto », 2006, p. 251. Ibid. 1001 Voir : Gilles Deleuze, Félix Guattari, « Le lisse et le strié », in Mille plateaux, op. cit., p. 592-625. 1000 316 marcha. Un momento después llegó a la esquina de su casa. Se sentó de nuevo en el muro del Malecón [...].1002 Fuyant les policiers, Rey dérive dans Centro Habana. Il progresse dans les rues, revient sur ses pas puis s‟arrête finalement sur le mur du Malecón au cours d‟une déambulation qui ne répond à aucun programme préétabli. Toujours pour échapper à la police ou à une situation critique, Rey s‟éloigne aussi de La Havane : il se retrouve tour à tour à Guanabacoa et à Regla, puis retourne finalement dans la capitale. Tel un nomade, il semble condamné à errer mais il l‟est dans un espace qu‟il connaît et à l‟intérieur duquel il peut se cacher puisqu‟il y a ses repères. Il s‟agit donc d‟une errance en terrain connu car à aucun moment il ne se perd dans les méandres de la ville. Ainsi, l‟impression labyrinthique qui se dégage des différentes descriptions topographiques de La Havane n‟est qu‟apparente car le personnage contrôle l‟espace. Cette maîtrise crée de la sorte un semblant d‟ordre dans le chaos ambiant. Cependant, même s‟il connaît géographiquement la capitale, Rey n‟en demeure pas moins un être qui vit en marge de la société cubaine et qui a perdu tout repère et toute norme sociale. Ainsi, s‟il sait se repérer dans l‟espace, jamais il ne l‟habite vraiment et ne fait que le traverser. Sa dérive, aussi bien spatiale qu‟ontologique, ne semble pouvoir s‟arrêter qu‟avec la mort comme le suggère la fin terrible du roman déjà évoquée. C‟est de façon tout aussi tragique que prendra fin la fuite du personnage d‟Ena Lucía Portela, Lorenzo/Gabriela (héros tantôt homme, tantôt femme). Après avoir tué deux personnes au cours d‟un entraînement de tir, le/la protagoniste s‟enfuit et déambule dans La Havane sans but précis. C‟est une véritable dérive car, comme le suggère le titre, le personnage devient « marcheur » (caminante). Ne sachant pas où aller après l‟assassinat, il entreprend un parcours sans en anticiper l‟itinéraire et se laisse guider mécaniquement par ses propres pas, comme s‟il avait perdu toute volonté propre : Alucinada, Gabriela camina como si algo dentro de ella caminara por ella, como si algo la arrastrase […]. Sus pasos, maquinales, marcan una ruta profunda. Un camino habitual, mil veces recorrido y tan incorporado a los pies como lo estuvo hace un rato el arma en la mano.1003 Dans cette errance, l‟individu devient machine, il n‟est plus qu‟un corps mécanique qui chemine. La réflexion est évacuée de cette pratique, comme le suggère l‟adjectif « alucinada » qui montre l‟égarement psychique et la perte de raison de Gabriela. Ici aussi l‟espace est connu et maîtrisé, il n‟y a donc aucun risque de se perdre. Pour Lorenzo/Gabriela, la dérive 1002 1003 Pedro Juan Gutiérrez, El rey de La Habana, op. cit., p. 43-44. Ena Lucía Portela, La sombra del caminante (2001), Madrid, Kailas Editorial, 2006, p. 41-45 317 dans la ville permet tout d‟abord de s‟échapper après le double meurtre, elle permet aussi d‟éviter le retour au foyer familial, qu‟il/elle ne veut pas retrouver 1004, et enfin, elle permet de fuir sa propre existence. Car pour ce personnage différent et marginalisé depuis l‟enfance, l‟important est de fuir. Peu importe ce que l‟on fuit ou ce qui est recherché (lui-même ne semble pas vraiment le savoir), il s‟agit d‟exister à travers l‟errance. Celle-ci va d‟ailleurs s‟accentuer et ne plus répondre à aucun automatisme : Caminar y caminar hacia ninguna parte. Ahora […] no hay ruta prefijada. No hay camino incorporado a los pies, aprendido por ellos en carne y sangre hasta hacerlos independientes de la cabeza […]. Ya no hay rutina ni tampoco una voluntad de trayecto, un orden, un plan, una forma de razonar los pasos. La nueva vida de nuestro héroe consiste en dar tumbos. Escapar sin saber bien adónde, perseguir sin saber muy bien qué. Es el Vedado en círculos no muy perfectos. De vez en cuando, algunos barrios cercanos también en cìrculos no muy perfectos. […] Un pedazo de ciudad con fronteras invisibles y visible decadencia, pues el perseguidor fugitivo […] no se aventura más allá […]. Sñlo su pequeðo mundo de loma en loma, entre escaladas y deslizamientos.1005 Si dans le passage précédent la déambulation était encore régie par une certaine habitude, maintenant, elle est absolument libre et correspond en tous points aux principes de la dérive situationniste. Elle n‟est plus un réflexe, n‟a plus aucun but et constitue une fin en soi. Le terme final (« deslizamientos ») renvoie, quant à lui, à l‟espace lisse du nomade dont parlaient Deleuze et Guattari. Dorénavant plus rien ne saurait dicter les pas de celui qui est devenu le « perseguidor fugitivo » et qui a décidé de ne plus consacrer sa vie qu‟à ça. La liberté que procure la dérive point assez nettement dans ces lignes ; le personnage semble enfin délivré de toute contrainte. Mais cette liberté s‟arrête brutalement lorsqu‟il rencontre Aimée et meurt avec elle (tous deux ingurgitent des médicaments). Aussi tragique soit-elle, l‟errance de Gabriela/Lorenzo lui aura permis de se libérer et de connaître un peu de répit dans les bras d‟Aimée. Dans les deux textes étudiés, la dérive est une réappropriation du territoire qui échoue finalement car elle accentue l‟isolement entre le personnage errant et la société dans laquelle il se meut. Lorsqu‟elle n‟est pas dictée par la fuite, autrement dit lorsqu‟elle est volontaire et non plus subie, la dérive prend une autre dimension. « Les difficultés de la dérive sont celles de la liberté »1006, écrit Debord. Cette affirmation s‟applique parfaitement à l‟expérience d‟Escorpión et Veranda dans la nouvelle de Ponte, « Corazón de skitalietz ». La Havane de ce récit est pleine de ces vagabonds qui errent sans 1004 « ¿ A dónde ir ? ¿ Al dulce hogar ? No. Ahí no. A cualquier sitio menos al dulce hogar », ibid., p. 40. Ibid., p. 165, 166. 1006 Guy Debord, Œuvres, « Théorie de la dérive », op cit., p. 257. 1005 318 but précis dans les parcs et rues de la ville. Pour être comme eux, les deux protagonistes vont abandonner leur travail, leur demeure et devenir marginaux. Ils font donc table rase du passé, renoncent à leur vie d‟antan et s‟inscrivent volontairement en marge de cette société qui ne peut plus rien leur apporter. Ils errent donc volontairement dans un espace décrépit, fait de décombres, bravant les coupures d‟électricité qui plongent certaines parties de la ville dans le noir. Cet espace hostile devient paradoxalement un lieu protecteur pour Escorpión : « le quedaba aún la ciudad, esas ruinas por las que atravesaba. Eran su abrigo, no podría alejarse »1007. Ayant pour foyer la ville entière, les deux protagonistes semblent jouir d‟une liberté totale (illusoire ?) qui leur permet d‟échapper à la réalité. C‟est d‟ailleurs ce qu‟aimerait expliquer Escorpión au psychologue qui lui demandera, plus tard, quand il sera interné, pourquoi, puisqu‟il avait une maison, vivait-il dans la rue : « Si le contesto que soy libre se reiría en mi cara »1008. Mais nous avons vu que la réalité à laquelle ils tentent d‟échapper finira par les rattraper : une travailleuse sociale mettra fin à leur errance et ils seront internés. Même si elle finit tragiquement (Veranda meurt) Ŕ mais comment pouvait-il en être autrement ? Ŕ l‟errance leur a offert la ville entière, elle leur a permis de se réapproprier un territoire et de recouvrer provisoirement un semblant de liberté. En tentant d‟exister, ces figures errantes qui fuient ou cherchent à être libres font aussi exister la ville. En effet, de manière concomitante, la dérive édifie le milieu urbain et façonne les personnages. En s‟inscrivant dans la même démarche de fuite de la réalité environnante et pour s‟extraire d‟une société qu‟ils refusent, d‟autres personnages vont, à l‟inverse, se cloîtrer chez eux. Pour eux, survivre signifie fuir le monde extérieur, en l‟occurrence la ville. Il ne s‟agit alors plus d‟habiter un territoire mais au contraire de le nier. b- Nier la ville En nous appuyant sur « la dialectique du dehors et du dedans »1009, nous pouvons opposer les lieux privés à l‟espace extérieur pour construire une territorialité symbolique. En effet, l‟espace intérieur et fermé de la maison envisagé comme un havre de paix, un lieu protecteur, propice à la rêverie, est un topique de la littérature. Ce motif est donc très présent, dans notre corpus dès le XIXème siècle et tout au long du XXème siècle. Avec la crise de la période spéciale, l‟enfermement se fait plus intense et surtout, il marque un rejet et une négation de la 1007 Antonio José Ponte, « Corazón de skitalietz », in Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, op. cit., p. 169. Ibid., p. 185. 1009 Formule que nous empruntons à Bachelard. Voir : Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, op. cit., p. 191. 1008 319 ville sans précédent. Pour mesurer cette différence, il nous semble pertinent de comparer les différents traitements spatiaux dans la diachronie. Nous commencerons par évoquer deux exemples qui correspondent à des époques distinctes (XIXème et moitié du XXème siècles) avant d‟aborder ensuite l‟époque contemporaine. Notons tout d‟abord que, traditionnellement, le foyer est surtout un espace féminin où l‟on reste pour se protéger des regards extérieurs et des dangers de la ville. Ce sont donc plutôt (mais pas uniquement) les personnages féminins qui vont concevoir la maison comme un refuge, un nid ou une coquille, pour reprendre les métaphores employées par Bachelard. Dans Carmela, de Meza, la demeure de doña Justa la satisfait pleinement ; elle y est très heureuse : « Era feliz : aquella casita a orillas del mar le había servido como de asilo dulce, de apacible y tranquilo lugar, en donde los años pasaban extinguiendo los dolores de su corazón lacerado por una pasión, la única de su vida, correspondida con harta perfidia e ingratitud »1010. La maison apparaît déjà comme un rempart contre le monde extérieur, un lieu de réconfort et de sérénité. Les personnages de ce roman étant principalement féminins (une mère et sa fille1011), le narrateur paraît devoir accorder une attention particulière à cette maison. Les descriptions sont fort nombreuses et mettent souvent en avant le côté protecteur du foyer : « Su casita, aquella querida casita, aseada, limpísima, arreglada y ornada toda por sus propias manos, y de la de su ahijadita, parecía haberse convertido para las dos en un retiro dulce »1012. Tous les adjectifs témoignent du soin que la maîtresse de maison et sa « filleule » apportent à leur demeure. Mais ce que le narrateur qualifie de retraite agréable ne s‟inscrit pas en opposition avec la ville. Il n‟y a pas de réelle dichotomie entre l‟espace privé et l‟espace public car les deux dialoguent ensemble. La maison grâce à sa terrasse s‟ouvre sur le monde extérieur : ¡ Ah !, pero en el verano nada más bello que aquel terrado, a la vez azotea y patio de la casa. Desde él se disfrutaba del siempre hermoso, nuevo y sublime espectáculo del mar […]. Los botecillos, con sus velas infladas por la brisa, y los bergantines, y las goletas, y fragatas, y tanto buque, […] mientras que en lontananza, las sombras de la noche subía como densa neblina de opalino color ; los vapores, dejando tras sí negra línea en el aire […]. Las tinas y cajones que en el terrado habìa se llenaban de plantas escogidas ; y entonces, con tantas variadas hojas y hermosas flores, semejaba el terrado pequeño y bien cuidado jardincillo. Casi a la misma hora, todas las tardes, los paseantes de la playa y los vecinos veían asomar por entre aquellos tallos verdes y hojas menudas el angelical rostro de una joven.1013 1010 Ramón Meza, Carmela, op. cit., p. 20. Doña Justa se fait passer pour la marraine de Carmela. 1012 Ibid., p. 57. 1013 Ibid., p. 15, 16. 1011 320 L‟azotea transformée en jardin est un lieu délicieux duquel on peut contempler la mer. La description expressive et poétique de la terrasse et du paysage maritime s‟appuie sur une exclamation, une comparaison quelque peu empruntée, une forte adjectivation et une prosodie harmonieuse faite de propositions plutôt longues qui s‟enchaînent avec fluidité grâce aux conjonctions. Jouant sur une double symbolique (ouvert/fermé), cet espace est ambivalent : il est à la fois un jardin clos qui sert de refuge et une terrasse ouverte qui permet de voir et, ici, d‟être vu également. Notons que le propre des azoteas et des balcons, considérés comme des espaces hybrides ou des « îles urbaines »1014, est plutôt de favoriser l‟observation panoptique, comme l‟ont observé Emma Álvarez-Tabío Albo, dans son étude sur la fonction de l‟azotea dans El acoso, de Carpentier1015, et Ariel Camejo1016. Dans notre deuxième exemple, il est nettement moins question d‟espace hybride puisque la maison est un lieu presque hermétiquement clos qui permet de protéger l‟individu de la société environnante. La maison familiale de la rue du Prado, dans Paradiso, se caractérise effectivement par son isolement et son système complexe d‟ouverture et de fermeture. Il en est question dans l‟incipit du chapitre VII où portes, grilles, fenêtres et volets sont décrits en détail : La casa del Prado donde Rialta seguía llorando al Coronel, se expresaba por las dos ventanas de su pórtico. Una verja de hierro aludía a un barroco que desfallecía, piezas de hierro colado colocadas horizontalmente, abriéndose a medida que ascendían en curvaturas que se juntaban en una boca floreada. Por la mañana, a la hora de la limpieza, las otras dos puertas se abrían, quedando la verja detrás de un portal apuntalado por tres columnas macizas con una base corintia. Una de las verjas era tan sólo una ventana, aunque respaldada también por puertas. La otra se abría como si fuese también una puerta. Ambas ventanas, de las que una era también puerta, eran seguidas por dos puertas con persianas. Después, dos piezas de madera que se plegaban, cerraban en su totalidad las dos piezas anteriores, que abrían la sala al portal […]. La puerta, de impresionante tamaño para la era republicana, contenía la puerta mayor, cerrada de noche, con la otra pequeña puerta que se abría cuando la familia regresaba de la ópera, de bailes o de fiestas familiares.1017 1014 Expression de l‟écrivain Josefina Ludmer, reprise par Jorge Fornet dans son étude éclairante sur le rôle des azoteas dans la littérature cubaine de la période spéciale. Voir : Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI, op. cit., p. 119-122. 1015 « En el movimiento pendular entre la calle y la azotea, la ciudad se descubre y adquiere su definitivo protagonismo. […] la azotea, como una especie de calle elevada, ofrece la seguridad de la que carecen las calles. Estos desplazamientos de perspectiva, que subvierten la estabilidad física de las nociones de calle y azotea, juegan con el sentido mítico-cultural de la muerte y la rendición que tiene el lector : la idea de que, al morir, el cuerpo es enterrado y el alma va al cielo », Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 175. 1016 Ariel Camejo explique que « La azotea funciona como una especie de panóptico invertido en el que no es el poder (como macroestructura de control y supervisión) quien contempla y somete al sujeto, sino que es éste quien se emplaza como ojo », Ariel Camejo, « „Estar en la zona‟. Confluencias territoriales del reguetñn y la literatura », in La Gaceta de Cuba, La Havane, Ediciones Unión, novembre-décembre 2010, p. 8. 1017 José Lezama Lima, Paradiso, op. cit., p. 294. 321 Dans cette maison, qui prend des allures de temple grâce aux ferronneries baroques et aux colonnes doriques, toutes les ouvertures sont pourvues d‟un système de fermeture qui sépare efficacement la demeure du reste de la ville. Les verbes « cerrar » et « abrir » se répondent d‟ailleurs en écho pour bien montrer que le rôle de la maison est de permettre ou d‟empêcher la sortie. Par ailleurs, comme le suggère la première phrase, la demeure semble propice au deuil et au recueillement. Si les personnages féminins, Rialta, la mère, et doña Augusta, la grand-mère, sont toujours associés à cette maison, Cemí, lui, va en sortir pour découvrir la ville. Cela dit, c‟est toujours vers le foyer qu‟il se tournera quand apparaîtra un danger. Après la manifestation étudiante à Upsalón, José Cemí retrouve la maison familiale : Cemí llegó a casa con el peso de una intranquilidad que se remansaba, más que con la angustia de una crisis nerviosa de quien ha atravesado una oscuridad, una zona peligrosa. […] Al toque en la puerta de su casa había acudido Rialta, que lo esperaba sentada muy cerca de la puerta, ansiosa por ver llegar a su hijo. […] Cuando lo vio llegar se sintiñ alegre, pues siempre que las madres ven que un hijo parte para un sitio de peligro, se atormentan […].1018 Rialta conçoit la ville comme un espace inquiétant et dangereux tandis que la maison est, au contraire, un lieu protecteur. Nous constatons que retrouver la maison signifie, pour Cemí, retrouver sa mère. D‟ailleurs, l‟image maternelle et celle du foyer familial semblent se confondre pour ne faire qu‟un, au point que nous pourrions parler ici de la maison comme d‟une matrice1019. Les travaux de Bachelard à ce propos renforcent cette idée : Le retour au pays natal, la rentrée dans la maison […] a été caractérisé par la psychanalyse classique comme un retour à la mère. […] L‟intimité de la maison bien fermée, bien protégée appelle tout naturellement les intimités plus grandes, en particulier l‟intimité du giron maternel, ensuite du sein maternel.1020 A la lecture du philosophe, nous pouvons dire que, pour Cemí, la maison constitue donc un des points centraux de son univers. Emma Álvarez-Tabío Albo signale d‟ailleurs que l‟écrivain accorde toujours beaucoup d‟importance aux maisons et que celles-ci jouent 1018 Ibid., p. 378. Cela a aussi été souligné par Françoise Moulin Civil : « […] regresar a casa, pasar por la puerta, equivale a volver a la madre y de cierta manera, volver ad uterum. Fuera de casa, no hay salvación. Fuera de la madre, ninguna protección », Françoise Moulin Civil, « ¡ Upsalón ! ¡ Upsalón ! : una universidad en el Paradiso », in Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, op. cit. http://www.bnjm.cu/sitios/revista/2003/01-02/francoise.htm (consulté le 12/10/2012) 1020 Gaston Bachelard, « La maison natale et la maison onirique », La terre et les rêveries au repos, op. cit., p. 137-138. 1019 322 toujours un rôle protecteur dans ses œuvres1021. Ajoutons également que l‟expérience personnelle de Lezama fit du foyer un havre qui le maintenait retiré du monde extérieur. Il ne sortait que très peu de sa maison de la rue Trocadero, dans Centro Habana, renonçant presque complètement aux voyages et s‟isolant dans la lecture. Dans les deux exemples que nous venons d‟étudier, il existe un antagonisme certain entre la ville et le chez-soi. Si nous avons souhaité évoquer quelques textes antérieurs à la période spéciale, c‟est pour mieux souligner les changements concernant le rôle de l‟habitat. Nous observons certaines constances (ce sont surtout les femmes qui s‟y réfugient et il protège toujours d‟une menace extérieure). Cela dit, avec la crise, la maison ne dialogue plus du tout avec la ville. Dans certains récits de cette période, l‟habitation va permettre de renforcer la dichotomie entre l‟individu et la société. Tout échange entre les deux entités est volontairement interrompu. Il s‟agit à la fois de se protéger, bien sûr, mais aussi de refuser, de rejeter même, le monde extérieur de manière radicale. L‟isolement prend donc une tournure plus extrême car il s‟agit de s‟exclure d‟un monde devenu trop insupportable. Refuser la réalité et s‟isoler chez soi est le parti pris de la jeune protagoniste de Silencios (1999), de Karla Suárez : Afuera había mucho calor, no había transporte, la gente se quejaba, las calles estaban llenas de los perros que la gente echaba de casa por falta de comida, los cines cambiaron para horarios restringidos ; en fin, que el panorama que me brindaba la ciudad no era atrayente y […] no existìa ninguna cosa que me obligara a salir de casa. Opté por recluirme. Como los animales que pasan el invierno ocultos, pensé que si afuera existía el « periodo especial », yo me quedaría adentro. Así estuve los primeros meses del año. […] Yo permanecìa en casa estudiando1022. La narratrice énumère un à un tous les changements que connaît la ville, les pénuries, la dégradation, les incommodités, et se prévaut de la métaphore animale (l‟hibernation) et de l‟opposition dehors/dedans pour expliquer son choix. Ne pas sortir lui permet de ne pas constater la crise et donc de la nier1023. Le foyer s‟inscrit donc plus que jamais en opposition avec l‟extérieur et devient une sorte de « contre-univers »1024 : 1021 « […] para Lezama, la única protecciñn frente a la ciudad desconocida siempre será la casa, incluso la que aparece en las pesadillas. […] Lezama jamás olvidarìa describir, minuciosamente, las puertas y ventanas de las casas reales que habitan sus personajes », Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 247. 1022 Karla Suárez, Silencios, op. cit., p. 221. 1023 Elle ajoute d‟ailleurs un peu plus loin : « Me quedé sola en la casa grande […]. El mundo de afuera continuaba deteriorándose y entonces determiné que me quedarìa adentro. Pasarìa el „periodo especial‟ encerrada entre paredes viejas. Como un náufrago que no se entera de la civilización ni de los cambios de Gobierno. Una ermitaña, eso quise ser », ibid., p. 229. 1024 Nous reprenons l‟expression de Bachelard qui qualifie ainsi la maison. Cf Gaston Bachelard, « La maison natale et la maison onirique », in La terre et les rêveries du repos, op. cit., p. 128. 323 Pero yo estaba a salvo. Todo llegaba a través de la ventana, todo del lado de allá. Adentro era una fortaleza de puertas cerradas […]. No quería mezclarme, ni que vinieran noticias de afuera a enredarse conmigo. El « período especial » era un hecho del lado de allá de mis paredes. Del lado de acá era otra cosa, un reino sin leyes ni causas ni consecuencias, un espacio vacío.1025 L‟enfermement du personnage répond bien à une stratégie de survie (« a salvo »). La prédominance du « je » (« yo », « conmigo »), qui se démarque des autres et donc du monde extérieur, en est une manifestation. Cette fois, la narratrice oppose les déictiques « allá » et « acá » pour bien marquer la frontière entre les deux univers, frontière matérialisée par le mur épais de la maison qu‟elle compare à l‟enceinte d‟une forteresse. Dans un élan nihiliste, son foyer devient néant, comme l‟attestent les nombreuses négations finales et l‟adjectif « vacío ». Mais cette vie d‟ermite censée la maintenir à distance de la période spéciale est vouée à l‟échec. La maison-refuge n‟est pas imperméable à la crise et à la misère environnantes puisque le foyer se détériore, les cafards envahissent l‟espace clos et le bruit de la ville se fait entendre : « Me paraba cerca de las ventanas para escuchar la respiración del edificio. […]. Yo llegaba a la ciudad a través de sus voces »1026. Dans une démarche qui s‟avèrera tout aussi vaine, la vieille Berta, dans Trilogía sucia de La Habana, fait le choix de vivre seule et en totale autarcie, se réfugiant quotidiennement dans ses souvenirs obsolètes, témoins d‟un luxe et d‟un temps certes révolus mais qui restent néanmoins tellement plus rassurants que l‟époque présente : Cada día se refugia más en los recuerdos que guarda en el escaparate y en las gavetas de la cómoda. Vestidos, guantes, sombreros con flores, invitaciones para bailar, frascos vacíos de perfumes franceses, ropa interior de encajes holandeses [...]. Todo está ajado, amarillento, frágil. Estas cosas dejaron de usarse hace treinta o cuarenta años. 1027 Cette septuagénaire s‟enferme petit à petit dans un refuge fait de poussière et de naphtaline car la ville lui fait peur (« Le da miedo bajar, salir a la calle. Le agota subir las escaleras cuando regresa »1028). Berta s‟est construit un univers clos qui ne laisse rien pénétrer du monde extérieur. Elevé à son paroxysme, cet isolement fait que la vieille dame n‟ose même plus ouvrir les fenêtres de son balcon : « Ya hace tiempo que ni abre las puertas de su balcón » 1029. Le dernier lien qui pourrait encore l‟unir à la société est donc rompu, l‟unique 1025 Karla Suárez, Silencios, op. cit., p. 231. Ibid., p. 230 1027 Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 295. 1028 Ibid., p. 297. 1029 Ibid., p. 295. 1026 324 espace transitionnel entre les deux mondes est ainsi réduit à néant, annulant de la sorte l‟existence de l‟extérieur. Ces personnages éprouvent à leur manière ce que Gaston Bachelard a qualifié de « complexe de Jonas »1030. Car, à l‟image de Jonas au cœur de la baleine, ce n‟est que blottis hors du monde et hors du temps qu‟ils semblent trouver un peu de réconfort. Mais cette résistance au monde extérieur est vouée à l‟échec Ŕ Jonas n‟est-il pas finalement rendu à la lumière ? Ŕ car le monde extérieur parvient toujours à s‟infiltrer dans les espaces hermétiques. Dans le cas de Berta, le fragile cocon qu‟elle s‟est construit ne parviendra pas à la protéger de ses propres sentiments et de la cupidité des autres. Nous avons vu, en effet, qu‟elle meurt peu après avoir rencontré celui qui est devenu son amant par intérêt, Omar. Se sachant trahie et abandonnée, elle fait une attaque cérébrale. Dans les deux cas étudiés, nier la ville en se calfeutrant chez soi est une tentative vaine, car les frontières entre les deux mondes restent poreuses malgré tous les efforts des personnages. Reste alors une troisième et dernière démarche : construire un espace autre. c- Créer des hétérotopies S‟il est difficile d‟habiter la ville et impossible de la neutraliser, peut-être faut-il la transformer en un lieu autre, hors du temps et de l‟espace, c‟est-à-dire en une hétérotopie. Ce concept foucaldien désigne les espaces « absolument autre[s] »1031 déterminés et localisables1032, qui se caractérisent, notamment, par leur isolement par rapport à l‟espace environnant1033. Ce sont des contre-espaces « hétérotopiques » que vont construire Abilio Estévez, dans le roman Los palacios distantes, et Antonio José Ponte, dans la nouvelle « Un arte de hacer ruinas ». Dans le récit d‟Estévez, les trois personnages, Victorio, Salma et Don Fuco, qui vivent en marge de la société, vont déambuler et errer dans la ville. Eux aussi vont trouver refuge dans un lieu fermé et protecteur : un théâtre en ruines. Mais, contrairement aux espaces clos que l‟on vient d‟étudier, ce théâtre va devenir une hétérotopie car c‟est un lieu isolé, à part, qui se situe hors du temps et de la ville. Le narrateur dit qu‟il s‟agit d‟« un espace sans espace »1034 1030 Gaston Bachelard, « Le complexe de Jonas », in La Terre et les rêveries du repos, op. cit., p. 147-204. Michel Foucault, Le corps utopique, les hétérotopies, Paris, Nouvelles Editions Lignes, 2009, p.25. 1032 Le philosophe parle d‟« utopies qui ont un lieu précis et réel », ibid, p. 23. 1033 Comme le dit le philosophe, « les hétérotopies ont toujours un système d‟ouverture et de fermeture qui les isole par rapport à l‟espace environnant. En général, on n‟entre pas dans une hétérotopie comme dans un moulin », Michel Foucault, Le corps utopique. Les hétérotopies, op. cit., p. 32. 1034 Abilio Estévez, Los palacios distantes, op. cit., p. 101. C‟est nous qui traduisons. 1031 325 puis d‟« une hallucination hors du temps et de l‟espace »1035. C‟est un micro-monde qui fonctionne avec ses propres règles et qui a la particularité d‟être fait à l‟image du monde extérieur. A moins que ce ne soit le contraire, comme le suggère le narrateur : […] existen dos sitios diversos que son al mismo tiempo, el mismo e idéntico : La Habana y las ruinas del teatro. Y [Victorio] ha concluido que, como la mayoría de las paradojas, ésta de la diversidad entre ciudad y ruinas del teatro es sólo paradoja en apariencia [...]. Podría afirmarse que La Habana deriva de los restos del teatro. La Habana, sencilla y enigmática prolongación de este teatro que, en otras épocas, se llamó Pequeño Liceo de La Habana.1036 Dans une sorte de gradation, il explique tout d‟abord que la cité et les ruines du théâtre se confondent pour ne former qu‟un seul et même espace. Il va ensuite plus loin en ajoutant que le théâtre lui-même serait à l‟origine de la ville et que cette dernière n‟en serait qu‟une extension. Autrement dit, l‟auteur construit un lieu clos et circonscrit qui serait une concentration du monde. Cette idée est d‟ailleurs formulée tout de suite après : ¿ cómo puede llegarse a la conclusión de que la ciudad haya sido levantada a partir del teatro, reproduciéndolo en esquinas, muros, calles, parques y edificios ? Una vez que se accede a las ruinas, resulta inevitable suponer que se ha entrado en el corazón mismo de La Habana. Victorio piensa en un hipotético Génesis de la ciudad donde se deje escrito : En el principio fue el teatro.1037 Dans ces lignes, le substrat biblique explicite renvoie à la création de La Havane par le théâtre qui l‟a construite à son image. L‟idée que ce lieu se situerait au centre de la ville et qu‟il en serait le cœur en somme, n‟est pas sans rappeler le centre caché et secret du labyrinthe, sorte de Saint Graal que seuls les initiés peuvent découvrir. Les trois personnages semblent être les « élus » dignes d‟accéder à cet endroit sacré. Si au commencement était le théâtre et s‟il était lui-même la ville, force est de constater que bien des années plus tard, en temps de crise, c‟est le théâtre, lieu de la représentation et de l‟illusion par excellence, qui va rendre encore plus illusoire le monde extérieur pourtant bien réel. Expliquons-nous : le théâtre va rendre la ville encore plus lointaine, plus abstraite et plus évanescente qu‟elle ne l‟est déjà, il va lui faire perdre sa réalité. Et c‟est là la fonction de l‟hétérotopie : contester les autres espaces en montrant qu‟ils sont encore plus illusoires. La ville perd ainsi de sa matérialité et devient un décor en carton-pâte : 1035 Ibid., p. 258. C‟est nous qui traduisons. Ibid., p. 95. C‟est nous qui soulignons. 1037 Ibid., p. 96. 1036 326 La calle ostenta algo chapucero, de cartón. Las paredes carcomidas [...], tienen la gracia y el descaro de las paredes pintadas que usaban, o usan, en puestas de teatro comerciales, pésimas y zarzueleras. Igualmente artificial, la luz es sólo la que proviene de la luna : artificial : reflejo de otra luz.1038 La Havane devient un théâtre : elle n‟est plus qu‟une scène factice éclairée par une lune artificielle faisant office de projecteur. Tout est faux donc, sauf paradoxalement l‟ancien théâtre qui, lui, reste bien réel et ne disparaît pas, contrairement à la ville : « Termina de borrarse la ciudad desaparece sin desaparecer, huidiza, fantasmal, como la catedral de Rouen en los famosos lienzos de Monet »1039. Elle deviendra même « La-Habana-que-no-existe y LaHabana-paraíso-perdido »1040. Sans insister sur l‟évanescence de la ville, dont nous reparlerons dans notre troisième partie, soulignons que l‟allusion au tableau impressionniste de Monet crée un paysage urbain fugace, une ville qui ne serait que représentation et fauxsemblant et qui serait vouée à disparaître complètement. Créer un espace à part, tout aussi symbolique que ce théâtre, est aussi le parti pris d‟Antonio José Ponte dans la nouvelle « Un arte de hacer ruinas »1041. Dans ce récit, le protagoniste anonyme fait une thèse sur les barbacoas et s‟interroge sur cet étrange phénomène spatial, propre à La Havane, de croissance depuis l‟intérieur1042 et sur cette impression de flottaison miraculeuse qui semble caractériser l‟architecture de la ville. Ses recherches et ses visites chez son directeur de thèse vont le mener, à la fin de la nouvelle, à la mystérieuse découverte de Tuguria, ville souterraine habitée par les Tugures qui utilisent les ruines de La Havane pour édifier une autre cité. Avant cela, le professeur D. lui avait expliqué la démarche de ces « squatteurs » nomades : « Cuando no encuentras tierra nueva, cuando estás cercado, puede quedarte todavía un recurso : sacar a relucir la que está debajo de lo construido. Excavar, caminar en lo vertical. Buscar la conexión de la isla con el continente, la clave del horizonte »1043. Il s‟agit donc pour les Tugures de survivre en construisant un espace autre, une véritable hétérotopie souterraine. Comme nous l‟avons dit auparavant, ils se servent de La 1038 Ibid., p. 250. Ibid., p. 124 1040 Ibid., p. 219 1041 Dans un jeu d‟intertextualité, c‟est aussi le titre d‟un ouvrage que l‟un des personnages, le professeur D., avait l‟intention d‟écrire. 1042 Faute d‟espace, les habitants rusent pour pouvoir se loger dans la capitale. Les appartements sont divisés puis subdivisés verticalement et horizontalement grâce aux barbacoas construites entre les étages. Ainsi, sans s‟étendre ou s‟agrandir, la ville gonfle démographiquement. 1043 Antonio José Ponte, « Un arte de hacer ruinas », in Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, op. cit., p. 66, 67. 1039 327 Havane en ruines pour édifier Tuguria, la ville en construction1044. Ce contre-espace, situé hors du temps et séparé de La Havane par un tunnel qui matérialise la frontière entre les deux lieux, en s‟édifiant grâce à la déconstruction de la ville, anéantit l‟espace réel. C‟est pourquoi, nous pouvons dire qu‟ici, l‟hétérotopie déconstruit, au sens propre comme au figuré, la ville. A mesure que la capitale cubaine disparaît, Tuguria grandit. Par un effet d‟asymétrie complète, La Havane décatie et en ruines s‟oppose à la ville parfaite et nouvellement construite. A ce propos, rappelons la fonction contestataire de l‟hétérotopie qui « dénonce tout le reste de la réalité […] en créant réellement un autre espace réel aussi parfait, aussi méticuleux, aussi arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon »1045. Dans cette nouvelle, l‟hétérotopie, parce qu‟elle le détruit définitivement, est un moyen d‟échapper à un espace réel moribond. Tuguria, qui réduit à néant une ville déjà agonisante, marque, s‟il fallait le prouver, l‟échec de l‟utopie. Comme chez Estévez, La Havane de Ponte est donc vouée à disparaître inéluctablement1046 car l‟hétérotopie n‟engendre pas seulement la négation de l‟espace extérieur mais aussi sa destruction. C‟est pourquoi, des trois stratégies mises en place par les personnages pour habiter l‟espace urbain, elle est la plus radicale. La ville envisagée comme un territoire hostile et dangereux constitue un leitmotiv dans l‟ensemble de notre corpus. L‟image de l‟enfer apparaît, par exemple, à travers un climat étouffant, un décor insalubre ou encore des comportements violents, voire inhumains. Ce décor infernal devient aliénant notamment lorsque, à partir des années quatre-vingt-dix, misère, saleté, marginalité et criminalité s‟intensifient dans un sauve-qui-peut général. Beaucoup d‟écrivains contemporains ont largement puisé dans ces motifs et ont donné une nouvelle tonalité à la littérature cubaine. Que cette prose, qui oscille entre la chronique journalistique et la fiction pure, soit parfois motivée par des intérêts éditoriaux ne fait guère de doute1047. Peu importe, le fait est que cette récurrence infernale forge finalement une image de La Havane actuelle assez stéréotypée. Jorge Fornet considère d‟ailleurs qu‟avec la construction d‟un paysage urbain en crise, dans la littérature, la capitale cubaine s‟est rapprochée des autres grandes villes latino-américaines : « Hasta poco antes [de los 90] la 1044 « […] allì existìa una ciudad muy parecida a la de arriba. Tan parecida que habrìa sido planeada por quienes propiciaban los derrumbes. Y frente a un edificio al que faltaba una de sus paredes, comprendí que esa pared, en pie aún en el mundo de arriba, no demoraría en llegarle », ibid., p. 72, 73. 1045 Michel Foucault, Le corps utopique. Les hétérotopies, op. cit., p. 34. 1046 Cette idée est renforcée par l‟allusion finale à Bethmoora, ville imaginaire créée par Lord Dunsany. Nous n‟y reviendrons pas car il en a déjà été question précédemment, dans notre partie sur l‟espace nostalgique. 1047 On a reproché à certains écrivains cubains de se soumettre aux exigences du marché éditorial étranger et d‟écrire une littérature commerciale qui fait de la misère cubaine son fond de commerce. D‟ailleurs, quelques auteurs cubains ironisent à ce sujet dans leurs récits (Ena Lucía Portela ou Karla Suárez, par exemple). 328 realidad habanera (y cubana) era tan singular y propia que hubiera sido imposible identificarlas con aquéllas. Pero a partir de los noventa, para bien y para mal, comenzó su proceso de asimilación al resto de las ciudades latinoamericanas »1048. Nous avons dégagé, dans cette partie qui s‟achève, deux lieux communs utilisés avec plus ou moins d‟intensité par les écrivains cubains pour décrire La Havane : le locus amoenus et son double inversé, le locus terribilis ou locus horridus. Il s‟agit de deux mondes opposés que nous avons unis avec un espace intermédiaire : le purgatoire. On ne s‟étonnera pas de voir ces motifs contradictoires coexister pour caractériser le même espace à une même époque car les descriptions urbaines sont toujours subjectives et orientées. Il est néanmoins intéressant de constater certaines constantes. Si nous schématisons un peu, nous pouvons dire que c‟est essentiellement au XIXème siècle que La Havane-paradis coïncide avec le temps de la fiction. C‟est-à-dire que le narrateur décrit un espace-temps agréable sinon idyllique, qui correspond à la temporalité « vécue » par les personnages. L‟exemple de la Comtesse Merlin est en cela remarquable : elle dépeint le paradis qu‟elle a sous les yeux1049. A partir de la deuxième moitié du XXème siècle, la ville envisagée comme un lieu édénique correspond souvent à un espace perdu qui s‟inscrit dans une temporalité passée. Les écritures de l‟exil (effectif ou intérieur) créent une véritable géographie de la nostalgie. Enfin, en temps de crise politique (dictatures) ou économique (la période spéciale), l‟enfer caractérise systématiquement le hic et nunc des personnages. Après avoir analysé les multiples significations symboliques de la ville, il convient à présent de voir comment celle-ci est décrite, autrement dit, comment elle devient un véritable objet d‟écriture. 1048 1049 Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI, op. cit., p. 106. La chaleur étouffante est sa seule réserve. 329 TROISIÈME PARTIE POÉTIQUES DE LA VILLE Chapitre 1 : Des paysages urbains 1- De l‟espace au paysage Après avoir envisagé La Havane comme un espace topographique précis, puis après avoir étudié la portée symbolique des descriptions urbaines, il convient à présent d‟analyser les écritures de la ville, c‟est-à-dire les procédés qui transforment le simple référent spatial en paysage littéraire. Cette partie vise donc à mettre au jour d‟autres fonctions de l‟espace dans les récits. S‟il a une portée objective (situer géographiquement) et subjective (créer du sens au sein de l‟œuvre), l‟espace joue aussi un rôle affectif (traduire les émotions) et purement littéraire (il est appréhendé de différentes manières, d‟un point de vue stylistique, par les écrivains). Nous allons donc voir comment la ville devient une estampe purement rhétorique qui s‟appuie sur un système de corrélation entre divers éléments narratifs (techniques d‟écriture, figures de style, lexique, langue, style, etc.). Nous définirons la notion de paysage pour ensuite considérer nos textes à l‟aune de ce concept. Puis nous étudierons les différentes manières d‟écrire la ville pour montrer enfin que l‟espace littérarisé est réinventé, recréé, voire transfiguré. Si l‟espace traduit une réalité topographique précise et concrète, le paysage, lui, s‟affranchit des contraintes qu‟impose le réalisme. Il n‟est plus question pour le narrateur de décrire fidèlement un lieu mais de le recréer à travers un paramètre affectif qui transcende en quelque sorte l‟espace urbain. Alain Roger parle d‟un paysage qui devient alors « surnaturel » : « un paysage n‟est jamais réductible à sa réalité physique […] la transformation d‟un pays en paysage suppose toujours une métamorphose, une métaphysique, entendue au sens dynamique. En d‟autres termes, le paysage n‟est jamais naturel, mais toujours „surnaturel‟ […] »1050. On l‟aura compris, le rapport entre l‟espace réel et la description qui en est faite importe peu puisqu‟il ne s‟agit plus uniquement de situer, comme l‟explique Michel Collot : Le paysage n‟est pas le pays, mais une certaine façon de le voir ou de le peindre comme « ensemble » perceptivement et/ou esthétiquement 1050 Alain Roger, Court traité du paysage, Paris, Editions Gallimard, 1997, p. 9. 330 organisé : il ne réside jamais seulement in situ mais toujours déjà aussi in visu et/ou in arte. Sa réalité n‟est perceptible qu‟à partir d‟une perception et/ou d‟une représentation. Dès lors, pour comprendre ou évaluer un paysage artistique ou littéraire, il importe moins de le comparer à son référent éventuel […] que de considérer la manière dont il est « embrassé » et exprimé.1051 C‟est bien la manière de voir qui est importante ici, plus que l‟objet décrit. Cette représentation implique donc un sujet regardant qui va, grâce à son point de vue, transformer l‟espace en paysage. Dans cette perspective, l‟action du personnage dans un lieu défini passe au second plan, au profit du regard que celui-ci porte sur ce qui l‟entoure. Venko Kanev exprime ainsi cette distinction : « […] el personaje actúa dentro del espacio, mientras que contempla al paisaje […] »1052. Le paysage, entendu comme contemplation, est donc une écriture subjective de l‟espace1053 ; ou, pour le dire autrement, il est le lieu de l‟expérience et de la perception, comme l‟a démontré Merleau-Ponty, dans une approche phénoménologique. Ce que nous nommons « paysage » pourrait correspondre, en partie, à ce que le philosophe a appelé « l‟expérience mythique de l‟espace »1054. C‟est le lieu des sensations et des émotions qui en dit sans doute plus sur celui qui regarde que sur l‟objet observé1055. Le paysage a donc une fonction narrative importante, il est significatif et crée du sens au sein d‟une œuvre soit parce qu‟il caractérise davantage les personnages, soit parce qu‟il renforce un parti pris stylistique, soit, enfin, parce qu‟il participe à l‟élaboration d‟une atmosphère. Venko Kanev explique d‟ailleurs : « Los espacios y paisajes son portadores de un sentido social, político, filosófico, utópico. Cumplen ambos la función de ilustrar la historia »1056. A la lumière de cette notion théorique, qu‟il nous semblait nécessaire de définir, nous allons voir à présent comment le paysage devient un espace vécu au sein de notre corpus. 1051 Michel Collot, Paysage et poésie du romantisme à nos jours, Paris, Editions José Corti, 2005, p. 12. Venko Kanev, « Paisaje y espacio en la literatuta », in Christian Giudicelli (dir.), América : cahiers du CRICCAL - Le paysage II, n°29, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2003, p. 15. 1053 Michel Collot exprime également cette idée : « C‟est un espace perçu et/ou conçu, donc irréductiblement subjectif », Michel Collot, Paysage et poésie du romantisme à nos jours, op. cit., p. 13. 1054 « […] l‟expérience mythique de l‟espace […] repose sur la conscience de l‟espace objectif et unique, car un espace qui ne serait pas objectif et qui ne serait pas unique ne serait pas un espace : n‟est-il pas essentiel à l‟espace d‟être le „dehors‟ absolu, corrélatif, mais aussi négation de la subjectivité […] ? », Maurice MerleauPonty, Phénoménologie de la perception (1945), Paris, Gallimard, « Tel », 1976, p. 333. 1055 En reprenant la distinction qu‟établit Ariel Camejo, entre « ser » et « estar », nous pourrions dire que le paysage serait le lieu du « ser » et non pas du « estar » car il ne situe pas mais définit. Voir Ariel Camejo, « ¿ Cómo entrar en La Habana si no está ahí ? », in La Siempreviva, La Havane, Instituto Cubano del Libro, Editorial José Martí, n° 8, 2009, p. 54. 1056 Venko Kanev, « Paisaje y espacio en la literatuta », in Christian Giudicelli (dir.), América : cahiers du CRICCAL - Le paysage II, op. cit., p. 17. 1052 331 2- La ville comme paysage de l‟âme « Le peintre ne doit pas simplement peindre ce qu'il voit devant lui, mais aussi ce qu'il voit en lui-même. ». Cet aphorisme du peintre allemand, Caspar David Friedrich, pourrait tout à fait s‟appliquer à la littérature. Décrire la ville permet d‟y projeter les impressions, les états d‟âme, l‟humeur du personnage qui observe. L‟espace est une métaphore des sentiments et des émotions, dans la plus pure tradition romantique. Notons que ce paradigme est une constante dans notre corpus et qu‟il apparaît dans des ouvrages de style très différent, comme nous allons le voir à travers quelques exemples tirés de courants littéraires distincts. On ne s‟étonnera pas de voir apparaître ce motif romantique dans notre corpus du XIXème siècle. Deux exemples tirés d‟œuvres de Ramñn Meza illustrent ce principe. Dans Carmela (1887), la jeune protagoniste, qui donne son nom au roman, et son amant, Joaquín, se trouvent sur la terrasse de la maison de Doña Justa, face à la mer, et contemplent le paysage : Las noches que brillaba la luna, Joaquín y Carmela arrastraban sus mecedores al terrado, y uno al lado del otro, pasábanse horas enteras sin desplegar los labios. […] callaban y miraban henchidos de amor. ¡ Qué noches aquellas tan hermosas ! La brisa purificada por el océano venía llena de sus acres perfumes ; la luna plateaba el agua que se extendía ante la mirada de los dos jóvenes enamorados, inmensa, llena de poesìa […]. Todo en redor estaba tranquilo y solitario. Las plantas de las tinas erguíanse ; salían del abatimiento en que las habían sumido los ardorosos rayos del sol, enderezando sus tallos con aquel fresco rocío de la noche, que recogían, con avaricia y voluptuosidad, los claveles en sus rojos cálices, las balsaminas, las rosas, las maravillas matizadas y los blancos jazmines que con su suave y mezclado olor saturaban el aire de perfumes.1057 L‟harmonie parfaite entre les personnages contemplatifs et le paysage observé est manifeste. Le narrateur crée un cadre idyllique qui, par un effet de miroir, illustre la perfection de l‟amour des protagonistes : la beauté du paysage nocturne (« tan hermosas ») fait écho à la grandeur de leurs sentiments (« henchidos de amor »). Nul besoin de parler, l‟espace se substitue à tous les mots, il traduit leur bien-être et devient donc le relai des émotions. La tranquillité de cette scène marque la paix et la sérénité retrouvées après le tumulte de la journée. C‟est pourquoi le narrateur évoque une à une les plantes et les fleurs qui s‟épanouissent à nouveau avec la fraîcheur de la nuit, à l‟image des deux personnages. Nous constatons également que ce paysage est fortement intellectualisé : la mer est poétisée (« llena de poesía ») et les éléments naturels sont personnifiés (« solitario », « abatimiento », 1057 Ramón Meza, Carmela, op. cit., p. 71. 332 « avaricia y voluptuosidad »). Quant à la forme, le rythme lent des phrases et les sonorités douces (allitération en « s ») rendent la quiétude de la scène. L‟extrait cité, qui décrit une nature sublime, est assez caractéristique de l‟écriture romantique. Mais le paysage conçu comme une projection de l‟âme n‟est pas l‟apanage de ce courant littéraire. Dans une autre œuvre de Meza, de veine plutôt réaliste, Mi tío el empleado, on retrouve cette même subjectivité : « Y el paisaje varió. La sombra envolvía ya como espesa bruma negra el lejano término del paseo : no se distinguía apenas el Campo de Marte. A intervalos disipaban las tinieblas relámpagos de luz […] »1058. Le temps qui s‟assombrit soudainement et l‟orage qui se prépare illustrent le changement d‟humeur du personnage. Dans ce début de chapitre, intitulé d‟ailleurs « Inexplicable hastío », le paysage sert à rendre la mauvaise disposition de Coveo. Malgré toute sa fortune, il se sent seul et perçoit la ville avec lassitude et tristesse. Tout de suite après, sa grande maison luxueuse lui paraît également sinistre : […] figurñsele al conde que penetraba en alguna lñbrega cripta. ¡ Qué desierta, qué frìa, qué oscura le pareciñ su bien amueblada casa ! […] y a pesar de que la casa se inundó de claridad y lucían aún más sus ricos muebles, cortinas y tapices, el conde proseguía su tenaz cavilación : Ŕ ¡ Oh, sí ; me falta algo !1059 Les exclamations marquent le désappointement de ce personnage pourtant comblé matériellement. Le décalage entre la perception et la réalité est visible à travers les antithèses (« lóbrega », « desierta », « fría », « oscura » ; « bien amueblada », « claridad », « lucían », « ricos »). Le narrateur projette sur l‟espace extérieur et intérieur la solitude du protagoniste. Le paysage, projection ou prolongement du personnage, est au service de la trame narrative. En somme, il est un élément dramatique de plus. Dans le récit épistolaire de la Comtesse Merlin, cette interdépendance entre le sujet et l‟espace est beaucoup plus prégnante et elle revêt une dimension bien plus profonde. Disons, tout d‟abord, que l‟auteur revendique la subjectivité de ses propos, et donc de ses observations sur la ville, dès le début, dans une note introductive qu‟elle dédie à ses compatriotes : « J‟ai écrit ces lettres sans art, sans prétention d‟auteur, ne pensant qu‟à reproduire avec fidélité les impressions, les sentiments et les idées qui naissaient de mes voyages »1060. En exposant son projet, l‟auteur nous place d‟emblée face à un espace vécu. Revoir la capitale cubaine, sa ville natale, va effectivement être source de grandes émotions car, nous l‟avons dit, il s‟agit d‟un retour aux sources. L‟interaction entre espace et personnage opère dès le début. Alors qu‟elle se trouve encore sur le bateau qui 1058 Ramón Meza, Mi tío el empleado, op. cit., p. 194. Loc. cit. 1060 La Comtesse Merlin, La Havane, T.I, op. cit., p. 3. 1059 333 l‟amène à Cuba, elle est attirée par une maison qu‟elle ne reconnaît pas immédiatement : « La maison m‟est inconnue, elle ne dit rien à mes souvenirs, et pourtant je ne sais quelle sympathie secrète, quel attrait mystérieux, me portent vers elle. Ŕ Oh ! oui, c‟est la maison de mon oncle Montalvo [...] mon cœur l‟avait déjà nommé[e] »1061. Quelque chose d‟instinctif unit la ville et la femme de lettres : un élan qui ne serait pas le fruit d‟une réflexion mais serait un contact brut et naïf avec le monde. Les retrouvailles avec La Havane mettent au jour une relation viscérale et inconsciente entre le personnage et l‟espace. Aussi, l‟émotion spontanée ressentie est incontrôlable : « On dirait que mon cœur devient ma vue dans cet instant, car je sens mon cœur, ma vue et ma mémoire se confondre dans cette vive révélation »1062. Observer la ville provoque un bouleversement des sens, une confusion émotionnelle qui brouille toute lecture intelligible de l‟espace. Tout ce qu‟elle voit passe dorénavant par le paramètre affectif, comme le montre la synesthésie « mon cœur devient ma vue ». De surcroît, le terme « révélation » donne une tonalité presque mystique à ces retrouvailles. Car c‟est une géographie du passé et de l‟intime, un espace affectif, qu‟elle retrouve : « Je ne saurais te dire […] l‟émotion que j‟éprouvais en me retrouvant au milieu de cette ville où je suis née »1063. Nous voyons bien que l‟écrivain fait une expérience émotionnelle de l‟espace, pour reprendre le titre d‟un célèbre ouvrage du philosophe Pierre Kaufmann. En retournant dans sa ville natale et en s‟identifiant au paysage urbain, la Comtesse cherche à rétablir un dialogue qui a été rompu. L‟espace devient alors le seul lien entre le passé et le présent. Par ailleurs, il joue un rôle actif : il fait naître le souvenir, l‟émotion, l‟allégresse. L‟observateur n‟y projette plus ses états d‟âme, c‟est l‟espace au contraire qui les provoque. Il n‟est donc plus réceptacle mais moteur : « Chaque objet qui frappait ma vue renouvelait une impression d‟enfance, et je me sentais pénétrée de je ne sais quelle joie folle et sauvage qui m‟attendrissait et me faisait pleurer »1064. La protagoniste est submergée par ses sentiments, elle semble subir passivement les « assauts » émotionnels que provoque l‟espace. Nous constatons ainsi que deux rôles différents sont assignés au paysage urbain : il est tantôt passif quand il est à l‟image de l‟humeur du personnage (il n‟est alors qu‟une projection), tantôt actif quand il agit directement sur le sujet (il s‟agit, pour ainsi dire, d‟une intériorisation de l‟extérieur). Dans un cas comme dans l‟autre, la relation entre la ville et son sujet s‟appuie donc sur une interaction causale. 1061 Ibid., p. 290, 291. Ibid., p. 295, 296. 1063 Ibid., p. 296, 297. 1064 Ibid., p. 297. 1062 334 Nous retrouvons très souvent ces deux nuances au XXème siècle, dans des récits de genres assez éloignés. La Havane qui s‟imprègne de l‟humeur des personnages est, par exemple, visible dans la fameuse nouvelle de Senel Paz, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, qui a été portée à l‟écran par Gutiérrez Alea (Fresa y chocolate). Lorsque David aperçoit son ami Diego dans une voiture diplomatique, il se sent profondément trahi : « Llegué al Malecón, y como suele ocurrir, la naturaleza se puso a tono con mi estado de ánimo : el cielo se encapotó en un dos por tres, se escucharon truenos cada vez más cerca, y en el aire empezó a flotar un aire de lluvia »1065. Le narrateur explique que son humeur et la ville sont souvent coordonnées. Ainsi, de manière soudaine, le ciel se couvre comme pour matérialiser la peine du personnage. On pourra voir dans cette phrase un clin d‟œil de l‟auteur qui montre qu‟il utilise sciemment un cliché littéraire. C‟est sans distance, en revanche, que Julio Travieso utilise ce procédé à la toute fin de Llueve sobre La Habana, lorsqu‟il relate l‟enterrement de Mónica et la peine profonde que ressent alors le protagoniste qui était son amant : « Pensé en Mónica, en nuestras vidas. Abrí los ojos, miré el horizonte. A lo lejos unos nubarrones venían hacia nosotros. Pronto volvería a llover sobre La Habana »1066. Cette phrase finale, qui fait clairement allusion au titre du roman, fait aussi écho, par un effet d‟inclusion, à l‟incipit du récit1067. Sans revenir sur l‟épigraphe de Verlaine déjà évoquée (« Cae el llanto en mi corazón como la lluvia en la ciudad »), disons que toutes ces évocations montrent une parfaite adéquation entre le temps qu‟il fait et l‟état d‟esprit du personnage. Dans une représentation symbolique quelque peu éculée, la pluie, présente ponctuellement tout du long du récit, sert à marquer un peu plus la mélancolie du personnage. Même les récits les plus noirs mettent en scène une projection du moi sur l‟espace. A la toute fin de Entre el miedo y las sombras, d‟Amir Valle, le personnage de Milton regarde, un peu désabusé, le paysage nocturne, alors que l‟enquête policière est arrivée à son terme et a révélé, une fois de plus, les côtés les plus sombres de l‟humanité : « Milton mira hacia la noche […]. Respira el aroma que le llega, frío, desde el mar […]. Las primeras putas han llegado ya al Malecñn y se sientan sobre el muro […]. La Habana, en silencio y resignada, entre el miedo y las sombras, también las mira »1068. Ce passage, qui clôt le roman, marque une pause finale au sein de la diégèse ; c‟est un moment de réflexion et de contemplation, après un récit qui s‟est accéléré. Le narrateur projette sur la ville les pensées du personnage, c‟est pourquoi il la personnifie (« resignada », « miedo », « mira »). Ces termes renvoient bien sûr au point de vue du protagoniste. On 1065 Senel Paz, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, op. cit., p. 46. Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 309. 1067 « Llovìa con fuerza, como llueve en La Habana durante la temporada de lluvias […] », ibid., p. 7. 1068 Amir Valle, Entre el miedo y las sombras, op. cit., p. 157. 1066 335 remarquera, enfin, que les tout derniers mots du récit sont aussi le titre du roman. De façon peut-être plus inattendue, les œuvres de Gutiérrez comptent aussi des moments de contemplation, qui sont le signe d‟un débordement, voire d‟une inondation, du moi sur le monde. Comme par mimétisme, la ville apparaît au spectateur en lui montrant ce qu‟il veut bien y voir. Depuis sa fenêtre, Sandra, le travesti de El rey de La Habana, contemple la ville. Elle vient de rencontrer Rey et se sent bien : Sandra se asomó a la ventana, [...] admirando la belleza derruida del barrio de Jesús María : los edificios de sólo dos o tres plantas, muy antiguos y arruinados. Los patios enormes, con grandes árboles : ceibas, mangos, mamoncillos. El leve ruido del barrio, sin tráfico alguno. La luz intensa de la maðana. […] La sensualidad de los olores. [...] Se sentía bien.1069 Son regard se pose sur les vieux immeubles du quartier et les grands arbres. L‟oxymore « belleza derruida » montre bien l‟ambivalence du décor urbain qui peut être tout et son contraire. Les ruines se font belles, les odeurs sensuelles et le bruit de la ville est imperceptible. Rien ne vient contrarier ce moment contemplatif ; tout est calme et silencieux, propice au bien-être. Parce qu‟il est subjectif, le paysage urbain se caractérise donc par une certaine variabilité. Celle-ci est explicitement exprimée dans les œuvres de Padura où le personnage de Mario Conde décrypte la ville en fonction des circonstances. La Havane pourra ainsi être source de langueur, d‟aversion, de sérénité, de réconfort et, plus rarement, de bienêtre : « Desde el carro la ciudad le parece más sosegada, más promisoria y hasta más limpia, aunque duda de la validez circunstancial de sus apreciaciones. […] se siente feliz, conducido y tranquilo […] »1070. Comme le dit le narrateur, le jugement porté sur la ville est déterminé par différents facteurs contextuels. En l‟occurrence, le policier est accompagné de la jeune et belle Karina, ils écoutent du jazz et Conde voit le paysage urbain défiler. Ce passage est l‟un des rares à exprimer le bonheur du détective, plutôt enclin à la mélancolie habituellement. Un peu après, la narration change pour mieux montrer son point de vue sur la ville : […] mi relaciñn con la ciudad se ha marcado por los claroscuros que le van pintando mis ojos […]. Por eso sé que es pasajera, mortal, la ruinosa belleza […] y la paz aparente de una ciudad que por ahora veo con los ojos del amor y se atreve a descubrirme esas alegrías inesperadas de su fastuosa prosapia. Me gustaría ver con tus ojos la ciudad, me dijo ella […], y pienso que sì, que serìa hermoso y lúgubre […] mostrarle mi ciudad, pero ya sé que es imposible, pues ella nunca podrá calzar mis 1069 1070 Pedro Juan Gutiérrez, El Rey de La Habana, op. cit., p. 66. Leonardo Padura Fuentes, Vientos de cuaresma, op. cit., p. 89. 336 anteojos, está desbordada de felicidad, y la ciudad no se le va a revelar.1071 La métaphore de la peinture, des yeux et des lunettes que l‟on pourrait interchanger rend bien l‟ambivalence du jugement qui est porté sur la ville. L‟antithèse « hermoso y lúgubre » l‟énonce aussi clairement. Une même ville peut ainsi produire des paysages différents comme le montre le possessif dans « mi ciudad ». Chacun porte en lui sa propre Havane et celle-ci change en fonction de l‟état d‟esprit et du caractère des personnages1072. La ville étant un espace vécu, elle n‟est donc jamais neutre et se distingue par son instabilité. Mais chez Padura la cité est bien plus qu‟une simple projection, elle entre véritablement en symbiose avec le personnage. Il est, par exemple, question d‟une union très profonde entre le détective et La Havane : « […] el Conde sintiñ otra vez la comunión sentimental que lo ligaba a aquella calle mal pintada y sucia en la que faltaban ya muchos jirones de sus propias remembranzas […] »1073. L‟affection et l‟attachement ressentis ont été forgés par toutes ces années de pratique urbaine. Les souvenirs, qui rapprochent la ville et celui qui l‟habite, font que l‟espace est ici un lien avec le passé. Mais l‟espace envisagé comme le support de la mémoire individuelle entraîne aussi l‟éloignement entre le protagoniste et la capitale actuelle. Nous avons déjà souligné l‟impression de décalage ressentie à plusieurs reprises par Mario Conde. Cela dit, constater les changements qui marquent la physionomie de la ville est aussi un moyen de s‟interroger sur sa propre existence et sur le temps écoulé. Dans cette perspective, la ville et le personnage se définissent l‟un l‟autre. L‟espace n‟est plus seulement une projection, il devient un double du personnage : Todo se ennegrece con el tiempo, como la ciudad por la que camino, entre soportales sucios, basureros petrificados, paredes descascaradas hasta el hueso, alcantarillas desbordadas como ríos nacidos en los mismísimos infiernos y balcones desvalidos, sostenidos por muletas. Al final nos parecemos la ciudad que me escogió y yo, el escogido : nos morimos un poco, todos los días, de una muerte prematura y larga hecha de pequeñas heridas, dolores que crecen, tumores que avanzan… Y aunque me quiera rebelar, esta ciudad me tiene agarrado por el cuello y me domina, con sus últimos misterios.1074 1071 Ibid., p. 138. Il est intéressant d‟observer que l‟urbaniste et architecte américain, Kevin Lynch, a une conception similaire de la ville : « Aucun élément n‟est vécu par lui-même ; il se révèle toujours lié à son environnement, à la séquence d‟événements qui y ont conduit, au souvenir d‟expériences passées. Chaque habitant a eu des rapports avec des parties définies de sa ville, et l‟image qu‟il en a est baignée de souvenirs et de significations », Kevin Lynch, « Structure de la perception urbaine », in Françoise Choay, L’urbanisme. Utopies et réalités. Une anthologie, Paris, Editions du Seuil, 1965, p. 385. 1073 Leonardo Padura Fuentes, Vientos de cuaresma, op. cit., p. 85. C‟est nous qui soulignons. 1074 Ibid., p. 138. 1072 337 L‟effet de miroir entre La Havane en ruines et le détective fatigué est rendu par un parallélisme : les douleurs physiques du protagoniste font écho aux dommages matériels de la ville (saleté, vétusté, ruines). D‟ailleurs, le narrateur passe du « je » au « nous » pour signifier que tous deux vieillissent ensemble, simultanément. A ce processus d‟identification s‟ajoute une personnification qui dote la ville d‟une volonté propre. C‟est elle qui choisit ses habitants et les domine, dans une relation asymétrique. Tous ces exemples montrent que le paysage urbain est tantôt une projection, tantôt une intériorisation, tantôt une identification. Dans tous les cas, l‟interdépendance qui unit la ville et l‟individu apparaît nettement : d‟une part le citadin a besoin de s‟inscrire et de se définir dans un espace. D‟autre part, c‟est lui qui, en l‟observant, remodèle la cité pour la créer à son image. Cet attachement qui unit un personnage à une ville devient évident lorsque le paysage se transforme en espace affectif. 3- Un espace affectif Nombre d‟auteurs vont témoigner de leur attachement à la ville en l‟écrivant abondamment. On pense, notamment, à Carpentier, Cabrera Infante, Padura ou encore Abilio Estévez. « […] esta Habana que amo más que cualquier otra ciudad en el mundo […] »1075, disait d‟ailleurs Alejo Carpentier, dans un article paru dans le journal Tiempo en 1940. Cette affection se manifeste de différentes manières, soit par une attention portée à la ville, notamment lorsqu‟elle devient une géographie de la nostalgie, nous l‟avons vu dans notre deuxième partie, soit par l‟expression explicite de cet amour. Cela apparaît de différentes façons dans les œuvres de fiction qui nous intéressent. On se souvient de la formule de Cabrera Infante, « Dos matrias tengo yo : La Habana y la noche »1076, qui résume parfaitement le lien fusionnel qui unit le personnage à la capitale cubaine. Cette relation étroite, l‟écrivain l‟exprime à diverses reprises tout au long de ce récit autobiographique, en jouant sur le sens du mot « desmadre », par exemple, lorsqu‟il dit : « La Habana es una fijaciñn en mì […]. Dos desmadres tengo yo, la ciudad y la noche »1077 ; lorsqu‟il oppose la ville à la campagne : « Yo que odiaba el campo tanto como amaba la ciudad »1078 ; ou encore quand il montre que la capitale est le sens de son existence : « La Habana no sólo era mi fin y mi principio sino mi 1075 Alejo Carpentier, El amor a la ciudad. La Habana de Alejo Carpentier, op. cit., p. 64. Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 425. 1077 Ibid., p. 461. 1078 Ibid., p. 468. 1076 338 medio »1079. Dans ce récit, qui peut se lire comme une déclaration d‟amour à La Havane, la ville est louée parce qu‟elle a façonné le personnage. L‟écrivain formulera d‟ailleurs explicitement cette idée dans l‟introduction de El libro de las ciudades (1999) : « El hombre no inventó la ciudad, más bien la ciudad creó al hombre y sus costumbres »1080. Si la ville a créé l‟homme, c‟est pourtant bien l‟écrivain qui recrée la capitale cubaine dans La Habana para un infante difunto. Sous sa plume, elle devient le lieu de l‟expérience et de l‟initiation, et, si elle est aimée, c‟est en partie parce qu‟elle est intimement liée aux trajectoires sentimentales du protagoniste. Comme nous l‟avons dit, écrire la ville lui donne l‟occasion de s‟écrire soi-même. C‟est dans cet effet de miroir qu‟il faut déchiffrer l‟attachement de Cabrera à La Havane. Pedro Juan Gutiérrez considère aussi que l‟amour que l‟on ressent pour une ville est lié aux expériences vécues et aux sentiments éprouvés en ce lieu. Ses récits autofictionnels lui permettent d‟exprimer clairement son attachement personnel : « Se ama una ciudad si allí has sido feliz y has sufrido. Si has amado y odiado. [...] Si no tienes historia donde vives eres un grano de polvo volando al viento »1081. Espace de l‟affect, la cité serait une surface sur laquelle s‟imprimeraient les souvenirs et les émotions ressenties. Elle est attachante parce qu‟elle rappelle au personnage qu‟ils ont un passé commun. Comme Cabrera, Gutiérrez estime que c‟est la ville qui façonne l‟individu, c‟est même elle qui le fait exister en le définissant. On retrouve, par ailleurs, chez les deux auteurs, un trope assez commun qui va permettre de rendre encore plus explicite (mais plus ambigu) l‟amour ressenti pour la ville : la personnification de La Havane. Lorsque le personnage Pedro Juan explique : « Se cae a pedazos, pero es hermosa esta cabrona ciudad donde he amado y odiado tanto »1082, c‟est, en fait, l‟ambivalence de ses sentiments à l‟égard des autres qu‟il projette sur la ville. L‟amour et la haine ressentis, c‟est-à-dire son expérience personnelle, semblent déteindre sur l‟espace urbain. L‟insulte prend alors tout son sens : elle reflète ces sentiments contradictoires et fait de La Havane un espace émotionnel. Ajoutons que cette peinture poétique et affective de La Havane nuance le pessimisme du réalisme sale. A cet égard, Milagros Sánchez Arnosi explique que seul le paysage échappe à l‟écriture pessimiste et violente de l‟auteur : Lo único que escapa a esta visión escatológica es la poetización del paisaje cubano, bálsamo en una prosa descarnada, directa y con un acento muy personal, reveladora de un desbordante optimismo, a pesar de que la 1079 Ibid., p. 472. Id., El libro de la ciudades, op. cit., p. 13. 1081 Pedro Juan Gutiérrez, Animal tropical, op. cit., p. 37. 1082 Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 206. 1080 339 vida « no alcanza para vivirla y comprenderla », eso sí desde la certidumbre de que, irremediablemente, Cuba es el paraíso perdido.1083 Selon la critique, le traitement spatial porterait même les marques d‟un certain optimisme. Effectivement, dans la prose de cet auteur, c‟est le seul élément sublimé. Dans un registre très différent, Padura associe également le corps féminin à l‟espace urbain pour montrer l‟ambiguïté des sentiments que l‟on éprouve à l‟égard de la ville. A la fin de Paisaje de otoño, le narrateur s‟interroge : « ¿ Qué quedaría de aquella ciudad castigada y envejecida que el Conde llevaba en su corazón a pesar de no tener correspondencia en sus proporciones amatorias ? »1084. Mario Conde est attaché à une ville qui est un peu à son image : défraîchie et fatiguée. En suggérant que le protagoniste donne plus d‟amour à la ville qu‟il n‟en reçoit en échange, le narrateur montre qu‟il s‟agit d‟une relation à sens unique et donc inégale. Le personnage fait figure d‟amant malheureux et la ville de maîtresse ingrate. On retrouve ici la supériorité de la cité dans un schéma dominant/dominé déjà relevé auparavant dans Vientos de cuaresma, du même auteur. De manière plus générale, cet attachement inconditionnel pour un espace décati et inhospitalier, prouve, une fois de plus, que le détective est un personnage sentimental qui s‟attache aux choses et aux gens. Enfin, c‟est de manière plus ou moins caricaturale que Zoé Valdés anthropomorphise La Havane pour exprimer l‟attachement de deux personnages, dans Te di la vida entera. En adoptant le point de vue de Cuca Martínez, tout d‟abord, la narratrice explique : « Eso tiene La Habana, mientras más la caminas, más la quieres. Nunca te aburres, más bella la encuentras, porque en cada ocasión te aguarda una aventura distinta, una seducción que te hace batido de mamey del corazón »1085. Pour souligner la beauté de la ville des années cinquante, la narratrice emprunte le lexique de la séduction. Elle personnifie la cité et en fait quelque chose à la fois d‟irrésistible et de surprenant mais qui s‟apprivoise progressivement. Il faut pratiquer l‟espace pour succomber à ses charmes. Cette féminisation de la ville est encore plus patente lorsque la narration omnisciente adopte le point de vue de El Uan : « […] se morìa de amor por ella [Cuca Martínez]. Y por su ciudad. Como si mujer fuera sinónimo de ciudad. Y la ciudad tuviera útero »1086. Le narrateur reprend une image assez fréquente Ŕ nous avons déjà eu l‟occasion d‟en relever quelques occurrences Ŕ, celle d‟une ville qui prend corps et se confond avec la femme aimée. La confusion des sentiments de Juan Pérez (El Uan) est visible dans cette 1083 Milagros Sánchez Arnosi, « Trilogía sucia de La Habana », in Cuadernos hispanoamericanos, n° 584, février 1999, p. 150. 1084 Leonardo Padura Fuentes, Paisaje de otoño, op. cit., p. 258, 259. 1085 Zoé Valdés, Te di la vida entera, op. cit., p. 72. 1086 Ibid., p. 90. 340 association femme/ville. Cette assimilation se renforcera quand il quittera l‟Île et Cuca simultanément pour émigrer aux Etats-Unis où il fondera une famille. La personnification, voire l‟érotisation, de la ville semblent nécessaires pour traduire l‟attachement à l‟espace. Dans une relation affective, les personnages projettent sur le territoire urbain leurs expériences émotionnelles et dessinent une géographie sentimentale. La Havane devient un espace investi qui traduit, une fois de plus, une extériorisation de l‟individu. Nous aurons montré dans cette première partie, qu‟en devenant paysage, la ville était toujours une projection du personnage. C‟est parce qu‟elle révèle l‟humeur, les états d‟âme et les expériences émotionnelles de ce dernier que l‟on peut dire que c‟est l‟observateur qui fonde l‟espace urbain. Dans ces conditions, la transposition du moi sur le paysage sert davantage à construire un personnage, à lui donner de l‟épaisseur, qu‟à caractériser la ville. Après avoir montré comment l‟espace devenait paysage, nous allons voir à présent comment celui-ci s‟écrit. Chapitre 2 : Les écritures du paysage 1- La ville représentée a- Tableaux urbains La description est une appréhension par le langage d‟un motif regardé. Aussi, analyser les écritures de la ville signifie s‟interroger sur les moyens mis en place par le narrateur (ou descripteur) pour fabriquer un paysage littéraire. En nous penchant sur certains procédés stylistiques très présents dans notre corpus, comme l‟ekphrasis et l‟hyperbole, nous verrons comment la ville est représentée. Puis, nous étudierons les différents styles littéraires qui caractérisent l‟écriture de La Havane. Selon la définition de Philippe Hamon, l‟ekphrasis, déjà évoquée auparavant, « désigne la description d‟une œuvre d‟art réelle, rencontrée, ou simplement rêvée par les personnages de la fiction, telle qu‟elle apparaît dans une œuvre littéraire »1087. L‟exemple toujours cité pour illustrer ce procédé est la fameuse description du bouclier d‟Achille faite par Homère, dans 1087 Philippe Hamon, La description littéraire. De l’Antiquité à Roland Barthes : une anthologie, op. cit., p. 112. 341 l‟Iliade. Il s‟agit à la fois de faire voir au lecteur mais aussi de s‟adonner à un exercice de style, de montrer un savoir faire rhétorique, comme l‟a remarqué Philippe Hamon1088. L‟ekphrasis est la représentation d‟un paysage qui est déjà lui-même une représentation, comme nous l‟avons vu dans le premier chapitre de cette partie. Il s‟agit donc d‟une mise en abyme de l‟espace. Celle-ci se manifeste de deux manières différentes dans les œuvres : l‟ekphrasis traditionnelle, entendue comme description d‟une œuvre d‟art, apparaît à plusieurs reprises ; mais c‟est surtout l‟acception plus moderne de ce procédé qui marque les textes qui nous occupent, celle d‟une description d‟un paysage à la manière d‟une œuvre d‟art. Nous trouvons des ekphraseis, au sens originel du terme, lorsque La Havane est décrite alors qu‟elle est représentée sur un tableau, une photo ou même une carte topographique. Dans Memorias del subdesarrollo, il est question d‟un tableau du peintre cubain René Portocarrero que le protagoniste possède : Ahora estoy mirando el pequeño cuadro de La Habana que le compramos a Portocarrero : es mucho más atractivo que la ciudad. Hay más colorido, está mejor compuesto. La Habana no tiene esos colores. La Habana es blanca, amarilla, está llena de colores pálidos, desvaídos o sucios : verdes, azules, grises, rosados. Hay edificios de todo tipo, no sólo coloniales con balcones y gruesos balaústres y vitrales y lámparas, como pinta Portocarrero. Ha escogido lo que le interesa de la ciudad y le ha dado los colores que tiene en su imaginación. Todo el mundo tiene una ciudad distinta en la cabeza.1089 Le personnage confronte la réalité environnante et La Havane de Portocarrero pour montrer que la ville représentée, et donc imaginée, est plus belle, plus éclatante et moins sinistre. Dans un jeu antithétique il oppose les « couleurs vives » de la peinture aux coloris ternes de la capitale. Il évoque le mélange architectural représenté par l‟artiste pour expliquer que la ville est en réalité beaucoup moins riche. Ce patchwork pictural correspond à une vision personnelle et idéalisée de l‟espace. Il ne se veut pas fidèle à la réalité mais plutôt en accord avec l‟imagination. L‟ekphrasis se substitue ici à une description de la ville réelle et montre de la sorte le désintérêt, voire le rejet, du personnage à l‟égard de La Havane révolutionnaire. Juste avant ce passage descriptif, alors qu‟il regardait la ville depuis son balcon, il expliquait : « Todo es tan aburrido, no sé por qué lo estoy describiendo »1090. Il cesse de parler de ce qu‟il 1088 Id., Du descriptif, op. cit., p. 13. Edmundo Desnoes, Memorias del subdesarrollo, op. cit., p. 135. 1090 Loc. cit. 1089 342 voit à l‟extérieur pour se réfugier chez lui et donc ignorer la réalité. Tel un esthète, il préfère la beauté de l‟œuvre d‟art qui sublime le réel. Les cartes topographiques de La Havane donnent aussi lieu à des ekphraseis. Nous trouvons une description de l‟une d‟elles dans Vista del amanecer en el trópico où il est question d‟une carte du XVIIIème siècle, qui date d‟avant la prise de la ville par les Anglais (1762) : He aquì un mapa hecho pocos dìas […] antes del ataque inglés a la capital de la isla. Como se puede ver el mapa es más bien grosero, pero llena muy bien su cometido, ya que se señalan con precisión las fortalezas del Morro y La Cabaña, al cruzar la bahía, y las fortalezas propiamente habaneras de La Punta, el Castillo de Atarés y el Torreón de San Lázaro. Se puede observar como distorsiona el mapa las características de la ciudad propiamente dicha y sus alrededores. Se cree que dicho mapa fue hecho por un espía inglés.1091 Le narrateur décrit la carte en énumérant les édifices historiques qui y figurent. Ils servent de repères. Cette carte fait la part belle aux bâtisses militaires et néglige les abords de La Havane. C‟est pourquoi on imagine qu‟elle aurait pu servir aux Anglais pour la prise de la ville. L‟ekphrasis permet ici de raconter un épisode de l‟histoire du pays à travers un élément anecdotique, une carte mal proportionnée. C‟est une fonction toute différente que revêt la carte historique de la ville qui apparaît dans la nouvelle « Un arte de hacer ruinas ». Alors que le personnage se trouve chez son directeur de thèse, il découvre une carte du XIXème siècle : « […] alcancé a examinar un plano antiguo colgado entre los libros. Representaba la parte más vieja de la ciudad y llevaba una fecha : 1832. […] Aquel plano describìa el itinerario del cólera, el avance de la muerte por la ciudad »1092. Le directeur de thèse explique que cette carte, qui rappelle un épisode douloureux de l‟histoire de la capitale, a été achetée dans une boutique située à l‟angle des rues Cuba et Lamparilla. Plus tard, il donnera même le nom de cet établissement : « Bodega de Rincón ». Tous ces éléments, tout d‟abord anodins, deviennent énigmatiques : le professeur explique au protagoniste que s‟il se réveille en 1832, pendant l‟épidémie de choléra, ce dernier saura où aller pour acheter cette carte et échapper à la maladie : « […] sabes que en la bodega de Rincñn, en Cuba y Lamparilla, te la cambian [la moneda] por un plano que va a guiarte en ese laberinto »1093. Tous ces détails s‟éclairent rétrospectivement à la fin de la nouvelle et acquièrent une dimension prophétique. Lorsque le personnage est perdu dans Tuguria, il s‟aperçoit soudainement qu‟il se trouve à l‟angle de ces deux rues mais sous terre : « […] me acordé, sin razñn, de la esquina de Cuba y Lamparilla. O 1091 Guillermo Cabrera Infante, Vista del amanecer en el trópico, op. cit., p. 17. Antonio José Ponte, « Un arte de hacer ruinas », in Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, op. cit., p. 59. 1093 Ibid., p. 61. 1092 343 con no menos razón que la de estar en aquel sitio bajo tierra »1094. L‟allusion à la carte, disséminée tout au long du récit, joue un rôle primordial car elle contribue au caractère fantastique de la nouvelle. Dans un exercice similaire, des photos de la capitale sont également décrites dans les romans. Un exemple retient particulièrement notre attention car il accorde une place importante à la ville : Las palabras perdidas, de Jesús Dìaz. Il s‟agit d‟une photo de la place de la Révolution accrochée dans le bureau du directeur d‟une revue littéraire : « El Flaco […] mirñ hacia la tercera pared, cubierta por una foto mural en la que la Plaza de la Revolución aparecía colmada por más de un millón de personas »1095. C‟est une véritable mise en abyme car la pièce où elle se trouve donne directement sur la place de la révolution. A la fin du récit, on trouve une description un peu plus précise de cette même photo : « Estaba tomada desde la cúspide del monumento a Martí y abarcaba todo el espacio de la Plaza y sus alrededores, cubierto por más de un millón de personas »1096. Cette prise de vue zénithale, qui tend à rendre la monumentalité de la place, capte un moment historique : il s‟agit sans doute d‟un des nombreux rassemblements de personnes qui avaient lieu lors des discours de Fidel Castro. L‟auteur insiste sur cette photo pour mieux souligner les positions idéologiques de celui qui la possède. Le directeur est, en effet, un révolutionnaire convaincu et il considère cette place comme un véritable symbole : « Esa es nuestra plaza, el símbolo de nuestra democracia socialista… »1097, dit-il à El Flaco qui regardait la photo. Par un effet d‟association métonymique, le cliché devient l‟emblème de la Révolution. Les extraits cités, qui décrivent la ville représentée, montrent un paysage urbain figé et comme soustrait à la vie. Fonctionnant sur le principe des instantanées, ils révèlent une réalité historique précise et sont porteurs de sens au sein du récit. Le deuxième type d‟ekphraseis que l‟on trouve n‟est plus celui d‟une illustration de La Havane mais d‟un espace envisagé comme un tableau. Là encore, le narrateur adopte le point de vue d‟un personnage pour créer l‟ekphrasis et souligner la beauté du paysage contemplé. Ainsi dans Don Aniceto el tendero, de Meza, c‟est le regard de la jeune Marìa et de son prétendant, Emilio, qui orientent la lecture de la ville : 1094 Ibid., p. 72 Jesús Díaz; Las palabras perdidas, op. cit., p. 71. 1096 Ibid., p. 332. 1097 Loc. cit. 1095 344 La ciudad teñida de gris por las penumbras de la tarde, dibujaba sobre el cielo iluminado por las últimas y amarillentas claridades del crepúsculo, el irregular zigzag que en su parte alta trazaba el hacinamiento de las construcciones. En el azul oscuro, que había invadido ya el cielo por oriente, brillaba hermosísimo un lucero. La tarde moría en silencio, imprimiendo a todo cierto sello de melancolìa contagiosa, invencible. […] Poco a poco la parte más baja de la ciudad tornóse una masa informe ; sólo el variado e irregular contorno de la cima se dibujaba limpio sobre el fondo de color indefinible, mezcla del amarillo, del escarlata, del azul… […] Marìa y Emilio no hablaban ; embargados por la emociñn, habìanse olvidado de todo.1098 Cette description très poétique du crépuscule fait la part belle aux nuances chromatiques. Toutes les couleurs du ciel sont décrites précisément. Par ailleurs, l‟allusion métaphorique au dessin (« teñida », « dibujaba », « trazaba », « imprimiendo », « el contorno ») nous place devant une véritable œuvre d‟art, un tableau figé car, malgré le verbe « tornóse », qui souligne un changement, la ville ainsi observée semble immobile, comme suspendue dans le temps. On remarquera là aussi une concordance entre le paysage harmonieux et paisible de cette fin de journée et le bien-être des jeunes gens qui, tout entiers à leur contemplation, ne souhaitent pas rompre le silence qu‟impose ce spectacle. A ce propos, l‟image de la lumière qui imprègnerait la ville de sa mélancolie témoigne d‟un besoin d‟« anthropomorphiser » le paysage pour le rendre semblable à l‟état d‟âme des personnages. D‟un point de vue formel, le rythme lent des phrases et l‟allitération en « s » marquent, une fois de plus, la douceur de ce moment. Dans ce roman, l‟azotea n‟est pas le seul mirador qui donne aux personnages suffisamment de hauteur pour regarder la ville ; la fenêtre offre également un point de vue panoramique : [María] estuvo un rato con la cara pegada al marco y mirando con fijeza hacia las azoteas del frente. La luz del sol, aunque bastante alto ya, cortaba en secciones diagonales los blancos muros. Un alto mirador almenado […] recortaba su elegante silueta sobre el cielo de un azul claro, transparente. De algunos muros, erizados de vidrios, salían, como de gigantesco collar de diamantes, tendido entre los oscuros tejados y las habitaciones altas pintadas de color vario, deslumbradores destellos de luz. […] En el fondo, semejando hermosa faja azul cortada por las últimas construcciones de la ciudad se veía el mar. Y dominándolo todo, sobre su verde colina alzábase el murallón gris de la Cabaña. Al lado del faro del Morro, las banderas que señalaban los buques descubiertos por el catalejo del vigía, parecían pequeñas pinceladas azules, amarillas, rojas, sobre la masa nácar formada por grandes nubes. […] Pero Marìa nada de esto observaba. Su mirada continuaba fija en una azotea situada sólo a algunos pasos de la ventana que le servía de observatorio.1099 1098 1099 Ramón Meza, Don Aniceto el tendero, op. cit., p. 120. Ibid., p. 66. 345 Sur le fond, nous retrouvons la même attention portée aux couleurs et aux formes qui se détachent du paysage, ainsi que la métaphore picturale (« secciones diagonales », « recortaba », « pintadas », « pinceladas »). Sur la forme, les sonorités douces et le rythme fluide des propositions sont similaires à ceux observés dans l‟extrait précédent. Mais ici, une attention particulière est portée à la situation topographique des éléments qui composent ce paysage (« en el fondo », « al lado », « situada »). De plus, des métaphores sophistiquées (« collar de diamantes », « masa nácar ») rendent le style encore plus précieux. Enfin, le narrateur a inséré ce passage descriptif entre deux allusions à la fenêtre servant de poste d‟observation, comme pour circonscrire distinctement l‟ekphrasis. L‟encadrement évoqué au tout début de l‟extrait cité rappelle le cadre d‟un tableau ; il permet de construire et de structurer le paysage car, comme l‟a souligné Anne Cauquelin : « […] la fenêtre, le cadre, sont des „passes‟ pour les vedute, pour y voir du paysage là où sans eux il n‟y aurait que… la nature »1100. La fenêtre fabrique donc la « vue », la représentation perspective de la ville, c‟est elle qui transforme l‟espace en paysage. Contempler la ville depuis une fenêtre est un motif assez fréquent (tout comme la description depuis une terrasse) qui traverse les siècles. On la retrouve ainsi chez Padura chez qui Mario Conde regarde souvent La Havane de son appartement : Colgado de la nostalgia, el Conde miraba el inalterable paisaje que se le ofrecía desde la ventana de su cubículo : copas de árboles, el campanario de una iglesia, los pisos altos de varios edificios, y la eterna y retadora promesa del mar, siempre al fondo, siempre inalcanzable […]. Le gustaba aquel paisaje recortado por el marco de la ventana, tan bucólico y solícito, ahora difuso bajo la luz plana y calcinante de agosto, porque le permitía pensar y, sobre todo, recordar, y él sí era un cabrón recordador. 1101 Nous trouvons là presque tous les éléments propres à l‟ekphrasis : l‟allusion explicite à un paysage agréable, la fenêtre faisant office de cadre, une description précise de ce que l‟on voit, des détails chromatiques, une écriture fluide qui rend formellement l‟harmonie de la scène. Figée elle aussi, La Havane de Conde est une estampe propice à l‟introspection et à la réminiscence. C‟est aussi d‟une fenêtre qu‟Alisio regarde la ville en ruines, dans Perversiones en el Prado : Alisio observa desde el ventanal de su apartamento el espectáculo del fin de tarde. Lo que aún resta del sol recalienta las techumbres del Prado, convierte las paredes en amasijos de cal. El sol se destila entre las grietas 1100 1101 Anne Cauquelin, L’invention du paysage, Paris, Plon, 1989, p. 122. Leonardo Padura Fuentes, Máscaras, op. cit., p. 113. 346 y seca los ladrillos, todo no es más que exhausta consunción, y La Habana en pleno es cómplice para dejarse abatir su paisaje, en el desfallecer de los frontones, templos, dinteles, cartujas, […] desplomes que repercuten con una perspectiva cambiante, que se abre espacios donde la gente mira la fatalidad.1102 Pour parler de La Havane, le narrateur emploie les termes « spectacle », « paysage » et « perspective », comme pour la mettre à distance. Le personnage donne l‟impression de ne pas observer la réalité mais une représentation du réel. La ville qui s‟écroule devient, malgré tout, un paysage poétique qui évolue : en fonction des éboulements, le panorama urbain change. D‟ailleurs, il est ici nullement question de regretter cette détérioration, simplement de constater les conséquences d‟un point de vue esthétique. Enfin, on ne s‟étonnera pas de trouver aussi, chez Pedro Juan Gutiérrez, plusieurs ekphraseis qui transforment la capitale en vue panoramique. Ainsi, lorsqu‟il est à Casablanca, de l‟autre côté de la baie, Rey contemple la ville et apprécie la beauté du paysage : Desde allí divisaba muy bien toda la bahía. [...] Con la vista abarcaba todos los muelles, los buques, la gente minúscula moviéndose, los camiones, las pequeñas lanchitas de pescadores, muchos caminando por el Malecón, y más allá, la ciudad. La inmensa ciudad que se perdía de vista entre la bruma de la humedad y el resplandor de la luz solar cegadora. A la derecha, los edificios altos y ruinosos de su barrio. Centro Habana seguía igual de hermosa y ajada, esperando que la maquillaran.1103 Cette vue, qu‟il embrasse complètement d‟un regard, ressemble à une maquette. Tout y est réduit par la distance, comme le suggèrent les adjectifs « minúscula » et « pequeñas ». Du reste, la brume et la lumière éclatante rendent la ville encore plus lointaine et presque irréelle. Quant à l‟antithèse (« hermosa y ajada »), elle rend toute la contradiction de ce paysage urbain qui s‟écroule mais qui n‟en garde pas moins une certaine beauté. Enfin, la personnification finale (« esperando que la maquillaran ») fige La Havane dans un temps en suspens, un présent éternel. Cette pause descriptive offre à Rey un statut de spectateur contemplatif qu‟il n‟a que très rarement. Toujours happé par le tumulte de son existence, le protagoniste n‟a presque jamais l‟occasion de s‟arrêter pour regarder la ville. D‟un point de vue narratif, ces descriptions sont aussi le moyen de ralentir une trame essentiellement marquée par l‟action. En effet, les personnages de ce roman, toujours en mouvement, agissent plus qu‟ils ne réfléchissent ; ils ne favorisent donc pas les pauses introspectives ou analytiques. On l‟aura compris, l‟ekphrasis caractérise des ouvrages d‟époque et de style très différents mais elle se 1102 1103 Miguel Mejides, Perversiones en el Prado, op. cit., p. 141. Pedro Juan Gutiérrez, El Rey de La Habana, op. cit., p. 36. 347 construit toujours plus ou moins de la même manière. Le narrateur porte une attention particulière à la lumière et aux couleurs, il décrit souvent le ciel, la mer et/ou les immeubles de la ville, le tout avec une prose douce et harmonieuse. S‟il ne nous paraît pas nécessaire de nous étendre davantage sur ces pauses narratives, il convient en revanche de relever d‟autres manières d‟intellectualiser le paysage urbain à travers des ekphraseis encore plus explicites. La ville n‟est pas seulement décrite à la manière d‟une œuvre d‟art, elle devient une œuvre d‟art. Les auteurs vont convoquer des peintres ou des styles picturaux pour parler de l‟espace. C‟est ainsi que Cabrera Infante fait de la tombée du jour un tableau de la Renaissance italienne : « La tarde se hace dorada […], las casas al atardecer cobrando color de cuadro de Bellini, al que prestaba contraste el cielo luminoso. (Puedo seguir, seguir con estas descripciones pictóricas, haciendo del tiempo paisaje, pero prefiero hablar de la carne hecha verba.) »1104. Avec distance, le narrateur montre qu‟il se livre à un exercice de style qu‟il pourrait tout à fait prolonger car il en maîtrise les codes. Mais il préfère interrompre la description du paysage pour parler de Julieta, une de ses conquêtes féminines. Alejo Carpentier, quant à lui, compare la ville à des tableaux cubistes, dans La consagración de la primavera : […] y cuando iba yo, conduciendo mi pequeðo automñvil, de la Plaza Vieja a mi escuela del Vedado, siguiendo la orilla del mar, parecía que los edificios giraran en torno mío, mostrándoseme desde todos sus ángulos Ŕ como en ciertos cuadros de Braque y de Gris mostraban los objetos la totalidad de sus facetas. Barroca en mi espíritu, La Habana se me hacía cubista […].1105 Le déplacement en voiture permet à Vera de reconsidérer la ville. Toutes les perspectives sont réunies sur un même plan, comme dans une œuvre cubiste. Les courbes, les arabesques, les volutes, les grilles de fer forgé ouvragé, qui caractérisent l‟architecture havanaise, disparaissent au profit de lignes droites. On retrouve cette vision moderniste de la ville dans un court extrait de En el cielo con diamantes, quand le narrateur fait allusion à l‟art abstrait pour parler du coucher de soleil : « Ya sentado en el malecón, [David] miraba al oriente y al poniente, y era como asistir a exposiciones de pintores abstractos »1106. Le paysage n‟est plus composé que de formes et de couleurs qui rendent la ville irréelle 1107. Le référent artistique 1104 Guillermo Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 240. Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, op. cit., p. 537. 1106 Senel Paz, En el cielo con diamantes, op. cit., p. 110. 1107 Dans El acoso, c‟est la chambre du guichetier du théâtre qui est conçue comme une œuvre d‟art abstraite : « el feo edificio moderno donde él vivía, debajo de las últimas chimeneas, en el cuarto de criadas cuyo tragaluz 1105 348 apparaît également dans un récit de Ponte, « Un seguidor de Montaigne mira La Habana » : « La perenne lluvia que cae entre la pared y el ojo que la mira hace entrar a las calles en lo pasado. Una fotografía de ciudad proyectada sobre un lienzo que el aire ondeara es mucho más corpórea que La Habana que se levanta hoy […] »1108. La pluie, qui tel un filtre s‟interpose entre la cité et le regard, fait perdre à la ville de sa réalité. La Havane est transformée en une photo projetée sur un écran et la projection se fait plus réelle que le modèle. L‟œuvre d‟art a plus de consistance que l‟espace authentique et concret. Nous pouvons ainsi dire que le narrateur déconstruit la ville pour recréer une image artificielle mais qui lui semble néanmoins plus tangible. De la même façon, l‟écrivain va figer l‟espace en en faisant un décor de cinéma : El sonido de las olas borraba todo ruido de la carretera y frente a la costa desembocaba la mayoría de los residuos líquidos de la ciudad. Sudor, saliva, sangre, orines, semen, mierda, se ligaban allí con el agua salada. En ese punto terminaba la vida habanera. Escorpión tuvo la sensación de que alguien lo miraba, de que pertenecía a un rodaje de exteriores. No sabía qué hacer frente a Dios o la cámara.1109 Ce fragment, qui clôt la nouvelle « Corazón de skitalietz », semble être une scène finale de film. Escorpión est face à la mer ; il écoute le bruit des vagues et observe les détritus d‟origine humaine se déverser dans l‟eau. L‟allusion à Dieu qui le regarderait ou à une caméra qui filmerait témoigne du besoin de se distancier de la réalité. Dans cette perspective, concevoir la ville comme un décor contribue à minorer, voire à nier, son existence. On trouvait déjà ce procédé chez Cabrera Infante quand lui aussi transformait la capitale en décor de cinéma. Les métaphores cinématographiques sont si nombreuses dans Tres tristes tigres que Christilla Vasserot parle d‟un roman qui « […] propose une série de rushes, des scènes tournées sous différents angles, disséminées dans l‟espace et dans le temps. Il revient au lecteur, vivement interpellé par l‟auteur, la tâche d‟effectuer le montage et de construire sa propre version »1110. Citons à titre d‟exemple un passage du chapitre intitulé « Los visitantes » où, dans un jeu rhétorique et ironique, le narrateur décrit l‟arrivée du couple d‟Américains, les Campbell. La description qui suit adopte le point de vue de la femme, qui est enchantée par La Havane : se pintaba, como una geometría más, entre los rombos, círculos y triángulos de una decoración abstracta Ŕ », Alejo Carpentier, El acoso, op. cit., p. 21. 1108 Antonio José Ponte, « Un seguidor de Montaigne mira La Habana », in Un seguidor de Montaigne mira La Habana. Las comidas profundas, op. cit., p. 40, 41. C‟est nous qui soulignons. 1109 Id., « Corazón de skitalietz », Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, op. cit., p. 191. C‟est nous qui soulignons. 1110 Chistilla Vasserot, « Le polylogue extérieur ou la narration barroque », in América : Cahiers du CRICCALLe néo-baroque cubain, n°20, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, p. 143. 349 La Habana lucía bellísima desde el barco. El mar estaba en calma, de un azul claro, casi celeste a veces, mechado por una costura morada, ancha […]. Habìa unas olas pequeðitas, espumosas, que parecìan gaviotas volando en un cielo invertido. La ciudad apareció de pronto, blanca, vertiginosa. Había nubes sucias en el cielo, pero el sol brillaba afuera y La Habana no era una ciudad sino un espejismo de una ciudad, un fantasma. Luego se abrió hacia los lados y fueron apareciendo unos colores rápidos que se fundían enseguida en el blanco soleado. Era un panorama, un CinemaScope real, el cinerama de la vida […].1111 Les hyperboles et les métaphores pompeuses moquent l‟enthousiasme de Mrs. Campbell. Mais ce pastiche d‟ekphrasis, qui décrit précisément la mer et la ville vue d‟un bateau, introduit aussi un motif qui sera récurrent chez Cabrera : la transformation du paysage en décor. Dans une mise en scène toute cinématographique, la cité apparaît soudainement aux personnages. Et progressivement, La Havane va se dématérialiser : la lumière solaire transforme la ville en mirage illusoire. La narratrice exprime cette étrange impression à l‟aide d‟oxymores qui renvoient explicitement au cinéma : « un Cinemascope real » et « el cinerama de la vida ». Le paysage pourtant bien réel devient une prise de vue filmique, un plan fixe qui, une fois de plus, fige la ville. L‟autre procédé utilisé par l‟écrivain est celui du travelling. L‟impression d‟un décor qui défile est évidente lors des déplacements en voiture : « Con él [Eloy Santos], en su vehículo temporal, viajamos todo el trayecto de la ruta 23, desde Águila y Reina y Estrella hasta El Vedado […] todo el tiempo estuve ocupado en ver pasar a los lados el petrificado paisaje urbano »1112. Le personnage est spectateur et observe la variation des paysages urbains. Mais, paradoxalement, chaque plan est fixe et la ville qui défile reste immobile. De plus, le mouvement des personnages accentue la fixité de ce décor. Ici aussi, nous pouvons dire que l‟œuvre d‟art anéantit son modèle. Cela est encore plus manifeste dans un extrait de Tres tristes tigres où le narrateur parle explicitement de travelling : […] el Malecñn, en el carro de Cué que se desliza como un travelling del castillito de La Chorrera a los frontones del Vedado Ténis, el continuo Malecñn ahora y siempre a la izquierda, hasta que demos la vuelta […] y a la derecha el hotel Riviera que es un estuche cuadrado con un jabón de baño azul al lado : el huevo veteado del roc : el domo de placer del salón de juego, y la gasolinera frente a la rotonda a veces asesina : esa estación de servicio que es un oasis de luz en las noches del negro y desierto Malecón, y al fondo el mar siempre y por sobre todo, el cielo embellecedor, que es otro domo veteado : el huevo del roc del universo, un infinito jabón azul.1113 1111 Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 196. Id., La Habana para un infante difunto, op. cit., p. 16. 1113 Id., Tres tristes tigres, op. cit., p. 319. C‟est nous qui soulignons. 1112 350 Nous avons là une ekphrasis qui décrit précisément, tout en situant géographiquement (« a la izquierda », « al lado », « frente a », « al fondo », « por sobre todo »). La poésie transparaît dans les métaphores à la fois prosaïques et lyriques qui comparent, par exemple, l‟hôtel Riviera à un coffret, son dôme à un savon, une station-service à une oasis, le ciel à une coupole, etc. Toutes ces images esthétisent l‟espace urbain et en font un vrai décor cinématographique. Ici aussi La Havane est une scène immobile où seuls les personnages se déplacent, ne captant que des images éparses du décor. Le mouvement ne donne pas vie au paysage mais l‟anéantit complètement. Ces exemples de transformation de la ville en œuvre d‟art témoignent d‟une forte esthétisation et intellectualisation de l‟espace. Plus rien n‟est naturel car même la mer, le ciel et les couleurs deviennent des constructions humaines. L‟ekphrasis est donc un exercice stylistique qui tend à donner un caractère pictural au texte, dans la tradition horacienne de l‟Ut pictura poesis. La littérature devient donc peinture et elle s‟en inspire pour décrire la ville. Parce que l‟art pictural (et cinématographique) informe et influence la vision des écrivains, nous pouvons parler d‟« artialisation »1114 de l‟espace urbain. Dans les exemples cités, les auteurs transforment, en effet, La Havane en objet esthétique. On l‟aura remarqué, le paysage « artialisé » met souvent en lumière la beauté de la ville. b- L’estampe parfaite Les citations étudiées auparavant montrent que ces passages descriptifs visent souvent à louer la beauté de La Havane, sa mer, son ciel, son architecture. La ville est un paysage riche qui conjugue harmonieusement nature et culture. Nous retrouvons ce discours esthétisant et laudatif tout au long des deux siècles. Même durant la période spéciale, la beauté de la ville sera soulignée, nous le verrons. Outre l‟ekphrasis, l‟hyperbole semble être l‟autre procédé stylistique nécessaire pour tenter de rendre la splendeur et l‟unicité de la capitale cubaine. Les écrivains vont donc s‟appuyer sur une écriture très expressive (emphases, superlatifs et exclamations) pour souligner la beauté exceptionnelle de la ville. Le narrateur de Dos amores, 1114 Terme utilisé par Alain Roger, qui le reprend de Charles Lalo, qui le tenait lui-même de Montaigne. Voir : Alain Roger, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997, p. 16. Ce terme sera également repris par Michel Collot, Paysage et poésie du romantisme à nos jours, op. cit., p. 193. 351 de Villaverde, dépasse l‟ekphrasis pour signifier que la ville est bien plus belle que toutes les représentations artistiques qui en ont été faites : […] ofrecìan aquellos raros y mágicos contrastes que ningún pintor ha podido trasladar al lienzo, ni ningún poeta describir con la exacta verdad de la naturaleza. El cielo también ofrecìa un aspecto grandioso. […] Templo inconmensurable y sublime de la creación, no era por cierto Celeste la criatura que entonces debía levantarse a su consideración y adorar la mano del divino artìfice […].1115 Pour talentueux qu‟il soit, aucun artiste ne pourra rendre la beauté de ce paysage nocturne que contemple la jeune Celeste. Le modèle sera toujours plus beau que l‟œuvre d‟art. Après avoir énoncé les limites de l‟écriture, le narrateur se risque malgré tout à décrire cette vue et à en rendre la magnificence. S‟appuyant sur une adjectivation laudative hyperbolique (« grandioso », « inconmensurable », « sublime »), la prose de l‟écrivain s‟attache à souligner le caractère exceptionnel de cette scène et à la rendre presque irréelle (« raros y mágicos »). Il finit même par convoquer Dieu le Créateur (« divino artífice ») pour rendre ce paysage encore plus extraordinaire. Notons que nous retrouvons l‟idée d‟une intervention divine dans deux romans contemporains : Llueve sobre La Habana et Las palabras perdidas. Alors que Mónica contemple le coucher de soleil sur le Malecón, le narrateur explique : « Te gusta sentarte en el muro del Malecón a contemplar el mar y la puesta del sol, invicto dios que desciende lentamente en las aguas »1116. En associant le soleil couchant de La Havane au Sol Invictus de l‟Empire romain, le narrateur a lui aussi recours au divin pour décrire la vue contemplée. Chez Jesús Díaz cela se traduit de la sorte : « El Gordo miraba las cúpulas tocadas por la gracia diciéndose que únicamente una ciudad así pudo haber producido semejante poeta […] »1117. La composition architecturale de la ville lui semble si parfaite que El Gordo imagine que Dieu (« la gracia ») est intervenu. D‟autre part, il montre que La Havane est la seule muse capable d‟inspirer Lezama Lima, dont il parle implicitement. Le personnage de El Rojo cite ensuite un vers du poète qui correspond parfaitement au paysage qu‟ils contemplent : « La mar violeta añora el nacimiento de los dioses, / ya que nacer aquí es una fiesta innombrable »1118. La beauté de la ville inspirerait donc aux poètes leurs plus beaux vers. 1115 Cirilo Villaverde, Dos amores, op. cit., p. 65. Julio Travieso, Llueve sobre La Habana, op. cit., p. 85. 1117 Jesús Díaz, Las palabras perdidas, op. cit., p. 136. 1118 Ibid., p. 137. 1116 352 De manière plus courante, les écrivains s‟en tiennent à l‟exclamation pour traduire la splendeur de la ville. On le voit notamment chez la Comtesse Merlin : La vie de nuit est si belle, si pleine de charmes ici ! Quelle transparence ! Quelle grandeur dans le ciel éblouissant d‟étoiles et de météores ! Ŕ Et ces nuages gigantesques qui planent dans l‟air, habillés d‟opales et de rubis ! et ce souffle tiède de la brise de terre, chargée de tous les parfums de la végétation, si doucement incisif à travers des pores épanouis par la chaleur ! Comment te décrire la puissance de cette vie animée et sensuelle, quand l‟ardeur brûlante du jour a fait place à l‟air doux et voluptueux du soir ? Ŕ Lorsque, vis-à-vis du port, à demi couchée au fond de ma butaca, sur le balcon de mon oncle, je contemple un bâtiment les voiles déployées, se détachant au loin sur le firmament étoilé, au milieu de l‟air diaphane et phosphorescent, que la lune m‟apparaît à droite et le château du Morro à gauche, planant sur l‟espace, blanc comme un fantôme, avec sa lanterne vacillante, dont la lumière tourne toujours au milieu des airs [...] Ŕ je me crois livrée à un rêve enchanteur, et je jouis de ce bonheur fugitif à pleine poitrine. 1119 Cette ekphrasis se compose de termes exclamatifs (« quelle », « si »), d‟une ponctuation expressive, d‟énumérations, de métaphores, d‟adjectifs élogieux. Malgré tous ces effets, la narratrice souligne les limites du langage (« Comment te décrire […] »). Aucun mot ne lui paraît à même de traduire la volupté de la nuit havanaise. Elle a donc finalement recours à une comparaison onirique (« rêve enchanteur ») pour marquer la beauté parfaite de la ville. Au XXème siècle, l‟emphase permet toujours de marquer l‟exceptionnelle beauté de La Havane. Chez Guillermo Cabrera Infante, elle est teintée de sarcasme puisque, comme nous l‟avons vu, en donnant la parole à un couple de touristes américains, dans Tres tristes tigres, l‟auteur tourne en ridicule le ravissement de la femme : « […] todo le parecía encantador : la encantadora pequeña ciudad, la encantadora bahía, la encantadora avenida frente al muelle encantador »1120. Avec le polyptote « encantador(a) », Mr. Campbell, le narrateur, se moque de l‟engouement ingénu de son épouse. Un peu après, lorsque Mrs. Campbell sera narratrice, ces répétitions seront encore plus lancinantes : Muchas cosas en la ciudad me parecieron encantadoras [...]. Me gustó la ciudad vieja. Me gustó el carácter de la gente. Me gustó, mucho, la música cubana. Me gustó Tropicana : a pesar de ser una atracción turística […] es hermoso y exuberante y vegetal, como la imagen de la isla.1121 Dans cette énumération, Mrs. Campbell répète de manière obsédante le verbe « gustar ». Elle aime tout ce qui plaît habituellement aux touristes : la vieille ville, la musique, le Tropicana. 1119 La Comtesse Merlin, La Havane, T. I, op. cit., p. 317. Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, op. cit., p. 187. 1121 Ibid., p. 197. 1120 353 Cabrera, qui répètera un peu plus loin ce procédé en faisant parler tour à tour le mari et sa femme, caricature l‟enthousiasme de ce personnage qui aime une Havane de carte postale, faite de clichés. C‟est donc avec ironie que Cabrera évoque une beauté urbaine surfaite et édulcorée. L‟hyperbole n‟est, en revanche, pas ironique chez Zoé Valdés. Elle permet de renforcer l‟opposition entre les époques car c‟est, évidement, la ville prérévolutionnaire qui est « la capital más bella de Latinoamérica »1122. Superlatifs et exclamations vont de pair pour la décrire (« […] la luminosidad de La Habana, tan bella, tan nueva y radiante para sus ojos »1123, « […] ¡ qué bella cuidad, Dios santo ! »1124). Dans La nada cotidiana, la beauté de la ville semble plus furtive. Elle est le résultat d‟une combinaison chromatique : « El cielo está despejado y menos teñido que el mar. Es bella, hermosísima, esta combinación de luz y color. Lo nunca visto »1125. La gradation mettant en lumière la grâce du paysage, le suffixe « ísima » et l‟expression « lo nunca visto » marquent la beauté absolue de l‟aurore. Enfin, même si c‟est avec plus de retenue, soulignons que Pedro Juan Gutiérrez évoque également à plusieurs reprises la beauté de La Havane. Alors qu‟il pêche sur une bouée à quelques mètres du rivage, le protagoniste contemple le paysage nocturne et s‟exclame : « La Habana es muy linda con las luces y todo el mar negro delante de uno. La he mirado así cientos de veces, flotando en el mar, a quinientos metros de la costa. Y siempre me gusta »1126. Si nous ne pouvons pas parler véritablement d‟emphase, soulignons tout de même que les adverbes « muy » et « siempre », l‟adjectif « todo » et le substantif « cientos » témoignent d‟une volonté de rendre absolue la beauté de la ville. Ces pauses contemplatives et méditatives, sans être légion, apparaissent ponctuellement dans les récits de Gutiérrez. On en trouvait déjà la trace dans son premier recueil, Trilogía sucia de La Habana, qui est pourtant le plus violent et le plus sombre du cycle « Centro Habana » : Desde aquí arriba se ve toda la ciudad a oscuras. […] La luna llena lo platea todo a través de esa niebla densa de gas y humo. Casi no hay carros. Algún auto por el Malecón. Todo en silencio y tranquilo, como si no pasara nada. […] Me gusta este lugar. […] Desde allì se ve toda la ciudad, plateada entre el humo, la ciudad oscura y silenciosa, asfixiándose. […] Se cae a pedazos, pero es hermosa esta cabrona ciudad […].1127 1122 Zoé Valdés, Te di la vida entera, op. cit., p. 19. Ibid., p. 28. 1124 Ibid., p. 31. 1125 Id., La nada cotidiana, op. cit., p. 183. 1126 Pedro Juan Gutiérrez., Animal tropical, op. cit., p. 106. 1127 Id., Trilogía sucia de La Habana, op. cit., p. 206. 1123 354 Observer la ville de nuit, depuis sa terrasse, permet au narrateur de décrire un paysage urbain calme et rassurant. L‟obscurité et la lumière lunaire semblent adoucir les aspérités de la ville tout en figeant la scène. Le temps est comme suspendu. L‟antithèse présente dans la phrase finale, déjà évoquée auparavant, souligne le contraste entre l‟aspect décati de La Havane et sa beauté. Toute l‟ambivalence des sentiments qu‟éprouve le personnage de Pedro Juan à l‟égard de la ville est d‟ailleurs exprimée dans l‟injure (« cabrona ciudad ») dont il a déjà été question. Tout en personnifiant la capitale, le narrateur fonde les prémices d‟une poétique des ruines dont nous reparlerons. Grâce à une série de procédés récurrents (ekphrasis et hyperbole), La Havane est poétisée, esthétisée et louée pour sa beauté. Le paysage littéraire est donc un espace réinventé, recréé de toutes pièces par des mots. 2- Une ville faite de mots a- La ville baroque La Havane telle que nous l‟entendons maintenant est un pur objet littéraire, c‟est une ville faite de mots ou une ville-texte pour reprendre l‟expression d‟Emma Álvarez-Tabío Albo1128. Cette reconstruction de la ville par le biais de la littérature apparaît réellement, pour la première fois, avec Alejo Carpentier et Lezama Lima, tous deux fondateurs du baroque cubain. En effet, la ville costumbrista, réaliste et naturaliste du XIXème et début du XXème siècles, que nous avons étudiée dans notre première partie, obéit à un souci de vraisemblance. Ces partis pris littéraires ne réinventent pas la ville mais la représentent plus ou moins fidèlement. Loin des contraintes réalistes, Carpentier et Lezama, vont cesser de décrire simplement un référent géographique, historique et/ou social et vont transformer La Havane par l‟écriture littéraire. L‟espace urbain, ainsi transcendé par une écriture baroque, est au service d‟un projet artistique plus vaste : créer une nouvelle manière d‟écrire le réel. C‟est ce qu‟explique Emma Álvarez-Tabío Albo : […] de la ciudad de los monumentos de Carpentier a la ciudad de los pensamientos de Lezama, La Habana se va edificando como una especie de maqueta sobre la cual se ponen a punto las estrategias intelectuales de la modernidad cubana […] la ciudad comienza a perder cualquier definición clara : deja de ser representada como un medio urbano y social para sublimarse en un nivel espiritual. La ciudad se convierte en una 1128 Emma Álvarez-Tabío Albo, Invención de La Habana, op. cit., p. 16. 355 metáfora, una representación dinámica de los conflictos y temores del intelectual cubano […].1129 C‟est parce que la ville faite de mots naît avec ces deux auteurs qui bouleversent la lecture et l‟écriture de La Havane qu‟il nous a semblé nécessaire de leur consacrer une partie. Comme nous l‟avons dit, ils marquent une rupture dans l‟histoire littéraire cubaine (et latinoaméricaine) et c‟est à l‟aune du baroque carpentérien et lézamien que nous allons ensuite étudier la ville néobaroque de Sarduy et de Cabrera Infante. Encore une fois, soit parce qu‟ils ont beaucoup décrit La Havane dans leurs récits de fiction, soit parce qu‟ils marquent une nouvelle étape dans l‟histoire de la littérature, il nous paraît important de nous arrêter sur ces auteurs. Cela nous amènera à définir plus précisément les particularités stylistiques de leur écriture en les rattachant toujours à notre angle d‟étude : les représentations de la ville. Nous ne nous attarderons donc pas sur les origines ni sur les définitions conceptuelles Ŕ qui ont, par ailleurs, nourri de nombreuses études Ŕ du baroque et néobaroque cubain, même si, bien sûr quelques précisions s‟imposeront. De même, il ne s‟agira pas de traiter exhaustivement ces représentations stylisées de La Havane chez chacun d‟eux mais plutôt d‟envisager la ville dans la globalité de leur œuvre. Cela nous amènera à comparer les différents traitements littéraires de l‟espace car il s‟agit bien d‟écritures baroques distinctes les unes des autres. Si Carpentier a amplement décrit la capitale, en l‟évoquant dans cinq romans et un essai, ce n‟est pas le cas de tous les auteurs cités. La Havane apparaît dans les deux romans de Lezama, Paradiso et Oppiano Licario, ainsi que dans certains articles théoriques et journalistiques, et elle est présente, de manière plus ou moins importante, dans trois romans de Sarduy (Gestos, De donde son los cantantes, Cocuyo). Notre étude se fera donc l‟écho de ces différences de traitement. Après avoir analysé la ville baroque et néobaroque, nous dégagerons ensuite, dans une appoche thématique, certains motifs privilégiés de ces choix littéraires dont nous retrouvons encore des traces dans la prose contemporaine, notamment chez Abilio Estévez que nous étudierons plus précisément. Théorisé par Alejo Carpentier dans le prologue à El reino de este mundo (1949), le baroque latino-américain s‟appuie sur une lecture merveilleuse du réel. Prenant ses distances avec les surréalistes, qui créaient, selon lui, un merveilleux artificiel, l‟écrivain cubain souhaite se faire l‟interprète d‟une Amérique naturellement et intrinsèquement baroque et prodigieuse. Le réelmerveilleux, fondé par Carpentier, est un style littéraire qui prétend restituer formellement 1129 Ibid., p. 20. 356 cette réalité extraordinaire. Mais loin de tout folklorisme centripète, ce programme esthétique tend aussi à rendre universelle la singularité latino-américaine. L‟écriture baroque, qui devient l‟esthétique sine qua non pour décrire le sous-continent, se caractérise par sa grande précision lexicale, sa richesse énumérative et son style luxuriant. Plus que jamais le fond et la forme se confondent pour décrire, notamment, la capitale cubaine, si chère à l‟auteur. Considérant, en effet, que les villes latino-américaines ont toujours été délaissées par les écrivains, Carpentier préconise de les (re)découvrir et de les nommer1130 : Al ver cuán pocas veces han dado los novelistas cubanos, hasta ahora, con la esencia de La Habana, me convenzo de que la gran tarea del novelista americano de hoy está en inscribir la fisonomía de sus ciudades en la literatura universal, olvidándose de tipicismos y costumbrismos […]. Hay que fijar la fisonomía de las ciudades como fijó Joyce la de Dublín. Me dirán que esto se viene haciendo en el mundo desde los tiempos de Balzac. Es cierto. Pero como nuestras ciudades están empezando a hablar ahora, no lo harán en el estilo de Balzac, sino en estilos que correspondan a sus esencias profundas […].1131 Son projet, clairement formulé, est de faire de La Havane une cité universelle, à l‟instar des autres grandes villes littérarisées (Dublin, Paris, …). Mais cette écriture ne doit pas copier un style, elle doit être authentique (l‟espagnol dirait genuina) pour refléter au mieux les spécificités de l‟espace décrit. C‟est en révélant « […] los barroquismos siempre implícitos, presentes, en la urbe cubana »1132 que l‟écrivain fait de la « ville sans style »1133 Ŕ parce qu‟elle est justement un mélange de tous les styles Ŕ une cité éminemment baroque. Des romans comme El acoso (1956)1134, El siglo de las luces (1962), La consagración de la primavera (1978) et El recurso del método (1974), auxquels il faut bien sûr ajouter l‟essai intitulé La ciudad de las columnas (1970), regorgent de descriptions baroques de La Havane. Il serait vain de prétendre épuiser ici la ville baroque carpentérienne. Nous nous attacherons donc à dégager quelques exemples probants qui illustreront la transformation de l‟espace par l‟écriture littéraire. Nous observons que, chez Carpentier, la doctrine et la pratique littéraires sont indissociables : les fictions de l‟auteur sont le reflet des préceptes qu‟il développe dans ses essais et inversement. C‟est pourquoi il nous semble nécessaire d‟éclairer certains textes 1130 A l‟image d‟Adam, l‟écrivain doit nommer le monde américain, pour Alejo Carpentier. C‟est ce que tente de faire, par exemple, le protagoniste de Los pasos perdidos : « […] la única tarea que me pareciera oportuna […] : la tarea de Adán poniendo nombre a las cosas », id., Los pasos perdidos (1953), Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 75. 1131 Id., Tientos y diferencias, op. cit., p. 11, 12. 1132 Id., La ciudad de las columnas, op. cit., p. 43. 1133 « […] la ciudad aparentemente sin estilo (si nos atenemos a las nociones académicas que al estilo se refieren) que es La Habana […] », id., La ciudad de las columnas, op. cit., p. 20. 1134 Notons que c‟est le seul roman de l‟auteur qui se déroule exclusivement à La Havane. 357 littéraires d‟articles plus théoriques. A l‟analyse individuelle des œuvres, nous avons préféré une étude thématique pour éviter un effet catalogue et les répétitions. Ainsi, dans une sorte de gradation focalisante, nous allons étudier tout d‟abord le traitement des quartiers, puis celui des édifices et des villas pour enfin nous attarder sur un élément architectural cher à l‟auteur : les colonnes. La Havane de El acoso est composée de plusieurs zones : il y a Centro-Habana (où habite Estrella) qui se caractérise par ses nombreuses colonnes, et le quartier moderne du Vedado où se trouve le théâtre qui abrite le protagoniste qui sera finalement abattu1135. Dans ce quartier se trouve aussi la maison du Mirador où habite le « fugitif » : Protegiéndose con el cuerpo del Mirador de la siempre temible azotea del edificio moderno, asomábase a la calle, a ratos cortos, contemplando el mundo de casas donde, revueltos con lo californiano, gótico o morisco, se erguían partenones enanos, templos griegos de lucetas y persianas, villas renacentistas entre malangas y buganvilias, cuyos entablamentos eran sostenidos por columnas enfermas.1136 En adoptant le point de vue panoptique du personnage, qui regarde discrètement le quartier depuis la terrasse du Mirador, le narrateur offre une description panoramique du Vedado. Dans une seule phrase, faite de multiples énumérations, ponctuées de virgules, le narrateur fait montre de son intérêt pour l‟architecture de la ville. En employant un lexique précis, il rend, d‟un point de vue formel, la richesse du décor urbain. Il décrit, en effet, un paysage hétéroclite où se mêlent des styles d‟époques très différentes (moderne, antique, médiévale, etc.). Les demeures elles-mêmes sont bigarrées : elles sont composées d‟éléments architecturaux disparates, comme, par exemple, ces villas imitant les temples grecs auxquelles on a ajouté des fenêtres et des volets. Mais ce patchwork architectural est quelque peu décati, comme le prouvent les colonnes qui ont perdu de leur splendeur. Enfin, il convient de remarquer que, dans cet inventaire architectural, la nature est évoquée, soulignant de la sorte une des particularités de la ville tropicale qui ne peut dompter complètement la végétation. Notons au passage que l‟image d‟une nature qui reprend sa place dans la ville est fréquente chez l‟écrivain. C‟est bien une ville-décor qui se construit ici, une ville faite de faux- 1135 Yolanda Izquierdo offre une lecture symbolique de ces deux quartiers : « En la novela coexisten dos espacios fundamentales, excluyentes uno del otro […] : El Vedado, donde le dan la muerte [al protagonista], representativo de la modernidad burguesa, y Centro Habana, adonde ha acudido para refugiarse, emblema de la ciudad clásica, del centro sagrado, de la madre », Yolanda izquierdo, « La representación de La Habana en El acoso de Carpentier », in Acoso y ocaso de una ciudad. La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, op. cit., p. 107, 108. 1136 Alejo Carpentier, El acoso, op. cit., p. 47, 48. 358 semblants et de trompe-l‟œil qui ne serait que le simulacre d‟autres cités 1137. Rappelons au passage que l‟illusion et l‟artifice sont des motifs privilégiés de l‟esthétique baroque. Mais quoi que suggèrent les apparences, cette ville est bien réelle et elle se définit justement par ces « concrétions » stylistiques qui produisent le fameux « tercer estilo » de Carpentier : Montar el escenario de una novela en Brujas, Venecia, Roma, París o Toledo, es cosa fácil y socorrida. Los decorados se venden hechos. […] Todas esas ciudades tienen un estilo fijado para siempre. Las nuestras, en cambio, están desde hace mucho tiempo, en proceso de simbiosis, de amalgamas, de transmutaciones […]. Nuestras ciudades no tienen estilo. Y sin embargo empezamos a descubrir ahora que tienen lo que podríamos llamar un tercer estilo : el estilo de las cosas que no tienen estilo. 1138 Dans cet article, l‟auteur compare les grandes cités européennes aux villes latino-américaines, pour montrer que ces dernières ont toujours manqué d‟un style propre clairement défini. Elles ont accumulé, au cours de l‟histoire, différentes influences architecturales. Cela dit, tous ces mélanges finissent par former un style caractéristique et unique, comme le suggère la dernière phrase citée. Pour en revenir à La Havane, ajoutons que le Vedado n‟est pas le seul quartier qui se caractérise par ce « troisième style », la vieille ville aussi a connu divers courants architecturaux qui se sont succédé. Toujours dans le même article, Carpentier explique : La Habana colonial conserva edificios admirables, ejemplos de majestad y sobriedad arquitectónicas, de los siglos XVII y XVIII. Pero junto a ellos los años novecientos trajeron una arquitectura más o menos madrileña, más o menos catalana Ŕ remotas alusiones a Gaudí Ŕ que en otros días me parecían inadmisibles. Pues bien : desde hace poco esa arquitectura ha empezado a tener encanto y gracia. Va cobrando carácter y empaque. El tiempo le confirió una relativa vetustez, un aire de época, un tanto humilde, patinado y demodé, que las inscribe, poéticamente, dentro de los caracteres fisonómicos de la ciudad.1139 Une des spécificités de la capitale cubaine est d‟assimiler progressivement les vagues successives qui transforment sa physionomie pour créer un tout finalement homogène et 1137 Cet extrait n‟est pas sans rappeler un article de l‟auteur où il était également question des différents styles architecturaux visibles dans le quartier du Vedado : « En el Vedado de La Habana, zona urbana de la que soy transeúnte infatigable, se entremezclan todos los estilos imaginables : falso helénico, falso romano, falso Renacimiento, falso Castillo de la Loire, falso rococó, falso modern-style, sin olvidarlos grandes remedos, debidos a la ola de prosperidad traída por la Primera Guerra Mundial Ŕ remedos, a su vez, de otras cosas Ŕ de los que habían edificado en los Estados Unidos los Cornelius Vanderbilt, Richard Gambrill, Stanford White o Charles Sprague. Notaba yo recientemente que el estilo románico no tenía representación en el Vedado. Pero hace poco tuve la alegría de tropezarme con una tintorería del más puro falso estilo románico, entre Ravena y San Zenón de Verona, que se armonizaba maravillosamente con el silbante movimiento de las máquinas planchadoras de vapor », id, Tientos y diferencias, op. cit., p. 12, 13. 1138 Ibid., p. 13. 1139 Loc. cit. 359 harmonieux. Parce que la ville arbore les traces d‟un métissage culturel lié à son histoire, nous pouvons dire qu‟elle matérialise le processus de transculturation propre aux sociétés coloniales1140. Ici aussi, Carpentier observe la cité caribéenne avec le regard d‟un architecte1141. Cela se traduit par une attention portée aux édifices, à leur style, à leurs ornements et à leur fonctionnalité. De surcroît, l‟auteur cite des grands noms de l‟architecture, il utilise une terminologie architecturale extrêmement précise et, enfin, il met en scène des architectes ou des étudiants en architecture (El acoso). Dans La consagración de la primavera, Enrique, qui est architecte, offre, quand il est narrateur, des descriptions qui permettent de souligner les évolutions de La Havane. C‟est ainsi, par exemple, qu‟il met en lumière l‟intelligence des constructions de la vieille ville, qui s‟adapte parfaitement aux besoins : […] las vìas estrechas Ŕ casi todas las de La Habana Vieja Ŕ canalizaban, presionaban las brisas, haciéndose verdaderas mangas de aeración. Los interiores, en cambio, eran amplios, altos de puntal, con anchas salidas a los patios, y sobre puertas y ventanas se situaban los cristales polícromos, que llenaban las mismas funciones de los brise-soleil de Le Corbusier. Arquitectura perfectamente funcional, concebida por los alarifes de la Colonia, cuando aún de « funcionalismos » no se hablaba en el mundo. Entre habitación y habitación, mamparas lindamente ornamentadas, que podían cerrarse o abrirse, según se quisiese propiciar o reducir la circulación del aire.1142 Le narrateur souligne le bon sens intuitif des maçons qui ont façonné La Habana Vieja en fonction du climat tropical, bien avant que les grands noms de l‟architecture contemporaine ne reprennent et ne conceptualisent ces notions. Enrique suggère clairement que les trouvailles de Le Corbusier ne sont en rien révolutionnaires et que La Havane dispose depuis longtemps d‟instruments efficaces pour rafraîchir l‟air. Le narrateur évoque l‟intérieur des demeures pour énumérer quelques-unes des particularités des maisons cubaines : des pièces spacieuses, une grande hauteur sous plafond, des medio puntos au dessus des fenêtres et des portes, et des mamparas entre les pieces. Là encore, ce passage n‟est pas sans faire echo à un autre texte de l‟auteur, tiré de l‟essai La ciudad de las columnas, publié huit ans auparavant : Así como los alarifes españoles quisieron, en los días de la temprana colonia, que las urbes de esta llave y antesala del Nuevo Mundo tuviesen el mayor número posible de esquinas de fraile […] el interior de la casa cubana fue durante siglos, tradicionalmente, guardador de penumbras e invitaciñn a la brisa, con un juicioso aprovechamiento de sus rumbos. […] 1140 Nous reprenons le concept créé par l‟anthropologue cubain, Fernando Ortiz. Nous l‟avons dit, son père était architecte et lui-même a suivi des études d‟architecture. 1142 Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, op. cit., p. 436, 437. 1141 360 De ahí que la obsesión de tener amaestrado algún lugar del fresco originara la multiplicación de las mamparas. 1143 Tout est parfaitement étudié ; l‟extérieur comme l‟intérieur : les maisons sont orientées vers le nord-est pour bénéficier de l‟ombre et des vents dominants et des paravents (mamparas) viennent scinder les grandes pièces. Toujours d‟un point de vue architectural, Carpentier va opposer les époques. Dans une dichotomie plus ou moins prégnante, il va distinguer les constructions modernes des bâtiments plus anciens et plus authentiques. Dans El acoso, la maison du Mirador, où habite le fugitif, et le bâtiment moderne contigu, où vit le guichetier, vont symboliser deux styles différents : […] la casona del mirador Ŕ antaño casa quinta