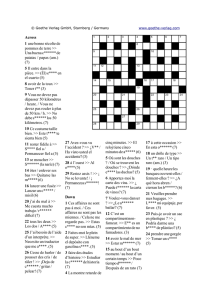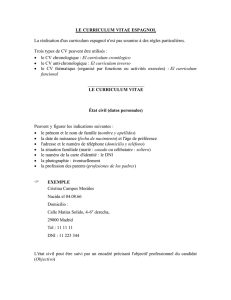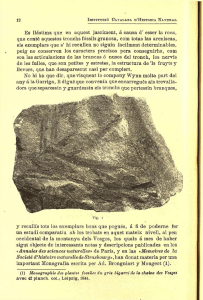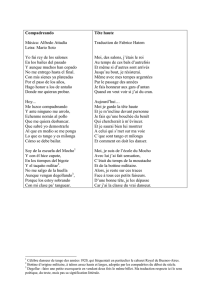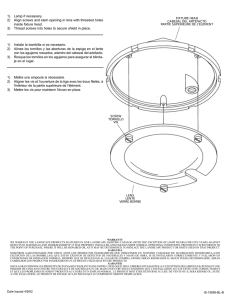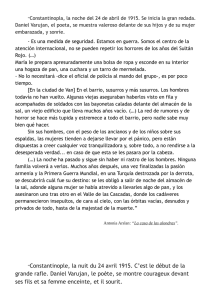Représentation de Madrid dans La noche de los tiempos, d`Antonio
Anuncio

Représentation de Madrid dans La noche de los tiempos, d’Antonio Muñoz Molina : de l’utopie à la barbarie Gregoria PALOMAR Université de Lorraine – Metz CENTRE ÉCRITURES (EA 3943) En 1993, le romancier paraguayen Augusto Roa Bastos affirmait la permanence de l’utopie en tout temps et en tout lieu : « Depuis les temps les plus anciens les grandes entreprises humaines ont été marquées du feu de l’utopie. D’une façon ou d’une autre, celle‐ci les a suscitées et engendrées aux différents stades de civilisation et de culture. La flamme immatérielle, intemporelle, spirituelle, des obsessions, des prémonitions y des anticipations créatives serait la métaphore la plus ancienne de l’utopie. Les événements réellement significatifs qui n’aient rien à voir avec l’utopie sont très rares »1. Au début du vingtième siècle, l’Espagne se lançait dans ce qui pouvait paraître un projet utopique : accéder à l’avant‐garde de la modernité, objectif qui se concrétisa dans les grands projets architecturaux de Madrid et, surtout, dans la Cité Universitaire, symbole du développement scientifique et culturel du pays, un symbole qui est au centre du roman d’Antonio Muñoz Molina, La noche de los tiempos, publié en 20092 et traduit en 2012 par Philippe Bataillon sous le titre de Dans la grande nuit des temps3. Parler d’utopie, c’est évoquer, selon la définition du Trésor de la Langue Française, un « plan imaginaire de gouvernement pour une société future idéale, qui réaliserait le bonheur de chacun », mais c’est aussi, toujours selon le même dictionnaire, « ce qui appartient au domaine du rêve, de l’irréalisable ». L’utopie supposerait donc de se libérer d’une réalité que l’on juge 1 A. Roa Bastos, 1993, cité par P. Campos Calvo‐Sotelo, 75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid: memoria viva de un «campus» transcendental, Madrid, Editorial Complutense, 2004, p. 47 : « Desde los tiempos más remotos los grandes emprendimientos humanos han estado marcados por el fuego de la utopía. De una u otra manera, ella los ha suscitado y engendrado en los distintos estadios de civilizaciones y culturas. El fuego inmaterial, intemporal, espiritual, de obsesiones, premoniciones y anticipaciones creativas sería la metáfora más antigua de la utopía. Apenas hay acontecimientos verdaderamente significativos que no tengan que ver algo que ver con la utopía. » (traduction personnelle) 2 A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, Barcelona, Seix Barral, 2009. 3 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, traduit de l’espagnol par Philippe Bataillon, Paris, Éditions du Seuil, 2012. 1 insatisfaisante, voire condamnable, pour en concevoir une autre dont on a conscience qu’elle est, dans un premier temps du moins, inaccessible. Cette élaboration de sociétés futures idéales a trouvé son expression dans de nombreux écrits, l’utopie s’exprimant en premier lieu sous forme de discours littéraires. On considère que les précurseurs de la pensée utopique sont les architectes de la Renaissance. À cette époque, en effet, plusieurs traités dessinent des villes imaginaires, reflets des nouvelles découvertes relatives à la perspective et de la volonté de créer une cité nouvelle qui accueille un homme nouveau. Ainsi, Jean‐Marc Stébé, dans son petit livre Qu’est‐ce qu’une utopie ? explique qu’« en explorant les règles mathématiques auxquelles obéit le corps humain, il paraissait possible aux architectes de maîtriser le sens et l’ordre de l’univers »4. Ainsi surgissent, comme le rappelle Raymond Trousson dans son Histoire littéraire de la pensée utopique5, des théoriciens d’un urbanisme utopique, tel Léon Battista Alberti qui rédige en 1452 le traité De re aedificatoria. La pensée utopique en tant que telle trouve son point de départ dans le livre de Thomas More, Utopia publié en 1516. Dans ce traité, inspiré de l’Atlantide de Platon, Thomas More imagine une île inaccessible, un non‐lieu, comme le suggère l’étymologie du nom, gouverné de façon idéale. Thomas More y décrit avec minutie les conditions de travail, d’hygiène, les modalités du mariage, du commerce, la suppression de la propriété privée. L’humaniste anglais, par le biais de cette société imaginaire et inaccessible, propose en fait une réflexion sur la meilleure façon de gouverner, en opposition avec une vision très critique de son état, et en vient à se demander quel est le meilleur état possible. Mais, en le situant dans une île isolée de tout, il fait de ce gouvernement parfait un idéal impossible à atteindre. Thomas More mène donc une réflexion plus profonde sur l’organisation sociale que celle que proposaient les architectes italiens. Cependant, la ville est aussi au centre de ses propositions, démontrant que l’utopiste, comme l’affirme Jean‐Marc Stébé, « transforme les rapports sociaux (les usages) en rapports spatiaux (en plans, en maquettes) »6. Dans le livre II d’Utopia, Thomas More présente l’organisation architecturale et urbanistique de sa cité idéale, une cité avant tout fonctionnelle, les 54 villes d’Utopia étant toutes édifiées selon le même modèle, géométrique, aux maisons également identiques. D’autres cités idéales suivront que Patrice de Moncan énumère dans son ouvrage intitulé Villes utopiques, villes rêvées7. J’en J.‐M. Stébé, Qu’est‐ce qu’une utopie? Paris, Vrin, 2011, p. 43. 5 R. Trousson, Voyage au pays de nulle part : histoire littéraire de la pensé utopique, Bruxelles, éd. De l’Université de Bruxelles, 1979. 6 J.‐M. Stébé, Qu’est‐ce qu’une utopie?, op. cit., p. 46. 7 P. de Moncan, Villes utopiques, villes rêvées, Paris, Éditions du Mécène, 2003. 4 2 cite quelques‐unes : la Cité du Soleil du moine et philosophe italien Campanella, en 1602, le Phalanstère du philosophe français Charles Fourier au début du 19e siècle, la Familistère de l’industriel Jean‐Baptiste Godin, créé en 1880, la Cité Radieuse de l’architecte Le Corbusier, vaste projet immobilier parisien conçu en 1922, synthèse, selon de Moncan, des villes imaginaires conçues avant lui, un projet grandiose qui n’a pas vu le jour ; toutefois, des Cités Radieuses ont bien été construites à Marseille et à Briey. Depuis Thomas More, l’urbanisme a toujours été lié au progrès social, la ville idéale ne pouvant naître que dans une société ayant atteint son plein épanouissement. Le vingtième siècle, particulièrement, a cru au développement industriel et à la rationalisation des villes qui en découlait, symbole du bien‐être humain en passe d’être atteint. Parler de villes utopiques c’est donc envisager une projection vers un avenir meilleur, voire irréalisable. C’est pourquoi les architectes se sont appuyés sur leur imagination pour élaborer des modèles de vie idéale et c’est aussi par l’imagination que les romanciers ont donné à voir des villes symboles d’une société parfaite ou, dans le cas par exemple de George Orwell, de ce qu’on pourrait appeler une contre‐utopie. Le roman qui nous intéresse aujourd’hui n’a pas comme espace fictionnel une ville imaginaire, contrairement à de nombreux romans de Muñoz Molina qui se situent dans une ville imaginaire, Mágina dans laquelle on peut reconnaître cependant une transposition de la ville natale de lʹauteur, Úbeda. La noche de los tiempos se situe dans un espace et un temps bien réels, le Madrid de la Seconde République espagnole et du début de la Guerre Civile, mais, à travers le parcours d’un jeune architecte, Ignacio Abel, on passe du rêve d’une société idéale à l’effondrement de ce rêve, qui cède le pas à la barbarie. Comment peut‐on alors parler d’utopie quand il s’agit d’un épisode de l’histoire et d’un projet architectural qui a permis la naissance de l’actuelle Cité Universitaire, vaste campus aux portes de Madrid ? Pour répondre à cette question, nous verrons comment ce projet de Cité universitaire s’inscrivait dès le départ dans une vision utopique, et comment, sous la plume de Muñoz Molina, ce projet acquiert les caractéristiques d’une utopie, par la vision qu’en a ce personnage architecte qui est au centre du récit et aussi par le biais de l’écriture, qui met en évidence le contraste entre le futur prometteur évoqué avec lyrisme et la barbarie de la destruction. 3 Ignacio Abel ou l’effondrement d’un idéal de progrès Je commencerai, avant toute analyse, par une brève présentation du roman d’Antonio Muñoz Molina. Le récit s’ouvre sur la vision du protagoniste Ignacio Abel perdu dans la gare de Transylvannia à New York, alors qu’il s’apprête à effectuer un trajet en train de deux heures qui le conduira à Rhineberg. Au cours de ce voyage, il reverra le long parcours qui l’a amené aux États‐Unis depuis Madrid, ville où il a vécu jusque‐là. Malgré une narration à la troisième personne, faite par un narrateur presque omniscient, les espaces parcourus par Ignacio Abel sont vus à travers le prisme du regard de ce dernier, ce qui provoque une interférence entre l’effondrement des certitudes du personnage et celui de son environnement : chaos personnel et collectif se mêlent dans des espaces qui deviennent soudain hostiles. Au moment où commencent les faits évoqués (octobre 1935), Ignacio Abel est un architecte promis à un grand avenir ; il a 46 ans et, après une formation en Allemagne, au prestigieux Bauhaus, il poursuit une brillante carrière, vit dans le luxueux quartier de Salamanca, dans un vaste appartement qui témoigne de sa réussite sociale. C’est un architecte reconnu, qui participe au gigantesque projet de la Cité Universitaire de Madrid, dont il a réalisé les plans de la centrale thermique (en réalité c’est l’architecte Manuel Sánchez Arcas qui a élaboré ces plans8). Tout bascule quand il tombe passionnément amoureux d’une américaine divorcée, Judith Biely, relation qui sera brutalement interrompue, en juillet 1936, par le drame individuel de la tentative de suicide de sa femme, Adela, et par la tragédie collective de l’explosion de la violence guerrière qui pousse Judith à quitter précipitamment Madrid. Commence alors pour Ignacio Abel, séparé de sa famille restée en zone « rebelle » et de Judith, partie il ne sait où, une longue descente aux enfers où il n’aura plus qu’une pensée : quitter la ville chaotique qu’est devenue Madrid pour répondre à l’invitation d’un riche Nord‐américain, Van Doren, qui lui propose de travailler aux plans d’une bibliothèque universitaire à Rhineberg, où il finira par arriver après trois mois plongé dans l’horreur de la guerre civile. Ce roman dense, très riche, permet donc de représenter, entre autres choses, cet idéal de progrès social et culturel qui a nourri le grand projet de la Cité Universitaire de Madrid pendant les années trente, symbole d’une société idéale basée sur la sacralisation de la culture comme moyen d’accéder au progrès humain. Et c’est cette vision d’une ville utopique qui est développée dans le roman à travers les rêves du protagoniste Ignacio Abel, qui travaille avec conviction à la modernisation de la ville, qui est pour lui comme la promesse d’un futur qui ne peut être que meilleur. En tant qu’architecte, Ignacio Abel contemple avec admiration les P. Campos Calvo‐Sotelo, 75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid, op. cit., p. 114. 8 4 nouvelles constructions ; celles‐ci doivent faire de Madrid une ville moderne qui fera sans nul doute oublier l’Espagne pittoresque qu’il contemple avec regret, disant à Judith : « Ne prends pas pour de l’exotisme ce qui n’est que de l’arriération […]. Nous autres Espagnols, nous avons le malheur d’être pittoresques »9 et l’Espagne est un pays dont il méprise cette « inépuisable laideur espagnole de tant de choses quotidiennes »10. Ignacio Abel n’aime pas ce Madrid où les étrangers vont chercher le dépaysement et croit en revanche à un avenir qu’il essaie de faire sien à travers l’architecture : « pour Ignacio Abel, Madrid était le décor malpropre dans lequel il avait vécu sans envie depuis sa naissance […] avec la même passion il voulait se consacrer à des projets d’urbanisme inventif qui, malgré la lassitude, son scepticisme croissant, son adaptation a une vie bourgeoise où il s’était peu à peu installé sans s’en rendre vraiment compte, continuaient à foisonner dans son esprit avec un élan pour la justice sociale, pour l’embellissement du monde et de la vie des gens ordinaires »11. Nous retrouvons bien dans ces projets auxquels se raccroche le brillant architecte les fondements de l’utopie, le rêve d’une société parfaite, d’un monde beau et harmonieux, d’un bonheur collectif. Le grand projet de la Cité Universitaire, sorte de microcosme en marge de ce Madrid encore trop pittoresque à son goût, est donc un moyen de concilier son ambition d’architecte dont la réussite a donné à cet homme d’origine modeste (fils d’un chef de chantier mort prématurément et d’une concierge) la reconnaissance sociale et sa foi en un pays dont seront éradiqués l’analphabétisme et l’ignorance. Rappelons que l’Espagne, à l’avènement de la République, comptait l’un des taux d’analphabétisme les plus élevés d’Europe : « en 1930, plus d’un million d’enfants ne sont pas scolarisés et le taux d’analphabétisme atteint encore 44 % »12 ; Ignacio Abel s’insère donc dans une vision utopique d’une Espagne libérée de ses principaux maux, les divisions sociales et le retard culturel, ce qu’il a lui‐même surmonté en tant qu’individu. Admirateur de Le Corbusier, socialiste, membre du syndicat UGT et du parti socialiste PSOE, la vision qu’a Ignacio Abel de l’architecture est le reflet de sa foi en un avenir brillant pour les générations futures et il y travaille avec A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 158. « No tomes por exotismo lo que sólo es atraso […]. A los españoles nos ha tocado la desgracia de ser pintorescos » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p.195). 10 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 176. « la inagotable fealdad española de tantas cosas cotidianas » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 217) 11 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 235. « para Ignacio Abel Madrid era el escenario desastrado en el que había vivido con desgana desde que nació […] con la misma vehemencia quería empeñarse en proyectos de invención urbana que a pesar del cansancio, del gradual escepticismo, del acomodamiento a una vida burguesa en la que se había ido instalando sin darse mucha cuenta, seguían alimentándose en su alma con un impulso de justicia social, de hermoseamiento del mundo y de las vidas comunes » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p.292). 12 J. Pérez, Histoire de l’Espagne, Paris, Fayard, 1996, p. 715. 9 5 passion, convaincu que l’Espagne républicaine est à l’aube d’une nouvelle ère de progrès et de justice sociale. Il est pour lui évident qu’une Espagne aux constructions modernes et fonctionnelles fera oublier cette Espagne cruelle, symbolisée par la corrida qu’il condamne : « l’architecture des temps nouveaux devait être un outil parmi d’autres dans un effort opiniâtre pour améliorer la vie des hommes, soulager leurs souffrances et leur apporter la justice, ou mieux encore, et pour le dire d’une manière plus précise, rendre accessible […] l’eau courante, les espaces aérés et salubres, l’école, une alimentation suffisante et si possible savoureuse »13. L’utopie de la Cité Universitaire de Madrid Ignacio Abel est ainsi, en quelque sorte, la représentation fictionnelle de ces espoirs que portaient les intellectuels de la Seconde République en une Espagne qui, loin de la légende noire dont elle souffrait, serait à l’avant‐garde du progrès. Sortir du sous‐développement passait obligatoirement par l’instruction et, après avoir développé l’enseignement primaire, le projet de la Cité Universitaire de Madrid devait confirmer cet élan vers la modernité14. Une conférence de l’écrivain Ramiro de Maeztu, alors ambassadeur d’Espagne en Argentine, montre bien les espoirs que nourrissaient les intellectuels espagnols de construire cette société idéale dont le ciment serait l’université. La Cité Universitaire donnera aux étudiants les meilleures conditions d’études car, selon Maeztu, « nous savons bien qu’en plaçant l’étudiant dans un environnement particulier, à l’écart du monde et adapté à sa condition, on obtient de bien meilleurs résultats que si on le laisse s’égarer dans la ville »15. Le lieu n’a pas été choisi au hasard, la Moncloa est alors « la plus belle des périphéries de Madrid », 560 hectares « de terrain vallonné, avec la montagne, 13 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 87. « la arquitectura de los nuevos tiempos había de ser una herramienta en el gran empeño de hacer mejores las vidas de hombres, de aliviar el sufrimiento, de traer la justicia, o mejor todavía, de hacer accesible […] el agua corriente, los espacios ventilados y saludables, la escuela, el alimento suficiente y a ser posible sabroso » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 107). 14 L’université, sous l’impulsion des krausistes et de l’Institution Libre d’Enseignement, a été une des priorités de la Seconde République. Joseph Pérez estime que « entre 1930 et 1936, l’Université espagnole est sans doute l’une des meilleures du monde » (J. Pérez, Histoire de l’Espagne, op. cit., p. 715). La Guerre Civile mettra fin à cet élan et « il faudra attendre quarante ans pour que l’Université espagnole retrouve un niveau comparable à celui qu’elle avait atteint à la veille de la guerre civile » (id.). 15 « La Ciudad Universitaria », in Club Español : conferencias pronunciadas por los siguientes señores: Exmo. señor embajador de España, don Ramiro de Maeztu, Dr. Antonio Goicoechea, Sra. María Teresa León de Sebastián, D. Arturo Berenguer Carisomo, Buenos Aires : 1928, p. 14, « ya sabemos que colocando al alumno universitario en un modo de vivir especial, apartado y adecuado a su condición, se obtiene mucho mejor resultado que dejándolo perderse en la ciudad » (traduction personnelle). 6 Madrid dans son dos et la rivière Manzanares à ses pieds »16. Maeztu rêve ainsi d’un monde à part, à l’instar des penseurs utopistes : « C’est un monde en quelque sorte à part, où maîtres et disciples vivent la vie du savoir, loin des préoccupations économiques et loin également des tentations de l’ambition et du plaisir »17. Bien que le discours de Maeztu puisse être motivé par le désir de récolter des fonds auprès des Argentins fortunés, il n’en reste pas moins que nous sommes face à l’expression d’un projet utopique, celui d’un lieu où s’uniraient la nature et l’architecture moderne, où s’effaceraient les différences sociales, où l’argent deviendrait secondaire et où maîtres et disciples seraient unis dans une même soif de savoir, tout ceci dans ce qui devra être, selon Maeztu, « el mayor centro científico del mundo ». C’est ce caractère utopique que reprend, en 2004, l’architecte Pablo Campos Calvo‐Sotelo, dans un ouvrage publié à l’occasion des 75 ans de la Cité Universitaire. L’épigraphe de l’ouvrage est en effet « Au rêve éveillé »18 et, évoquant la volonté d’Alphonse XIII, l’auteur explique : « Ses efforts inépuisables et enthousiastes pour que fleurisse l’Université, ajoutés à une indéniable énergie utopique, se matérialisèrent bientôt dans l’action »19. Calvo‐ Sotelo considère donc que c’est sous le signe de l’utopie que ce projet est né : Alphonse XIII voulait que la Cité Universitaire soit l’œuvre de sa vie, mais il n’en vit pas l’aboutissement puisque les élections municipales du 12 avril 1931 provoquèrent le départ du roi et la proclamation de la Seconde République le 14 avril 1931. Le projet fut conservé par le nouveau régime et « Le Roi passa le témoin à la République mais l’utopie était toujours vivante »20. En juillet 1936, on avait déjà inauguré les bâtiments de Philosophie, de Sciences et d’Architecture, ainsi que l’hôpital. Dans un style très lyrique, Pablo Campos Calvo‐Sotelo décrit ainsi la fin des espoirs portés par cette construction : « La situation de la Cité Universitaire en 1936 révélait un dynamisme porteur d’espoir. C’était une entreprise ambitieuse qui avançait à un bon rythme, brillamment portée par une société qu’elle était amenée à servir. Mais cette même société dut affronter en cette année fatidique une attaque brutale qui allait la briser de haut en bas, l’écrasant sans pitié : la guerre. Le rêve se brisa en mille morceaux. Le ciel espagnol se couvrit d’un nuage noir de ibid., p. 15, « el más hermoso de los alrededores de Madrid » ; « de terreno ondulado, con la sierra, Madrid a la espalda y el río Manzanares a los pies » (traduction personnelle). 17 ibid, p. 18‐19, « Es un mundo en cierto modo aparte, donde maestros y alumnos viven la vida del saber, lejos de las preocupaciones económicas y lejos también de las tentaciones de la ambición y del placer » (traduction personnelle). 18 P. Campos Calvo‐Sotelo, 75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid, op. cit., « Al sueño despierto ». 19 Ibid., p. 8, « Su innagotable entusiasmo por que floreciera la Universidad, sumando a una inequívoca energía utópica, pronto cristalizaron en un paso a la acción » (traduction personnelle). 20 Ibid., p. 12, « El rey dio el testigo a la República pero la utopía permaneció viva » (traduction personnelle). 16 7 haine. Le campus, cet espace éclairé par un idéalisme pédagogique, intellectuel et architectural, devint du jour au lendemain un sombre et sanglant terrain de combat »21. C’est ce même espoir qu’exprime Antonio Muñoz Molina à travers le personnage d’Ignacio Abel. Le jeune architecte aime contempler les maquettes de la Cité Universitaire et la perfection des édifices que l’échelle réduite accentue : « À la différence des bâtiments réels, les maquettes avaient une nature abstraite que ses mains appréciaient autant que ses yeux, formes pures, surfaces lisses, incisions des fenêtres, angles droits des arêtes et des toits sur lesquels le bout de ses doigts passait avec plaisir »22. Ce monde virtuel symbolisé par les maquettes est celui d’un idéal encore inaccessible, cette « nature abstraite » des édifices, qui semble leur donner une supériorité sur les constructions qui surgissent peu à peu du sol montre bien cette distance qui est prise par rapport au projet, comme si Ignacio Abel voulait rester dans le domaine du rêve, de l’irréalisable, fondement de l’utopie. Nous voyons aussi comment Muñoz Molina choisit d’adopter le point de vue d’Ignacio Abel, en se référant à son regard, son toucher, qui lui procurent un plaisir sensuel. C’est l’irréalisable, le caractère inachevé, qui permet tous les espoirs, la projection permanente vers un avenir meilleur ; le jeune architecte peut encore, roulant au milieu des odeurs mêlées de pins, de chênes, de ciste, de thym, de terre humide23, façonner à sa guise cette vision de la cité telle qu’il la voudrait : « À quelques minutes de Madrid la Cité Universitaire aurait à la fois l’harmonie géométrique d’un tracé urbain et l’ampleur d’un horizon silhouetté sur des versants boisés. En quelques années, les masses des arbres composeraient le contrepoint des formes rectilignes de l’architecture »24. La Cité Universitaire permet donc, dans un espace isolé de la ville qui rappelle l’insularité d’Utopia, l’union harmonieuse des lignes architecturales épurées et de la nature, qui envahit ici les sens de l’architecte pendant qu’il 21 Ibid., p. 116, « La situación de la Ciudad Universitaria en 1936 mostraba un dinamismo esperanzador. Era una ambiciosa empresa avanzando a buen ritmo, impulsada con brío por una sociedad a la que habría de servir. Pero esa misma sociedad sufrió en ese fatídico año una brutal embestida que la quebraría de arriba abajo, aplastándola sin piedad: la guerra. La ilusión saltó en mil pedazos. Una negra nube de odio oscureció el cielo español. El campus pasó de ser un espacio iluminado por el idealismo educativo, intelectual y arquitectónico a convertirse de la noche al día en un sombrío y sangriento territorio de lucha » (traduction personnelle). 22 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 39. « A diferencia de los edificios reales, los modelos a escala tenían una cualidad abstracta que sus manos apreciaban tanto como sus ojos, formas puras, superficies pulidas, incisiones de ventanas o ángulos rectos de esquinas y aleros en los que se complacían las yemas de sus dedos » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p.45). 23 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 49. 24 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 42. « A un paso de Madrid la Ciudad Universitaria tendría a la vez una armonía geométrica de trazado urbano y una amplitud de horizontes perfilados por laderas boscosas. En no muchos años las espesuras de los árboles serían el contrapunto de las líneas rectas de la arquitectura » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p.49). 8 imagine le futur, dans une communion qui se fait également entre l’homme et la nature qui l’entoure. C’est un univers idyllique dans lequel l’architecte imagine déjà un homme nouveau, sain et fort, en harmonie avec son environnement et, comme l’avait imaginé Maeztu, libéré des préoccupations économiques et des préjugés religieux : « hommes et femmes jeunes, bien nourris, leurs os devenus longs et solides grâce au calcium du lait, enfants de privilégiés mais aussi enfants de travailleurs, éduqués dans de solides écoles publiques où la rationalité du savoir ne serait pas corrompue par la religion, où le mérite prévaudrait sur la naissance et sur l’argent »25. Nous avons ici un rappel de l’idéal hygiéniste du socialisme utopique du dix‐neuvième siècle. Étant donné qu’Ignacio Abel est membre du PSOE, nous pouvons nous demander s’il n’y a pas une vision ironique d’un socialisme ancré dans d’anciennes certitudes et qui n’a pas pu voir l’effondrement d’une Espagne qui ne correspondait absolument pas à ces idéaux. Mais, alors qu’Utopia est un univers clos, replié sur lui‐même, sans contact avec l’extérieur, ce qui assure sa pureté, ce campus universitaire n’est que la première étape vers la construction de la capitale du futur : « Les alentours plats de Madrid étaient une table à dessin dégagée sur laquelle pourrait se projeter la ville future, plus ample encore que le domaine universitaire »26. En transformant le paysage qu’il contemple en une table à dessin, l’architecte en fait une étendue qui s’offre à lui, sur laquelle il pourra agir et faire surgir tous ses rêves et où il peut déjà visualiser ce qu’il fera construire, montrant là toute son ambition : la ville n’est pas seulement le lieu d’une possible société parfaite, elle semble ici un terrain vierge où s’assoira son propre pouvoir, celui que lui donne la force de ce « rêve éveillé » évoqué par Pablo Campos Calvo‐Sotelo. Le triomphe de la barbarie L’explosion du conflit marque la fin de ce monde idyllique où toutes les forces semblent converger vers un avenir lumineux, mais Ignacio Abel, tout à sa carrière et à sa passion pour Judith n’avait pas voulu voir les signes précurseurs de la violence. Ce rêve d’une société ordonnée, où tout est mathématiquement calculé, où tous les hommes sont frères, se heurte à une nouvelle vision de A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 208, « hombres y mujeres jóvenes bien alimentados, los huesos largos y fuertes gracias al calcio de la leche, hijos de privilegiados pero también hijos de trabajadores, educados en sólidas escuelas públicas en las que la racionalidad del saber no estaría corrompida por la religión y en las que el mérito prevalecería sobre el origen y el dinero » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 260). 26 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 209. « Las afueras planas de Madrid eran un despejado tablero de dibujo sobre el que podría proyectarse la ciudad futura con una amplitud mucho mayor que la del recinto universitario ». (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 261). 25 9 Madrid. Dès les premiers jours de la guerre, alors qu’Ignacio Abel cherche partout désespérément Judith Bieley, Madrid est livrée aux flammes et à la destruction : « Par la rue d’Atocha descendait un tramway incendié qui laissait derrière lui un sillage de fumée noire au‐dessus d’une chevelure de flammes et d’une traînée d’étincelles bleues sur les fils électriques. Un autre incendie s’élevait au‐dessus des maisons, une colonne de fumée éclairée de l’intérieur par le feu qui dévorait la toiture d’une église »27. Encore une fois nous suivons le regard d’Ignacio Abel, d’abord à son niveau, celui de la rue, où il découvre le tramway en flammes puis, en observant la fumé, le regard s’élève au‐dessus des toits : il ne voit plus la vaste plaine qu’il transformait en table à dessin mais des églises en flammes, images de la déchirure de l’Espagne. Ce ne sont plus des jeunes gens unis qui parcourent les rues mais une marée humaine qui entraîne Ignacio Abel dans un mouvement incontrôlable : « C’est à peine s’il marchait, il était poussé, emporté en direction du grand vacarme qui montait de la place, non pas une clameur de voix humaines mais le grondement prolongé d’un orage, une avalanche qui dévalait, bousculant tout »28. Cet homme qui rêvait il y a peu d’un monde où tout serait ordonné, contrôlé, selon une rigueur mathématique visant à la perfection, se voit maintenant emporté par un terrible flux destructeur. Sa chère Cité Universitaire, conçue comme un ilot préservé des dangers de la ville, n’est pas épargnée par la folie qui semble avoir pris tous les hommes. Dès les premiers jours de la guerre, les travaux sont interrompus et au désarroi personnel d’Ignacio Abel, resté seul à Madrid, s’ajoute dès le mois de juillet l’anéantissement d’un futur prometteur : « Adela et ses enfants dans la Sierra, Judith il ne savait où ; les chantiers de la Cité Universitaire arrêtés, les bureaux vides, le vent qui s’engouffrait par les vitres brisées par les explosions et les coups de feu, couvrant les bureaux de poussière et dispersant sur le sol plans et documents oubliés »29. Le vent qui s’engouffre par les fenêtres montre que la nature sauvage prend le dessus sur l’œuvre de l’homme, annihilant tous les A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 488. « Por la calle de Atocha bajaba un tranvía incendiado, que iba dejando atrás una estela de humo negro sobre la melena de las llamas y un fulgor de chispazos azules en los cables eléctricos. Otra hoguera se levantaba por encima de las casas, una columna de humo iluminada desde dentro por las llamas que devoraban la techumbre de una iglesia » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 622). 27 28 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 498. « Casi no caminaba, era empujado, arrastrado, en dirección al gran estruendo que se levantaba de la plaza, no un clamor de voces humanas sino un prolongado retumbar de tormenta, un alud despeñándose, arrasándolo todo » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 634). 29 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 507. « Adela y sus hijos en la Sierra y Judith no sabía dónde y las obras en la Ciudad Universitaria interrumpidas y las oficinas vacías, el viento que entraba por las ventanas rotas a causa de explosiones y disparos que cubrían de polvo los escritorios y dispersaban por los suelos planos y documentos olvidados » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 645). 10 efforts pour maîtriser son environnement et pour atteindre l’harmonie. La barbarie s’impose vraiment à Ignacio Abel quand des miliciens, anciens ouvriers de la Cité Universitaire, le considérant comme un bourgeois réactionnaire, un fasciste, l’arrêtent et feignent de l’exécuter. Le dialogue avec ces miliciens qui ont pris les armes et le pouvoir détruit la vision utopique d’une société où les classes n’existent plus, ou du moins ne sont plus en lutte. Les miliciens voient surtout dans Ignacio Abel un nanti qui les méprisait (même si l’architecte tout à ses projets n’en avait pas conscience) et qu’ils peuvent mépriser et humilier à leur tour : « Chez nous personne ne commande. Et pour nous tu n’es personne. Tu es pire que personne. Les camarades du bâtiment se souviennent bien de toi. Tu passais ton temps à embaucher des jaunes et à appeler la Garde d’assaut chaque fois qu’une grève était annoncée. Maintenant tu vas payer »30. À la vision idyllique qu’avait Ignacio Abel s’oppose maintenant la réalité des luttes sociales qu’il voulait ignorer car elles auraient pu entraver la construction de ce qui était sa Cité Universitaire. Tout à son projet et à son ambition, Ignacio Abel, en faisant appel aux jaunes et aux forces armées, agissant ainsi en contradiction avec son adhésion au syndicat et au PSOE. L’utopie, rêve intellectualisé, se heurte ici au pragmatisme ambitieux et à la réalité économique et sociale. Les miliciens choisissent symboliquement d’organiser le simulacre d’exécution sur les lieux mêmes de ce qu’eux considèrent comme leur exploitation, et qui était la concrétisation des chimères d’Ignacio Abel, la faculté de Philosophie, qui devrait être le règne de la raison, et dont les murs éclaboussés de sang témoignent maintenant de la folle barbarie de la guerre : « Ils le poussèrent contre un mur et il reconnut avec étonnement un des murs latéraux de la faculté de philosophie, les rangées de briques criblées de balles, tachées d’éclaboussures et de filets de sang »31. La Cité Universitaire n’est plus un espace autonome isolé et préservé du monde, entièrement consacré au savoir. Sa proximité de Madrid, voulue par ses concepteurs, et la vue sur la Sierra feront sa fragilité : Ignacio Abel voit la cité tout d’abord envahie par les réfugiés, des familles de paysans venus des environs et dont les troupeaux envahissent les futurs terrains de sport : « Leurs troupeaux de chèvres et de brebis paissaient parmi la broussaille des futurs terrains de sport, où l’on trouvait maintenant des cadavres de fusillés, les mains A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 523. « En nosotros no manda nadie. Para nosotros tú no eres nadie. Eres peor que nadie. Los compañeros de la construcción se acuerdan bien de ti. Te faltaba tiempo para contratar esquiroles y para llamar a los guardias de Asalto cada vez que se convocaba una huelga. Ahora vas a pagar ». (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 666). 30 31 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 525. « Lo empujaron contra una pared y reconoció con extrañeza uno de los muros laterales de la Facultad de Filosofía, las hileras de ladrillo picoteadas de disparos, de salpicaduras y chorreones de sangre » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 668). 11 attachées dans le dos avec de la corde, des morceaux de fil de fer ou des lacets de soulier. Les femmes étendaient leur linge aux fenêtres rationnellement alignées des bâtiments encore en construction »32. Vie et mort se côtoient maintenant, sans ordre apparent, dans une improvisation contraire au rêve utopique de la Cité Universitaire ou tout était mathématiquement programmé. La rationalité des files de fenêtres apparaît comme un vestige dérisoire de ce rêve d’ordre. La fiction reprend ici ce qui fut un épisode marquant de la bataille de Madrid et qui est resté dans la mémoire des Espagnols. La proximité de la montagne, la situation de la Cité à l’entrée de la ville, fera de la Cité Universitaire le lieu de combats acharnés. Pablo Campos Calvo‐Sotelo indique qu’en 1939, 40 % de ce qui avait été construit jusqu’en 1936 avait été détruit et dès 1936 les livres des bibliothèques remplaçaient le sable dans les sacs entassés pour protéger les combattants33. C’est bien à cette destruction d’une cité universitaire idéale et d’un projet d’avenir qu’assiste l’architecte Ignacio Abel qui, a posteriori, considère ce chantier comme un mirage, reflet de l’aveuglement des intellectuels de la République : « Peut‐être n’y a‐t‐il jamais eu le temps ; jamais n’a existé la possibilité véritable d’éviter le désastre ; l’avenir qui semblait s’ouvrir devant nous en 31 était un mirage aussi insensé que notre illusion de rationalité »34. La première personne du pluriel présente dans le complément « devant nous » indique qu’à la jouissance individuelle de l’architecte ambitieux succède maintenant l’insertion dans une collectivité, celle des intellectuels qui se sont égarés en croyant à l’avenir de l’Espagne. C’est aussi une façon pour Ignacio Abel de refuser une responsabilité personnelle dans ce fiasco auquel il assiste impuissant. Ignacio Abel, qui croyait profondément à une humanité triomphante, en adéquation avec la vision de son propre futur, rejette maintenant la faute sur la barbarie inhérente au genre humain, ce retour à l’animalité que représente la guerre : « Bien des gens qui semblent normaux deviennent des sauvages quand ils voient du sang ou qu’ils le flairent »35, une animalité qui se révèle dans cette A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 552‐553. « Sus rebaños de cabras y ovejas pastaban en las malezas de los futuros campos de deportes, en los que aparecían cadáveres de fusilados, las manos atadas a la espalda con cuerdas o trozos de alambre o cordones de zapatos. Las mujeres tendían la ropa en las hileras racionalistas de ventanas de los edificios sin terminar » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 703). 33 P. Campos Calvo‐Sotelo, 75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid, op. cit., p. 120. 34 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 534. « Nunca hubo tiempo, tal vez ; nunca existió la posibilidad verdadera de eludir el desastre ; el porvenir que parecía abrirse por delante de nosotros el año 31 era un espejismo tan insensato como nuestra ilusión de racionalidad » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p.680). 35 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 712. « Muchas personas parecen normales y se vuelven salvajes cuando ven la sangre y la huelen » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 908) 32 12 facilité à tuer qui ressurgit en temps de guerre : « Tuer une personne désarmée et pacifique est la chose la plus facile du monde. Tu n’imagines pas combien c’est facile. Personne ne le sait avant de l’avoir vu »36. Le projet utopique d’une cité idéale, qui se projette dans un avenir lointain et qui suppose un horizon d’attente, se heurte en 1936 à l’immédiateté de la destruction et de la barbarie. Au rêve d’un univers où tout est harmonieux et programmé s’oppose la guerre comme « un état d’improvisation et de hâte »37. La Cité Universitaire projetait l’Espagne dans un futur lumineux, dans l’utopie d’une Espagne unie, éclairée, à l’avant‐garde de la culture et de la rationalité, la guerre la renvoie au passé dont elle est incapable de se libérer. C’est la conclusion qu’en tire Ignacio Abel : « Il s’était trompé sur tout, mais plus que tout sur lui‐même, sur sa place dans le temps. Passer toute sa vie à penser qu’il appartenait au présent et à l’avenir, et maintenant commencer à comprendre que s’il se sentait si décalé c’était parce que son pays était le passé »38. Si l’utopie est un non‐lieu, la nuit des temps exprimée dans le titre du roman semble renvoyer à une négation de progrès, une absence de progression temporelle, un retour à la barbarie originelle qui annihile toute possibilité de ville utopique. Conclusion À travers le parcours d’Ignacio Abel, sa foi en la réalisation d’une cité idéale, Antonio Muñoz Molina évoque donc ces projets utopiques qui ont porté les espoirs des intellectuels espagnols du début du XXe siècle. Ignacio Abel a une vie intense, soutenue par des aspirations profondes, moteurs de son activité. Le bureau où il dessine devient le reflet de ces projections utopiques que Ramiro de Maeztu exposait en 1928. La Cité Universitaire, cet ilot de culture et de paix, devait permettre, comme d’autres villes utopiques, l’avènement d’un homme nouveau. Nous pouvons penser que le fossé entre la réalité de l’Espagne du début du XXe siècle et la vision du futur que sous‐tendait le projet de la Cité Universitaire faisant déjà de ce projet une utopie irréalisable. Tout l’art de 36 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 701. « Matar a una persona desarmada y pacífica es la cosa más fácil del mundo. Tú no sabes qué fácil. Nadie lo sabe hasta que no lo ha visto » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 894). 37 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 602. « un estado de impremeditación y de prisa » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 767). 38 A. Muñoz Molina, Dans la grande nuit des temps, op. cit., p. 734. « Se había equivocado acerca de todo, pero más que nada sobre sí mismo, sobre su lugar en el tiempo. Toda su vida pensando que pertenecía al presente y al porvenir, y ahora empezaba a comprender que si se sentía tan fuera de lugar era porque su país era el pasado » (A. Muñoz Molina, La noche de los tiempos, op. cit., p. 935). 13 Muñoz Molina est de personnaliser ce projet à travers cet architecte fictif dont l’itinéraire montre toutes les contradictions de cette Espagne qui se veut en mouvement vers un avenir heureux et qui montre un terrible aveuglement face aux tensions naissantes. Le drame que vit Ignacio Abel devient le reflet de l’effondrement total des valeurs au moment de l’explosion de la guerre. Cependant, cette vision est celle d’Ignacio Abel a posteriori, influencée par son sentiment d’échec ; c’est aussi celle d’un narrateur qui apparaît à plusieurs reprises dans la narration et qui se penche sur le passé de l’Espagne, sur sa mémoire personnelle de cette blessure collective que représente la Guerre Civile. Selon Gonzalo Navajas, qui a consacré un ouvrage à l’utopie dans le roman contemporain, la Guerre Civile est maintenant considérée, comme la « destruction et la rupture de la convivialité et du consensus collectif »39. Il se produit alors une vision utopique a posteriori de ce qui a précédé la Guerre Civile. Il voit, par exemple, dans Beatus Ille, le premier roman de Muñoz Molina, une mythification du Front Populaire. Le retour sur l’histoire s’accompagne d’une idéalisation de ce passé, ce qui apparaît dans la vision de la Cité Universitaire, qui garde encore pour les Espagnols une valeur symbolique. Ainsi en 2002, Miguel Angel Baldellou, professeur en architecture, critiquait en ces termes les réformes prévues : « La Cité Universitaire est devenue, dès son inauguration et malgré elle, un symbole fondamental de la défense de Madrid pendant la Guerre Civile. […] Cet idéal universitaire intellectuellement anticonformiste, on veut aujourd’hui le contrôler : l’Utopie perdrait son visage et avec lui son âme »40. Par‐delà les évolutions successives, la Cité Universitaire reste une ville utopique pour beaucoup, image de visions du futur irréalisables mais porteuses d’espoir. Par ailleurs, nous pouvons souligner qu’Ignacio Abel, arrivé à Rhineberg, élabore un nouveau projet utopique, celui d’une vaste bibliothèque universitaire au milieu des bois, intégrée dans le paysage. Ne serait‐ce pas la qualité des architectes de concevoir des projets utopiques pour créer les villes du futur, de même que la littérature a pour fonction de créer des mondes possibles, tous deux se rejoignent alors dans la création de ces horizons d’attente. G. Navajas, La utopía en las narrativas contemporáneas (novela, cine, arquitectura), Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, p. 38, « destrucción y ruptura de la convivencia y el consenso colectivo », (traduction personnelle) 40 P. Campos Calvo‐Sotelo, 75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid, op. cit., p. 175, « La Ciudad Universitaria de Madrid se convirtió, apenas inaugurada, y de modo involuntario, en un símbolo fundamental de la Defensa de Madrid durante la Guerra Civil. […] Aquel ideal universitario, intelectualmente inconformista, hoy se quiere poner bajo control: la Utopía perdería su rostro y con él también su alma » (traduction personnelle). 39 14 Bibliographie MUÑOZ MOLINA, Antonio, La noche de los tiempos, Barcelona, Seix Barral, 2009. MUÑOZ, MOLINA Antonio, Dans la grande nuit des temps, traduit de l’espagnol par Philippe Bataillon, Paris, Éditions du Seuil, 2012. CAMPOS CALVO‐SOTELO, Pablo, 75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid , memoria viva de un «campus» transcendental, Madrid, Editorial Complutense, 2004. EATON, Ruth, Cités idéales : lʹutopisme et lʹenvironnement (non) bâti, Anvers, Fonds Mercator, 2001. ELIAS, Norbert, L’utopie, Paris, La Découverte, 2014. MAEZTU, Ramiro DE, « La Ciudad Universitaria », in Club Español: conferencias pronunciadas por los siguientes señores, Exmo. señor embajador de España, don Ramiro de Maeztu, Dr. Antonio Goicoechea, Sra. María Teresa León de Sebastián, D. Arturo Berenguer Carisomo, Buenos Aires, 1928. MONCAN, Patrice DE, Villes utopiques, villes rêvées, Paris, Éditions du Mécène, 2003. MORE, Thomas, L’utopie, 1516 (disponible sur Internet, http://classiques. uqac.ca/ classiques/More_thomas/l_utopie/utopie_Ed_fr_1842.pdf) NAVAJAS, Gonzalo, La utopía en las narrativas contemporáneas (novela, cine, arquitectura), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. PEREZ, Joseph, Histoire de l’Espagne, Paris, Fayard, 1996 STEBE, Jean‐Marc, Qu’est‐ce qu’une utopie? Paris, Vrin, 2011. TROUSSON, Raymond, Voyage au pays de nulle part : histoire littéraire de la pensée utopique, Bruxelles, éd. De l’Université de Bruxelles, 1979. 15